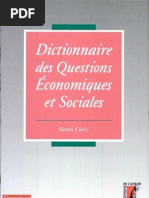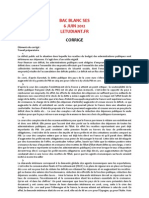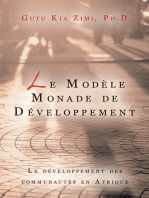Citations SES
Citations SES
Transféré par
odakawoiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Citations SES
Citations SES
Transféré par
odakawoiCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Citations SES
Citations SES
Transféré par
odakawoiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Citations SES
TES1, 2008/2009 S. Dzimira
-1-
ACCUMULATION DU CAPITAL ORGANISATION DU TRAVAIL ET CROISSANCE ECONOMIQUE
-2-
CROISSANCE, CAPITAL ET PROGRES TECHNIQUE. Sources, limites de la croissance conomique
"Des rapports avec la terre bass exclusivement sur l'utilisation de celle-ci en vue de la croissance conomique ne peuvent que mener sa dgradation, en mme temps qu' la dprciation de la vie humaine." Ren Dubos Ren Dubos est un microbiologiste amricain d'origine franaise (1901-1982). En plus d'avoir jou, un rle de premier plan dans la dcouverte des antibiotiques, Ren Dubos aura t, le chercheur qui, au XXe sicle, aura le plus efficacement contribu faire passer l'environnement au premier rang des proccupations humaines. Commentaire. Si on ne cherche qu' exploiter la terre pour produire plus et plus longtemps, on ne peut que la dtruire. Par exemple, si on ne veut que produire plus, sans se soucier des missions de gaz a effets de serre, la terre ne pourra que se dtriorer. Il faudrait donc pouvoir, la fois, produire beaucoup et sur une longue priode, mais aussi et surtout, dans le mme temps prserver les ressources naturelles de la terre. Aurlie Jochel
"La nature de la croissance importe au moins autant que son ampleur". Jean-Marie Harribey Jean-Marie Harribey est un conomiste franais, matre de confrences l'universit MontesquieuBordeaux 4. Il intervient galement l'IEP de Bordeaux dans le cadre de la prparation au CAPES et l'agrgation de sciences conomiques et sociales. Il est galement co-prsident d'Attac France, avec Aurlie Trouv, depuis fin 2006. Commentaire : Il est aussi important d'avoir une croissance leve mais il est galement ncessaire de prserver l'environnement. De plus, la croissance peut tre surestime avec des augmentations du PIB. Par exemple, une entreprise qui rejette ses dchets dans une rivire et entrane la construction d'une usine de traitement des eaux. Dans ce cas, le PIB (et donc la croissance) augmentera, mais les raisons ne seront pas les bonnes. Par ailleurs, il est maintenant possible de produire plus tout en ayant une empreinte cologique rduite. La prise en compte des facteurs environnementaux est donc ncessaire: le type de croissance est aussi important que son niveau. Aurlie Jochel
Durant les annes 1965-2000, il y a une remarquable progression de lenrichissement individuel. Mais cette modernisation de lconomie, loin davoir lev le niveau du bonheur collectif, sest traduit par une monte dramatique de la crise de lhomme P. Saint Marc. Lcologie a secours de la vie, 2003 Philippe Saint Marc, narque et Conseiller la Cour des Comptes, est aussi depuis quarante ans un ardent militant de la cause cologique. Il a publi quelques ouvrages comme : Socialisation de la nature, Progrs ou dclin de l'homme et L'cologie au secours de la vie. Commentaire. Entre 1965 et 2000, c'est--dire durant les 30 glorieuses, la croissance a t trs forte le pays est donc devenu plus riche, ce qui fait que les salaires ont augment et les emplois se sont
-3-
dvelopps, ainsi lenrichissement individuel ou PIB/habitants a augment, sous forme de prestations, avec ltat-Providence, notamment, entranant dans son sillage le niveau de vie des habitants car ceux-ci ayant plus dargent, ils peuvent lamliorer. Ainsi, deux des facteurs du dveloppement sont satisfaits grce la croissance, mais cette modernisation de lconomie a un impact sur la socit en diminuant le bonheur collectif car les hommes se referment sur eux-mmes du la libralisation de lconomie. Laura Baudouin
Les sommes accumules par les pays producteurs de ptrole, dans les annes 1970, nont gure servi leur dveloppement B. Masse-stamberger B. Masse-stamberger est un journaliste de lexpress. Commentaire. Bien quayant fait du profit, les pays producteurs de ptrole ne lont pas utilis dans des secteurs caractrisant le dveloppement comme le niveau de vie intrinsquement li au PIB/habitants ce qui veut dire que les pays nont pas, par exemple, mis en place des prestations sociales qui profiteraient aux habitants qui pourraient ainsi augmenter leur niveau de vie. De plus, cet argent nest pas non plus investi dans des structures ducatives ou hospitalires, ce qui fait que le dveloppement reste bas alors que le pays est riche. Laura Baudouin
-4-
CROISSANCE, CAPITAL ET PROGRES TECHNIQUE. Accumulation du capital, organisation du travail et croissance conomique
"La machine a jusqu'ici cre, directement ou indirectement, beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en a supprims." Alfred Sauvy, Mythologie de notre temps, 1965 Polytechnicien de formation, Alfred Sauvy (1898- 1990) commence son parcours la Statistique Gnrale de la France. Trs vite, il s'aperoit que derrire ses chiffres dorment des vrits, trop souvent ignores des gouvernants. Il s'emploie alors les noncer haut et fort, critiquant notamment l'action du Front populaire. L'objectivit est son but. En 1938, Paul Reynaud l'appelle pour se charger des questions conomiques mais la guerre arrive dj. Sauvy crit alors dans le 'Bulletin Rouge-Brique'. Le conflit pass, De Gaulle le nomme au secrtariat gnral la famille et la population mais l'conomiste prfre se tourner vers la dmographie et prend la direction de l'INED (Institut national d'tudes dmographiques), vritable institution franaise. Ses tudes sur la population tendent prouver que l'augmentation de celle-ci est une bonne chose si la socit sait s'y prparer. Paralllement, il reprsente la France ds 1947 la commission de la statistique des Nations-Unies et est professeur. Grand penseur franais, il crit pour le Monde avant de s'teindre en 1990. Commentaire. Pour Alfred Sauvy, la machine ne tue pas lemploi. Il dresse une thorie de la compensation et du dversement. Selon ce dmographe et conomiste franais, lorsque, dans une branche donne, laugmentation de la productivit engendre par le progrs technique se ralise avec une hausse suprieure de la demande, ce progrs dbouche sur un accroissement du niveau de lemploi. Le progrs technique est dit processif. Dans le cas dune demande qui saccrot moins vite que la productivit induite par linnovation, le progrs technique est dit rcessif, il favorise la substitution capital-travail. Il ne faut donc pas voir dans le progrs technique, les gains de productivit, les machines, des sources du chmage. Il y a seulement des disparitions de postes de travail mais pas ncessairement demploi total. En effet, il faut des concepteurs et des ralisateurs de ces machines, alors il y a compensation. Armelle Jamet
Lefficacit marginale du capital est le taux descompte qui, appliqu la srie dannuits constitues par les rendements escompts du capital, pendant son existence entire, rend la valeur actuelle des annuits gale au prix doffre du capital J.-M. Keynes, La Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie, 1936. John Maynard Keynes (1883- 1946) est issu d'une famille d'universitaires. Mathmaticien de formation, il se tourne ensuite vers l'tude de l'conomie politique sous la direction d'Alfred Marshall. Devenu fonctionnaire l'India Office, il travaille paralllement une tude sur la thorie des probabilits. Keynes enchane les emplois comme lecteur d'conomie politique en 1908, rdacteur en chef de l'Economic Journal et conseiller du gouvernement britannique. Dans son uvre principal, 'Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de la monnaie' (1936), Keynes s'oppose aux classiques et prconise une politique de relance par la demande puisque le march ne peut s'autorguler. De plus, il inscrit son analyse au niveau macroconomique et raisonne en termes d'emploi, de revenu, de dpenses, d'investissement et d'pargne. C'est l'un des conomistes les plus connus, il a donn son nom tout un courant de pense conomique ainsi qu'aux politiques conomiques qui s'inspirent de ses thories.
-5-
Commentaire :Chez Keynes, la dcision dinvestir de lentrepreneur dcoule de la comparaison entre lefficacit marginale de linvestissement et le taux dintrt pratiqu sur le march des capitaux. Si lentreprise se connat le cot de linvestissement, elle ne peut quanticiper ce quil va rapporter (demain limage daujourdhui) ; cest le rendement escompt ou encore, lefficacit marginale du capital. Armelle Jamet
Je vois des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivit. Robert Solow, Wed better watch out, New York Times - July 12, 1987, p.36 N Brooklyn, New York aux tats-Unis, Robert Solow servit l'arme de terre amricaine entre 1942 et 1945. Il obtint un doctorat en conomie l'universit d'Harvard. Wassily Leontief fut un de ses professeurs. Solow a dfendu lide que lconomie ne peut tre spare du social: c'est ce que montre le modle de Solow, qui est frquemment utilis dans l'tude de l'origine de la croissance conomique. Il a d'ailleurs t le conseiller de John Fitzgerald Kennedy. En 1987, il a reu le Prix Nobel d'conomie pour son travail sur la thorie de la croissance. Il a galement reu la National Medal of Science aux tats-Unis en 1999. Robert Solow est actuellement professeur mrite au dpartement conomique du MIT, il a prcdemment enseign l'Universit Columbia. Il est Docteur Honoris Causa du Conservatoire National des Arts et Mtiers. Commentaire. Pour les innovations de procd, les gains de productivit peuvent se faire sentir aprs une priode dadaptation la mise en uvre des nouveaux outils. Cest ce qui expliquerait que jusqu une priode rcente, leffet des technologies de linformation et de la communication ntait pas toujours visible directement sur la croissance. Cest ce qui expliquerait le paradoxe de la productivit de Robert Solow. Armelle Jamet.
Le client nest pas la source de linnovation. Joseph Schumpeter Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) entre en 1901 la facult de droit de Vienne ou il se passionne pour lconomie. Il crira ds lors de nombreux ouvrages sur sa thorie qui postule que lconomie entire repose sur le progrs technique et linnovation qui sont limpulsion du changement perptuel de lactivit conomique. Commentaire. Selon Schumpeter cest lentrepreneur qui est la source de linnovation. En effet, selon lui, cest lentrepreneur qui prend le pari plus ou moins risqu dinnover. Cette thorie est explique dans son ouvrage Thorie de lvolution conomique (1913). Pour lui lentrepreneur est une sorte daventurier qui cherche inventer de nouvelles choses sans craintes de bousculer le conformisme, les murs de son poque. Enfin Schumpeter nous dit que si lentrepreneur est en parti motiv par le bnfice quengendrera son invention, innovation => monopole (temporaire ou pas) => augmentation des bnfices, il serait aussi motiv a innover par une recherche dune forme de gloire , de satisfaction de crer ou encore de got du risque William Roze
-6-
Entreprendre consiste changer un ordre existant Joseph Schumpeter Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) entre en 1901 la facult de droit de Vienne ou il se passionne pour lconomie. Il crira ds lors de nombreux ouvrages sur sa thorie qui postule que lconomie entire repose sur le progrs technique et linnovation qui sont limpulsion du changement perptuel de lactivit conomique. Commentaire. Toute la thorie de Schumpeter repose sur cette citation. En effet Schumpeter prend comme point de dpart une conomie dite stationnaire ou lquilibre rgne et se perptue. Selon lui linnovation vient bouleverser cet ordre en modifiant lquilibre de lconomie (par exemple le monopole li a un produit nouveau permet de changer lquilibre en augmentant les prix). Et donc selon lui linnovation est vecteur de croissance et de transformations structurelles (innovations de procds, changement de structure de lentreprise). Enfin Schumpeter nous dit que cette logique peut sinscrire dans des cycles plus ou moins long mettant en vidence une destruction cratrice c'est--dire des phases de rcession et des phases de croissances lies aux changement quoccasionne linnovation (obsolescence). William Roze
-7-
TRAVAIL ET EMPLOI. Organisation du travail et croissance
Cest les consommateurs qui demandent la flexibilit du travail. En voulant des pizzas tout heure et en changeant doprateurs de tlphone toutes les 5 minutes, ils poussent la flexibilit du travail. Alors avant de critiquer les uns et les autres, balayons aussi devant notre porte. Olivier Pastr dans sa chronique du 27 fvrier 2007, sur France Culture. Olivier Pastr est un conomiste franais (1950-?). Il est actuellement Professeur d'conomie l'Universit de Paris VIII, prsident de la banque IM Bank (Tunis), et membre du Cercle des conomistes. Son exprience professionnelle couvre un large spectre de responsabilits, en France et l'tranger (particulirement au Maghreb) : outre les fonctions scientifiques lies son statut universitaire, il a exerc des fonctions managriales entre la France et le Maghreb en tant que Directeur Gnral de GP Banque (rebaptise SBFI depuis 1999) jusqu'en 2002, des responsabilits ditoriales (il a notamment cr la collection Repres, aux ditions La Dcouverte), et des missions d'tude et de conseil pour des structures publiques et prives. Jusqu'en juin 2007, il dlivrait chaque matin 7h15 sur France Culture une courte chronique conomique, souvent sous forme d'une analyse d'un sujet d'actualit suivie de recommandations, et marque par le souci d'un quilibre entre les dimensions conomique et sociale du problme trait. Commentaire : Selon Olivier Pastr, l'exigence actuelle de la socit franaise face un potentiel de consommation trs grand est presque ridicule; Ainsi, en commandant une pizza en pleine nuit, on oblige l'entreprise qui vend les pizzas laisser un chauffeur et un cuisinier en place toutes les nuits (afin de satisfaire le client), ce qui donne lieu une augmentation de la flexibilit interne par une mise en place de sous-traitance ou d'emplois temps partiel. L'exemple du livreur de pizza nous montre bien que tout type de flexibilit, aussi nfaste soit-elle, n'est pas provoqu par le producteur mais bien par la demande du consommateur. Fabrice Gelin
Limmigration et la dlocalisation sont les deux mamelles de la France moderne. Dun ct, les pauvres arrivent, de lautre, les riches sen vont. . Citation de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard (1929-?) est un journaliste, humoriste, et prsentateur de mdias public franais. Il fut directeur de la rdaction de France Soir de 1987 2003. Les derniers recueils de Philippe Bouvard vont au-del tant des potins mondains que des gnralits d'hebdomadaire. L'auteur y fait montre d'une observation amuse des petits travers de ses contemporains (et d'ailleurs des siens propres) tout en gardant en filigrane la brivet de la vie. Il fait sienne cette autre remarque : Ne prenez pas le monde trop au srieux : vous n'en sortirez pas vivant. La possibilit qu'il se prsente l'Acadmie franaise a t srieusement envisage. Commentaire. Philippe Bouvard travers cette phrase tendance humoristique met en vidence un grand fait d'actualit de la socit franaise quand la flexibilit du travail, aussi bien interne que externe. Les dlocalisations font en effet bien partie de la flexibilit externe ; ainsi, les "riches", c'est dire les grandes FTN s'implantent l'tranger et tendent ainsi rduire la cration de richesses franaise. D'un autre cot des immigrants en qute d'argent et de bien-tre se retrouvent sous-traits dans les quelques usines franaises restants, ou dans d'autres secteurs d'activits tout autant pauvres. Il
-8-
met donc en avant un des grands problmes de gestion des entreprises actuelles, savoir la flexibilit. Fabrice Gelin
La limite idale vers laquelle tend la nouvelle organisation du travail est celle o le travail se bornerait cette seule forme de l'action : l'initiative. Jean Fourasti, Le grand espoir du XXe sicle. Jean Fourasti (1907-1990) est un sociologue et un conomiste franais. Il a crit entre autres Machinisme et bien tre (1951) et les Trentes Glorieuses (1979). Commentaire ? Paul Jeannin
C'est l'homme tout entier qui est conditionn au comportement productif par l'organisation du travail, et hors de l'usine il garde la mme peau et la mme tte. Dpersonnalis au travail, il demeurera dpersonnalis chez lui. Christophe Dejours, Travail usure mentale. Christophe Dejours est un psychiatre et psychanalyste franais, fondateur de la psychodynamique du travail. Ses thmes de prdilection sont l'cart entre le travail prescrit et rel, les mcanismes de dfense contre la souffrance, la souffrance thique ou bien encore la reconnaissance du travail et du travailleur. Il est aussi professeur titulaire de la chaire de psychanalyse-sant-travail au Conservatoire national des arts et mtiers. Il est aussi directeur du laboratoire de psychologie du travail et de l'action. Commentaire. Cette citation se rfre l'alination qui peut tre caus en particulier par le travail la chane de type fordiste, avec pour exemple Charlie Chaplin dans son film Les temps modernes. Paul Jeannin
On a jamais vu de chien faire, de propos dlibr, l'change d'un os avec au autre chien. Adam Smith, La Richesse des nations, 1776 Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et conomiste cossais des Lumires. Il reste dans lhistoire comme le pre de la science conomique moderne, et son uvre principale, la Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libralisme conomique. Professeur de philosophie morale luniversit de Glasgow, il consacre dix annes de sa vie ce texte qui inspire les grands conomistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les classiques et qui poseront les grands principes du libralisme conomique. La plupart des conomistes considrent Smith comme le pre de lconomie politique ; pourtant certains, comme lAutrichien Joseph Schumpeter, lont dfini comme un auteur mineur car son uvre ne comportait que peu dides originales. Commentaire. Selon moi, cette citation illustre la clbre mtaphore de Smith de la main invisible qui tend de rfuter l'ide que les penchant humains ncessitent un ordre politique pour s 'accorder en socit. La fameuse main invisible de l'intrt personnel pousse les individus agir de manire profitable pour l'ensemble de la collectivit sans mme qu'ils n'en soient conscient. La division du travail n'est pas la consquence des motivations altruistes des agents au sens ou chacun agirait pour le bien de la socit toute entire. Neil Letaifa
-9-
l'ouvrier Michael Johnson Shartle : On ne vous demande pas de penser ; il y a des gens pays pour cela, alors mets-toi au travail. Frederick Winslow Taylor Frederick Winslow Taylor (20 mars 1856, Germantown (Pennsylvanie) - 21 mars 1915, Philadelphie (Pennsylvanie)) tait un ingnieur amricain qui a mis en application l'organisation scientifique du travail, qui est la base de la rvolution industrielle du XXe sicle. Ses travaux de recherche ont conduit au dveloppement du travail la chane, la parcellisation des tches, en transformant les ouvriers et les employs ne devenir que de simples machines de guerre dans d'immenses entreprises mcanises. Pour Taylor, le rle de l'encadrement consiste indiquer aux employs la meilleure manire de raliser une tche, de leur fournir les outils et formations appropris, et de leur dlivrer des objectifs et incitations en vue d'atteindre la performance. Selon ses dtracteurs, il a introduit dans le monde du travail une sparation radicale entre ceux qui conoivent et ceux qui produisent. Pour Taylor, louvrier nest pas l pour penser, mais pour excuter des gestes savamment calculs pour lui. Il est encourag tre performant par un systme de primes. Tout travail intellectuel doit tre limin de latelier pour tre concentr dans les bureaux de planification et dorganisation de lentreprise. Commentaire. Cette situation illustre l'alination des individus par le processus de production que va dvelopper Taylor a travers le taylorisme. Les individus deviennent trangers a leurs travail, ils sont simplement astreints a un travail rptitif et non plus aucun droit de regard sur la manire dont ils doivent produire. Cette situation traduit aussi les raisons qui vont dboucher peu de temps aprs a la remise en question du taylorisme du a une organisation du travail trop rigide. Neil Letaifa
- 10 -
TRAVAIL ET EMPLOI. Croissance, progrs technique et emploi.
Le progrs technique modifie la structure des emplois . Arnaud Parienty, Progrs technique et emploi, (2004) Arnaud Parienty est professeur agrg de sciences conomiques et sociales au lyce de Courbevoie (92). Auteur d'ouvrages sur la fiscalit (Le monde - Marabout), la productivit (Armand Colin) et la protection sociale (Gallimard - Le monde), il a particip de nombreux manuels scolaires et universitaires aux ditions Nathan et collabore rgulirement Alternatives Economiques. Il a galement t membre, en tant que reprsentant de la FSU, du Conseil d'orientation des retraites et du groupe "prospective des mtiers et des qualifications" du Conseil d'analyse stratgique. Commentaire. Le progrs technique cre des emplois comme il peut en dtruire. Les chmeurs doivent alors s'adapter aux changements des besoins des employeurs. L'ajustement entre les qualifications demandes par les nouveaux et celles que possdent les chmeurs, est longue, coteuse et surtout difficile. C'est ainsi que la nature des emplois ne cesse de se modifier. Morgane Lorrain
Ce processus de destruction cratrice constitue la donne fondamentale du capitalisme Joseph Alos Schumpeter, Capitalisme, socialisme et dmocratie, Payot, 1990 Joseph Alos Schumpeter (Moravie, Empire Austro-Hongrois ; 8 fvrier 1883 Salisbury Connecticut, 8janvier 1950) est un conomiste du XX sicle, connu pour ses thories sur les fluctuations conomiques, la destruction cratrice et l'innovation. En 1901, il s'engage dans des tudes de droit et d'conomie. Il devient professeur d'universit, d'abord en Europe puis en Amrique du Nord, Harvard, et ce jusqu' sa mort. Au cours de sa carrire europenne, il a dirig, avec Max Weber, la revue Archive pour les sciences sociales. Commentaire. Le capitalisme est un type (ou une mthode) de transformation conomique. La maintenance en mouvement de celui-ci est due aux nouveaux objets de consommation, aux nouvelles mthodes de production et de transport, aux nouveaux types d'organisation industrielle. Ce processus dtruit des lments vieillis en crant continuellement des lments neufs. Morgane Lorrain
Le rle de l'entrepreneur consiste rformer o rvolutionner la routine de production en exploitant une invention ou plus gnralement, une possibilit technique indite. (...) C'est ce genre d'activits que l'on doit primordialement attribuer la responsabilit des "prosprits" rcurrentes qui rvolutionnent l'organisme conomique, ainsi que des "rcessions" non moins rcurrentes qui tiennent au dsquilibre caus par le choc des mthodes ou produits nouveaux . Schumpeter Joseph Alos Schumpeter (Moravie, Empire Austro-Hongrois ; 8 fvrier 1883 Salisbury Connecticut, 8janvier 1950) est un conomiste du XX sicle, connu pour ses thories sur les fluctuations conomiques, la destruction cratrice et l'innovation. En 1901, il s'engage dans des tudes de droit et d'conomie. Il devient professeur d'universit, d'abord en Europe puis en Amrique du
- 11 -
Nord, Harvard, et ce jusqu' sa mort. Au cours de sa carrire europenne, il a dirig, avec Max Weber, la revue Archive pour les sciences sociales. Commentaire. Pour Schumpeter le rle du progrs technique dans la croissance est primordial : les innovations sont destructrices dactivit (certaine production sont stoppes cause de leur caractre obsolte) et cratrices dactivits (nouvelle productions plus performante, qui permettent daugmenter la productivit). Ce principe est appel destruction cratrice et est lorigine du caractre cyclique de lconomie. Hermine Lamiot.
Lre de lordinateur est arrive partout sauf dans les statistiques . Robert Solow R. Solow, (prix Nobel dconomie en 1987) a mit une thorie sur les raison de la croissance : linvestissement cote plus cher quil ne rapporte puisque les rendements marginaux du capital sont jugs dcroissants. Cependant il constate une faille dans son analyse : le PIB par tte continu daugmenter au lieu de rgresser, cest cette inexactitude statistique quil constate dans la citation cidessus. Il en conclut quil existe un troisime facteur de croissance en plus du travail et du capital, ce facteur tant le progrs technique. Hermine Lamiot.
- 12 -
INEGALITES, CONFLITS ET COHESION SOCIALE : LA DYNAMIQUE SOCIALE
- 13 -
STRATIFICATION SOCIALE ET INEGALITES. La dynamique de la stratification sociale
"La stagnation des salaires et la progression des revenus financiers fait de l'accs au patrimoine un enjeux stratgique, mais parfaitement ingalitaire et, en outre, alatoire". Louis Chauvel, "Le retour des classes sociales", Revue de l'OFCE n79, octobre 2001. Louis Chauvel, n le 2 novembre 1967, est un sociologue franais, professeur des universits lInstitut dtudes politiques de Paris, spcialis dans lanalyse des structures sociales et du changement par gnration. Il dveloppe une lecture compare des formes de stratification sociale et les changements de l'tat-Providence dans le cadre de ses recherches l'Observatoire franais des conjonctures conomiques et l'Observatoire sociologique du Changement. Commentaire : Nous sommes dans une situation o les salaires stagnent et le patrimoine prend de plus en plus de valeur. Comme les salaires stagnent, la solution pour augmenter son revenu est d'augmenter son capital, savoir son patrimoine. Ce dernier est donc une source de revenus financiers, donc un enjeu stratgique. Les capacits d'acqurir du capital sont ingalitaires, car elles proviennent en partie des revenus. Ces derniers tant ingaux, l'accs au patrimoine est ingalitaire : tout le monde n'a pas les mme chance d'acqurir du capital. Enfin, le patrimoine peut dpendre d'un hritage. Il est donc alatoire. Charlotte Marti.
"Approximation sans doute que de placer dans le mme bloc ouvriers et employs". Robert Castel, La mtamorphose de la question sociale, Fayard, 1995. Agrg de philosophie en 1959, Robert Castel est Matre assistant de philosophie la Facult des lettres de Lille jusquen 1967. Docteur dtat des lettres et Sciences humaines en 1980, il enseigne la sociologie la Sorbonne, Vincennes, puis Paris VIII. Directeur dtudes lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales depuis 1990, il dirige le Centre dtude des Mouvements Sociaux jusquen 1999. Aprs une srie de travaux sur la sociologie de la psychiatrie, de la psychanalyse et de la culture psychologique, ses recherches portent depuis les annes 80 sur les interventions sociales, la protection sociale, les transformations des politiques sociales du travail et de lemploi. Commentaire : Depuis une cinquantaine d'annes, on a constat des volutions de la socit (salarisation croissante, tertiarisation, augmentation des qualifications) qui poussent certains auteur soutenir la thse de la moyennisation (Ide selon laquelle on assiste une attnuation des clivages sociaux accompagne d'un gonflement des couches sociales intermdiaires ou "moyennes"). Pour Castel, certes les ouvriers et employs diffrent par certains aspects, mais leurs conditions de vie et de travail se rapprochent : la classe ouvrire compte de plus en plus d'employs, les employs des grands magasins ou des bureaux d'entreprises subissent des contraintes proches de celles des ouvriers et leurs salaires tendent se rapprocher. Pour lui, on peut parler d'un "bloc populaire" compos d'ouvriers et d'employs, mais il faut nuancer ce propos. Charlotte Marti.
- 14 -
Dans les socits industrielles, la relation entre niveau d'instruction et mobilit est normalement faible. Raymond Boudon, L'ingalit des chances (1973) Raymond Boudon (1934, -) est l'un des sociologues franais contemporains, avec Pierre Bourdieu, Edgar Morin, Alain Touraine, notamment, ayant une notorit internationale. N Paris en 1934 dans une famille bourgeoise de culture classique, Raymond Boudon fait ses tudes secondaires dans les meilleurs lyces, Condorcet et Louis le Grand, puis il intgre l'Ecole Normale Suprieure et passe, en 1958, l'agrgation de philosophie. Entr au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) en 1962 il est nomm matre de confrences Bordeaux en 1963. Il sjourne pendant l'anne universitaire 1964-1965 Harvard. Il soutient sa thse en 1967 et est nomm professeur la Sorbonne. Commentaire. Boudon affirme ici que dans nos socits, un taux dinstruction lev nentraine pas forcment une mobilit (la mobilit sociale est la circulation des individus entre diffrentes positions sociales) et gnralement une mobilit ascendante (la mobilit ascendante est un changement de position sociale soit vers le haut de la hirarchie sociale (mobilit verticale ou promotion sociale).Ce concept rejoint nettement ce que Boudon appelle le paradoxe dAnderson qui dmontre quun fils ayant un diplme suprieur son pre aura 67% de chances davoir une position sociale au plus gale celle de son pre. En effet, chacun trouve logique davoir le meilleur diplme possible, mais de ce fait, le nombre de diplms augmentant, les diplmes ont perdu leur valeur. Christopher Morron
Les espces de capital, la faon des atouts dans un jeu, sont des pouvoirs qui dfinissent les chances de profit dans un champ dtermin . Pierre Bourdieu, Espace social et gense des classes (1984) Reconnu internationalement comme l'un des matres de la sociologie contemporaine, Pierre Bourdieu (1930-2002) a t l'un des rares intellectuels humanistes engags de la fin du XXe sicle. Excellent lve, il est reu l'cole normale suprieure de la rue d'Ulm o il obtient l'agrgation de philosophie. De 1958 1960, il chappe au service militaire en Algrie et enseigne la philosophie la Facult des Lettres d'Alger. C'est l qu'il dcide de faire une carrire de sociologie et ralise diffrents travaux d'ethnologie. En 1964, Pierre Bourdieu devient directeur d'tudes l'Ecole des hautes tudes en sciences sociales. Il se fait connatre en fondant la revue Actes de la recherche en sciences sociales et est nomm professeur au Collge de France en 1981. Commentaire. A travers cette citation, Pierre Bourdieu rappelle sa position sur lanalyse des ingalits : Selon lui la dotation des individus en capital conomique (revenus et patrimoines sous ses diffrentes modalits), social (rseau de relation) ou culturel (ensemble des ressources culturelles) est discriminante. Ainsi, on peut comprendre la citation dans ce sens : une forte dotation en quelque capital que ce soit assure la personne une russite proportionnelle. Ainsi, l'individu se situera dans l'espace social en fonction de la somme de ces trois formes de capital dont il dispose. Christopher Morron
- 15 -
STRATIFICATION SOCIALE ET INEGALITES. Les enjeux et dterminants de la mobilit sociale
"La reproduction des ingalits sociales par l'cole vient de la mise en uvre d'un galitarisme formel, savoir que l'cole traite comme "gaux en droits" des individus "ingaux en fait" c'est--dire ingalement prpars par leur culture familiale assimiler un message pdagogique." Pierre Bourdieu - 1930-2002 - La reproduction 1966 N dans le Barn, Pierre Bourdieu (1930-2002) est le fils d'un facteur qui deviendra directeur de bureau de poste. Excellent lve, il est reu l'cole normale suprieure o il obtient l'agrgation de philosophie. De 1958 1960, il chappe au service militaire en Algrie et enseigne la philosophie la Facult des Lettres d'Alger. En 1964, Pierre Bourdieu devient directeur d'tudes l'Ecole des hautes tudes en sciences sociales et est nomm professeur au Collge de France en 1981. Luvre sociologique de Pierre Bourdieu est domine par une analyse des mcanismes de reproduction des hirarchies sociales. Il met en vidence l'importance des facteurs culturels et symboliques dans les actes de la vie sociale. Reconnu internationalement comme l'un des matres de la sociologie contemporaine, Pierre Bourdieu a t l'un des rares intellectuels humanistes engags de la fin du XXe sicle. Commentaire : Pierre Bourdieu critique ici le systme mritocratique sur lequel le systme scolaire est fond : en effet, thoriquement, lcole rpond au principe dgalit des chances puisquelle permet chacun de concourir dans une mme comptition, sans que les ingalits de fortune ou de naissance ninterviennent dans les chances de russite scolaire. Mais il explique que ce systme nest pas le bon, puisque pour lui, les lves ne sont pas gaux face au systme scolaire, car les familles transmettent leurs enfants non seulement un capital conomique (patrimoine cd par donation ou hritage) mais aussi un capital culturel (matrise de la langue, de la syntaxe, du vocabulaire, tournures desprit, got pour la culture savante), et les exercices proposs par lcole valorisent ceux qui dtiennent ce capital culturel. Ceci explique donc que les enfants issus de milieux favoriss, dots dun fort capital culturel, aient une meilleure russite scolaire, soient plus diplms et finissent par obtenir des positions sociales suprieures celles des enfants issus de milieux sociaux dfavoriss. Maryam Ramassamy
" La survie d'un individu dans le systme scolaire lui-mme ou dans une filire particulire du systme scolaire, dpend d'un processus de dcision dont les paramtres sont des fonctions de la position sociale ou position de classe. De par leur position, les individus ou les familles ont une estimation diffrente des cots, risques et bnfices anticips qui s'attachent une dcision." Raymond Boudon - L'ingalit des chances (1973) Elev au sein d'une famille bourgeoise, Raymond Boudon (1934 ; -) accde aux lyces les plus cots avant d'entrer l'Ecole normale suprieure. Agrg de philosophie, il fait un sjour l'universit de Columbia New York grce une recommandation de Raymond Aron. Raymond Boudon rejoint le CNRS et devient professeur l'universit de Bordeaux en 1963. Le jeune matre de confrence s'envole de nouveau vers les Etats-Unis et passe une anne Harvard. Trs influenc par la sociologie d'outre-Atlantique, il prend le chemin des mthodes quantitatives. Aprs la soutenance de sa thse intitule L' Analyse mathmatique des faits sociaux en 1967, il devient enseignant la Sorbonne. Fervent dfenseur de l'individualisme mthodologique, Raymond Boudon installe et prennise le courant en France. Libral dans son analyse du monde social, il envisage la rationalit au cur des
- 16 -
relations et des dcisions de chacun. Son idologie se heurte ainsi celle des socialistes et ses ides sont souvent en opposition avec celles de Pierre Bourdieu. Raymond Boudon est l'un des sociologues franais contemporains les plus influents et jouit d'une reconnaissance internationale. Commentaire : Raymond Boudon ne nie pas que les enfants issus de milieux sociaux dfavoriss puissent souffrir dun handicap linguistique et culturel. Mais ce nest pas l, selon lui, lexplication essentielle. Celle ci est rechercher, pour lui, dans la rationalit de ces enfants et de leurs familles : les milieux favoriss auront ainsi plus de motivation et dambition que les milieux dfavoriss qui sont emprunt au fatalisme. Les fils et filles de milieux aiss seront donc encourags suivre de longues tudes afin de maximiser leurs chances de russite dans leur vie professionnelle, tandis que les enfants issus de milieux populaires sont dfavoriss vis--vis de lcole, car les parents financent surtout des tudes permettant de rentrer rapidement dans la vie active, ceci afin de sassurer une rmunration dans les meilleurs dlais. Maryam Ramassamy
La reproduction des ingalits sociales par l'cole vient de la mise en uvre d'un galitarisme formel, savoir que l'cole traite comme "gaux en droits" des individus "ingaux en fait" c'est--dire ingalement prpars par leur culture familiale assimiler un message pdagogique. Pierre Bourdieu, La reproduction, 1970 Sociologue franais (1930-2002), Pierre Bourdieu est devenu la fin de sa vie par son engagement public- lun des principaux acteurs de la vie intellectuelle franaise, reconnu comme lun des matres de la sociologie moderne. Parmi ces uvres, on peut citer Les Hritiers (1964), La Reproduction (1970), La Distinction (1979) ou La Tlvision (1996). Commentaire. Bourdieu remarque que lcole a sa part de responsabilit dans cette ingalit des chances face lcole : le systme ducatif, sous couvert du prtexte dgalit des chances , entrane tout bonnement lexclusion des enfants issus de milieu difficiles (classe populaire-CP). Lcole exerce une violence symbolique, du fait quelle valorise et lgitime une culture savante acquise par les enfants des classes suprieures (CS) essentiellement en-dehors de lcole. Ces hritiers , pour reprendre le titre dun autre ouvrage de Bourdieu, possdent dj une partie des attentes requises, tandis que les enfants des CP partent avec un handicap : ils doivent assimiler ce qui ne fait pas partie de leur capital culturel. Les handicaps ou les avantages lis aux origines familiales ne seffacent pas dans le contexte scolaire, mais tendent plutt se renforcer ; en ce sens o lcole lgitime ces ingalits et met ainsi en place un vritable systme de dominance. Maximes Rollin.
Une fois les fonctions naturelles de l'cole affirms, l'on peut alors renforcer la dpendance du devenir scolaire par rapport aux performances et, ainsi, attnuer les effets ingalitaires des aspirations des familles Raymond Boudon, cole et socit. Les paradoxes de la dmocratie N en 1934, ancien lve de lEcole normale suprieure, Raymond Boudon est agrg de philosophie en 1958. Il commence sa carrire denseignant comme matre de confrences la facult des lettres de Bordeaux en 1964. Nomm la Sorbonne en 1967, il est actuellement professeur la Sorbonne. Il a t directeur du Centre dEtudes Sociologique puis du Groupe dtudes des mthodes de lanalyse sociologique. Commentaire. Boudon, quant lui, explique que si la mobilit sociale nest pas aussi importante, cest que les phnomnes collectifs sont toujours rductibles lintrt individuel.
- 17 -
Dans le cadre des parents de CS, ceux-ci sont davantage motivs pour assurer leurs enfants une situation comparable la leur, et cette fin il dispose galement de moyens suprieurs : cest ainsi quils vont lutter contre une ventuelle dchance sociale de leurs enfants. Ils veillent la leur viter toute mobilit sociale descendante. Les parents des CP, quant eux, sont beaucoup moins motivs assurer ce type de position leurs enfants, quils considrent comme un luxe. Ils jugent assez vite que la mobilit ascendante nen vaut pas la peine, et ils favorisent en ce sens les emplois le plus rapidement rmunrs. Boudon calque donc les aspirations des familles sur un calcul cot/risque/avantage effectu par chaque famille. Maximes Rollin.
- 18 -
STRATIFICATION SOCIALE ET INEGALITES. Idal dmocratique et ingalits
Pourquoi la rgle qui est applicable un homme ne serait-elle pas galement tous les autres ? Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville (Charles Alexis Henri Clrel de Tocqueville) est n Paris le 29 juillet 1805 une famille de noble ultra-royaliste. Il frquenta le collge de Metz. De 1820 1826, il fit ses tudes de droit et fut nomm juge auditeur Versailles en 1827. Puis il dcida d'aller tudier le systme carcral amricain, modle possible pour remplacer le vieux systme franais mais, en fait, comme le rvla sa correspondance, il entendit examiner le systme politique. Il obtient en 1835 un prix Montyon pour son livre La Dmocratie en Amrique. Dput en 1839, acadmicien en 1941, il fut galement ministre des Affaires trangres en 1849, puis fut incarcr pendant quelques jours au Coup d'tat de 1851. Il rdigea L' Ancien Rgime et la Rvolution, dont le dbut paratra en 1856. Il y juge la noblesse franaise, qui n'a pas su s'adapter comme l'avait fait la noblesse britannique. En 1857, il voyage en Angleterre pour prparer une suite L'Ancien Rgime et la Rvolution, mais n'a le temps que de rassembler des notes. En octobre 1858, il part avec sa femme pour Cannes o il meurt de la tuberculose. Commentaire. Pour Tocqueville, toute socit volue vers plus dgalit. Cette tendance passe progressivement de lgalit civile cest--dire lgalit devant la loi lgalit politique qui est lgalit des droits dont le droit de vote pour tous. La dmocratie marque cette volution et va supprimer les barrires daccs aux professions et distinctions ce qui va en un sens dune plus grande galit des chances de promotion. Ici, il critique le fait que la dmocratie, malgr ses efforts, cre des ingalits sachant que tout homme est n comme gal autrui daprs la Dclaration des Droits de lHomme. Ainsi quelle que soit la culture, les valeurs, lappartenance religieuse, la carrire professionnelle, le niveau de vie, la loi qui sapplique un individu est la mme pour tous quelle que soit son origine sociale. Charlotte Cavanna
La division des fortunes a diminu la distance qui sparait le pauvre du riche ; mais en se rapprochant, ils semblent avoir trouv des raisons nouvelles de se har Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville (Charles Alexis Henri Clrel de Tocqueville) est n Paris le 29 juillet 1805 une famille de noble ultra-royaliste. Il frquenta le collge de Metz. De 1820 1826, il fit ses tudes de droit et fut nomm juge auditeur Versailles en 1827. Puis il dcida d'aller tudier le systme carcral amricain, modle possible pour remplacer le vieux systme franais mais, en fait, comme le rvla sa correspondance, il entendit examiner le systme politique. Il obtient en 1835 un prix Montyon pour son livre La Dmocratie en Amrique. Dput en 1839, acadmicien en 1941, il fut galement ministre des Affaires trangres en 1849, puis fut incarcr pendant quelques jours au Coup d'tat de 1851. Il rdigea L' Ancien Rgime et la Rvolution, dont le dbut paratra en 1856. Il y juge la noblesse franaise, qui n'a pas su s'adapter comme l'avait fait la noblesse britannique. En 1857, il voyage en Angleterre pour prparer une suite L'Ancien Rgime et la Rvolution, mais n'a le temps que de rassembler des notes. En octobre 1858, il part avec sa femme pour Cannes o il meurt de la tuberculose. Commentaire. Pour Tocqueville, la rduction des ingalits de conditions au lieu d'apaiser les tensions sociales ne fait que les exacerber. Ainsi lorsque la pauvret n'est plus ressentie comme une
- 19 -
fatalit, le pauvre se met regarder avec plus d'envie le riche et ressentir de la rancur pour ne pas avoir autant de fortune que lui : tout ce que l'on te des abus semble mieux dcouvrir ce qu'il en reste et en rend le sentiment plus cuisant : le mal est devenu moindre, il est vrai, mais la sensibilit est plus vive . Ainsi les ingalits crent un sentiment de jalousie entre les citoyens. Charlotte Cavanna
- 20 -
CONFLITS ET MOBILISATION SOCIALE. Mutations du travail et conflits sociaux
"Un syndicaliste doit tre capable , et ce n'est pas facile, de connatre aussi bien le point de vue des salaris que le dossier de l'entreprise." Nicole Notat. Nicole Notat (1947 ; -) ft secrtaire gnrale de la CFDT, mais quitta son poste en 2002 afin de crer une agence de notation thique "VIGEO". Commentaire : Ici Nicole Notat montre les diffrents rles d'un syndicaliste, devant grer conflit entre salaris et employeurs tout en matrisant exactement, le cas posant problme. Coline Salvado
"Si les syndicats regroupaient seulement des intrts matriels similaires, leur influence serait faible ; mais, en associant des mcontentements et des haines , ils acquirent une grande puissance rvolutionnaire" Gustave Le Bon Gustave LE BON : (1841-1931) : Anthropologue, psychologue social, sociologue et scientifique. Commentaire: Ici Gustave LE BON montre que les syndicats de l'poque de l'industrialisation, ont puis leurs force dans le rassemblement entre qute des intrts matriels communs et mcontentement de la population (certainement ouvrire). Coline Salvado
Les grands groupes peuvent rester inorganiss et ne jamais passer l'action mme si un consensus sur les objectifs et les moyens existe. Mancur Olson Comme les groupes relativement petits sont frquemment capables de sorganiser sur la base du volontariat et dagir en conformit avec leurs intrts communs et que les grands groupes ne sont pas dans lensemble en mesure dy parvenir, lissue du combat politique qui oppose les groupes rivaux nest pas symtrique Les groupes les plus petits russissent souvent battre les plus grands qui, dans une dmocratie, seraient naturellement censs lemporter. Mancur Olson
Mancur Olson (22 janvier 1932, Grand Forks, Dakota du Nord - 19 fvrier 1998) est un conomiste et un sociologue amricain. Connu principalement pour ses deux ouvrages La Logique de l'action collective (1966, parution en anglais 1971) et The Rise and Decline of Nations (1982), il est parmi les grands thoriciens du public choice (thorie du choix public) le seul mnager un rle important l'tat. Diplm en sciences conomiques (North Dakota State University) Docteur en sciences conomiques (universit Harvard) Enseignant en sciences conomiques l'universit Princeton puis l'universit du Maryland. Il fonde en 1990 le Center for Institutional Reform and the Informal Sector l'universit du Maryland.
- 21 -
Commentaire. Un petit groupe restera toujours actif car ne pouvant se reposer sur les actions de ses membres, ils devront lutter eux-mmes pour ainsi atteindre les bnfices voulus. Par contre, les membres dun groupe dune taille consquente ne peuvent sorganiser, et si une action est entreprise, beaucoup de personnes bnficieront du travail accompli par une minorit en ayant pay le cot minimum voire chapper ce cot. C'est le phnomne du 'passager clandestin' (en anglais 'free rider'). Plus grand est le groupe et plus cette tendance est importante. Georges Varvitsiotis
- 22 -
CONFLITS ET MOBILISATION SOCIALE. La diversification des objets et des formes de laction collective
Un mouvement social est une action collective organise, par laquelle un acteur de classe lutte pour la direction sociale de lhistoricit dans un ensemble historique concret. Alain Touraine Alain Touraine (Hermanville-sur-Mer, Calvados, 3 aot 1925) est un sociologue franais de l'action sociale et des nouveaux mouvements sociaux. Alain Touraine est docteur s Lettres (1960), agrg d'histoire l'cole normale suprieure. Il est actuellement Directeur d'tudes lEHESS. 1968 : Le mouvement de mai ou le communisme utopique 1974 : La socit invisible 1984 : Le Mouvement ouvrier Commentaire. Selon Touraine, lhistoricit est une rfrence au changement social, l'volution de la socit sur le long terme. Cette dfinition est donc proche de celle Marxienne du mouvement social, car Marx dit que la lutte des classes fait lhistoire. Ici, Touraine dit que le mouvement social entrane du changement social, pas uniquement partir des conditions relles de production. La diffrence majeure entre ces 2 auteurs est que Marx pensait que le travail et les conflits dans le monde du travail taient centraux. En effet, selon Touraine, le mouvement social est la consquence de 3 mouvements comme nous lavons vu dans les documents tudis le 16 mars : principe didentit, principe dopposition, principe de totalit. Franois Nicolle
L'histoire de toute socit jusqu' nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes . Karl Marx, Le Manifeste Du Parti Communiste, 1867 Karl Heinrich Marx, n le 5 mai 1818 Trves en Rhnanie et mort le 14 mars 1883 Londres, tait un activiste politique, philosophe et thoricien allemand, clbre pour sa critique du capitalisme et sa vision de l'histoire comme rsultat de la lutte des classes, l'origine du marxisme. Aprs avoir obtenu son Abitur (baccalaurat en Allemagne), Marx entre l'universit, d'abord Bonn, en octobre 1835, pour y tudier le droit, puis Berlin, partir de mars 1836 o il se consacre davantage l'histoire et la philosophie. Au dbut de 1842, certains bourgeois radicaux de Rhnanie, en contact avec les Hgliens de gauche, crent Cologne un journal d'opposition au gouvernement, la Rheinische Zeitung. Cette lutte des classes, donc des diffrences de classes, de statuts, est lorigine des mouvements sociaux et de laction collective. uvre : Manifeste du Parti communiste (1848), Le Capital (1867) Commentaire. ?
- 23 -
La cohsion sociale est due en grande partie la ncessit pour une socit de se dfendre contre dautres. Henri Bergson Henri Bergson, n le 18 octobre 1859 Paris o il est mort le 4 janvier 1941, est un philosophe franais. Il a publi quatre principaux ouvrages : dabord en 1889, lEssai sur les donnes immdiates de la conscience, ensuite Matire et mmoire en 1896, puis L'volution cratrice en 1907, et enfin Les Deux Sources de la morale et de la religion en 1932. Il a obtenu le prix Nobel de littrature en 1927. Son uvre est tudie dans diffrentes disciplines : cinma, littrature, neuro-psychologie, etc Commentaire. Ce qui amne les individus se rapprocher les uns des autres, de sorte de crer une cohsion sociale et de former une unit, est li aux ventuelles menaces extrieures. Ce qui expliquerait un dclin de la cohsion sociale dans nos socits contemporaines. Charles Rimpot.
Donnez un homme tout ce quil dsire, sur le champ, il lui paratra que ce tout nest pas tout. (Kant) Emmanuel Kant (Immanuel en allemand) est un philosophe allemand, fondateur de l' idalisme transcendantal ). N le 22 avril 1724 Knigsberg, capitale de la Prusse-Orientale, il y est mort le 12 fvrier 1804. L'un des grands penseurs des Lumires, Kant continue exercer, aujourd'hui encore, une influence considrable, tant dans la philosophie analytique, plutt anglo-saxonne, que dans la philosophie continentale. Son uvre, considrable et diverse dans ses intrts, mais centre autour des trois Critiques, la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la facult de juger, fait ainsi l'objet d'appropriation et d'interprtations successives et divergentes Commentaire : Ainsi donc, lhomme nest jamais combl ni parfaitement satisfait, quel que soit ce quil obtienne. Voil donc un point de vue qui expliquerait le nombre constant de mouvements sociaux au fils des annes, malgr tout les progrs sociaux qui en dcoulent. Charles Rimpot.
- 24 -
INTEGRATION ET SOLIDARITE. La cohsion sociale et les instances dintgration
L'intgration, c'est l'exact inverse de l'exclusion Claude Allgre, Extrait d'un Discours au Colloque sur l'Ecole du XXIme sicle, Janvier 1999 Claude Allgre est n le 31 mars 1937 Paris. Cest un gochimiste et homme politique franais. Il a t ministre de lEducation Nationale de 1997 2000. La plus grande part de ses ouvrages ont pour but une vulgarisation scientifique. Il a eu des prises de positions controverses sur le changement climatique et sur le dveloppement durable. Il obtient en 1986, le prix Crafoord, prix trs prestigieux en gologie. Commentaire. Claude Allgre oppose ici deux termes a priori antagoniques : lintgration et lexclusion. Lintgration sociale signifie lintgration des individus dans la socit, cest--dire que les individus occupent une place reconnue dans la socit et quils sont inscrits dans un rseau de relations sociales. Lexclusion est le processus au terme duquel un individu ou un groupe est rejet hors dun ensemble social donn et ne peut plus participer son fonctionnement collectif. Selon Allgre, pour quun individu ne soit pas exclu, il faut donc lintgrer dans un groupe et plus gnralement dans la socit. Cela suppose linculcation dun certain nombre de normes et de valeurs ainsi quun effort de la socit toute entire de la socit pour intgrer les exclus. Ainsi, linculcation de valeurs et de normes se faisant dans linstance rpublicaine quest lcole, le meilleur moyen pour rintgrer les exclus de la socit semble tre le rapprentissage lcole (ou dans une sorte de substitut) de ces normes et valeurs. Raphal Terrenoire
La solidarit n'existe pas : n'existe qu'une coalition d'gosmes. Chacun reste avec les autres pour se sauver soi-mme. Francesco Alberoni, Extrait de Vie publique et vie prive Francesco Alberoni est n le 31 dcembre Borgo Novo Val Tidone en Italie. Il est un sociologue, un journaliste et un professeur en sociologie et en psychologie italien. Il a par ailleurs travaill la Rai, une tlvision italienne. Il sest spcialis dans la sociologie des mouvements et des individus. Son livre principal est Movimento e istituzione (Mouvement et Institution) paru en 1977. Ce livre est lun des ouvrages fondateurs de la sociologie des mouvements. Commentaire. Lapproche dAlberoni de la solidarit est la fois utilitariste thorique et individualiste mthodologique. Tout dabord, Alberoni suppose que les individus ne fonctionnent que par gosme, selon leur propre intrt. Il faut alors que les individus aient quelque chose gagner de cette solidarit, car si ce nest pas le cas, participer la solidarit collective est alors totalement contre-productif . De plus Alberoni suggre que les individus sont totalement libre de participer la solidarit collective, que celle-ci est bien le fruit dindividus isols qui se mettent ensemble plutt que le fruit dun appareil socital aux mcanismes bien plus complexes. Par lexplication individualiste et intresse de la solidarit, Alberoni se place donc dans la filiation intellectuelle de Spencer et Boudon. Il soppose par contre Durkheim pour qui la solidarit mcanique est domine par la conscience collective lintrieur de la socit, socit qui possde une vie propre. Raphal Terrenoire
- 25 -
La ccit aux ingalits sociales condamne et autorise expliquer toutes les ingalits, particulirement en matire de russite scolaire, comme ingalits naturelles, ingalits de dons. Pierre Bourdieu - La reproduction,1966 Pierre Bourdieu est n en 1930 Denguin. tant bonne lve, il poursuit ses tudes l'cole normale suprieure o il obtient l'agrgation de philosophie. En 1964, Pierre Bourdieu devient directeur d'tudes l'cole des hautes tudes en sciences sociales. Il fonde ses travaux sur les concepts de champs (espace social de domination dans la socit), d habitus (manire de penser, dagir), de capitaux (conomique, culturel, social et symbolique). Il est lun des sociologues du XXme sicle les plus renomms. Quelques ouvrages : Les Hritiers (1964), La Reproduction (1970), La Distinction (1979) , Questions de sociologie (1980) Commentaire. Dans cette citation extraite de La reproduction, Pierre Bourdieu expose son point de vue sur les ingalits et condamne le fait du choix dignorer les ingalits, choix qui a pour consquence de les accentuer, et pire, de les lgitimer. En effet, si la socit fait le choix dignorer les ingalits, il ny a alors aucun frein leur expansion et lon assiste une polarisation de la socit : les plus riches senrichissent et les plus pauvres sappauvrissent. Si on ne cherche pas savoir do proviennent les ingalits, indirectement, on les autorise et leur trouve une explication naturelle. Hayek pense que la socit volue delle-mme, par une voie que lon ne peut pas vraiment prvoir, ainsi, les ingalits sont le fruit du hasard et non pas de dcisions. Ici, Bourdieu voque les ingalits dans un domaine qui lui tient cur, lcole. Juliette Le Hnaff
La reproduction des ingalits sociales par l'cole vient de la mise en uvre d'un galitarisme formel, savoir que l'cole traite comme "gaux en droits" des individus "ingaux en fait" c'est--dire ingalement prpars par leur culture familiale assimiler un message pdagogique . Pierre Bourdieu, La reproduction,1966 Pierre Bourdieu est n en 1930 Denguin. tant bonne lve, il poursuit ses tudes l'cole normale suprieure o il obtient l'agrgation de philosophie. En 1964, Pierre Bourdieu devient directeur d'tudes l'cole des hautes tudes en sciences sociales. Il fonde ses travaux sur les concepts de champs (espace social de domination dans la socit), d habitus (manire de penser, dagir), de capitaux (conomique, culturel, social et symbolique). Il est lun des sociologues du XXme sicle les plus renomms. Quelques ouvrages : Les Hritiers (1964), La Reproduction (1970), La Distinction (1979) , Questions de sociologie (1980) Commentaire. Ici, dans cette citation, Bourdieu critique une nouvelle fois les ingalits travers la critique de lgalitarisme quil considre comme formel . En effet, celui-ci est inscrit dans nos lois et nos mentalits, nos valeurs essentielles respecter. L galitarisme est la volont dtablir lgalit qui est une tradition franaise. Mais celle-ci nest pas toujours applicable et cest cela que critique Bourdieu. Lgalit des droits, des chances ou de situation est inaccessible certains, notamment dans le cadre scolaire. Pour Bourdieu, cette volont dgalit ne peut tre efficace que si lindividu est prparer culturellement et socialement. La culture scolaire sacquire par son respect, son loge et son acceptation inconditionnelle. Mais elle nest pas mise en valeur dans toutes les cultures. Ainsi, comment parler dgalit scolaire vraie, prsente, assure pour tous lorsque les individus sont ingaux la base ? Bourdieu prsente ici le dcalage entre la thorie et la ralit. Juliette Le Hnaff
- 26 -
INTEGRATION ET SOLIDARITE. Protection sociale et solidarits collectives
Si l'on peut parler d'une remonte de l'inscurit aujourd'hui, c'est dans une large mesure parce qu'il existe des franges de la population dsormais convaincues qu'elles sont laisses sur le bord du chemin, impuissantes matriser leur avenir dans un monde de plus en plus changeant. Robert Castel - L'inscurit sociale Les "exclus" sont des collections (et non des collectifs) d'individus qui n'ont rien d'autre en commun que de partager un mme manque. Robert Castel - L'inscurit sociale Robert Castel (n en 1933) est un sociologue franais qui travailla dans les annes 1960 avec Pierre Bourdieu, puis se rapproche de Michel Foucault. Il finit par s'intresser l'exclusion, qu'il appelle la dsaffiliation. A partir du dbut des annes 1980, il fait des recherches sur les interventions sociales, la protection sociale, les transformations des politiques sociales et du travail et de lemploi. Commentaire ? Sonia Y
Mme si le rapport l'emploi est devenu de plus en plus problmatique, le travail a conserv sa centralit [...] Mme s'il n'est plus quasi hgmonique, le rapport travailprotections est toujours dterminant. Robert Castel, Linscurit sociale Robert Castel a travaill dans les annes 1960 avec Pierre Bourdieu, puis s'est intress la psychanalyse, en tablissant une sociologie critique de ces questions et en se rapprochant de Michel Foucault, dont il apprcie l'approche gnalogique. Enfin, il s'intresse l'exclusion, ou plutt ce qu'il appelle la dsaffiliation, qui frappe les individus par dfaut . Il veut comprendre comment le salariat, qui fut d'abord une position mprise, s'est petit petit impos comme modle de rfrence et s'est progressivement associ des protections sociales, et la notion de proprit sociale, crant un statut constitutif d'une identit sociale. Commentaire. Dans cet extrait de L'inscurit sociale, Robert Castel montre que la relation travailprotection est toujours dterminant car prs de 90% de la population franaise, est couverte partir du travail, y compris dans les situations de hors travail comme la retraite et, partiellement, le chmage Laure Messiah
Depuis une vingtaine d'annes on a vu se dvelopper ce qui pourrait bien reprsenter un nouveau rgime de la protection sociale en direction des laisss-pour-compte des protections classique . Robert Castel, L'inscurit sociale (Seuil, 2003)
Commentaire. Par cette phrase Robert Castel dsigne toutes les transformations qui ont eu lieux ces dernires annes. Par transformation, on entend donc; la multiplication de minima sociaux (=Prestations d'assistance, gnralement diffrentielles, assurant un niveau de vie minimal diverses catgories de populations), le dveloppement de politiques locales d'insertion et politique de la ville,
- 27 -
de dispositifs d'aide l'emploi, de secours aux plus dmunis et de lutte contre l'exclusion. Ces nouvelles politiques tendent l'individualisation des protections car le monde se trouve de plus en plus diversifi et mobile. Laure Messiah
- 28 -
LES ENJEUX DE LOUVERTURE INTERNATIONALE
- 29 -
INTERNATIONALISATION DES ECHANGES ET MONDIALISATION. Commerce internationale, croissance et dveloppement
La maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui lui cotera moins acheter qu faire . David Ricardo David Ricardo (1772-1823) dcouvre lconomie politique en lisant Adam Smith (1723-1790) et JB Say (1767-1832) Aprs stre intress aux questions montaires, il publie en 1817 ses Principes de lconomie politique et de limpt. Commentaire. Ide de Smith, loi des avantages absolus. Ricardo reprend lanalyse en la compltant. Chaque pays doit se spcialiser la ou il est le meilleur, cest a dire dans les domaines ou il produit des biens a un cot de production infrieur a celui des concurrents. Chaque pays a intrt participer au commerce mondial par le biais de la spcialisation. Pauline Prez.
Il faut laisser faire les hommes et laisser passer les marchandises . Jacques Claude Marie Vincent Jacques Claude Marie Vincent, marquis de Gournay (1712 1759) est un conomiste franais. Commentaire. Dans cette citation il est question de la main invisible d'Adam Smith : laisser faire les hommes laisser passer les marchandises, cest la loi du libralisme. Laisser faire : c'est la libre concurrence. Laisser passer : c'est la libre circulation des marchandises. Pauline Prez.
La protection douanire est notre voie, le libre-change est notre but . Friedrich List, Systme national d'conomie politique, 1840 Economiste allemand, Friedrich List (1789 184) est surtout connu pour ses thories sur le commerce international, opposes celles de SMith et de Ricardo. Il est rest dans l'histoire des ides comme le principal dfenseur du protectionnisme, au nom de l'argument des "industries dans l'enfance". Selon lui, le libre-change a tendance perptuer la domination des nations qui ont su se lancer en premier dans une industrie porteuse. Commentaire. Les changes internationaux favorisent la croissance, d'autre comme F. List prne un protectionnisme tatique (par la mise en place de politiques d'achats publics, de normes, de barrires douanires, de subventions l'export) qui permet d'aider au dveloppement des entreprises nationales du pays concern et ainsi pousser une consommation de produits locaux qui relanceraient l'conomie, mais cette thorie est limite car en ralit elle ne vise pas le bien de tous mais juste des populations des pays qui favorisent le protectionnisme. Enfin, le libre change permet aux pays non producteurs de certaines matires ou pas trs efficace dans un domaine d'avoir des produits moins chers et donc d'inciter la consommation qui engendre la croissance. Nous pouvons donc conclure que :
- 30 -
Le libre change est une thorie sans ralit et le protectionnisme une ralit sans thorie , Bairoch. Bairoch (1930 1999) a commenc sa formation universitaire en 1956 Paris l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Il a obtenu son doctorat en 1963 lUniversit libre de Bruxelles ou il a enseign de 1965 1995. Il fut conseiller conomique au GATT Genve de 1967 1969, professeur l'Universit Sir George Williams (Concordia) Montral de 1969 1971, et directeur d'tudes l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de 1971 1972. En 1972 il fut nomm professeur d'histoire conomique l'universit de Genve ou il enseigna jusqu' sa retraite en 1995. Paul Bairoch s'est particulirement attach remettre en cause certaines ides reues en conomie, notamment celles qui soutiennent qu'il existe un lien entre le libre-change et dveloppement socio-conomique. Oeuvres : Le Tiers-Monde dans l'impasse, Victoires et dboires. Emma Gerin-Jean Commentaire ?
Dans un systme d'entire libert de commerce, chaque pays consacre son capital et son industrie tel emploi qui lui parat le plus utile. Les vues de l'intrt individuel s'accordent parfaitement avec le bien universel de toute la socit. D. Ricardo, Principes de l'conomie politique et de l'impt, 1817 Economiste anglais du dix-neuvime sicle, David Ricardo (n le 18 avril 1972 et mort le 11 septembre 1823) est l'un des conomistes les plus influents de l'cole classique aux cts d'Adam Smith et Thomas Malthus. Il a galement t agent de change et dput. uvres : Essai sur l'influence des bas prix du bl sur les profits du capital (1815) Des principes de l'conomie politique et de l'impt (1817) Commentaire. Pour Ricardo, dans un systme dentire libert de commerce soit un systme fond sur lchange, tous les pays ont intrt se spcialiser dans une activit, le libre change, mme sils ne disposent pas davantage absolu puisque renoncer ses avantages permet de tirer parti davantages plus forts. En dautres termes, chaque pays a intrt se spcialiser dans les produits dont les conditions de productions sont les plus favorables et importer les autres produits. Tous les pays seraient alors mutuellement gagnants do lide que le commerce international, selon Ricardo, profite tous, toutes les socits. De plus, il semblerait que, comme en tmoignent les fortes croissances conomiques des Nouveaux Pays Industrialiss dAsie (NPIA), plus les pays rduisent leurs barrires aux changes, plus le taux de croissance leve. Arnick Singh
Une nation en arrire, par un destin fcheux, sous le rapport de lindustrie, du commerce et de la navigation et qui, par ailleurs, possde les ressources matrielles et morales ncessaires pour son dveloppement, doit, avant tout exercer ses forces afin de se rendre capable de soutenir la lutte avec les pays qui lont devance F. List, Systme national dconomie politique, 1841 Economiste allemand, Friedrich List (n le 6 aot 1789 et mort le 30 novembre 1846 ) est partisan et thoricien du protectionnisme ducateur mais aussi un nationaliste romantique et un des prcurseurs de l'cole historique allemande, via l'influence du saint-simonisme, qui avait dvelopp une thorie des stades conomiques. Son ouvrage le plus connu, Le systme national d'conomie politique
- 31 -
(1841) fut crit contre les doctrines libre-changistes qui se rpandaient dans l'conomie classique et fut la base du nationalisme conomique. Commentaire. A travers cette citation, Friedrich List nous donne une justification du protectionnisme, c'est--dire l'ensemble des mesures visant protger la production nationale contre la concurrence trangre. Selon List, il existe un protectionnisme qui permettrait aux pays en retard de se dvelopper plus rapidement : le protectionnisme ducateur. Il sagit, pour ces pays, de se remettre niveau en protgeant les activits dveloppes sur leur territoire jusqu ce quelles atteignent des volumes de production assez suffisants pour devenir comptitives et donc permettre aux pays en retard de concurrencer, voire de dpasser les pays qui les ont devancs. Arnick Singh
- 32 -
INTERNATIONALISATION DES ECHANGES ET MONDIALISATION. Les stratgies internationales des entreprises
Pourquoi certaines entreprises dlocalisent-elles leur activit ? La rponse semble vidente : en raison des carts en terme du cot du travail, dont elles cherchent tirer profit pour se positionner avantageusement dans la concurrence mondiale dont lintensit est croissante. Olivier Bouba Olga., Les Nouvelles Gographies du capitalisme, 2006, Olivier Bouba-Olga est un conomiste franais n en 1968, matre de confrences la facult de sciences conomiques de Poitiers, chercheur au CRIEF (Centre de recherche en intgration conomique et financire), au laboratoire TEIR (Territoire, industrie, rseaux), Matre de Confrences au Premier Cycle Amrique latine, Espagne, Portugal de Sciences Po Ses recherches portent sur l'conomie de l'entreprise, l'conomie de l'innovation et l'analyse du dveloppement conomique local. Il tient en parallle un blog rgulirement mis jour et participe activement d'autres sites d'actualits et de dbats conomiques. Il a t jusqu'en 2007 le directeur adjoint de la formation professionalisante Master Professionnel Amnagement du Territoire et Dveloppement conomique Local, master dans lequel il enseigne toujours... Commentaire: A travers cette question, Olivier Bouba Olga veut nous expliquer la raison qui motive les FTN (Firmes Transnationales) dlocaliser (dlocalisation : processus de dplacement des activits de production hors de leur lieu pays dimplantation dorigine). Cest dans un souci dconomie, en effet elles cherchent rduire leurs frais, en dlocalisant leur production dans un pays o la main duvre est la moins onreuse possible, o le cot du travail sera le moins lev (cot du travail : C'est l'ensemble des dpenses de l'entreprise lies l'utilisation de la main d'uvre. Le cot du travail comprend donc les salaires bruts verss aux salaris et l'ensemble des cotisations sociales verses par l'employeur (charges sociales). Mais aussi donc dtre le plus comptitifs en ce qui concerne les prix (comptitivit-prix : Comptition entre les entreprises qui porte sur des produits homognes dont la seule variable est le prix.) dans la mesure o le processus de mondialisation samplifie. Thomas Aulib.
Depuis vingt ans, le gouvernement irlandais se concentre sur la cration demplois et propose des avantages fiscaux, des programmes de formation et une politique territoriale pour inciter les multinationales comme Dell installer des usines sur son territoire. Ces trois pays offrent des allgements fiscaux aux firmes trangres, comme tous les gouvernements en qute dinvestissements internationaux. Suzanne Berger, Made in monde, 2006. Suzanne Berger est professeur de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology de Cambridge (Etats-Unis). Elle a notamment publi en franais Notre premire mondialisation. Leons dun chec oubli, Paris, La Rpublique des Ides / Seuil, 2003. Commentaire : Suzanne Berger veut nous dmontrer travers lexemple irlandais que pour amliorer leur comptitivit-prix, les FTN vont aussi chercher avant tout se localiser dans des pays o les taux dimposition sont faibles (le taux dimposition est le montant total prlev sur les agents conomiques (ici les FTN) divis par lassiette fiscale (L'assiette fiscale est le montant auquel s'applique un taux d'imposition ou de taxation. Par exemple, pour l'impt sur le revenu des individus, l'assiette fiscale est la somme des revenus imposables et des bnfices imposables) sur lequel cet impt s'applique.) Et ces
- 33 -
pays proposent ces taux dimposition faibles par ce quils souhaitent crer des emplois. Thomas Aulib.
La mondialisation, de fait, entrane la rgionalisation. d'une interview dans Les Echos - 17 Octobre 2001
Jacques Sgula, Extrait
Docteur en pharmacie, Jacques Sgula devient nanmoins reporter 'Paris Match' puis 'France Soir'. Ce n'est qu' 32 ans qu'il s'essaie en tant que publicitaire. Il s'associe alors avec Bernard Roux, Alain Cayzac et Jean-Michel Goudard afin de crer RSCG, qui fusionne avec Eurocom en 1991. Sa vocation lui vient de son enfance passes Perpignan, berce par la littrature de Cervants. Son credo s'inspire d'ailleurs de l'un de ses aphorismes : 'La jeunesse est une maladie mentale dont on gurit quelques fois avec l'ge', Sgula rajoute 'Ne gurissons jamais'. Cette phrase rsume l'optique publicitaire qui n'est autre que de rveiller l'enfant qui sommeille en chaque consommateur. Avec plus de 1500 campagnes son actif et 15 campagnes prsidentielles, dont celles de Franois Mitterrand et de Lionel Jospin, Sgula marque indubitablement le paysage publicitaire franais. Homme d'affaires incontest, ce 'fils de la pub' officie dans le milieu depuis prs de 35 ans, et pourvoit avec brio son poste de vice-prsident d'Havas. Commentaire : Actuellement, ce terme de rgionalisation est parfois utilis pour dsigner, dans un sens troit purement conomique, la mondialisation lorsquil sagit de louverture des frontires aux changes conomiques. La mondialisation et la rgionalisation se sont dveloppes depuis la fin des annes 80 et durant la dcennie 90 : Union europenne, Mercosur, Alena, Anase, Sadc etc. Mais actuellement, la rgionalisation a pris une nouvelle dimension des relations conomiques internationales et concerne lensemble de grandes rgions du monde : Europe, Amrique du Nord, Amrique Latine, Asie et Afrique avec cette monte de la mondialisation. Dans ce cas, il reprsente plutt l'inverse de la mondialisation lorsquil sous-entend un monde moins connect o l'attention est davantage porte au niveau rgional. Cependant pour quelques observateurs, il est chimrique et sournois de considrer que ces rassemblements rgionaux sont une simple modalit de la mondialisation. En effet, rgionalisation et mondialisation coexistent de manire variable, peuvent sopposer selon les domaines tudis mais aussi tre en interaction. Martin Reyre
Qui ne sait pas lire et vit avec un dollar par jour, ne ressentira jamais les bienfaits de la mondialisation. Jimmy Carter Trente-neuvime homme s'asseoir derrire le bureau ovale, Jimmy Carter - de son vrai nom James Earl Carter - se distingue par son combat perptuel pour les droits de l'homme. En pleine guerre froide, la situation le pousse mettre en place une politique extrieure principalement base sur la volont de pacifier les zones de conflits. Ses actions remportent quelques francs succs : la ratification du trait du canal de Panama, l'accord de paix entre l'Egypte et Isral, la restriction de l'armement de l'Union sovitique et l'ouverture des relations diplomatiques avec la Rpublique populaire de Chine en sont des exemples. Sur le plan national, le chmage et la hausse des prix deviennent les btes noires de Carter. Il uvre alors la stimulation de la production pour lutter contre ces crises. Son gouvernement se penche galement sur les sphres cologique et sociale. Mais les consquences de ces mesures ne sont pas toutes favorables au politicien. Les efforts fournis pour rduire l'inflation aboutissent une priode de rcession et son image est ternie par la prise en otage du personnel de l'ambassade amricaine Thran en 1979. Telle une sanction suite au refuge du leader iranien sur le sol amricain, la captivit dure plus d'une anne et la libration a lieu le jour o le prsident passe la porte de la Maison-Blanche. Malgr ces checs, Jimmy Carter s'impose sur la scne internationale
- 34 -
comme un grand mdiateur et s'implique dans la rsolution des conflits bien aprs le terme de son mandat. Commentaire : La mondialisation est un processus complexe, si complexe que les lites qui la pilotent - si tant est que la mondialisation puisse tre pilote - ne le comprennent pas toujours. Les populations dfavorises dont nous parlons sont encore moins armes pour penser ce mouvement et a fortiori s'inscrire dedans. Seule une poigne d'individus dans les pays mergents tire son pingle du jeu - et plutt bien d'ailleurs. Malheureusement ces russites n'ont gure d'chos favorables sur le bien-tre des populations. Pourtant, rfuter que la globalisation est source de progrs serait mentir. Malgr les injustices qu'elle cre, le principal bienfait de la mondialisation est de favoriser les volutions institutionnelles, culturelles, juridiques, conomiques Ces progrs sont bien l'ordre de mission de grandes organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies et ses satellites (CNUCED, FAO), la Banque Mondiale mais aussi, en quelque sorte, de l'Organisation Mondiale du Commerce. Martin Reyre
- 35 -
INTERNATIONALISATION DES ECHANGES ET MONDIALISATION. Mondialisation, volutions sociales et culturelles et rgulations
Sur la balance de la mondialisation, une tte denfant du tiers-monde pse moins lourd quun hamburger. Fatou Diome, crivain sngalaise, Le Ventre de lAtlantique. Ne dans lle de Niodor, au Sngal, Fatou Diome quitte son pays natal pour poursuivre ses tudes en France. Une exprience difficile dont elle sinspirera pour crire son premier livre, un recueil de nouvelles intitul La Prfrence nationale. Son premier roman, Le Ventre de lAtlantique, crit avec humour et finesse, a remport un succs mrit. Ses uvres sont inspires de sa vie, de son intgration dans son pays dadoption quest la France, son enfance au Sngal et les relations quentretiennent les deux pays. Commentaire. Jai particulirement aim cette citation, car elle illustre bien le triste sort des oublis de la mondialisation. En effet, quil soit zimbabwen ou npalais, un habitant du tiers-monde ne pse pas grand-chose. On peut ainsi voir dans cet extrait de Le Ventre de lAtlantique une critique fort pertinente du travail des enfants dans les pays pauvres, cautionn par les dirigeants de certaines FTN qui voient en ces derniers un simple chiffre statistique, de la main- duvre bon march, et non pas un tre humain. Lappt du gain semble ainsi penser plus lourd que le respect de lindividu. Quentin Duthilleul
La mondialisation nest ni lhorreur ni le bonheur. Jacques Le Goff, dans le Monde de lducation. Passionn par lhistoire ds le lyce, Jacques Le Goff effectue un parcours brillant qui le conduit, via lEcole normale suprieure et lagrgation, lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales. Il est lune des figures majeures de lEcole des Annales et sintresse particulirement la dimension humaine de lhistoire et lvolution des socits. Spcialiste du Moyen ge, il a consacr de nombreux livres cette priode, et notamment Les Intellectuels au Moyen ge (1957). Fervent pdagogue, il dirige depuis 1962 des tudes sur lanthropologie historique de lOccident mdival. Il anime par ailleurs un clbre sminaire lE.H.E.S.S et enseigne luniversit de Rennes. Commentaire. Cette citation mest apparue pertinente, dans la mesure o elle cerne assez bien ce phnomne de globalisation que connaissent nos socits. En effet, la mondialisation, dont lconomie nest quune des facettes, - il est parfois bon de le rappeler sapparente plus une construction, une volution historique qu un modle cre de toute pice par quelque individus. Et comme toute construction historique, la mondialisation est un phnomne neutre, sans prtentions faire le bonheur ou le malheur de ltre humain. Ainsi, lencenser ou la diaboliser outrance semble vain et vide de sens. Par ailleurs, cette citation mapparat complmentaire de la premire, puisquelle montre bien que ce sont les hommes qui doivent tre sanctionns, positivement comme ngativement, pas la mondialisation. Quentin Duthilleul
- 36 -
Lide de crer une exception culturelle vient des pays dont la culture est en dclin, ceux qui ne connaissent pas ce problme nont rien craindre. (..)Lexception culturelle est le refuge des cultures en dclin. Je ne crois pas en lexception culturelle europenne et je ne redoute pas la mondialisation. Jos Maria Aznar Jos Mara Alfredo Aznar Lpez, n le 25 fvrier 1953 Madrid, est un homme politique espagnol, ancien prsident du Parti populaire et prsident du gouvernement durant deux mandats (1996-2000 et 2000-2004) du 5 mai 1996 au 17 avril 2004. Commentaire. Tout d'abord il nous faut expliquer le terme d'exception culturelle. Lexception culturelle franaise est une expression utilise pour caractriser certaines spcificits, actuelles ou passes, de la France par rapport aux autres pays d'Europe, voire du monde, dans le secteur culturel. L'auteur de cette citation essaie de nous faire comprendre que le fait de trop privilgier sa culture est significatif d'une peur de sa disparition. Afin de la faire persister, on l'impose, elle nous fait donc oublier le rle complmentaire et essentiel que les autres cultures peuvent lui apporter. Lon Chatiliez
Ce nest pas le libre-change qui est la loi du plus fort, mais plutt le protectionnisme car seuls les pays riches et puissants ont les moyens de mettre en oeuvre des aides pour protger leurs industries. Jean- Louis Caccomo Jean-Louis Caccomo, n en 1963, est docteur en sciences conomiques, actuellement matre de confrences l'universit de Perpignan - Via Domitia o il est responsable des relations internationales du dpartement Economie & Management , et directeur du Master professionnalis Economiste Financier . Commentaire. Il nous faut dfinir le terme de protectionnisme. Le protectionnisme est une pratique politique selon laquelle l'tat rglemente l'conomie pour protger l'industrie nationale, le commerce national, etc. On qualifie souvent des pratiques isoles de protectionnistes sans que cela engage une politique gnrale. Il est faux d'affirmer que le protectionnisme est pour un pays une faon de s'enrichir tant qu'on n'a pas cherch qui s'enrichit ainsi : ce qui se passe le plus souvent est une redistribution l'intrieur du pays, aux dpens des uns (consommateurs ou contribuables selon les cas) et au bnfice des autres (producteurs). Un produit de bonne qualit, ou offrant un bon rapport qualit/prix, n'a pas besoin de mesures protectionnistes pour se vendre. Le protectionnisme n'est qu'une tentative de changer par la force une situation commerciale dfavorable. Le seul cas o le protectionnisme peut enrichir un pays est celui o un pays est assez puissant pour imposer ses vues aux autres pays et les contraindre acheter ses produits au prix qu'il souhaite. Lon Chatiliez
- 37 -
INTEGRATION EUROPEENNE ET POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES. LUnion europenne et la dynamique de lintgration rgionale
Avec leuro, lEurope se dote dun instrument la mesure de son poids conomique et commercial Benot Ferrandon, LUnion europenne , Les notices de la documentation franaise, 2004 Benot Ferrandon travaille la Documentation franaise. Commentaire : Ici, Benot Ferrandon montre que leuro joue un rle majeur dans la puissance conomique et commerciale mondiale de lUnions europenne. Il est vrai que pour un pays ou un ensemble dse pays (comme lUnion europenne) une monnaie unique renforce le poids commercial et conomique de la zone. Ici leuro contribue renforcer lunit de lUnion Europenne puisquil permet un commerce direct entre lUE et ltranger, et renforce le commerce intra zone qui fait aujourdhui la force conomique de cette espace. De plus une monnaie forte telle que lest euro ne fait quaugment le poids politique de lEurope dans le processus de dcision international. Camille Rives
() llargissement conomique (de lUnion europenne) sans approfondissement social pourrait conduire le projet europen vers de lourdes contradictions. Louis Chauvel, 2005, OFCE Louis Chauvel, n le 2 novembre 1967, est un sociologue franais, professeur des universits lInstitut dtudes politiques de Paris, spcialis dans lanalyse des structures sociales et du changement par gnration. Il dveloppe une lecture compare des formes de stratification sociale et les changements de l'tat providence dans le cadre de ses recherches l'Observatoire franais des conjonctures conomiques et l'Observatoire sociologique du Changement. Commentaire : Dans cette citation Louis Chauvel souligne la ncessit dune politique social commune lEurope en plus dune politique conomique. LEurope a besoin de prparer ses socits aux changements conomiques. Ainsi une politique conomique doit aller de paire avec une politique sociale, afin daider les nouveaux pays de lunion dont le standard de vie est plus faible que celui des pays les plus dvelopps de lUE sintgrer sans tre dpasss (en matire de budget et de savoirfaire) par ces mmes pays. Ainsi pour que les dcisions dordre conomique soient adoptes par tous les pays formant lUnion europenne, il est ncessaire que leurs socits soient elles mme sur un pied dgalit. Camille Rives
- 38 -
INTEGRATION EUROPEENNE ET POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES. Les nouveaux cadres de laction publique
Aux Etats-Unis, on est libral par culture, par choix explicite et interventionniste par empirisme. En Europe, on est libral par contrainte et orthodoxe par choix doctrinal. Outre que cela ne correspond ni notre culture, ni nos traditions, il est temps que lon saperoive, pour en finir avec la croissance molle que cette orthodoxie ne sert pas nos intrts . J.P Fitoussi Jean-Paul Fitoussi est un conomiste franais dorigine tunisienne. Professeur des Universits lInstitut dtude politique de Paris depuis 1982, et prsident de lObservatoire franais des conjonctures conomiques (OFCE) depuis 1989.Il travaille sur les thories de linflation, du chmage, des conomies ouvertes, et sur le rle des politiques macroconomiques. Il est critique au sujet de la rigidit budgtaire et montaire, au motif quelle aurait un effet ngatif sur la croissance et lemploi. Il est membre du Conseil danalyse conomique auprs du Premier ministre. Commentaire. Dans cette citation, Jean-Paul Fitoussi nous explique que le budget europen est dorientation librale. Pour expliquer ce phnomne, il compare le libralisme prsent aux Etats-Unis avec celui prsent en Europe. Il montre en effet que les amricains sont libraux par choix et non par obligation comme les europens. Pour lconomiste franais, le libralisme amricain est une ralit alors quen France, on est libral par pure tradition. Aprs avoir oppos ces deux politiques budgtaires librales, Jean-Paul Fitoussi poursuit son analyse en sappuyant sur la thorie de la croissance endogne qui, face la rcession, prne une intervention rapide de lEtat afin de relancer la croissance, en conjuguant investissements et innovations. Faustine Barbier
Il nest pas possible davoir des politiques divergentes. Je suis convaincu que la coordination des politiques conomiques sera bientt voulue par tous les Etats membres . R. Prodi Romano Prodi est un conomiste et homme politique italien appartenant la coalition du parti de centre-gauche lUnion dont il est devenu le prsident lors de la constitution de la fdration le 26 fvrier 2005. Il est prsident dhonneur du Parti dmocrate europen. Son parti gagne de justesse les lections lgislatives 2006 en Italie, avec une majorit de 63 siges la Chambre et de 2 siges au Snat. Romano Prodi succde ainsi Silvio Berlusconi la prsidence du Conseil le 17 mai 2006. Commentaire. Dans cette citation, Romano Prodi explique quil est impratif que tous les membres de la zone euro sentendent sur la question budgtaire. En effet, aucun mcanisme nest prvu dans le cadre de lUnion Europenne montaire pour rsorber les chocs asymtriques. Les pays de lUnion Europenne confronts un choc asymtrique ne peuvent pas utiliser loutil montaire pour relancer linvestissement et la croissance. En effet selon lui, la seule solution est la mise en place dune seule politique budgtaire commune aux 27 Etats membres, qui permettrait dapporter un soutien lactivit conomique et de faire face aux chocs asymtriques. Cependant, lintervention ventuelle de la BCE connat des limites en raison dun pacte de stabilit de croissance limitant la libert des Etats de mener des politiques budgtaires autonomes, donc leur capacit de rpondre des chocs asymtriques est illusoire. Cette citation montre loptimisme irrel de Prodi, dans la mesure o lEurope connaissait dj des difficults sentendre 15, quen sera-t-il avec une Union Europenne 27 ? Faustine Barbier
- 39 -
(Choc symtrique ou asymtrique : perturbation en provenance de lextrieur qui vient modifier lactivit conomique dun pays ou dun ensemble de pays. Ils peuvent tre montaires, doffre ou de demande. Dans lUE, les chocs symtriques sont ceux qui atteignent lensemble des pays membres, les chocs asymtriques ne concernent quun ou quelques pays membres.)
Les hommes n'acceptent le changement que dans la ncessit et ils ne voient la ncessit que dans la crise Jean Monnet. Jean Monnet est un homme politique franais , il est l'artisan de la victoire des allis pendant la Seconde Guerre mondiale . Il est galement l'un fondateurs de l'Union Europenne, aussi considr comme l'un des pres de l'Europe. Commentaire. Jean Monnet est -comme indiqu au dessus- l'un des pres fondateurs de l'Europe ; une de ses volonts tait de fonder une Europe aux intentions sociales et conomiques. Il concrtisa ce dsir avec l'laboration du plan Schuman, qui a institu la CECA. Jean Monnet explique ici, par le biais de cette citation, quil nest pas ncessaire quune crise ait lieu pour innover, institutionnaliser et oprer des changements importants. Selon Monnet, linstitutionnalisation et la mise en place de grandes politiques ( en loccurrence , la CECA ) a malheureusement tendance se faire en des temps de crise, ou daprs-crise... cest dailleurs le cas du lancement dune Europe commune, qui arrive aprs la Seconde Guerre mondiale. Raphal Chakor
I argued that, under fixed exchange rates, monetary policy had to be devoted to the balance of payments and fiscal policy to stimulating the economy. Robert Mundell Trad. : Je soutiens que, sous des taux de changes fixs , la politique montaire devait tre dvoue la balance des paiements et la politique fiscale , pour stimuler lconomie. Robert Mundell est un conomiste canadien. Il fonda une thorie conomique, qui gnralise la thorie keynsienne la dynamique montaire, aux taux de change et aux marchs des capitaux. Il favorise l'largissement des blocs montaires comme l'euro. Il fut rcompens pour ses recherches et ses travaux, par un prix Nobel dconomie en 1999. Commentaire. Mundell met en place le mcanisme suivant : Dans un rgime de changes fixes, la politique montaire n'est pas efficace, alors que la politique budgtaire l'est : en effet, la banque centrale intervient sur le march des changes pour satisfaire la demande en monnaie trangre. Elle perd ainsi le contrle de la masse montaire qui s'ajuste automatiquement la demande. Cette thorie intervient dans la question budgtaire et montaire europenne. En effet, avec la mise en place du systme des Banques Centrales en 1992, la politique montaire est fixe par la Banque Centrale Europenne. Cette dernire exerce un contrle strict sur la croissance de la masse montaire, et fixe les taux directeurs pour les pays de la zone euro. Il y a donc menace pour Mundell... Raphal Chakor
- 40 -
Vous aimerez peut-être aussi
- La Gestion de Projet - 3e ÉditionDocument222 pagesLa Gestion de Projet - 3e ÉditionArthur DUMAS100% (11)
- Halte A La CroissanceDocument5 pagesHalte A La CroissanceHanuman DasPas encore d'évaluation
- Dossier 1Document3 pagesDossier 1Nicolas DESHAYESPas encore d'évaluation
- La Participation Aux 2changes Est Necessaire A La CroissanceDocument7 pagesLa Participation Aux 2changes Est Necessaire A La CroissanceAyoub FakirPas encore d'évaluation
- Dissertation HGGSPDocument2 pagesDissertation HGGSPlili BrissaudPas encore d'évaluation
- Section 5 Principaux Courants de La Pensée ÉconomiqueDocument9 pagesSection 5 Principaux Courants de La Pensée Économiqueboutagayouthamza174Pas encore d'évaluation
- Intro Au Développement 2020Document23 pagesIntro Au Développement 2020Justin AtriPas encore d'évaluation
- Écologie et Économie aujourd'hui: L'urgence de recentrer l'économie sur l'homme et la natureD'EverandÉcologie et Économie aujourd'hui: L'urgence de recentrer l'économie sur l'homme et la naturePas encore d'évaluation
- Un projet de décroissance: Manifestation pour une Dotation Inconditionnelle d'AutonomieD'EverandUn projet de décroissance: Manifestation pour une Dotation Inconditionnelle d'AutonomiePas encore d'évaluation
- Book review : Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie: Résumé et analyse du livre de John M. KeynesD'EverandBook review : Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie: Résumé et analyse du livre de John M. KeynesPas encore d'évaluation
- Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent: Le capitalisme contre le climatD'EverandQuand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent: Le capitalisme contre le climatPas encore d'évaluation
- CM Pouvoir Et Administration (Complet)Document68 pagesCM Pouvoir Et Administration (Complet)Shika 131Pas encore d'évaluation
- Climat, la démission permanente: De « notre maison brûle » à la Convention citoyenne pour le climat, vingt ans de politiques climatiquesD'EverandClimat, la démission permanente: De « notre maison brûle » à la Convention citoyenne pour le climat, vingt ans de politiques climatiquesPas encore d'évaluation
- En Quoi La Seconde Gerre Mondiale Est-Elle Une Guerre D'anéantissementDocument2 pagesEn Quoi La Seconde Gerre Mondiale Est-Elle Une Guerre D'anéantissementvincduvPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Des Questions Économiques Et Sociales Par Denis ClercDocument66 pagesDictionnaire Des Questions Économiques Et Sociales Par Denis ClercsamdodPas encore d'évaluation
- Crise de 1929Document8 pagesCrise de 1929mjidbelPas encore d'évaluation
- Ethique Et Mondialisation Des AffairesDocument30 pagesEthique Et Mondialisation Des AffairesDassi LionelPas encore d'évaluation
- Le Role Des Banques Dans Le Financement de L Activite EconomiqueDocument1 pageLe Role Des Banques Dans Le Financement de L Activite EconomiqueImane OuarPas encore d'évaluation
- À L'aide D'un Exemple, Vous Montrerez Que La Croissance Économique Se Heurte À Des Limites Écologiques.Document1 pageÀ L'aide D'un Exemple, Vous Montrerez Que La Croissance Économique Se Heurte À Des Limites Écologiques.bdjemai5Pas encore d'évaluation
- Regimes Totalitaires CNEDDocument18 pagesRegimes Totalitaires CNEDVermontPas encore d'évaluation
- Cours Problèmes Économiques Et Sociaux - 2021 SupportDocument115 pagesCours Problèmes Économiques Et Sociaux - 2021 Supportrofix ayoubPas encore d'évaluation
- Le Soft Power Des Etats-UnisDocument22 pagesLe Soft Power Des Etats-UnisHouda El Alaoui100% (1)
- Le Mirage Climatique. 2023Document18 pagesLe Mirage Climatique. 2023Richard ANDRE0% (1)
- Thème 5 - Travail Emploi ChômageDocument89 pagesThème 5 - Travail Emploi ChômageEric ClémentPas encore d'évaluation
- Les Différentes Modalités de Financement de L'activité ÉconomiqueDocument4 pagesLes Différentes Modalités de Financement de L'activité ÉconomiqueEl MehdiPas encore d'évaluation
- Leçon 1 - Le PIB - OdtDocument11 pagesLeçon 1 - Le PIB - OdtMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Corrigé EC2 2 6 Et 11Document4 pagesCorrigé EC2 2 6 Et 11Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Croissance Économique Et Soutenabilité ÉcologiqueDocument28 pagesCroissance Économique Et Soutenabilité ÉcologiqueradoniainaPas encore d'évaluation
- Systemes Politiques Africaines - Google DriveDocument13 pagesSystemes Politiques Africaines - Google DrivewyzychuigunsPas encore d'évaluation
- Mda Bulle Speculative 1Document2 pagesMda Bulle Speculative 1ABRAHAM NENEPas encore d'évaluation
- La Mondialisation en Question-CoursDocument6 pagesLa Mondialisation en Question-CoursdjarmelPas encore d'évaluation
- CHAPITRE TERMINALE CROISSANCE Jay Ses 2007-2008Document52 pagesCHAPITRE TERMINALE CROISSANCE Jay Ses 2007-2008Mme et Mr Lafon80% (5)
- Programme SES TerminaleDocument8 pagesProgramme SES TerminaleraftoupinPas encore d'évaluation
- Les Théories de La Décroissance: Enjeux Et Limites de Jean-Marie HarribeyDocument11 pagesLes Théories de La Décroissance: Enjeux Et Limites de Jean-Marie HarribeyGuillaume Vandecasteele100% (1)
- II. Les Causes Du Sous-DeveloppementDocument9 pagesII. Les Causes Du Sous-DeveloppementnzigouleliaPas encore d'évaluation
- Corrige Ses Bac BlancDocument3 pagesCorrige Ses Bac BlancLetudiant.fr100% (1)
- Croissance Economique Et Dépenses Publiques PDFDocument26 pagesCroissance Economique Et Dépenses Publiques PDFHasni AbderrahimPas encore d'évaluation
- Progrès Technique Et CroissanceDocument29 pagesProgrès Technique Et Croissance31071978Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1 PRINCIPEDocument28 pagesChapitre 1 PRINCIPEFATOU DIALLO NDAOPas encore d'évaluation
- Nouvelle Revue de L'indeDocument124 pagesNouvelle Revue de L'indeAnonymous GISEkLfbDwPas encore d'évaluation
- Thème 311 - La Croissance Économique Est-Elle CompatibleDocument34 pagesThème 311 - La Croissance Économique Est-Elle CompatibleMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- TD - Combien ProduireDocument12 pagesTD - Combien Produireanon_481617522Pas encore d'évaluation
- Milton Friedman et le monétarisme: Un libéral en marge du keynésianisme ambiantD'EverandMilton Friedman et le monétarisme: Un libéral en marge du keynésianisme ambiantPas encore d'évaluation
- Le Modèle Monade De Développement: Le Développement Des Communautés En AfriqueD'EverandLe Modèle Monade De Développement: Le Développement Des Communautés En AfriquePas encore d'évaluation
- Thème 1 - Le PIBDocument46 pagesThème 1 - Le PIBMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Decroissance Vs Developpement Durable Capitalisme Mondialisation Altermondialisme Ecologie Nature PDFDocument472 pagesDecroissance Vs Developpement Durable Capitalisme Mondialisation Altermondialisme Ecologie Nature PDFAmelNesrinePas encore d'évaluation
- Seconde Guerre MondialeDocument3 pagesSeconde Guerre MondialeemodreamsPas encore d'évaluation
- Pouvoir Et Pouvoir PolitiqueDocument4 pagesPouvoir Et Pouvoir PolitiqueAbdessamad El JeraouiPas encore d'évaluation
- Croissance Et Développement Marc AnthonyDocument4 pagesCroissance Et Développement Marc AnthonyMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- DemocratieDocument11 pagesDemocratieluiggiPas encore d'évaluation
- PlumeMNG Correction TD Sciences Politiques 2019-2020Document11 pagesPlumeMNG Correction TD Sciences Politiques 2019-2020Elhadji BopPas encore d'évaluation
- Fiche de RévisionDocument3 pagesFiche de RévisionMeryame KhezamiPas encore d'évaluation
- Chapitre 4Document187 pagesChapitre 4Eric ClémentPas encore d'évaluation
- Problèmes Économiques Contemporains - Support Du CDocument167 pagesProblèmes Économiques Contemporains - Support Du C4w6rwmm8h9Pas encore d'évaluation
- Dissertation - Firmes Transnationales Et Mondialisation (2009-2010)Document6 pagesDissertation - Firmes Transnationales Et Mondialisation (2009-2010)Papa SarrPas encore d'évaluation
- Sources de La Croissance 2013 GVDocument26 pagesSources de La Croissance 2013 GVDaryl MbaPas encore d'évaluation
- Corrigé Investissement Et CroissanceDocument3 pagesCorrigé Investissement Et CroissanceAbdellatif ElaayadiPas encore d'évaluation
- Sujets Des Problemes Economiques Et SociauxDocument2 pagesSujets Des Problemes Economiques Et SociauxKoffi Ange Guy Roger KONANPas encore d'évaluation
- Intro Science Politi QueDocument62 pagesIntro Science Politi QueFranck Yves100% (1)
- Économie de L'environnementDocument13 pagesÉconomie de L'environnementGvfvbgmPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document2 pagesChapitre 3Nounoubila MajjdPas encore d'évaluation
- Thème 1 Comment Un Marché Concurrentiel Fonctionne-T-IlDocument54 pagesThème 1 Comment Un Marché Concurrentiel Fonctionne-T-IljayseseckPas encore d'évaluation
- Grandes Theories EconomiquesDocument5 pagesGrandes Theories EconomiquesHurbain GbaméléPas encore d'évaluation
- Pfe AyoubDocument58 pagesPfe AyoubSaîda BendoumaPas encore d'évaluation
- Résumé Global-Finances PubliquesDocument5 pagesRésumé Global-Finances Publiquesbendora hanane100% (2)
- Cours Economie Politique 2Document10 pagesCours Economie Politique 2Elhadji BopPas encore d'évaluation
- Questions HPEDocument3 pagesQuestions HPEEtudiants CFIE100% (1)
- SCIENCES ECONOMIQUES + Cours 3Document12 pagesSCIENCES ECONOMIQUES + Cours 3logan77176Pas encore d'évaluation
- Introduction À L'économie S5Document5 pagesIntroduction À L'économie S5Myra Riri100% (1)
- TD Microéconomie s1 Encg AgadirDocument7 pagesTD Microéconomie s1 Encg Agadirxagaci8664Pas encore d'évaluation
- Commerce InternationalDocument28 pagesCommerce InternationalAlioune Badara Thioune0% (1)
- Théories Du MGMTDocument20 pagesThéories Du MGMTtayeg riadhPas encore d'évaluation
- Bat D'ecopolDocument12 pagesBat D'ecopolGedeon NamwisiPas encore d'évaluation
- Pierre rosanval-WPS OfficeDocument6 pagesPierre rosanval-WPS Officejohnsonkabulo7Pas encore d'évaluation
- Marketing InternationalDocument6 pagesMarketing InternationalAngel’s PartnersPas encore d'évaluation
- Le Journal Marianne Recense "La Soif Du Gain" de Michael WalzerDocument4 pagesLe Journal Marianne Recense "La Soif Du Gain" de Michael WalzerHerne EditionsPas encore d'évaluation
- Rapport Sur La GRHDocument435 pagesRapport Sur La GRHGedeon Maxime BOUCHOKOPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Les Limites de La Régulation Par Le MarchéDocument13 pagesChapitre 2 Les Limites de La Régulation Par Le MarchéMme et Mr Lafon100% (2)
- NAISSANCE DE L ECONOMIE POLITIQUE Version Longue ÉtudiantsDocument29 pagesNAISSANCE DE L ECONOMIE POLITIQUE Version Longue ÉtudiantsAmir BouazzaPas encore d'évaluation
- Correction Épreuve Composée 2Document5 pagesCorrection Épreuve Composée 2Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Comptabilité Nationale S5Document21 pagesComptabilité Nationale S5abdel hakimPas encore d'évaluation
- Droit de La ConcurrenceDocument25 pagesDroit de La ConcurrenceNzPas encore d'évaluation
- Transport Maritime Et Le Commerce InternationnalDocument83 pagesTransport Maritime Et Le Commerce InternationnalAYMEN AMIDPas encore d'évaluation
- Corrige IndustrialisationDocument19 pagesCorrige IndustrialisationrebeccamartorellaPas encore d'évaluation
- Rosanvallon 1Document27 pagesRosanvallon 1Franck DubostPas encore d'évaluation
- La Fable Des Abeilles Et Le Développement de L'économie Politique - Ch20Document21 pagesLa Fable Des Abeilles Et Le Développement de L'économie Politique - Ch20Olivier DevoetPas encore d'évaluation
- Tableau Comparatif Adam Smith Et David RicardoDocument4 pagesTableau Comparatif Adam Smith Et David RicardoScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- 2023-2024-Partie I-Support Commerce - InternationalDocument35 pages2023-2024-Partie I-Support Commerce - InternationalDric LionsPas encore d'évaluation
- Fiche - Adam SmithDocument1 pageFiche - Adam SmithRIHANI MohamedPas encore d'évaluation