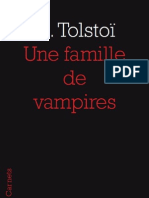Quinzaine Litteraire 86
Quinzaine Litteraire 86
Transféré par
egonschiele9Droits d'auteur :
Formats disponibles
Quinzaine Litteraire 86
Quinzaine Litteraire 86
Transféré par
egonschiele9Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Quinzaine Litteraire 86
Quinzaine Litteraire 86
Transféré par
egonschiele9Droits d'auteur :
Formats disponibles
e e
UlnZalne
3F
a
littraire Numro 86 Du 1- au 15 janvier 1970
e
Ul a
bombard
Blanchot fait table rase, Michaux
raconte ses rves, Jnger chasse le coloptre
SOMMAIRE
a LI: LIVlll: Maurice Blanchot
DI: LA QUINZAINE
li ESSAIS Ernst Jnger
8 IlOMANS II:TllAIIGEBS John Updike
Salvador Elizondo
8 BOMANS rBAllAIS Michel Bemard
8 POESIE Jacques Dupin
Jean.Pierre Burgart
10 Luis Cermida
11 HISTOIRE Andr Billy
LITTEBAIBE
12 SCIENCE l''ICTION Fritz Leiber
1& PSYCHOLOGIE Henri Michaux
18 EXPOSITIOIIS
1'7
Ventretien infini
Chas&es subtila
Couples
Farabeuf
t
La Nue
Le chevalier brnc
L'embrasure
Failles
lA. ralit et le dsir
/oubert nigmatique
et da.iciew:
Le
FCIOlU d'endormi,
faOlU d'vel
Chagall... avant 23
Deux Italiens
Le C.N.A.C. dans la rue
par Maurice Nadeau
par Gilles Lapouge
par Jean Wagner
par Severo Sarduy
par Jean-Nol Vuamet
par G. P.
par Serge Fauchereau
par Albert Bensoussan
par Lionel Mirisch
par Juliette Raabe
par Roger Dadoun
par Marcel Billot
par Grald Gassiot-Talabot
par G. G.-T.
18 MYTHOLOGIES
20 LETTBBS A
LA QU.IIIZAINB
22 ETHNOLOGlE
23
24 HISTOIRE
LETTBB DB SUISSE
2'7 CINEMA
28
rEUILLII:TOII
Walter F. Otto
Lucien Bodard
1. Meunier et A.M. Savarin
J. Delperrie de Bayac
Dionysos, le mythe et le culte
Qui a bombard Guernica ?
Le massacre des 1ndielU
Le chant du Silbaco
Hi&toire de la milice
L'artiste enropen nO 1?
L'Opra de Quat'sous
Dtruire, dit-eUe
Table ronde Beyrouth
w
par Pierre Pachet
par Brian Crozier
par Herbert R. Southworth
par Jean Duvignaud
par Andr Akoun
par Maurice Chavards
par Jos Pierre
par Gilles Sandier
par Jean-Marie Benoist
par Claude-Michel Cluny
par Georges Perec
Crdits photographiques
La Quinzaine
Ihtiralre
2
Franois Erval, Maurice Nadeau.
Conseiller : Joeeph Breitbach.
Comit de rdaction :
Georges Balandier, Bernard Car.ee,
Franois Chtelet,
Franoise Choay,
Dominique Femandez, Marc Ferro,
Gilles Lapouge, Bemard PJllaud,
Gilbert Walusinaki.
Secrtariat de la rdacrion :
Anne Sarraute.
Courrier littraire :
Adelaide Blasquez.
Rdaction, adminUtration :
43, rue duTemple, Paris-4",
Tlphone: 887-48-58.
Publicit littraire :
22, rue de Grenelle, Paria-7
e
Tlphone : 222-94-03.
Publicit gnrale : au journal.
Prix du n" au CanadG : 75 cent...
Abonnements :
Un an : 58 F. vingt.trois numros.
Six mois : 34 F. douze numros.
Etranger:
Un an : 70 F. Six mois : 40 F.
Pour tout changement d'adresse ':
envoyer 3 timbres 0.30 F.
Rglement par mandat. chque
bancaire. chque postal :
C.C.P. Paris 15.551.53.
Directeur de la publication :
Franois Emanuel.
Imprimerie: Graphique. Gamhoa
Printed in France
p. 5
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 12
p. 15
p. 16
p. 17
p. 20
p. 22
p. 23
p.24
p. 25
p.26
Vasco
Roger Viollet
Galerie Louise Leiris
Gallimard
D.R.
Magnum
Jacqueline Hyde
Le Point cardinal
D.R.
D.R.
D.R.
D.R.
Mercure de France
Roger Viollet
Roger Viollet
Roger Viollet
D.R.
BernaDd
LB LIV.B DB
LA QUINZAIIiB
Table rase
La Quiuuine littraire, du 1- GU 15 jan. 1970
Eorire devient alors une rnpoasabWt ter-
rible.
Eorire, en oe sen.... suppo.e un ohangemeat
radioal d'poque... et, par l, pane par llav.
Dement du oommumsme...
1
Maurice Blanchot
L' Entretien infini
Gallimard d., 644 p.
N'est-il pas outrecuidant de
vouloir accompagner la pen
se de Maurice Blanchot alors
qu'on n'est pas un profession-
nel du maniement des ides
et qu'on ne saurait se flatter
d'entrer dans les dtours d'un
des esprits les plus rigoureux
mais aussi les plus subtils
d'aujourd'hui? Du moins la
difficult de lecture, la diff-
rence de celle qu'on prouve
propos d'ouvrages rcem-
ment crits par des penseurs
moins discrets, ne tient-elle
pas un vocabulaire infran-
chissable ou de tortueuses
prciosits d'criture : Mau-
rice Blanchot use d'une lan-
gue transparente et si quel-
que affirmation nous parat
d'abord obscure, c'est au
cur, de la plus grande
clart.
Si nous comprenons difficile-
ment du premier coup ce qu'il
dit, c'est nous que nous devons
nous en prendre, notre dfaut
d'exercice, notre manque d'ou-
verture, notre paresse. En tout
cas et serions-nous incapables de
nous lever au-dessus du plus bas
niveau de comprhension que le
courant entre l'auteur et nous
serait suffisamment fort et riche
pour que s'en aillent vaul'eau
un certain nombre de certitudes
jusqu' prsent ancres en notre
esprit et qui n'taient que fichaises
encombrantes.
D'abord, pourquoi un tel titre?
Parce qu'il s'agit effectivement,
sous maintes formes, d'un dia-
logue. Dialogue qui serait moins
le compte rendu d'une conver
sation vritable entre deux inter-
locuteurs vritables qu'une esca-
lade o il importe de bien assurer
le pied droit aprs le gauche, et
ainsi de suite. Quant la plus
grande partie de l'ouvrage, si elle
est compose d'tudes que nous
avons pu lire successivement en
revue depuis une dizaine d'annes,
mais groupes dans un certain
ordre et en vue d'une certaine
fin, on peut bien dire que l'auteur
y poursuit galement un certain
entretien : avec des crivains
et des uvres qui sont vivement
caractriss dans leur originalit
et leur lumire particulire -
comme c'est le rle et le devoir
du critique - et qui sont en mme
temps tenus pour autant de points
o s'accrocher pour une pense
qui, par eux et travers eux,
poursuit son chemin propre.
Encore convient-il de signaler que
l'auteur ne semble pas lui avoir
assign de but prcis et qu'il ne
parat pas vouloir parvenir des
conclusions qui figureraient le
terme d'une dmonstration. C'est
chemin faisant et comme en se
jouant (mais il s'agit d'un jeu
rigoureux) que Maurice Blanchot
abat un certain nombre de quilles
philosophiques ou mtaphysiques,
ruine des concepts comme ceux de
tout , d'cc unit )), de conti.
nuit ), de c( discours )), dgonfle
nombre de mtaphores qui nous
servent de raison suffisante (toutes
celles qui se rapportent par exem-
ple la lumire )), la (c clart ,
le dsir d'cc claircir) une ques-
tion ou un problme), tandis qu'il
ne nous reste plus grand'chose,
vraiment, de ce quoi l'auteur
semblait encore tenir dans l'Es-
pace littraire ou le Livre venir :
les notions d' art )), de littra-
ture , de chefd'uvre , voire
d' uvre )) tout court, voire, plus
radicalement encore, de livre .
Comment parvient.il faire ain-
si table rase, au point de penser
que la notion de cc nihilisme
appartenait une heureuse po-
que ? TI nous faut revenir ce
qu'il entend par cc entretien et
qui, avou ou cach, formel ou
sous - entendu, n'a videmment
rien de la dispute philosophique :
quand il s'agit de faire plier
l'adversaire ou de l'utiliser -
comme le fit assez bien Socrate
- pour l'accoucher d'une vrit
la lente gestation de laquelle
nous avons assist. Mais il n'est
pas question davantage - cela
serait trop facile - de donner en
soi la parole l'avocat du dia
ble, ou d'objectiver une part de soi
qui jouerait les compres, ou en-
core de prendre l'crivain (ou
l'uvre) pour un simple com-
parse. L'entretien n'existe qu'
partir de l'existence de cc l'autre ,
existence ressentie comme la plus
grande tranget et comme l'tran-
get la plus proche qu.and, pour
Maurice Blanchot, cet autre
s'appelait par exemple Georges
BataHIe et qu'entre eux, durant une
amiti de trente annes, se poursui-
vit cet entretien infini .
C'est propps de Bataille
que Blanchot prcisment crit :
Dans le dialogue que nous
considrons, c'est la pense mme
qui se joue en nous appelant
soutenir, en direction de l'incon-
nu, l'illimit de ce jeu, lorsque
penser, c'est, comme le voulut
Mallarm, mettre un coup de
ds. L'objet de ce jeu? Il
s'agit, dans ce mouvement, non
pas de telles ou telles manires
de voir et de concevoir, fussent-
elles importantes, mais toujours
de l'unique affirmation, la plus
tendue, la plus extrme, au point
q'affirme, elle devrait, puisant
la pense, la rapporter une tout
au,tre mesure, la mesure de ce
qui ne se laisse pas atteindre, ni
penser .
Plutt que de nommer ce
genre d'entretien dialogue )J,
Maurice Blanchot prfre l'appe-
ler parole plurielle , qu'il dfi
nit: c( recherche d'une affirma.
tion qui, bien qu'chappant
toute ngation, n'unifie et ne se
laisse pas unifier, toujours ren
voyant une diffrence toujours
plus tente de diffrer... D'o
il s'ensuit que les interlocuteurs
disent 'la mme chose, parlant
dans la mme direction, car ils
ne discutent ni ne parlent de
sujets capables d'tre abords
diversement, ils sont porteurs de
la parole en vue de cette affir-
mation unique qui excde toute
unit, ils ne s'opposent donc et
ne se distinguent en rien quant
ce qu'ils ont dire, et pour-
tant le redoublement de l'affir-
mation, sa rflexion, la diffren-
cie toujours plus profondment,
mettant au jour la diffrence
cache qui lui est propre et qui
est son tranget toujours irrv-
le... Plus simplement peut-
tre, nous dirions que des deux
interlocuteurs l'un est toujours
l'autre pour celui qui parle
et que cet autre , rptant ce
que dit le premier, parle dans
cette prsence de parole qui est
sa seule prsence , parole que
Maurice Blanchot dfinit comme
neutre, sans pouvoir, o se joue
l'illimit de la pense, sous la
sauvegarde de l'oubli . Plus sim-
plement encore, si c'est possible,
il faudrait admettre que, pour
s'effectuer, le jeu (dans les
diffrents sens du mot) de la pen-
se a toujours besoin d'au moins
deux partenaires.
Et l'on voit, propos de
Bataille prcisment - mais aussi
en partant d'Hraclite, de Sade,
de Nietzsche, de Simone Weil, de
Camus, de Robert Antelme, de
Raymond Roussel, du Surralisme
- Maurice Blanchot Il redoubler
la parole de littrateurs, de pen-
seurs, de philosophes, d'crivains
qui, tous, ont voulu excder les
limites de la littrature, de l'u-
vre d'art, de la pense. Non en
vue d'une vrit particulire qu'ils
auraient dcouverte et moins
encore dans le but d'enrichir le
trsor culturel de l'humanit,
mais plutt comme si, sujets et
objets d'une exprience qui rui-
nait radicalement l'exprience
commune, ils n'avaient t que
les ll0rte-parole de ce qu'on
appelle inconnu par incapa-
cit de le nommer, sans doute
toujours inatteignable mais qui
se serait exprim travers eux
et que Maurice Blanchot carac-
trise au moins dans ses pouvoirs
d'videment (de la ralit, des
concepts, des notions philoso-
phiques, travers une incessante
mise en question de toute ralit,
de tout concept, de toute notion)
et comme si cet inconnu ne
pouvait tre autrement capt que
sous les espces de l'Extriorit
et du Neutre.
L'Extriorit et le Neutre ce
80nt l les caractristiques de
l'criture en mme temps que ce
qu'engendre (il faudrait dire auto-
engendre) l'criture par l'exer-
cice dsintress qu'on fait d'elle.
Alors qu'on la croit au service de
3
la parole (et qu'elle s'y place
quasi naturellement), parole qui
n'est jamais autre qu'idaliste ou
moralisante, Blanchot la voit
comme le jeu insens dont
parlait Mallarm, mais un jeu
qui n'est rien s'il n'est en mme
temps ressenti comme une exi
gence. Alors que nous la tenions
il n'y .a pas longtemps encore, et
dans une idologie hrite du
XIX sicle, pour productrice de
cc chefs-d'uvre , d' cc uvres et
de livres , tout le moins
elle est une force qui ne se
reporte qu' elle-mme , qui ne
se consacre qu' elle-mme et qui,
lentement libre en tant que
force alatoire d'absence , sans
appartenir personne et comme
sans identit, dgage des possi.
bilits infinies. Force de nan.
tisation? Ce serait lui confrer
encore une sorte de positivit.
Entendue, dclare Blanchot,
dans sa rigueur nigmatique ,
elle apparat plutt comme une
force anonyme, distraite, diffre
et disperse d'tre en rapport par
laquelle tout est mis en cause, et
d'abord l'ide de Dieu, du Moi,
du Sujet, puis de la Vrit et de
l'Un, puis de la Vrit et de
l'uvre... Loin d'avoir pour
but le Livre , elle se tient hors
discours, hors langage et, du
Livre, cc marquerait pllttt la
fin .
Aprs cc la Parole plurielle et
l'Exprience.limite , Maurice
Blanchot intitule une des trois
grandes parties de son ouvrage pr-
sicment : cc l'Absence de livre . Il
y fait entrer, outre Novalis, Rim.
baud, Kafka, Artaud, Ren Char,
Andr Breton. Tous, peu ou prou,
auraient selon lui tacitement sous.
crit cette dfinition: cc Le [.-ivre :
passage d'un mouvement infini,
allant de l'criture comme op.
ration l'criture comme dsu-
vrement; passage qui aussitt
empche. Par le livre passe l'cri-
ture, mais le livre n'est pas ce
quoi elle se destine (sa destine).
Par le livre passe l'criture qui
s'y accomplit tout en y disparais.
sant; toutefois on n'crit pas
pour le livre. Le livre : ruse par
laquelle l'criture va vers l'ab
sence de livre. Ces longs dtours
de la pense de Maurice Blanchot
ne sont pas inutiles en regard de
la leon que nous autres, lec
teurs, pouvons en tirer : savoir
qu' l'encontre d'assez affligeantes
thories la mode, l'criture est
avant tout force de questionne-
4
ment, d'videment des ralits
apparemment les mieux assises,
de discontinuit et de rupture.
Elle ne cre rien et n'enrichit pero
sonne. Au contraire elle dcape,
dissout, dtruit.
Force qui nous invite aller
toujours au-del, en rompant tous
les cercles (et, ajoute Blanchot,
cc le cercle de tous les cercles : la
totalit des concepts qui fonde
l 'histoire, se dveloppe en elle et
dont elle est le dveloppement ).
Force qui s'en prend d'abord au
cc discours : ce discours dans
lequel, si malheureux que nous
croyons tre, nous restons, nous
qui en disposons, confortablement
installs . Force qui en fait n'est
jamais manie par un seul, mais
qui devrait l'tre au nom de tous,
et anonymement, et qui, comme
finale exigence, suppose un
changement radical d'poque >l.
Autrement dit : la cc fin de l'his.
toire et l'avnement du commu
nisme, de ce communisme qui se
tiendra toujours au-del du com
munisme. Dans ces conditions et
selon cette perspective, cc crire ,
dclare Maurice Blanchot, devient
alors une responsabilit terrible .
C'est en effet cc exercer la violence
la plus grande : celle qui cc trans-
gresse la Loi, toute loi et sa propre
loi .
Le mrite de Maurice Blanchot,
la fascination qu'il exerce sur son
lecteur tiennent peut-tre moins
la personnalit de l'auteur,
l'ensemble de qualits qui font de
lui l'crivain que nous connaissons,
qu' cette bonne conductihilit
qu'il offre au passage de la pense,
qu' cette facult de pousser la
pense qui s'empare de lui et dont
il s'empare jusqu' lui faire exc-
der ses limites. Non par raisonne-
ments, arguments, dveloppements.
Mais par sauts et bonds dans l'es
sentiel et qui nous jettent au cur
d'une vidence jusqu'alors jamais
perue. Cette dmarche qui tient
galement du jeu (par curiosit
de voir jusqu'o on peut aller),
relve d'un jeu plus grave et o
se risque l'essentiel: de ce que
gnralement nous pensons, sen-
tons, croyons. Convis une
gymnastique difficile nous n'y
prendrons certes aucune graisse
culturelle, mais ce que nous pero
dons, par lambeaux ou grands
pans, n'tait qu'un alourdissement
pataud que nous prenions pour de
la richesse.
Maurice Nadeau
DITEURS
Seuil
Aux Editions du Seuil, Jean Cayrol
(voir les nO> 1 et 44 de La Quinzaine)
nous propose un nouveau roman inti-
tul Histoire d'une prairie et qui se
prsente comme une ferie historique
et cosmique, englobant la fois le
pass, le prsent et l'avenir, depuis
la Gense jusqu' la guerre isralo-
arabe et l'avnement de l're de
l'informatique, la prairie faisant Ici
office de lieu commun ., de miroir
o vient se reflter le monde par le
truchement d'un personnage hybride,
sorte de cerveau lectronique et tl-
command.
On pourra lire galement, traduit
du hongrois, Les Parents perdus, par
Magdo Szabo, roman sur le conflit
des gnrations dans la Hongrie
contemporaine, dchire entre ses
traditions chrtiennes et le commu-
nisme, marque par ses compromis-
sions avec le nazisme au cours de
la Seconde Guerre mondiale et qui,
aux yeux de sa Jeunesse, s'est dfi-
nitivement disqualifie pendant la r-
volution de 1956; Le Soleil des Ind-
pendances, par Amadou Kourouma,
fresque savoureuse, entremle de
contes et de dictons mallnhs, sur
le petit peuple de la Cte-d'Ivoire,
que l'Indpendance de leur pays n'a
gure modifi dans leurs coutumes,
leurs rites et les tribulations de leur
vie quotidienne; Je ne joue plus, par
Mlroslav Karleja, long cri de rvolte
d'un des meilleurs crivains yougo-
slaves contemporains contre un ordre
social qui consacre la sottise et la
cruaut et contre les fondements
mmes de sa propre rvolte; Les
Troyens, par Jean-Pierre Faye, rseau
de rcits rpercuts et reflts entre
trois noms de femmes et que l'on
peut aborder par n'importe quelle
entre, lire littralement et dans tous
les sens. (collection Change.).
Albin Miohel
Deux nouveaux titres dans la col-
lection Lettre ouverte d'Albin
Michel: Lettre ouverte un malade
en colre, par Robert Soupault; Lettre
ouverte aux hommes d'avenir, par
Jean Fourasti. Chez le mme di-
teur, on annonce un nouveau roman
d'Erskine Caldwell, Miss Marna alme,
dont l'action se situe dans une petite
ville du Sud et dont les protagonistes
sont des outsiders. enferms dans
leur solitude et leurs traditions rotico-
mystiques et Indiffrents l'volution
de la socit amricaine. Autre titre:
Les Tmoins, par M. W. Waring, roman
traduit de l'anglais, et o se trouve
voque la socit russe pendant les
bouleversements qui prcdrent la
Rvolution d'Octobre.
Robert Laffont
Chez Laffont, dans la collection
Les sommets de l'art o nous
ont t prsentes les peintures
noires de Goya la Qulnta dei Sordo,
Jacques Thuillier et Jacques Foucart
nous proposent une tude approfondie
de l'ensemble de l'uvre de Ruben
L'ouvrage, qui comprend 131 lIIus-
tratlons et 23 planches en couleurs,
nous restitue la srie des grandes
toiles du peintre exposes au Louvre.
Prix de la souscription: 640 F. Prix
aprs souscription: 690 F.
A paratre: MichelAnge l la Cha-
pelle Sixtine; Le Grco.
Cerele du BlbUophile
Sous la direction de Pierre Sabbagh,
une nouv611e collection vient d'tre
Inaugure au Cercle du Bibliophile:
Le Cercle de l'Explorateur ., qui
runira les noms des explorateurs et
crivains de tous les temps et de
tous les pays. Aprs Le Livre du
devlsement du monde, de Marco Polo,
et Voyages autour du monde, par le
capitaine Cook, rcemment parus,
Le Cercle de l'Explorateur. nous
proposera: Du zambze au Tan-
ganyika (1858-1872), par Livlngstone-
Stanley; Voyage autour du monde,
par Bougainville; Voyages en Perse,
par Jean-Baptiste Tavernier; Premiers
voyages au mont Blanc (1779-1796),
par H.-B. de Saussure; Voyage autour
du monde, par J.-F. La Prouse:
Voyages en France, par R. L. Steven-
son; Premier voyage autour du monde
par Magellan, rdig par le compa-
gnon de Magellan et l'un des rares
rescaps de l'expdition, Antonio Pi-
gafetta; L'Homme la conqute du
P61e, par Paul-Emile Victor.
Stook
Aux Editions Stock, o sera inaugu-
re au dbut de l'anne 1970 une
collection de romans franais avec
Alcide ou la fuite au dsert, par
Jean Orieux, auteur d'une biographie
de Voltaire parue en 1966 chez Flam-
marion et qui fit couler beaucoup
d'encre (voir le n 10 de La Quin-
zalne), ainsi qu'une collection de
thtre dont le premier titre sera
L'Absolu naturel, de G. Parls, on
annonce, dans la collection Tmoins
de notre temps ., une tude d'Edouard
Bens, o l'ancien prsident de la
Rpublique tchcoslovaque raconte par
le dtail les fameuses journes de
Munich. qui devaient conduire la
Seconde Guerre mondiale: Munich.
Signalons galement un roman bio-
graphique traduit de l'amricain: Jack
London, l'aventurier des mers, par
Irving Stone, o se trouve restitue
la vie mouvemente de l'auteur de
Croc-Blanc, de Martin Eden et de tant
d'autres romans clbres.
Il L'entretien secret"
de Pierre Bourgeade
sera pubU dans notre
prochain numro.
Ce sera l'avant-
dernire renoontre de
notre ami .veo un
auteur.
La traverse
des apparences
ESSAI
1
Ernst Jnger
Chasses subtiles
Traduit de l'allemand
par Henri PIard
Christian Bourgois d., 456 p.
Les hros de ce livre n'ont
rien de clbre. La drypta
bleue et le Iymelyxon, la
strangalia rouge et le ptynus
ne sont pas de nos familiers.
Il s'y ajoute que leur taille
est trs petite, un grain de
riz parfois, ce qui n'aide pas
les reconnatre et s'il faut
les dcrire, c'est le diable, car
un coloptre, allez l'imaginer
si vous n'tes pas vous-mme
un collectionneur. Ecrire alors
450 pages sur le sujet des
vesperus, des saphryna et de
leurs petits collgues s'appa-
rente une gageure.
Jnger la soutient. Vous avez
beau ne pas distinguer une cicin-
dle d'un typhe, Jnger vous
emporte parmi ces immenses peu-
plades d'insectes comme on dcou-
vre une Amazone.
Subtiles, ces chasses ne sont pas
frivoles. A dcrire les chinoi
series de corne, de jade et
d'agathe, les carapaces d'or et de
charbon, les ailes de verre et la
fragilit des antennes, Jnger ne
cde jamais au plaisir de la
prouesse littraire. Son dessein
est plus orgueilleux. Il l'nonait
dj dans un livre ancien et
malheureusement introuvable, le
Cur aventureux: Lorsqu'on
observe un coin du rel, comme
ici les gupes, on acquiert en
mme temps la connaissance d'au-
tres objets cachs, tel le chasseur
l'afft ou le guerrier aux avant
postes .
Cette phrase, crite il y a
vingt.cinq ans, contient toutes
les Chasses subtiles. Et Jnger
la prcise anjourd'hui quand il
dcrit le collectionneur d'insectes:
C'est en ce seul lieu qu'il a
vu, dans la mer des apparences
tinceler la vague sur
laquelle se brisait la lumire, et
c'est justement l que s'ouvre la
minuscule fentre par laquelle il
peroit la splendeur de l'univers .
Voil qui trace les limites de ce
livre mystrieux: en fixant ses
appareils sur l'infiniment petit,
comme un astronome observe le
mouvement des constellations,
Jnger dcrypte d'autres vrits.
En premier lieu, la sienne.
L'diteur franais caractrise
Chasses subtiles comme les Anti.
mmoires de Jnger. Grandilo-
quence en moins, un livre peut
en effet voquer l'autre. Pris trs
jeune l'hameon, Jnger n'a
qu' suivre le fil invisible de ses
chasses pour dbobiner toute son
existence depuis le temps o son
pre, pharmacien Hanovre,
l'initiait cette autre science dli-
cate qu'est le jeu d'checs, jus-
qu'aux promenades qu'il accom-
plit aujourd'hui, cinquante ans
plus tard, dans les forts de Sig-
marigen. Entre ces deux bornes,
une srie de figures se succdent.
Elles ne se concilient pas aisment
car les profils de Jnger sont
dconcertants : l'colier le plus
nul de l'Allemagne est devenu
le plus grand crivain de son
pays. Le voyageur acharn est un
homme de bUreau et de mdita.
tion. Le passionn d'archologie
se pme pour un vin sicilien ou
une bouillabaisse corse. L'ama-
teur d'utopies est un pote incom-
parable. Le philosophe de l'his-
toire n'est l'aise que dans le
royaume de Gulliver des insectes.
Enfin, et l'amhigut atteint ici
son comble, le guerrier fascin
par le sang et les flammes, est
aussi un homme qui a travers sa
vie avec un filet papillons.
Un mot sur ce sujet. Depuis
Orages d'acier Jnger passe rai.
son pour un de ces romantiques
de la violence que l'Allemagne a
la triste manie de produire. Il
est vrai que Jnger a chant la
guerre. Il ne cache mme pas que
dans les annes 20, Hitler l'a
sduit. Mais, trs vite, il s'en
dtourne, se retire dans sa tour
d'ivoire. Les carnages mthodi
ques des guerres modernes lui
rpugnent. Les guerres qui han-
tent cet homme de droite sont
celles des temps fodaux, non les
exterminations. Et il faut dire
davantage : Chasses subtiles nous
montre un homme sans cesse par-
tag entre le got de la violence
et celui de la mditation. A plu-
sieurs reprises, la mme scne
revient. Dans une tranche de 14
ou sur les routes de 40, la fureur
du monde s'efface soudain, la
guerre s'loigne, pour la raison
que deux insectes noirs, luisants,
pars de leurs trois cornes sur-
gissent sous les yeux de Jnger.
l( En me penchant vers ce couple
menu, j'oubliais ma mission guer
rire - le lieu, le temps et la
consigne. Des deux ralits, celle-
ci tait la plus forte .
Lors d'un voyage en Afrique,
plus rcemment, Jnger est convi
une chasse au gros gibier. Cette
ide le rvulse tout coup. Il
s'interroge. Est-ce donc l'ge qui
lui donne la destruction en hor
reur? II Dsormais, les buffles
eux-mmes ne m'attiraient plus .
Un tel dclin d'ardeur ne peut
gure s'expliquer par l'ge, car
on voit de vieux chasseurs enflam
ms d'une passion persistante, et
mme, parmi eux, des anctres.
On est bien oblig de songer
une mutation, ce que les astro
logues appellent communment
II l'entre dans une nouvelle mai
son .
De chasse en chasse, le visage de
Jnger se transforme. Il se modle
de l'intrieur. Il scrute mainte-
nant la face cache des choses.
Il dcouvre que sa seule passion
est celle de la connais811nce. De
sorte que ce livre n'voque pas
seulement les Antimmoires. Son
plus proche modle devient bizar-
rement Mobv Dick.
La blanche du capi.
taine Achab est remplace par
les insectes de Lilliput. Le chan-
gement d'chelle est de peu de
signification. Les myriades d'in-
sectes dtiennent le mme secret
que l'introuvable baleine. Leur
assemblage dans la mmoire com-
pose une immense et fantastique
mosaque. Chaque prise comhle
un vide du puzzle chatoyant, fra-
gile et chimrique. Dans les entre-
croisements des espces et des
genres, dans les analogies de leurs
cornes et de celles du rhinocros,
de leurs couleurs et des brillances
de l'eau ou du ciel, dans la dis-
tribution des dessins de leurs
carapaces, Jnger dchiffre des
rseaux d'une fabuleuse finesse
dont les mailles recouvrent, selon
lui, les mailles d'une autre ra-
lit, cache.
Nous allons dans le monde en
aveugles. Nous le considrons dis-
traitement et nos yeux n'utilisent
pas leurs pouvoirs. Jnger, qui le
sait, choisit de dcouper dans le
rel une lamelle trs troite de
manire que les trsors enfouis se
rvlent. Le livre de l'infiniment
petit devient alors celui de la
richesse et de la profusion. Une
seule famille du genre coloptre,
celle des Carabida.e, ne comprend
pas moins de 25.000 espces. La
chasse subtile est une chasse au
snark. A force de fixer cette zone
Ern3t Jnger
troite du rel, mille facettes se
dvoilent. Le monde se met
scintiller. Certaines subtilits,
dit Jnger, ne me devinrent dis-
cernables qu'aprs des dizaines
d'annes .
Cette passion est servie par un
langage admirable. Jnger, tout
au long de son uvre, nous a dit
sa fascination pour le cristal,
la fois objet et principe forma
teur, la fois surface et profon-
deur. Ainsi de cette criture qui
semble nimhe de lumire: en
relatant les apparences, ce style
rvle aussi les structures occul-
tes qui organisent ces appa-
rences, exactement comme le
cristal donne lire, au mme
regard, le8 facettes qui le compo-
sent et les gomtries qui gou-
vernent l'ordre de ces facettes.
Le chasseur, conclut Jnger,
devient la longue subtil, force
de ne pas pargner sa peine,
mme dans la plus modeste des
qutes. Un souffle presque imma
triel, comme venu d'ailes d'ph-
mres, a model son esprit. Quant
aux noms qu'il a chasss au bord
mme de l'innomm, il est vrai
qu'il ne peut les emporter avec
iui. L'art va plus loin, de mme
qu'une chanson dont les paroles
sont oublies VOliS obsde encore
de sa mlodie. Puis, la mlodie
elle-mm.e reste derrire VOltS .
Gilles Lapouge
La Quinzaine littraire, du 1- au 15 jWl1'ier 1970 5
ROMANS
:8TRANGERS
1
John Updike
Couples
Trad. de l'amricain
par Anne-Marie Soulac
Gallimard d. 564 p.
On pouvait attendre beau-
coup de John Updike. Il appar-
tenait cette cohorte de pe-
tits marquis en jabots de den-
telle qui, de la forteresse du
New Yorker dversrent sur
la littrature amricaine des
paillettes toutes plus tince
lantes les unes que les autres.
Les femmes taient sous cel
lophane et avaient la grce
des hrones de Fitzgerald.
Cet univers sophistiqu -
qui atteignit son point culml
nant avec le Centaure - Irrita
bien des gens : cette belle
brute de Norman Malle r
regretta par exemple que,
sous les volutes stylistiques,
le sexe n'affleurt point. Son
Initiation tait d'autant plus
grande, que le talent d'Updike
tait vident.
Mailer doit tre content : pour
crire son norme roman Couples,
Updike, ayant abandonn ses jabots
de dentelle dans les archives du
New Yorker, a promu le sexe au
rang de premier personnage. Il a
fait craquer la cellophane et ses
personnages s'avancent dsormais,
dans le monde, avec, solidement
colls eux, les miasmes de leurs
vigoureuses et nombreuses activits.
Pour rester dans le domaine physio-
logique, disons qu'Updike a vir
sa cuti...
Couples, donc, nous raconte la
vie sexuelle de cinq ou six couples
appartenant la classe moyenne
d'une petite ville du Massachussets.
Un partenaire chasse l'autre et, au
terme de ce gros roman, rien ne
sera vraiment chang la situation
initiale. On n'aura rien appris sinon
que le sexe est l'obsession privilgie
des poux et pouses amricains. Les
scnes de couche.ries se succdent et
leur accumulation ne va pas sans
une certaine monotonie. Dans le
flot des pages, on ne sait plus trs
bien qui a ou n'a pas tent une
exprience , qui est ou n'est pas
frustr, qui fut ou ne fut pas, un
moment ou un autre, un parte.
naire convoit ou consomm. D'ail
leurs, tout a, en fin de compte, n'a
pas trs grande importance.
6
Best-seller
Mme si elle est rate (et ambi
gu), l'intention satirique est vi
dente : toute cette socit, au fond
trs conformiste, sans la moindre
culture, qui a de l'argent, qui est
la base de la socit amricaine -
c'est elle qui a mis, par exemple,
un Nixon au pouvoir et c'est d'elle
dont parle le Prsident lorsqu'il se
dit soutenu par l'Amrique silen-
cieuse - cette socit est, en vrit,
mine de l'intrieur parce qu'elle
n'a plus qu'une proccupation essen-
tielle, jouir - et au sens le plus
animal du terme.
Cette dnonciation vhmente
est, en mme temps trs ambigu.
Elle ressemble fort celle des vau-
devillistes qui s'adressent, de mani-
re bourgeoise, au public bourgeois,
dcochant quelques flches qui ne
remettent pas en cause la socit,
flches qui recueillent de nombreux
applaudissements. Il y a eu des pr.
cdents qui, tous, ont obtenu un
succs public certain : citons Ren-
dez-vous Samarra de John O'Hara,
Par l'amour possd de James Could
Cozzens et mme la Vie d'artiste
de Mary Mc Carthy. Tous se drou-
lent dans ce NordEst des Etats-
Unis, berceau des premiers immi
grants et sige aujourd'hui de la
haute puissance financire.
Et ce n'est pas un hasard : La
Nouvelle Angleterre (considre
comme province, non comme Etat)
est le berceau du puritanisme. Sa
lem, de sinistre mmoire, est
quelques kilomtres de l'Etat de
Pennsylvanie o est Updike (il vit
d'ailleurs dans l'Etat de Nouvelle
Angleterre). Couples est un roman
puritain mis au got du jour. Parce
que nous vivons une poque o
un chat peut tre non seulement
appel un chat mais dcrit minu-
tieusement, le puritanisme d'au
jourd'hui est fidle sa vocation,
c'estdire qu'il exprime l'obsession
d'une chair qu'il mprise et dtes-
te. Rien, dans les bat amoureux,
n'exprime une quelconque joie ou
un quelconque panouissement.
L'amour n'est rien d'autre qu'une
servitude, un mal ncessaire. Rien
n'est moins rotique que Cou-
ples. Et les nombreux dtails ana-
tomiques qui maillent le rcit n'ont
d'autre objet que de dmystifier
cette question sexuelle au premier
plan des proccupations amricai
nes. L'homme de Cur de livre
avec sa mysoginie de bon ton ne
peut que se rvulser devant l'offen-
sive du nu sur les scnes amricai
nes. Pour des raisons esthtiques
certes, mais aussi pour des raisons
morales.
On pouvait attendre beaucoup de
John Updike, disionsnous au dbut
de cette chronique. Son talent sem
blait mme suffisamment riche pour
voluer dans une direction incon-
nue, mais on n'imaginait pas qu'il
pt aboutir la plate tranche de vie
naturaliste. Des traces ariennes de
Fitzgerald, il est pass sans transi.
tion au sillon laborieux de John
O'Hara. A croire qu'il a, entre
temps, suivi des cours dans une de
ces coles d'crivains qui pullulent
aux Etats-Unis.
Certes, par moments, au hasard
d'un paragraphe, on retrouve Updi.
ke, mais on esprait plus qu'un
John O'Hara en mieux. On esprait
un univers personnel. Et on a beau
ne pas vouloir craser la jeune litt
rature amricaine sous le poids de
ses ans, on ne peut s'empcher de
penser qu' l'ge o Updike a crit
Couples, Faulkner, Hemingway,
Fitzgerald avaient publi leurs
chefs-d'uvre et que Thomas Wol-
fe tait bien prs de sa mort.
Jean Wagner
Salvador Emondo
Farabeuf ou La Chronique
d'un Instant,
trad. de l'espagnol
par Ren L.F. Durand
Gallimard, d. 190 p.
C'est la photo du Leng Tch'e
- le supplice chinois dit des
Cent Morceaux -, prise en
1905 Pkin et publie pour
la premire fois dans le Trait
de psychologie de G. Dumas,
qui inspire ce premier roman
d'un jeune Mexicain, ou plutt
qui lui fournit son motif :
une uvre, crit Octavio Paz,
froide et tincelante comme
un chteau de couteaux (un
castillo de navajas) ...
On connat l'utilisation que fit
Georges Bataille de cette mme
photo dans les Larmes d'Eros.
On connat moins son apparition
rpte ailleurs : dans un tableau
du peintre espagnol Jos Gutierrez
Solana, dans Marelle de Julio
Cortazar - au chapitre 14 : un
Chinois, Wong, la porte toujours
sur lui et introduit une variante
de lecture : l'objet de la torture
serait une femme _. D'une faon
mtaphorique, dans Crmonie
d'un Corps, de Giancarlo Marmo-
ri, et, finalement, dans Farabeuf.
Le livre d'Elizondo n'est que
la mise en spectacle de la photo.
Un amant sadique fait dpecer
vivante sa matresse suivant la
mthode des Cent Morceaux, de-
vant un miroir, bien sr, et par
un expert :t : la chose se passe
Paris, et son excutant est le
Docteur Farabeuf qui s'est illus-
tr, au cours de sa jeunesse, au
Grand Amphithtre de la Fa-
cult, par son adresse amputer
les memhres tumfis des cada
vres, et qui se prsente aujour.
d'hui trs simplement, comme un
homme habill de noir, une grosse
valise la main (ce sont ses ins-
truments de travail), la dmarche
lente. Son parcours, la nuit de la
crmonie (squence sur laquelle
le rcit, bris, fait sans cesse re-
tour), est bref et bien du quar
tier :t - il reste trs attach
l'Ecole de Mdecine - : il part
de La Pergola, aprs y voir bu,
jusqu' la dernire goutte, ner
veusement, un petit verre de cal-
vados, tourne droite, continue
rue de l'Odon et s'arrte, par
hasard :t, devant le numro 3.
L'alnour nlort
Au moment o Farabeuf fran
chit le !!euil de l'immeuhle, la
victime, assise au fond du cou
loir, agite dans le creux de ses
mains trois pices de monnaie
qu'elle lai88e tomber sur une
table avec un petit bruit mtal
lique... Quel est ce jeu ? A
entendre le bruit que font les
trois pices en tombant successi
vement, on peut conjecturer
qu'il s'agit de la mthode chi-
noise de divination au moyen
d'hexagrammes symboliques :t.
Mais le narrateur entend autre
cho!!e : c le bruit peut-tre de
AVIS
Quand on lira
ee Une : inoises
de puehe droite... ;
attaquez le bord
Ilauohe du pied...,
poursuivez jsuqu'
la faoe droite du
membre...
pas tranants (les pages de Fara
beuf dans l'escalier ?) ou d'un
objet qui glisse au-deS$us d'un
autre en produisant un son com-
me celui de pas tranants, couts
travers un mur :t ; peut-tre
encore le glissement d'une plan.
chette indicatrice sur une autre
planche plus grande ; nous voici
alors renvoys l'oui-ja, cette
mthode divinatoire tradition-
nellement considre comme une
partie du patrimoine magique de
la culture occidentale , et qui
rappelle par un de ses lments,
d'ailleurs, les hexagrammes :
chaque extrmit de la planche
est grav un mot significatif : le
mot OUI droite et le mot NON
gauche... allusion la dualit
antinomique du monde qu'expri-
ment les lignes continues et les
lignes brises, les yang et les yin
qui se combinent de soixante
quatre laons diffrentes pour
nous donner la signification d'un
instant :te Un jeu, un instant dont
la voix narrative (dtache et
s'adressant aux personnages tour
tour), avertit l'amant que,
pour ainsi dire , il contient
le sens de sa vie toute entire :t,
aussi bien.
Un sens, en tout cas, reprer
moins dans ce qui se voit que
dans les systmes de 8ignes qui
commandent la repr8entation.
A l'arrive du Matre l'tage,
tout est prt pour la ractiva
tion :t de la photo. Mais on a coma
pri8 que cette mi8e mort, plu8
qu'un travail propre :t, doit
tre la clbration d'un rituel :
autant dire la foi8 une question
et une rponse : l'exposition d'une
nigme, le trac d'un rbus, la r-
ptition d'une formule incanta-
toire, qui euxmme8 surgis!!ent
comme la solution d'un autre pro-
blme pos en un lieu inconnu,
d'une interrogation demeure pr-
chiffre.
Une prmisse analogique sou-
tient effectivement toute la mille
en acte de Farabeuf .: 8ur la photo
du Leng Tch'e les bourreaux se-
raient disposs en un hexagone
qui se dveloppe dans l'espace
autour d'un centre constitu par
le supplici ; or, cette disposition
renvoie la reprsentation c qui.
voque d'un idogramme chinois
qui se prononce lri., qui est celui
du chiffre 8ix, mais dont les traits
rappellent prcisment le corps
d'un supplici.
L'exprience de Farabeuf serait,
au plus exact, la dramatisation
d'un idogramme, le retour ce
qui est reprsent par le trac si
gnifiant (ici, le supplici) et qui
se trouve vacu au niveau du si
gnifi (ne retenant ici, du sup-
plice, que le nombre, six, de8 8UP-
pliciant8), la rupture, donc, de la
figure qui constitue tout 8igne
daus sa matrialit, l'explication
du rfrent qui s'inscrit dans la
trace et qui est plu8 accessible
pour un langage idogrammatique.
La praxi8 mticuleuse du Matre
invertit et renvoie toute mta-
phore sa littralit initiale.
Une comparaison, ds lors, peut
clairer tout le projet. Dans sa
Crmonie d'un corps (1), Mar.
mori structurait un rituel sadique
pris son niveau 8ignifiant - les
gestes -, pour le dmentir et
crer une dception au niveau du
signifi - la 80uffrance -. Son
criture tait celle d'une phra!!e
sadique vide, celle d'un faux
idogramme: derrire l'apparence
signifiante, il n'y a rien; elle n'est
qu'un pur trac, un geste qui ne
Excutiop, en Chine en 1905
renvoie qu' lui-mme, une invo-
cation prive de lIens. Elizondo,
au contraire, veut reprer, mettre
en vidence, la prsence du 8igni.
fi, dmontrer que tout 8ignifiant
n'e8t qu'un chiffre, un thtre,
l'criture d'une ide : un ido-
gramme. Une c 8eCOUS!!e :t du 8i
gnifiant - dan8 ce cas-ci, le trac
du li -, une espce de prise au
corp8 (2) de l'idogramme, doit
permettre le reprage d'Un sens
:premier - en ce cas-ci, la torture.
Comment crer une phra8e, une
organi8ation de graphes 8ans 8UP-
port, un emblme 8ans 8ens, un
rituel tladique san8 80uffrance ?
Telle tait la que8tion pose par
Crmonie d'un corps. Qu'est-ce.
qui a donn lieu au graphe, de
quelle ralit chaque lettre est-
elle le hiroglyphe, qu'est-ee qui
se cache ets'ab8ente derrire cha-
que .signe ? Voil la question que
eemble poser Farabeuf.
Pour le lecteur franais, trop
hahitu aux ( fre8que8 :t, aux
c: 8agas :t, au dferlement peycho-
logique du roman 8uppos c nou-
veau :t mexicain, ce livre annon-
cera san8 doute une rupture. Rup-
ture qui explique l'ambigut, en
dfinitive, de la dmarche: Faro-
beuf remonte du spectacle la
lettre, mais cherche dans la lettre
le rever8 motiv d'un sens.
SetJero Sarduy
(1) 1966, traduction aux Ed. du Seuil.
(2) CoauDe on dit li: prendre la
lettre lt.
La Quinzaine littraire, du 1" ou 15 janvier 1970
7
ROMANS
FRANAIS
Erotisme et satire
1
Michel Bernard
La Nue
L'Or du Temps d.
La nue, elle, qu'elle tire ses
charpes dans le ciel blanc, ou
qu'elle 1Jacille, crase de chaleur
opaque, hsite encore pouser
le songe clibataire : femme ou
nue, d1Joile ou toutes 1Joiles,
elle chappe ellemme comme
au regard qui 1Joudrait la pi.
ger .... la Nue est le dixime
romanrve de Michel Bernard,
peut.tre le plus parfaitement rv
et crit. Donnant sa parole aux
phantasmes (nus, nues, nuages),
Michel Bernard est-il le pote des
songes vcus ou de la vie fve,
on ne sait - mais il en est ainsi
de la plupart qui se satisfont de
Andr Masaon : Fem_ damna (1922)
8
rombre du geste, ou de rcho du
pou1Joir... la Nue est un rve,
o le rveur mme est inclus, se
rve lui-mme.
Rve aberrant qui, venu du
feu, forme la Nue, puis opre,
page aprs page, son retour au
feu - criture nue et qui n'en
finit pas de se vtir et de se d-
nuder, ellemme attentive et
sa propre consumation : comme
une nonne se consume, perptuel-
lement attenti1Je ., la nue se fait
et se dfait, pendant que se con-
fondent l'auteur, le lecteur et les
personnages dans une mme et
anxieuse tentati1Je d'interprta.
tion.
L'art est ici semhlahle celui
des haruspices : mantique, inter
prtation des signes les plus incer
tains, les plus mouvants - l o
tout semhle symbole mais o rien,
vraiment, n'est symbolis. C'tait
aussi la dmarche de la Ngresse
muette (voyeurs voyants et voyeurs
vus) : de l'auteur, du lecteur et
des personnages, on ne sait qui
pie qui - chacun se fait devin
ou traducteur, jaloux : il s'agit
d'pier les signes auxquels la v
rit se trahit, incertaine vrit
d'un Eros Energumne toujours
dj mis en fuite par les paroles
qui l'apprivoisent. Car la Nue
chappe : la trouvant, je me perds
ou je la perds - et, de mme la
vrit, le fin mot de l'histoire, son
fil qui n'est autre peut-tre qu'un
film.
Cinma d'une pouvante, cela du
moins est sr - mme si l'pou.
vante, la perte, l'errance, s'inti
tulent ici sexe, rotisme, raffine
ment. La Nue est un livre inspa.
rablement rotique et austre qui,
s'il pose l'angoisse tout son pro-
blme, est aussi un extraordinaire
et pervers di1Jertissement. En ce
fm o la chair, les corps, sem
hlent jouer le premier rle, nous
ne saisi880ns de la scne relle
que des doubles et leurs multiples.
Le livre est un jeu de miroirs
artistement disposs en dcor et
qui, ne refltant rien que leur pro-
pre reflet, leur bante et femelle
vacuit, invoquent et suscitent
des corps qui seulement feignent
1
Michel Bernard
Le Chevalier Blanc
Christian Bourgois, d. 344 p.
Michel Bernard, qui crivit na
gure de beaux romans d'amour et
de dlire, s'attaque tout--eoup la
soeit de consommation. Il prsente
son rcit comme un hommage don
Quichotte, Bouvard et Pcu-
chet. Ce soin est bien regrettable.
A la lumire que distribuent ces
grands noms, le rcit de Michel
Bernard perd quelques couleurs.
L'histoire est ordinaire. Elle dit
qu'un jeune homme s'appelle M.
Blanc et s'occupe de dtergents. Il
villgiature en Espagne, fait l'rotis-
me une dame, subit les moqueries
de trois jeunes filles. Le rcit n'est
pas trop mal fait, il lui arrive d'avoir
du mQuvement.
L'ennui est que le sujet contami-
ne le livre. C'est l'inconvnient des
satires : on est sans cesse menac
de se prter leur jeu.
Que sont ces corps lan
gages (1), phantasmatiques ido-
les berces dans le foyer noir des
miroirs prolifrants ? Ces quasi.
corps (ou quasi.incorporels) me
nacent la page et la vie mme,
brlent en se redoublant, en se
ddoublant. La nue est grosse
d'orages. L'on souponne en un
clair (c'est peut.tre la profonde
leon du livre) que le corps peut.
tre n'est que dcor - dessous, la
fulgurance, le feu : l o il n'y
a que dcor, se dit il, la vie peut-
elle se perptuer ?
La question n'est si vaine que
d'tre mal pose, car la chair aussi
est dcor et l'esprit souffle o il
1Jeut . Corps : dcor - espr&t :
feu ? Cette (implicite) question,
qui fait de Michel Bernard un
mule des stociens, voire de Ba-
taille ou de Klossowski, s'abrite
dans les interstices de la fiction,
au creux, au cur de la Nue. On
demeure libre de ne considrer
le livre que comme une trs belle
uvre de littrature rotique .,
mais ce serait mconnatre ce que
devient ou peut devenir cette lit-
traturel plus qu'aucune autre
peut.tre lorsqu'on la rend la
sauvagerie de ses lments.
lean-Nol Vuarnet
1. Expression utilise par G. Deleuze
(La du .em) propoe de
KlOSIIOwski.
d'tre aussi plat que les travers
qu'on dnonce. M. Blanc et ses aco-
lytes nous infligent d'interminables
conversations sur lesquelles ne sur
nagent ni une ide, ni une trouvail-
le, ni un bonheur.
Il y a belle lurette que la btise
est l'une des mamelles de la littra
ture franaise et il est vrai que Flau-
bert a montr la voie. Mais il inno-
vait et puis c'tait Flaubert. Ses
deux imbciles y gagnaient une ma
jest faustienne. Rien de tel chez les
pigones.
Ce qui aggrave le cas du chevalier
blanc, c'est que les personnages
chargs de l'intelligence sont
aussi dserts que le pauvre M. Blanc
lui-mme. Les trois jeunes intellec
tuelles qui perscutent M. Blanc
sont d'pouvantables bas-bleus. Il
suffit que ces pcores ouvrent la
bouche pour qu'on ait envie de fer
mer tous les livres, y compris celui
ci.
G.L.
PO'=SIB
Qute de la
#
poesIe
Jean-Pierre Burgart
Failles
Mercure de France, d., 80 p.
1
Jacques Dupin
L'Embrasure
Gallimard, d., 124 p.
1
Celui qui lit un recueil de
pomes ne peut parfois s'em-
pcher de supputer dans quel
sens Ira le recueil suivant.
Avant d'tre partie d'une u-
vra et d'une volution mesu-
rable, un recueil de pomes
forme pourtant un tout rcla-
mant chaque fois pour soi-
mme un regard neuf. Qu'on
apprcie ou non ('Embrasure
de Jacques Dupin, Failles de
Jean-Pierre Burgart, on est
conscient d'un souci essen-
tiel d'agencement en livre, en
objet achev.
Jacques Dupin n'est pas un p0-
te se laisser prendre l'inflation
littraire. Il n'avait rien publi de-
puis six ans, mais comme ce ne sont
pas ncessairement les uvres yolu-
mineuses qui en imposent le plus,
on ne l'oubliait pas pour autant.
Lorsque, en 1963, parut Gravir, le
recueil reut de la critique un ac-
cueil chaleureux.
On peut s'en tonner aujourd'hui
quand on relit cette uvre fonda-
mentalement livresque. L'pithte
mrite sans doute quelque explica-
tion. On apprciait dans Gravir un
got no-classique pour la maxime
(<< Dam la connaissance du fleuve la
pile de pont l'emporte sur la bar-
que), pour la pointe mme (1gno-
rez-moi passionnment ), et jus-
qu' de discutables mots d'auteur
(II /'ai jou pour perdre et j'ai ga-
gn : je suis perdu). On trouvait
agrable que l'auteur dmarqut les
formules de Ren Char (<< La pesti-
fre, les dieu% la possdent de-
bout ) ou de Saint-John Perse (0: Il
gouvernait la croissance asctique
des lances parmi lesquelles je nais
sais ). Jacques Dupin ne procdait
pas aiilsi de propos dlibr; celui
qui crivait : je n'ai plus la vo%
sche des adolescents qui guettent
les dtonatiom tait sans doute le
premier s'y mprendre. C'tait la
voix d'un crivain adaptant sa voca-
tion au style des potes les plus co-
ts du moment, et chez qui le Van
Lerberghe (Il 0 ma parole - Qui
trouble peine un peu - D tes ailes
- L'air du silence bleu ...) tournait
au Mallarm :
o ma parole en perte pure,
Ma parole semblable la rtraction
d'une aile extrme sur la mer!
tandis que l'Henri de Rgnier (0: Il
m'a suffi de ce petit roseau... Et
j'ai, du souffle d'un roseau, Fait
chanter toute la fort. ) finissait en
Saint-John Perse :
Il a suffi que j'emporte ton souffle
dans un roseau
Pour qu'une graine au dsert
clatt sous mon talon.
Vraisemblablement fortuites, ces
rencontres n'en taient pas moins si-
gnificatives.
En rappelant les limites d'un re-
cueil prcdent, on ne craint pas de
diminuer un pote quand il produit
ensuite l'Embrasure. Six ans entre
les deux recueils ne se sont pas
couls en vain, et ceux qui avaient
salu Gravir se trouvent avoir raison
contre ceux (j'en tais) qui n'esp-
raient pas voir sortir Jacques Dupin
des rminiscences. Il est un de nos
meilleurs potes. Qu'on en juge :
Les treuils, les cordes, les pou-
lies, - les volants et les leviers - les
manettes, les trappes, les glissires -
la poussire et les aboiements toute
la machinerie du thtre mental se
met en marche, fonctionne vide,
fonctionne pour le vide, pour le di-
vertissement du vide...
lusqu' ce que le fleuve en crue
sur lequel est flottant ce thtre,
s'engouffre entre les colonnes et les
ors, et apporte un dnouement une
vacance ternelle de drame. Tout ce
qui roule entre mes tempes, de s-
cheresse et de cailloux, les faire
clater, comme travers un cirque
de montagne qui amplifie son gron
dement, et roule, et dferle contre
vos genoU%...
L'originalit est atteinte d'emble,
sans dtonatiom adolescentes, les
fulgurations sentencieuses ont laiss
place un art dont la violence, pour
tre sous-jacente, est d'autant plus
vidente. Ce n'est plus ici la pointe
finale mais le dnouement ncessai.
re et inattendu; l'effet dramatique
a gagn de la force tre trs dis-
cret. Jacques Dupin s'est achemin
vers plus de simplicit et si sa voix
a gagn en autorit, c'est que, juste-
ment place
t
elle n'a plus hausser
le ton. Des mtaphores fortes et in-
dites sont prsentes avec sobrit :
L'tang dam la fort, l'enfance
comme une branche immerge
tire par surprise la berge
et qui scintille contre-jour.
Dans une admirable suite de pro-
ses intitules Moraines, Jacques Du-
pin expose, non un art potique,
mais un essai de dfinition de sa
propre qute de la posie. Ni mage,
ni phare, le pote n'est qu'un hom-
me; mais sa fonction est vitale :
Le pote n'est pas un homme
maim minuscule, mow indigent et
moim absurde que les autres hom-
mes. Mais sa violence, sa faiblesse et
son incohrence ont pouvoir de
s'inverser dam l'opration potique
et, par un retournement fonc14men-
tal, qui le comume sam le grandir,
de renouveler le pacte fragile qui
maintient l'homme dam sa division,
et lui rend le monde habitable.
C'est l l'humilit d'un vrai pote
face son art.
JeanPierre Burgart n'est pas une
voix nouvelle. Avant Failles, il avait
publi quatre ans plus tt, aux m-
mes ditions, Ombres. Il nous y pr-
sentait des rivires, des montagnes,
des forts et des champs. Chez Bur
gart, comme chez Dupin, peu
d'hommes: en dehors du pote, tout
au plus un autre personnage, une
femme, une seule. La prose lgato
du pote convenait son propos :
le m'enfonais la suite de l't
vers le cur de la montagne en re-
montant le cours du torrent dans la
pnombre forestire que remplissait
le silence; de l'alpage encore mon-
taient selon le vent les tintement.s
des troupeaU%, les tendres mugisse-
ments, l'appel d'un berger...
le me suis confondu avec cette
obscure solitude.
Se levait en nos mmoires - un
peu malgr nous, car ce discret ly-
risme requiert aisment la sympa-
thie - le fameux sentiment de la
nature de nos cours de rhtori-
que. Burgart ne procdait pas
coup d'ellipses et d'pithtes percu-
tantes, mais droulait cette prose
propre dont un pote du sicle der-
nier disait qu'elle tait plus difficile
crire que les vers.
Le lecteur qu'Ombres avait rete-
nu risque d'tre dllOncert par l'o-
rientation nouvelle du pote dans
Failles. A la premiere page, il trou-
ve:
Jacques Dupin
Seule me touche l'indiffrente
simplkit du ciel, dsert et lumi-
neU% dam tes yeux, comme ail-
leurs, au fond d'une solitude bleue
que nul vent ne dchire. tremble
une toile.
Cette solitude bleue, cette toi-
le tremblante, cette fausse prose,
presque un quatrain (ciel - toile,
yeU% - bleue), nous ramnent Paul
Fort. Ailleurs, ce seront des allit-
rations insistantes dans la pire tradi-
tion symboliste :
Notre nant rciproque nous uni-
ra, dlivrs, travers l'infini dsol
d'une nouvelle nuit.
Au mieux, nous trouverions un
disciple attard de Mallarm (<< De
son modle vacu, ma parole ne
rappelle que l'vanescence... J) ).
Comme autrefois le premier Dupin
voquait, mais combien plus discr-
tement, l'impassibilit du ciel, Jean-
Pierre Burgart va voquer la vacui-
t, l'inanit, sonores ou non, ses tor-
tures devant la blancheur adore,
la blancheur suffocante :
...m'prouvant obscur je devieR$
la peme fragile et dcisive de la lu-
mire, son dsir, son cho anticip
qui la profre en s'cunortisMmt.
...Ce qui s'nonce moi s'abolit
dam la noirceur sauvage dont je ne
suis que l'cume hasardeuse.
Du pote qui avait crit Ombres,
on n'attendait pas qu'il se regardt
page aprs page. L'acte potique -
voyez Moraines - n'a pas lieu de-
vant la glace. Attendons le pro-
chain recueil.
Serge Fauehereau
L. Quinzaine littraire, du 1- au 15 janvier 191Q
9
Une
; .
poesie de l'exil
Luis Cernudo
Luis Cernuda :
La Realidad y el Deseo
La Ralit et le Dsir-
Trad. par Robert Marrast
et Aline Schulman
Prface et choix
de Juan Goytisolo
Coll. Posie du Monde entier
Gallimard d. 179 p.
Compagnon de la premire
heure de Federico Garcia Lor
cal, seul pote de la gnra-
tion de 1927 qui ait joui d'une
pleine et universelle popula-
rit, Luis Cernuda est mort
Mexico en 1963. Il avait re-
nonc en 1938 ses espran-
ces espagnoles en mme
temps qu' ses fonctions
l'Ambassade de Paris. De
France en Angleterre, des
Etats-Unis au Mexique, il a
connu vingt-cinq annes de
dracinement et de solitude,
pour finir mconnu, oubli,
mal aim, lanant ses com
patriotes d'amres vrits :
10
Vous ne m'aimez pas, je sais...
... je suis, sans pays et sans peuple,
un crivain bien trange...
Ai-je voulu qu'on se souvnt de
moi?
Cette voix solitaire nous est pr-
sente pour la premire fois en
France dans un choix fort judi-
cieux de Juan Goytisolo, qui le fait
prcder d'une prface savante et
tendre, pleine d'motion fraternelle
pour l'un des derniers potes en-
fants du sicle.
La posie de Cernuda est essen-
tiellement une posie de l'exil. Bien
avant la dbcle et la ruine, sur ce
plateau brlant dans ses hail-
Ions qu'est l'Espagne, cette Il im-
possible patrie , il se sent menac
et banni. Il n'y rencontre que cou-
ronnes renverses , l( dieux cruci-
fis , tours d'pouvante et
barreaux menaants . Blason d-
dor de l'Espagne ternelle! Que
nous sommes loin des exaltations
puriles d'Unamuno, des vaines
gloires hispaniques d'Azorin! Ce
petit.fils de la gnration de 98 a
vir sa cuti. L'essence de ce pays
est l'interdit.
Le pote, de par sa nature m-
me, y est tranger. Comment ap-
plaudir l'esprit et rclamer des
chanes ? Comment aimer et les
splendeurs baroques de Gongora et
la fte stupide et cruelle des
taureaux? Cernuda, rpondant
Larra qui fut peut-tre le seul Espa-
gnol lucide du sicle pass - mort
en 1837 -, ose dire : Ecrire en
Espagne ce n'est pas pleurer, c'est
mourir . Cet Espagnol contre-
cur voit dans le meurtre de
Federico l'amre vrit se faire
jour :
Vo pourquoi ils t'ont tu :
tu tais verdeur
pour notre terre aride,
azur pour notre air tnbreux.
Deux couleurs qui ne sont assu-
rment pas celles de l'Espagne o
Hemingway relevait les teintes de
pus, sang et permanganate. Car les
couleurs vivantes sont proscrites
dans ce pays morbide, cette terre
en noir et sang. L'histoire de mon
pays lut crite - dit encore Cer
nuda - par des ennemis acharns
de la vie . Aussi est-il Espagnol
la manire de ceux qui ne peuvent
tre autre chose .
Mais est-il Espagnol ce pote qui
a lu Holderln, et peut-tre Rilke,
qui se rclame de Becquer, ce ro-
mantique allemand n par erreur en
Espagne, qui reoit le message de
Gide dans le pays le moins apte
tolrer pareille subversion, qui voue
Verlaine et Rimbaud l'affectueuse
admiration du disciple? Rien de
moins hispanique que ces Plaisirs
interdits qu'il publie en 1931, et o
il exprime sa rvolte contre le ma-
riage, la piquette conjugale , la
famille (je-vous-hais !), la religion
des dieux crucifis et sanguinolents,
les lois puantes , la socit, avec
des accents de la rebellion surra-
liste de Breton et de Crevel qu'il
connut, peut-tre, dans les annes
1928-29 lors d'un sjour Paris.
Tout comme eux il sait que le
pote est un boute-feu, car il est
presque toujours un rvolutionnaire
qui, comme tous les hommes, man-
que de libert mais qui, la diff-
rence de ceux-ci, ne peut accepter
cette privation et se heurte un nom-
bre incalculable de lois aux murs de
sa prison . Chez cet homme
trange l'homosexualit devient,
comme pour l'auteur des Nourritu-
res' terrestres, le moyen du dfi et de
la libration. Le symbole en est,
proche du gitan lorquien, ce jeune
Andalou qu'il invoque en 1934-35 :
parmi les fantmes transis
qui peuplent notre monde,
tu tais une vrit,
l'unique vrit que je cherche,
plus que vrit d'amour,
vrit de vie.
Son dsir insens bute contre
l'troite frontire de la ralit. Tou.
te son uvre potique, de 1924
1963, traduit ce conflit essentiel.
C'est pourquoi elle fut rassemble
et publie sous le titre expressif
la ralit et le Dsir .
Cet amant de la vie, de la lumi-
re et de la libert connat avec
l'exil de 1938 un autre cauchemar:
celui du Nord et de sa vomissure
d'ennui et de brouillard . Il dcou-
vre, dans son errance anglo-saxonne,
l'affreux monde pratique, l'affai-
rement curant des marchands et
des fourmis, l'ignoble idal du ren-
dement et du Capital. A la condam-
nation de l'Espagne s'ajoute ds lors
celle de la socit de consomma
tion que Goytisolo, dans sa prface,
rapproche abusivement, ce nous
semble, de l'attitude d'un Unamuno
mprisant le progrs et la techni-
que. Quel pote a jamais chant les
charmes indcents de Wall Street et
les chauffements lubriques de la
Bourse ? Qui dira l'insondable ver.
tige des supermarchs? Il n'en de.
meure pas moins que cette frustra.
tion essentielle de son Dsir, de man
que gagner sur le bonheur lgiti-
me conduisent naturellement Cer-
nuda vanter la beaut du monde
primitif, du rivage idal du rve,
quter le pur amour d'un dieu
adolescent , fuir la terre, la vie,
les hommes, soliloquer avec sa
solitude, cette treinte infinie,
rechercher la fin de tout et mme
du langage, ultime rempart du dsir
sur la ralit. L'aboutissement de
cete posie de l'exil est dsespoir,
amertume, retrait, oubli :
...Si vous voulez
que j'aime encore, rendez-moi
le temps de l'amour.
La ralit est morte, mais le dsir
subsiste : fivre de vie, passion de
feu, ardeur de l'impossible. Et la
beaut d'une langue - l'espagnol
- pourtant maudite par le pote
loin de ses sources. Voix ptrie
d'amour, flure, c'est peine si
nous la dcouvrons aprs ce long
parcours de silence. Cernuda dis-
paru, son uvre se dresse, s'adresse
nous, singulirement prsente.
Albert Benssoussan
Un grand moraliste
Andr Billy
de l'Acadmie Goncourt
1
Andr Billy
Joubert, nigmatique
et dlicieux
Gallimard, d. 234 p.
J'ai donn mes fleurs et mon
fruit : je ne suis plus qu'un tronc
retentissant; mais quiconque s'as
sied mon ombre et m'entend
devient plus sage. Telle est la pre-
mire des Penses de Joubert, dans
le recueil tabli et. publi par Cha-
teaubriand. Qui vient maintenant
s'asseoir l'ombre de Joubert ?
Il Y a, c'est vrai, une socit des
Amis de Joubert, qui rassemble
des fidles de qualit. Oui, le mo-
raliste contemporain de la Rvo-
lution et de l'Empire a encore des
admirateurs, et Andr Billy les
cite dans l'ouvrage qu'il vient de
faire panltre : Joubert, nigma-
tique et dlicieux. Jadis ce fut
l'abb Pailhs, plus tard Andr
Beaunier ; ce sont aujourd'hui
Raymond Dumay, Maurice An-
drieux, et aussi Gabriel Marcel,
Jean Guitton, Andr Monglond,
Georges Poulet... Et Andr Billy
lui-mme qui, d'abord rticent,
avoue-t-11, trouvant Joubert goste
et paresseux, s'est laiss apprivoi-
ser. Aprs Diderot, Stendhal, Bal
zac, Sainte-Beqve, Mrime, les
Goncourt, dont 11 a nagure crit
les biographies, 11 s'est donc pen-
ch sur Joubert, et mme il lui
donne la prfrence, puisque c'est
avec lui qu'il efit souhait passer
une journe, un mots ou une sai-
son.
DITEURS
Une rentre littraire trs attendue,
chez Fayard, celle de l'auteur de
Treblinka, JeanFranois Steiner. Il
s'agit cette fois d'un conte rotico-
messianique. trs violent, intitul Les
Mtques, ces derniers symbolisant
les laisss pour compte de nos so-
cits dans leur combat contre les
brets basques ou partisans de
l'ordre tabli, le tout entreml de
paraboles et de rminiscences bi-
bliques.
Chez le mme diteur paraissent
deux ouvrages qui ne manqueront pas
de susciter un certain nombre de
rapprochements puisqu'ils se rappor-
tent tous deux la mme priode
de notre pass rcent: le troisime
volume des Mmoires de Jacques
Duclos (voir le n 59 de La Quin-
zaine) qui porte comme sous-titre
De la drle de guerre Stalingrad
et. dans la collection Grands Do-
cuments Contemporains ., Debout,
partisans!, par Claude Angeli et Paul
Gillet, o se trouvent voqus les
dbuts de la Rsistance dans les
milieux communistes. Autres titres:
Pourtant, du livre mme d'Andr
Billy, Joseph Joubert ne sort pas
grandi, ni sympathique. Il manque
par trop de chaleur, mme s'il
fut bon (Je n'ai jamais appris
parler mal, injurier et mau-
dire. - J'imite la colombe : sou-
vent je jette un brin d'herbe la
fourmi qui se noie.) Il manque de
passion, ce pour quoi Andr Billy
lui dnie juste titre l'pithte de
romantique. Certes, il fut honnte,
courtois, discret (rien de lui n'a
t publi de son vivant), 11 de-
meura loign des affaires publi-
ques, le plus souvent dans sa mai
son de Villeneuve-sur-Yonne, car
11 aimait la campagne. Mais, avec
une parfaite bonne foi et mme,
pourrait-on dire, avec une fot par-
faite, 11 fut troitement conserva-
teur sur les plans politique, social
et religieux. La Rvolution lui avait
fait prendre dfinitivement en
horreur la ,fois le' dsordre et la
philosophie des lunires. Converti
aprs une jeunesse libertine .,
il applaudit le Gnie du Christia-
nisme et Napolon. Ami de Cha
teaubriand, il fut aussi celui des
officiels Fontanes et Mol.
Quant vie sentimentale, s'il
fut paisiblement fidle la femme
qu'il avait pouse, sans passion
bien so.r, il fut tout aussi paisible-
ment (Andr Billy cite nombre de
ses lettres) l'ami tendre mais r-
serv de Pauline de Beaumont puis
de Louise de Vintimille.
Tu trahiras sans vergogne, par Phi-
lippe Azzlz, document sur l'action
de la Gestapo franaise et notam-
ment sur la bande Bony Lafont qui
rendit si tristement clbre la rue
Lauriston; Doriot, par Dieter Wolf,
biographie traduite de l'allemand; Ces
princes du management, par Henri
Hartung, essai fort svre sur le
patronat franais, et Le P,rti de l'en-
treprise, par Gabriel Banon et Daniel
Huguenin, qui se pr sen t e, au
contraire, comme une dfense de
"entreprise prive franaise face la
politique des trusts; La Loi du retour,
par Jacques Derogy qui, au terme
d'une minutieuse enqute mene au-
prs des survivants, s'est efforc
de reconstituer la vritable histoire
de l'Exodus .; Amerlcan Foreign
Pollcy, par Henry A. Kissinger. o se
trouvent rassembls trois essais de
celui que l'on tient communment
pour l'minence grise des trois der-
niers prsidents amricains en ce
qui concerne la politique trangre
des U.S,A.; Lnine vivant. un album
de photographies prsent par Lucien
Rioux.
Reste une incontestable intelli-
gence, et un style parfois prcieux
mais incomparable, et qui du mo-
raliste fait un pote. Intelligence
et posie, c'taient, comme chez
Mallarm ou chez Valry, de gran.
des, d'indissociables allies : Je
voudrais tirer tous mes effets du
sens des mots, comme vous les ti-
rez de leur son... - Vous allez
la vrit par la posie, et j'arrive
la posie par la vrit. Il se
savait, sans vanit, un esprit su-
prieur : J'ai trop de cervelle pour
ma tte; elle ne peut pas jouer
l'aise dans son tui. Mais, pour
lui, tre intelligent c'tait un
moyen de sentir son me, donc la
seule faon de vivre. Il se disait
une me qui a rencontr par ha
sard un corps, et qui s'en tire com-
me elle peut. C'tait cette me qui
lui offrait, en mme temps que le
recours Dieu, l'espace intrieur
seulement il pouvait se mouvoir:
Dans mes habitations, je veux qu'
se mle toujours beaucoup de ciel
et peu de terre. Mon nid sera d'oi-
seau, car mes penses et mes pa-
roles ont des ailes.
A de si beaux accents, on sent
bien que si Joubert tait un mo-
raliste, 11 tait avant tout un pote,
un crivain. C'est apparemment ce
qui le rend cher Andr Billy, qui
dans cette biographie crite avec
vivacit et sensibilit a tenu sur ce
point lui rendre hommage. Dli-
cieux, Joubert apparait rarement
comme tel au long de ces pages.
Le. Revues
Esprit (Dcembre 1969). L'essentiel
dp. cette livraison est consacr diIf-
exposs sur la socit de consom-
mation, avec plaidoieries et rquisitoires.
Il ne semble pas que cet ensemble renou-
velle la question dj abondamment
traite depuis dixhuit mois. La littra-
ture est reprsente par des pomes de
Roman Brandstaetter, crivain polonais
vivan,t en Isral.
Les Temps modernes (Novembre 1969,
nO 280). L'Algrie (un essai de descrip-
tion), le Brsil (des documents prcieux
sur la guerre rvolutionnaire), l'Italie,
le Mexique et la fin des passionnantes
rflexions dt; Lucio Magri sur les v
nements de mai, tels sont les principaux
ples d'attraction de ce' numro.
La Noutlelle Revue Franaise (Dcem-
bre 1969, n
O
204). Le dernier numro
de l'anne 1969 s'ouvre par un texte
blouissant de E.-M. Cioran sur Paul
Valry. La posie est reprsente par
la trop rare Edith Boissonnas et par
Pierre Garnier. Roger Caillois tudie le
monde pictural de Remedios Varo qui
NIGMATIQUE ET DLlCIEUX
Mais nigmatique, certes, il le de-
meure, car on sait trop peu de
choses sur lui, et il semble d'ail
leurs qu'Andr Billy l'ait racont
un peu vite, plus vite en tout cas
qu'il ne fit pour Goncourt ou
Sainte-Beuve. Au fond, Andr Billy,
s'efforant de cerner Joubert en
parlant de lui comme d'un ami, ne
peut pas nous montrer une image,
car sans doute elle n'existe pas,
mais les facettes plus ou moins
sduisantes d'un tre ambigu, qui
tmrairement se voulut ang-
lique.
Lionel Mirtsch
fut, on le sait, la femme de Benjamin
Pret. Une nouvelle de Marcel Arland
complte la srie des textes. Les chro-
niques sont consacres Michel Butor,
Roger Judrin, Jean-Claude Renard, Wil-
liam Styron et Vieira da Silva.
Action potique (no 41-42). Il faut
croire que le groupe Tel Quel empche
beaucoup de gens de dormir si l'on en
juge par les commentaires qu'il suscite.
Sur 168 pages de cette revue, no lui sont
consacres. Hlas, en dehors d'un texte
de Philippe Boyer, d'une rfutation tres
prcise (et trs technique) de Julia Kris
teva par Jacques Roubaud et Pierre Lus-
son, ce ne sont que bavardages sans
grande porte. Et nous donnerons faci-
lement tout le reste du numro pour
les deux pomes de Yannis Ritsos, le
grand pote grec actuellement dport
par les colonels.
Les Cahiers du Chemin (no 7). Toute
l'artillerie de choc de la collection de
Georges Lambrichs s'est donn rendez-
vous : J.M. Le Clzio, Pierre Bourgeade.
Michel Butor, Michel Deguy.
r. Quiaiu.e littraire, dg 1" _ 15 jcnM 1910 11
SCIENCE.
FICTION
Hritage et conjecture
1
Fritz Leiber
Le Vagabond
Coll. Ailleurs et demain
Laffont d. 402 p.
Aujourd'hui, la littrature vi-
vante, c'est la Science-Fic-
tion -, cette devise courageu-
se prside au lancement de
la collection Ailleurs et De-
main -. Jusqu' prsent, on le
salt, la Science-Fiction n'a ja-
mais atteint chez nous l'au-
dience dont elle Jouit aux
U.S.A., en U.R.S.S., en Grande-
Bretagne, au Japon et dans
bon nombre de pays du mon-
de.
En lanant sa nouvelle collec-
tion, Robert Laffont tient le pari
d'attirer non seulement les habi
tuels lecteurs du genre, mais aus
si de lui gagner un public plus
large, jusqu' prsent ignorant ou
rebelle. Le succs de 2001, rOdys-
5e de rE5pace (1), mme s'il
s'appuyait sur un film, n'en tait
pas moins encourageant. Un au-
tre atout, et non des moindres,
est d'avoir confi la direction de
la collection quelqu'un qui con-
nat et aime vritahlement la
Science-Fiction, puisque Grard
Klein, auteur luimme de plu-
sieurs romans et recueils de noue
velles, se dmarque d'emble des
hahituels zlateurs du genre, qui,
caprice ou mode, se penchent sou-
dain sur lui d'un air protecteur
et lgrement mprisant.
Tel qu'il se prsente, tince-
lant de reflets gomtriques sous
son trange et luxueuse couver
ture mtallise, le Vagabond de
l'crivain amricain Fritz Leiber
(2) mrite de prendre place sur
les rayons de bibliothques en-
core fermes la
. Mais qu'il n'y ait pas malenten-
du! Le Vagabond n'est pas un
de ces romans qui frle la SF
sans l'avouer, ou cherche s'en
dmarquer par quelque procd
artificiel; il n'a pas besoin d'ali-
bi de cet ordre et son auteur, qui
approche aujourd'hui de la soi-
xantaine, est un spcialiste clont
la renomme dpasse le cadre des
Etats-Unis.
Ds les premires pages, le ro-
man exprime un intrt passionn
pour l'exploration de l'espace et
pour les mystres imagins ou
imaginables qu'il recle. Tandis
qu'aux quatre coins du morde et
14
sur notre satellite naturel. bas
tion avanc de l'humanit, des
hommes et des femmes poursui.
vent leur destin individuel, l'ap-
proche d'une clipse de lune atti-
re vers le ciel l'attention des sp-
cialistes et des curieux. Alors ap-
parat dans la nuit un ob.iet sph-
rique et monstrueux qui fait cla
ter dans l'obscurit ses mystrieu-
ses figures pourpres et orang.
A mesure que les minutes pas-
sent, les observateurs les plus
perspicaces. devinent, sans pour
autant l'expliquer, qu'il s'agit d'u-
ne plante inconnue, grosse com-
me la terre, et dont la prsence
au voisinage de la lune risque
d'avoir les consquences 1eR plus
funestes, du fait des nouvelles
forces d'attraction qu'elle dve-
loppe autour de nous. Ainsi, en
quelques secondes, le devenir de
la terre et de l'humanit toute
entire se trouve brutalement
compromis et bientt clatent
les premiers cataclysmes, trem-
blements de terre, ruptions vol-
caniques, temptes et mares gi-
gantesques.
Certes, du Pont sur rAbme de
Stewart (3) Seuls les Amants
5urvivent de Dave Wallis (4), en
passant par Ravage de Barjavel
(5), le thme de la catastrophe a
t largement utilis par les ro-
manciers de Science-Fiction aux-
quels il a souvent donn l'occa-
sion d'exprimer leur
d'un monde primitif. Le grand
intrt du roman de Leiber est
de se servir de cette catastrophe
pour une tude minutieuse de ses
rpercussions sur tel ou tel grou-
pe humain ou individu. L'al'pari-
tion du Vagabond dans notre deI
a beau marquer une coupure ir-
rmdiable dans l'histoire de
l'humanit, les structures pr-
existantes n'en continuent pas
moins fonctionner tant bien que
mal et, dans leurs efforts pour
s'adapter et survivre, les indivi-
dus emportent tout leur condi-
tionnement pass.
Dj Walter Lewino dfendait
une ide voisine dans l'Heure (6).
Ici, elle est exploite systmati-
quement, dans une optique plus
sociologique que psychologique,
grce au choix d'un chantillon
de groupes tmoins dont Leiber
nous dcrit le comportement par
flashes successifs tout au long du
roman. L'utilisation de ce proc-
d simultaniste :t montre assez
que Leiber ne reste pas prisonnier
d'une construction strotype,
bien que subsiste, malgr tout,
une ligne romanesque, par l'in-
termdiaire de quelques pf"rson-
nages-hros auxquels le If".('teur
est convi s'intresser plus vive-
ment.
Dans sa dernire partie, le Y4-
gabond introduit un second th-
me qui se greffe sur le premier
et l'enrichit considrablement:
par l'intermdiaire du Vageb'lnd,
les hommes entrent momentan-
ment en contact avec la ralit
de l'immense univers stellaire
dans lequel ils ne hasardent en-
core que des pas minuscules. Ce
qu'ils dcouvrent alors des civi-
lisations plus avances que les n-
tres et qui s'grnent dau l'espa-
ce, ne fait que confirmer ce aODt
la catastrophe leur avait fait pren-
dre conscience; la contradi<'tion
insoluble entre l'ordre et le d-
sordre dans toute socit intelli-
gente, le dsir de scurit et la
soif d'aventure, l'inertie et lfl dy-
namisme qui coexistent et Se heur-
tent au fond de nous et suscitent,
au niveau des groupes, des affron-
tements douloureux et exaltants
la fois. Cette rflexion appro-
fondie, mais jamais didactique
sur le rle de l'vnement :t
catalyseur, sur l'organisation de
l'Etat, sur l'avenir de l'individu
et des peuples, est, coup sr,
d'une actualit frappante. De la
part d'un crivain amricain
dj g et de grande diffuAion,
elle rvle un courage et une lu-
idit remarquables, mais non
point exceptionnels dans le do-
maine de la Science-Fiction.
Littrature ides, qui applique
le systme de la conjecture tous
les domaines de la connaissance,
pour l'intgrer une structure
romanesque, la SF est en mme
temps l'hritire de l'utopie phi-
losophique et d'une tradition nar
rative qui l'apparente au roman
d'aventure et suppose l'utilisa-
tion de toute une gamme de st-
rotypes.
Juliette Raabe
(1) Robert Laffont. (2) Leiher est
connu en France par un remarquable
roman A l'aube du tnbres, publi au
Rayon Fantastique ,. et malheureuse-
ment puis. (3) Hachette. (4) Stock.
(5) Livre de Poche. (6) Eric Losfeld.
PSyeBOLOGI.
Petite onirologie
d'Henri Michaux
Henri MichaWl: : Peinture ci l'encre de Chine, 1967
1
Henri Michaux
Faons d'endormi,
faons d'veill
Le Point du Jour
Gallimard d., 240 p.
La tendance actuelle tant
aux explications tt profondes-,
Michaux rappelle opportun-
ment qu'il y a, dans l'espace
du dedans -, des plaines
mesurer, des surfaces par-
courir. A ce type d'exploration
convenaient bien, semble-t-II,
les hallucinognes, avec leur
aptitude mettre en mouve-
ment des trains d'images et
de sensations. Le rve suscite
chez Michaux plus de rti-
cence.
Il y vient tard, singulirement
tard pour un crivain si soucieux
de prospecter ses territoires int-
rieurs. Serait-ce que la position
est trop solidement occupe par
la psychanalyse - ce qui ne man-
que pas d'agacer Michaux, qui
voit en Freud un remarquable
analyste et interprtateur qui,
avec IUtuce, s'ingnia prou-
ver etc. Parler d' astuce pro-
pos de Freud et de la Traumdeu
tung - laquelle, soixantedix ans
aprs sa parution, n'a apparem-
ment gure perdu de son pouvoir
d'analyse et d'interprtation et se
rvle tre autre chose qu'une
astuce - c'est avouer la pres-
que irrductihle allergie qui
spare Michaux d'une psychana-
lyse du rve identifie une psy-
chologie des profondeurs.
Avec Faons d'endormi, faons
d'veill, Michaux ne fouille donc
pas du ct des mcanismes oni-
riques, des structures inconscien-
tes, de ce puissant travail du
rve , dont la thorie freudienne
est parvenue faire passer quel-
ques chos, quelques hrihes dans
le savoir contemporain. Il s'agit
hien ici de faons d'tre, per-
ues, comme l'indique prcis.
ment le titre, dans leur dupli.
cation : registre de l'endormi, du
sommeil, du rve, et registre de
l'veill, de la veille, du jour.
Limitant sa prospection an do-
maine du suhconscient, Michaux
se tient, en dfinitive, au plus
prs de la conscience, des parti-
cularits du sujet individuel et de
ses proccupations quotidiennes.
Il n'est nullement tonnant, ds
lors, qu'il y ait, entre .ces deux
registres, dans cette douhle gamme
de faons, continuit, ou parall-
lisme, et que Michaux retrouve
dausl'endormi la tonalit majeure
- affective, ou intellectuelle, ou
plastique, ou, plus glohalement
encore, existentielle - de 1'veill.
Michaux apporte l'appui de
son interprtation des exemples
nomhreux, souvent suggestifs et
savoureux, et sans nul doute
convaincants - au moins quant
au niveau d'interprtation adopt.
Voici quelques modles :
Il rve qu'il est sous l'eau,
suhmerg, avec sensation d'touf
fement, et cette eau semhle avoir
comme signification essentielle,
dans sa tonalit onirique vcue,
ahsence d'air. La veille, Michaux
assistait la confrence d'un
psychiatre tranger : ah, cet
ennui!. S'ennuyer, touffer.
manque d'air, donc plonge totale
dans l'eau : telle est la faon
d'tre qui se prolonge, en plus
rducteur, en plus littral, de la
veille au rve. Autre rve : plu-
sieurs lions allant de long en
large, c( comme nous faisons lors-
que nous sommes enferms . La
veille, avait eu lieu une discus-
sion avec quelques chercheurs et
enseignants, chacun cherchant
placer son mot et se heurtant
l'ohstruction des autres; tels des
lions en cage; et tel s'offre le
rve, avec sa suppression typique
du terme de comparaison. Mi-
chaux rve d'un jaguar endormi
dans le chemin, rendu inof-
fensif mais condition de veil-
ler . Dans la vie relle, Michaux
se trouvait la mer, une cr: mer
devenue mauvaise, dangereuse ;
dangereuse comme un fauve, sui.
vant une quation familire : f-
lin = danger. Il y a aussi un autre
rve de Michaux richement fourni
en lion: s'tant rv lui-mme
lion, il voit confiuer dans cette
image la forme qu'il avait perue
dans le collage prsente par une
femme-peintre, et le jugement de
cette femme lui affirmant que
c'tait lui, Michaux, le lion. Juge-
ment favorahle qui se rencontrait
merveilleusement avec la propre
satisfaction de Michaux, heureux
d'avoir russi une lithographie,
aprs quinze ans de timidit.
Que Michaux se contente d'tahlir
le rseau analogique, ou l'isotopie,
de toutes ces images flines, est
une chose ; qu'il refuse, ou laisse
entendre, qu'il est de peu d'int-
rt de se pencher sur les mca.
nismes qui font surgir et s'orga-
niser ces images, c'est que tout
autre chose, et sans doute le point
o l'onirologie de Michaux se
rvle courte vue, et, trop sou-
vent, simplement tautologique.
L'efficacit en quelque sorte
pdagogique du petit livre de
Michaux - sans nul doute il
appartient chacun de faire pour
soi les analyses tIont Michaux offre
l'exemple et la mthode - risque
d'tre amoindrie, sinon annule,
par les perspectives manifestement
pjoratives dans lesqUelles Mi.
chaux peroit et prsente le. rves.
Selon Michaux, le rve dnigre,
avilit, rahaisse - en cela analogue
l'argot: mme cynisme, mme
imprulence, mme profllNJ-
teur, vil et voyou ; tendan,
crit-il plus loin, prsenter les
vnements mme rjouissants de
faon plustt avilissante, maligne
et dnigrante J); et ailleurs
radoteur... paTeil l'imbcile .
lugements hienvenus, s'il s'agit de
dgonfler un certain idalisme
nocturne, une mystique du rve
comme dtentenr de secrets, lieu
d'un savoir primordial, aussi rv-
lateur du pass humain - tant
l'individu que l'espce - que
capahle de prononcer l'avenir.
Mais c'est l pourfendre un adver-
saire en ralit hien dmuni. L'in-
terprtation de Michaux parat
plutt dirige contre une thorie
du rve qui ne peut tre que
d'inspiration freudienne, et qui
voit dans le rve le lieu, non seu-
lement d'une activit symholique
troitement lie l'inconscient, le
nommant, l'actualisant, et dilfu-
sant dans toutes les formes relles
et imaginahles, mais encore d'une
nergtique, d'une production et
d'une transformation mentales
enracines dans une perception du
corps propre et qui alimentent la
dynamique et la spcificit du
sujet.
Michaux relve fort hien que
les hommes sont semhlahles, et
se comprennent profondment, en
ce qu'ils sont des dormeurs, des
rveurs. Mais il faut hien voir
aussi quel point ce versant de la
condition humaine est dvalu,
occult, refoul : le Dr Jekyll se
pavane le jour, mais Mr. Hyde, la
nuit, avance en se cachant, se
fond dans les tnhres, tant qu'il
peut. Ainsi, la moiti nocturne
Ile l'existence humaine manque
l'homme : pareil quelqu'un qui
aurait deux jambes et se complai-
rait vivre en unijamhiste. Pour
difier le statut d'un homme
vivant la plnitude de son tre,
d'un homme total, il importe
d'tahlir - ou de rtahlir, s'il
est vrai que certaines socits
archaques en connaissent la pra-
tique - les communications entre
la veille et le rve ; seul un savoir
scientifique semhle capable d'ou-
vrir une telle possihilit. (1)
Roger Dadoun.
1. Si la psychanalyse du rve n'a pas
fait de progrs notables depuis L'Inter
prtation MS Rves de Freud, la physio-
Iop du tata de sommeil, dition du
de ces dernires annes, de Douvelles
et prcieuses lumires. Cf. Neuroplayso.
Iop .des tata de sommeil. dition du
Centre national de la Recherche Scien
tique, Paris 1965.
La Quinzaine littraire, du 1- au 15 janvier 1970
EXPOSITION
C agall avant 23
Chagall : L'autoportrait au% sept doigtl, 191213
Le GrandPalals retrouve ses
fastes d'antan. Aux Salons de
la Belle Epoque succdent les
Hommages, dans un cadre r-
nov, a u s s 1 somptueux que
Parly II. On a masqu la char
pente mtallique, construit des
niveaux relis par des esca
lators en panne, amnag d'im
menses halls, cafeteria et autres
salles sans doute de conf
rences ou de projection car un
oriteau en Interdit l'entre,
mais Il reste si peu de place
pour les tableaux qu'il faut
installer des pis dans les salles
qui leur sont attribues. Bref,
on se demande ce qui passe
par la tte des gens qui s'oc-
cupent de a, comme on se
demanderait d'ailleurs ce qu'on
va faire dans ce genre d'endroit
si, dans ces normes bataclans
que sont les Hommages, la 101
du genre n'Imposait en prlude
une vraie exposition de belle
et bonne peinture.
Chqall
'en la Ruai.
Chagall, c'est la Russie, c'est
Bella et travers les courants
artistiques de ce prodigieux pre
mler quart du sicle, la recher-
che du langage qui les expri-
mera. En quinze ans, tout sera
dit et partir de 1924 Chagall
mritera bien l'hommage qui lui
est rendu aujourd'hui.
Ds 1908, le peintre est l.
Chagall : Nu /lU peipae, 1911
1.
Non dans le quelconque Auto-
portrait (n 1), mais avec Le
petit salon (n 2) o dj la
couleur labore cette espce
d'apesanteur qui tmoigne d'une
recherche spcifiquement pictu-
rale et non pas potique sous
prtexte que plus tard, elle fera
voler les vaches et enverra les
amoureux en plein ciel. Un an
aprs, en 1909, Bella fait une
entre fracassante, les mains
sur les hanches (Ma fiance aux
gants noirs, n 7) et Chagall
peint la Russie paysanne, comme
Gontcharova et Malevitch.
D kao d. fauvUm..,
d. oubi.m..,
d. dmu.1ta1l61......
Mais alors que ceux-ci ont
recours ce thme travers
l'art populaire et le primitivisme
pour l'imprgner ensuite des
courants de la peinture occiden-
tale, Chagall l'en prserve et
peint les gens qui l'entourent.
D'emble, vlngt-deux ans, il a
rencontr son uvre.
On aperoit bien, et l,
quelques traces d'expression-
nisme, de fauvisme, de cubisme,
de simultanisme, etc. mais
c'est tout simplement qu'entre
1910 et 1914, Chagall est
Paris et qu'il voit beaucoup de
gens - mme Marie Laurencin
(n 45). Il vit la Ruche, Cen-
drars dresse l'inventaire de son
monde en un pome lastique
qui n'omet pas le Golgotha
(n 30) de 1912, lequel jouera
par la suite de bien mauvais
tours Chagall (La Rsistance,
n 103, L'Exode, n 174). Apolli-
naire parle son propos de sur-
ralisme, parole prmonitoire
que deux belles toiles de 1915
(La Lampe, n 48, et Fentre la
campagne, n 47) confirmeront
de faon trange et passagre.
Durant ces quatre annes, Cha-
gall cre Chagall avec une
blouissante matrise: les cou-
leurs clatent, tout s'envole,
ttes, attelages, vaches, mai-
sons, et les violons mnent la
danse. Mais pendant ce temps,
Moscou, ses anciens compa-
gnons crent le rayonnisme, le
suprmatisme...
En 1914, Chagall retourne en
Russie et la guerre l'y retient.
Il retrouve Bella dont il avait
emmen Paris le portrait de
1909 (l'Atelier, n 9). Il l'pouse
et la peint: en 1916 les Amou
reux en gris (n 49), en 1917
Bella au col blanc (n 50), le
Mariage (n 54), la Promnade
(n 57). le Double Portrait au
verre de vin (n 58) et, de nou-
veau, c'est tourdissant. Mais
1917, c'est aussi l'anne de la
Rvolution et Chagall se re-
trouve, en 1918, commissaire
des Beaux-Arts Vitebsk. Il y
fonde une Acadmie d'o Male-
vitch le videra proprement un
an plus tard. Qu'a peint Chagall
en 1918, en 1919? Mystre.
A-t-il repeint de couleurs cla-
tantes les faades de Vitebsk
avec Malevitch? Ou seulement
repris le motif de son aquarelle
de 1917 En avant (n 55) pour la
dcoration de sa ville, lors du
premier anniversaire de la Rvo-
lution clbr en 1919 ? S'il par
ticipe aux vnements, ce n'est
pas avec sa peinture et il fau-
dra attendre vingt ans pour que
Chagall peigne. hlas en 1937
(tait-ce aussi une clbration?)
cette Rvolution (n 82) qui fut
par la suite coupe en mor-
ceaux.
On imagine sans peine que
la Russie bolchevique n'est pas
celle de Chagall et qu'il ne peut
confondre, comme Malevitch, la
peinture et la Rvolution. Sans
doute est-ce pout cette raison
qu'il se tourne alors vers le
thtre et dessine des dcors
o l'on entrevoit l'influence de
son ami Lissitzky, jusqu'au jour
o il quitte dfinitivement la
Russie.
En 1923. Chagall s'installe
Paris et devient peintre de
l'Ecole de Paris. L'exposition
Chagall s'arrte l. Elle occupe
deux salles et tient soixante
numros au catalogue. Aprs,
c'est l'hommage: cent cin-
quante toiles qui ressassent du
rant cinquante ans un vocabu-
laire acquis en dix ans, un tas
de pierres o Chagall se prend
pour un sculpteur roman. un lot
de vaisselle et, pour finir. une
rot 0 n d e pnombreuse pour
contemplation de vitraux, avec
musique, s'il vous plat.
Marc.1 Billot
e s
La Quinzaine littraire, du 1- cm 15 janf)ier 1970
La section de l'A.R.C., anime
par Pierre Gaudibert, a fait de-
puis trois ans du Muse d'Art
moderne de la ville de Paris, un
des rares lieux d'animation et
de confrontation dans la capi-
tale, o le rituel des rtrospec-
tives se trouve bris par des
moyens d'approches divers: des
rencontres placent le peintre en
contact - parfois brutal - avec
le publc; tout un ensemble
d'activits (c i n m a, thtre,
danse, jazz, etc.) mettent en
question le monopole pictural du
muse; l'vnement, on le verra
par ailleurs avec fi Chur pour
six curs de Jean Dupuy, est
saisi dans son actualit. Avec
des moyens drisoires et des
pouvoirs limits, Pierre Gaudi
bert et tous ceux qui, d'une part,
soutiennent son action et qui,
d'autre part, collaborent avec
lui, sont parvenus donner
notre muse municipal une
place internationale.
Deux expositions, trs amples
et trs bien conues, confirment
le dmarrage d'une saison
qui avait dbut dans la grisaille
avec l'effondrement de la Bien
nale de Paris. Elles concernent,
par concidence ou volont dli-
bre, deux Italiens bien connus
Paris et dont les travaux se
sont imposs en quelques an-
nes. Cremonini montrait, en
dcembre, une rtrospective de
son uvre depui.s 1953 (vous
avez jusqu'au 4 janvier pour la
voir); Adami lui succde ce
mois-ci avec des toiles rcentes.
Les contacts entre les mou-
vements franais et italiens sont
la fois troits et assez mal
illustrs par le jeu des muses
.et des galeries. Les changes se
font plutt au niveau des artis-
tes et des critiques. C'est pour-
quoi ce doublet revt une signi-
fication particulire : il nous
montre comment deux tempra-
ments trs diffrents ont rsolu
certains problmes de la figura-
tion moderne. L'impressionnant
catalogue dit pour Cremonini
runit le texte de Louis Althus-
ser (considr comme fonda-
mental), et qui a exerc une
influence vidente sur la propre
vision du peintre sur son u-
vre), des extraits de prfaces
de Jacques Brosse, Max Clarac
Srou, Michel Butor, et une ana-
lyse chronologique de Pierre
Gaudibert particulirement mi-
nutieuse et pertinente. La ri-
chesse de l'appareil critique a-t-
elle gn la libre vision des toi-
les? Cela parat un paradoxe;
c'est pourtant ce qui est arriv.
La brillante tude d'Althusser,
par exemple, en faisant conci-
der le travail de Cremonini avec
le code structuraliste, a renou-
vel la vision que l'on pouvait
avoir de ce travail mals au prix,
peut-tre, de certains abus d'In-
terprtation. En renversant le
couple artiste-uvre, en dbus-
quant .Ia subjectivit. dans des
thmes qui demeurent essentiel
lement oniriques, en insistant
sur les aspects anti-humanistes
d'une peinture qui possde un
fort climat dramatique et ne
cesse de mettre l 'homme en
condition - jusque dans son
absence et sa fuite fugitive -
le philosophe, avec d'ailleurs le
consentement du peintre, effec-
tue une transposition . De
toute faon, dans ses ambigu-
ts, ses obscurits (ou plutt
dans sa prcision maniaque et
ses droutantes clarts) la pein-
ture de Cremonini ne cesse de
nous solliciter et de nous poser
des problmes. Parti d'un uni-
vers ni maniriste, ni expres-
sionniste, traumatis en 1961
par l'vnement politique (la
guerre d'Algrie), Cremonini a
trouv. depuis 1962, d'abord une
mise en page, dont les implica-
tions cinmatographiques sont
videntes, ensuite un vocabu-
laire qui fait appel aux signes
(les miroirs, les lments du
mobilier, les fentres, et plus
rcemment tout un jeu de pou-
trelles qui viennent arrimer, par
leur orthogonalit, la matire
mouvante du tableau). Que sa
dfinition de l'homme sans vi-
sage soit, comme chez" Recal-
cati, l'effet structural d'une
absence. (Althusser), absence
des rapports qui gouvernent
dans ses personnages leur
libert vcue ., c'est une Inter-
prtation intressante, mais on
peut lire cet anonymat en ter-
mes de fatalit, d'Interchangea-
bilit des destins, c'est--dire
sur un mode moins politique que
psychologique. Car Cremonini
est prsent dans chacune de ses
toiles avec tout le particularisme
que peut entraner une vision
venant tout droit d'un acquit
culturel trs localisable (le my-
the de la Renaissance) et dbou-
chant dans un monde devenu
absurde. La peinture de Cremo-
Cremonini
nini est autant une peinture de
signes qu'une peinture de
rapports ., elle est' autant
coercitive qu'objective, e Il e
choisit ses points de vue, la
nature et la forme des objets
qu'elle vhicule autant qu'elle
propose une relation' entre une
ralit donne et des sujets.
Adami, quant lui, reconnat
plus explicitement ses rapports
avec la mmoire, avec le temps
vcu d'une exprience humaine
qui donne aux objets une signi-
fication qui va trs au-del de
leur destination et de leur usage.
Peintre des associations. plus
Adami
que des rapports., il conoit
une imagerie de constantes mu-
tations dont l'tat final, fix sur
la toile, n'est qu'un des avatars.
De la mme faon qu'il part trs
en-de de l'objet, il conoit une
peinture qui va trs au-del de
l'uvre acheve, en laissant au
spectateur le soin de refaire le
chemin et d'aller encore plus
loin. Adami peignait il y a quel-
ques annes des sortes de puz-
zles o il dressait la panoplie
d'un ftichisme dont les carac-
tres n'ont pas disparu aujour-
d'huI. Mais un ordre est venu,
structurant l'image, matrisant la
Cremonjnj
Le C.N. A. C. dans la rue
sensibilit, qui clate cependant
dans la couleur. Adami suit dans
la toile un itinraire intrieur, au
cours duquel l'apparence se
trouve recompose selon un pro-
jet rvolutionnaire -.
La comparaison de ces deux
expositions sera trs intres-
sante faire : deux peintres,
Cremoninl et Adami, se dfinis-
sent par rapport au monde en
partant d'un schma non exempt
de manirisme, pour arriver
une plnitude qui soumet la
forme une pense teJlace :
"autobiographie s'panouit chez
chacun d'eux en une exprience
qui fait clater les limites troi-
tes du moi.
Grald GassiotTalabot.
(1) Jusqu'au 4 Janvier 1970.
Le Centre National d'Art
Contemporain a voulu, cette
anne, prendre possession de
la rue. Organises par Frank
Popper, plusieurs manifesta-
tion ont impos le fait lumi-
no-cintique : une sculpture
de Schoffer sur le terre-plein
du muse d'Art moderne, un
labyrinthe de Cruz-Diez au
carrefour Odon et une rali-
sation de Lily Greenham
Montreuil. Nous restons trs
loin du projet de Kowalski qui
devait illuminer le Chtelet.
Ce sera pour plus tard. Au
sige du C.N.A.C., rue Berger,
on nous montre en projec-
tions et en photographies ce
qu'auraient pu t rel e s
Champs-Elyses ficels par
Christo : un assez sinistre
emballage au puissant pou-
voir de dpaysement. L'expo-
sition choisit ses exemples :
Klein, Tinguely; Vostell est
le plus convaincant. Ben,
comme d'habitude, s'en tire
par une factie srieuse, mais
si ses cartons restent inac-
cessibles, il nous promet un
acte vritablement construc-
tif : Pendant cette exposi
tion, je vais balayer trois fois
ma rue., La curieuse salle
des Attitudes - runit Ray-
naud et Louw qui ont modifi
un mme lieu, l'un avec un
panneau, l'autre avec un tas
de briques. Un film nous mon-
tre que les passants ne s'en
sont pas aperus. Buren, in
vit d'office et film en dou-
blure hors de son consente-
ment, s'est dgag par voie
de justice posant un problme
juridique nouveau qui
jurisprudence.
A la galerie Sonnabend et
l'Arc, Jean Dupuy, revenu
pour quelques semaines de
New York, montre ses machi-
nes et organise un chur
pour six curs -,
G. G.-T,
Une nouvelle forme d'quipement cu.lturel
LE COLLGE GUILLAUME BUD DE YERRES
a 1 CES 1200 lves : enseignement gnral
b/ CES 1200 lves: enseignement
scientifique et spcialis
c / CES 1200 lves : enseignement pratique
d 1 Restaurant libre-service, salles
de runion, centre mdico-scolaire
e 1 Logements de fonction
f 1 Salle de sports avec gradins (1000 places)
et salles spcialises
9 / Piscine
.'''' h 1 Installations sportives de plein air
, i 1 Formation professionnelle
et promotion sociale
j / Bibliothque, discothque
". k / Centre d'action sociale,
ri garderie d'enfants, conseils sociaux,
accueil des anciens
1 / Maison des jeunes
m 1 Centre d'action culturelle:
thtre, galerie d'exposition, muse,
centre d'enseignement artistique
n / Foyer des Jeunes Travailleurs
LE COLLGE DE YERRES INTGRE, EN UN MME ENSEMBLE ARCHITECT.URAL, LES DIVERS aUIPEMENTS
SPORTIFS, SOCIAUX ET CULTURELS DE LA COMMUNE,
L'ENSEMBLE DE CES aUIPEMENTS EST AU SERVICE DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATIQN. LEUR UTILISATION.
TOUT Au LONG 'DE LA JOURNE, DE LA SEMAINE ET D.E L'ANNE, PAR LES JEUNES COMME PAR LES ADULTES.
ASSURE LEUR PLEIN EMPLOI.
18
ralisation gllPL'Abbaye. Yerres Essonne-925.39.80
MYTBOLOGIBS
Le dieu dm.ent
La Quinzaine
ABONNEZ-vous
abonnez-VOUS
1
Walter F. Otto
Dionysos, le mythe et le culte
Trad. de l'allemand
par Patrick Lvy
Mercure de France d. 251 p.
On peut comprendre raisons
.qui poussent publier aujour-
d'hui une traduction de l'ouvrage
cla88ique mais contest de Walter
Otto. D'abord parce que cet ou-
vrage important le mrite. S'u-
tout parce que le c problme du
dionysiaque est essentiel pour
nous depuis que la libration de
l'individu est l'ordre du jour.
Avec chaque effort pour dcou-
vrir le c a qui est au fond de
l'homme et pour dfinir une nou-
velle morale, nous sommes prts
couter tous ceux qui prten-
dent une connaissance plus ou
moins directe de cet inconnu que
nous ne savons pas nommer, leur
tmoignage ft-il vieux de plu-
sieurs millnaires. Comment com-
prendre autrement les repr!es p-
riodiques off-Broadway des Bac-
chantes d'Euripide, pice dont les
donnes sont la base de l'tude
de Walter Otto? Et, en gnral,
la formidable rsurgence de c dio-
nysiaque dont notre poque tout
entire est parat-il le thtre?
Dionpos
et l'Allemagne
Il n'est pas besoin d'tre grand
clerc pour souponner un malen-
tendu. Malentendu qui ne date
pas d'hier, qui remonte peut-tre
au premier qui essaya de dtermi-
ner l'essence de Dionysos (Tir-
sias, dans la pice d'Euripide) au
lieu de simplement reconnatre
sa puissance. Dionysos est ce qui
ne peut pas tre connu, et qui
il faut obir lorsqu'il ordonne.
Beaucoup sont sans doute l'heu-
re actuelle prts cette obis-
sance, mais le renoncement con-
natre le fond des choses s'accorde
peu au temprament occidental.
Ce qui frappe, la lecture du
livre de Walter Otto, c'est qu'il
pose le problme non pas du sens
absolu du dionysisme, mais du
rapport privilgi que l'Allema-
gne entretient avec ce dieu,
c nom sacr et symbole infini
pour nos plus grands esprits , dit
l'auteur. Goethe, Schelling, Hoe}-
derlin, Schopenhauer, Nietzsche,
entre autres, semblent avoir t
frapps par lui, avoir vcu son
contact autant sinon plus qu'Eu-
ripide. On crdite traditionnelle-
ment Nietzsche de la rhabilita-
tion du dionysisme; mais que
dire de cette phrase de Schelling,
cite par Otto : c la folie se d-
chirant elle-mme... toujours de-
meure le plus intime de toutes
choses, et, domine seulement
par la lumire d'une plus haute
intelligence et en quelque sorte
rdime par eUe, est la force
authentique de la nature et de
toutes ses productions. ?
Roelderlin, Niet.sohe
enfono_ vivanu
dan. la folie
Elle tmoigne d'une proccu-
pation constante de la posie et
de la philosophie allemandes au
XIX" sicle, et exprime la convic-
tion que l'artiste, dans ses mo-
ments de plus grande tension, en-
tre en contact avec une force
obscure qui n'est pas, ou pas seu-
lement, celle de son inconscienL
Elle jaillit du monde lui-mme.
Aussi le destin de Hoelderlin,
puis celui de Nietzsche, enfoncs
vivants dans la folie pendant de
longues annes, est-il pour beau-
coup de penseurs allemands, com-
me il l'tait sans doute pour les
deux potes, la preuve d'un lien
profond entre l'esprit grec et l'es-
prit allemand.
La science de l'antiquit (Alter-
tums Wissenschaft) fut en Allema-
gne jusque rcemment, le champ
d'une querelle lourde de cons-
quences entre ceux qui voulaient
comprendre la pense, et surtout
la religion, grecques la lumire
de la pense moderne et ceux qui
maintenaient qu'il fallait, suivant
le mot de Wilamowitz, c penser
grec au sujet de ce qui est grec
Ce dernier groupe tait son
tour divis entre les Il philolo-
gues pour qui c penser grec
impliquait surtout une tude ru-
dite des sources, et les c philoso-
phes , rsolus puiser la vraie
source, c lire pour phares
suivant l'expression de W. Otto,
cr les grands esprits qui ont port
sur le monde le regard le plus
Nanmoins, le contact
n'tait pas rompu entre ces deux
partis, frres ennemis plutt
qu'trangers l'un l'autre; et
comme Nietzsche, excut par le
Professeur Wilamowitz, a v ait
longtemps gard l'amiti du Pro-
fesseur Rohde, de mme Heideg-
ger n'est pas ignor par les clas-
sicistes allemands comme il l'est
par les Franais.
Le postulat
de base
W. Otto n'tait pas lui-mme
trs loin de Heidegger, avec qui
il voulut mme travailler une
nouvelle dition de la Volont de
puissance de Nietzsche. Cette pa-
rent se devine dans l'excellente
traduction de Patrick Lvy, qui
F. Fdier a apport son exprien-
ce de traducteur de Heidegger.
Le postulat de base de W. Otto
est que l'exprience religieuse
grecque, que nous connaissons
par les mythes et les rites, rend
compte d'un vnement, la rv-
lation du divin un peuple dter-
min, et nous ne devons pas cher-
cher rduire cet vnement
authentique en le considrant
travers notre conception de la pen-
se c mais au con-
traire c largir nos penses,
suivant le mot de Schelling, pour
nous mettre son niveau. Dans
le cas de Dionysos, ce parti-pris
donne ici des rsultats particuli-
rement heureux, savoir nn por-
trait solidement document du
dieu dment comme reprsentant
de la dmence du monde - et non
comme personnification d'nne cri-
se de dmence collective dont on
ne s'expliquerait pas l'origine -
(comme dans la thorie de Roh-
de). Sa folie est l'impossible unit
de la vie et de la mort, du eva-
carme et du c silence de mort
de la souffrance et de la joie
d'Ariane.
C'est l que la dmonstration
de W. Otto devient prilleuse :
il ne tente rien moins que d'lu-
cider l'essence du dieu qui fut
la source d'innombrables mani-
festations rituelles des Grecs, et
aussi, selon ses propres dires, de
quelques-unes des plus grandes
uvres de la pense allemande.
Or, ni les Tragiques ni ces po-
tes modernes n'ont abord Diony-
sos de front : leur travail a con-
sist chercher la forme la plus
approprie, la plus apollinienne,
l'expre88ion de la grandeur du
Dieu, et on peut dire que les plus
c dionysiaques ont t ceux qui
ont t p088ds par lui au point
d'y renoncer. Mais alors que
Nietzsche, par exemple, n'attei-
gnit Ariane qu'au moment o il
se sparait de lui-mme dans la
folie, W. Otto croit saisir Diony-
sos par la seule force du concepL
Malaise
dans la oivili..tion
Il y a plus inquitant : en iro-
nisant sur les travaUx des psycho-
logues, des sociologues, des ethno-
logues, il s'interdit de voir la pr-
sence imminente de Dionysos dans
la socit allemande, prsence dont
le symptme est ce Il malaise dans
la civilisation dont parlait Freud
en 1930, avec une autre lucidit. II
est difficile d'oublier quel aveu-
glement ce parti-pris devait condui-
re tant de savants allemands et Ot-
to lui-mme, comme si Dionysos se
vengeait, en les conduisant son
dlire, de ceux qui ne l'adoraient
qu'en paroles. II faut relire le Dio-
nysos de W. Otto, parce que le dieu
dment, qui nous chappe encore,
a laiss sa marque sur ce livre.
Pierre Pachet
La Quinzaine littraire, du 1" GU 15 janvier 1970
1.
LETTRES A LA
Qui a bombard
QUIJlZAINB
La Quinzaine
Uniralre
43 rue du 'fempl':. Paria 4.
C.C.P. 15.551.53 Paris
fait, il ne fait que confirmer l'vi.
dence des archives allemandes et
espagnoles. Prtendre, comme le
fait Southworth, que l'absence de
certains documents allemands ex-
clut toute possibilit d'en arriver
la vrit est un raisonnement so-
phistique. Parmi les documents
retrouvs, deux en particulier
(Tome III, numros 249 et 251)
manifestent un tonnement visible-
ment sincre devant les accusations
lances contre l'aviation de la l-
gion Condor. On voit mal pourquoi
la diplomatie allemande afficherait
cette ignorance dans des documents
de caractre secret. Au demeurant,
on voit mal pourquoi l'aviation
nazie aurait pargn le chne sacr
et la mairie, mme si ses moyens
techniques lui avaient permis
d'pargner un seul quartier de la
ville.
De surcrot, Southworth trouve
trange que je n'aie pas demand
mes Il amis espagnols de consul
ter leurs archives sur ce point. En
fait, j'ai pu examiner les textes
originaux que Luis Bolin avait ci-
ts dans son livre de mmoires. fi
s'agissait de dpches de campagne
du commandement nationaliSte,
faisant tat du fait que les forces
de Franco, en pntrant dans Guer.
nica, avaient trouv la ville d
truite par les RpubUcains.
A la lecture de ces dpches, ain-
si que des documents allemands,
j'avais pos l'hypothse de la non
responsabilit des nazis dans la des-
Q"uction de Guernica. Le tmoi-
gnage de Sir Archibald James, pos-
trieur la parution de mon livre,
confirme cette hypothse.
que je n'avais au dpart
pas le moindre prjug favorable
aux nazis. Bien au contraire, je
maintiens intacte toute ma dtesta
tion primitive du rgime hitlrien,
et des atrocits dont il fut responsa
ble. Mais force est de constater
que, parmi ces atrocits, il semble
dplac d'y inclure Guernica. Une
fois de plus, Southworth s'est mon-
tr plus soucieux de prserver le
mythe dont il a lui-mme une part
au moins de responsabilit, que de
la vrit historique.
Le restant des arguments dont se
sert Sotithworth pour discrditer
ma biographie est peu prs du
mme ordre de sophisme, et je ne
tiens pas ajouter la longueur
dj considrable de cette commu-
nication en les rfutant.
Brian Crozier
L'aviateur
qu'ut 'Sir Arohibald
avions avaient survol J ville et
que des bombes avaient t lches.
Je cherchai donc des cratres. Mon
examen des troia-quart3 de J vle
dtruite ne rvJ aucun dgt at-
tribuable de& bombes. D'autre
part, je parcourU3 J 'vle deux ou
trois fois et je dcouvris environ
une demi-douzaine de cratres de
bombes environ cent yard3 du p-
rimtre, toU3 de bombes qui, dans
la premire guerre auraient t des
bombes de vingt livres. La signifi-
cation des dgts consiste en ceci :
le quadrangle nord-ouest o &e trou
vaient J mairie, le chne &acr et J
cathdrale, tait ab,olument intact.
Pa3 un &igne de dgt3 d'une esp-
ce ou d'une autre. Dans les' trois
Gutres quadrangles (... ) J destruc-
tion tait complte et cawe par le
feu.
En fait, l'aviateur qu'est Sir Ar-
chibald James avait abouti la
conclusion que les dgts constats
ne pouvaient pas, pour des raisons
bien videntes, tre attribus
une attaque arienne. Pour quicon-
que se souvient du niveau techni-
que atteint par les vions de 1936-
1939, il est en effet inconcevable
qu'un bombardement arien, avec
des bombes explosives ou incen
diaires, peu importe, aurait pu lais-
ser un quart de la ville enttre-
ment intact.
Ce tmoignage me parat absolu-
ment concluant en soi. Mais en
IUpt.
occasion pour donner vos lecteurs
l'essentiel d'un des tmoignages
qui me sont parvenus aprs la pa-
rution de l'dition anglaise de ma
biographie.
Ce tmoignage, je le tiens de
l'Air Vice-Marshal Sir ArchU>ald
James, ancien dput conservateur,
ancien attach l'Ambassade de
Grande-Bretagne Madrid, dont
l'intgrit ne saurait tre conteste.
J'ajoute que, dans l'occurrence, la
capacit technique de cet aviateur
distingu'; n'est pas moins impor-
tante que son honntet.
Sir Archibald James a bien vou-
lu enregistrer son tmoignage sur
bande. Pendant la guerre civile, il
visita l'Espagne plusieurs fois en
compagnie d'autres parlementaires.
Il se rendit Guernica quelques
jours aprs la destruction partielle
de la ville et, sur les lieux, en fit
un examen minutieux. Voici quel-
ques extraits de l'enregistrement
(ma traduction) :
.... Ayczm pau trois am et de-
mi d4ns le Flying Corps pendant J
premire gUrre mondiale, j'avais
quelque conncrisMmce pour ce qui
est de l'aviation et des bombarde-
ment&, et je JXU$ai plwieur& bon-
nes heures examiner J dtuation
de 'trs prs. Ce que je consta-
tai, que les trois-quaTt$ de la
ville avaient t &y&tmatiquement
brl& jU3qu'au sol, d4na J mesure
o il est po$$ible de brler ces soli-
des difices espagnols. Les incen
dies taient compltement unifor-
mes. Un des rare& habitants qui
taient rest& me dcJra que des
souscrit un abonnemelit
0' d'un an 58 F l'Etranger 70 F
o de six mois 34 F 1 Etranger 40 F
rglement joint par
o mand!lt postal 0 cheque postal
o chque bancaire
Renvoye2 carte i
M.
Vill.
Daw
L'article de M. Herbert South-
worth : Une dfense de
Franco. (voir notre n 83)
propos du livre de M. Brian
Crozier (Franco, Mercure de
France). a suscit une lettre
de la part de l'auteur. Nous la
publions ci-dessous.
Notre coUaborateur rpond
M. Crozier. dans une lettre
que nous publions galement.
Je vous saurais gr de bien vou-
loir publier cette mise au point
relative la critique de ma biog:t;ll-
phie de Franco parue dans votre
revue le 16 novembre.
Que M. -Herbert Southworth, an-
cien porte-parole du gouvernement
de la Rpublique espagnole et au-
teur du Mythe de J Cro&ade de
Franco, n'prouve aucuil plaisir
la lecture de mon livre, voil qui
n'est gure tonnant. Ce n'est
d'ailleurs pas la premire fois qu'il
s'exprime en ces termes. .
Il nie ma (que des
historiens de la plus haute distinc-
tion, tels que le professeur Tre-
vor-Roper,. le professeur Seton-
Watson et bin d'autres reconnais-
sent). Je ne nie pas la sienne, .mais
je conteste sa bonne foi.
Il me reproche de ne pas avoir,
jusqu'ici, publi la nouvelle viden-
ce que je possde au sujet de
Guernica. La raison de ce silence
est purement technique. Cependant,
je voudrais profiter de la prsente
Lettre de M. Crozier
20
Guernica?
Rponse de
M. Southworth
M. Brian Crozier conteste ma
critique de ses conclusions dcou-
lant la fois de sa biographie de
Franco et d'autres dclarations p0s-
trieures, en ce qui concerne la
destruction de la ville basque de
Guernica le 26 avril 1937, durant
la guerre civile d'Espagne. Dans le
New Stateman du 26 janvier 1968,
M. Crozier annona que, la suite
de la publication de son livre en
Angleterre, une nouvelle vi
dence importante tait venue
lui et consolidait son postulat se-
lon lequel les Allemands n'avaient
pas bombard Guernica. Dans The
Times du 9 juillet 1969 il disait
avoir encore une nouvelle preuve
dmontrant que la destruction
massive de Guernica tait cause
par le dynamitage ays;matique
d'un quart de Guernica - et d'un
quart seulement - par les Rpu-
blicains en retraite.
Il vient maintenant de rvler
cette nouvelle vidence . C'est
une dclaration que lui a faite le
Vice-Marchal de l'Air Sir Archi-
bald James, et cette dclaration est
enregistre sur ruban magntique.
Loin de moi l'intention de nier l'in-
trt extrme de cette dclaration.
M. Crozier a agi correctement en se
la procurant et en la publiant. Le
fait de conserver cet enregistrement
doit peser lourd sur sa propre res-
ponsabilit devant l'Histoire, et
pour la tranquilit de son esprit,
j'espre que ce ruban magntique
est bien enferm dans un coffre-
fort de la Banque d'Angleterre.
Mais malgr de telles mesures de
scurit, M. Crozier doit passer des
nuitl blanches dans la cral;1te que
ce document puisse tre perdu ou
dtruit.
Eh bien, arrtons-nous un ins-
tant, et essayons d'imaginer ce qui
pourrait arriver si cette bande ma-
gntique tait perdue. Que pour-
rait faire alors M. Crozier? Ici,
heureusement, et en dpit de ce
qu'il appelle ma a: mauvaise foi,
je peux lui de quelque secours.
C'est du fond de mon cur que je
lui apporterai cette aide.
Si cet enregistrem.ent disparais-
sait, M. Crozier aurait la possibilit
de choisir entre deux solutions, ou
d'adopter les deux la fois. Il pour-
rait, en se promenant, al].er au Par
lement Londres, ou dans une
quelconque bibliothque gnrale
londonienne, feuilleter les compte-
rendus les dbats des Communes,
s'arrter la date du 21 octobre
1937, o James, alors simplement
lieutenant-colonel, raconta en
grands dtails, ses collgues par
lementaires, il y a trente-deux ans,
la mme histoire que celle que M.
Crozier vient de nous rvler .
Il peut aussi se rendre Colindale,
o le British Museum conserve ses
priodiques, chercher le numro du
19 fvrier 1938 du journal conser
vateur londonien, Daily Telegraph,
o James rpte le rcit de sa visite
Guernica. Un shilling, deux peut
tre, une photocopie, et Crozier est
possesseur de l'quivalent de son
enregistrement, ou de quelque cho-
se de mieux. Car, mon sens, la
mmoire de J mes tait plus fidle
en 1938.
Ainsi, en nous prsentant cette
nouvelle preuv&- aussi actuelle
qu'un journal vieux de trente et
une annes, Crozier, involontaire-
ment, confirme ce que j'ai tou
jours maintenu : ses recherches
sur la guerre civile d'Espagne sont
trs superficielles. Cette ngligence
est visible non seulement dans son
ignorance des deux !dclarations
antrieures de James, mais dans
la faon d'analyser cette troisime
dclaration. Dans The Times cit
plus haut, Crozier crivit que seu
lement un quart de Guernica fut
systmatiquement dtruit. Son
tmoin James parle des trois-
quarts . Dans sa lettre au Times
Crozier attribue la destruction de
la ville la dynamite. Son tmoin
l'attribue au feu, et ne mentionne
pas du tout la dynamite. De plus,
Crozier nous affirme dans sa lettre
que James visita Guernica quel.
jours aprs la destruction partielif!
(sic) de la ville . En ralit, en
1937, James dclare avoir visit
Guernica en octobre de cette mme
anne, c'est--dire presque six mois
aprs les vnements.
Je dois prsenter prochainement,
l'Universit de Paris, une thse
qui traite de la destruction de
Guernica, et je ne veux pas aller
jusqu'au fond de ce sujet aujour.
d'hui. Je dsire garder quelques
suprises pour Crozier. Entre temps,
peut-tre pourrait-il rflchir sur
les dtails suivants :
1) James tait un officier anglais
d'aviation pendant la Premire
Guerre mondiale. Rien de ce qu'il
a vu cette poque ne le prparait
ce qu'il a vu Guernica, dix-
neuf ans aprs, car jusqu'au 26
avril 1937, aucune ville comme
Guernica n'avait t dtruite par
des bombes incendiaires jetes
d'avions.
2) La comptence de James
comme observateur fut fortement
mise en doute quand il insista,
tant la Chambre des Communes
que dans le Daily Telegraph, sur
le fait d'avoir vu des clats d'obus
d'artillerie Guernica. Rien, ni
dans la documentation nationaliste
ni dans la rpubli<:.aine, ne montre
que Guernica fut bombarde par
artillerie. Ces documentations
apportent la preuve contraire.
3) Harcel de questions, aux
Communes, James admit qu'il
avait vu Guernica des traces de
bombes explosives et incendiaires.
4) Dans un effort de mettre
de l'ordre dans sa propre. confu-
sion, James crivit dans le Daily
Tele$faph que les dfenseurs
de la ville en retraite vers une
nouvelle ligne sur les hauteurs
l-'ouest de Guernica, avaient foute
raison et tout droit militaire_ de
dtruire la ville en l'abandon-
nant. Ici encore, je dfie la capa-
cit de James comme observateur
militaire. Guernica avait t la
proie des flammes depuis 60 heures
quand' elle fut vacue militaire-
ment le matin du 29 avril.
5) Autre dtail pour M. Cra-
zier: Dans le Daily Telegraph,
James cita le tmoignage d'un pr-
tre qui tait Guernica lors de la
destruction de la cit. Ce prtre
lui dit : Beaucoup d'a1'ions ont
survoU ta vliie, en aissaftt tomber
beaucoup de bombes; les routes
taient mitrailles par des avions,
c'tait le jour du march et il y
avait beaucoup de monde Guer-
nica... le total des morts fut d'envi-
ron cent. li
De l'aveu du tmoin du tmoin
de Crozier, presque 100 personnes
prirent - par le bombardement a-
rien de Guernica. Ce dlai doit
amener un soldat de la guerre froi-
de aussi expriment que Crozier
rflchir sur la ncessit de modi-
fier sa stratgie et de trouver une
base plus solide que le ruban ma-
gntique de James _pour renforcer
sa dfense de la Lultwaffe nazie.
L'engagement de M. Crozier
comme soldat --- ou plutt comme
officier - (arm de sa plume)
dans la guerre froide l'a conduit
la dfense de Franco et du fascis-
me espagnol. De l, il a t inluc-
tablement conduit la pOsition
expose, o il se maintient debout,
aujourd'hui, pour dfendre. seul,
la Luftwaffe nazie cOntre l'accu-
sation d'avoir dtruit la ville
ouverte de Guernica, et d'avoir mi-
traill les femmes et les enfants
en fuite. Je dis II seul car per-
sonne, ni en Espagne nationaliste
ni en Allemagne actuelle, ne vien-
dra sa rescousse.
Le cheminement intellectuel de
M. Crozier est triste en tant que
spectacle humain, mais il est lo-
gique.
Pour soutenir sa rputation
d'historien, M. Crozier prsente en
qualit d'aval, le professeur Seton
Watson. Toujours pour l'informa-
tion de M. Crozier, je suggre la
lecture de l'ouvrage de M. Seton-
Watson, Britain and the Dictators.
Aux pages 380-381 de ce livre,
le bombardement par les forces
insurges est qualifi l'un des
incidents les plus odieux de toute
la guerre. Pour ajouter l'in-
sulte l'injure , continue _Seton.
Watson, la progagande insurge
demanda l'Europe de w;roire que
les Rouges basques avaient
dtruit la ville pour empoisonner
l'opinion contre le gnral Franco.
Heureusement, il y avait des t
moins oculaires trangers et notam-
ment le correspondant du Times
pour dmentir cette fabrication
impudente, et cependant il y a
encore des gens suffisamment jo-
bards pour accepter l'histoire.
Ainsi, SetonWatson qualifie de
jobards les personnes qui sou-
tiennent les mmes opinions que
M. Crozier, sur la destruction de
Guernica.
A ma connaissance, Seton-
Watson n'a jamais reni cette posi-
tion. Comment alors, M. Crozie.r
ose-til mme suggrer que ses
conclusions sont garanties par
Seton-Watson ?
Herbert R. Southworth
P.5. : M. Czozier me qualifie d'an-
cien porte-parole du gouvernement de la
Rpublique espagnole Ji. En fait, en 1938,
j'ai abandonn mon emploi la Biblio--
thque du Congrs Washington, pour
travailler comme rdacteur et crivain en
faveur de la eaU8e de la Rpublique
espagnole; et co jusqu' la fin de la
guerre civile en 1939. Je luis fier d'avoir
fait le peu que j'ai fait, mais co peu
ne me confre certainement pas le rle
de porte-parole de la Rpublique espa-
gnole Ji. D'ailleurs, je doute qu'aucun
non.Espagnol n'ait jamais eu une telle
position.
La QuiDuine littraire, du 1" GU 15 janvier 1970
ETHNOLOGIE
Le massacre
1
Lucien Bodard :
Le massacre de& Indiens
Gallimard d., 487 p.
Il Dire que la civilisation blan-
che est, pour les autres civilisations,
l'univers, est dire que nous les
entourons, les enserrons, nous po-
sons face eU% un point tel que
nous avons, pour eux, humanis
l'univers, au dtriment de leur
propre hurnanlsation, et que leur
alliance ou compatibilit avec le
monde est devenue alliance ou
comeatibilit avec notre civilisa
tion. Cette compatibilit est pour
nous significative de leur rduc-
tion notre civilisation, la cl de
vote de leur comportement est
aujourd'hui l'ethnocide que nous
commeUons leur gard li (1).
Ainsi l'anthropologue Robert 1aulin
dfinit-il l'entrepri8e de destruc-
tion systmatique inhrente la
civiliaation blanche .
De longs et frquents sejOurs
chez les Indiens de l'Amazone,
Robert 1aulin rapporte la convic-
tion que cet ethnocide est inspa-
rable de la pense occidentale, tout
masqu qu'il soit par les valeurs
humanistes , les normes de pro-
grs ou du dveloppement .
L'ethnologue et l'anthropologue
eux-mmes portent une responsa-
bilit certaine dans cette destruc-
tion par intgration : le passage
de la sauvagerie sans rgle
l'examen de structures de rgle-
mentations complexes ne tmoi-
gnerait point d'une approche plus
raliste de la vie appele primi-
tive mais d'une mutation interne
de la civilisation blanche, muta-
tion inconBCiente et hypocrite per-
mettant de procder une intgra-
tion plus complte des tran-
gers .
Tout se passerait none comme
si la pense blanche se mysti-
fiait elle-mme afin de mieux
dtruire les groupes et les socits
humaines situs en dehors de son
propre systme de valeurs; comme
si la pense occidentale secre-
tait en mme temps des anti-
corps li lui permettant de garder
sa bonne conscience et d'exciper
de valeurs humanitaires tout
en p,oursuivant le lent travail de
destruction des socits diff-
rentes.
La pense de R. 1aulin tend, en
fait, la critique radicale de l'an-
thropologie, voire sa destruction.
De l'ethnocide qu'elle porterait en
elle-mme comme la nue porte
l'orage li, le livre de Lucien Bo-
dard nous apporte une confirma-
tion clatante. et fantastique.
Certes, la destruction des In-
diens d'Amrique du Sud est un
aspect - un aspect seulement -
de l'ethnocide perptr par l'Occi-
dent : entre les Australiens, les
Marquisiens, les socits ngres, les
Indiens d'Amrique du Nord et
du Canada, les peuples amazoniens
occupent une place de choix, mais
seulement une place.
Du moins, la description que
nous propose L. Bodard prend-elle
un aspect presque dlirant. L'au-
teur est all au Brsil, il s'est
enfonc dans le sertao li jusqu'au
milieu des terres o se confondent
l'eau, la boue, l'norme prolifra-
tion vgtale, les insectes, les rep-
tiles et les peuples nus que sont
les Indiens. L'image qu'il nous
donne de la fort est une des plus
saisissantes qu'on puisse lire; c'est
celle d'un visionnaire qui s'empare
de dtails rapidement aperus.
L, il est ais de constater que
l'limination des Indiens est ins-
crite dans la gographie mme :
hier, le caoutchouc, aujourd'hui
l'or et les diamants. Du monde
entier et pas seulement du Brsil
arrivent des aventuriers au pfo.
let rapide, la cruaut consom
me d'hommes seuls et menacs.
Ici, Bodard mle le pass au pr-
sent dans une fresque fantastique,
obissant aux lois d'une inflation
d'images et de mots qui dborde
le journalisme pour nous mener
aux confins d'une littrature pi.
qe : les cadavres des milliers
d'Indiennes et d'Indiens tromps,
bafous, torturs, massacrs se d-
roulent comme une fresque depuis
les bandeirantes li de la conqute
et les seringueiros li du boom
sur le caoutchouc jusqu'aux tech
niciens gringos li au regard glac.
Cela n'est pas sans rappeler 1&
grande vocation de Diego Rivera
du Palais national de Mexico...
En fait, Bodard relate trs peu
de faits rellement vus. Entre l'ta
blissement des frres Vilas Bou
chargs de sauver les Indiens, la
dcouverte de quelques postes per-
dus dans la fort, la visite des
gouverneurs dchus et quelques
bars de Brasilia, le support du re-
portage est mince. Mais pour avoir
travers au Brsil des rgions sem
blables, je puis tmoigner que le
sertao et l'immense Amazonie
sont d'abord l'univers du tmoi
gnage oral, que l'vnement parait
s'y drober, surtout ds qu'on le
cherche.
Mais dj dans ses livres sur
l'Indochine, Bodard utilisait cette
technique du tmoignage indireet
- ce que l'on pourrait appeler Je
dtour de Marlowe , du nom de
Ce rcitant qui, dans les roD1IlDS
de Conrad authentifie un rine-
des Indiens
ment que l'crivain n'affronte ja-
mais directement, comme le lui
avait appris Henry James. Le Mas-
sacre des Indiens pousse cette tech-
nique jusqu' l'exaspration: par
fois la plthore d'images dpasse
sOn but et l'Indien perscut de-
vient un fantme.
Cela tant, Bodard ouvre un
dossier : celui de la liquidation
physique des Indiens d'Amazonie
'lui, lentement repousss de la
steppe vers la fort, retrouve leurs
bourreaux dans l' enfer vert . Il
est singulier de constater que ce
grand peuple multiple et divers des
Indiens, d'Amrique semble avoir
t l'enjeu de l'enrichissement du
continent, au sicle dernier pour
les U.S.A. et le Canada, aujour.
d'hui pour les Amazoniens du Br
sil. On dirait que cette nation doit
mourir pour assurer la prosprit
des Blancs.
Qui donc porte la responsabilit
de ce gnocide ? Les gouverne
ments lointains et impuissants ?
Les hommes d'affaires yankee sou
cieux de faire place nette pour
exploiter paisiblement les riches
ses du sol ? La situation mme
d'une immense rgion ou n'exi!!te
aycune autre loi que celle du plus
fort ? Assurment tout cela en
semble.
Et cela ne suffit pas. Car Robert
Jaulin a raison : c'est la civilisa
tion blanche qui porte la respon
sabilit de cette destruction dans la
mesure o elle est devenue une
socit d'accumulation de marchan
dises et de production de la ri-
chesse. Une civilisation qui
n'admet les diffrences examines
par les a,nthropologues que pour
se donner bonne conscience et
poursuivre sa monstrueuse bouli
mie. Il serait peut-tre ncessaire
de procder une rvision gnrale
de nos rapports avec les autres
civilisations - et mme de nous
demander si la rationalit que nous
trouvons dans les cultures sau-
vages n'est pas un alibi ou un
masque. C'est l' autre enfin
que nous cherchons ab!lOrher,
digrer ou que nous dtruisons par
incapacit congnitale admettre,
rellement, la diffrence. Fanon,
dj, voici plus de dix ans, avait
pressenti cette mystification.
Jean Duvignaud
(1) Rapport au 4< congrs interna-
tional : Dveloppement conomique d!l
l'Arctique et avenir des socits esqui-
maudes , Fondation franaise des tudes
nordiques, Le Havre-Rouen, 1969.
1
J. Meunier et
A.M. Savarin
Le chant du Silbaco
Edition spciale, 206 p.
Le livre de Jacques Meunier
et A.-Marie Savarin, s'il fait cho
la grande presse qui, rcemment
encore, a montr que le gnocide
des Indiens n'avait pas cess, ne
saurait cependant tre rduit la
dimension d'un reportage d'ac-
tualit. Et s'il est nourri de rf-
rences ethnologiques et de science
rudite, il ne saurait, non plus,
tre dfini en termes universi
taires. Journal de voyage
aimerait-on dire, si le terme vou-
lait bien dsigner non seulement
le rapport d'vnements et de p
rgrinations mais aussi un ordre
imaginaire et affectif.
Notre enfanoe et
nos rves
Les auteurs ont beaucoup lu -
sans aucune censure du got ou de
la convention - journaux d'explo-
rateurs, travaux d'ethnologues, po-
mes, romans populaires, reportages
de grands voyageurs, et ils sont al
ls sur le terrain, la rencontre de
ces Indiens dont on sait bien qu'ils
sont gens comme nous mais qui
sont aussi les citoyens d'une loin.
taine patrie : celle de notre
enfance et de nos rves. Ce qu'ils
ont vu nous est donn dans les
entrelacs du lyrisme, du comtat
et de la dnonciation, et qu'on
peut rsumer ainsi : les Indiens
existent et ils meurent d'tre
indiens, incapables de se transfor
mer en civiliss, refusant les va
leurs d'une socit - la ntre -
qui ne sait leur offrir que l'exploi-
tation conomique, la dgradation
des murs et l'hbergement dans
les bidonvilles.
Une longue histoire
La longue histoire du continent
que le livre, sans la raconter res-
suscite par une technique en mo-
saque o les textes cits, les
analyses, les vocations, derrire
un dsordre apparent manifestent
une finalit fermement maintenue,
est monotone et triste dans sa r
ptition : gnie de la destruction
d'un ct, gnie de la survie de
l'autre, et toujours dfaite de
l'Indien. Il p.n va ainsi depuis que
les chevaux et les hommes venus
d'Europe ont apport les bienfaits
Indien Macou
de la rationalit technique, les
consolations des religions mono-
thistes institues en glises mili
tantes, les librations de l'alcool.
Notre civilisation affiche ses
prtentions l'universalit mais
est incapable de tolrer ce qui
n'est pas elle. Sourde ce que
dit , l'autre , elle transforme
en cendre ce qui ne devient pas
conforme sa propre nature. Bien.
tt, la plante purifie de ses
sauvages , la rumination soli-
taire de la rationalit n'aura d'au-
tre ennemi qu'elle-mme.
Chercheurs et professeurs pro-
testeront - peut.tre - contre
cette Edition Spciale qui
semble faire fi des rgles de la
rigueur et du concept. Deux rai
sons plaideront devant eux en fa
veur du livre : On assassine les
Indiens et il faut le dire vite car
le massacre, s'il ne cesse bientt,
trouvera sa fin dans la dispari-
tion des massacrs. Il faut aussi
le dire bien c'estdire de
telle sorte que l'opinion publique
l'entende. Le srieux d'un livre
qui parfois semble ne pas vouloir
tre srieux, c'est le srieux non
d'une thse mais d'un acte moral,
d'un acte militant qui, la chose
est rare, a la grce d'une chanson
de geste.
.Andr .Akoun
La Quinzaine littraire, du 1" cm 15 janvier 1970
BI8TOI
La Milice
1
Jacques Delperrie de Bayac
Hi5toTe de la Milice
Fayard d. 686 pages.
On peut s'tonner que, vingt-
cinq ans aprs l'effondrement de
la milice franaise, aucun ouvrage
de fond n'ait t consacr cette
unit suppltive que commanda
Joseph Darnand et dont le chef
lgal fut Pierre Laval. Des infor-
mations fragmentaires, disparates
ou partisanes peuvent tre glanes
dans un certain nombre de livres
qui traitent des annes quarante
quarante-cinq. Les rassembler,
les confronter, faire le tri ne suffi
rait pas reconstituer l'histoire
de la Milice.
On saura donc gr Jacques
De1perrie de Bayac - auteur d'une
remarquable tude sur Lu Bri8a-
des internatioruala - d'avoir fon-
d son ouvrage sur des documents
en grande partie indits et sur des
tmoignages recueillis par lui au-
prs de plusieurs de ceux qui fu-
rent non lMlulement des tmoins
privilgis, mais parfois les acteurs .
mmes de la guerre coloniale .
que, sur le sol de France, quelques
Franais, aux cts de Allemands
et avec l'appui officiel du gouver-
nement de Vichy, livrrent aux
autres Franais..
Pour commencer : une analf!e
freudienne de la li collaboration
(sur laquelle reposent la concep-
tion, l'organisation et l'esprit de la
Milice). Passant de la dfaite mili-
taire un sentiment de culpabilit
gnrale, les premiers partisans de
l'allgeance Hitler admirent et
finirent par souhaiter l'humiliation
sous les coups d'un vainqueur bru-
tal, viril, sans scrupules. On peut
affirmer que, ds 1940, la collabo-
ration emprunta l'inversion
IMlxuelle ses modes JI. Appliqu
des hommes qui se comportrent en
combattants et exposrent souvent
leur vie, cela peut paratre trange ;
en ralit, conscienunent ou incons-
ciemment, les miliciens en vinrent
lMl frapper eux-mmes en frappant
le corps de la patrie...
Rien d'tonnant si les princi-
paux responsables de la Milice fu-
rent des aigris, des solitaires, des
frigides ou des mous. D'une saisis-
sante srie de li portraits brosss
par Jacques Delperrie de Bayac,
on retiendra que Laval fut un ins-
table, un ambitieux sans vigueur,
curieusement attir par la crapule ;
que Damand, intellectuellement
peu dou, dpourvu d'imagination,
dbordait de ressentiment contre
l'arme qui ne l'avait pas jug di-
LA Milice au Vl' d'Hiv'
gne d'tre un officier ; que, trans-
fuge de la S.F.I.O., Marcel Dat
tait un excit froid JI.
Que ces rats fussent parfois des
exalts, qu'ils aient dcouvert, par
le li miracle de la dfaite, un cli-
mat propice leur besoin de revan-
che dans les milieux qui, en 1940,
n'avaient pas encore admis la R-
volution de 1789, l'Hi5toire de la
Milice le dmontre merveille.
Elle dmontre aussi, l'aide de
preuves accablantes pour les deux
parties, jusqu'o la Milice, approu-
ve par Ptain, s'est confondue avec
les sursauts et les spasmes d'un
rgime honni et condamn JI,
mais qui refusa de se dmettre,
compromis par sa collaboration avec
l'occupant, et li contraint, pour du-
rer. de se compromettre chaque
jour davantage. C'est un truisme
de dire que, sans Vichy, la Milice
n'aurait pas exist; ce n'en est
plus un de voir ses racines dans la
Cagoule et mme dans l'Action
franaise : les tueurs de la Milice
ont pris au srieux les appels de
Maurras au li couteau de cuisine
et la suppression des li mt-
ques , des marxistes et des Juits
(assassinats de Jean Zay, du pre de
Roger Stphane, de Mandel...).
Sans rien omettre des dissen-
sions entre les chefs, Jacques Del-
perrie de Bayac montre la conti-
nuit et l'unit d'un mouvement
qui, n de la Lgion des combat-
tants et du Service d'ordre lgion-
naire, s'est affirm paradoxalement
contre la Lgion des volontaires
franais (de Doriot, Dat et Bu-
card, rivaux de Damand) et, faute
de pouvoir s'avouer comme une
Phalange franaise (rplique trop
choquante de la Phalange espa-
gnole) a abouti la Milice - poli-
ee et arme parallle - qui prit
pour emblme le gamma, reprsen-
tation zodiacale du blier, symbole
de force et de renouveau, 0: car le
monde entre au printemps sous le
signe du blier JI.
Cete dose de purilit ordinaire-
ment prsente dans les liturgies fas-
cistes et nazies, Darnand n'en fut
pas exempt, qui, le jour de la san-
ce inaugurale de la Milice fran-
aise (31 janvier 1943), flicita la-
val pour la blessure glorieuse
qu'il portait dans sa chair .
Avec humour, dans le style fami
lier et percutant qui est une des
qualits de son ouvrage, Jacques
Delperrie de Bayac rappelle que la
glorieuse blessure (dont l'auteur
tait Collette) permit Laval, qui
n'avait jamais figur sur aucun
champ de bataille , d'tre reconnu
li pour brave par un brave bre-
vet et batterie de cuisine JI.
La modration dont l'auteur ne
se dpart pas dans ses jugements
sur les hommes et les faits ne l'em-
pche point de faire justice, avec
une heureuse vhmence, de la th-
se du CI: double jeu de Vichy. th-
se prcisment ruine par l'exis-
tence de la Milice : si Ptain avait
secrtement jou contre l'occupant,
auraitillaiss CI: sa Milice torturer
et abattre les patriotes ? En conclu-
sion, les abominations de celle-ci
dnonant l'abjection de celui-l,
li on chercherait vainement clam
l'hi5toTe de la France quelque qui-
valent au rgime de Vichy dont
l'incomptence avre (rarement
.tant de mdiocrit se trouva la
tte de l'Etat) n'est pas une ex-
cuse ab801utoire .
Maurice Chavarcl8
Au d but de l'hiver 1942,
Joseph Beuys participe, avec
son stuka (bombardier en
piqu Ju 87) une mission de
bombardement en Crime. La
neige se colle sur les vitres
de l'appareil, empchant le
pilote d'apercevoir les avions
de ses camarades. Alors qu'il
revient vers l'ouest, mission
accomplie, le stuka est
touch par hasard : son alti-
mtre drgl, il pique du nez
et son moteur, tournant
plein rgime, s'enfonce dans
le sol toute vitesse.
C'est un commando de Tatars
qui dterrera J 0 sep h Beuys,
enfoui parmi les dbris de m-
tal de son appareil... Sans doute
est-ce un autre homme qui nait
de cette exprience-clair de la
mort et de la rsurrection dont
Joseph Beuys conserve sur lui
le permanent symbole : ce gilet
d'aviateur de la Luftwaffe dont
il ne se spare pas plus que de
son sempiternel chapeau de feu-
tre. Mais quel est donc ce per-
sonnage aux yeux clairs jusqu'
la transparence, au visage ma-
ci d'ascte (la peau cireuse,
pre s que translucide, comme
pour laisser apercevoir le sque-
lette, ou la flamme intrieure),
auquel de Kunstmuseum de
Ble, "un des muses les moins
frivoles d'Europe. consacre en
ce moment une importante expo-
sition rtrospective (1).
Certains le tiennent d'ores et
dj pour l'artiste europen nu-
mro un, et pas seulement en
Allemagne et en Suisse : mme
Paris, o cependant on n'a
jamais rien vu de lui, Il com-
mence avoir des disciples et
il a boulevers Bob Morris, l'un
des leaders du Minimal Art am-
ricain. Et ce qu'jJ fait, quoi cela
ressemble-t-jJ? Justement, cela
ne ressemble rien. en tout cas
rien de ce que, jusqu' ce
jour, on nous a donn pour de
l'art. (Ce nous concerne, il
convient d'y insister, le seul
public parisien qui, en dpit des
efforts des galeries i1eana Son-
nabend et Yvon Lambert, n'a pas
eu encore la possibilit d'tre
confront une manifestation
d'ensemble de ce que l'on
nomme diversement l'art concep.-
tuel, l'antiforme, l'.rte povera,
etc.) .
L'artiste europen n 1?
Il Y a des amoncellements de
feuilles de feutre, des morceaux
de fer rouills ou des fragments
de caisses sur le sol et aussi
toute une srie de vitrines o,
sans la moindre tiquette ni
notice, s'accumulent des paves
tranges et banales telles que
rats morts, christs en chocolat,
abeilles englues dans leur cire,
tissus maculs, morceaux de
graisse... On dirait d'une exposi-
tion impromptue des rsultats
de fouilles par des archologues
qui auraient brusquement mis
jour les vestiges, assez peu p,r-
lants du reste, d'une civilisation
absolument inconnue jusque-l.
Ou encore la prsentation des
seules traces recueillies au len-
demain d'une catastrophe o
aurait disparu tout un groupe
humain : le naufrage du Titanic
ou, pourquoi pas, Auschwitz? Il
n'est pas encore exclu que Jo-
seph Beuys apparaisse en effet
comme l'archologue de notre
prsent et il n'est jamais agra-
ble pour un tre vivant de s'ima-
giner en quelque sorte comme
un tmoignage archologique en
sur sis... D'ailleurs, sans la
guerre, Beuys aurait t natu-
raliste ou spcialiste en zoolo-
gie.
Les procds de la
naturalisation
L'exprience dont j'ai fait tat
l'a en somme port rserver
l'espce humaine et ses
diverses activits, les procds
de la naturalisation. Mais on se
tromperait fort en limitant l'art
de Beuys cet aspect fig et
mnmonique. Au contraire, la
plupart de ses uvres s'ins-
rent dans une trajectoire sym-
bolique, dans le mouvement
d'une pense continue aux pri-
ses avec les matriaux de notre
dcor quotidien: non seulement
elles suggrent ou crent un
environnement, mais leur signi-
fication s'est souvent rvle
l'occasion d'un" happening - de
Beuys, de ce que l'on pourrait
appeler une parabole agie. Car
il n'existe pas pour lui de divorce
entre l'action et l'art. Bien que
ses uvres se situent aux anti-
podes du " ralisme socialiste
et autres pitreries propagandis-
tes, il dclare : J'essaye dans
mon art d'exprimer mon pro-
gramme politique.. Il Y a deux
Beur.
ans en effet que Joseph Beuys
a fond Dsseldorf, o Il est
professeur l'Acadmie des
Beaux-Arts (en A Il e m a g n e
comme aux U.S.A., contraire-
ment ce qui se passe en
France, les artistes d'avant-
garde obtiennent trs facilement
des postes de professeurs), le
D.S.P. (Parti des Etudiants Alle-
mands), lequel groupe aujour-
d'hui environ une centaine de
membres.
Mais de quel "programme
s'agit-il? En 1964, Joseph Beuys
propose que l'on hausse de cinq
centimtres le mur de Berlin :
les proportions en seront meil-
leures, assure-toi\. Un mur, en
tant que tel, est trs beau si les
proportions sont justes.. En
somme il n'y a que deux moyens
d'annuler l'existence d4 mur :
ou bien en faire un objet esth-
tique (et alors sa signification
douloureuse disparat), ou bien
" fonder sur l'auto-ducation une
meilleure morale dans 1
1
espce
humaine, (pour) que tous les
murs disparaissent -. C'est vi-
demment pour la seconde solu-
tion que milite Beuys, dont toute
l'activit cratrice prend ainsi
un sens moral trs appuy (ne
serait-ce qu' ce seul titre, il
s'inscrit en faux contre l'esth-
tisme creux du Minimal Art et
d'une bonne partie des bateleurs
du lumino-cintisme!). Mais, au-
del de ces ambitions morales
et pdagogiques (former des
artistes ne lui apparaissant que
comme une partie de ses de-
voirs l'gard de ses lves de
l'Acadmie) , il dbouche sur des
proccupations de caractre ma-
gique ou mystique.
Symphonie .ibrieD.D.e
Par exemple, son happening
intitul Symphonie sibrienne
(1966) t 0 ur n e autour de la
" division de la croix entre
Rome et Byzance et semble sug-
grer comme remde une diffi-
cile mal'che vers l'Est afin de
rconcilier les qeux moitis de
la croix. On ne peut s'empcher
de songer alors Novalis et
son texte Europe ou la Chr
tlent (1799) : CI Il y aura du
sang sur l'Europe (...) tant que
ne sera pOint clbr, en guise
de Ftes de la Paix, un immense
repas d'amour sur les ruines
fumantes des champs de bataille
avec des larmes chaleureuses.
Ce rve de communion univer-
selle, qui termine par exemple
une longue action respiratoire
de Beuys sur les paroles sui-
vantes : ft Pensez to.us ceux
qui respirent en mme temps
dans le monde chappe au
vague et la niaiserie grce
un objet comme La bche en
commun, munie de deux man-
ches, ce qui en rduit l'utUisa-
tion pratique mais en accrot la
signification symbolique! Celui
qui affirmait que Le silence de
Duchamp est surestim, partir
du moment o il pense que
ft l'poque des glises touchant
sa fin, le collectif forc ne
pOuvant rsoudre le problme
social, l'individu seul porte toute
responsabilit., n'a peut-tre
pas tort de vouloir mettre en
action des symboles visuels...
Des formules pour initis
C'est l, bien entendu, agir
davantage au niveau mystique
qu'au niveau politique propre-
ment dit. Nous savons du reste
que la cloison entre ces deux
niveaux est loin d'tre tanche
et aussi qu'une certaine insatis-
faction mystique cherche, chez
nos contemporains, se satis-
faire comme elle peut. Joseph
Beuys, pour qui la rvolution
n'est rien CI si elle ne se passe
pas d'abord dans l'homme ., me
parat namoins mieux fait pour
combler cette insatisfaction-l
que la revendication sociale et
conomique de type marxiste.
Son vocabulaire, volontiers obs-
cur, se plat d'ailleurs aux for-
mules pour initis comme Erd
telephon (tlphone de terre),
Eurasienstab (bton d'Eurasie),
Leberverbot (interdiction du
foie), Fettraum (pice remplie
de graisse). Mais il n'ignore pas
l'humour, comme le prouvent
ses pices de thtre en deux
secondes, sa Partition de chou-
croute (Manger partition!) ou
telle Recommandation: Si l'on
s'est coup, ce n'est pas au
doigt que l'on doit mettre un
pansement, mais au couteau...
Enfin, i1.y a l'tonnante prsence
de ses uvres, aussi peu" lit-
traires qu'il est permis et qui
doivent l'exceptionnelle con-
centration psychique dont elles
procdent (de 19S5 19S9 Beuys
a " expriment. quatre annes
durant la maladie, ses pouvoirs
et les moyens de s'en prmu-
nir) leur force tonnante.
Une qualit
En outre, le fait de s'accom
plir dans des matriaux dpour-
vus de toute raret et de tout
prestige leur confre une qua-
lit supplmentaire de gnra
lit, on pourrait presque dire de
popularit. (Par exemple, une
chose aussi simple q'un piano
queue emball et cousu dans
du feutre gris vous laisse assez
sidr. Pourquoi? Ah! diable,
si je le savais...). Mais voici en-
core Novalis: Quand je donne
au vulgaire un sens sublime,
l'habituel un aspect mystrieux,
au connu la dignit de l'inconnu,
au fini un reflet infini, alors j'en
fais du romantique... Joseph
Beuys, ce serait donc notre WiI
liam Blake? C'est ce que con-
testent certains, qui vont disant
que notre Blake c'est un autre
artiste allemand de gnie, Frie-
drich Schrder-Sonnenstern, en-
ferm depuis deux ans dans un
hpital psychiatrique de Berlin
et qui a jur de se doon.er la
mort si, pour les ftes de Nol
on ne lui rendait pas la libert...
Jos Pierre
(1) JWIqU'au 4 janvier 1970.
La Quinzaine littraire, du 1- au 15 janvier 1970
TBATRB
1Jn propos
1
Brecht et Kurt Weill
L'Opra de Ouat'sous
Thtre de l'Est Parisien (TEP)
L'Opra de Ouat'sous, crit
Bernard Dort, ouvre sur le vide;
il donne le vertige du vide -,
Nous qui ne connaissons de
l'uvre que les deux versions
cinmatographiques de Pabst,
l'allemande et la franaise, tou-
tes deux dsavoues par Brecht
et qui par un mchant caprice
du sort n'avons pu voir ni la
mise en scne du Berliner
Ensemble - ni celle de Strehler,
nous ne pouvons que rver
d'une reprsentation de l'u'#
vre qui donnerait ce vertige du
vide. Ce n'est pas te spectacle
du T.E.P., pour propre qu'il soit,
qui pourra combler nos imagi-
nations. Nous avons vu sur la
scne, trs correctement mis
en place, un opra au charme
seulement un peu insolite, un
opra des gueux, parfois sati-
rique et grinant puisque le
texte le comporte, mais d'une
consommation toujours agra-
ble, avec ses airs connus. Nous
n'avons jamais vu cette trange
machine, sorte d'opra sur
l'opra, ce spectacle de provo-
cation que Brecht a conu pour
laisser le spectateur bourgeois
le cul dans le vide, pris au pige
d'un spectacle qui ridiculise ses
propres gots, - ses gots de
bourgeois amateur d'opra -
dans le mme moment qu'il les
comble. La reprsentation du
T.E.P. joue l'uvre au premier
degr, elle joue l'opra avec ses
charmes et ses grincements, et
son folklore. Il n'est que de voir
se pmer d'aise les imbciles
de la bourgeoisie - (c'est un
mot de Baudelaire) qui, cha-
que pice de Brecht joue avec
la duret ncessaire, poussent
des cris d'orfraie qu'on viole,
pour comprendre que le spec-
tacle du T.E.P. ne rpond pas
prcisment au propos qui fut
celui du Brecht : il est dsa-
mort.
Le luxe du pauvre
Dans La noce chez tes petits
bourgeois, mesure que se
dglinguent tables et chaises,
tous ces meubles bricols par
le jeune poux, tout ce luxe du
pauvre qui veut faire riche, c'est
tout un univers social et moral,
- celui de la petite bourgeoi-
sie de Weimar ruine par le ca-
pital - qui se dcompose du
mme coup : la fausset des
rites, la mascarade des bonnes
manires, la comdie des res-
pectabi 1its et des beaux senti-
ments. Tout craque, tout se
dpiaute, tout fout le camp :
le vide, l aussi, se creuse sous
les pas; c'est un univers min
qui se dvoile sur la scne.
Dans L'Opra de Ouat'sous
les choses sont peu diffren-
tes; mais elle sont moins vi-
dentes, et les prestiges du faux
opra risquent de masquer ce
qu'il a pour mission de dvoi-
ler. Dans cette uvre pleine
de chausse-trapes, de piges
et de sapes, tout sonne savam-
ment faux, de cette mme faus-
set baroque par quoi Genet
irralise et rend au nant un
univers d'apparences. Mackie-
le-Surineur, Brown le policier
en chef, et Peachum l'exploi-
teur des mendiants, les trois
figures mythologiques des Mys-
tres de Londres, ne sont pour
Brecht que des signes dont Il
joue pour dsigner les grandes
et petites manuvres d'un
autre monde de truands et de
flics, celui de la bourgeoisie pe-
tite et grande : la socit ca-
pitaliste. Il faut d'ailleurs re
marquer que le truand et le po-
licier qui est son double et son
ami (Genet, toujours...) entre-
tiennent, comme Puntila et
Matti, et comme c'est souvent
le cas chez Brecht, une trange
liaison, dont il ne serait pas
inintressant de scruter les
troubles profondeurs; mais ceci
est une autre histoire. Bref,
c'est la comdie sinistre du
monde bourgeois qui s'installe
sur la scne. La morale est
d'ailleurs tire en termes
clairs: Qu'est-ce qu'un passe-
partout compar une action
de socit anonyme? Qu'est-ce
que le cambriolage d'une ban-
que compar la fondation
d'une banque ? Qu'est-ce que
tuer un homme compare au fait
de le faire travailler pour un
salaire ? -. Et Brecht, la fin
de chaque acte, se tourne vers
le public: Beaux messieurs.."
la bouffe vient d'abord, enlulte
la morale... De quoi vit l'hom-
me ? De sans cesse torturer,
dpouiller, dchirer, gorger et
dvorer l'homme ,
A double fond
Mais tout cela est dit par le
truchement d'une forme com-
plexe : celle d'un opra qui
dnonce chaque instant la
mythologie bourgeoise de l'op-
ra : les songs - sont l pour
faire chavirer, pour disloquer
cette vieille forme en ruines.
Tout doit donc tre toujours
double fond : attitude, ges-
tes, actes, paroles, romances,
chorals, tout doit comporter
chaque instant sa propre paro-
die, sa figure critique, faute de
quoi on savoure les dlices
d'une oprette baroque. Tout
doit garder une subtile faus-
set, un dcalage constant, une
distance critique. D'o la diffi-
cult pour la mise en scne et
el jeu des ,acteurs. Rtor et ses
comdiens qui nous avaient don-
n un remarquable Lorenzacclo,
n'y sont pas parvenus, pour la
bonne raison qu'un tel jeu exige
une discipline d'acteur qui n'est
pas pratique en France, cel1e
dont nous avons eu l'exemple
avec tes comdiens de t'Open
Theater -.
Un IQle trop ralUte
H et fallu sans d 0 u t e
rester plus prs du jeu de ma-
rionnettes Inspir de ce thtre
expressionniste dont Brecht est
encore trs proche en 1928. Le
style trop raliste des dcors
et du jeu des acteurs (mme
celui de Pierre Santini qui, dans
le rle de Brown, s'essaie ce
jeu distanci que la mise en
scne aurait d imposer par-
tout), sans compter la mala-
dresse dans l'excution de cer-
tains songs - (ceux des fem-
mes surtout), empche que ne
s'tablisse sur la scne, tra-
vers un grand jeu rus, cet uni-
vers dcompos o un cpra
se rvle carcasse, du mme
mouvement que la socit d'ar
gent rvle son sinistre gui-
gnol.
Gilles Sandier
CINBMA
La prise en passant
Marguerite Duras, prsen-
tant son film Dtruire, dit-
elle au London Film Festival
o il a t trs applaudi, a
eu ce mot, qui semble de
prime abord contredire le
titre : Je ddie ce film
la Jeunesse du monde -.
Quelle destruction s'opre,
et dbouchant sur quoi, dans
un tel film minutieusement
calcul, rigoureux comme
une fugue de" Bach, et sur-
tout lisible comme un livre ?
Car ce n'est pas de voir, ni
d'entendre qu'il s'agit, mais
bien de lire, si lire veut bien
dire cette relation d'coute
active et agissante qui asso-
cie le spectateur la pro-
duction du film.
La destruction est jeu : don-
nes renouveles des lments
qui se combinent, des rseaux
de relations qui se tissent entre
les quatre personnages habi-
tant ensemble cette unit de
lieu qu'est l'htel-penslon-parc
o le besoin de repos les a ru-
nis, cerns par la mystrieuse
et Interdite fort (la hyl) ; jeu
des noms propres qui se rpon-
dent comme des miroirs briss,
des entrelacs dissymtriques du
signifiant avec lui-mme (Max
Thor, Alione, Alissa, la diffrac-
tion du nom propre, comme sur
une pierre, vient rebondir ou
s'craser, sur le nom de Stein,
personnage supplmentaire, in
justifi, dur, je m'appelle
Stein, je suis Juif -, et parce
que Juif, personnage la fois
dedans et dehors, nud de ren-
contre o se mlent les fils d'un
autre jeu, celui que Marguerite
Duras fait jouer ce film avec
ses autres textes, Le Ravisse-
ment de LoI. V. Stein, Alissa,
etc.) .
Jeu !e cartes que jouent en-
semble ces personnages qui ne
savent pas la rgle et qui ce-
pendant imperturbables coupent
avec de l'atout, prennent les
plis, comptent, perdent des par-
ties... S'agit-il d'un rve, dont
la paralogique - rigoureuse
rappellerait les sophismes sen-
tencieux du chapelier fou et
du livrE> de Mars dans Alice,
(Alissa), au pays des Merveil
les? Il s'agira bien d'un oni-
risme, mais au sens freudien
des rapports du dsir et du si
gnlflant, geste dans la progres-
sion bien scande duquel s'ac-
complit une qute orphique
rate, la faillie libration de
la presque Eurydice Elizabeth
Alione ne Villeneuve, person-
nage fragile et diffract que son
mari bourgeois viendra disputer
au trio du parc: Max Thor, Alis-
sa sa presque image spculaire,
et Stein.
UDe srie de jeua
Cheminement orphique rat,
dlibrment : la destruction
du thme s'opre par l'cono-
mie trs calcule d'une srie
de dcalages, de jeux : le jeu
de ,Marguerite Duras consiste,
si J'ose dire, mettre du Jeu
dans les signes tablis, les
montrer comme lzards l o
on les croyait pleins, spars
d'avec eux-mmes l o l'on
croyait tenir des entits bien
homognes.
Ce jeu de la destruction, de
la dconstruction, est subver-
Faisons le bilan de ce qu'il
inquite; par le jeu spirallque
de son dcalage : le concept
d'une uvre d'abord, cinma-
tographique ou littraire, com-
me plnitude, fermeture sur soi
d'un sens : le chteau, le parc,
le trio plus un, les initiales des
personnages (M, A), tout cela
fait- repasser devant n 0 u s
l'Anne Dernire Marienbad
de Resnais-Robbe-Grillet, sym-
bole de l'uvre symphonique
qu'il faut dtruire : Dtruire,
dit-elle; dans sa discontinuit
scripturale est la continuit
mlodique de l'Anne Dernire
ce que Boulez de Pli selon Pli
est Stravinski, ce que Ren
Char est Saint-John Perse :
de l'criture disloque rigou-
reusement, dissmine, oppo-
se de la tonalit.
L'uvre est donc mise en
question, l'auteur aussi, c'est--
dire aussi ie sujet, dans tous
les sens de : personnage, cri-
vain, matire de J'uvre : cla-
tement du regard et de l'acte
d'crire: Max Thor dcrit ce
que Stein regarde -. Stein parle
de Max Thor la troisime per-
sonne, en prsence de celui-ci.
Qui est Stein ? Je ne peux
parler de Stein -, mais Stein
dit tout -. Physiquement Max
Thor ressemble parfois Mar-
guerite Duras elle-mme. Tous
sont des crivains diffrs -,
dont le livre est toujours ve-
nir. Il n'y a pas non plus de
personnages, les vrais person-
nages, ceux qui il arrive quel-
que chose, sont les relations
entre les personnages : redou-
blement spculaire de type la-
canien entre Elizabeth Alione et
Alissa; ambigut de Stein, qui
dit tout sans qu'on puisse par-
Ier de lui, qui n'est autre que
le Dsir dans son rapport au
signifiant, il agit tout, mais il
est aussi l'immobilit mortelle
de la pierre (Stein). Et son
nom, son attitude dans le parc,
seront en rapport avec cette
fort Interdite et refoule par
ceux qui en ont peur, l'incons-
cient.
Relations entre les personna-
ges qui ne sont pas de vri-
tables dialogues, la"voix est tou-
jours un peu off, dcale, tran-
ge (ailleurs, comme Alione,
Alissa, est du ct de l'altrit
de l'Autre), et qui passent aussi
trs subtilement par ce rseau
de lettres que les personnages
s'crivent, banales et hirati-
ques, qui ne parviennent jamais
au destinataire, ou dont le texte
se modifie de lui-mme : les
psychanalystes auront reconnu
la lettre, l'inscription du dsir
par opposition la parole, la
voix et l'uvre.
Des destruotioDs
sUooeiV8S ".
Ces destructions successives
(le sujet, l'uvre, l'histoire, Je
caractre) qui se rsumeraient
en une seule, la mise en ques-
tion du propre : nom propre,
sens propre, proprit des cho-
ses et de la femme, identit
soi, etc.,. ces destructions m-
nent-elles la folie ? Folie, on
le sait, est absence d'uvre :
mais ce mot signifie-t-il encore
quelque chose de l o Margue-
rite Duras nous parle ?
L'uvre est diffre, mais
elle est a,-tre dans son avenir
rvolutionnaire : Alione, Alissa,
ces" noms propres - nous par-
Ient d'une tranget, d'une
altrit par rapport laquelle
notre monde prtendu propre
est peut-tre folie dnoncer :
la plonge possible, mais inter
dite, dans la fort de l'incons-
cient relativise jamais cette
catgorie de la folle : le mot
folie, comme Alione, qui hsite
sur le point de cder cette
altrit dans le parc, font par
tie encore de l'alination : il
faut choisir entre ces deux for-
mes de l'Autre: ou bien accep-
ter la chance de cette altrit
qui subvertit nos catgories lit
traires critiques, notre code
en gnral, ou bien comme ce
mari bourgeois gar la fin
du film, Orphe ridicule (Da-
niel Glin), rester dans l'ali-
nation.
Tel est l'enjeu, telles sont les
questions du film: on comprend
alors pourquoi Marguerite Du.
ras ddie son film la jeunesse
du monde : elle volt dans cette
jeunesse qui fait des rvolu-
tions la chance de trouver la
libration des alinations, et de
faire accder cette altrit pro-
mise et impossible encore
nommer. Nous sommes tous
des Juifs allemands -, dira
Stein, avec le clin d'il de ri-
gueur.
Tout cela est donc riche;
mais les thmes voqus, les
destructions proposes, nous
conduisent poser une ques-
tion ce film : ne s'agit-il pas
d'un exercice d'cole, d'un com-
pendium de tous les enjeux fa-
miliers de la critique fraflalse
contemporaine, badigeonns en
hte (comme par les jardiniers
d'Alice (encore) qui peignaient
les roses blanches en rouge
avant l'arrive de la Reine de
Cur). aux couleurs de la der-
nire rvolution en date : entre
les orages dsirs que la tran-
quille Alissa annonce: il faut
tout dtruire -, (et Stein de r-
pter : Dtruire, dit-elle -) et
le jeu de l'criture qu'a invent
notre dcennie, n'y a-t-il place
que pour l'alternative entre
cette articulation-l, et l'incom-
patibilit totale? Entre un laca-
nisme qui nous rvle que
nous sommes tous des Juifs
allemands - et l'alternative
sommairement manlchiste et
bigote : bourgeois/rvolution-
naire, n'y aurait-il pas un peu
de place pour le jeu plus multi-
dimensionnel des formes de
l'Autre avec les formes du
Mme, que l'on nommait na-
gure l'ironie ? Ce film me
pousse en douter un peu.
Jean-Marie Benoist
La Quinzaine littraire, du 1- GU 15 janvier 1970
Table ronde
Beyrouth... La Vit Table Ronde
du cinma et de la tlvision
consacre, sous l'gide de
l'UNESCO, aux arts des pays
arabes et asiatiques, se tient
dans une capitale que le couvre
feu rend tonnamment silen-
cieuse pour tous ceux qui con-
naissent sa bruyante vitalit.
.La premire chose ncessaire
tait de se dbarrasser de cri
tres d'apprciation exclusive-
ment occidentaux ; la seconde
tait d'viter le pige du fol
klore, de ne pas s'acharner
vouloir tracer des frontires. Ce
n'est pas encore cette fols
qu'on sera parvenu le dfinir,
mals ce qui est rvlateur de
son Importance, c'est blel) la
sparation des points de vue
son propos : pour certains, le
folklore, li des spectacles
figs ou pesant comme une con-
trainte sur les tentatives nou-
velles d'expression, est condam
n disparaftre (et ce serait
une sorte de libration) ; pour
d'autres, il est riche de la m-
moire des peuples, il est le ter-
reau idal o fortifier un art
authentique...
Il y a, pour Enrico Fulchigno-
ni, une dIffrence de nature
essentielle, entre le spectacle
occidental et celui de l'Orient o
toute reprsentation reste char-
ge d'un ensemble de signes,
de donnes, infiniment plus ri-
che. Alors que nos spectacles
se seraient appauvris de tout ce
qui s'est trouv port, par la
forme de nos civilisations et nos
structures sociales, au temple
ou dans les glises, le forum ou
les assembles, l'Orient aurait
conserv la reprsentation le
privilge d'tre le lieu et le lan
gage d'une totalit. Sans, je
crois, qu'on puisse absolument
gnraliser une proposition
aussi rigoureuse, sa part de v
rit est telle, d'emble, que le
principe d'un rejet des valeurs
traditionnelles (donc, du fol-
klore), se trouve pos avec une
vidente gravit.
Les formes traditionnelles de
spectacle, si elles n'voluent
pas - extrmement labores,
elles peuvent tre l'abri des
censeurs et vhiculer une satire
politique comme en Indonsie,
ou rester une sorte de thtre
de dolances ., comme cette
reprsentation annuelle devant
le souverain du Maroc, gardent
parfois le prestige et la beaut
d'un art sa perfection (le N6
japonais), ou la popularit que
justifient la verdeur et la libert
de son inspiration au niveau du
divertissement, qui est celui du
Karakouz tunisien.
Mals ce qui spare plus net
tement encore les arts tradition-
nels des formes d'expression
nouvelles, c'est, pour reprendre
un autre schma d'Enrico Fulchl-
gnoni, qu'en Occident le specta-
cle peut s'appuyer sur une so-
cit technologiquement trs
puissante, et qu'il s'est libr
de ses traditions - encore qu'il
y ait des traditions culturelles
difficiles oublier notamment
au thtre - ; et qu'en Orient,
ou tout pays du tiers-monde, la
proposition est renverse. Il
apparaft que l'volution des
moyens d'expression reste d-
pendante des facteurs cono-
miques. En Jordanie, ce sont
les danses et les crmonies
populaires qui sont devenues le
vhicule d'une prise de cons
cience politique. Dans le mme
FEUILLETON
par Georges Perec
Rsum des chapitres prcdents. - Alors que Gaspard Wlnck-
1er commence comprendre ce que lui veut Otto Apfelstahl,
celui-ci lui prcise peu peu l'histoire de son homonyme.
- L'tude du journal de bord et des documents portuaires ta-
blis chaque fols que le Lysandre faisait escale, et le recoupement
de divers renseignements mtorologiques et radiogonlomtriques,
nous ont permis, par la suite, de reconstituer d'une manire
peu prs satisfaisante les circonstances du naufrage. La dernire
escale du Lysandre avait t Port Stanley, aux Falkland; de l,
le yacht avait gagn le dtroit de Le Maire, avait doubl le cap
Horn, puis, au lieu de continuer vers le Pacifique, tait remont
dans la baie de Nassau et, par la passe trs troite qui spare
les les Hoste et Navarin, avait rejoint le canal de Beagle presque
en face d'Ushuaia. Le 7 mai, midi, Hugh Barton, comme chaque
jour, fait le point et note sur le journal de bord sa position:
quelque chose comme 55
0
et quelque de latitude sud et 71
0
de
longitude ouest, c'est--dire peu prs au dbut de la pnin-
sule de Brecknock, la portion la plus occidentale de la Terre de
Feu proprement dite, entre les les O'Brien et Londonberry, au
large des derniers contreforts de la cordillire de Darwin, c'est-
-dire moins de 100 milles marins du lieu du naufrage.
Le lendemain, exceptionnellement, la position n'est pas releve
ou, en tout cas, ce qui revient au mme, n'est pas note sur le
journal de bord. Le 9, 3 heures du matin, un baleinier norvgien
en chasse dans la mer de Weddell et un radio amateur de l'le
Tristan da Cunha captent un appel S.O.S. du Lysandre, mais ne
parviennent pas entrer en communication avec lui. L'appel nous
est transmis moins de deux heures plus tard, mais dj le yacht
est muet et c'est en vain que nos stations de Punta Arenas et
du cap de l'Ermite tentent d'tablir un contact. Il ressort du
rapport tabli par les secouristes chiliens que l'appel de dtresse
prcda de trs peu, quelques minutes, peuttre mme quelques
dizaines de secondes seulement, la catastrophe. Les fixations des
canots de sauvetage n'taient pas dverrouilles, trois des cinq
cadavres n'taient mme pas habills, aucun n'avait eu le temps
de mettre une boue individuelle. La violence du choc dut tre
terrible. Angus Pilgrim fut littralement cras contre la paroi
de sa cabine; Hugh Barton eut la tte fracasse par la chute
du grand mt, Zeppo fut dchiquet par le rocher et Felipe dca
pit par un filin d'acier. Mais la mort la plus horrible fut celle
de Caecilia; elle ne mourut pas sur le coup, comme les autres,
mais, les reins briss par une malle qui, insuffisamment arrime,
avait t arrache de son logement lors de la collision, elle tenta,
,
a
Beyrouth
temps, Il semble que le thtre
soit en voie de disparition au
Pakistan...
Pourtant, si le folklore a pu
devenir cette mmoire des peu-
ples qu'il est encore chez beau-
coup d'entre eux, c'est parce
qu'il tait le dit et la geste d'une
prennit, d'une volont de du-
rer. Un conqurant a toujours
tent de dtruire les traditions
du vaincu. Si les traditions de-
meurent vivantes, c'est qu'il y a
refus de disparatre. De mme,
un art nouveau ne nat pas dans
l'imitation: rien n'est plus dan
gereux pour le jeune thtre (1)
ou le jeune cinma du tiers-
monde que les exemples et les
modes occidentaux. L'avant-
garde est un jeu de vieille so-
cit riche. Ce qui doit inspirer
le cinma ou le thtre du tiers-
monde, ce n'est pas ce qui nous
amuse six mois Paris ou
New York : mals une ralit qui
ne peut tre importe. Dans le
Liban dchir, le dernier jour de
ces travaux qui taient des
changes, nous en avons eu la
plus clatante illustration.
Et nous dcouvrions un vrai
cinma arabe, dont les racines
taient vraies et fortes : la
Terre (qui ne porte pas fortui-
tement le titre de l'un des
grands films de Dovjenko),
uvre magistrale, qui mle vio-
lence et tendresse, humour et
rvolte, le sang et la lumire.
A partir d'un roman d'El Cher-
kaoui, Youssef Chahine a cons-
truit une fresque mouvante qui
est la fois le plus bel hommage
qu'on ait jamais rendu au fellah
du Nil, et une date dans l'his-
toire du cinma arabe, un grand
titre parmi les grands films du
monde. Rien ici de ce miel qui a
si souvent chang les milliers
de km de pellicule du film gyp-
tien - ou libanais -, en tue-
mouches.
La Terre est un film construit
avec une remarquable rigueur,
et une libert magnifique d'cri-
ture. Il s'agit de la rvolte d'un
village, priv d'eau par un fonc-
tionnaire richissime de la fin du
rgne de Farouk, pour pouvoir
amnager une route d'accs
l'une de ses proprits. (Imagi-
nerait-on eh France
quelqu'un d'assez influent pour
faire passer une autoroute tra-
vers le Bois de Boulogne plutt
que sous ses fentres? Impos-
sible, bien sr). Il n'empche
que les sbires de Farouk matent
les villageois, pendant que les
troupes britanniques essaient de
mater ce qui au Caire finira
quand mme par tre une rvo-
lution.
Pas. un seul personnage qui
soit strotyp, pas une scne
qui sonne faux, pas un effet qui
soit appuy. Un rythme ample
et superbe emporte des scnes
avec un lyrisme qui rappelle ce-
lui du cinma russe de la grande
poque (Dovjenko, justement),
alors que la violence se traduit
par une utilisation de plans
brefs, coups sec, qui laissent
en mmoire autant d'impacts.,
Une fresque, mais aussi un
hymne de couleurs et de beau-
t. Il faut que ce film soit vu (2).
Claude Michel Cluny
1. Ainsi un metteur en scne maro-
cain, Tayeb Sakkirl, recherche-t-i1 un
espace scnique pour le thtre
arabe, rejetant la formule de nos salles
l'Italienne.
2. le cinma des pays du tiers-monde
souffre de problmes de distribution
qu'il n'est pas ais de rsoudre. Pro-
blmes voqus dj lors du Festival
de Carthage, en 1968
pendant plusieurs heures sans doute, d'atteindre, puis d'ouvrir
la porte de sa cabine; lorsque les sauveteurs chiliens la dcou-
vrirent, son cur avait peine cess de battre et ses ongles en
sang avaient profondment entaill la porte de chne.
- Et son fils?
- Sa cabine tait voisine de celle de Caecilia. Tout y gisait
ple-mle, ses vtements, ses jouets. Mais il n'y tait pas.
- Il tait peut-tre tomb la mer.
- C'est extrmement peu probable. Il aurait fallu qu'il soit
sur le pont et il n'avait aucune raison d'y tre.
- Mais s'il y avait t quand mme?
- A 3 heures du matin! Qu'aurait-il fait sur le pont?
- Quelqu'un, Hugh Barton par exemple, s'est peut-tre dit
que le spectacle de la tempte aurait un effet dcisif sur l'enfant...
Mais Otto Apfelstahl secoua la tte.
- Non, dit-il, ce n'est pas possible. Mme s'il avait t pr-
cipit la mer, la mer l'aurait fracass sur le rcif et nous aurions
retrouv une trace, un iridice, quelque chose de lui, du sang, une
mche de ses cheveux, un bonnet, une chaussure, n'importe quoi.
Non, nous avons cherch, nos hommes-grenouilles ont plong
jusqu' l'puisement, nous avons fouill chaque anfractuosit du
rocher. En vain.
Je demeurai silencieux. Il me semblait qu'Otto Apfelstahl,
cet endroit de son discours, attendait de moi une rponse, ou
tout au moins un signe quelconque, ft-il d'indiffrence, ou d'hos-
tilit. Mais je ne trouvais rien dire. Il se taisait, lui aussi; il
ne me regardait mme pas. On entendait quelque part un accor-
don. J'eus la vision furtive d'un bouge matelots, dans un port
presque polaire, et trois marins emmitoufls dans de gros cache-
nez bleus, buvant du viandox, soufflant entre leurs doigts. Je
fouillai mes poches la recherche d'une cigarette.
- Votre paquet est sur la .table, dit, tranquillement, Otto
Apfelstahl.
Je pris une cigarette. Sa main m'offrit un briquet allum. Je
murmurai un remerciement peine audible.
Nous restmes ainsi silencieux pendant peut-tre cinq minutes.
J'aspirai de temps autre une longue bouffe, acre et sche, de
ma cigarette. Lui paraissait perdu dans la contemplation de son
briquet qu'il tournait et retournait en tous sens. Puis il se gratta
deux ou trois fois la gorge.
La Quinzaine littraire, du 1" au 15 janvier 1970
- Si, dit-il enfin, rompant un silence qui devenait de plus
en plus pesant, si l'on considre la vitesse moyenne du Sylvandre
et sa position telle qu'elle fut releve et note le 7 mai midi, on
s'aperoit que le 9, 3 heures du matin, le yacht aurait d tre
beaucoup plus loin vers l'ouest. Si, par ailleurs, on admet que seul
un bouleversement extrme, un affolement gnral, presque une
panique, peut empcher un commandant de bord d'accomplir cette
formalit lmentaire mais indispensable la scurit qu'est
un relev de position, on est amen, ncessairement, une
conclusion unique. La voyez-vous?
- Je crois fa voir, mais je ne suis pas sr qu'erre soit
unique.
- Que voulez-vous dire?
- Ils ont fait demi-tour pour partir sa recherche; cela peut
vouloir dire que Gaspard s'tait enfui, je ne dis pas le contraire,
mais il se peut aussi qU'ils l'aient abandonn et qu'ensuite ils
s'en soient repentis.
- Est-ce que cela change quelque chose?
- Je ne sais pas.
Il y eut, nouveau, un long silence.
- Comment avez-vous retrouv ma trace? demandai-je.
- J'tais un peu fascin par cette catastrophe, par la per-
sonnalit des victimes, par le mystre qui semblait entourer la
disparition de l'enfant, Escale aprs escale, j'ai reconstitu l'his-
toire de ce voyage, j'ai contact les familles, les amis, j'ai eu
accs aux lettres qu'ils avaient reues. Il y a trois mois, profitant
d'un dplacement Genve, j'ai pu rencontrer l'ancien secrtaire
de Caecilia; c'est lui qui vous remit vos papiers d'identit; il
m'apprit votre existence, il me raconta votre histoire. Vous tiez
beaucoup plus facile retrouver que l'autre. Il n'y a que vingt-
cinq consulats helvtiques dans toute l'Allemagne...
- Et plus de mille lots dans la Terre de Feu,
comme pour moi-mme.
- Plus de mille, oui. La plupart sont inaccessibles; inhabits,
inhabitables. Et les garde-ctes argentins et chiliens ont inlas-
sablement fouill les autres.
Je me tus. Un bref instant, j'eus envie de demander Otto
Apfelstahl s'il croyait que j'aurais plus de chance que les garde-
ctes. Mais c'tait une question, bien sOr, laquelle dsormais
je pouvais seul rpondre.
fA suIvre.)
39
au 20 dcembre 1969
Livres publis du 5
Fayard, 588 p., 30 F
Une srie d'entretiens
sur les problmes
spirituels et historiques
les plus actuels
Pierre Haubtmann
P."". Proudhon
Gense d'un antlthlste
Mame, 278 p., 28 F
Les origines et les
causes de l'attitude
religieuse de Proudhon
et, au-del de sa
personne, du phnomne
dit de l'apostasie des
masses -.
Jean Le Ou
Catchse et
dynamique de groupe
Mame, 106 p., 9,50 F
L'adoption des mthodes
de groupe pour
l'instruction religieuse et
les problmes qui se
posent en ce domaine.
Marie-France
Qure-Jaulmes
M.-F. Qure-Jaulmes
Le mariage dans
l'Eglise ancl.nn.
Introduction de
A. Duml:\s et de M.F.
QureJaulmes
Centurion, 340 p., 22 F
La conception du
mariage travers les
crits des Pres de
l'Eglise.
Eugne Quinche
Les fils de D.vld
La Pense Moderne,
320 p., 22,70 F
La figure et la vie du
Christ vus sous un
clairage inattendu.
Philippe Roqueplo
La fol d'un mal-eroyant.
mentalit sclentlflqu. .t
vie de fol
Cerf, 352 p., 32 F
La rfh:xion d'un doml
nicaln, polytechnicien et
ingnieur sur les
facteurs de l'athisme
actuel (Prix Nol 1969).
Henri Verbist
Les grandes
controverses de IEgllse
contemporaine
16 p.. d'i11. hors texte
Rencontre, 568 p. 18,30 F
Par un historien de
l'Eglise, un essai de
solution aux nombreux
conflits qui agitent
actuellement les
catholiques.
Andr M. Aauzen
Pierre Ripert
Montlcelll
626 III. en noir,
46 pl. en couleurs
Bibliothque des Arts,
472 p., 42 F
ARTS
URBANISMB
Henri Manceau
Des luttes ardenn.lses
Editions Sociales,
232 p., 15,70F
Trois sicles de luttes
ouvrires ardennaises
conomiques ",
Calmann-Lvy, 280 p.,
23,40 F
Une tude pratique et
technique qui dbouche
sur des questions
fondamentales touchant
la fonction mme
d'ducation.
Etienne-Charles Dayez
La Belgique .st-ell.
morte?
Coll . En toute libert"
Fayard, 172 p., 15 F
Quatorze personnalits
parmi les plus
reprsentatives de ce
pays nous parlent des
principaux problmes
auxquels se trouve
actuellement confronte
la Belgique.
RBLIGION
Pavel Tlgrld
La chute Irrsistible
d'AI.xand.r Dubcek
Traduit de "anglais
par Jean Bloch-Michel
CalmannLvy, 320 p.,
20 F
Un ouvrage appuy sur
des documents de
premire main et qui
apporte des Informations
essentielles sur le
printemps de Prague ".
Bertrand Russell
Pratique .t thorie
du bolch.vlsme
Mercure de France,
200 p., 18,70 F
Publi en 1920, la
suite d'un voyage en
U.R.S.S., un essai qui
prend aujourd'hui une
grande valeur
rtrospective.
Aldo Chlaruttlnl
Le dossier du
catchisme hollandais
Fayard, 248 p., 20 F
Le dossier d'un dbat
doctrinal et disciplinaire
qui a secou rcemment
l'Eglise catholique.
Olivier Clment
Dialogues avec le
patri.rche Athnagoras
Sylvain Wickham
L'espace. Industriel
europen
Collection Perspectives
conomiques"
Calmann-Lvy, 272 p.,
24,10 F
De "Europe potentielle
la constitution d'un
systme industriel
authentique: une tude
d'une actualit brOlante.
POLITIQUB
BCONOMIB
M. Avl-Yonah
Histoire de la
Terre Sainte
269 illustrations dont 39
en couleurs
A. Michel, 324 p., 86 F
A la lumire des plus
rcentes dcouvertes
archologiques,
l'ensemble des
vnements qui se
droulrent en Palestine
du palolithique
l'poque actuelle.
Drago Arsenljevic
Genve appelle Moscou
8 pages de photos
Laffont, 320 p., 19 F
Un nouveau dossier de
la guerre secrte au
cours de la seconde
guerre mondiale.
Marcel Brion
Le sicle des Mdicis
91 pl. hors-texte dont
28 en couleurs et
72 gravures ln-texte
A. Michel, 216 p., 75 F
De la Florence de Dante
la veille de la
Rvolution franaise.
Paul Chack
Jean-Jacques Antier
Histoire maritime
de la premire
guerre mondial.
24 p. de hors-texte
France-Emplre,
600 p., 25,30 F
Une rdition revue et
augmente de textes
indits.
HISTOIRB
Pierre Daumard
Le prix de
l'enseignement
en France
Prface d'Edgar Faure
Coll. Perspectives
Henri de Montfort
Le massacre de Katyn
Presses de la Cit,
254 p., 17 F
Le dossier secret de
('une des affaires les
plus atroces de la
dernire guerre
Johannes Steenstrup
Les Invasions normandes
en France
Coll. Le Mmorial
des Sicles"
A. Michel, 344 p., 24 F
Les aspects
gographiques,
ethniques, politiques,
militaires et
conomiques de ces
invasions travers les
chroniques, les annales
monastiques, les
tmoignages oculaires,
etc.
pays au cours des
derniers sicles.
PHILOSOPHIB
Andr Richel
Contribution l'tude
du dveloppement
humain
Editions Sociales,
156 p., 10,50 F
L'origine et l'volution
de l'homme au travers
du dveloppement de
son histoire.
E. Vlllequez
Le cancer de l'homme
Delta d., 220 p., 23 F
Par un ancien
professeur de mdecine,
un svre bilan des
recherches en ce
domaine.
Raoul de Palma
Cours moderne de
calcul automatique
A. Michel, 480 p., 98 F
Un ouvrage qui intresse
aussi bien les dbutants
que les spcialistes de
l'informatique.
Bernard Gorsky
La gr.nde barrire de
corail
54 photos hors-texte
dont 40 en couleurs,
A. Michel, 256 p., 29 F
Le rcit d'une expdition
dans l'un des lieux les
plus riches de la plante
sur le plan biologique.
Cornelius S. Hurlbut
Les minraux et l'homme
Traduit de l'amricain
par Denise Meunier
155 ill. en couleurs
et 70 en noir,
Stock, 300 p., 85 F
De la gense des roches
et des premiers usages
que l'homme fit de la
pierre jusqu'aux
multiples utilisations
modernes des minraux.
Le centenaire du Capital,
Exposs et entretiens
sur le marxisme
Mouton, 336 p., 38 F
Le texte des Dcades
du Centre Culturel
International de Cerisy-
Ia-Salle " sur le
marxisme.
Le manu.1 d'Histoire
IIttralr. d. 1. France
Tom. III : 1715-1789
Ouvrage collectif sous la .Georges Politzer
direction de M. Duchet, Les fondements de
Pierre Abraham et la psychologl.
Roland Desn Textes runis par
16 tableaux synoptiques Jacques Debouzy
Editions Sociales, Editions Sociales,
624 p., 30 F 304 p., 15 F
Une tude appuye sur Un ouvrage posthume du
les meilleurs travaux grand philosophe
consacrs une poque communiste fusill par
qui contient en germe les Allemands en 1942.
quelques-unes des
contradictions majeures
de notre temps.
SOCIOLOGIB
PSYCHOLOGIB
BTBNOGBAPHIB
Thor Heyerdahl
Le secret de l'Ile de
Piques Aku-Aku
Traduit du norvgien
par M. Gay et G. de
Maufort
58 photos hors texte
en couleurs, 8 cartes
et dessins ln-texte,
A. Michel, 352 p., 29 F
Par l'auteur de
L'expdition du
Kon-Tlkl", une tude
ethnographique sur la
population d'une ile qui
a drout les
explorateurs de tous les
R.M. Albrs
L'av.ntur. Int.llectuell.
du XX slcl.
Panorama d.s
IIttratur.. .uropennes
1900-1970
A. Michel, 512 p., 25 F
Une rdition revue et
augmente et dont le
plan a t etltlrement
refondu.
Paul Frlschauer
L'archologl. d. 1.
sexualit
Traduit de "allemand
par R. Laurelllard
200 reproductions.
Stock, 400 p., 55 F
Les coutumes
amoureuses travers
les sicles et les
civilisations.
Marle Fargues
L. paix de l'automn.
Mame, 216 p., 16 F
Comment affronter les
difficults physiques,
psychologiques, morales
et familiales du
troisime Age".
BIOGRAPHIES
MBMOIRBS
CORRBSPON-
DANCBS
Rosalynd Pllaum
Madame de Stail
(La famille Necker,
Madame de Stal et sa
descend.nce)
Ouvrage publi sous les
auspices de la Socit
des Etudes Stallennes
Trois portraits et une
gravure
Fischbacher, 368 p., 29,
40 F
Madame Necker,
Madame de Stal et sa
fille voques travers
nombre d'lments
biographiques jusqu'ici
disperss et souvent
indits.
Gaston Marchou
Chaba....D.lm
11 photographies
A. Michel, 272 p., 18 F
Un portrait physique et
moral d'un homme en
qui d'aucuns voient un
Rastignac et que
l'auteur considre
comme un Florentin du
Quattrocento ".
Janheinz Jahn
Manuel d. IIttratur.
no-afrlcalne
du XVI sicle nos
Jours
Traduction de G. Bailly
Resma, 296 p., 29 F
De la posie populaire
aux blues, du jazz au
roman rvolutionnaire,
l'mergence d'un
commun univers culturel
au-del de la diversit
des 'angues et de la
sensibilit.
Guillaume Apollinaire
Lettres Lou
Prface et notes de
M. Dcaudln
16 pl. hors texte
Gallimard, 544 p., 32 F
Prsentes pour la
premire fols dans leur
Intgralit, les lettres
adresses par Apollinaire
Louise de
Coligny-Chatillon. Albert-Marle Schmidt
La posie sclentlflqu.
en France au XVI' sicle
Rencontre, 344 p., 23,10 F
Rdition d'une thse
clbre sur les sources
de taut un courant de
notre posie.
Gandhi .t Romain
Rolland
Correspondance, .xtralts
du Journal et textes
divers
A. Michel, 480 p., 33 F
A "occasion du
centenaire de la
naissance de Gandhi un
numro spcial des
Cahiers Romain Rolland
consacr l'homme
d'Etat et l'sptre de la
nonvlolence.
JO
Bilan de dcembre
LA QUINZAINE LITTRAIRE
VOUS RECOMMANDE
1
1
3
3
2
3
5
1
2
2
5
4
2
3
7
6
1
Mouton
Gallimard Ides
Flammarion
Le Seuil
La VrIt
S.E.D.E.S.
Maspero
Gallimard
Gallimard
Denol LN
Stock
Gallimard
Losfeld
C....zy (Gallimard)
Les allumettes sudoises (Albin-
Michel)
L'adIeu au roI (Grasset)
Jacquou le croquant (Calinann-Lvy)
Madame et le management (Tchou)
Papillon (Laffont)
Les feux de l,a colre (Grasset)
Le massacre des IndIens (Gallimard)
L'antl-de Gaulle (Le Seuil)
La deuxIme mort de Ramon Meree-
der (Gallimard)
Auguste BlanquI. Des origInes
il la Rvolution de 1848.
Le grand tournant du socIalisme
Un monde que nous avons perdu.
La rumeur d'Orlans
Samizdat 1
Cinquante ans de thAtre
L'Elite du pouvoir
Lettres l G6nlca Athanaslou
Lettre. l Lou
Anibel
Un portrait de femme
Correspondance III
uvre. compltes 1
Paul Surer
Wright MlIIs
Roger Garaudy
Peter Laslett
Edgar Morin
Antonin Artaud
Apollinaire
Victor Hatar
Henry James
Mallarm
Benjamin Pret
Es.aI.
Maurice Dommanget
LIttrature
Liste tablie d'aprs les renseignements donns par les libraires suivants :
Biarritz, la Presse. - Dijon, l'UnIversIt. - Issoudun, Cherrier. - Mont-
pellier, Sauramps, - Nice, Rudln. - Paris, les Allscans, Au charlot d'or,
Fontaine, la Hune, JullenCornic, Varit, Weil. - Rennes, les Nourritures
terrestres. - Toulon, Bonnaud. - Tournai, Decallonne. - Versailles, la
Ucorne. - Vichy, Royale.
1 Flicien Marceau
2 Robert Sabatier
LES LIBRAIRES ONT VENDU
3 Pierre Schoendoerffer
4 Eugne Le Roy
5 Christiane Collange
6 Henri Charrire
7 Max Olivier-Lacamp
8 Lucien Bodard
9 Louis Vallon
10 Jorge Semprun
dont se trouvent runies
ici les chroniques.
Shakespeare
Hamlet
La mgre apprIvoise
Comments et expliqus
par L. Contour-Marsan
La Pense Moderne,
242 p., 12,40 F
Ren Andrieu
Jean Effel
En feuilletant
l'histoire de France
170 dessins de J. Effel
A. Michel, 240 p., 24 F
Une vocation, tantt
cocasse, tantt
passionne, de notre
histoire, du Front
populaire nos jours.
Jacques Carel man
Les objets introuvables
200 dessins
A. Balland, 140 p., 35 F
Comment on peut
transformer avec une
rigoureuse, logique les
objets les plus familiers,
jusqu' les rendre
parfaitement
inutilisables.
Paula Delsol
Horoscopes chinoIs
Dessins originaux
4 tableaux-dpliants
Mercure de France,
160 p., 26 F
Un livre-jeu et une
initiation l'astrologie
chinoise
Raymond Dumay
Guide des vins de pays
80 illustrations
Stock, 300 p., 30 F
Le vignoble franais
travers les sicles et
jusqu' nos jours.
Henri-Paul Eydoux
Promenades
en Provence
Coll . Promenades"
80 illustrations, 1 carte
A. Balland, 270 p., 36 F
Un voyage au long du
Rhne travers le
Conitat, entre la Durance
et la Mditerrane et
sur les rivages de la
Cte d'Azur.
Franka Guez
Masculin-quotidIen
100 dessins
Stock, 300 p., 30 F
Un guide pratique
l'usage des hommes.
Mina et A. Guillois
Les quatre saisons
du rire
Fayard, 410 p., 25 F
2.000 histoires drles,
souvent indites en
France, sur tous les
vnements d'une
anne.
HUMOUB
SPORTS
DIVEBS
B. Poirot-Delpech
Au soir le soir
Thtre 1960-1970
Mercure de France,
296 p., 25 F
Dix ans de thtre par
le critique du Monde ",
Annie Morand
Encyclopdie des styles
d'hier et d'aujourd'huI
1.650 dessins
75 photos couleurs
Denol, 520 p., 42,50 F
Tout ce qu'il faut savoir
pour acheter un meuble,
reconnaitre un style,
crer ou recrer une
ambiance.
A. von Wuthenau
Terres cuites
prcolombiennes
Traduit de l'allemand
par Jacques Legros
41 pl. en couleurs
36 photographies hors-
texte en noir, 29 figures
in-texte, 2 cartes
A. Michel, 228 p., 54,40 F
Une tude archologique
et historique qui nous
restitue la vie
quotidienne des
premiers habitants du
Nouveau Monde.
GuIde 1970
Connaissance des Arts
des ventes publiques
en France
Ouvrage collectif sous
la direction de F. Spar
Nombreuses illustrations
dont 57 en quadrichromie
Hachette, 212 p., 45 F
Un guide dtaill qui
prsente les plus beaux
objets d'art achets en
vente publique au cours
de la saison coule.
Les trs riches heures
de Catherine de Clves
A. Michel, 360 p., 98,80 F
Un ouvrage somptueux
o se trouvent
reproduites en grandeur
nature et en couleurs
les 157 miniatures du
clbre manuscrit
compos vers 1440 par
un artiste anonyme
d'Utrecht.
Lord Kilbracken
Van Meegeren ou
la vie d'un faussaIre
Traduit de l'anglais
par Georgette Henry
24 p. d'i11. hors-texte
Mercure de France,
256 p., 28,10 F
Une affaire
sensationnelle en
matire de supercherie
picturale: comment un
artiste obscur russit
mystifier les plus grands
critiques de son temps
en peignant des
Vermeer
Pierre Cabanne
P. Restany
L'avant-garde
au XX, sicle
A. Balland, 472 p., 45 F
Un panorama de l'avant-
garde contemporaine
dans les arts plastiques.
Yvan Christ
Les mtamorphoses
de la banlieue parisienne
A. Balland, 208 p., 69,60 F
200 photographies prises
rigoureusement la
mme place cent ans
d'intervalle: un parallle
saisissant.
M. Beurdeley
Mme Georges Bataille
Kristofer Schipper
Tchang Fou-Jouei
Jacques Pimpaneau
Jeux des nuages
et de la pluie
103 iII. en noir,
28 pl. en couleurs,
Bibliothque des Arts,
224 p., 165 F
Estampes, pomes en
prose contribuent faire
de ce bel ouvrage un
art d'aimer en Chine"
o la dlicatesse des
sentiments s'associe au
pur acte rotique.
Le plus Important
ouvrage consacr au
peintre des Scnes
dans un parc", qui fut
aussi un portraitiste
curieux et beaucoup plus
ignor.
Jean Clay
Visage de l'art moderne
Entretiens avec Chagall,
Arp, Giacometti, Albers,
Babo, Moore, Hartung,
Vasarely, Manessier,
Soto
Avec un portrait de
chacun des artistes
Rencontre, 320 p., 18,30 F
Un tmoignage de
premier ordre sur "art
contemporain.
Wolfgang Brckner
Imagerie populaire
allemande
Traduit par M. Pianzola
199 i11. dont 45 pl.
en couleurs
Electa-Weber, 224 p.,
115 F
Vues par l'il naif et
souvent malicieux des
Imagiers, toutes les
activits de la vie
populaire allemande
depuis quatre sicles.
G. et P. Francastel
Le portrait, 50 sicles
d'humanisme en peinture
37 photos en noir
Hachette, 208 p., 25 F
Une tude historique de
ce genre artistique
considr comme un fait
social et culturel
La Quinzaine littraire, du 1" au 15 janvier 1970
31
CONNAISSANCE
DE L'ORIENT
Publie sous la direction de M. ETIEMBLE,
({ Connaissance de l'Orient" est, pour une grande partie,
la srie orientale de ta collection UNESCO
d'uvres reprsentativeS.
Elle permettra nos contemporains de dcouvrir
tes grands domaines littraires des Indes, de la Chine,
du Japon: toute une littrature classique, foisonnante
et merveilleuse, apparat ici.
Les chefs-d'uvre de la littrature japonaise,
chinoise, indienne, vietnamienne.
Srie chinoise
KOUO MOJO: K'iu Yuan
Traduction, prface et notes de Mlle Liang Pai-Tchin
LOU SIUN: Contes anciens notre manire
Traduits et prsents par Li Tche-houa
LIE TSEU: Le vrai classique du vide parfait
Traduit du chinois par Benedykt Grynpas
Anthologie de la Posie chinoise classique,
sous la direction de Paul Demiville Traduit du chinois
Le signe de patience, et autres pices du Thtre des Yuan
Traduction, introduction et notes de Li Tche-houa
LIEOU NGO: L'Odysse de Lao Ts'an
Traduit du chinois par Cheng 'l'cheng
LAO TSEU: Tao t6 king
'llraduit du chinois par Liou Kia-hway. Prface d'Etiemble
CHEN FOU: Rcits d'une vie fugitive
Traduit du chinois par Jacques Reclus et prfac par P. Demiville
L'oeuvre complte de Tchouang-tseu
Traduction, prface et notes de Liou Kia-hway
Srie indienne
TOUKARAM: Psaumes du plerin
Traduction, introduction et commentaires de G.-A. Deleury
Hymnes spculatifs du Vda
Traduits du sanskrit et annots par Louis Renou
Choix de Jtaka
extraits des vies antrieures du Bouddha Traduits du pli par Ginette TerraI
KALIDASA: La Naissance de Kumara
Traduction du sanskrit et prsentation par Bernadette Tubini
KABIR: Au cabaret de l'amour
Traduction du hindi, prface et notes par Charlotte Vaudeville
PRINCE ILANGO ADIGAL: Le roman de l'anneau
Traduit du tamoul par Alain Danilou et R. S. Desikan
prface d'Alain Danilou
Contes du Vampire
Traduits du sanskrit et annols par Louis Renou
Pancatantra
Traduit du sanskrit et annot par Edouard Lancereau
prface de Louis Renou .
Mythes et lgendes extraits des Brkamana
Traduit du sanskrit et annot par Jean Varenne
BIBHOUTI BHOUSAN BANERJI:
La complainte du sentier
Traduit du bengali par France Bhattacharya
Srie japonaise
UDA AKINARI: Contes de pluie et de lune
Traduction et commentaires de Ren SiefTert
NATSUM SOSKI:
Le Pauvre Cur des hommes (Kokoro)
Traduction de Horiguchi Daigaku et Georges Bonneau
ZEAMI: La tradition secrte du N
suivi de Une journe de N
Traduction et commentaires de Ren Sieffert
IHARA SAIKAKU: Cinq amoureuses
Traduction du japonais, prface et notes par G,llorges Bonmarchand
AKUTAGAWA RYNOSUKE: Raskomon et autres contes
Traduction du japonais par Arimasa Mori
SEI SHONAGON: Notes de chevet
Traduit du japonais et comment par Andr Beaujard
Histoires qui sont maintenant du pass
Traduction, prface et commentaires de Bernard Frank
URABE KENK: Les heures oisives,
suivi de Notes de ma cabane de moine
par Kamo no Chmei Traduit du japonais par Charles Grosbois, Tomiko Yoshida
et le R.P. Sauveur Candau
Contes d'Ise
Traduction, prface et commentaires de G. Renondeau
Srie vietnamienne
NGUYN-DU: Kim Vn Kiu
Traduction du vietnamien par Xun-Phuc et Xun-Vit
NGUYN-DU: Vaste recueil de lgendes merveilleuses
Traduit du vietnamien par Nguyn-Tran-Huan
GALLIMARD
Vous aimerez peut-être aussi
- Kierkegaard Ou Bien Ou BienDocument653 pagesKierkegaard Ou Bien Ou Bienegonschiele9100% (14)
- Sans La Liberte - Francois SureauDocument48 pagesSans La Liberte - Francois SureauElie BeylaPas encore d'évaluation
- 361 Calvino Si Par Une Nuit D Hiver Un VoyageurDocument14 pages361 Calvino Si Par Une Nuit D Hiver Un VoyageurMlle Francaise100% (1)
- Georges Bernanos L'auxiliateurDocument10 pagesGeorges Bernanos L'auxiliateurgigiPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 97 Juin 1970Document32 pagesQuinzaine Littéraire 97 Juin 1970thanatonaute100% (1)
- Tristan Trémeau - Le Tournant Pastoral de L'art ContemporainDocument14 pagesTristan Trémeau - Le Tournant Pastoral de L'art ContemporainAlexandre BerubePas encore d'évaluation
- Henri Michaux Et Le Refus de Vedettisation Dans Le Monde LitteraireDocument80 pagesHenri Michaux Et Le Refus de Vedettisation Dans Le Monde LitteraireAlexandra FicicarPas encore d'évaluation
- Le Vocabulaire de Merleau-PontyDocument64 pagesLe Vocabulaire de Merleau-Pontyegonschiele9100% (5)
- L'Espace littéraire de Maurice Blanchot: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandL'Espace littéraire de Maurice Blanchot: Les Fiches de lecture d'UniversalisÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Les Mots de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Mots de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 106 Novembre 1970Document32 pagesQuinzaine Littéraire 106 Novembre 1970thanatonautePas encore d'évaluation
- Cahiers Du Cinema N. 231Document56 pagesCahiers Du Cinema N. 231Gabriela MaiaPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire, 89, Février 1970Document32 pagesQuinzaine Littéraire, 89, Février 1970thanatonaute100% (1)
- L'énigme Blanchot, Magazine Littéraire, N° 424, Octobre 2003Document3 pagesL'énigme Blanchot, Magazine Littéraire, N° 424, Octobre 2003David FielPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 955Document32 pagesQuinzaine Littéraire 955thanatonaute100% (1)
- Fontaine, DIALOGUE SARTRE-BATAILLEDocument97 pagesFontaine, DIALOGUE SARTRE-BATAILLEBarouk SalaméPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 94, Mai 1970Document32 pagesQuinzaine Littéraire 94, Mai 1970thanatonautePas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 108 Décembre 1970Document40 pagesQuinzaine Littéraire 108 Décembre 1970thanatonautePas encore d'évaluation
- Jean Luc Nancy Texte Touche Le CorpsDocument9 pagesJean Luc Nancy Texte Touche Le CorpsdarouchkaPas encore d'évaluation
- L'UNEBEVUE Revue de Psychanalyse Nº 12 - Dispositifs, Agencements, MontagesDocument212 pagesL'UNEBEVUE Revue de Psychanalyse Nº 12 - Dispositifs, Agencements, MontagesRui MascarenhasPas encore d'évaluation
- A Propos de L'affaire EichmannDocument16 pagesA Propos de L'affaire EichmannHerne Editions100% (2)
- Quinzaine Littéraire 964Document32 pagesQuinzaine Littéraire 964thanatonautePas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 956Document32 pagesQuinzaine Littéraire 956thanatonaute100% (1)
- L'histoire Redevient Tragique - Une Rencontre Avec Emmanuel MacronDocument20 pagesL'histoire Redevient Tragique - Une Rencontre Avec Emmanuel MacronNicolas MasvaleixPas encore d'évaluation
- Fin de partie de Samuel Beckett (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandFin de partie de Samuel Beckett (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- La Revue SocialisteDocument128 pagesLa Revue SocialisteParti socialiste100% (2)
- Aurélien de Louis Aragon: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandAurélien de Louis Aragon: Les Fiches de lecture d'UniversalisÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Arnaud Vareille, L'Œil Panoptique: La Norme Dans Les Romans D'octave MirbeauDocument11 pagesArnaud Vareille, L'Œil Panoptique: La Norme Dans Les Romans D'octave MirbeauAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Cahiers Du Cinema 298Document76 pagesCahiers Du Cinema 298Axel NuñezPas encore d'évaluation
- Maxime BENOÎT-JEANNIN, Mirbeau/Céline: Une Fausse AnalogieDocument12 pagesMaxime BENOÎT-JEANNIN, Mirbeau/Céline: Une Fausse AnalogiePierre MICHELPas encore d'évaluation
- Maurice Blanchot - Georges BatailleDocument10 pagesMaurice Blanchot - Georges BatailleVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 84Document32 pagesQuinzaine Littéraire 84thanatonautePas encore d'évaluation
- Kropotkine Pierre - L'entraide PDFDocument342 pagesKropotkine Pierre - L'entraide PDFjeroe12100% (2)
- Duroselle - Paix Et Guerre Entre Les NationsDocument18 pagesDuroselle - Paix Et Guerre Entre Les NationsBejmanjinPas encore d'évaluation
- KAlifa 1999 L Ere de La Culture MarchandiseDocument8 pagesKAlifa 1999 L Ere de La Culture MarchandiseRafael RíosPas encore d'évaluation
- Bernard Jahier, La Caricature Dans Les "Contes Cruels" D'octave MirbeauDocument22 pagesBernard Jahier, La Caricature Dans Les "Contes Cruels" D'octave MirbeauAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- De L'écologie À L'autonomieDocument7 pagesDe L'écologie À L'autonomierichardPas encore d'évaluation
- Ivan Segré Re - Flexions - Sur - Les - Mondes - de - L - Esclavage - 1Document8 pagesIvan Segré Re - Flexions - Sur - Les - Mondes - de - L - Esclavage - 1josé macedoPas encore d'évaluation
- Louis Janover - Préface Au Livre de M. Rubel "Marx, Critique Du Marxisme" (2000)Document25 pagesLouis Janover - Préface Au Livre de M. Rubel "Marx, Critique Du Marxisme" (2000)EspaceContreCimentPas encore d'évaluation
- Clement Rosset Le Reel Et Son Double Ess PDFDocument8 pagesClement Rosset Le Reel Et Son Double Ess PDFabelPas encore d'évaluation
- Latour Bruno TeleramaDocument3 pagesLatour Bruno Teleramatotipotent3395Pas encore d'évaluation
- Revue Des Deux Mondes - AnimaDocument36 pagesRevue Des Deux Mondes - AnimaJean-François SpricigoPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Marielle Macé Ma Colère Veut Aller Vers Plus D'amour de La Vie, de La Vie CollectiveDocument11 pagesEntretien Avec Marielle Macé Ma Colère Veut Aller Vers Plus D'amour de La Vie, de La Vie Collectivejosé macedoPas encore d'évaluation
- Collège Méthodiste Libre Des Gonaïves 2017 1er ControleDocument2 pagesCollège Méthodiste Libre Des Gonaïves 2017 1er ControleWougens VincentPas encore d'évaluation
- Woroscope Frances PDFDocument14 pagesWoroscope Frances PDFHenrique XavierPas encore d'évaluation
- 02-3.situation Du WesternDocument118 pages02-3.situation Du WesternGabriel Fernandes de CarvalhoPas encore d'évaluation
- Cl. Burgelin, Lire L'idiot de La FamilleDocument11 pagesCl. Burgelin, Lire L'idiot de La FamilleAnonymous va7umdWyhPas encore d'évaluation
- Une Famille de VampiresDocument8 pagesUne Famille de VampiresHerne EditionsPas encore d'évaluation
- Vincent Peillon, Prophète D'une Religion LaïqueDocument40 pagesVincent Peillon, Prophète D'une Religion LaïqueCERU_publicationsPas encore d'évaluation
- Agone 45 - Orwell, Entre Littérature Et PolitiqueDocument214 pagesAgone 45 - Orwell, Entre Littérature Et PolitiqueSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- La Machine Infernale de Jean Cocteau (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa Machine Infernale de Jean Cocteau (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire, Numéro 90, Févier 1970Document32 pagesQuinzaine Littéraire, Numéro 90, Févier 1970thanatonautePas encore d'évaluation
- Les Spectres de L'ideologie Slavoj ZizekDocument13 pagesLes Spectres de L'ideologie Slavoj ZizeklestroyennesPas encore d'évaluation
- La Violence Du Pouvoir: Le Regard de Pier Paolo PasoliniDocument27 pagesLa Violence Du Pouvoir: Le Regard de Pier Paolo PasolinijibPas encore d'évaluation
- Johann Chapoutot - Je N'en Pouvais Plus Du Nazisme, Changer de Sujet Était Une Question de Survie - LibérationDocument7 pagesJohann Chapoutot - Je N'en Pouvais Plus Du Nazisme, Changer de Sujet Était Une Question de Survie - LibérationSpyros KakouriotisPas encore d'évaluation
- Georges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereDocument4 pagesGeorges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Quinzaine Littéraire 93, Avril 1970Document32 pagesQuinzaine Littéraire 93, Avril 1970thanatonautePas encore d'évaluation
- Marx Le Capitale 1875 IDocument96 pagesMarx Le Capitale 1875 Ilph21Pas encore d'évaluation
- Internationale Situationniste 1Document32 pagesInternationale Situationniste 1michaelkbg100% (1)
- Huis ClosDocument4 pagesHuis ClosCaro SgPas encore d'évaluation
- Bureau de Recherches SurrealistesDocument18 pagesBureau de Recherches SurrealistesGavin MichaelPas encore d'évaluation
- Aron R Introduction A La Phi Lo Sophie de L HistoireDocument293 pagesAron R Introduction A La Phi Lo Sophie de L Histoireegonschiele9Pas encore d'évaluation
- Regulae (Traduction)Document43 pagesRegulae (Traduction)Chasa ZigoPas encore d'évaluation
- Reperes PhiloDocument4 pagesReperes PhiloGustavoPas encore d'évaluation
- Philo ESDocument1 pagePhilo ESbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Les Dilemmes de La Métaphysique PureDocument302 pagesLes Dilemmes de La Métaphysique Pureegonschiele9100% (1)
- Alexandre D'Aphrodise - Traité Du DestinDocument173 pagesAlexandre D'Aphrodise - Traité Du Destinzevencias100% (1)
- Emile Meyerson Le Physicien Et Le PrimitifDocument38 pagesEmile Meyerson Le Physicien Et Le Primitifegonschiele9Pas encore d'évaluation