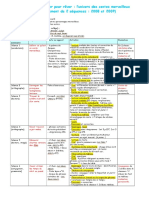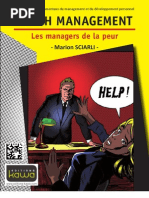Etude D'exil
Etude D'exil
Transféré par
Ahmed BerrouhoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Etude D'exil
Etude D'exil
Transféré par
Ahmed BerrouhoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Etude D'exil
Etude D'exil
Transféré par
Ahmed BerrouhoDroits d'auteur :
Formats disponibles
AHMED BERROUHO
TENTATIVE D’INTERPRETATION
D’EXIL
DE SAINT - JOHN PERSE
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
INTRODUCTION
Saint –John Perse est un poète français contemporain qui est né en
Guadeloupe en 1887 et qui est mort en France en 1975.Il a exercé le métier
de diplomate Jusqu’en 1939 et, quand la seconde guerre mondiale éclate, il
part aux Etats – Unis où il réside pendant dix-huit ans ; il ne revient en
France qu’en 1957. Durant la guerre, tout en travaillant comme conseiller à
la Bibliothèque du Congrès, Il compose un petit recueil qu’il intitule Exil
et qui se compose de sept poèmes numérotés en chiffres romains de I à
VII. Le premier comporte sept versets, le second, vingt-et-un versets, le
troisième, vingt-trois versets, le quatrième, vingt-et-un versets, le
cinquième, seize versets, le sixième, sept laisses qui sont de véritables
paragraphes et cinq versets ; le dernier poème compte deux séries de sept
versets et un monostiche final.
Le recueil de poèmes, Exil a été écrit en 1941 à Long Beach Island,
au New Jersey. La guerre qui fait rage en Europe constitue alors une
sombre catastrophe qui met la civilisation occidentale en danger. Le recueil
porte les traces sombres de ce péril. Nous verrons combien cette œuvre est
radicale et quelle table rase le poète y fait quant aux valeurs qui lui
paraissent arbitraires et suspectes. Nulle part ailleurs dans ses livres
ultérieurs, si l’on excepte cependant Vents, il ne sera aussi sombre et
sévère. C’est d’ailleurs dans Vents, que l’expression sera claire et efficace.
Saint – John Perse se plaint souvent dans son œuvre de ce qu’il appelle la
sécheresse du siècle qui se manifeste dans la mort de la culture, de son
ossification qui la transforme en fardeau mort qui encombre les
bibliothèques et les musées. Tout un poème de Vents est consacré à ce
problème. Pour lui, le siècle inculte et exsangue ressemble à un arbre mort
qui n’a pas reverdi au printemps et qui garde sa robe morte et désuète de
l’année dernière. « Car tout un siècle s’ébruitait dans la sécheresse de sa
paille, parmi d’étranges désinences : à bout de cosses, de siliques, à bout de
choses frémissantes,
Comme un grand arbre sous ses hardes et ses haillons de l’autre
hiver, portant livrée de l’année morte ;
Comme un grand arbre tressaillant dans ses crécelles de bois mort et
ses corolles de terre cuite –
Très grand arbre mendiant qui a fripé son patrimoine… » 1 la même
expression est déjà présente dans Exil : « Plus d’un siècle se voile aux
défaillances de l’histoire. » 2 Dans La gloire des rois, ce reproche apparaît
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
comme un refrain, aux chants I et III : » Aux soirs de grande sécheresse sur
la terre. »2 bis
Dans le poème 4 de la partie I de Vents, Saint – John Perse tourne en
ridicule tout cet appareil onéreux qui a pour objectif l’établissement d’un
culte à une culture morte. « Un homme s’en vint rire aux galeries de pierre
des Bibliothèques (…) où sont les livres dans leurs niches, comme jadis,
sous bandelettes, les bêtes de paille dans leurs jarres, aux chambres closes
des grands Temples – les livres tristes, innombrables, par hautes couches
crétacées portant créance et sédiment dans la montée du temps… » Le
poète dénonce ce nouveau « Serapeum », « cette pruine de vieillesse »,
ce » leurre », « cette sécheresse et cette supercherie d’autels » où il n’ y a
que « cendres et squames de l’esprit ».3
Nous verrons comment le poète s’efforce de résoudre ces questions
dans Exil, comment il essaie d’éviter l’immobilité et la sclérose qu’elle
provoque, quelle forme l’œuvre créée doit avoir pour ne pas devenir à son
tour un cadavre supplémentaire d’un patrimoine culturel qui ne cesse de
s’élargir aux dépens du jeune créateur intimidé qui doit apprendre à
coltiner de lourds et inutiles fardeaux avant de décider de les jeter bas pour
se lancer dans la recherche de sa propre œuvre.
La poésie de Saint – John Perse est d’un abord difficile, mais cette
difficulté n’est ni gratuite ni insurmontable ; Saint – John Perse conçoit la
poésie comme une tâche noble qui exige un effort d’exploration d’une
réalité lointaine qu’il faut aller trouver aux confins du senti et du connu.
Cette rencontre et l’investigation qui en résulte, se font dans des conditions
particulières de péril, de souffrance et d’obscurité. Il s’ensuit que
l’expression est obscure sinon inintelligible. Dans le discours de Suède
qu’il prononce quand il reçoit le Prix Nobel, il déclare : « L’obscurité
qu’on lui (à la poésie) reproche ne tient pas à sa nature propre, qui est
d’éclairer, mais à la nuit même qu’elle explore, et qu’elle se doit
d’explorer ; celle de l’âme elle-même et du mystère où baigne l’être
humain. »4
Cette poésie comporte un réel dépassement de soi, elle nous incite à
repousser les limites de cette réalité intérieure et de ce monde qui nous est
extérieur ; ces derniers se ferment vite sur nous et nous acculent à la
sclérose ; pour esquiver cette mort prématurée, il est indispensable d’être
rapide, clairvoyant et d’éviter le repli et le refroidissement de cet
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
avènement incessant et inconnu qui nous échappe toujours et avec lequel il
faut se colleter sans arrêt.
Dans cette étude, nous allons essayer de montrer de
façon humble combien cet effort poursuivi par le poète pour traverser le
désert et explorer cette réalité innommable qui se retire, doit être
vigoureuse et rigoureuse afin que soit saisi cela qui fait rage et le mettre en
phrases écrites qui seront forcément incomplètes, n’évoquant qu’une partie
de ce que le poète parvient à saisir ; à une écriture âpre et ardue devrait
correspondre sans aucun doute l’exercice courageux d’une lecture
ambitieuse et opiniâtre. Saint –John Perse à l’instar de Mallarmé considère
la lecture comme une pratique désespérée.
Nous allons user pour tenter d’appréhender le sens de ce recueil,
d’une méthode d’analyse sémantique et rhétorique qui se trouve exposée
dans Rhétorique de la poésie, du Groupe de Liège. Sur le plan
syntagmatique, des sèmes peuvent être regroupés et lorsque les
impertinences sémantiques auront été reconverties et traduites grâce aux
procédures rhétoriques qui sous-tendent des tropes tel que les synecdoques,
les métaphores et les métonymies, une partie importante de l’œuvre sera
éclaircie, une véritable cohérence en résultera, nous aimerions ainsi
démontrer que l’esprit du poète n’a jamais été obnubilé par aucune ivresse,
surtout celle de l’euphuisme et de la loquacité ; la lucidité est un véritable
impératif catégorique pour Saint – John Perse. « Ivre, plus ivre, disais-tu,
de renier l’ivresse… »5
LE CHOIX DE LA MOBILITE
Dans Exil, Saint – John Perse pense que toute existence installée et
ancrée dans un espace et une culture, finit par se trouver à l’étroit ; ce
milieu restreint devient un piège pour cette existence qui s’appauvrit et
dégénère. Saint John Perse pose à nouveau à l’instar d’autres poètes le
problème du rapport à la terre ; comme Hölderlin et comme René Char, il
opte pour une occupation poétique de la terre où l’homme est obligé de
préserver la grandeur et la beauté de la terre. Pour donner à la vie richesse,
variété et capacité créative, il se doit d’adopter un mode de vie poétique
caractérisé par l’ouverture d’esprit, par l’éveil de la conscience et des sens
à toutes les dimensions de la vie sur terre. « Mais plus encore que mode de
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
connaissance, la poésie est d’abord mode de vie – et de vie intégrale . »6
affirme Saint – John Perse dans le discours de Suède.
Dès le premier poème, Le thème de l’habitation est présent. Une
isotopie du logement apparaît à plusieurs reprises ; il est question de
« portes » puis de « clés », de « maison de verre » et de « seuil » ;
d’ailleurs, même la couche que le divin déserte, en fait partie. A travers la
métaphore filée de l’habitat, Saint – John Perse oppose ici deux attitudes
antithétiques dans la façon de se loger sur la terre : il dénonce celle qui est
négative et qui consiste à construire une demeure fermée pour s’y abriter
contre le monde et ses dangers ; cela se traduit par le rétrécissement des
ressources vitales, par l’appauvrissement de la vie. Il s’agit d’une situation
de clôture perverse où l’individu ne peut que végéter en sorte que
l’existence devient une mort lente.
Saint – John perse semble condamner par là toute volonté de
sédentarité qui porterait les germes d’une dégénérescence due sans doute à
l’isolement où se trouve cette vie à jamais établie et qui cesse d’entrer en
communication avec le reste du monde.
« Portes ouvertes sur les sables, portes ouvertes sur l’exil »6 bis
Le premier verset du poème d’Exil, qui sur le plan syntaxique se
caractérise par son inachèvement, constitue en quelque sorte un slogan, une
proclamation pleine d’émotion, de colère contre un piège qui menace
d’enfermer celui qui s’attarde dans une sédentarisation susceptible de
l’affaiblir et de l’étrangler, comme il vibre de ferveur qui l’incite à se lever
et à sortir de cette prison dangereuse ; dès le départ, l’exil est considéré non
comme un événement pathétique qui s’accompagne de cris, de larmes et de
nostalgie, mais comme un acte certes dramatique, néanmoins tout à fait
libre et nécessaire, la seule issue vraiment désirée, appelée, celle qui même
accomplie dans la douleur, permet à l’homme menacé dans ses ressources
vitales, de retrouver valeur dignité et fécondité.
Une attitude est librement adoptée, une décision difficile est prise.
L’exil est voulu et assumé au début de ce recueil ; l’allusion à la maison
que l’on quitte pour entrer dans ce désert ou cette mer qu’évoque de façon
métaphorique l’exil et les sables. Dans les deux phrases nominales qui
ouvrent le poème initial d’Exil, le parallélisme syntaxique permet en effet
de rapprocher deux phénomènes distincts, les sables et l’exil.
L’inachèvement des deux phrases s’explique sans doute par le principe de
mobilité et de rapidité qui revient dans l’ensemble de l’œuvre de Saint –
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
John Perse ; la brièveté traduit l’impatience du sujet de l’énonciation
poétique qui veut sortir de cette demeure fermée et sans hésiter accomplir
la résolution qu’il a prise. Il choisit de sortir de cette maison dont il quitte
le « seuil », malgré le soleil qui se trouve écartelé et qui a les os brisés, «
l’astre roué vif sur la pierre du seuil »7, menaçant de brûler le poète lui-
même.
L’ECLIPSE DU DIVIN
L’exil est dû à une autre cause ; le poète s’aperçoit que l’homme
sédentaire évacue tout sacré. Dans cette vie étriquée, vouée à la satisfaction
des instincts, le divin se trouve à l’étroit et s’échappe : « Et, sur toutes
grèves de ce monde, l’esprit du dieu fumant déserte sa couche
d’amiante. »8 Rappelons que Saint - John Perse est un athée endurci ; des
écrivains beaucoup plus âgés que lui comme Francis Jammes et Paul
Claudel, ont essayé de le convertir au catholicisme quand il n’avait pas
encore vingt ans mais ils ont échoué. Cependant, il n’est animé d’aucune
haine ou rancune anticléricale ou irréligieuse. Aussi, Quand il parle de sa
mère, qui a toujours été très pratiquante et très pieuse, dans Exil et dans
Neiges, il rappelle et respecte sa grande piété ; il le fait avec sympathie
certes mais surtout avec détachement quand il utilise le pronom possessif
« son Dieu » :
« Et cette à qui je pense entre toutes femmes de ma race, du fond de
son grand âge lève vers son Dieu sa face de douceur »9
Athée, il l’est en effet, parce qu’il ne croit à aucune religion établie ;
pourtant cela ne l’empêche pas d’être sensible au divin, au sacré et son
œuvre poétique porte la marque de cette sensibilité. Dans la discours de
Suède, il affirme clairement la nécessité du divin qui constitue selon lui
une dimension indispensable et irréductible de l’homme : « De l’exigence
poétique, exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes, et par la
grâce poétique, l’étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain.
Quand les mythologies s’effondrent, c’est dans la poésie que trouve refuge
le divin ; peut-être même son relais »10 Dans Exil, le divin semble se
manifester non pas continûment mais de manière discontinue ; son
intermittence semble liée au caractère sporadique de la création poétique.
Le caractère bref, instantané de l’effort fructueux de création, accompagne
et détermine cette épiphanie. Par ailleurs, le divin apparaît dans Exil, grâce
à la métaphore de l’orage, surtout dans les manifestations violentes et
rapides de l’éclair et de la foudre. Notons que dès le départ, la métaphore
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
est amorcée ; le divin , comme Jupiter, possède cet apanage et cette arme
redoutable qu’est la foudre ; en effet l’allusion au feu est indéniable, le
dieu est fumant, sa couche est constituée par ce matériau incombustible
qu’est l’amiante. De plus, la métaphore qui est utilisée à la fin de ce
premier poème d’Exil, abonde dans ce sens ; le divin quand il se manifeste,
le fait de façon intermittente, discontinu comme le prouve le métaphore
finale.
« Les spasmes de l’éclair sont pour les princes en Tauride »11
L’éclair fulgure en effet de manière spasmodique avec une phase de
tension et un autre de détente, d’apparition et de disparition.
Si la lumière éphémère du divin fait défaut au monde moderne qu’un
mode de vie sédentaire altère, elle se manifeste en Tauride, ancien nom de
la Crimée, il semble que Saint –John Perse désigne ainsi une tranche de
l’histoire où le divin était présent sur terre ; L’importance accordée au
divin, est renforcée par la primauté et l’ascendant que Saint – John Perse
attribue à l’âme sur le corps ; le poète privilégie l’ascèse et considère
l’effort, la ténacité et la volonté comme des atouts dans la recherche
poétique. D’un recueil à l’autre, Saint – John Perse stigmatise le fatalisme,
la paresse et la délectation morose ; pour lui, l’homme doit rester debout et
faire preuve d’optimisme dans toute situation quelque tragique qu’elle soit.
Dans Vents, il déclare : « Nos revendications furent extrêmes à la
frontières de l’humain » ; il ajoute que : « les revendications de l’âme sur
la chair sont extrêmes. Qu’elles nous tiennent en haleine
Et qu’un mouvement très fort nous porte à nos limites, et au-delà de
nos limites. »12
Dans, Exil aussi, Saint – John Perse exige cette vigilance surtout
lorsque le bonheur menace d’envoûter le poète pour ensuite le plonger dans
le bourbier de l’aisance et du plaisir ; pour affronter le confort et résister à
« l’aigle équivoque du bonheur, il doit imposer silence à sa sensualité, à sa
sensibilité : « Tais-toi, faiblesse, et toi, parfum d’épouse dans la nuit (…)
Tais-toi, douceur, et toi présence gréée d’ailes à hauteur de ma selle. »13
L’ADVERSITE
L’exil, une fois déclenché, dépouille celui qui l’accomplit de toute
protection, de toute arme, en sorte que ce dernier se trouve dehors exposé à
tous les dangers, alors qu’il est démuni, nu, vulnérable. En effet, l’exil
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
redonne à l’homme sa condition première, celle où il était la proie de tous
les périls. L’exil s’accompagne de souffrances ; étant donné que l’homme a
abandonné toutes les richesses acquises sur le plan matériel et intellectuel,
il se trouve désormais sans armes ni protection contre l’adversité à laquelle
il est exposé. Déjà, dans le premier poème d’Exil, Saint – John Perse
souligne ce calvaire que déclenche celui qui franchit le seuil de sa maison
pour devenir errant. De toutes façons, dans ce désert où il pénètre, même le
bourreau qu’est le soleil se découvre victime. La métaphore, « l’astre roué
vif sur la pierre du seuil » montre que le soleil souffre et râle sans cesser
par ailleurs de s’acharner sur le pauvre exilé en lui jetant ses flèches
incandescentes ; les rayons du soleil deviennent des fers de lances qui lui
font des blessures qu’ils continuent à élargir cruellement.
« L’été de gypse aiguise ses fers de lances dans nos plaies »14
LE CHOIX DE L’EXTREME
Nous avons déjà dit que l’exil n’était pas une fatalité que le poète
était obligé d’accepter. L’exil est un acte libre et volontaire. Saint – John
Perse le répète deux fois. « J’élis un lieu flagrant et nul »15 ; et il ajoute
dans le chant suivant : « J’ai fondé sur l’abîme et l’embrun et la fumée des
sables. »16 Mais cet acte constitue pour l’esprit et le corps une gageure et
un scandale ; les sévices qui y sont récoltés, en font une véritable traversée
du désert. Sur le plan intellectuel, cet acte reste inintelligible, presque
dément. Saint – John Perse, pour en souligner la gravité et la radicalité,
recourt à plusieurs reprises à l’oxymore. Quand il affirme qu’il choisit
d’explorer « un lieu flagrant et nul comme l’ossuaire des saisons », la
contradiction est évidente entre le caractère local et ponctuel du mot lieu et
la négation de cette limitation, de cette détermination qui est due à la
seconde épithète nul. Un lieu nul est en effet une contradiction qui
empêche l’intégration du sens du syntagme, sauf si l’on accepte d’atténuer
ou d’effacer l’un des termes de la contradiction. Une autre oxymore est là
encore dans le second poème quand il écrit : « J’ai fondé sur l’abîme et
l’embrun et la fumée des sables. » Fonder, édifier quelque chose sur rien
étant impossible, une contradiction nette oppose le verbe fonder et son
complément circonstanciel sur l’abîme. Le poète avait déjà répété
auparavant son attachement à une gloire qui n’en est pas une : « Ma gloire
est sur les sables ! Ma gloire est sur les sables !... »16 bis La même
contradiction oppose ici encore la gloire qui présuppose célébrité,
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
admiration, réussite et les sables qui n’évoquent que solitude, précarité et
dénuement.
Toutes ces oxymores ont pour fonction de faire de l’exil un acte
dangereux, extrême, quasi impossible ; il ne s’agit pas d’une simple
pérégrination mais d’une exploration, d’une pénétration de la nuit
complète, dure et hostile qui résiste et qui fait échouer cet effort. Saint –
John Perse considère effectivement l’exil comme l’essai d’une avancée
illimitée dans ces parages inconnus que l’homme n’a ni parcourus ni
cadastrés et où, comme c’est un véritable saut dans un univers inconnu à la
fois intérieur et extérieur, encore vierge, il est indispensable d’user de tous
les pouvoirs, de toutes les ruses et de toutes les audaces.
Dans le discours de Suède, Saint – John Perse, qui est un homme de
science par ailleurs, reconnaît, à côté de l’investigation efficace de la
recherche scientifique, une fonction de connaissance intuitive à la poésie
dans les domaines restés inexplorés ; il lui attribue le rôle d’éclaireur et de
pionnier qu’avait la philosophie à l’époque des Présocratiques : « Par la
pensée analogique et symbolique, par l’illumination lointaine de l’image
médiatrice, et par le jeu de ses correspondances, sur mille chaînes de
réactions et d’associations étrangères, par la grâce enfin d’un langage où se
transmet le mouvement même de l’Etre, le poète s’investit d’une surréalité
qui ne peut être celle de la science. Est-il chez l’homme plus saisissante
dialectique et qui de l’homme engage plus ? Lorsque les philosophes eux-
mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le
métaphysicien ; et c’est la poésie alors, qui se révèle la vraie « fille de
l’étonnement », selon l’expression du philosophe antique à qui elle fut
suspecte. »17
LA NUIT / L’INCONNU
L’exil oblige l’homme à quitter le monde connu pour entrer dans
l’inconnu. Pour désigner ce milieu dans lequel il s’efforce de pénétrer,
Saint – John Perse utilise la métaphore de la nuit qui ne s’oppose plus au
jour mais à la clarté d’une réalité déjà approchée, éclaircie et comprise.
Pour accéder à la nuit, le poète doit sortir du périmètre connu, laisser de
côté cette clairière d’objets, de sentiments, d’habitudes ; il doit du moins
tenter d’en atteindre les limites car il est difficile de sortir de l’ornière dans
laquelle le corps et l’esprit ont pris leurs assises et leurs aises.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
Cet arrachement violent et difficile trouve son expression dans
l’isotopie de la frontière qui est partout présente dans le recueil, qu’elle soit
« seuil » de la demeure, « rives » de la mer. La traversée du désert est un
acte douloureux qui coûte sur le plan physique et moral. La nuit trouve son
expression la plus scandaleuse et la plus radicale, dans les oxymores qui
parsèment ce recueil puisqu’il est difficile sinon impossible de donner une
signification nettement délimitée et plausible à ces états limites.
Cependant, le thème apparaît à plusieurs reprises :
«… Plus haute, chaque nuit, cette clameur muette sur mon seuil,
plus haute, chaque nuit, cette levée de siècle sous l’écaille, »17bis
« Etrange fut la nuit où tant de souffles s’égarèrent au carrefour
des chambres… »18
« L’officiant (…) efface (…) l’affleurement des signes illicites
de la nuit. »19
La nuit est donc cette limite extrême où mène l’exil dans la traversée du
désert du corps comme de l’âme. Le poète est obligé d’avancer jusqu’à
cette frontière où règne la nuit et où il ne possède aucun pouvoir :
« Et la naissance de son chant ne lui est pas moins étrangère. »20
En fait, l’exil est une espèce de déblayage qui évacue tout ce qui encombre
un espace en faisant table rase d’un contenu et d’un connu totalement
refroidis afin qu’une réalité encore incandescente et dangereuse vienne s’y
poser et trouver forme. Saint – John Perse fait allusion au caractère
préparatoire et transitoire de l’exil quand il affirme :
« Comme le cavalier, la corde au poing, à l’entrée du désert,
J’épie au cirque le plus vaste l’élancement des signes les plus
fastes. »21
Cette avancée attentive caractérisée par une humble expectative, est une
attitude que le poète renouvelle plusieurs fois. Souvent, l’attente se révèle
vaine :
« Sur trop de grèves visitées furent mes pas lavés avant le jour,
sur trop de couches désertées fut mon âme livrée au cancer du silence. »22
Cette attente a lieu la nuit et il s’agit non de dormir mais de veiller ; ce qui
montre que l’exil est une exploration de l’intériorité et du monde extérieur,
c’est le rôle que joue le silence qui s’impose dans ce désert car tout
bavardage pour tromper sa peur, est interdit.
10
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
LA TRAVERSEE DU DESERT
Le choix de l’exil est une gageure qui s’expie ; lorsque le seuil de la
demeure close et sure, est franchi, le monde devient un désert et la vie, une
déambulation sans fin de nomade. Cela est dit et répété dès le départ ;
désormais, le seuil du logis est une « maison de verre » qui n’abrite guère,
qui au contraire expose à tous les périls du dehors et du désert ; cet espace
choisi est en fait un lieu flagrant et nul, un lieu qui ne protège point, un lieu
qui ne retient point celui qui y séjourne dans la mesure où il ne cesse de
changer et de s’annuler ; ce « lieu nul » est une oxymore qui fait de cet
espace qui n’accroche ni ne retient, la négation même d’un lieu déterminé
et délimité. Dans le chant II, Le choix de la vie nomade est rappelé, le
poète opte pour un lieu nu :
« Et ce n’est pont errer, ô Pérégrin,
Que de convoiter l’aire la plus nue pour assembler aux syrtes de
l’exil un grand poème né de rien, un grand poème fait de rien… »23 Ainsi,
devient-il l’errant, le pèlerin, le« pérégrin », et ici encore Saint – John
Perse affirme que cette errance n’est pas une erreur, qu’elle est réellement
la seule façon de suivre sa voie, la voie féconde de la régénération de soi et
de la création poétique. En outre, il pense que cet exil ne se limite pas à
l’espace géographique mais s’étend à l’Histoire. Après s’être détaché du
lieu habité, il faut se libérer du présent où il est ancré ; en effet, l’exil est le
parcours incessant d’un lieu flagrant et nul qui est comparé à « l’ossuaire
des saisons » ; sans doute, est-ce là une métaphore qui transforme le temps
qui est désigné de façon synecdochique par les saisons, qui ne cesse de
détruire et de tuer et qui transforme peu à peu le monde en ossuaire. L’exil
acquiert aussi une dimension temporelle et historique qui apparaît à
plusieurs reprises dans Exil grâce à des noms de personnages ou de lieu.
Dans le premier chant, la poésie (que représente la métaphore du spasme
des éclairs) fait défaut alors qu’elle fut le lot « des princes en Tauride ».24
La traversée du désert n’est pas une étape provisoire qui une fois
accomplie, donne au poète le droit de s’établir et de se reposer ; l’exil a un
caractère durable, permanent qui semble transformer la vie réellement
vécue en une traversée du désert. Saint – John Perse le répète tout au long
d’Exil : « L’exil n’est point d’hier ! L’exil n’est point d’hier ! »25
11
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
PHILOSOPHIE DE LA DESTRUCTION
Dans ce voyage interminable, le poète qui est exposé à tous les
dangers d’une réalité hostile, découvre dans le monde une philosophie
extrêmement pessimiste que les éléments ne cessent de répéter à qui peut
les entendre et qui dit que tout est en vain, tout est voué à la mort et à la
destruction et rien ni personne ne mérite d’échapper à cette fatalité. C’est
ce que dit la mer à ceux qui la traversent :
« Où furent les voiles haut tendues s’en va l’épave plus soyeuse
qu’un songe de luthier,
Et la mer à la ronde roule son bruit de crânes sur les grèves, »
C’est ce que le vent clame aussi :
Et que toutes choses au monde lui soient vaines, c’est ce qu’un soir,
au bord du monde, nous contèrent
Les milices du vent dans les sables d’exil… »26
Cette philosophie négative est appelée encore une « sagesse de l’écume »
qui est aussi nocive et absurde que les pires élucubrations de l’esprit :
« Sagesse de l’écume, ô pestilences de l’esprit dans la crépitation du
sel et le chaux vive ! »27 Cette connaissance est fort corrosive puisqu’elle
a la capacité de destruction du sel et de la chaux ; Du reste, Saint – John
Perse affirme qu’il s’agit d’ « Une science » qui lui « échoit aux sévices de
l’âme… » .28 Cela signifie que son acquisition provoque une véritable
souffrance puisqu’elle heurte en lui toutes les bonnes dispositions à l’égard
du monde.
LA RENCONTRE
Désarmé, le poète affronte dans l’exil un inconnu fort violent et
hostile qui met sa vie en danger. En effet, quand il quitte le confort douillet
du connu où le préserve la force de l’habitude, le poète qui est allé au bout
de lui-même jusqu’à la frontière du monde de l’émotion du sentiment et de
la pensée, se heurte à une réalité insaisissable et obscure ; pour souligner
cette distance, cette limite lointaine, Saint – John Perse recourt à une
batterie de comparaisons et de métaphores à l’aide desquelles, il s’efforce
de faire passer au lecteur le caractère d’étrangeté, l’aspect imprévu de cette
réalité.
12
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
Il utilise pour la désigner le terme le plus général et partant le plus
vague parce qu’il s’agit d’un phénomène difficile sinon impossible à
appréhender, en sorte que n’ayant pas encore de nom puisque personne n’a
encore réussi à l’approcher pour le nommer, il demeure littéralement
innommable. C’est pourquoi le poète est forcé de recourir au vocable
passe-partout chose :
« Toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette splendeur
(…)
Cette grande chose sourde par le monde…
Cette chose errante par le monde… »29
Il s’agit non seulement d’une réalité inconnue, mais surtout d’une réalité
monstrueuse qu’il tente d’approcher et de nommer en vain. En tout cas,
quand il la rencontre et l’interpelle, il se sert du substantif monstre
Il utilise pour la circonscrire tout un arsenal rhétorique ; d’abord, il
fait appel à plusieurs noms ; dans une anaphore qui structure la première
moitié du troisième chant, il reprend à trois reprises cette clameur ; «
Toujours, il y eut cette clameur »30 devient un refrain où, dans le second
hémistiche si l’on peut dire, il remplace splendeur par grandeur puis par
fureur. Il fait appel ainsi à ses caractéristiques fondamentales. Cette chose
est grande, lumineuse, violente ; puis il égrène quatre comparaisons :
« Et comme un haut fait d’armes en marche par le monde »31
Dans la première, la chose est un exploit qui a un caractère cruel, meurtrier
à l’instar d’une guerre qui fait rage dans le monde entier comme celle qui
venait d’éclater en Europe pendant la composition de ce recueil.
« Comme un dénombrement de peuples en exode »32
Dans la seconde, il donne au lecteur la forte impression causée par de
grands déplacements de populations que provoquent de grandes
catastrophes d’origine naturelle ou humaine.
« Comme une fondation d’empires par tumulte prétorien »33
L’image terrible de la conquête militaire d’une grande armée comme celle
de Rome, revient ici encore.
« Ha ! Comme un gonflement de lèvres sur la naissance des grands
Livres »34
La quatrième évoque, comme un point culminant que souligne
l’interjection ha ! l’avènement de la parole prophétique.
Des métaphores prennent le relais : « cette chose errante par le
monde, cette haute transe par le monde, et sur toutes grèves de ce monde,
du même souffle proférée, la même vague proférant
13
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
Une seule et longue phrase sans césure à jamais inintelligible… »
Et ce très ressac au comble de l’accès, toujours, au faîte du désir, la
même mouette sur son aire, à tire-d’aile ralliant les silences de l’exil, et sur
toutes grèves de ce monde, du monde souffle préparée, la même plainte
sans mesure
A la poursuite, sur les sables, de mon âme numide… »35
A la faveur d’une métaphore filée, le poète assimile cette chose à une mer
agitée et houleuse ; cette montée avait déjà commencé grâce à une
comparaison selon laquelle le phénomène grossit de façon prodigieuse
jusqu’à transgresser les limites : cette chose « s’accroît comme une
ébriété. » L’ivresse est un état d’excitation qui entraîne une perte de
conscience ; aussi, la transe qui réfère ensuite à la chose, souligne-elle cet
accroissement, et à la faveur de l’isotopie apportée par le soulèvement de la
mer, l’action violente et destructrice de la vague et du ressac atteint un
paroxysme. Cette manifestation violente ne reste pas muette, la vague
comme la mouette qui en écume la crête, prononce un chant qui a une
forme longue, ininterrompue et une signification énigmatique : la plainte
est sans mesure, l’unique et longue phrase est sans césure et à jamais
inintelligible.
Ainsi, pour permettre au lecteur d’approcher cette réalité
monstrueuse, de l’imaginer, de la saisir par plus d’un sens, Saint – John
Perse recourt aux procédés les plus divers de la rhétorique ; il faut noter
que le chant III d’Exil a une forme singulière qui attire l’attention du
lecteur averti. Il est bâti d’abord sur un rythme ternaire puis le nombre sept
prend la relève. Le poème est divisé en deux parties distinctes- structure
que l’on retrouve dans les premiers poèmes de Pluies. La première, à son
tour, compte trois parties reliées par l’anaphore : « toujours, il y eut… »
Chacune de ces parties est elle-même constituée d’une laisse insérée entre
deux versets. La deuxième partie du poème est divisée en deux strophes de
sept versets.
Dans ce troisième chant, le sujet de l’énonciation qui grâce à l’exil, a
atteint la frontière du connu et du senti, se trouve tout d’un coup face à face
avec cette réalité insaisissable et grandiose. Il s’efforce de cerner ce qui
évolue et il utilise des synecdoques quand il recourt aux substantifs
clameur, splendeur, grandeur, fureur. Cela nous permet sinon
d’appréhender cette manifestation paroxystique, du moins d’en recueillir
quelques caractéristiques. Ensuite des comparaisons apparaissent qui ont
pour but de montrer l’excès de force et de violence de cette réalité
14
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
exceptionnelle et monstrueuse. Cette grand chose sourde est un phénomène
mondial ; elle n’est pas installée ici plutôt qu’ailleurs, mais elle se déplace,
elle erre et le monde est son théâtre. Cette chose ne se manifeste pas de
façon uniforme, la force qui la caractérise, augmente et le poète utilise pour
exprimer cette montée une comparaison avec l’état d’ébriété ; il veut sans
doute montrer que cette force est inextinguible comme l’est l’ivresse qui
supprime toute maîtrise ; cette chose dépasse la capacité de saisie et de
contrôle ; c’est pourquoi cette chose est comparée à une bataille militaire, à
un formidable exode comme à la parole prophétique. Elle devient comme
nous venons de le voir, une transe, une vague et une mouette.
LA JOUTE
Dans les deux strophes de la seconde partie du chant III, comme
l’annonçait la fin de la précédente laisse, le poète recherche cette réalité
monstrueuse et cette dernière le pourchasse aussi (« A la poursuite sur les
sables de âme numide… ») 36 La rencontre a lieu, le poète fait face à cette
chose. Rappelons ici que le poète n’a pas le pouvoir de l’appeler ni de la
convoquer à sa guise ; la chose, en revanche bénéficie de liberté et de
souveraineté, tandis que le poète ne peut que se risquer à l’extrême limite
et attendre ; s’il a de la chance, cette chose se manifeste car elle aussi
semble affectionner la chasse.
Une fois qu’il se trouve face à elle, le poète l’interpelle en utilisant le
terme monstre. De plus, ce n’est pas la première fois qu’il la rencontre ; il
l’a déjà défiée puis affrontée à diverses reprises.
« Je vous connais, ô monstre ! Nous voici de nouveau face à
face. »37 La lutte qu’il lui livre alors est une joute oratoire : « Nous
reprenons ce long débat où nous l’avons laissé. »38 Chacun use
d’arguments pour convaincre l’autre de sa supériorité : « Vous pouvez
pousser vos arguments comme des mufles bas sur l’eau, »39 le poète se bat
sérieusement pour avoir le dessus ; il s’efforce de fatiguer le monstre : « Je
ne vous laisserai point de pause ni répit. »40 Il semble que le poète
revendique la victoire et la remporte et cela grâce à l’ascèse qui l’a purifié
et grandi, ascèse qui consistait d’abord à veiller le plus possible :
« Sur trop de grèves visitées furent mes pas lavés avant le jour »41,
puis à s’imposer un silence absolu qui l’a fait souffrir comme une maladie
incurable :
« Sur trop de couches désertées fut mon âme livrée au cancer du
silence. »42
15
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
Le poète ignore cependant l’issue de cette lutte car il ne maîtrise pas
la naissance de son chant ; en revanche, le monstre a un dessein et entend
l’accomplir comme le montre la question du poète :
« Que voulez-vous encore de moi, ô souffle originel ? Et vous, que
pensez-vous encore tirer de ma lèvre errante ? »43 Nous apprenons ici que
cette réalité monstrueuse est le souffle originel ; il s’agit donc de la source
même de la parole poétique qui est seule en mesure de prodiguer
inspiration et création. Le poète recourt pour y référer à plusieurs
dénominations ; il l’appelle Souffle originel, ensuite, il la nomme force
errante, enfin, il la traite de Mendiante, alors qu’il se désigne lui-même
comme un Prodigue et comme un prince en exil.
RENVERSEMENT DES VALEURS
Ce qu’il faut mentionner à ce sujet c’est que le poète dévoile ici
l’attitude subversive et iconoclaste qu’il adopte à l’égard des valeurs
traditionnelles et bourgeoises. Ce renversement des valeurs frappe l’amour
et l’économie. Ainsi, sur le plan des mœurs, la poésie qui sera personnifiée,
n’est pas considérée comme une femme aimante et fidèle à l’instar d’une
Laure ou d’une Béatrice par exemple, mais comme une fille de joie qui n’a
avec le poète que des rencontres charnelles furtives et brèves ; aussi, sera-t-
elle considérée comme une fille répudiée, comme une fille malaimée,
comme une courtisane. Sur le plan économique, contrairement aux
conduites intéressées, utiles et bourgeoises, la poésie est un acte qui se
caractérise par sa gratuité ; la poésie comme la guerre, l’architecture
monumentale, la mode somptuaire, est une conduite de dépense où une
énergie est consumée sans qu’aucun gain ne s’ensuive qui compense cette
perte ; cette notion de dépense improductive est exposée dans La Part
maudite de Georges Bataille. Le poète est un prodigue parce qu’il dilapide
à perte toutes les richesses qui lui sont confiées ; Du reste, la poésie n’est
pas une denrée avec laquelle il peut initier un négoce car ce qu’il a, ne peut
ni ne doit être monnayé ; la fin du chant V qui est si long, si bizarre et si
baroque par l’énorme énumération qui y est faite des princes de l’exil,
quatre versets sont consacrés à la question de l’économie ; le poète est
étranger à ce trafic et quand il passe dans une grande ville, il ne peut y
trouver ni part ni place car il ne possède pas les richesses qui les lui
auraient données. En revanche, la manne poétique qu’il a, ne vaut rien ici
parmi ces gens qui ont perdu leur âme depuis belle lurette :
16
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
«Hôte précaire à la lisière de nos villes, tu ne franchiras point le seuil
des Lloyds, où ta parole n’a point cours et ton or est sans titre…44
Et sur les tables du changeur, tu n’as rien que de trouble à produire,
Comme ces grandes monnaies de fer exhumées par la foudre. »45
L’INSPIRATION
La rencontre du poète et de cette réalité monstrueuse qui habite le
monde aux confins du senti et du connu, ne prend pas uniquement
l’apparence d’un duel violent et meurtrier, à cause ou grâce à la force de
désir et de séduction qui les attirent l’un vers l’autre ; cette double attirance
revêt la forme d’une aventure amoureuse intense mais brève, la nuit qui
préserve la part d’inconnu qui habite les deux partenaires, semble favoriser
cette rencontre ; Le recours à l’isotopie de la relation érotique, est
indéniable. Ainsi, apparaissent, dans le chant IV, des termes qui réfèrent
explicitement à l’amour vénal, à la faveur de la rencontre furtive d’une
nuit :
« Etrange fut la nuit où tant de souffles s’égarèrent au carrefour des
chambres… »46
Cette rencontre éphémère ne permet pas au poète de connaître parfaitement
la poésie avec laquelle il vient de passer la nuit ; la brève expérience qu’il
vit, le surprend lui-même comme le montent les interrogations qu’il pose ;
il ne parvient pas à discerner la véritable nature de sa partenaire :
« Et qui donc avant l’aube erre aux confins du monde avec ce cri
pour moi ? Quelle grande fille répudiée s’en fut au sifflement de l’aile
visiter d’autres seuils, quelle grande fille malaimée,
A l’heure où les constellations labiles qui changent de vocables pour
les hommes d’exil déclinent dans les sables à la recherche du mot
pur ? »47
Un peu plus loin dans le même poème, la même incertitude et le même
ahurissement reviennent dans deux questions :
« Et qui donc était là qui s’en fut sur son aile ? Et qui donc, cette
nuit, a sur ma lèvre d’étranger pris encore malgré moi l’usage de ce
chant ? »48 La seconde interrogation précise que le poète ignore qui est la
poésie et par conséquent, en avoue le caractère involontaire et inattendue.
Comme beaucoup d’autres poètes, Saint – John Perse croit à l’inspiration ;
il pense que le travail de création n’est pas le résultat prémédité d’une
conscience intellectuelle ; le poète ne maîtrise pas le processus de la
17
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
création poétique ; il n’écrit pas volontairement selon un plan préétabli et
un calendrier fixé à l’avance ; il ne peut que se préparer à la réception de ce
que la chance lui donne souvent au moment où il s’y attend le moins.
L’idée de l’inspiration apparaît déjà à la fin du deuxième chant :
« Et la naissance de son chant ne lui est pas moins étrangère. »49 La
même notion se retrouve ici dans cette interrogation sur l’identité de la
poésie :
« Et qui donc, cette nuit, a sur ma lèvre d’étranger pris encore malgré moi
l’usage de ce chant ? »50
LA TRANSFIGURATION
La rencontre avec la poésie est suivie de plusieurs conséquences ; la
nuit dense et noire s’entrouvre et pour peu de temps fait place au matin :
« Toute chair à naître s’horripile à l’orient du monde, toute chair
naissant exulte aux premiers feux du jour ! »51
Le poète avait déjà amorcé cette éclaircie à la fin du second chant :
« Et le matin pour nous mène don doigt d’augure parmi les saintes
écritures. »52 puis, la poésie qui est venue passer quelques instants
nocturnes avec le poète, ne s’attarde pas et s’en va « avant l’aube, à l’heure
où les constellations »53 disparaissent du ciel hyperboréen.
La seconde conséquence est la transformation qui s’opère dans la
personnalité du poète ; il se trouve transfiguré, il change d’aspect et
devient un autre personnage avec une autre prestance, une nouvelle
identité ; il acquiert le charisme et le prestige d’un dieu ; cette apothéose
est incontestable dans ce verset du troisième poème :
« Tu ne te tairas point, clameur ! que je n’aie dépouillé sur les sables
toute allégeance humaine. (Qui sait encore le lieu de ma naissance ? »54
Ainsi, le poète considère son appartenance à l’espèce humaine comme une
carapace de chrysalide, comme une peau de serpent dont il va se
débarrasser pour trouver une apparence plus belle, digne de l’exploit qu’il
vient d’accomplir ; il bénéficiera d’une identité neuve comme le montre
l’allusion à son lieu de naissance. On peut se demander s’il reste encore un
homme, si la poésie ne le déifie pas ? A-t-il la même identité, porte-t-il le
même nom, il est permis d’en douter quand il ajoute dans le chant quatre:
« Et sur les rives très anciennes fut appelé mon nom… »55
A ce propos, Exil, s’achève sur une ambiguïté ; le poète déclare :
18
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
« Et c’est l’heure, ô Poète, de décliner ton nom, ta naissance et ta
race… »56
Que signifie ici le verbe décliner, le poète doit-il déclarer son identité,
produire ses papiers ou au contraire faut-il qu-il se débarrasse de son
identité pour en trouver une autre ? Il semble que la poésie transforme la
personne qui en est investi, lui donnant un corps nouveau et une
personnalité nouvelle.
LE PAYS NATAL
En troisième lieu, l’avènement de l’inspiration fait cesser subitement
mais momentanément le sentiment de l’exil, le poète transformé retrouve la
plénitude qu’il a connue quand il était encore enfant ; au troisième chant,
juste après son affrontement avec la réalité monstrueuse, il cesse d’être la
proie du vide et de l’ennui et se sent soudain envahi par une émotion forte,
semblable à un enthousiasme qui le remplirait et le ravirait ; il met l’accent
sur sa soudaineté et son exubérance :
« Et soudain tout m’est force et présence, où fume encore le thème
du néant. »57
A cause de son dénuement, à cause surtout de sa liberté et de sa
disponibilité, quand le bonheur l’aguiche de nouveau, toute la tristesse qui
le grevait comme une peau morte, se déchire et il se retrouve derechef
heureux et comblé. Dans le cinquième chant, il traduit ce sentiment de
plénitude par l’impression gratifiante d’avoir retrouvé le pays natal ; ce
n’est pas un hasard s’il se compare alors à un homme qui a longtemps
désiré plonger dans la mer mais qui en était frustré par la distance qui l’en
séparait, quelle est sa joie quand il revoit la mer et qu’il peut de nouveau
s’y jeter ! Il se compare ensuite à quelqu’un qui se lève tôt parce qu’il veut
respirer l’air pur du matin ; il insiste sur l’état d’innocence et de
vulnérabilité quand il retrouve le pays natal :
«…Comme celui qui se dévêt à la vue de la mer, comme celui qui
s’est levé pour honorer la première brise de terre (et voici que son front a
grandi sous le casque),
Les mains plus nues qu’à ma naissance et la lèvre plus libre, l’oreille
à ces coraux où gît la plainte d’un autre âge,
Me voici restitué à ma rive natale… »58
Le poète remarque le caractère inattendu et bref de cette plénitude et il met
l’accent sur la simplicité, la gratuité de cet état dans la mesure où il n’est
19
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
question de rien d’autre que de la résurgence du sentiment perdu de
l’existence ; Saint – John Perse prend soin de montrer que cette existence
pure ne requiert aucun moyen onéreux ; la présence de choses très futiles
suffisent pour en sublimer les délices, comme des insectes ou des
végétaux :
« Avec l’achaine, l’anophèle, avec les chaumes et les sables, avec les
choses les plus frêles, avec les choses les plus vaines, la simple chose que
voilà, la simple chose d’être là, dans l’écoulement du jour… »59
Comme Saint – John Perse est originaire des Caraïbes, la plénitude
s’accompagne d’une évocation des îles :
« Sur des squelettes d’oiseaux nains s’en va l’enfance de ce jour, en
vêtement des îles, et plus légère que l’enfance sur ses os creux de mouette,
de guifette, la brise enchante le eaux filles en vêtement d’écailles pour les
îles… »60
LE RETOUR DU DIVIN
En quatrième lieu, un changement crucial se produit ; le divin qui
avait déserté sa couche d’amiante au début d’Exil, est de retour ; le
sentiment de force, de présence et de plénitude, s’accompagne de l’arrivée
du sacré ; dans le troisième chant, quand il signale sa métamorphose, le
poète ajoute qu’un feu a éclaté, (qui semble coïncider avec la manifestation
de la poésie ,) et qu’une fumée s’en dégage encore : « où fume encore le
thème du néant. » ; et dans le chant suivant, l’expression devient plus
nette ; le dieu revient en effet et il a comme attribut, la capacité de faire du
feu :
« L’esprit du dieu fumait parmi les cendres de l’inceste. »61
En fait, Saint – John Perse fait de la poésie un feu sacré et il accorde à
l’instance qui la prodigue un caractère divin ; de plus, la manifestation de
la poésie est traduite métaphoriquement par l’isotopie de l’orage et surtout
par les phénomènes météorologiques de la foudre et de l’éclair. Ainsi, au
début du dernier chant, pour parler de la rapidité, de la volatilité du texte
poétique, pour en souligner l’aspect lapidaire, il parle de « syntaxe de
l’éclair » ; en outre, quand il demande à sa mère (avec qui il paraît
entretenir une relation muette mais privilégiée à telle enseigne qu’il semble
croire ici à la télépathie) si elle a assisté de loin, ( il se trouve en Amérique
tandis qu’elle habite en France) à l’éclosion de cette ferveur divine dont il
fut gratifié ; il se sert alors de la métaphore de « de l’arbre de phosphore »
qui réfère à l’éclair :
20
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
« Dormiez-vous cette nuit, sous le grand arbre de phosphore, ô cœur
d’orante par le monde, ô mère du Proscrit, quand dans la chambre fut
imprimée sa face ? »62
La femme bien-aimée est aussi témoin de cette manifestation divine et
éblouissante : « Et toi plus prompte sous l’éclair, » 63 le poète lui annonce
l’arrivée rapide de la poésie et du bonheur :
« Tu n’écouteras point l’orage au loin multiplier la course de nos pas
sans que ton cri de femme, dans la nuit, n’assaille encore sur son aire
l’aigle équivoque du bonheur ! »64
La poésie explore un territoire de l’âme et du monde qui reste encore
inconnu, grâce à la lumière de l’inspiration qui prend la forme de l’éclair :
« L’éclair m’ouvre le lit de plus vastes desseins. »65
L’isotopie de l’orage est attachée à la manifestation divine de la création
poétique de sorte qu’on retrouve ici une allusion à la mythologie gréco-
romaine qui donne à Zeus - Jupiter le privilège de la foudre.
« L’orage déplace en vain les bornes de l’absence. »66
«Les hautes passions sont lovées sous le fouet de l’éclair… »67
La création poétique, grâce à l’inspiration, abolit pour un moment le
sentiment de détresse et de déréliction que suscite l’exil, comme il met un
terme à la stérilité et à la déchéance ; cela ne dure pas longtemps car l’exil
est d’hier et de demain comme le réitère le poète ; le matin disparaît à son
tour rapidement car paradoxalement, la clarté intense qui lui succède lui est
fatale, et midi où culmine la journée, met fin à cet instant virginal et
privilégié. Saint – John Perse le dit clairement : « la journée s’épaissit
comme un lait. »68 Le jour en effet en avançant perd sa clarté et sa
transparence comme le montre le recours à la notion opaque de
l’épaississement et de la solidification ; et quand midi arrive, son chant
n’est plus capable de dissiper la tristesse qui envahit le poète : « Midi
chante, ô tristesse !... »69
DETRESSE ET ABANDON
Ainsi, la plénitude qu’il a reçue en partage, est de courte durée. La
totale coïncidence entre le monde et lui se révèle éphémère ; le clivage qui
sépare et oppose une partie du poète à une autre partie, un moment
estompée, refait de nouveau surface et recommence à l’écarteler comme les
élancements d’une blessure mal cicatrisée qui ressaigne ; le poète est
rattrapé par cette dualité, cette dichotomie qui le divise ; Saint – John Perse
21
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
le souligne par deux oxymores qui allient deux notions contradictoires,
d’une part, le soleil et la tristesse , de l’autre, le rire et les larmes : « Midi
chante, ô tristesse » et « ce n’est pas assez que d’en rire sous les
larmes »70 la contradiction est claire et il décrit le tiraillement entre le goût
de la félicité qui est encore sur la langue et l’amertume de l’ennui et du
chagrin qui repercent : « L’ennui cherche son ombre aux royaumes
d’Arsace ; et la tristesse errante mène son goût d’euphorbe par le
monde. »71Tristesse, ennui, amertume sont des sentiments négatifs qui
rejettent le poète dans la solitude et l’exil.
Saint – John Perse utilise deux métaphores pour parler de l’extinction
de celle lumière créatrice. Dans la première, le jour est assimilé à une eau
qui imbibe une étoffe et qui, une fois essorée, la perd dans les sables où
elle enfonce et disparaît :
« Et quand se fut parmi les sables essorée la substance pâle de ce
jour, »72
Dans la seconde métaphore, les rayons du soleil qui se couche, deviennent
des sesterces, pièces de monnaie romaine en argent, qui tombent sur le
sable et s’y évanouissent :
« Et le soleil enfouit ses beaux sesterces dans les sables, à la montée
des ombres où mûrissent les sentences d’orage. »73
Le sentiment de solitude, d’abandon même qui envahit le poète,
s’accompagne de dénuement et de détresse funestes ; quelque chose de
macabre comme un linceul voile alors la pensée du poète car le ton des
phrases qu’il utilise est celui d’un thrène lugubre ; cela est d’autant plus
poignant que le poète n’a d’habitude que répugnance pour cette attitude
résignée, abattue :
« Ô présides sous l’eau verte ! qu’une herbe illustre sous les mers
nous parle encore de l’exil… et le poète prend ombrage
De ces grandes feuilles de calcaire, à fleur d’abîme, sue des socles :
dentelle au masque de la mort… »74
DESTINATAIRES DU MESSAGE
Le poème, une fois composé, devient un message que le poète
destine d’abord et de façon privilégiée, à deux lectrices, sa mère et la
femme qu’il aime ; en effet, la poésie exige que le destinataire soit capable
de la saisir au vol et il semble que grâce à la passion qui les anime, les
deux lectrices soient aptes à appréhender le sens ce ces paroles aériennes et
sibyllines. Saint – John Perse le souligne ; la poésie est l’expression d’une
22
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
lumière violente qui offusque comme l’éclair. Sa densité, la fréquence des
ruptures d’isotopies, la variété et l’originalité des stratégies rhétoriques
mises en œuvre, ne peuvent que dérouter un lecteur froid et lent ;
« Syntaxe de l’éclair ! ô pur langage de l’exil ! Lointaine est l’autre
rive où le message s’illumine : »75
La compréhension du poème exige un effort, pour en saisir la signification,
pour en devenir la cible et la rive, il faut être habile et lucide ; les deux
femmes jouissent de ce privilège de façon inexplicable, irrationnelle :
« Deux fronts de femmes sous la cendre, du même pouce visitées ;
deux ailes de femmes aux persiennes, du même souffle suscitées… »76
Saint – John Perse accorde à sa mère et à sa compagne, la capacité intuitive
d’appréhender grâce à l’amour, le message du recueil ; la mère voit l’image
de son fils dans le miroir de sa chambre tandis que la femme qui est à ses
côtés, ressent dans sa chair les mouvements qui font vibrer tout l’être du
poète et qui la font tressaillir elle-même ; par cette transe, un même souffle
relie les deux amants :
« Et toi plus prompte sous l’éclair, ô toi plus prompte à tressaillir sur
l’autre rive de son âme, »77
En revanche, d’autres lecteurs sont incapables de saisir la
signification de ce message car l’attitude qu’ils adoptent à l’égard du
poème est inadéquate. Du reste, le poète rappelle que le poème senti et reçu
diffère beaucoup du poème écrit .Il semble utiliser une métaphore
d’accident d’avion pour illustrer l’inachèvement du poème ; le poème
intérieur, initial est assimilé à un appareil aérien qui explose en plein vol en
sorte que les lecteurs ne découvrent, ne lisent que des fragments, des débris
qui jonchent le sol :
« De beaux fragments d’histoire en dérive, sur des pales d’hélices,
dans le ciel plein d’erreurs et d’errantes prémisses, se mirent à voler pour
le délice du scoliaste. »78
Cet inachèvement fait du poème un texte lapidaire, lacunaire qui se révèle
hermétique pour le public ; il s’en suit que la lecture en devient un exercice
si ardu qu’il attire, comme la charogne les vautours, ce lecteur
professionnel et intéressé qu’est le scoliaste.
Dans la troisième partie du quatrième poème, juste après l’éclosion
puis la pulvérisation de la poésie, apparaissent trois personnages qui
représentent trois attitudes face au poème. Il y a d’abord le scribe qui
recueille les bribes du texte qui lui parviennent et il semble que Saint –
John Perse lui attribue la volonté non de conserver mais de perdre le peu
qui lui échoit :
23
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
« Renverse, ô scribe, sur la table des grèves, du revers de ton style la
cire empreinte du mot vain. »79
Intervient aussi le scoliaste pour qui la pulvérisation du texte poétique est
une aubaine car il y trouve sa raison d’être ; parce que le poème se
fragmente et disparaît, il tire son plaisir de la reconstruction du texte
lacunaire et de son commentaire :
« De beaux fragments d’histoires en dérive, sur des pales d’hélices,
dans le ciel plein d’erreurs et d’errantes prémisses, se mirent à virer pour
le délice du scoliaste. »80
Cependant, une entreprise encore plus dangereuse incombe à un autre
protagoniste, l’officiant qui décide d’attribuer à cette poésie un caractère
sacré ; mais de façon frauduleuse et illégitime, il en gomme les aspérités
qui peuvent heurter la ferveur des prosélytes ; il refaçonne le poème,
enlève les éléments subversifs pour ne garder qu’un texte inepte et plat qui
a été expurgé de toutes ses trouvailles et de toutes ses audaces.
« Et c’est l’heure, ô Mendiante, où sur la face close des grands
miroirs de pierre exposés dans les antres,
L’officiant chaussé de feutre et ganté de soie grège efface, à grand
renfort de manches, l’affleurement des signes illicites de la nuit. »81
Nous voyons apparaître ici une attitude fondamentale qui fait de la poésie
une rébellion, une contestation ne souffrant aucune tentative de
récupération ou de momification. La poésie comporte une attitude critique
belliqueuse, inexpugnable.
LUCIDITE CORROSIVE
Saint – John Perse ne considère pas comme une rédemption la
production d’un recueil de poèmes dès lors qu’il cultive la lucidité et le
scepticisme jusqu’ à en faire des impératifs catégoriques :
« Et le Poète encore est parmi nous, parmi les hommes de son temps,
habité…
Homme infesté du songe, homme gagné par l’infection divine,
Non point de ceux qui cherchent l’ébriété dans les vapeurs du
chanvre, comme un Scythe,
Mais attentif à sa lucidité, jaloux de son autorité, et tenant clair au
vent le plein midi de sa jeunesse : »81
« Ivre de renier l’ivresse. »82 clame Saint – John Perse dans Vents ;
il est persuadé que la seule pensée incontestée, et que l’homme est
confronté à un destin qui le dépasse où le temps a toujours le dernier mot.
Il reconnaît la vanité de la création car l’échec et la mort sont au bout de
24
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
chaque entreprise, de chaque vie ; la seule voix qui dit toujours la vérité et
qui a toujours raison, est la voie des éléments auxquels s’attachent
l’érosion et la destruction ; Saint – John Perse attribue cette philosophie
négative au vent et à la mer ; nous avons déjà évoqué cette science
délétère, cette sagesse de l’écume.
Après le bref moment de fécondité, qu’il connaît, le poète ne se
laisse pas bercer par des illusions, il n’oublie pas la suprématie de cette
philosophie destructrice. Dans le cinquième chant, dès qu’il a parlé de la
naissance du poème et de sa prise en charge par le scribe, le scoliaste et
l’officiant, il reprend le triste refrain de la vanité et de l’inanité de tout :
« Ainsi va toute chair au cilice du sel, le fruit de cendre de nos
veilles, la rose naine de vos sables, et l’épouse nocturne avant l’aurore
reconduite…
Ah ! toute chose vaine au van de la mémoire, ah ! toute chose insane
aux fifres de l’exil… »83
Notons que la dichotomie entre la vie et l’œuvre, ne joue pas ici ; pour
Saint – John Perse, l’art est une lutte contre la mort, qui est inefficace
puisque le poème lui-même est voué à la disparition ; « le fruit de cendre
de nos veilles, » autrement dit les poèmes qui sont les fruits du travail et de
l’insomnie, sont aussi victimes de la destruction et de la mort ; par ailleurs,
qu’est-ce qui reste quand la quintessence même du poème a été perdue,
quand le jour revient ?
« Et les poèmes de la nuit (sont) avant l’aurore répudiés, »84 en sorte
qu’il n’en reste qu’un minuscule vestige fossile enfoui dans une gangue
d’ambre : « l’aile fossile prise aux grandes vêpres d’ambre jaune… »85
Juste après l’éclosion du poème, ce qui demeure paraît dérisoire et
ressemble à ces insectes dont l’espèce a disparu et qu’on trouve pétrifié
dans du calcaire.
Du reste, le poète accepte la perspective de la disparition, plus
encore, il l’appelle :
« Ah ! Qu’on brûle, ah ! Qu’on brûle, à la pointe des sables, tout ce
débris de plume, d’ongle, de chevelures peintes et de toiles impures, »86
Saint – John Perse explique cette attitude paradoxale par la volonté
d’éviter que des vestiges qui ne sont que vétilles puissent devenir des
reliques et que ne soit institué un rituel sacré qui ne serait en définitive
qu’un nouvel et ridicule fétichisme. Une autre raison justifie cette austérité
destructrice ; même si ces poèmes disparaissaient, cela ne serait pas grave
parce que l’essence poétique y est fort rare :
25
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
« Et les poèmes nés d’hier, ah ! les poèmes nés au soir à la fourche
de l’éclair, il en est comme de la cendre ai lait des femmes, trace
infime… »87
Nous voyons s’éclairer les paradoxes qui parsèment Exil ; dès le
début en effet s’affrontent deux forces antithétiques, deux pulsions
inconciliables ; le poète affirme immédiatement ce qu’il nie ; ainsi, l’exil
l’incite à choisir un lieu qui n’en soit pas un, un lieu nul ; quand il veut
bâtir quelque chose, il le fait sur le vide qui ne peut constituer un
fondement ; la gloire qu’il cherche, est précaire et obscure ; ce n’est donc
pas une gloire. Cette propension au paradoxe se manifeste poétiquement
par une volonté de sobriété, de dénuement et d’ascèse. Le poète se montre
attentif, lucide et critique à l’égard de sa production poétique qu’il n’hésite
pas à amputer de morceaux qui ne le satisfont pas. Dans Exil, Cette
exigence sévère et l’austérité qu’elle dicte, le poussent à prendre une
position extrême ; il se montre si critique qu’il accepte paradoxalement que
l’œuvre qu’il vient d’écrire disparaisse, et le paradoxe est justement dans
l’oxymore qui suit ;
« Voici que j’ai dessein encore d’un grand poème délébile… »88
Il veut composer un grand poème, un monument de la littérature dont la
force et la beauté seraient incontestées ; en même temps, il affirme, comme
une mère dénaturée, que cette oeuvre est appelée a disparaître ; plus
encore, il y consent sans que tout son être en soit révoltée ; en fin de
compte et de manière incompréhensible et comique, l’attitude du poète se
rapproche de celle de l’officiant qui cependant ne fait que l’expurger de ses
impuretés.
CONCLUSION
L’exil ne prend pas avec la naissance de la parole poétique ; après
ces instants de répit, le poète redevient l’Etranger, l’errant qu’il a toujours
été et qu’il sera toujours : « L’exil n’est point d’hier. » Le poète est
convaincu que l’état de précarité et de vulnérabilité qui caractérise l’exil,
peut seul tenir éveillés le discernement et la passion dans cette tâche
d’explorateur qui incombe au poète précurseur. Le poète refuse en effet
que l’amour que lui voue sa compagne ne se transforme en piège qui serait
fatale à sa recherche ; certes, cet attachement est une force mais c’est
26
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
surtout une faiblesse : « compagne de sa force et faiblesse de sa force » ;
89 aussi essaie-t-il d’imposer silence à cette affection :
« Tais-toi, faiblesse, et toi, parfum d’épouse dans la nuit comme
l’amande même de la nuit.
« Tais-toi, douceur et toi présence gréée d’ailes à hauteur de ma
selle. »90
Sa résolution est alors prise ; il faut quitter le lit douillet de l’amour
pour reprendre ses pérégrinations loin de cette Capoue :
« Je reprendrai ma course de numide, longeant la mer
inaliénable… »91
Il croit que le poète comme les grands voyageurs, les grands explorateurs,
a besoin de cette distance, de ce large qui favorise et attise les passions :
« Ceux-là qui furent se croiser aux grandes Indes atlantiques, ceux-là
qui flairent l’idée neuve aux fraîcheurs de l’abîme, ceux-là qui soufflent
dans les cornes aux portes du futur
Savent qu’aux sables de l’exil sifflent les hautes passions lovées sous
le fouet de l’éclair… »92
On peut dire que cette œuvre recèle un sens fort intéressant pour le
lecteur qui a assez se patience et de persévérance pour fournir l’effort
nécessaire qui lui permettrait d’y pénétrer et de le saisir. C’est une œuvre
qui rappelle la piètre situation de l’homme faite de solitude et de
dénuement face à des forces destructrices qui le dépassent ; c’est une
œuvre qui nous incite néanmoins à restaurer et à sauvegarder notre dignité,
à assumer la tâche qui nous incombe et qui consiste à nous tenir
constamment éveillés, à donner à l’âme la primauté sur le corps, à tendre à
l’autodépassement.
L’hermétisme même de ce recueil est dû à une volonté de se rendre
intéressant ; le poète le montre quand il déclare, à la fin d’Exil, que sa
poésie est occulte :
« Ô Prodigue sous le sel et l’écume de juin ! garde vivante parmi
nous la force occulte de ton chant ! »93
Il trouve sa satisfaction dans la grandeur et la difficulté de la saisie par le
verbe, d’une part encore inconnue de l’homme et de l’univers, part qui
exige, comme l’effort qui fut jadis accompli par les philosophes
présocratiques, pari et audace du poète d’abord , du lecteur ensuite.
27
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
NOTES
1. Saint – John Perse, Œuvre poétique I, Paris, Gallimard, deuxième
édition, 1953, p.298-299.
2.Saint – John Perse, Eloges, suivi de La Gloire des rois,
Anabase,Exil, Paris, Gallimard, collection poésie, 1960, p.161.
2bis. Ibidem, p.80.
3. Saint – John Perse, Oeuvre poétique I, p. 311-312-313.
4. Saint – John perse, Amers suivi de Oiseaux et de Poésie, Paris,
Gallimard, collection poésie, p.243-244.
5. Saint –John Perse, Œuvre poétique I, p.320.
6. Saint - John Perse, Amers, p.244.
7. Saint –-John Perse, Eloges, op. cit.p.150
8. Ibid.
9. Ibid. p.200
10. Saint - John Perse, Amers,op. cit. p.244
11.Saint -John Perse, Eloges, op. cit. p.150
12. Saint -John Perse, Oeuvre I ,p.328
13.Eloges, op. cit. p.170
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Amers, op. cit. p.243-244
17 bis. Eloges, op. cit. p.156
18. Ibid. p. 157
19. Ibid. p. 158
20. Ibid; p. 153
21. Ibid. P 152
23. Ibid. P. 151
24. Ibid. P. 150
25. Ibid. P; 155
26. Ibid. P. 152
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid. P. 154
30. Ibid.
31. Ibid.
28
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
32. Ibid.
33. Ibid.
34. Ibid.
35. Ibid. P. 154-155
36. Ibid. P. 155
37. Ibid.
38. Ibid.
39. Ibid.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. Ibid.
43. Ibid.
44. Ibid. P. 168
45. Ibid.
46. Ibid.157
47. Ibid.
48. Ibid. P.158
49. Ibid. P. 159
50. Ibid. P.158
51. Ibid. P. 156
52. Ibid. Ibid.
53. Ibid. P. 157
54. Ibid. P. 156
55. Ibid. P. 158
56. Ibid. P.171
57. Ibid. P. 156
58. Ibid. P. 160
59. Ibid.
60. Ibid. P. 160-161
61. Ibid. 158
62. Ibid. P. 169
63. Ibid.
64. Ibid. P. 170
65. Ibid.
66. Ibid.
67. Ibid.
68. Ibid. P. 161
69. Ibid.
70. Ibid.
71. Ibid.
29
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
72. Ibid. P. 158
73. Ibid. P. 161
74. Ibid. P. 162
75. Ibid. P. 169
76. Ibid.
77. Ibid.
78. Ibid P. 158
79. Ibid.
80. Ibid.
81. Oeuvre I, op. cit. P.402-403
82. Ibid. P. 320
83. Eloges, op. cit. P.159
84. Ibid.
85. Ibid.
86. Ibid;
87. Ibid.
88. Ibid.
89. Ibid. P. 169
90. Ibid. P.160
91. Ibid. P.170
92. Ibid.
93. Ibid.
30
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
TABLE DES MATIERES
Introduction P.2
Le choix de la mobilité P.4
L’éclipse du divin P.6
L’adversité P.7
Le choix de l’extrême P.8
La nuit / l’inconnu P.9
La traversée du désert P.11
Philosophie de la destruction P.11
La rencontre P.12
La joute P.15
Renversement des valeurs P.16
L’inspiration P.17
La transfiguration P.18
Le pays natal P.19
Le retour du divin P.20
Détresse et abandon P.21
Destinataires du message P.22
Lucidité corrosive P.24
Conclusion P.26
Notes P.28
Bibliographie P.32
31
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
BIBLIOGRAPHIE
Corpus : Exil de Saint – John Perse in Saint – John Perse, Eloges
Suivi de La Gloire des Rois,Anabase, Exil, Paris, Gallimard, collection
poésie, 1960.
- Saint – John Perse, Amers suivi de Oiseaux et de Poésie, Paris,
Gallimard, 1977.
- Saint – John perse, Œuvre I, Paris, Gallimard, 1953.
Ouvrages critiques utilisés :
Cohen Jean, Structure du langage poétique, Paris, Flammarion, 1966.
Cohen Jean,Le Haut langage, Paris, Flammarion, 1979
Groupe de Liège, Rhétorique de la poésie,Bruxelles, Editions
Complexe, 1977.
Bataille Georges, La Part maudite , Paris, Les Editons de Minuit, 1967
32
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
Vous aimerez peut-être aussi
- Perec W Ou Le Souvenir D'enfanceDocument3 pagesPerec W Ou Le Souvenir D'enfanceŁukasz Świercz50% (2)
- Les Etoiles de Sidi Moumen by Mahi BinebineDocument92 pagesLes Etoiles de Sidi Moumen by Mahi BinebineAbdelillah KrimPas encore d'évaluation
- 3 COURS Séquence Originale EtrangerDocument9 pages3 COURS Séquence Originale EtrangerFireball44Pas encore d'évaluation
- 5 La Modification Michel ButorDocument1 page5 La Modification Michel ButorBen Khechine Rayen (KARGIIN)Pas encore d'évaluation
- Barthes - Mythologies - Le Mythe Aujourd'huiDocument16 pagesBarthes - Mythologies - Le Mythe Aujourd'huiEric SymakPas encore d'évaluation
- Vincent+Jouve +Poétique+Du+Roman 3e+édition +jerichoDocument275 pagesVincent+Jouve +Poétique+Du+Roman 3e+édition +jerichoKhi-khi-lou100% (4)
- Le Guide Des MassagesDocument16 pagesLe Guide Des MassagesComprendreChoisir25% (4)
- Titre. L Image Et L Identité Féminines Entre Mère Et Patrie Dans La Civilisation, Ma Mère!... de Driss ChraïbiDocument105 pagesTitre. L Image Et L Identité Féminines Entre Mère Et Patrie Dans La Civilisation, Ma Mère!... de Driss ChraïbiMounir Oussikoum100% (3)
- JCI Presenter ManualDocument12 pagesJCI Presenter ManualAnonymous 1FzIK5h100% (1)
- Theories de La Motivation Des Individus Au TravailDocument13 pagesTheories de La Motivation Des Individus Au TravailDaria Nikonovych100% (1)
- Eloges de ST John Perse (Analyse)Document3 pagesEloges de ST John Perse (Analyse)Jade100% (1)
- Khatibi La Memoire TatoueeDocument12 pagesKhatibi La Memoire TatoueeAmina Chams100% (1)
- La Transgression Dans Le Récit de Fatima MernissiDocument142 pagesLa Transgression Dans Le Récit de Fatima MernissiMounir OussikoumPas encore d'évaluation
- Littérature Féminine Au MarocDocument12 pagesLittérature Féminine Au Marockamal achikePas encore d'évaluation
- Stupeurs Et Tremblements - AnalyseDocument3 pagesStupeurs Et Tremblements - AnalyseDanielle TakasePas encore d'évaluation
- Les Registres LittérairesDocument2 pagesLes Registres Littéraireschaimaeelkhamar2100% (1)
- Exposé NarratologieDocument9 pagesExposé Narratologiejinchuuriki27100% (2)
- Exemples D'approche de Textes ComparésDocument12 pagesExemples D'approche de Textes ComparésRACHID AIT EL MAATI100% (2)
- Les Enjeux de L'écriture AutobiographiqueDocument52 pagesLes Enjeux de L'écriture AutobiographiqueTiti Suru100% (1)
- CML Sémiotique Poétique Licence 2 Réparé PDFDocument23 pagesCML Sémiotique Poétique Licence 2 Réparé PDFDjué Kouassi100% (2)
- L Incipit Du Dernier JourDocument2 pagesL Incipit Du Dernier JourFd MtPas encore d'évaluation
- ELUARD La Terre Est Bleue Comme Une Orange L'amour La Poésie 1929Document3 pagesELUARD La Terre Est Bleue Comme Une Orange L'amour La Poésie 1929Abdelhamid FerchichiPas encore d'évaluation
- L.A 1 Incipit EtrangerDocument3 pagesL.A 1 Incipit EtrangerAhmed ElharrarPas encore d'évaluation
- Le Etoile de Idi MoumenDocument7 pagesLe Etoile de Idi MoumenAbdellah GuaougaouPas encore d'évaluation
- L'absurdeDocument2 pagesL'absurde2h2f2100% (2)
- S Quence 3e L I La V Nus D'illeDocument2 pagesS Quence 3e L I La V Nus D'illeLa_titia_Derue_9670Pas encore d'évaluation
- Mode NarratifDocument9 pagesMode Narratifsaidifatimazahra198Pas encore d'évaluation
- La Symbolique de La Vieille Dans Il Etait Une Fois Un Vieux Couple Heureux de Mohammed KhairDocument10 pagesLa Symbolique de La Vieille Dans Il Etait Une Fois Un Vieux Couple Heureux de Mohammed KhairMourad Belhaj0% (1)
- Jacques Rabemananjara Antsa 1956Document1 pageJacques Rabemananjara Antsa 1956Abdoul kadir KoumaPas encore d'évaluation
- Figure de Style Définition Exemple Concrète D'uneDocument4 pagesFigure de Style Définition Exemple Concrète D'uneNikièma Adéline100% (1)
- L'Intertexte Des Littératures FrancophonesDocument7 pagesL'Intertexte Des Littératures FrancophonesMiha ElaPas encore d'évaluation
- Roman Moderne Vs Roman TraditionnelDocument8 pagesRoman Moderne Vs Roman TraditionnelkaoutharPas encore d'évaluation
- La Critique LittéraireDocument2 pagesLa Critique Littéraireberkane100% (3)
- Assarikhi Commentaire Composé de Chant D'automneDocument5 pagesAssarikhi Commentaire Composé de Chant D'automneAnoir Alaoui0% (1)
- Kilito Et BorgesDocument4 pagesKilito Et BorgesOuazzani KhalidPas encore d'évaluation
- Le Soir - Fouad Laroui Drame LinguistiqueDocument1 pageLe Soir - Fouad Laroui Drame LinguistiqueOmar HadarPas encore d'évaluation
- Analyse de "Demain Dès L'aube" de Victor Hugo TYPE BACDocument3 pagesAnalyse de "Demain Dès L'aube" de Victor Hugo TYPE BACgv073376100% (1)
- Littérature de Voyage Problématique Du GenreDocument18 pagesLittérature de Voyage Problématique Du GenreSàlma ChoùlPas encore d'évaluation
- Recit Et DiscoursDocument3 pagesRecit Et DiscoursAmeliePoulinPas encore d'évaluation
- Analyse Les Figures de Style Dans Le TexteDocument4 pagesAnalyse Les Figures de Style Dans Le TexteAltErna TivePas encore d'évaluation
- COURS Grammaire S3 - HbabouDocument77 pagesCOURS Grammaire S3 - HbabouÉtablissement AlyosarPas encore d'évaluation
- Terre Natale Et Figure MaternelleDocument46 pagesTerre Natale Et Figure MaternelleFarouk HarazPas encore d'évaluation
- DS Portrait de CosetteDocument4 pagesDS Portrait de Cosetteauvray100% (1)
- L'analyse Linéaire Du Texte N°1: Parfum Exotique, BaudelaireDocument4 pagesL'analyse Linéaire Du Texte N°1: Parfum Exotique, BaudelaireBen Khechine Rayen (KARGIIN)Pas encore d'évaluation
- Le Chateau de Ma MereDocument2 pagesLe Chateau de Ma MereOop ShiPas encore d'évaluation
- La Lecture Selon BarthesDocument11 pagesLa Lecture Selon Barthesandrada_miruna100% (1)
- Rachid BoudjedraDocument12 pagesRachid BoudjedraRiversayram100% (1)
- Récit Et DiscoursDocument2 pagesRécit Et DiscoursSara OulhajPas encore d'évaluation
- Le Naturalisme ZolaDocument9 pagesLe Naturalisme ZolaMarinela IordachePas encore d'évaluation
- Bremond - Le Message NarratifDocument30 pagesBremond - Le Message NarratifJohanna Bejarano B.Pas encore d'évaluation
- Comparer 4 Incipit FantastiquesDocument3 pagesComparer 4 Incipit Fantastiqueshoda100% (1)
- NadjaDocument5 pagesNadjaMarie Remise100% (1)
- Zoulikha OUDAI Heroine Epique Dans La Femme Sans Sepulture Dassia DJEBARDocument90 pagesZoulikha OUDAI Heroine Epique Dans La Femme Sans Sepulture Dassia DJEBARSãb RïnãPas encore d'évaluation
- 6° SQB4 OI Les Contes MerveilleuxDocument15 pages6° SQB4 OI Les Contes MerveilleuxAlinutza Alina100% (1)
- Analyse Conte Chaperon Rouge 1Document33 pagesAnalyse Conte Chaperon Rouge 1Jean Claude EnriquePas encore d'évaluation
- Production Orale-2Document1 pageProduction Orale-2Hanane Belati100% (1)
- Corrigé Analyse Linéaire Le Pont MirabeauDocument3 pagesCorrigé Analyse Linéaire Le Pont MirabeauAri Villavicencio GuerraPas encore d'évaluation
- Marcel Taibé, L'esthétique Du Fragment Et L'identité Chez Tahar Ben Jelloun Et Fatou DiomeDocument18 pagesMarcel Taibé, L'esthétique Du Fragment Et L'identité Chez Tahar Ben Jelloun Et Fatou DiomeAnnalesPas encore d'évaluation
- Corrigé Du Commentaire Sur Harmonie Du SoirDocument2 pagesCorrigé Du Commentaire Sur Harmonie Du SoirlyblancPas encore d'évaluation
- Figures de Style - CorrectionDocument7 pagesFigures de Style - CorrectionauberPas encore d'évaluation
- STOLZ C. - La Polyphonie Dans Les Romans Des Cinquante Dernières Années... - 19 Février 2008Document21 pagesSTOLZ C. - La Polyphonie Dans Les Romans Des Cinquante Dernières Années... - 19 Février 2008Rihab Tammar100% (2)
- Carra de Vaux GhazzaliDocument344 pagesCarra de Vaux GhazzaliAhmed Berrouho100% (2)
- Carra de Vaux Les Penseurs de L'islam 1Document402 pagesCarra de Vaux Les Penseurs de L'islam 1Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Siècle de La Renaissance - Batiffol, Louis, 1865-1946Document436 pagesLe Siècle de La Renaissance - Batiffol, Louis, 1865-1946Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Sumérisme Et L'histoire BabylonienneDocument171 pagesLe Sumérisme Et L'histoire BabylonienneAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- (1885) Le Mahdi Depuis Les Origines de L'islam Jusqu'a Nos JoursDocument140 pages(1885) Le Mahdi Depuis Les Origines de L'islam Jusqu'a Nos JoursHerbert Hillary Booker 2nd100% (1)
- Alain Viala Effets de Champ Et Effets de PrismeDocument9 pagesAlain Viala Effets de Champ Et Effets de PrismeAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Seizième Siècle en France. Darmesteter, Arsène, 1846-188Document720 pagesLe Seizième Siècle en France. Darmesteter, Arsène, 1846-188Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Le Schisme Oriental Du XIe Siècle - Bréhier, Louis, 1868-1951Document360 pagesLe Schisme Oriental Du XIe Siècle - Bréhier, Louis, 1868-1951Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Alfred Poizat Le Symbolisme de Baudelaire À ClaudelDocument210 pagesAlfred Poizat Le Symbolisme de Baudelaire À ClaudelAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Agnès Sorel Et La Chevalerie Par M. CapefigueDocument250 pagesAgnès Sorel Et La Chevalerie Par M. CapefigueAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Abrégé de L'histoire D'italie Depuis La Chute de L'empire Romain Jusqu'en 1864Document569 pagesAbrégé de L'histoire D'italie Depuis La Chute de L'empire Romain Jusqu'en 1864Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Musique Théorique Et Historique - Escudier, Léon, D. 1881Document546 pagesDictionnaire de Musique Théorique Et Historique - Escudier, Léon, D. 1881Ahmed Berrouho50% (2)
- Alain Viala Stylistique Et Sociologie Classe de PosturesDocument11 pagesAlain Viala Stylistique Et Sociologie Classe de PosturesAhmed Berrouho100% (1)
- Petit de Julleville Histoire de La Langue Et de La Littérature Française XVIième SiècleDocument625 pagesPetit de Julleville Histoire de La Langue Et de La Littérature Française XVIième SiècleAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Grands Écrivains Français de La Renaissance - Lefranc, A. (Abel), 1863-1952Document436 pagesGrands Écrivains Français de La Renaissance - Lefranc, A. (Abel), 1863-1952Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Musique Théorique Et Historique - Escudier, Léon, D. 1881Document546 pagesDictionnaire de Musique Théorique Et Historique - Escudier, Léon, D. 1881Ahmed Berrouho50% (2)
- Paul Valéry Exposition N5839347 PDF 1 - 1DMDocument145 pagesPaul Valéry Exposition N5839347 PDF 1 - 1DMAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Gustave Flaubert Albert Thibaudet - Gallimard (Paris) - 1992Document314 pagesGustave Flaubert Albert Thibaudet - Gallimard (Paris) - 1992Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Brunot, Ferdinand Histoire de La Langue Française Seizième Tome 2Document564 pagesBrunot, Ferdinand Histoire de La Langue Française Seizième Tome 2Ahmed Berrouho100% (1)
- Dictionnaire Des Rimes Françoises Jean Le FèvreDocument567 pagesDictionnaire Des Rimes Françoises Jean Le FèvreAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Classes Sociales, Pratiques Culturelles Et Styles de Vie Le Modèle de La Distinction Est-IlDocument28 pagesClasses Sociales, Pratiques Culturelles Et Styles de Vie Le Modèle de La Distinction Est-IlTiago VerçosaPas encore d'évaluation
- °sommer, Christian - BibliographieDocument64 pages°sommer, Christian - BibliographieAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- Module 5Document66 pagesModule 5yassine el hasnaouyPas encore d'évaluation
- Fiche Evaluation Et de Notation Comprehension Orale TijuanaDocument4 pagesFiche Evaluation Et de Notation Comprehension Orale TijuanaAngel Angeleri-priftis.Pas encore d'évaluation
- Le Druidisme Et Ses SymbolesDocument20 pagesLe Druidisme Et Ses SymbolesBelloṷesus Īsarnos100% (1)
- 050 Grille Générale Agir Manuels FLE 2013-05Document5 pages050 Grille Générale Agir Manuels FLE 2013-05Couture ElisePas encore d'évaluation
- Le Roman XIX XX PDFDocument207 pagesLe Roman XIX XX PDFMorteza KhakshoorPas encore d'évaluation
- 7 - Article 2 Germivoire EditorialDocument2 pages7 - Article 2 Germivoire EditorialMamadouPas encore d'évaluation
- Emc PDFDocument10 pagesEmc PDFSalomé AthlanPas encore d'évaluation
- MotivationDocument10 pagesMotivationIslam El OusroutiPas encore d'évaluation
- Confiance en Soi PDFDocument14 pagesConfiance en Soi PDFMartin Brait100% (1)
- ESSECT AdmitionDocument2 pagesESSECT AdmitionZied ZiedPas encore d'évaluation
- Comportement Du Consommateur Complet PDFDocument124 pagesComportement Du Consommateur Complet PDFMoHamed Ata90% (20)
- Devoir Les Representations SocialesDocument14 pagesDevoir Les Representations SocialesJizreel AstridPas encore d'évaluation
- Farmer, Paul (1996) Sida en Haïti - La Victime Accusée PDFDocument374 pagesFarmer, Paul (1996) Sida en Haïti - La Victime Accusée PDFFelipe SilvaPas encore d'évaluation
- Pierre Bourdieu La Domination Masculine Paris Seuil 1998 Coll Liber 134 PDocument6 pagesPierre Bourdieu La Domination Masculine Paris Seuil 1998 Coll Liber 134 PanirhamidPas encore d'évaluation
- Trash ManagementDocument190 pagesTrash ManagementArou N'a100% (1)