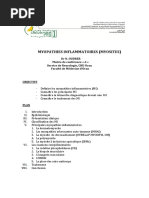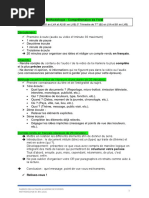Avionique
Avionique
Transféré par
seb0Droits d'auteur :
Formats disponibles
Avionique
Avionique
Transféré par
seb0Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Avionique
Avionique
Transféré par
seb0Droits d'auteur :
Formats disponibles
Un avion subit trois types de forces :
la poussée du réacteur ou la traction ou la poussée de l'hélice entraînée par le moteur ;
le poids, effet de la gravité terrestre sur la masse de l'appareil ;
la résultante des forces aérodynamiques décomposée en portance et en traînée :
la portance, créée par le déplacement dans l'air d'une aile profilée,
la traînée, somme des résistances aérodynamiques est opposée au mouvement.
Ces forces sont représentées par quatre vecteurs :
la traction vers l'avant s'oppose à la traînée vers l'arrière ;
la portance vers le haut s'oppose au poids vers le bas.
Quand l'avion vole en palier à vitesse constante le poids est équilibré par la portance, la traînée est
compensée par la traction.
À partir de cette position d'équilibre, toute modification de l'un des paramètres entraîne une
modification de l'équilibre. Si le pilote réduit les gaz, la traction diminue, la traînée devient
prépondérante et la vitesse diminue. Étant proportionnelle au carré de la vitesse, la portance
diminue avec la vitesse : l'avion s'inscrit dans une trajectoire descendante, entraîné par son poids. En
descendant, l'avion accélère à nouveau : la portance croît à nouveau, égale et dépasse le poids :
l'avion remonte. En remontant, la vitesse diminue, et ainsi de suite… Lorsque les oscillations
s'amortissent du fait de la stabilité en tangage, l'avion se stabilise en un nouveau point d'équilibre :
soit en descente à la même vitesse, soit en palier à une vitesse plus faible suivant son attitude de vol.
Le mot « aviation » (du latin « avis », qui signifie « oiseau », et du suffixe « atio ») a été employé pour
la première fois par Gabriel de La Landelle, en 1863, dans le livre Aviation ou navigation aérienne
sans ballon, un ouvrage rendant compte des tentatives d'envol de Jean-Marie Le Bris dans un
appareil plus lourd que l'air.
Le substantif masculin « avion » est un dérivé savant du latin avis. Il est attesté au XIXe siècle :
d'après le Trésor de la langue française informatisé4, il a peut-être été créé en 1875 mais sa plus
ancienne occurrence connue se trouve dans le brevet no BB 205 155, déposé le 19 avril 1890 par
Clément Ader7 et relatif à « un appareil ailé pour la navigation aérienne dénommé Avion ». C'est
ainsi qu'Ader a appelé l'appareil baptisé Éole, avec lequel il décolle le 9 octobre 1890 puis rase le sol
sur 50 mètres à 20 cm au-dessus de la piste. Cet événement ne sera toutefois pas homologué comme
étant un vol : la hauteur atteinte était insuffisante pour le qualifier de tel.
Vous aimerez peut-être aussi
- Comment Vole Un AvionDocument35 pagesComment Vole Un AvionDEFFODJIPas encore d'évaluation
- HelicoDocument16 pagesHelicomatoyayPas encore d'évaluation
- Les quatre forces du vol | Parlons sciencesDocument13 pagesLes quatre forces du vol | Parlons sciencessergiodicaprioPas encore d'évaluation
- expose thermoDocument14 pagesexpose thermoYahYa MabchoUrPas encore d'évaluation
- Vol (aéronautique) — WikipédiaDocument2 pagesVol (aéronautique) — WikipédiasergiodicaprioPas encore d'évaluation
- avion2Document2 pagesavion2plphungPas encore d'évaluation
- Théorie Du Vol Des Aéronefs - Theory of Flight ?Document12 pagesThéorie Du Vol Des Aéronefs - Theory of Flight ?sorgast06Pas encore d'évaluation
- Le PoidsDocument15 pagesLe PoidsLaura RaisonPas encore d'évaluation
- Grand Oral Sujet FINALDocument3 pagesGrand Oral Sujet FINALgvbh88hkv2100% (1)
- Grand Oral PhysiqueDocument5 pagesGrand Oral Physiquelouise.rouanet31Pas encore d'évaluation
- 4542155Document2 pages4542155Aziza DARDABPas encore d'évaluation
- AileDocument2 pagesAileLayla OmariPas encore d'évaluation
- Energieplus-Lesite - Be-Aérodynamique Des ÉoliennesDocument16 pagesEnergieplus-Lesite - Be-Aérodynamique Des Éoliennesesslaouimounia99Pas encore d'évaluation
- avionDocument1 pageavionplphungPas encore d'évaluation
- Les Fondamentaux Du ParapenteDocument28 pagesLes Fondamentaux Du ParapenteOlivbPas encore d'évaluation
- PortanceDocument12 pagesPortancedimachampionPas encore d'évaluation
- Go PCDocument4 pagesGo PCvasselinclement33Pas encore d'évaluation
- Dynamic of FlightDocument4 pagesDynamic of Flightmohamed.mhamdi.alaoui75Pas encore d'évaluation
- Comment un avion en papier vole-t-il ? – TPE Aérodynamisme d'un avion en papierDocument4 pagesComment un avion en papier vole-t-il ? – TPE Aérodynamisme d'un avion en papiersergiodicaprioPas encore d'évaluation
- AirodynamiqueDocument27 pagesAirodynamiqueLAMRI MOHAMEDPas encore d'évaluation
- Chap 4 Aerodynamique Eolien LAEER2022Document18 pagesChap 4 Aerodynamique Eolien LAEER2022ahmedimohamed2003Pas encore d'évaluation
- FR Trainee WikipediaDocument3 pagesFR Trainee Wikipediavaveveva2024Pas encore d'évaluation
- oral physiqueDocument3 pagesoral physiquevalentinstadnik00Pas encore d'évaluation
- Hélicoptère Aérodynamique - Aérodynamique Du Vol ?Document19 pagesHélicoptère Aérodynamique - Aérodynamique Du Vol ?sorgast06100% (1)
- ExtraitDocument8 pagesExtraitejaniainanekenaPas encore d'évaluation
- Cours N 1Document2 pagesCours N 1Sarra LoubnaPas encore d'évaluation
- MannlDocument4 pagesMannlMimoPas encore d'évaluation
- Dossier TechniqueDocument23 pagesDossier TechniqueMahdi HayouniPas encore d'évaluation
- 5 - Aérodynamique Des VéhiculesDocument12 pages5 - Aérodynamique Des VéhiculesYassinPas encore d'évaluation
- introductionDocument3 pagesintroductionLarbi Halima SaadiaPas encore d'évaluation
- Introduction Mecanique VolDocument11 pagesIntroduction Mecanique Volsumalee100% (1)
- Cours Brevet - Initiation AéronautiqueDocument38 pagesCours Brevet - Initiation AéronautiqueMartin PontalierPas encore d'évaluation
- A1 Classification AeronefsDocument1 pageA1 Classification Aeronefsluka_est100% (1)
- Conception Et Analyse D'ailes D'avion...Document68 pagesConception Et Analyse D'ailes D'avion...ScribdTranslations100% (1)
- Presentation Generale Sur Les AeronefsDocument102 pagesPresentation Generale Sur Les AeronefsWis DemhaPas encore d'évaluation
- Cours de pilotage avionDocument46 pagesCours de pilotage avionjmcsailingPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Du Débutant en AéromodélismeDocument0 pageGuide Pratique Du Débutant en AéromodélismeHaejer ChebilPas encore d'évaluation
- Manuel BIA CIRAS Toulouse Aerodynamique Mecavol Spatial 1025350Document46 pagesManuel BIA CIRAS Toulouse Aerodynamique Mecavol Spatial 1025350bella loutfiPas encore d'évaluation
- Cours Les AeronefsDocument20 pagesCours Les AeronefsLina KheliliPas encore d'évaluation
- SUITE de La Str+propDocument6 pagesSUITE de La Str+propzebifi fomekPas encore d'évaluation
- Ecoulement de L'airDocument9 pagesEcoulement de L'airBilel LetaiefPas encore d'évaluation
- AvionsDocument1 pageAvionsALNl-KARMARED-lADXPas encore d'évaluation
- Résumé 13Document2 pagesRésumé 13falitianarakotovaoPas encore d'évaluation
- Comment Vole Un HelicoptereDocument4 pagesComment Vole Un HelicopterejbouguechalPas encore d'évaluation
- Carte Elargissement UeDocument3 pagesCarte Elargissement Uephilippe ehlersPas encore d'évaluation
- Exposé Planeurs 3Document5 pagesExposé Planeurs 3bassompierresimonPas encore d'évaluation
- Cours Sur Principe de PropulsionDocument4 pagesCours Sur Principe de PropulsionSohaib OY100% (2)
- Aileron (Aéronautique) - WikipédiaDocument12 pagesAileron (Aéronautique) - Wikipédiaballa mohamadouPas encore d'évaluation
- Locomotion Q 56 À 81 16 Janv.Document31 pagesLocomotion Q 56 À 81 16 Janv.hezza043Pas encore d'évaluation
- AvionDocument13 pagesAvionOthman MohammedPas encore d'évaluation
- Aerodynamique 1-2Document3 pagesAerodynamique 1-2zinouthesePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Érodynamique de L'Avion: 2.1. NtroductionDocument10 pagesChapitre 2 - Érodynamique de L'Avion: 2.1. NtroductionAymen KoribaPas encore d'évaluation
- 1.resume Du BIA-Definitif-5 Chapitres-24!05!2024 2Document76 pages1.resume Du BIA-Definitif-5 Chapitres-24!05!2024 2iyadbenguenzPas encore d'évaluation
- Grand Oral PhysiqueDocument2 pagesGrand Oral Physiqueassaf.jad76Pas encore d'évaluation
- Aero 1Document41 pagesAero 1sumaleePas encore d'évaluation
- Cours2003 1Document18 pagesCours2003 1Schmetterling TraurigPas encore d'évaluation
- PCSI Ads Introduction A La Mecanique Du Vol-2Document12 pagesPCSI Ads Introduction A La Mecanique Du Vol-2Rachid BenjalouajaPas encore d'évaluation
- Travail Er Forcea380Document3 pagesTravail Er Forcea380gfPas encore d'évaluation
- Nouveau manuel complet de marine seconde partie: manoeuvresD'EverandNouveau manuel complet de marine seconde partie: manoeuvresPas encore d'évaluation
- Fiche de PosteDocument4 pagesFiche de Posteassoua kloliè konan100% (1)
- Fais Moi Une Place (Solfège+Tablature)Document2 pagesFais Moi Une Place (Solfège+Tablature)D RosPas encore d'évaluation
- Interpre Tez Les Chiffres Dans Les Re VesDocument68 pagesInterpre Tez Les Chiffres Dans Les Re VesJohane KoumetioPas encore d'évaluation
- QUIZDocument75 pagesQUIZKherbac Siham100% (1)
- Mémoire D'hydraulique UrbDocument12 pagesMémoire D'hydraulique UrblindaPas encore d'évaluation
- Communiquer Avec ConfianceDocument23 pagesCommuniquer Avec ConfianceJamila SafouanePas encore d'évaluation
- Correction Des Exercices SEMAINE 6Document7 pagesCorrection Des Exercices SEMAINE 6pocero.aurorePas encore d'évaluation
- Rapport KPELA Nassam M. Prince R.Document80 pagesRapport KPELA Nassam M. Prince R.Titan andrePas encore d'évaluation
- 14-Myopathies InflammatoiresDocument7 pages14-Myopathies InflammatoiresZedek MarwaPas encore d'évaluation
- 1as-Geo3-Trignometrie 1 PDFDocument3 pages1as-Geo3-Trignometrie 1 PDFAhmed benabdelkaderPas encore d'évaluation
- Gramm3 PDFDocument14 pagesGramm3 PDFEmmanuel CorreaPas encore d'évaluation
- Audit de La Restauration Collective À L'etat de Vaud: Rapport Numéro 6 Du 15 Décembre 2009Document126 pagesAudit de La Restauration Collective À L'etat de Vaud: Rapport Numéro 6 Du 15 Décembre 2009Mousa Peche100% (1)
- DEVOIR GESTION DE PROJET Groupe de BAH Morel Et FALL Mame Bousso Et SARR Eldrick Et NAMSENE Jay Et PENDY MOHAMME VIVALDI MichelDocument23 pagesDEVOIR GESTION DE PROJET Groupe de BAH Morel Et FALL Mame Bousso Et SARR Eldrick Et NAMSENE Jay Et PENDY MOHAMME VIVALDI MichelJay Malecson NamsenePas encore d'évaluation
- TP Modélisation Des Éruptions Effusives Et ExplosivesDocument2 pagesTP Modélisation Des Éruptions Effusives Et Explosivesthekiller.yahya.66Pas encore d'évaluation
- AppolinaireDocument2 pagesAppolinaireDiana TreastinPas encore d'évaluation
- Formation QualiteDocument44 pagesFormation QualiteFaress RabiPas encore d'évaluation
- 2012-3 Manager Booker Contrats Et CommissionsDocument2 pages2012-3 Manager Booker Contrats Et CommissionsgangshitdayofficielPas encore d'évaluation
- 2018 ChaireAgroTIC DeepLearning VD2 PDFDocument49 pages2018 ChaireAgroTIC DeepLearning VD2 PDFAbdou Aziz CisséPas encore d'évaluation
- 1999 Rivieres Transport SolideDocument97 pages1999 Rivieres Transport Solidehadil TemaciniPas encore d'évaluation
- Moteurs Diesel Quatre TempsDocument36 pagesMoteurs Diesel Quatre TempsHassan EL HasnaouiPas encore d'évaluation
- Cours S.M.SDocument28 pagesCours S.M.SAbdoulaye MboupPas encore d'évaluation
- Methodologie Bac 2021Document4 pagesMethodologie Bac 2021khalid ElmorabitPas encore d'évaluation
- QQOQCCP ExerciceDocument3 pagesQQOQCCP Exercicetopinf100% (1)
- 05 Corrige ApplicationsDocument39 pages05 Corrige ApplicationsTantely RamaromiantsoPas encore d'évaluation
- Em Nissan PatrolDocument99 pagesEm Nissan Patroljulien.lecointePas encore d'évaluation
- Accelerer PCDocument8 pagesAccelerer PCnoubowostephanePas encore d'évaluation
- Parcours de 4 TradersDocument10 pagesParcours de 4 Traderstheghostinthemachine3Pas encore d'évaluation
- Communication PosterDocument2 pagesCommunication Postermalakpa790Pas encore d'évaluation
- La Prestation Logistique Au Maroc Caractéristique - Perspectives - EnjeuxDocument25 pagesLa Prestation Logistique Au Maroc Caractéristique - Perspectives - EnjeuxEl ZinebPas encore d'évaluation
- Bao, Petits Pains À La Vapeur - Free The PickleDocument2 pagesBao, Petits Pains À La Vapeur - Free The PickleNathalie F. RaveloPas encore d'évaluation