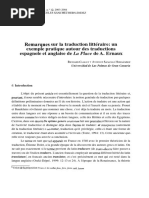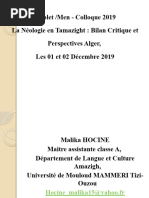2002 Correspondances Et Équivalences
2002 Correspondances Et Équivalences
Transféré par
Mokrane ChikhiDroits d'auteur :
Formats disponibles
2002 Correspondances Et Équivalences
2002 Correspondances Et Équivalences
Transféré par
Mokrane ChikhiDescription originale:
Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
2002 Correspondances Et Équivalences
2002 Correspondances Et Équivalences
Transféré par
Mokrane ChikhiDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Israël, F. (dir) Altérité, identité, équivalence, Minard lettres Modernes 2002,
pp. 17-34.
Correspondances et équivalences
faits de langue et faits de discours en traduction
M. Lederer
Une grande diversité règne dans l’emploi des termes ‘correspondance‘ et
‘équivalence’. Il me semble donc nécessaire d’y apporter une précision car ce
problème terminologique conditionne dans une très grande mesure la réflexion
des chercheurs qui se réclament de la théorie interprétative de la traduction.
Un grand nombre de théoriciens ne font pas la distinction entre l’un et l’autre
de ces termes ; beaucoup n’utilisent que le mot ‘équivalence’. Dans son
‘introduction à la traductologie’ en revanche, Werner Koller (1992)souligne que
le mot ‘équivalence’ est souvent qualifié par l’adjonction d’adjectifs tels que
‘formelle, communicative, pragmatique, stylistique’. Il estime que
correspondance (définie comme formale Ähnlichkeit) s’applique à la linguistique
comparée et que équivalence doit être réservée à la traductologie.
E. Nida (1977), auquel il faut rendre ici hommage, a depuis longtemps
clairement établi la distinction entre deux types de traduction, qu’il a appelé
‘formal-correspondence translation’ et ‘dynamic-equivalent translation’. Nida
est très clair lorsqu’il écrit
“ A formal- correspondence translation […] cannot be a dynamic-equivalent translation,
for it can never be a truly natural equivalent of the source text. ”.
Les tenants de la théorie interprétative n’auront pas de mal à reconnaître ce
qu’eux-mêmes dénomment transcodage d’une part, et de l’autre, interprétation du
texte, c’est à dire reformulation et non reproduction du sémantisme lexical et
grammatical.
2
Nous ne pouvons qu’applaudir à cette observation de Nida car nous y
trouvons la même distinction entre correspondances et équivalences que celle que
nous faisons nous mêmes.
Cette distinction est à la base de la Théorie Interprétative de la Traduction
qui voit dans l’emploi du langage, donc dans les textes et les discours, d’une part
la langue en tant que système dont on peut transcoder certains éléments, de l’autre
une créativité d’expression, des équivalences qui ne correspondent jamais qu’une
seule fois aux expressions originales.
La nécessité d’utiliser deux termes bien distincts : ‘correspondance ‘et
équivalence’ découle du niveau opérationnel auquel nous situons nos réflexions.
Nous nous penchons au premier chef sur l’opération, sur la façon dont la
traduction est effectuée, donc sur le processus, dont l’élucidation est
théoriquement intéressante, et pédagogiquement capitale.
Au moment où il traduit, le traducteur peut appliquer deux méthodes
différentes : soit il passe d’une langue à l’autre, introduisant dans son texte des
correspondances lexicales ou syntaxiques préexistantes entre deux langues, soit il
se construit une image mentale de la situation et, ayant trouvé le ‘sens’ du texte, il
l’exprime par équivalences, de façon idiomatique en langue d’arrivée. En fait,
dans la pratique, il fait concurremment les deux, recherchant d’une part dans une
langue les termes qui renvoient aux mêmes référents (à la même réalité) que ceux
désignés par l’original, et de l’autre créant des équivalences qui transmettent des
sens identiques à ceux de l’original.
Les correspondances sont utiles en traduction, mais il importe d’en
circonscrire la place dans le processus ; les équivalences, quant à elles, sont
indispensables dès lors qu’il ne s’agit plus seulement de désigner un même objet
mais de renvoyer à une même pensée. Les textes ne se contentent pas de répéter
toujours les mêmes pensées ; de même, les équivalences qui désignent ces
3
pensées sont non répétitives et doivent être crées à chaque instant par la
traduction.
Je disais que cette distinction terminologique est à la base même de la
Théorie interprétative de la traduction. La raison en est qu’elle montre le
fonctionnement du langage, fait de langue et de discours. Les correspondances
sont des faits de langue ; elles sont répertoriées dans les dictionnaires bilingues
ou, pour les termes techniques, dans les lexiques ou glossaires spécialisés. Hors
discours, tous les vocables pris isolément peuvent faire l’objet de
correspondances, simples ou multiples. Cependant, la traduction portant sur des
textes et non sur des langues, et les paramètres du discours prêtant à la langue des
caractéristiques inédites et inimaginables a priori, le recours aux correspondances
ne peut qu’être limité aux cas, relativement peu nombreux, où dans le fil du
discours, les vocables ne s’enrichissent pas des paramètres de la situation, ne
mobilisent pas les compléments cognitifs qui s’associent dans la tête du
traducteur mais gardent la signification que leur donne la langue. Tout le reste est
équivalence.
Les équivalences, faits de discours
Pour illustrer la distinction entre correspondances et équivalences, j’ai choisi
deux extraits de la traduction en français par Françoise Adelstain d’un roman de
Vikram Seth, “ A Suitable Boy ”.
Au début du roman, nous assistons à une réception de mariage dans les
jardins du Ministre du Trésor d’un petit état indien. Monsieur Kapoor marie son
fils aîné ; c’est un mariage arrangé. Monsieur Kapoor vient d’annoncer à son fils
cadet qu’il va bientôt le marier lui aussi et se rend compte que son fils est distrait.
4
“ Don’t you listen ? ” demanded “ Tu n’écoutes donc rien ? ” explosa
Mahesh Kapoor […], “ you are as bad Mahesh Kapoor […]. “ Tu ne vaux pas
as the clerks in the Revenue Department. mieux que les employés de mon
You were not paying attention, you were ministère. Tu étais bien trop occupé à
waving at Firoz. ” p.6 faire des signes à Firoz. ” p. 20
“ Don’t you listen ” reproche le père à son fils ; cela donne en français : ‘tu
n’écoutes donc rien ?’ Pour que la phrase : don’t you listen ? entraîne “ Tu
n’écoutes donc rien ? ” et pas seulement : “ n’écoutes-tu pas ”, il faut avoir
ressenti l’exaspération d’un père qui voudrait que son fils ait un peu plus de
plomb dans la cervelle. Cette exaspération se retrouve d’ailleurs dans la
traduction explosa qui rend demanded…
“ You were not paying attention, you were waving at Firoz ” est également
rendu par une équivalence : “ tu étais bien trop occupé (sous-entendu : pour
m’écouter) à faire des signes à Firoz. ” Dans l’original et dans la traduction, la
même scène se déroule sous nos yeux; la narration des mêmes événements
produit les mêmes effets. Ces deux passages qui restituent l’effet de l’original
sont traduits par équivalence.
La création d’équivalence signale aussi les connaissances acquises à la
lecture des premières pages du roman : “ Tu ne vaux pas mieux que les employés
de mon ministère ” ne reprend pas explicitement Revenue Department. La
traductrice se contente d’écrire “ mon ministère ” car deux pages auparavant,
l’auteur a présenté “ the groom’s father, Mr Mahesh Kapoor, who was the
Minister of Revenue of the state of Purva Pradesh ” et la traduction a fourni elle
aussi cette information. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler de quel ministère
il s’agit, le lecteur le sait.
5
Les correspondances, faits de langue
Cependant, toute traduction comporte toujours des correspondances.
Voyons par exemple un passage dans lequel toute une série de vocables font
l’objet, à juste titre, d’une mise en correspondance de l’anglais et du français :
“ And he greeted, before he had walked “ Il n’avait pas fait dix mètres qu’il
ten steps, a professor of literature[...] ; avait salué un professeur de littérature
two influential members of the state [...] ; deux représentants influents de
legislature from the Congress Party l’Assemblée, membres du parti du
[...] ; a judge, the very last Englishman Congrès […] ; un juge, le seul Anglais
to remain on the bench of the Brahmpur à siéger encore au banc de la Haute
High Court after Independence ; and his Cour de Brahmpur ; et son vieil ami le
old friend the Nawab Sahib of Baitar, Nawab Sahib de Baitar, l’un des plus
one of the largest landowners in the gros propriétaires fonciers de
state. ”. p. 7 l’Etat. ”.p.21
L’observateur pointilleux (et plus porté au comparatisme qu’au plaisir de la
lecture) remarquera probablement au début de la phrase un écart par rapport à la
formulation anglaise (ten steps et non dix mètres, ce qui ne représente pas la
même distance), de même qu’à la fin de la phrase, il découvrira de la part de la
traductrice une ignorance à la fois thématique (le contexte juridique) et
linguistique qui lui fait traduire “ on the bench ” par “ au banc ” alors que
l’anglais signifie ‘l’ensemble des juges’ ; comme toujours une ignorance a pour
conséquence une régression vers le transcodage. Mais mon objectif n’est ni de
critiquer les solutions de la traductrice ni d’en proposer d’autres, bien au
contraire, si j’ai choisi cette traduction, c’est que, dans l’ensemble, je la trouve
agréable à lire et qu’elle illustre, sur un passage restreint, le fait que toute
traduction est un mélange de correspondances et d’équivalences.
6
On trouve en effet dans l’extrait ci-dessus toute une série de correspondances
entre l’anglais et le français, c’est à dire de vocables ou de termes qui gardent dans
le fil du discours la signification que leur donne l’anglais et qu’il serait difficile (et
d’ailleurs peu utile) d’exprimer autrement :
Professeur de littérature pour professor of literature
Assemblée pour state legislature
Juge pour judge
Propriétaire foncier pour landowner
Ce sont des correspondances a priori, réalisées grâce au recours à une
terminologie connue dans les deux langues.
On y trouve également quelques noms propres et appellations :
Parti du Congrès
Haute Cour
Anglais
Brahmpur
Une autre appellation est gardée en l’état : le Nawab Sahib de Baitar, ce qui,
en l’absence de correspondance conventionnelle en français à cette dénomination
indienne passée en anglais, contribue à conserver la couleur locale.
Les correspondances a posteriori
On trouve également dans cet extrait des correspondances que j’appellerai a
posteriori, car on en constate l’existence lorsqu’on compare le texte traduit et
l’original, mais elles ne sont pas forcément voulues par le traducteur.
Font partie de cette catégorie
He greeted = il avait salué
Two influential members = deux [représentants] influents [de l’Assemblée],
membres And his old friend = et son vieil ami
One of the largest = l’un des plus gros
Correspondances a priori, correspondances a posteriori
Dans le cadre de la traduction interprétative, il n’est pas inutile de faire la
distinction entre les correspondances a priori, qui sont établies délibérément par
7
le traducteur dans le courant d’une traduction par équivalences et celles que l’on
détecte a posteriori, lorsque l’on compare le résultat de la traduction à l’original ;
celles-ci n’ont probablement pas été voulues en tant que telles par le traducteur ;
elles interviennent tout simplement lors de l’expression générale du sens. Les
correspondances a posteriori font partie intégrante de l’équivalence de formes à
laquelle aboutit la reformulation de l’idée. Beaucoup des vocables qu’une
comparaison entre l’original et la traduction croit pouvoir mettre en équation sous
le mot générique de ‘correspondance’, font en réalité partie de la traduction par
équivalence.
Jean Delisle l’avait pressenti dès 1980 :
“ Il arrive que la traduction corresponde au simple transcodage d’un énoncé ; on dit
alors qu’elle est littérale. La ressemblance des formes n’est cependant qu’un accident
étranger au processus de reformulation du sens. Cette coïncidence est fortuite et
l’analyse exégétique ne doit pas moins précéder la réexpression. ”p.69
Equivalences et déverbalisation
La traduction de textes et celle de mots ou de phrases isolés de leur contexte
ne peuvent pas être soumises à la même méthode de traduction. Dans les textes,
les mots et phrases s’enrichissent du contexte et de l’apport cognitif et émotif des
lecteurs et ont tendance à céder la place à une représentation mentale
déverbalisée.
Revenons au début de cet extrait :
L’anglais : “ And he greeted, before he had walked ten steps, a professor
etc… ” donne en français : “ Il n’avait pas fait dix mètres qu’il avait salué un
professeur … ”. On ne trouve ici que fort peu de correspondances, en tout cas pas
syntaxiques et les correspondances lexicales sont du type a posteriori. Ce début de
phrase est exemplaire d’une traduction par équivalence. Une fois de plus, la
traductrice, loin de traduire le système linguistique anglais en français, a imaginé
la scène : le Ministre reçoit dans son jardin la foule des invités. Il passe de l’un à
8
l’autre et dit un mot aimable à chacun. Cette scène, bien présente à l’esprit, se
prête à une expression française souple et spontanée, détachée de la formulation
originale.
Se faire une représentation mentale du texte à traduire signifie aussi tenir
compte de l’implicite charrié par le texte, que le lecteur de l’original saisit en
même temps que la langue du texte.
Dans: “ le seul Anglais à siéger encore [au banc] de la Haute Cour de
Brahmpour ”, le mot encore suffit à faire comprendre que le récit se déroule après
l’Indépendance. Il n’est pas nécessaire de parler en français de l’Indépendance
dans la mesure où, quelques lignes plus haut, le lecteur a appris que “ India had
been free for over three years ”. On retrouve ici le fameux principe
seleskovitchien de la non-imbécillité du lecteur.
Une différence conceptuelle profonde existe entre la traduction
interprétative, et la traduction des langues, c’est à dire celle qui traduit le
sémantisme des mots et des phrases.
Dans un petit ouvrage intitulé Sociolinguistics of Interlingual
Communication”, publié à Bruxelles en 1996, E. Nida écrit que
“ Translators who are certain of the meaning of a passage in the source language find
that a correct translation in the target language develops almost without thinking. They
don’t have to puzzle over grammatical classes of words, word order, or length of
sentences ”.
Nida ne va pas jusqu’à parler de déverbalisation mais je vais le faire et dire
qu’avec les équivalences, un traducteur ayant compris un texte et en ayant
reformulé le sens hors des contraintes linguistiques de l’original, apporte la
preuve du caractère non verbal du sens.
La synecdoque
A ce stade de mon raisonnement, je voudrais faire un pas de plus en
m’appuyant sur une caractéristique générale du langage qui n’est pas assez
9
souvent mise en avant, à savoir la synecdoque. Je reprends ici une notion qui me
tient à cœur. La synecdoque, en général considérée comme un simple effet
rhétorique en stylistique, est un phénomène beaucoup plus général du langage,
que la fréquentation constante de plusieurs langues met en évidence.
Les synecdoques de langue
Les linguistes ont dit il y a longtemps déjà que chaque langue découpe la
réalité de façon différente. J’ai d’abord considéré qu’il s’agissait là d’une façon
un peu grandiloquente de constater que les langues sont différentes les unes des
autres, ce qu’il ne faut pas être grand clerc pour admettre. Mais j’ai fini par me
rendre compte que c’était là le tout premier pas vers la justification de la
traduction par équivalences.
En effet, si l’on compare des langues, on s’aperçoit non seulement que les
vocables de chacune découpent différemment la réalité, mais encore que la partie
découpée désigne un tout plus large qu’elle et que la partie explicite (le
signifiant/signifié) d’un mot est loin d’exprimer le tout de l’objet ou de la notion
qu’elle transmet. Je donne souvent un exemple tiré du vocabulaire des fabricants
de sucre : (E) grower = (F) planteur ; la partie de la réalité découpée par l’anglais
vise celui qui fait pousser les betteraves alors que la partie découpée par le
français vise celui qui les met en terre (celui qui plante); dans le même domaine,
le français désigne l’installation où est traitée la betterave par sa fonction :
râperie, c’est à dire par un aspect, celui du traitement que subit la betterave, dont
une autre image est fournie par l’anglais juice station, qui renvoie à la même
installation, mais décrit un autre aspect, le résultat du traitement.
Dans des langues différentes, c’est un aspect différent (mais un aspect
seulement) de l’ensemble désigné qui est explicité. L’examen d’un corpus plus
large démontre que dans aucune langue, les vocables n’explicitent plus qu’un
aspect, qu’une partie du tout auquel ils renvoient. Il est donc clair, alors que nous
ne traitons encore que de mots isolés, que ce serait une erreur de ne vouloir
10
traduire que la partie explicite du mot ‘grower’ = qui fait pousser. Les
professionnels de la traduction savent bien que la seule manière de transmettre en
français la signification de ce vocable est de passer par la réalité à laquelle renvoie
‘grower’ dans le contexte des sucriers, à savoir un ‘planteur’ (de betteraves).
Dans d’autres contextes, la réalité désignée sera un ‘cultivateur’ ou un
‘producteur’ … Mais nous savons aussi que ceux qui traduisent sans formation,
ou sans réflexion, risquent de ne chercher à transposer que la partie explicite.
Les synecdoques de discours
Le phénomène de la synecdoque, de cet aspect partiel de la réalité que
désignent les mots et les phrases, est intéressant car il explique la nécessité de se
représenter l’ensemble de l’objet ou de la notion désignés pour établir dans l’autre
langue la correspondance correcte qui renverra, sous un explicite partiel lui aussi,
à la notion ou à l’objet tout entier.
La notion de synecdoque ne prend cependant tout son intérêt que lorsqu’on
passe aux discours, aux textes et donc aux équivalences. La synecdoque en effet,
loin de se limiter à la langue, est un phénomène de communication langagière. On
communique en utilisant un certain explicite, qui s’appuie sur l’implicite qu’il
charrie, pour faire passer l’intégralité de la chose désignée, c’est à dire le sens. On
fait confiance, pour le faire apparaître, au savoir que l’on sait exister chez les
interlocuteurs auxquels on s’adresse.
Là encore, l’examen détaillé de textes de langues différentes traitant du
même sujet montre que, à la fois en raison de l’idiomaticité différente de chaque
langue, et en raison des idiosyncrasies de chaque auteur, des discours identiques
utilisent des synecdoques différentes dans chaque langue. “ Tu étais bien trop
occupé à faire des signes à Firoz ” est une synecdoque (un explicite linguistique)
différente de “ you were not paying attention, you were waving at Firoz ”, mais
renvoie à la même idée. On a là une équivalence d’expression créée par deux
synecdoques différentes, désignant un sens identique. “ le seul Anglais à siéger
11
encore au banc de la haute cour de Brahmpour ” est une synecdoque différente
de “ the very last Englishman to remain on the bench of the Brahmpur High Court
after Independence ”, mais encore une fois, exprime un sens identique, dans la
création d’un nouvelle forme.
Quelle conclusion tirer de tout cela ? Pour transmettre les idées d’un texte
dans une autre langue, il faut trouver la combinaison d’explicite et d’implicite qui
fera comprendre le même sens. Les correspondances, faits de langue, ont leur
place en traduction ; mais ce sont les équivalences, faits de discours, qui en
respectant les synecdoques propres à la langue d’arrivée, permettent au traducteur
d’exercer sa créativité et au traductologue de voir clair dans le processus de la
traduction.
Je concluerai simplement, pour revenir au thème de ce colloque, que
traduire, c’est restituer une identité de sens dans l’équivalence des formes.
Références
Delisle, J. : L’analyse du discours comme méthode de traduction, Editions de
l’Université d’Ottawa, 1980.
Koller, W. : Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle und Meyer,
Wiesbaden, 4° ed., 1992, p.215
Nida, E. : The Sociolinguistics of Interlingual Communication, Les Editions du
Hazard, Bruxelles, 1996, p. 109
Nida, E. :‘The Nature of Dynamic Equivalence’, Babel, Vol. 23, n° 3, 1977
Seth, V. : A Suitable Boy, Pheonix, Londres, 1993, traduit de l’anglais par
F. Adelstain sous le titre Un garçon convenable, Grasset, Paris, 1995
Vous aimerez peut-être aussi
- Jakobson - Aspets Linguistiques TraductionDocument8 pagesJakobson - Aspets Linguistiques Traductionниколай ефимовPas encore d'évaluation
- La Pratica Della Traduzione - RiassuntoDocument10 pagesLa Pratica Della Traduzione - RiassuntoTessPas encore d'évaluation
- Recherche Et Méthodologie en Sciences Sociales Et Humaines PDFDocument286 pagesRecherche Et Méthodologie en Sciences Sociales Et Humaines PDFTewodros2014100% (3)
- Correspondances Et Équivalences - Faits de Langue Et de Discours en TraductionDocument12 pagesCorrespondances Et Équivalences - Faits de Langue Et de Discours en TraductionPaloma ReginaPas encore d'évaluation
- La traduction chapitre 4Document10 pagesLa traduction chapitre 4leslie.lemba.llPas encore d'évaluation
- Texte Traductologique #2 (TF1) 2021-IDocument2 pagesTexte Traductologique #2 (TF1) 2021-IPaola CárdenasPas encore d'évaluation
- La Traduction Histoire Et TheorieDocument11 pagesLa Traduction Histoire Et TheorienuagesdusudPas encore d'évaluation
- Paul Ricoeur Et Le Deuil de La Traduction Absolue, André DussartDocument2 pagesPaul Ricoeur Et Le Deuil de La Traduction Absolue, André DussartFiorella PatulloPas encore d'évaluation
- Initiationtraductions 3 G1Document31 pagesInitiationtraductions 3 G1ÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- Les Techniques de La Traduction, Notions de BaseDocument25 pagesLes Techniques de La Traduction, Notions de BaseCours UniversitairesPas encore d'évaluation
- Conseils de TraductionDocument4 pagesConseils de TraductionArusyak MikayelyanPas encore d'évaluation
- Traduzione 4 AprileDocument2 pagesTraduzione 4 Aprilesavina.fierroz123Pas encore d'évaluation
- Chapitre Cinquième. Au Cœur de Lopération Traduisante.Document8 pagesChapitre Cinquième. Au Cœur de Lopération Traduisante.Isaek IsberabahPas encore d'évaluation
- Gemar PDFDocument19 pagesGemar PDFMargareta CBPas encore d'évaluation
- Fidélité de La TraductionDocument9 pagesFidélité de La TraductionMIRONCRISTINA6853Pas encore d'évaluation
- Jeux de Traduction - SummaryDocument7 pagesJeux de Traduction - SummaryMiriana FaietaPas encore d'évaluation
- Chapitre Quatre - Théories de La Traduction. Dernier.Document14 pagesChapitre Quatre - Théories de La Traduction. Dernier.Isaek Isberabah100% (1)
- Traduction, Adaptation - Palimpseste - MeshionicDocument7 pagesTraduction, Adaptation - Palimpseste - Meshionic1dennys5Pas encore d'évaluation
- La Traduction ConclusionDocument1 pageLa Traduction Conclusionleslie.lemba.llPas encore d'évaluation
- Durdureanu Pour Une Définition de La Traduction CorrecteDocument14 pagesDurdureanu Pour Une Définition de La Traduction Correctelunatica2384Pas encore d'évaluation
- La Traductologie Origine Et Théories 2Document3 pagesLa Traductologie Origine Et Théories 2Stella WaelPas encore d'évaluation
- Les Enjeux de La Traduction Juridique PDFDocument19 pagesLes Enjeux de La Traduction Juridique PDFislemPas encore d'évaluation
- Georges Mounin Les Problèmes Théoriques de La TraductionDocument4 pagesGeorges Mounin Les Problèmes Théoriques de La TraductionÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- LING - Melcuk I., Collocations Dans Le Dictionnaire, 2003 PDFDocument43 pagesLING - Melcuk I., Collocations Dans Le Dictionnaire, 2003 PDFpetarPas encore d'évaluation
- Les Enjeux de La Traduction Juridique PRDocument10 pagesLes Enjeux de La Traduction Juridique PRhamza marouaniPas encore d'évaluation
- 1976SYNECDOQUEETTRADUCTIONDocument23 pages1976SYNECDOQUEETTRADUCTIONAlonso Oviedo PolleriPas encore d'évaluation
- Compte Rendu de Dire Presque La Meme ChoDocument10 pagesCompte Rendu de Dire Presque La Meme ChogaydonestellePas encore d'évaluation
- Traductologie Lectures en TraductologieDocument114 pagesTraductologie Lectures en TraductologieHaris HadžibaščauševićPas encore d'évaluation
- Pour Lire L Article La Phrase Nominale EDocument14 pagesPour Lire L Article La Phrase Nominale EPapaPas encore d'évaluation
- Traduction 2023Document9 pagesTraduction 2023Fati TimaPas encore d'évaluation
- MA Taphores Et TraductionDocument14 pagesMA Taphores Et TraductionWafia BélidamPas encore d'évaluation
- Livret Version L3 LEA 2021 2022Document52 pagesLivret Version L3 LEA 2021 2022Paul LemirePas encore d'évaluation
- Taber, Traduire Le Sens Traduire Le StyleDocument10 pagesTaber, Traduire Le Sens Traduire Le Stylesafia.belabed90Pas encore d'évaluation
- Lectures en Traductologiepdf Version 1 - 240223 - 111705Document115 pagesLectures en Traductologiepdf Version 1 - 240223 - 111705benhaddifuture01Pas encore d'évaluation
- La Traductologie Entre Art Et Miroir, Mansour Sayah, Marcos SimeonDocument23 pagesLa Traductologie Entre Art Et Miroir, Mansour Sayah, Marcos SimeonandemaximinPas encore d'évaluation
- JakobsonDocument4 pagesJakobsonKhinPas encore d'évaluation
- Ch. Taber - Traduire Le Sens, Traduire Le StyleDocument10 pagesCh. Taber - Traduire Le Sens, Traduire Le StyleRiccardo Raimondo100% (1)
- cours de traduction S5 T. Uakkas.Document62 pagescours de traduction S5 T. Uakkas.frabaa821Pas encore d'évaluation
- Je Brûle Pour Thésée Réflexions Sur Les Opérations Linguistiques Engagées Dans La Traduction D'une Métaphore de PhèdreDocument10 pagesJe Brûle Pour Thésée Réflexions Sur Les Opérations Linguistiques Engagées Dans La Traduction D'une Métaphore de Phèdreiranqajar2021Pas encore d'évaluation
- 09 M C MolinaDocument9 pages09 M C MolinaSoussou SouadPas encore d'évaluation
- 2006LaThorieInterprtativedelatraduction PDFDocument19 pages2006LaThorieInterprtativedelatraduction PDFAsarelaAhlaíAlavaPas encore d'évaluation
- L'Esprit Et La Lettre. Sur La Traduction de Textes Impossibles (D. Bellos)Document7 pagesL'Esprit Et La Lettre. Sur La Traduction de Textes Impossibles (D. Bellos)Erwan MorelPas encore d'évaluation
- Jeux de TraductionDocument14 pagesJeux de TraductionAnișoara RusanovschiPas encore d'évaluation
- Quest Ce Quun Texte Littéraire Et Que Signifie Sa CompréhensionDocument20 pagesQuest Ce Quun Texte Littéraire Et Que Signifie Sa Compréhensionzineb.zerafa2Pas encore d'évaluation
- في سبيل منحى لساني براغماتي تداولي للترجمة PDFDocument34 pagesفي سبيل منحى لساني براغماتي تداولي للترجمة PDFRadouane SlimaniPas encore d'évaluation
- Symbolisme Et Interpretation - Todorov, TzvetanDocument284 pagesSymbolisme Et Interpretation - Todorov, Tzvetan140871raph67% (3)
- Notes Bibliographique. Problèmes de Traduction, L'horlogerie de Saint JérômeDocument5 pagesNotes Bibliographique. Problèmes de Traduction, L'horlogerie de Saint Jérômebertrand.smithPas encore d'évaluation
- Traduction Vietnamien - Francais-2Document14 pagesTraduction Vietnamien - Francais-219041176 Nguyễn Thị Thu PhươngPas encore d'évaluation
- Initiation À La Traduction Ait Melloul BARRADocument12 pagesInitiation À La Traduction Ait Melloul BARRAHamid EslimaniPas encore d'évaluation
- Rey-Debove (2005) Actes Klingenberg 2004Document6 pagesRey-Debove (2005) Actes Klingenberg 2004salvius duwePas encore d'évaluation
- Studia Romanica Posnaniensia UAM Vol. 25/26 Poznań 2000Document10 pagesStudia Romanica Posnaniensia UAM Vol. 25/26 Poznań 2000younessmallouki1979Pas encore d'évaluation
- La Pratica Della Traduzione RiassuntoDocument9 pagesLa Pratica Della Traduzione RiassuntoAtraPas encore d'évaluation
- Linguistique TextuelleDocument45 pagesLinguistique Textuellekamy-g100% (1)
- La Traduction Des Métaphores (APU)Document14 pagesLa Traduction Des Métaphores (APU)Maroua Benk99rimaPas encore d'évaluation
- Pourquoi 5 Edition DInterpreter Pour TraDocument16 pagesPourquoi 5 Edition DInterpreter Pour TraRita LalindaPas encore d'évaluation
- Article: La Traductologie, La Traduction Naturelle, La Traduction Automatique Et La SémantiqueDocument15 pagesArticle: La Traductologie, La Traduction Naturelle, La Traduction Automatique Et La SémantiquemehdiPas encore d'évaluation
- Culture Monde 16.11Document6 pagesCulture Monde 16.11Polina GubanovaPas encore d'évaluation
- Dialnet RemarquesSurLaTraductionLitteraire 2011785Document13 pagesDialnet RemarquesSurLaTraductionLitteraire 2011785Paola DemgnePas encore d'évaluation
- Analyse - Comparative - de - Traductions - Du Catcher - in - The - RyeDocument142 pagesAnalyse - Comparative - de - Traductions - Du Catcher - in - The - RyeDelrieuPas encore d'évaluation
- Observations grammaticales sur quelques articles du Dictionnaire du mauvais langageD'EverandObservations grammaticales sur quelques articles du Dictionnaire du mauvais langagePas encore d'évaluation
- Une réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?D'EverandUne réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?Pas encore d'évaluation
- La Proclamation Du Premier Novembre 1954 - Naissance D'un Texte FondateurDocument21 pagesLa Proclamation Du Premier Novembre 1954 - Naissance D'un Texte FondateurMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Hamad Bin Ibrahim AL-TRAIF: Volume:20 / Issue 03 / (2021) PP: 320-357Document38 pagesHamad Bin Ibrahim AL-TRAIF: Volume:20 / Issue 03 / (2021) PP: 320-357Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- 28. دليل تطبيق محضر الخروج الإلكترونيDocument7 pages28. دليل تطبيق محضر الخروج الإلكترونيMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- 6071-Article Text-20357-1-10-20191021Document12 pages6071-Article Text-20357-1-10-20191021Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Corpus 292Document11 pagesCorpus 292Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Existe-T-Il Un Langage Propre A La PolitiqueDocument19 pagesExiste-T-Il Un Langage Propre A La PolitiqueMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Edb 010 0241Document7 pagesEdb 010 0241Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Analyse de Discours Évaluatif, Modèle Linguistique Et ApplicationsDocument23 pagesAnalyse de Discours Évaluatif, Modèle Linguistique Et ApplicationsMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Modélisation Des Textes JuridiquesDocument9 pagesModélisation Des Textes JuridiquesMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Questionsdecommunication 26823Document25 pagesQuestionsdecommunication 26823Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Griebel TextesetdiscoursjuridiquesDocument26 pagesGriebel TextesetdiscoursjuridiquesMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Le Lexique Amazigh Face A La StandardisaDocument24 pagesLe Lexique Amazigh Face A La StandardisaMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Trad BA G03Document1 pageTrad BA G03Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Imawalen UzzigenDocument3 pagesImawalen UzzigenMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- 2eme EMD AB'Document1 page2eme EMD AB'Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Edb 005 0032Document18 pagesEdb 005 0032Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Article de Ouahmi Ould BrahemDocument16 pagesArticle de Ouahmi Ould BrahemMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Communication CRASCDocument8 pagesCommunication CRASCMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Transpositions Et Modulations en TraductionDocument21 pagesTranspositions Et Modulations en TraductionMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- La Terminologie Berbere Entre Diverence Et ConvergenceDocument26 pagesLa Terminologie Berbere Entre Diverence Et ConvergenceMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Erreurs de TraductionDocument14 pagesErreurs de TraductionMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Cours Idir AzeddineDocument10 pagesCours Idir AzeddineMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Article de Djamel MechedDocument17 pagesArticle de Djamel MechedMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Les Premiers Emprunt Arabe en BerbereDocument7 pagesLes Premiers Emprunt Arabe en BerbereMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Terminologie Et Traduction AmazigheDocument4 pagesTerminologie Et Traduction AmazigheMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Traduire Vers Tamazight Entre Archaïsme Emprunt Et NéologismeDocument14 pagesTraduire Vers Tamazight Entre Archaïsme Emprunt Et NéologismeMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Comprendre Pour Traduire - Cas Des Diplômés en Traduction en AlgérieDocument18 pagesComprendre Pour Traduire - Cas Des Diplômés en Traduction en AlgérieMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Article de Mahdi GuouirgateDocument30 pagesArticle de Mahdi GuouirgateMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- BOUKHROUF Ramdane 2019Document14 pagesBOUKHROUF Ramdane 2019Mokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Approches de La TraductionDocument13 pagesApproches de La TraductionMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Les Positionnements ÉpistmologiquesDocument15 pagesLes Positionnements ÉpistmologiquesAli TarkiPas encore d'évaluation
- La Démarche Inductive en Pédagogie de L'alternanceDocument4 pagesLa Démarche Inductive en Pédagogie de L'alternanceOlsen MalagaPas encore d'évaluation
- Causalité Et Mécanique QuantiqueDocument203 pagesCausalité Et Mécanique QuantiqueAntonio Manuel Santos Barros100% (1)
- Debaise - Spéculation Et DramatisationDocument7 pagesDebaise - Spéculation Et DramatisationLe RouxPas encore d'évaluation
- Introduction GénéraleDocument3 pagesIntroduction GénéraleAssia El KhaldiPas encore d'évaluation