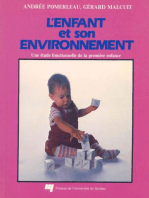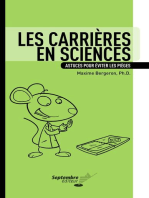QLM Ce1 GP
QLM Ce1 GP
Transféré par
janeeyre1986Droits d'auteur :
Formats disponibles
QLM Ce1 GP
QLM Ce1 GP
Transféré par
janeeyre1986Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
QLM Ce1 GP
QLM Ce1 GP
Transféré par
janeeyre1986Droits d'auteur :
Formats disponibles
Les Cahiers Istra CE1
Cycle 2
Questionner
le monde
Guide pédagogique
Catherine VILARO
Conseillère pédagogique
Didier FRITZ
Inspecteur de l’Éducation nationale
NOU
P R O V E AU X
GRA
M
2016 MES
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 1 11/10/2017 15:33
Création de la maquette de couverture : Florence Le Maux
Mise en pages intérieure et de couverture : Alinéa
Illustrations : Alain Boyer (couverture, grenouilles), Gilles Poing (dessins techniques)
Fabrication : Marc Chalmin
Édition : Christel Desmaris
Crédits photographiques
Couverture : © JPC-PROD / Fotolia ; © Neyak / Fotolia ; © Mickeing / Fotolia ; © onderartel / Fotolia.
0,49 Kg éq. CO2
ISBN : 978-2-01-394785-5
© Hachette Livre 2017, 58, rue Jean Bleuzen, CS 70007, 92178 Vanves Cedex.
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d’autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d’exemple ou d’illustration, « toute représentation
ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». Cette représentation ou reproduction, par quelque
procédé que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris), constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 2 11/10/2017 15:33
Avant-propos
Une démarche spiralaire conforme aux nouveaux programmes
La collection Les Cahier Istra Questionner le monde CE1 propose une démarche structurée pour
« permettre aux élèves de construire des connaissances nécessaires pour comprendre le monde qui les
entoure et développer leur capacité à raisonner » (B.O. du 26 novembre 2015).
Les programmes 2016 sont spiralaires : « Les apprentissages, repris et approfondis lors des cycles
successifs, se poursuivront tout au long de la scolarité en faisant appel à des idées de plus en plus
élaborées, abstraites et complexes. » La collection adopte cette démarche spiralaire en créant une
véritable continuité entre le cycle 2 (« Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets »)
et le cycle 3 (« Sciences et technologie »). Une proposition de répartition des thèmes et des notions
par niveaux du cycle 2 et du cycle 3 est proposée pour aider les enseignants à mettre en œuvre cette
démarche entre les niveaux.
La démarche scientifique d’investigation
Ce guide pédagogique permet d’accompagner l’enseignant dans la mise en œuvre de la démarche
scientifique d’investigation et le développement des compétences affirmées par les textes officiels.
Pour chaque leçon, l’enseignant trouvera :
◗ Une synthèse des notions scientifiques mises en jeu dans la séquence. Ces notions simples mais
précises apporteront des éléments de rigueur scientifique même aux enseignants peu familiarisés avec
la discipline scientifique.
◗ Les références aux nouveaux programmes et au socle commun.
◗ Une première séance développant une ou plusieurs situations en observation concrète directe et un
premier questionnement. Ce temps collectif est immédiatement suivi du travail dans le cahier sur la
rubrique « Je connais déjà », cette fois en observation concrète indirecte : à l’oral et en collectif, un débat
permet la mise en commun des connaissances des élèves, prérequis ou savoirs quotidiens. La discussion
se poursuit à partir de photographies pour faire émerger les représentations initiales des élèves.
◗ Deux séances s’attachent ensuite à suivre les étapes des rubriques « J’observe et j’expérimente / je
m’interroge » : la démarche guidée d’investigation permet de s’approprier des outils et des méthodes,
et de structurer progressivement l’observation, l’expérimentation, la description, la modélisation, le
raisonnement et la conclusion. Le guide offre à l’enseignant tous les conseils pour la mise en place
expérimentale des dispositifs proposés. Ces séances se terminent par le « Je conclus » : en cycle 2, les
élèves complètent un court texte de synthèse en utilisant les mots-clés de la leçon.
◗ La dernière séance permet le réinvestissement immédiat des savoirs et des savoir-faire acquis, grâce
aux rubriques « J’utilise ce que j’ai appris », qui permet de vérifier les acquis et préparer l’évaluation,
et « Je retiens », une synthèse de l’essentiel à retenir sous forme de carte mentale très illustrée, pour
faciliter la compréhension, l’appropriation et la mémorisation à long terme.
Ce guide pédagogique contient les corrigés de toutes les activités proposées dans le cahier.
Des références aux ressources disponibles sur la clé USB sont régulièrement présentes dans les déroulés
des leçons.
Avec le Cahier Istra Questionner le monde CE1 et sa clé USB de ressources numériques, l’enseignant
trouvera un cadre construit conduisant à une pratique d’observation et d’expérimentation, et à des
apprentissages concrets conformes aux programmes 2016.
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 3 11/10/2017 15:33
Sommaire
Avant-propos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Proposition de progression annuelle pour le cycle 2 . . . . . . . . . . 5
Qu’est-ce que la matière ?
1 Les changements d’état de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 De l’air partout autour de nous ............................................. 10
Comment reconnaître le monde vivant ?
3 Les êtres vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 Le cycle de vie des animaux ...................................................... 16
5 Les régimes alimentaires des animaux ............................. 19
6 Les graines des végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7 La croissance du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8 La dentition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9 Les aliments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Les objets techniques
Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?
10 Des activités et leurs outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
11 Fabriquer un bateau propulsé ................................................ 37
12 Des circuits électriques ............................................................... 40
13 Fabriquer des objets électriques .......................................... 43
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 4 11/10/2017 15:33
Proposition de progression annuelle – Cycle 2
Questionner le monde du vivant,
de la matière et des objets
CP CE1 CE2
Qu’est-ce que la matière ?
1 La matière solide
2 La matière liquide
3 Les états de l’eau 1 Les changements d’état 1 Les changements d’état
de l’eau de l’eau
2 De l’air partout autour 2 Les propriétés de l’air
de nous
Comment reconnaître le monde vivant ?
4 Les êtres vivants 3 Les êtres vivants 3 Les êtres vivants
5 La croissance des animaux 4 Le cycle de vie 4 Les êtres vivants et leur
des animaux milieu
5 Les régimes alimentaires 5 Les relations alimentaires
des animaux entre les êtres vivants
6 Les différents milieux 6 Les graines 6 Les conditions de
de vie des végétaux germination des graines
7 Le corps en mouvement 7 La croissance du corps 7 La croissance du corps
8 L’hygiène 8 La dentition 8 L’hygiène de vie
9 Bien manger 9 Les aliments 9 Une alimentation saine
Les objets techniques
Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?
10 Les outils 10 Des activités 10 Des outils et des métiers
et leurs outils manuels
11 Fabriquer un objet 11 Fabriquer un bateau 11 Fabriquer un véhicule
qui roule propulsé
12 Les circuits électriques 12 Des circuits électriques 12 Courant de la pile
simples et courant du secteur
13 Fabriquer une maison 13 Fabriquer des objets 13 Construire un jeu
éclairée électriques de questions/réponses
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 5 11/10/2017 15:33
La matière
1 Les changements d’état
Cahier
pp. 7-10
de l’eau
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état.
Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.
Reconnaître les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels.
Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau :
– les changements d’état de la matière, notamment solidification, condensation et fusion ;
– les états de l’eau (liquide, glace, vapeur d’eau).
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
L’eau peut apparaître sous trois états : solide, liquide ou gazeux.
Sous la forme liquide, on utilise le terme d’« eau », sous la forme solide celui de « glace » et sous sa forme
gazeuse celui de « vapeur d’eau ».
Le passage d’un état à l’autre détermine l’échelle Celsius de température.
Par convention, 0 °C est la température de la glace fondante et 100 °C est la température d’ébullition de
l’eau.
Le passage de l’eau à la glace s’appelle la solidification. Il se fait dès la température de 0 °C.
Le passage de la glace à l’eau s’appelle la fusion, ce passage se fait à la température de 0 °C par convention.
Le passage de l’eau à la vapeur d’eau s’appelle la vaporisation. Elle peut prendre deux formes :
– l’évaporation : ce phénomène naturel se fait à toutes températures. En fonction de la quantité de vapeur
d’eau contenue dans l’air et de la pression atmosphérique, l’eau contenue dans un récipient se transforme
doucement en vapeur d’eau. Moins la pression atmosphérique est élevée, plus le phénomène est impor-
tant. Le vent, la chaleur, l’importance de la surface de l’eau en sont les facteurs favorisants ;
– l’ébullition : ce phénomène dépend d’une source de chaleur importante et brutale. Comme signalé plus
haut, la température d’ébullition dépend de la pression atmosphérique extérieure. Les bulles de vapeur
d’eau se forment et s’échappent lorsque leur pression, dans le récipient chauffé, devient supérieure à la
pression atmosphérique.
Attention, lors du processus de chauffage, on aperçoit d’abord des petites bulles, puis un gros bouillon-
nement :
– les petites bulles ne sont pas de la vapeur d’eau, mais la manifestation d’autres gaz présents dans l’eau,
dioxygène dissous par exemple ;
– seules les grosses bulles du bouillonnement contiennent la vapeur d’eau.
Le passage de la vapeur d’eau à l’eau s’appelle la liquéfaction. Le plus souvent, on parle de condensation ;
pour être exact, il faudrait parler de condensation liquide. La liquéfaction se fait à toute température :
c’est aussi bien la transformation de la vapeur d’eau en rosée le matin du fait de la fraîcheur de la nuit,
que la transformation de la vapeur d’eau au-dessus de la casserole en ébullition en fines gouttelettes.
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 6 11/10/2017 15:33
Attention donc, ce que l’on voit au-dessus de la casserole en ébullition n’est pas de la vapeur d’eau, la
vapeur d’eau étant un gaz invisible ; ce sont de fines gouttelettes d’eau…
Seules les grosses bulles d’ébullition de l’eau constituent une manifestation visible de la vapeur d’eau,
cette vapeur étant emprisonnée pendant un très court instant dans une enveloppe d’eau avant d’éclater
à la surface.
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 7.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 7 :
– Observation À ton avis, comment l’eau passe-t-elle d’un état à l’autre ?
indirecte de 1re étape : faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
2e étape : observation indirecte.
Découvrir que l’eau peut subir des transformations.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Les élèves observent les documents de la page 7.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que fait la personne avec l’enfant ? Pourquoi faut-il sécher les
cheveux de l’enfant ? Quel appareil utilise-t-elle pour sécher les cheveux ? Quelle
est l’action du sèche-cheveux pour sécher les cheveux ?
– Document 2 : que voyez-vous sur le dessin ? Qu’utilise-t-on pour chauffer l’eau
et la faire bouillir ? À quoi voit-on que l’eau est en train de bouillir ? Vous avez
déjà vu de l’eau bouillir. Que se passe-t-il quand on fait bouillir de l’eau très long-
temps ?
– Document 3 : que voyez-vous sur ce document ? Qu’observez-vous sur la vitre ?
Qu’est-ce que la buée ? Selon vous, d’où vient-elle ?
– Document 4 : qu’y a-t-il dans le verre ? Comment fait-on des glaçons ? Que
vont-ils devenir ?
Les élèves entourent les phrases exactes de chaque document.
Corrigés
Document 1 : Entourer la deuxième phrase.
Documents 2, 3 et 4 : Entourer les deux dernières phrases.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 8.
– Expérimentation. – Bac à glaçons, Comment l’eau passe-t-elle de l’état liquide à l’état solide et inversement ?
eau. Découvrir les conditions de solidification de l’eau et de fusion de la glace.
– Présence d’un 1er temps : comment transformer l’eau en glace ?
congélateur Demander aux élèves comment on fait pour obtenir des glaçons.
dans l’école. Les élèves le vérifient en versant de l’eau dans un bac à glaçons et en le mettant
dans la partie haute (congélateur) du réfrigérateur.
Leur faire observer en quoi l’eau s’est transformée, et sous quelle action.
Ils concluent l’expérience en formulant que l’eau s’est transformée en glace sous
l’action du froid.
Ils mettent ensuite dans l’ordre les phrases de l’exercice 1 du cahier.
Corrigé
Relier l’étape 1 avec le troisième dessin, l’étape 2 avec le deuxième et l’étape 3 avec
le premier.
2e temps : comment faire fondre la glace ?
La question est posée collectivement.
Les élèves formulent les hypothèses.
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 7 11/10/2017 15:33
Mettre en place l’expérimentation : glaçons dans le réfrigérateur, dans la classe,
au soleil ou sur une source de chaleur.
Amener les élèves à observer que les glaçons fondent plus ou moins vite suivant
la source de chaleur.
Ils constateront que les glaçons fondent aussi dans le réfrigérateur, bien qu’il y
fasse froid.
On amènera les élèves à conclure en disant que les glaçons fondent à la chaleur
et si le froid n’est pas suffisant.
Les élèves complètent les exercices 2 et 3 de la page 8 du cahier.
Corrigés
Exercice 2 : Noter la durée mise par les glaçons pour fondre dans chacune des trois
situations.
Exercice 3 : vrai – faux – faux – vrai – vrai
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 9.
– Expérimentation. – Bouteille Comment l’eau s’évapore-t-elle ?
– Synthèse des d’eau vide. Découvrir la notion d’évaporation de l’eau et de condensation de la vapeur
connaissances d’eau en eau.
acquises. 1er temps : observation directe.
Observer le phénomène d’évaporation de l’eau.
Après une averse, descendre dans la cour de récréation à plusieurs moments de
la journée et constater que la cour sèche petit à petit.
Les élèves pourront être amenés à dire que l’eau rentre dans le sol. On leur propo-
sera de faire l’expérience en mettant une bâche plastique sur le sol de la cour de
récréation et d’observer ce que devient l’eau alors qu’elle ne peut plus transpercer
le bitume.
Avant l’entrée en classe les élèves passent aux toilettes pour faire l’expérience
proposée page 9 du cahier.
Leur demander de se mouiller les mains et de les égoutter légèrement pour qu’il
n’y ait plus de gouttes tombant naturellement, mais une pellicule d’eau.
Leur demander de laisser leur main à plat, paume vers le haut et d’observer ce
qui se passe.
L’expérience pourra être faite sous le préau de l’école, puis au soleil.
Une fois entrés en classe, demander aux élèves quel système permet de se sécher
les mains sans serviette, système qu’ils ont probablement vu dans des espaces
publics.
Leur demander de décrire comment fonctionnent ces appareils et comment ils
sèchent les mains.
Les élèves répondent ensuite aux questions de la page 9 du cahier de l’élève.
Corrigé
Colorier les phrases 3 et 4.
2e temps : observation directe.
Observer le phénomène de condensation de l’eau.
1re expérience
Repérer un espace de l’enceinte scolaire engazonnée.
Choisir un jour où aucune pluie n’est prévue.
Constater que l’herbe est sèche ; le lendemain avant l’entrée en classe, consta-
ter que l’herbe est mouillée. Les élèves pourront être amenés à dire qu’il a plu
pendant la nuit ; en ce cas, recommencer l’expérience en installant un couvercle
surélevé sur une partie engazonnée.
Faire le constat le lendemain qu’il n’y a pas eu de pluie sous le couvercle.
Se poser la question de l’origine de cette eau sous forme de rosée ; en expliquer
l’origine : cette eau était dans l’air sous forme de vapeur d’eau ; sous l’effet du froid,
elle s’est condensée en vapeur d’eau.
2e expérience
Les élèves réalisent l’expérience avec le réfrigérateur de l’école.
Prendre une bouteille et faire constater qu’elle est absolument vide d’eau.
Laisser la bouteille au réfrigérateur 24 heures ; amener les élèves à constater la
présence de gouttelettes d’eau sur la paroi de la bouteille.
Faire verbaliser la condition qui a permis cette transformation : le froid.
Mettre en relation avec l’observation de la rosée sur la pelouse le matin.
Se poser la question de la provenance de cette eau, eau sous une autre forme
invisible dans l’air.
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 8 11/10/2017 15:33
Je conclus
L’eau est dans la nature sous trois états : eau liquide, eau solide ou glace, et vapeur
d’eau. Au congélateur, l’eau se transforme en glace.
À la chaleur, la glace fond et se transforme en eau liquide.
Elle se transforme en vapeur d’eau quand on la laisse s’évaporer.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 10.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : Les élèves dessinent le verre rempli à moitié d’eau.
acquises. Exercice 2 : Les élèves entourent le dessin avec la partie haute (congélateur avec
3 étoiles) du réfrigérateur.
Je retiens
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 9 11/10/2017 15:33
La matière
2 De l’air partout
Cahier
pp. 11-14
autour de nous
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Existence, effet de l’air (matérialité de l’air).
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
L’air étant un gaz, il occupe l’intégralité de l’espace autour de nous et l’intégralité des espaces qui le
contiennent : ballon, bouteille vidée de son liquide, par exemple.
L’air est une matière ; il est pesant, il possède une masse de 1,2 kg/m3 au niveau de la mer et à 20 °C.
L’air est compressible. La même masse d’air peut être comprimée, comme c’est le cas dans une pompe à
vélo dont on a bouché l’extrémité avec le pouce et appuyé fortement sur le piston. On remarquera que
cette compression s’accompagne d’une augmentation de la température.
L’air est résistant : la résistance est la capacité que l’air a de résister partiellement au déplacement d’un
objet, soit verticalement dans le cas d’un objet tel le parachute, ou horizontalement dans le cas d’une
voiture… Résistance que l’on sent si l’on met la main à l’extérieur de la fenêtre de la voiture lorsqu’elle
roule.
L’air peut mettre en mouvement : c’est le cas du vent qui provoque le déplacement du voilier…
Cette résistance se manifeste notamment avec des objets légers et ayant une grande surface portante.
L’air peut être transvasé : il est possible de le faire passer d’un récipient à un autre.
10
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 10 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 11.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 11 :
– Observation À ton avis, comment savoir que l’air est là alors qu’on ne le voit pas ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille page 11 et y répondent collec-
concrètes tivement. Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux
représentées élèves de les organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves. Travail
sur les documents page 11.
Observer les effets de l’air en mouvement.
Les élèves observent les documents. Ils répondent d’abord aux questions de struc-
turation posées oralement par l’enseignant et, ensuite, par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur la photo ? Pourquoi la personne a-t-elle des
difficultés ? Comment sait-on qu’il y a beaucoup de vent ?
– Document 2 : que voyez-vous sur le document ? Pourquoi appelle-t-on ce bâti-
ment un moulin à vent ? Quelle est la partie du moulin qui est entraînée par le
vent ? Connaissez-vous d’autres constructions avec des ailes qui tournent lorsqu’il
y a du vent ?
– Document 3 : quel objet cette petite fille utilise-t-elle ? Quel usage en fait-elle ?
Quel mot reconnaissez-vous dans le mot éventail ? Comment cet éventail est-il
conçu pour bien tenir en main et bien mettre l’air en mouvement ?
– Document 4 : que voyez-vous sur la photo ? Comment appelle-t-on l’objet avec
lequel l’enfant joue ? Pourquoi le cerf-volant ne tombe-t-il pas ? Le cerf-volant
restera-t-il en l’air s’il n’y a plus de vent ? Comment l’enfant guide-t-il son cerf-vo-
lant ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 11.
Corrigés
Document 1 : Un vent violent pousse le parapluie.
Document 2 : Les ailes de ce moulin tournent quand il y a du vent.
Document 3 : Cette fille utilise un éventail pour faire du vent et se rafraîchir.
Document 4 : Ce cerf-volant vole grâce au vent.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 12.
– Expérimentation. – Sacs en Comment observer l’air ?
plastique. Matérialiser la présence de l’air : bulles dans l’eau, air enfermé dans un
– Bouteille en contenant.
plastique, bac 1er temps : emprisonner de l’air.
rempli d’eau, Dans la cour de l’école, les élèves disposent d’un sac plastique. Leur demander de
pompe à vélo. remplir ce sac d’air en courant et de l’emprisonner en fermant avec un élastique.
– Ballons de Les élèves partent avec le sac aplati et avec l’ouverture légèrement ouverte.
baudruche. Ils pourront comparer à celui qui aura emprisonné le plus d’air.
2e temps : l’air peut-il être visible ?
Dans la classe, mettre en œuvre l’expérience A page 12 du cahier de l’élève.
Les élèves dessinent ensuite ce qu’ils observent et colorient les bonnes réponses.
La même expérience peut être faite avec une pompe à vélo. Utiliser une pompe
à vélo avec un raccord.
Dans une bassine d’eau, immerger l’extrémité du raccord et actionner la pompe à
vélo. Les élèves constateront les bulles. Leur demander d’où elles proviennent et
ce que la pompe à vélo propulse.
Corrigé
Au départ, la bouteille contenait de l’air.
L’air s’est échappé de la bouteille sous forme de bulles.
11
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 11 11/10/2017 15:33
3e temps : l’air peut-il remplir un ballon ?
Mettre en œuvre l’expérience B page 12 avec un ballon de baudruche.
Les élèves complètent le dessin et répondent par vrai ou faux aux phrases propo-
sées.
Corrigés
Exercice 1 : Dessin du ballon qui gonfle.
Exercice 2 : vrai – faux – vrai – faux – vrai
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 13.
– Expérimentation. – Par élève : Comment utiliser l’air pour faire tourner un moulinet ?
– Synthèse des papier Réaliser un objet pouvant être mis en mouvement par le mouvement de l’air.
connaissances Canson, paire Les élèves observent l’objet à réaliser.
acquises. de ciseaux, Faire avec eux la description de chaque dessin en leur proposant de retrouver
1 épingle, l’ordre de fabrication.
1 perle, Identifier le matériel dont on a besoin pour le fabriquer : papier Canson, paire de
1 bouchon en ciseaux, épingle, perle, bouchon en liège.
liège. Leur faire réaliser le moulinet.
Une fois terminé, le tester dans la cour de l’école, puis dans la classe.
Dans la cour de l’école, les élèves seront amenés à courir ; en classe, ils seront
amenés à souffler dessus ou à utiliser un ventilateur.
Les élèves répondent aux consignes de la page 13.
Corrigés
Exercice 1 : 4 – 1 – 5 – 2 – 6 – 3
Exercice 2 : Entourer le premier et le deuxième dessin.
Je conclus
L’air est un gaz. Il est partout autour de nous, mais il est invisible.
On peut le voir lorsque l’on fait des bulles dans l’eau. Le vent est de l’air en mouve-
ment. Il peut faire tourner les ailes du moulin.
L’air peut être enfermé dans un ballon.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 14.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : Les élèves entourent ce qui peut être mis en mouvement par le vent.
acquises. Exercice 2 : Les élèves entourent tous les objets sauf le stylo.
Exercice 3 : Les élèves dessinent des bulles sortant du tuyau et montant à la surface
de l’eau.
Je retiens
12
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 12 11/10/2017 15:33
Le vivant
3 Les êtres vivants
Cahier
pp. 15-18
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, description, raisonnement, conclusion.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Connaître des caractéristiques du monde vivant. Comment reconnaître le monde vivant ?
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
Un être vivant se caractérise par sa capacité à se reproduire en un nouvel être vivant ayant les mêmes
caractéristiques. Ces caractéristiques sont communes à tous les êtres vivants qui sont capables de se
reproduire entre eux, et qui constituent une espèce.
Un être vivant se nourrit et respire pour assurer les besoins de son développement et de son fonctionne-
ment. Les élèves sont souvent tentés de définir le vivant par sa capacité à se déplacer, ce qui est un critère
non pertinent : un robot humanoïde, un train se déplacent et ne sont pas des êtres vivants ; un végétal
ne se déplace pas et est pourtant un être vivant.
Le cycle de vie d’un être vivant est la période qui commence par la naissance et se termine par la mort
de l’animal ou l’être humain considéré.
On notera les étapes suivantes :
– la conception et la naissance ;
– la croissance avec évolution régulière ou irrégulière ;
– la maturité qui correspond à la période où l’être vivant est en capacité de se reproduire ;
– le vieillissement et la mort.
Ce cycle de l’être vivant est souvent représenté sous forme circulaire. Cette représentation circulaire est
une représentation générale qui concerne l’espèce mais non l’individu.
Elle peut prêter à confusion et laisser croire que la vie recommence pour le même individu ; on préférera,
de ce fait, une représentation linéaire avec les générations successives.
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 15.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 15 :
– Observation D’après toi, quelles sont les étapes de la vie d’un être vivant ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves répondent à la question de la grenouille page 15 avec leurs représen-
concrètes tations.
représentées Les réponses sont d’abord notées au tableau ; un essai de classement peut alors
(photographies). être fait : ce dont on est sûr, ce sur quoi on a des questions ; ce qui est vivant, ce
– Questionnement. qui ne l’est pas.
13
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 13 11/10/2017 15:33
L’ensemble ainsi structuré est noté sur une affiche restant disponible pendant
tout le travail sur le thème. Elle sera reprise à la fin du travail pour comparer les
représentations avant et les connaissances après.
Distinguer les êtres vivants des objets fabriqués.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Les élèves observent les documents de la page 15.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document1 : que voyez-vous sur ce document ? Parmi les 3 personnages
visibles sur le document, quels sont ceux qui sont vivants, qui sont non vivants ?
Pourquoi le petit garçon au ballon n’est-il pas un être vivant ?
– Document 2 : que voyez-vous sur le document ? Que tient la petite fille ?
Peut-on la comparer au garçon au ballon du document 1 ? Pourquoi pouvez-vous
affirmer que c’est un être vivant ?
– Document 3 : que voyez-vous sur ce document ? Décrivez l’arbre. Un arbre est-il
un être vivant ? Pourquoi ? L’arbre du document est-il vivant alors qu’il n’a plus de
feuilles ? Comment l’expliquez-vous ?
– Document 4 : que voyez-vous sur le document ? Avec quoi le chien joue-t-il ? Le
chien est-il un être vivant ? Comment le manifeste-t-il dans son attitude ?
Les élèves illustrent ensuite chaque document d’une des phrases proposées.
Corrigés
Document 1 : Le garçon avec le ballon est un objet fabriqué.
Document 2 : La petite fille se repose après avoir joué au ballon.
Document 3 : L’arbre a perdu ses feuilles en hiver.
Document 4 : Le chien est un animal ; c’est un être vivant.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 16.
– Questionnement. Quelles sont les étapes de la vie d’un être vivant ?
Observation directe lors d’une sortie dans la cour et aux abords de l’école.
Repérer auparavant un certain nombre de végétaux : arbres, plantes ; d’animaux :
chien dans un jardin, chat souvent dehors ; objets en mouvement : vélo, automo-
biles… Au cours de la sortie, demander aux élèves si tel objet ou tel végétal ou tel
animal est un être vivant ; laisser émerger les représentations et les discussions
qui peuvent s’ensuivre entre élèves.
De retour en classe, noter les objets, végétaux et animaux que l’on a décrits au
cours de la sortie.
Effectuer un classement entre êtres vivants et objets non vivants.
Faire émerger quelques critères du monde vivant.
Discuter les critères qui sont admis ou contestés : le fait de se déplacer.
Quelles sont les étapes de la vie de la poule ?
Découvrir les étapes du développement d’un oiseau.
Faire décrire les étapes de la vie de la poule, illustrées par les photos page 16 en
désordre.
Associer à chaque photo l’un des six titres proposés.
Demander ensuite aux élèves de remettre dans l’ordre en numérotant chacune
des étapes.
Quelles sont les étapes de la vie de l’arbre ?
Découvrir les étapes de développement d’un végétal.
Les élèves lisent les quatre étapes de la vie d’un arbre.
Leur demander d’expliquer chacune de ces étapes : qu’est-ce que la mort d’un
végétal ? Quand un végétal est-il mort ? Prendre l’exemple d’une plante herbacée
(un pissenlit, par exemple).
Qu’est-ce que la croissance d’un végétal : croissance d’un arbre, croissance d’une
plante ?
Qu’est-ce que la germination ? Quand une plante naît, de quoi naît-elle ?
Qu’est-ce que la reproduction d’un végétal ?
Une fois les quatre termes redéfinis, les ordonner de la naissance à la mort.
Les élèves décrivent ensuite les quatre documents et les rattachent à l’une des
quatre étapes de la vie du végétal.
Les élèves inscrivent ensuite l’étape de vie sous chacun des documents page 16.
Corrigés
Exercice A : 4 – 3 – 2 – 6 – 1 – 5
Exercice B : 1 : la germination – 2 : la croissance – 3 : la reproduction – 4 : la mort.
14
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 14 11/10/2017 15:33
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 17.
– Questionnement. Quelles sont les étapes de la vie de l’être humain ?
– Synthèse des Découvrir les étapes du développement de l’être humain.
connaissances Les élèves essaient de retrouver les étapes de la vie d’un homme ou d’une femme.
acquises. Demander d’imaginer quelqu’un de très, très vieux et leur demander par quelles
étapes de la vie il (ou elle) est passé(e).
Les élèves donnent leurs réponses, probablement en désordre.
Un travail de mise en ordre est ensuite effectué.
Le rapprochement est fait avec les étapes de la vie de la poule et les étapes de la
vie d’un végétal.
Si la notion de mort n’est pas abordée, ne pas insister ; si elle l’est, du fait d’un
enfant dont un arrière-grand-parent ou grand-parent est décédé, indiquer que
lorsqu’on est très vieux, la mort est la fin de la vie, mais qu’aujourd’hui les gens
vivent jusqu’à près de 90 ans.
Les élèves réalisent ensuite le travail de la page 17 du cahier en entourant la
période correspondant à chaque étape de la vie dessinée.
Corrigés
Exercice 1 : la vieillesse – l’âge adulte – la croissance
la naissance – la croissance – la vieillesse
l’âge adulte – la croissance – la naissance
Exercice 2 : l’âge adulte – la croissance – la vieillesse – la naissance
Je conclus
Les végétaux, les animaux et les humains sont des êtres vivants. Un être vivant
connaît plusieurs étapes au cours de sa vie : il naît, grandit jusqu’à devenir adulte
et être capable d’avoir des enfants. Enfin, il vieillit et meurt.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 18.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : Les élèves entourent les dessins 2, 5 et 6.
acquises. Exercice 2 : 2 – 4 – 1 – 3
Exercice 3 : la naissance – la vieillesse – la croissance – l’âge adulte
Je retiens
15
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 15 11/10/2017 15:33
Le vivant
4 Le cycle de vie
Cahier
pp. 19-22
des animaux
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, description, raisonnement, conclusion.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Connaître des caractéristiques du monde vivant. Comment reconnaître le monde vivant ?
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
Les animaux, êtres vivants, changent au cours de leur vie en une succession de phases : naissance, crois-
sance, âge adulte, vieillissement et mort.
La croissance se caractérise par une augmentation irréversible de la taille et de la masse corporelle qui
se stabilisent au début de l’âge adulte.
Cette croissance peut être :
– continue : l’animal grandit progressivement chaque jour, avec des périodes plus ou moins rapides : c’est
le cas des mammifères et des oiseaux ;
– discontinue : l’animal passe par plusieurs étapes avec des changements de taille à chaque passage d’un
stade au suivant. C’est le cas de certains insectes : œuf, stade larvaire avec changement de taille à chaque
mue, stade de chrysalide, insecte adulte.
Dans le cas de la croissance continue, le développement peut être :
– direct : le petit ressemble à l’adulte, les mammifères et les oiseaux ;
– indirect : le jeune subit des transformations au cours de sa croissance, la grenouille par exemple.
Le passage à l’âge adulte se caractérise aussi par des transformations relevant de la différenciation sexuelle.
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 19.
initiales des élèves. – Vidéo. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 19 :
– Observation Connais-tu les grandes étapes de la vie des animaux ?
indirecte de En préalable aux leçons.
situations 1re proposition : visite d’une ferme, d’une ferme pédagogique ou d’un élevage.
concrètes L’enseignant utilisera les ressources de l’environnement (ferme, ferme pédago-
représentées gique, élevage...) pour aller observer les animaux et leurs petits.
(photographies). Au cours de cette visite, on fera décrire l’animal adulte et son petit.
– Questionnement. 2e proposition : observation d’une vidéo.
L’enseignant sensibilisera les élèves à partir de vidéos.
Il choisira une vidéo montrant la vie d’une espèce animale dans son milieu naturel.
La vie du lion dans la savane se prête bien à ce travail. On y observera le lion, la
lionne et les lionceaux, le développement et l’autonomie progressive des lionceaux.
16
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 16 11/10/2017 15:33
L’enseignant trouvera, sur Internet, des vidéos évocatrices et d’usage aisé. Il sera
attentif cependant à en vérifier la qualité.
Faire émerger les représentations initiales.
Les élèves lisent la question posée par la grenouille page 19 et y répondent collec-
tivement.
Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
organiser, de les regrouper.
Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Travail sur les documents page 19.
Remettre en ordre les étapes de développement d’un mammifère.
Les élèves observent les documents de la page 19.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Les élèves lisent les cinq étiquettes écrites en désordre.
Ils observent et décrivent les cinq étapes de la vie du lapin.
Leur faire associer l’étape de la vie du lapin et la photo correspondante en justi-
fiant.
Questionnement
À quoi voit-on qu’il s’agit de la naissance d’un lapereau ? Quelle différence obser-
vez-vous entre la phase de croissance et la phase de vieillissement ? Qu’est-il
nécessaire pour qu’il y ait reproduction ? À quoi voit-on que le lapin est mort ?
Les élèves écrivent l’étape de la vie du lapin sous chacune des photos page 19.
Corrigé
naissance – croissance – reproduction – vieillissement – mort
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 20.
– Questionnement. Comment la truite se développe-t-elle ?
Découvrir le mode de développement continu d’un poisson.
Les élèves décrivent les étapes du développement de la truite page 20 en les
remettant dans l’ordre.
Recherche de la 1re étape (photo en bas à gauche) : que voyez-vous sur cette
photo ? Qu’est-ce qui sort de l’œuf ? Quelle première ressemblance la jeune truite
a-t-elle avec la truite adulte ?
Recherche de la 2e étape (photo en haut à droite) : en quoi l’alevin ressemble
encore à l’étape 1 ? En quoi présente-t-il une ressemblance avec la truite adulte ?
Recherche de la 3e étape (photo du milieu à droite) : quelles sont les ressemblances
avec l’étape précédente ? Avec la truite adulte ?
Recherche de la 4e étape (en bas à droite) : quelle différence avec l’étape précé-
dente ? Qu’est-ce que la jeune truite a perdu ?
Recherche de la 5e étape (en haut à gauche) : décrivez la truite adulte.
Recherche de la 6e étape (au milieu à gauche) : à quoi voyez-vous que les truites
sont mortes ?
Faire observer que la truite grossit régulièrement et a des ressemblances avec la
truite adulte à chaque étape de son développement.
Les élèves numérotent seuls les 6 étapes du développement de la truite et
entourent la phrase exacte.
Corrigés
Exercice 1 : 5 – 2 – 6 – 3 – 1 – 4
Exercice 2 : La truite se développe de manière régulière.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 21.
– Questionnement. Comment le ténébrion se développe-t-il ?
– Synthèse des Découvrir le mode de développement discontinu d’un insecte.
connaissances Les élèves découvrent d’abord le ténébrion. Le ténébrion est un insecte qui se
acquises. nourrit principalement de farine ; il vit le plus souvent à l’abri de la lumière (d’où
son nom « ténébrion » venant du mot ténèbres).
Ils l’observent dans sa forme adulte sur le dessin 5 de la page 21.
Il sera possible éventuellement d’observer en continu le développement du téné-
brion si un élevage est mis en place dans la classe.
Faire décrire chaque étape du développement à partir des cinq dessins de l’exer-
cice 1 page 21.
17
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 17 11/10/2017 15:33
Questionnement
1. Que fait la femelle ténébrion adulte ?
2. Qu’est-ce qui sort de chaque œuf ?
3. En combien de fois la larve de ténébrion grandit-elle ?
4. Sous quelle forme la larve se métamorphose-t-elle ?
5. Quelle est l’étape de vie du ténébrion ?
Les élèves relient chaque dessin à son étape écrite de développement, puis
complètent le texte de l’exercice 2.
Corrigés
Exercice 1 : 1. Une femelle ténébrion pond des œufs.
2. Une larve sort de l’œuf pondu.
3. La larve grandit en plusieurs stades.
4. La larve se transforme en nymphe.
5. La nymphe se métamorphose en ténébrion adulte.
Exercice 2 : La femelle ténébrion pond jusqu’à 300 œufs.
De chaque œuf sort une larve.
La larve grandit en plusieurs stades larvaires.
La larve se transforme ensuite en nymphe. On dit qu’elle se métamorphose.
Puis, la nymphe se métamorphose enfin en un ténébrion adulte.
Le ténébrion n’a pas un cycle de vie continu comme celui du lapin ou de la truite :
il a un cycle de vie discontinu.
Je conclus
Le cycle de vie d’un animal est :
– continu quand le petit grandit et grossit régulièrement jusqu’à devenir adulte ;
– discontinu quand le petit change de forme pour devenir adulte.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 22.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : naissance – croissance – reproduction – vieillissement – mort
acquises. Exercice 2
Cycle de vie continu Cycle de vie discontinu
Mouche X
Cheval X
Thon X
Coccinelle X
Exercice 3 : un cycle de vie – une métamorphose – la larve – la nymphe
Je retiens
18
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 18 11/10/2017 15:33
Le vivant
5 Les régimes alimentaires
Cahier
pp. 23-26
des animaux
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, description, raisonnement, conclusion.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Lire et comprendre des textes documentaires illustrés.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.
Régimes alimentaires de quelques animaux.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
L’ensemble des animaux qui vivent et qui interagissent entre eux dans un même milieu (forêt, rivière,
savane, etc.) en constitue son peuplement.
Ce peuplement comprend à la fois les animaux qui vivent dans le ciel, sur terre et éventuellement dans
l’eau, si un point d’eau y est présent.
En ce cas, le point d’eau est généralement le lieu où passent tous les animaux à un moment ou à un autre.
Vivant en ce même milieu, les animaux se nourrissent des ressources qu’ils y trouvent :
– ceux qui se nourrissent de végétaux (plantes herbacées, graines, fruits, feuilles et écorce…) : animaux
végétariens ;
– les animaux qui se nourrissent à la fois de végétaux et de petits animaux tels les insectes ; animaux
omnivores ;
– les animaux qui tuent leurs proies pour se nourrir et nourrir leur progéniture : les prédateurs, animaux
carnivores.
Certains animaux sont à la fois prédateurs d’autres espèces, et sont à leur tour des proies pour des préda-
teurs secondaires.
Les animaux qui ne sont la proie d’aucune espèce sont des super-prédateurs.
Les animaux qui se nourrissent d’animaux déjà morts sont dits nécrophages ; ils ne sont pas considérés
comme prédateur, puisqu’ils ne tuent pas eux-mêmes.
Un milieu n’est donc pas une juxtaposition de végétaux et d’animaux, mais un système où les êtres vivants
sont interdépendants, la disparition d’une espèce ayant des conséquences sur les autres espèces.
19
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 19 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 23.
initiales des élèves. – Vidéos de la Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 23 :
– Observation clé USB. D’après toi, que mangent les animaux ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Observer ce que plusieurs animaux mangent et faire des hypothèses sur leurs
régimes alimentaires.
1er temps : observer les comportements alimentaires de quelques animaux.
Projection de vidéo(s), par exemple celle(s) de la clé USB associée au cahier.
Le but est de sensibiliser les élèves à la notion de peuplement et d’observer
quelques comportements alimentaires : animaux herbivores et phénomène de
prédation.
Une vidéo sur les animaux de la savane peut parfaitement bien installer le sujet
d’étude. On trouvera sur Internet de nombreux documents sur ce thème. On
prendra soin de visionner préalablement le document en veillant à ce que le docu-
mentaire ne soit pas trop explicatif pour ne pas déflorer le sujet d’étude.
Les élèves font part de leurs observations à la suite de ce temps de visionnement.
L’enseignant aidera les élèves à surmonter leurs représentations affectives et à leur
faire accepter qu’un animal soit dans l’obligation de tuer pour sa propre survie
2e temps : faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des
élèves.
Les élèves observent les documents de la page 23.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : quel animal voyez-vous sur la branche ? Que tient-il dans son
bec ? Selon vous, que mange-t-il régulièrement ? Quelle est la forme de son bec ?
En quoi cette forme allongée comme une pince pointue lui permet-elle d’attraper
facilement les insectes ?
– Document 2 : quel animal voyez-vous sur ce document ? Que fait-il ? La forme
de son bec est-elle la même que celle de l’oiseau du premier document ? Comment
doit être son bec pour qu’il arrache les graines ?
– Document 3 : quel animal voyez-vous sur le document ? Que mange-t-il ?
– Document 4 : quels sont les animaux que vous voyez sur ce document ? Pour-
quoi le guépard poursuit-il la gazelle ? Que pouvez-vous en déduire sur ce qu’il
mange ?
Les élèves relient chaque animal à son régime alimentaire.
Corrigés
Document 1 : insectes
Document 2 : graines
Document 3 : herbe
Document 4 : viande
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 24.
– Questionnement. Ces animaux sont-ils végétariens, carnivores ou omnivores ?
Définir les notions de régimes alimentaires : carnivore, végétarien, omnivore.
Faire d’abord définir les trois termes et l’expression « régime alimentaire » (ce que
l’animal mange habituellement).
Les élèves lisent le chapeau d’introduction page 24.
Leur faire émettre des hypothèses sur des animaux appartenant à chacune des
catégories.
20
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 20 11/10/2017 15:33
Questionnement : connaissez-vous des animaux qui ne mangent que des végé-
taux, des carnivores ? Lesquels ?
Connaissez-vous des animaux qui ne mangent que des végétaux ? Lesquels ?
Connaissez-vous des animaux qui mangent aussi bien des végétaux que des
animaux, des végétariens, des omnivores ? Lesquels ?
L’être humain est-il carnivore, végétarien ou omnivore ?
Lors d’une séance en salle informatique, les élèves pourront vérifier leurs hypo-
thèses en faisant des recherches sur Internet, en tapant en mots clés dans le
moteur de recherche le nom de l’animal et « régime alimentaire ».
Le travail se poursuit sur le cahier page 24.
Les élèves observent ce que mangent successivement le loup, l’ours, l’éléphant, la
chouette et le hérisson. Puis, ils complètent les phrases.
Corrigé
Le loup est carnivore.
L’ours est omnivore.
L’éléphant est végétarien.
La chouette est carnivore.
Le hérisson est omnivore.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 25.
– Questionnement. Que mangent ces animaux ?
– Synthèse des Relier l’animal à son régime alimentaire relativement à l’alimentation
connaissances disponible dans son milieu.
acquises. Présenter la situation page 25 aux élèves en indiquant que l’animal peut trouver
ces aliments-là dans le milieu où il vit, mais qu’il ne mange que les aliments qui
correspondent à son régime alimentaire.
Faire ensuite redéfinir les termes : herbivore, granivore (terme nouveau), carni-
vore, insectivore.
Les élèves barrent, dans chaque cas, les sources de nourriture qui ne corres-
pondent pas au régime alimentaire de l’animal.
Corrigé
La chèvre : barrer le lapin, le ver de terre et la fourmi.
La mésange : barrer le ver de terre et la souris.
La belette : barrer la branche, les baies et les carottes.
L’araignée : barrer les baies, la pomme de pin, le ver de terre et le lapin.
Je conclus
Un animal qui mange d’autres animaux est un carnivore. S’il ne mange que des
insectes, c’est un insectivore. Un animal qui ne mange que des végétaux est végé-
tarien. S’il ne mange que de l’herbe et des plantes, c’est un herbivore. S’il ne mange
que des graines, il est granivore. Un animal qui mange aussi bien des animaux que
des végétaux est omnivore.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 26.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigé
connaissances Carnivores Végétariens Omnivores
acquises.
Carnivores Insectivores Herbivores Granivores
le lion la grenouille le cheval la sittelle l’ours
l’aigle l’araignée la vache la souris
Je retiens
21
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 21 11/10/2017 15:33
Le vivant
1
6 Les graines des végétaux
Cahier
pp. 27-30
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
Imaginer, réaliser : domaine 5
Observer des situations d’activités de la vie quotidienne.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
Se situer dans l’espace et dans le temps : domaine 5
Construire des repères temporels.
8 Connaissances et compétences associées
Comment reconnaître le monde vivant ?
Connaître des caractéristiques du monde vivant.
Développement d’animaux et de végétaux.
Le cycle de vie des êtres vivants.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
On appelle croissance d’un végétal l’ensemble des étapes de son développement, du moment où la graine
est définitivement formée à la mort de la plante.
Si la graine contient tout le matériel génétique et les réserves nutritives nécessaires, la germination ne se
produit que lorsque les conditions, notamment de chaleur et d’humidité, lui sont favorables.
Elle est souvent contenue dans un fruit qui permet sa dissémination.
Le tégument est l’enveloppe de la graine. Durant la période de dormance qui peut être longue, jusqu’à
plusieurs années, il empêche la germination en constituant une barrière imperméable.
La germination est la reprise du processus végétatif de la graine au contact de l’eau et lorsque les condi-
tions de température sont réunies.
On observe alors un éclatement du tégument qui ne remplit plus son rôle de barrière protectrice.
Le germe se développe et grossit faisant éclater les cotylédons. La radicule apparaît : elle constitue
l’ébauche de la racine principale. Les deux premières feuilles sortent progressivement.
On distingue plusieurs formes de graines : les graines contenues dans des gousses (haricot, petits pois),
les pépins (pommes, poires, tomates), les noyaux (cerises, pêches)…
Les graines étant riches en matières nutritives, elles constituent une source d’alimentation recherchée
par les animaux.
22
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 22 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 27.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 27 :
– Observation D’après toi, qu’est-ce qu’une graine ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Les élèves observent les documents de la page 27.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant. Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Comment se compose la fleur
de pissenlit ? Que font les graines de pissenlit ? Qu’est-ce qui permet aux graines
de pissenlit de s’envoler ? Pourquoi dit-on que les graines de pissenlit ressemblent
à des hélicoptères ?
– Document 2 : comment la graine de pissenlit s’est-elle développée ? Où les
feuilles sont-elles attachées ? Décrivez la forme générale d’une feuille. Vous
pouvez la dessiner sur votre cahier de brouillon.
– Document 3 : que voyez-vous sur le document ? Qu’est-ce qui a poussé en
comparaison avec l’étape 2 de développement ? Quel est le rôle des fleurs de
pissenlit ? Quels animaux vont de fleur en fleur ?
– Document 4 : comment la fleur de pissenlit s’est-elle transformée ? Qu’a-t-elle
perdu ? Que s’est-il formé ? Que donnera chaque graine lorsqu’elle s’envolera ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 27.
Corrigés
Phrases non barrées
Document 1 : C’est le vent qui permet aux graines de s’envoler.
Document 2 : En germant la graine donne d’abord plusieurs feuilles vertes.
Document 3 : Les fleurs de pissenlit servent à sa reproduction.
Document 4 : Les fleurs de pissenlit se transforment en graines.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 28.
– Expérimentation. – Graines Qu’est-ce qu’une graine ?
de lentilles, Les élèves pourront mettre en place l’expérience en plantant, dans plusieurs réci-
coquillettes, pients remplis de terre, des graines de lentilles, des coquillettes, des graines de
graines de radis (et d’autres graines éventuellement : haricots…).
radis... Chaque pot sera arrosé régulièrement.
– Pots remplis Ils constateront que, dans deux pots, il y a germination et que, dans le troisième,
de terre. rien ne se passe (celui des coquillettes).
On les amènera à conclure que les coquillettes ne sont pas des graines,
puisqu’elles ne donnent pas de plante.
Le travail se poursuit sur le cahier page 28. Les élèves entourent les phrases
exactes de l’exercice 2.
Corrigé
Les lentilles germent et deviennent des plantes. Ce sont des graines.
Le radis pousse à partir d’une graine.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 29.
– Questionnement. Sous quelle forme se présente la graine ?
– Synthèse des Faire appel aux connaissances des élèves avec les questions : sous quelle forme
connaissances se présente la graine dans l’orange, le citron, le raisin… ? Sous quelle forme se
acquises. présente la graine dans une pêche, une cerise… ? Quelle est la différence entre
ces deux formes de graines : les pépins et les noyaux ?
23
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 23 11/10/2017 15:33
Le noyau est la seule graine du fruit ; les pépins sont en nombre dans le fruit.
Si on en a la possibilité, demander aux élèves d’apporter des pépins et des noyaux
de fruits qu’ils auront mangés à la maison.
Au retour en classe, les observer et les décrire.
Leur montrer en photo des gousses de haricot ou de petit pois. Les décrire.
Les élèves classent les graines des fruits dessinés en page 29.
Corrigé
Les fruits Les fruits Les fruits à graines
avec un noyau avec des pépins (gousse)
l’avocat – la pêche – la le citron – la tomate – la les haricots – les petits
cerise – la prune poire – la pomme pois
Je conclus
Les graines de la fraise, de la tomate et de la pomme sont des pépins.
La graine de l’avocat et celle de la pêche sont des noyaux.
Une nouvelle plante naît lorsque la graine germe.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 30.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigé
connaissances Exercice 1 : Barrer les bonbons et les cailloux.
acquises.
Je retiens
24
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 24 11/10/2017 15:33
Le vivant
7 La croissance du corps
Cahier
pp. 31-34
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une ques-
tion.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
Mobiliser des outils numériques : domaine 2
Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des informations
simples.
Adopter un comportement éthique et responsable : domaines 3 et 5
Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une attitude
raisonnée fondée sur la connaissance.
Se situer dans l’espace et dans le temps : domaine 5
Construire des repères temporels.
8 Connaissances et compétences associées
Mesurer et observer la croissance de son corps.
Croissance (taille, masse, pointure).
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
Dès la naissance, le corps humain commence sa croissance.
L’enfant grandit beaucoup au cours de la première année : jusqu’à 25 cm. La croissance est ensuite plus
lente, 4 à 6 cm par an jusqu’à la puberté.
La puberté constitue un second pic de croissance. L’adolescent grandit jusqu’à 10 cm par an pendant
deux ans environ.
Toutes les parties du corps grandissent, mais pas forcément simultanément. Au moment de l’adolescence,
les pieds grandissent d’abord à un rythme rapide ; ce sont ensuite les jambes, les bras puis la colonne
vertébrale.
La croissance se termine avec la fin de la puberté, à l’âge adulte.
Le sommeil est un élément déterminant d’une bonne croissance de l’enfant. Pendant qu’il dort, le corps
produit une hormone qui favorise une croissance normale.
25
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 25 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 31.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 31 :
– Observation À quoi vois-tu que tu grandis ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Constater par comparaison la croissance du corps.
Les élèves observent les documents de la page 31.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur la photo ? Selon vous, pourquoi les deux
enfants n’ont-ils pas la même taille ? Lequel des deux est le plus âgé ?
– Document 2 : où la photo a-t-elle été prise ? Que voit-on imprimé sur le sable ?
Selon vous, pourquoi y a-t-il un petit pied et de grands pieds ? L’enfant a un petit
pied ; quand aura-t-il un pied aussi grand que son père ?
– Document 3 : que voyez-vous sur ce document ? À qui appartiennent ces
mains ? Comment expliquez-vous que les mains de dessous sont plus grandes que
les mains du haut ? Les mains de l’enfant ont-elles leur taille définitive ? Quelle
taille auront-elles quand l’enfant deviendra adulte ?
– Document 4 : que voyez-vous sur le document ? Que pouvez-vous dire de la
taille de l’enfant par rapport à la taille de son père ? Que pouvez-vous dire de la
taille de son bras par rapport à la longueur du bras de son père ?
Quelles sont toutes les parties du corps observées sur ces quatre documents qui
grandiront toutes jusqu’à l’âge adulte ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 31.
Corrigés
Phrases entourées
Document 1 : L’un de ces enfants a deux ans de plus que l’autre.
Document 2 : Le pied de l’enfant est plus petit que celui de l’adulte.
Document 3 : Les mains de l’enfant grandiront.
Document 4 : Quand l’enfant grandira, son bras grandira aussi.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 32.
– Questionnement. Comment grandit-on ?
Travail sur le cahier de l’élève exercice A page 32.
Comment Lisa a-t-elle grandi ?
Découvrir le moyen de mesurer sa taille et l’évolution de la taille.
Les élèves observent les dessins du même enfant à des âges différents.
Leur faire remarquer la façon de mesurer sa taille en hauteur.
Faire repérer sur la toise l’âge qui a été indiqué, le reporter sous chaque dessin
de l’enfant.
Corrigé
11 ans – 7 ans – 3 ans – 9 ans – 1 an
Travail sur le cahier de l’élève exercice B page 32.
Les jambes grandissent-elles ?
Amener les élèves à constater que plus on grandit, plus la longueur des jambes
de pantalon est longue.
Leur poser pour cela la question : qu’observez-vous sur vos pantalons quand vous
grandissez ? Qu’est-ce que vos parents sont obligés de faire ?
26
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 26 11/10/2017 15:33
Les élèves complètent l’exercice en donnant à chaque âge de l’enfant le pantalon
qui lui convient.
Corrigé
2 ans – 4 ans – 6 ans – 8 ans
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 33.
– Questionnement. Comment grandit-on ?
– Synthèse des Travail sur le cahier de l’élève exercice C page 33.
connaissances Les pieds grandissent-ils ?
acquises. Demander aux élèves ce que deviennent leurs chaussures quand ils grandissent ?
Qu’est-il nécessaire de faire alors ?
Les élèves complètent le dessin de l’exercice C en reliant la paire de chaussures
correspondant à chaque moment de la croissance.
Corrigé
3 ans – naissance – 9 ans – 7 ans
Travail sur le cahier de l’élève exercice D page 33.
Les mains grandissent-elles ?
Les élèves effectuent un travail identique en notant l’âge sous chaque empreinte
de main.
Si des élèves ont fait cette empreinte à l’école maternelle et que leurs parents l’ont
gardée, une empreinte refaite au CE1 permettra de comparer.
Amener les élèves à conclure que lorsque l’enfant grandit, il grandit en taille, et
toutes les parties de son corps grandissent.
Corrigé
5 ans – 8 ans – 7 ans – 6 ans – 9 ans
Je conclus
Le corps grandit régulièrement de la naissance jusqu’à l’âge adulte.
C’est le moment de la croissance.
Chaque partie du corps grandit : les mains, les pieds, les jambes...
Deux situations d’observation concrète en continu pourront être mises en place.
1re proposition : prendre conscience de la croissance en taille.
Mettre en place dès le début de l’année une feuille murale de repérage de la taille
de quelques enfants : le plus petit garçon et la plus petite fille ; le plus grand
garçon et la plus grande fille.
Montrer aux élèves comment repérer avec un livre posé sur la tête (position du
livre sur la tranche).
Montrer la nécessité de marquer le prénom de l’enfant et la date.
2e proposition : découvrir que toutes les parties du corps grandissent.
La situation est d’abord faite avec un élève, puis par tous les élèves en travaillant
en binôme.
L’élève tend le bras sur le côté.
Tendre une ficelle entre le pli de l’aisselle et la couper à l’extrémité de la main.
Cette situation sera reprise à plusieurs moments de l’année.
L’élève découvrira qu’à chaque fois la ficelle précédemment mesurée est devenue
trop petite.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 34.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigé
connaissances Exercice 2 : faux – vrai – vrai – faux – vrai
acquises.
Je retiens
27
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 27 11/10/2017 15:33
Le vivant
8 La dentition
Cahier
pp. 35-38
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
Adopter un comportement éthique et responsable : domaines 3 et 5
Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une attitude
raisonnée fondée sur la connaissance.
8 Connaissances et compétences associées
Reconnaître des comportements favorables à sa santé.
Modifications de la dentition.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
La dentition joue un rôle important dans le processus de digestion. Elle permet d’effectuer une première
transformation mécanique des aliments ingérés. Les dents se répartissent sur les deux mâchoires infé-
rieure et supérieure, et de façon symétrique de gauche à droite.
On distingue trois types de dents :
– les incisives : 4 sur chaque mâchoire, soit 8 au total, en avant de chaque mâchoire ; elles servent à
couper et à trancher les aliments ;
– les canines : 2 par mâchoire, soit 4 au total ; elles permettent d’arracher les aliments ; ce sont les dents
les plus solidement implantées ;
– les molaires : 10 sur chaque mâchoire pour les adultes, soit 20 au total ; elles servent à broyer les
aliments.
L’enfant n’a, lui, que 4 molaires sur chaque mâchoire, soit 8 au total, pour un total général de 20 dents,
l’adulte en ayant 32.
La première dentition est une dentition provisoire que l’on nomme des dents de lait. Elles sont rempla-
cées entre 7 et 8 ans par des dents définitives.
Au vu de l’importance de la dentition dans le processus de digestion, le soin des dents est capital.
Les dents peuvent être attaquées par des caries, trous dans la dent, provoquées par des micro-organismes.
En absorbant les sucres, ces micro-organismes produisent des produits acides qui détruisent l’émail des
dents.
La consommation excessive de sucre est, de ce fait, un facteur négatif à limiter strictement.
Le brossage des dents doit être fait avec beaucoup de soin : l’idéal serait qu’il soit fait après chaque repas,
ce qui peut paraître difficilement réalisable le midi. En tout cas, il doit être effectué le matin, après le
petit déjeuner, et le soir, après le dîner.
Le brossage doit être fait avec beaucoup de soin, à la fois devant, derrière et sur les dents. Certains recom-
mandent une durée de trois minutes pour un bon brossage.
Il est ensuite important de consulter le dentiste deux fois par an, de manière à vérifier qu’aucun démar-
rage de carie n’apparaît.
28
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 28 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 35.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 35 :
– Observation À quoi servent tes dents ? Comment les garder en bonne santé ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Observer la dentition, expliquer la perte des dents de lait, découvrir
concrètes la notion de soins aux dents.
représentées Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
(photographies). Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
– Questionnement. organiser, de les regrouper.
Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Les élèves observent les documents de la page 35.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Que mange cette enfant ?
Quelles sont les dents qu’elle utilise pour croquer dans la fraise ? À quoi servent
ces dents ?
– Document 2 : qu’est-il arrivé à l’enfant ? Pourquoi a-t-elle perdu des dents ?
D’autres dents pousseront-elles à la place ? Comment appelle-t-on les dents qui
tombent vers 7 ans ?
– Document 3 : que voyez-vous sur ce document ? Pourquoi faut-il se brosser
les dents ? Quelles sont les dents que l’enfant brosse ? Quelle partie des dents
brosse-t-elle ? Pourquoi ?
– Document 4 : que voyez-vous sur le document ? Quelles sont les deux
personnes présentes ? Qui est la personne qui a des gants ? Quels outils utilise le
dentiste ? Quel usage en fait-il ? Pourquoi va-t-on chez le dentiste ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 35.
Corrigés
Document 1 : Les dents de devant servent à couper les aliments.
Document 2 : Lorsqu’une dent de lait est tombée, la dent définitive repousse à la
même place.
Document 3 : Il faut se brosser les dents après chaque repas. Cela permet de proté-
ger les dents et d’éviter l’apparition de caries.
Document 4 : C’est le dentiste qui soigne les dents.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 36.
– Questionnement. – 1 pomme Quelles sont les différences entre la dentition de lait de l’enfant et la dentition
pour 4 enfants, définitive de l’adulte ?
des morceaux Comprendre le rôle de chaque type de dent ; découvrir la différence entre
de pain. la dentition enfant et la dentition adulte.
Observer l’usage de chaque type de dents dans un processus de mastication.
Il faudrait disposer d’une pomme pour quatre enfants et de quelques morceaux
de pain.
Demander aux élèves de croquer dans le morceau de pomme et de regarder la
trace que les dents y ont faite.
Demander ensuite qu’ils mastiquent lentement en essayant de sentir quelles dents
ont agi et dans quel ordre, pour quel usage.
En ce qui concerne la pomme, les élèves sentiront que les dents de devant ont
coupé la pomme, que le morceau circule en étant déchiqueté par les canines, puis
broyé en fond de mâchoire par les molaires.
Refaire ensuite la même chose avec le morceau de pain.
Les élèves sentiront le rôle des canines (d’une canine) qui arrache en même temps
que l’élève tire le morceau de pain à l’opposé.
29
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 29 11/10/2017 15:33
Observer les dents à l’intérieur de la bouche.
Les élèves se mettent en binômes. À tour de rôle, ils observent la dentition de
l’autre enfant. Ils repèrent les différents types de dents. Ils les comptent. Ils
observent les dents qui sont tombées et les dents définitives qui peuvent éven-
tuellement pointer.
Les élèves effectuent les exercices de la page 36 du cahier de l’élève.
Corrigés
Exercice 2 : Les élèves complètent le tableau avec le nombre de dents qu’ils ont
comptées lors de l’observation directe (généralement, 8 incisives, 4 canines et
8 molaires, au total 20 dents).
Exercice 3 : Les élèves observent la mâchoire adulte, repèrent les dents et les
comptent : 8 incisives, 4 canines et 20 molaires, soit 32 dents.
Exercice 4 : Les premières dents sont provisoires. Elles vont tomber vers 7-8 ans.
Les dents adultes sont définitives. Ce sont les dents que l’on garde tout le reste de
la vie.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 37.
– Questionnement. Comment prendre soin de ses dents ?
– Synthèse des Quelles sont les sources de caries ?
connaissances Demander aux élèves ce qui abîme les dents.
acquises. Quels sont les produits sucrés qui risquent d’abîmer les dents ? Que faut-il faire
si on a mangé des sucreries ?
Repérer, dans l’exercice 1 de la page 37, les aliments qui sont susceptibles de
donner des caries si on en abuse.
Comment bien se laver les dents ?
Une séance de brossage des dents peut être organisée en début d’après-midi.
Demander préalablement aux élèves d’apporter leur brosse à dents et leur
dentifrice.
Décomposer chaque étape : le devant des dents, en haut, en bas ; le dessus des
dents, en haut, en bas ; l’arrière des dents, en haut, en bas… tout cela en veillant
bien à un brossage entre les dents.
Les élèves répondent à la consigne de l’exercice 2 de la page 37.
Corrigés
Exercice 1 : Barrer la bouteille de cola, le paquet de bonbons, les morceaux de
sucre, les sucettes, le lapin en chocolat et le gâteau.
Exercice 2 : Je brosse mes dents du haut et du bas, sur le dessus et le devant,
pendant 3 minutes.
Je conclus
Nous avons trois types de dents : les incisives qui coupent, les canines qui déchirent,
et les molaires qui écrasent les aliments.
La mâchoire de l’enfant est composée de dents provisoires qui tombent entre 6 et
8 ans. Pour prendre soin de ses dents, il faut se brosser les dents après chaque repas,
ne pas manger trop de sucreries et consulter le dentiste tous les 6 mois.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 38.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigé
connaissances Exercice 1 : Après le petit déjeuner.
acquises. Après le repas de midi.
Avant de me coucher.
Exercice 2 : Entourer la brosse à dents, le tube de dentifrice et le verre rempli d’eau.
Exercice 3 : Colorier : 3 fois par jour, après avoir mangé, pour éviter les caries.
Je retiens
30
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 30 11/10/2017 15:33
Le vivant
9 Les aliments
Cahier
pp. 39-42
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, description, raisonnement, conclusion.
Imaginer, réaliser : domaine 5
Observer des situations d’activités de la vie quotidienne.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
Adopter un comportement éthique et responsable : domaines 3 et 5
Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une attitude
raisonnée fondée sur la connaissance.
8 Connaissances et compétences associées
Reconnaître des comportements favorables à sa santé.
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie : variété alimentaire.
– Catégories d’aliments, leur origine.
– Les apports spécifiques des aliments (apport d’énergie : manger pour bouger).
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES
L’alimentation est un élément important de l’état de santé.
L’être humain a besoin d’aliments pour sa croissance et pour le renouvellement de ses cellules.
Il lui faut de l’énergie pour l’ensemble du fonctionnement du corps, toutes les activités qu’il peut pratiquer
au cours d’une journée, mais aussi la nuit, le corps n’étant jamais totalement au repos.
Il faut aussi des aliments qui apportent des défenses à l’organisme, vitamines, et des sels minéraux qui
régulent le fonctionnement du corps.
Il faut donc une alimentation qui réponde à l’ensemble de ces besoins.
On distingue les aliments bâtisseurs (viande, poisson, produits laitiers...) ; les aliments fournissant l’éner-
gie (pain, pâtes, pommes de terre, sucres, matières grasses…) ; les aliments qui protègent (fruits frais,
légumes…) ; les matières grasses qui permettent de constituer l’enveloppe des cellules.
On classe les aliments en six catégories :
– les viandes, œufs, poissons : ce sont des protéines qui servent à bâtir ; à consommer 1 ou 2 fois par jour ;
– les produits laitiers : ce sont aussi des protéines, ils sont importants dans l’apport du calcium nécessaire
à la constitution des os ; à consommer 3 ou 4 fois par jour ;
– les féculents, pommes de terre, pâtes, riz, céréales : ce sont des glucides qui apportent l’énergie au
corps ; il est préconisé d’en manger à chaque repas ;
– les fruits et légumes dont il est conseillé de manger 5 portions par jour ; ils ont pour effet de faciliter
le transit intestinal ;
– les boissons sachant que l’eau est la boisson strictement recommandée, à consommer à volonté ;
– les produits gras, sucrés et salés sont eux à consommer avec modération.
31
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 31 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 39.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 39 :
– Observation À quoi sert de manger ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille page 39 et y répondent collec-
concrètes tivement.
représentées Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
(photographies). organiser, de les regrouper.
– Questionnement. Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Observer comment se nourrir suivant son âge et ses activités ; découvrir une
catégorie d’aliments : les féculents.
Les élèves observent les documents de la page 39.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Quels sont les deux person-
nages ? Que fait la maman ? Que contient le biberon ? Comment le bébé fait-il
pour manger ? Pourquoi mange-t-il ?
– Document 2 : que voyez-vous sur le document ? Quel sport pratique cette
personne ? Que mange-t-elle ? Pourquoi mange-t-elle pendant son match ?
– Document 3 : que voyez-vous sur le document ? Que font ces deux enfants ?
Quels sont les aliments dont ils disposent pour leur petit déjeuner ? Pourquoi
le petit déjeuner est-il un repas important de la journée ? Que mangez-vous au
petit déjeuner ?
– Document 4 : que voyez-vous sur ce document ? Quels sont les aliments que
vous reconnaissez ? Citez tous les féculents que vous mangez habituellement.
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 39.
Corrigés
Document 1 : Le lait est l’aliment du bébé. Le bébé doit manger pour avoir l’énergie
nécessaire à sa croissance.
Document 2 : Le sportif mange une banane.
Il se nourrit car il pratique une activité physique qui demande de l’énergie.
Document 3 : Le petit déjeuner est important avant l’école car il donne de l’énergie
pour toute la matinée de travail.
Il est composé de lait, jus de fruit, pain ou croissants, céréales.
Document 4 : Les pâtes, le riz, les pommes de terre, les lentilles, le pain, les pois
chiches sont des féculents.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 40.
– Questionnement. Comment classer les aliments que l’on mange ?
Découvrir la classification des aliments.
Faire l’inventaire des aliments connus des élèves, catégorie par catégorie.
Demander aux élèves de rappeler les féculents qu’ils connaissent et qu’ils ont
repérés dans la séance précédente : pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, pain.
Leur demander ensuite de lister tous les fruits et légumes qu’ils peuvent être
amenés à consommer.
Leur indiquer que le beurre, l’huile et la margarine sont des matières grasses ; leur
demander ce que sont les matières grasses.
Leur demander les produits laitiers qu’ils connaissent, et avec quel produit ils
sont fabriqués.
Reconstituer la marguerite des catégories d’aliments.
Dans l’exercice 1 de la page 40, les élèves reconnaissent d’abord les féculents et les
entourent en rejoignant le rond central.
Ils font la même chose successivement pour chacune des catégories d’aliments.
32
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 32 11/10/2017 15:33
Dans l’exercice 2 de la page 40, les élèves font l’inventaire de ce qu’ils ont mangé
au cours de la journée précédente et identifient s’ils ont mangé de toutes les caté-
gories ou si certaines catégories manquaient.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 41.
– Questionnement. D’où proviennent les aliments ?
– Synthèse des Émettre des hypothèses sur des aliments que les élèves ont mangés à la cantine.
connaissances Leur demander d’où viennent les aliments qu’ils ont mangés : le fruit de la fin du
acquises. repas, les tomates de l’entrée, les œufs de l’omelette…
On pourra prolonger avec d’autres aliments et, éventuellement, faire une
recherche sur Internet lorsqu’on ne sait pas répondre, soit en salle informatique,
soit sur l’ordinateur présent dans la classe.
Les élèves réalisent l’exercice de la page 41 en joignant l’aliment à son origine.
Corrigé
Cuisse de poulet → poule
Sauce tomate → tomates
Œufs → poule
Huile d’olive → olives
Lait → vache
Pain → blé
Je conclus
Les aliments peuvent être classés en 7 familles :
– les féculents comme les pâtes et les pommes de terre ;
– les viandes, poissons et œufs ;
– les fruits et légumes ;
– les matières grasses comme le beurre et l’huile ;
– les produits laitiers comme les fromages et les yaourts ;
– les produits sucrés comme la confiture et les bonbons ;
– et les boissons.
Les aliments peuvent être d’origine animale comme les œufs ou d’origine végétale
comme le pain.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 42.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigé
connaissances Exercice 1 : Barrer les haricots verts, le fromage et l’œuf.
acquises. Exercice 2 : Tomates en salade (famille végétaux), cuisse de poulet (famille animaux),
riz (famille féculents), yaourt (famille lait), pomme (famille végétaux), eau (famille
boissons).
Exercice 3 : animale – végétale
végétale – animale
végétale – animale
Je retiens
33
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 33 11/10/2017 15:33
Les objets techniques
10 Des activités et leurs outils Cahier
pp. 43-46
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, description, raisonnement, conclusion.
Imaginer, réaliser : domaine 5
Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.
Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.
Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction.
Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques.
2 NOTIONS TECHNOLOGIQUES
La découverte et l’utilisation des outils ont été décisives dans l’évolution des êtres humains.
L’outil est un objet qui prolonge la main ; il est perçu par le cerveau comme si le bras était plus long (ainsi
la perception du menuisier avec son marteau lui permet de frapper le clou sans même le regarder).
Un outil est un instrument conçu et fabriqué par l’Homme pour un travail particulier à accomplir, une
fonction précise
L’outil est la réponse au problème d’une tâche que la main seule n’est pas capable de réaliser.
Dans leur principe de fonctionnement, les outils sont restés semblables à ceux que l’on utilisait autrefois.
L’évolution des techniques a permis le plus souvent de remplacer l’énergie musculaire par l’énergie électrique
utilisée par le moteur de l’outil. À titre d’exemple, une perceuse manuelle ou une chignole pour percer des
trous est aujourd’hui remplacée par une perceuse électrique tenue en main par le bricoleur.
L’évolution nouvelle amène même aujourd’hui à robotiser l’action de l’outil : pour notre exemple, le
perçage industriel se fait sans l’intervention d’un ouvrier, par positionnement mécanique de l’objet à
percer et du perçage électrique.
Mais dans tous les cas, le principe reste le même : une mèche qui tourne et perce à grande vitesse.
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 43.
initiales des élèves. – Des noix, un Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 43 :
– Observation casse-noix. Quels outils sont souvent associés aux métiers ou à certaines activités ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
34
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 34 11/10/2017 15:33
À quoi sert un outil ? Observation directe.
Découvrir la notion d’outil comme prolongement de la main pour une tâche
où la main n’est pas suffisante.
Prendre conscience de l’outil comme prolongement de la main.
Avoir quelques noix, et un casse-noix que l’on garde dissimulé dans un premier
temps.
Demander aux élèves comment casser la coquille pour manger la noix, sans utili-
ser les dents pour ne pas les abîmer.
Les élèves constateront qu’ils ne peuvent pas y parvenir avec la main seule.
Ils seront amenés à deux types de propositions : frapper la coquille avec un objet
lourd ou utiliser un outil qui pourrait faire comme les dents pour écraser la
coquille.
Leur demander quelle est la fonction de l’objet dont ils se sont ainsi servis et quel
a été son effet sur la coquille de la noix.
Prendre conscience de l’outil dans la vie quotidienne.
Rechercher des actions qu’on ne peut pas faire avec la main et qui nécessitent
l’usage d’un outil (préciser de quel outil il s’agit).
Proposer aux élèves de faire un classement des outils ainsi nommés ; ce classe-
ment dépendra des situations et outils nommés : couper, pincer, frapper…
Mise en relation de l’outil et de l’activité professionnelle. Découvrir des métiers
et les outils utilisés.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Les élèves observent les documents de la page 43.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Selon vous, quel est le métier
de cette personne ? Sur quels matériaux travaille-t-elle ? Quels sont les outils et
objets dont elle se sert ? Quelle protection la protège de la scie circulaire ?
– Document 2 : que voyez-vous sur le document ? Quel est le métier de cette
personne ? Quels outils utilise-t-elle ? Qu’utilise-t-elle pour se protéger ?
– Document 3 : que voyez-vous sur le document ? Quel est le métier de la
personne de gauche ? Quel outil utilise-t-elle ? À quoi sert ce stéthoscope ?
– Document 4 : que voyez-vous sur le document ? Où se passe la scène ? À quoi
sert la machine que vous voyez sur la droite ? À quoi sert le tracteur ? Quel métier
utilise ce type de matériel ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 43.
Corrigés
Document 1 : Entourer le crayon, le mètre et la scie circulaire.
Document 2 : Elle est peintre en bâtiment.
Elle a besoin d’un escabeau, d’un rouleau à peinture et de peinture.
Document 3 : Entourer le stéthoscope.
Document 4 : Entourer agriculteur.
La moissonneuse sert à récolter le blé. Le tracteur sert à transporter le blé.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 44.
– Questionnement. – Vidéo de la Quels outils sont utiles aux pompiers ?
clé USB S’interroger sur la fonction des objets et outils professionnels dans un cadre
professionnel.
Proposer aux élèves de parler des pompiers et des outils qu’ils utilisent.
Demander aux élèves quelles sont les tâches des pompiers, quel danger ils
courent, quel matériel ils utilisent pour combattre les incendies ou sauver des
gens dans des accidents, quel matériel ils utilisent pour se protéger.
Observer une vidéo montrant les pompiers en action : clé USB ou document
accessible et vérifié sur Internet.
À l’issue de la vidéo, les mêmes questions pourront être proposées pour que les
réponses soient approfondies : quel est le rôle du casque, de la tenue ? Quels outils
ont-ils repérés ? Quel usage a été fait de ces outils ?
Les élèves répondent ensuite aux questions de la page 44 du cahier.
Corrigés
Exercice 1 Le casque protège la tête et le visage du pompier pour qu’il ne soit pas
brûlé par l’incendie.
35
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 35 11/10/2017 15:33
Il porte un blouson en cuir ou en matériau ininflammable pour que son corps ne
ressente pas la chaleur de l’incendie.
Il porte une bouteille à oxygène dans le dos pour pouvoir respirer, l’incendie
rendant l’air irrespirable.
Nota : la bouteille contient un mélange et non de l’oxygène pur.
Exercice 2 : La lance, le tuyau et le camion pour projeter de l’eau pour éteindre
l’incendie.
La grande échelle pour atteindre les étages pour évacuer les habitants et projeter
l’eau en hauteur.
La camion-ambulance pour soigner, puis transporter les blessés.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 45.
– Questionnement. – Différents Quels outils sont utilisés pour une activité en particulier ?
– Synthèse des outils : sécateur, Attribuer une série d’outils à la profession qui lui correspond.
connaissances marteau, fouet Observation d’outils amenés en classe.
acquises. de cuisine... Amener en classe quelques outils correspondant à des usages ou métiers diffé-
rents, par exemple : un sécateur, un marteau ; un fouet de cuisine...
Pour chacun, demander aux élèves de nommer l’objet, de dire à quoi il sert, à quel
type de métier il s’adresse.
Les élèves observent les catégories d’outils présentés sur la page 45 du cahier.
Pour chacun, ils nomment les outils présentés et en décrivent l’usage.
Les élèves répondent aux questions de la page 45.
Corrigés
Exercice 1 :
– Ces outils sont utilisés pour jardiner.
L’outil qui sert à creuser la terre est une pelle (pelle-bêche).
La brouette est un outil qui sert à transporter des feuilles, de la terre...
L’arrosoir est un outil qui sert à mettre de l’eau dans les plantes.
– Ces outils sont utilisés pour cuisiner.
Le hachoir est un outil qui sert à hacher la viande en petits morceaux.
Le batteur est un outil qui sert à monter les blancs en neige.
La passoire est l’outil qui sert à égoutter les pâtes ou les légumes.
Exercice 2 : La scie, le marteau, le mètre, le serre-joint… C’est le matériel du
menuisier.
La pince coupante, le tournevis, les fils électriques, le ruban adhésif isolant… C’est
le matériel de l’électricien.
Je conclus
Chaque métier ou activité utilise des outils particuliers.
Chaque outil a sa fonction : il a été fabriqué dans un but précis.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 46.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : pompier – lance à incendie ; menuisier – scie ; médecin – stéthoscope ;
acquises. cuisinier – robot mixer
Exercice 2 : stéthoscope – écouter les battements du cœur ; lance à incendie –
éteindre un incendie en l’arrosant ; robot mixer – hacher la viande ; scie – scier les
planches de bois
Je retiens
36
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 36 11/10/2017 15:33
Les objets techniques
11 Fabriquer un bateau Cahier
pp. 47-50
propulsé
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
Imaginer, réaliser : domaine 5
Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.
Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Adopter un comportement éthique et responsable : domaines 3 et 5
Mettre en pratique les premières notions d’écogestion de l’environnement par des actions simples indivi-
duelles ou collectives : gestion de déchets, du papier, économies d’eau et d’énergie (éclairage, chauffage...).
8 Connaissances et compétences associées
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.
Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air).
Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air.
2 NOTIONS TECHNOLOGIQUES
Deux démarches technologiques peuvent être mises en œuvre.
La première consiste à réaliser un objet déjà conçu et déjà décrit, et le fabriquer en respectant les étapes
pas à pas. Cette démarche est celle que l’on retrouve couramment lorsque l’on achète un objet en kit, la
fiche de fabrication décrivant l’ordre des étapes et la procédure à appliquer à chaque étape de la fabri-
cation.
La seconde consiste à concevoir et à fabriquer un objet technologique destiné à une utilisation précise.
Il faut d’abord déterminer l’usage auquel on le destine et en définir le cahier des charges : le besoin.
Le cahier des charges définit les contraintes à respecter, les fonctions de chacune des parties qui doivent
composer l’objet...
Il faut ensuite réaliser un avant-projet visant à donner une première image concrète de l’objet, avec prise
en compte des différentes fonctions attendues et des sous-systèmes entrant dans la conception de l’objet.
Cette phase doit être suivie du choix des matériaux (et pour le projet-école, le choix de matériaux de
récupération ou d’usage courant).
Vient ensuite la phase de fabrication. Au cours de cette phase, les sous-fonctions sont testées, évaluées
et modifiées en fonction des résultats observés.
Au cours de la dernière phase de mise en situation, l’objet réalisé est testé et comparé aux contraintes
du cahier des charges.
37
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 37 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 47.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 47 :
– Observation Comment concevoir et construire un bateau qui avance avec une énergie
indirecte de renouvelable ?
situations Faire émerger les représentations initiales.
concrètes Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
représentées Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
(photographies). organiser, de les regrouper.
– Questionnement. Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Décrire des objets flottants et leur mode de propulsion.
Les élèves observent les documents de la page 47.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Comment est composé l’objet
flottant ? Quelle qualité la planche doit-elle avoir ? Quelle est la partie qui lui sert
à avancer ? Quelle énergie le surfeur utilise-t-il pour avancer ?
– Document 2 : que voyez-vous sur le document ? Comment cette embarcation
peut-elle flotter ? Quel moyen de déplacement permet au pédalo de se mouvoir ?
– Document 3 : que voyez-vous sur ce document ? Comment le canot avance-t-il ?
Combien de personnes transporte-t-il ?
– Document 4 : que voyez-vous sur ce document ? Où la scène se passe-t-elle ?
Quelle différence y a-t-il entre cette rivière et l’eau de la mer du document 1 ?
De quoi l’homme se sert-il pour faire avancer son canot ? Que porte-t-il pour se
protéger ? Pourquoi ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 47.
Corrigés
Ne pas barrer les phrases suivantes.
Document 1 : La planche flotte sur la mer. Le vent pousse la voile.
Document 2 : Pour faire avancer le pédalo, il faut pédaler.
Document 3 : Ces personnes sont sur une embarcation gonflable.
Le bateau avance car il est remorqué par un bateau à moteur.
Document 4 : Ce sportif utilise une pagaie. Il s’en sert pour faire avancer le kayak
sur l’eau.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 48.
– Expérimentation. – Ballons de Comment utiliser la force de l’air ?
baudruche, Découvrir comment utiliser le mouvement de l’air pour déplacer un objet.
ficelle, petits Découvrir la notion de réaction.
tubes, pinces Les élèves disposent d’un ballon de baudruche.
à linge, ruban Ils le gonflent, puis maintiennent l’embouchure avec les doigts.
adhésif. Ils relâchent le ballon et constatent le phénomène.
– Pâte à On pourra organiser une petite épreuve à celui qui enverra son ballon le plus loin.
modeler, Les élèves prendront ainsi conscience que plus le ballon est gonflé plus il est censé
baguette de aller loin, mais en faisant attention qu’il n’éclate pas au gonflage.
bois, papier, Expérience avec un ballon de baudruche.
ruban adhésif. Les élèves observent l’expérience A page 48.
Leur demander de récapituler le matériel dont ils vont avoir besoin, matériel qu’ils
auront à rassembler ou qui sera mis à leur disposition.
Les élèves réalisent le dispositif et l’expérience.
Ils répondent ensuite aux questions sur le cahier.
Expérience avec le souffle.
Les élèves réalisent l’expérience B page 48.
Ils mesurent à quelle distance la voile est sensible à la poussée du souffle.
38
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 38 11/10/2017 15:33
On amènera à mettre en lien cette expérience et le document 1 de la première
page de la leçon.
À la suite de chacune de ces expériences, les élèves complètent le cahier de
sciences page 48.
Corrigé
Expérience A : L’ air s’échappe vivement du ballon.
Le ballon se déplace vivement dans le sens inverse de l’air qui s’échappe.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et je m’interroge
60 min analyse. d’activités p. 49.
– Questionnement. – Par élève : Comment réaliser un bateau qui avance tout seul ?
– Synthèse des 1 barquette en Construire un objet technique à partir d’un cahier des charges.
connaissances polystyrène, Les élèves auront ici toute latitude pour réaliser une maquette de bateau sur la
acquises. 1 pique en base d’un cahier des charges.
bois, 1 feuille Les élèves liront d’abord le cahier des charges qui sera ensuite détaillé.
de papier, de la Définir un endroit de la classe ou de l’école où l’évaluation des projets sera réalisée
pâte à modeler, (petite piscine gonflable dans la cour de récréation) ; la distance de 60 cm sera
du ruban mesurée de manière à ce que les élèves perçoivent bien la performance à réaliser.
adhésif. Le mode de propulsion interdit devra être précisé ; bien entendu, le bateau ne
devra pas être tenu à la main ni propulsé à la main.
Les élèves devront prendre conscience de la nature des matériaux utilisables : leur
demander de citer des matériaux possibles.
Les élèves devront :
– lister le matériel qu’ils utilisent ;
– dessiner chaque étape importante de leur projet.
Les réalisations seront ensuite testées et évaluées collectivement au vu du respect
du cahier des charges.
Je conclus
Lorsqu’il n’a pas de moteur, un bateau peut être propulsé par le vent pour un
bateau à voiles, le mouvement des rames dans une barque, le pédalage dans un
pédalo. Pour concevoir et construire mon projet de bateau, je dois respecter les
critères du cahier des charges.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 50.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : pédalo – bateau à rames – bateau à voile
acquises.
Je retiens
39
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 39 11/10/2017 15:33
Les objets techniques
12 Des circuits électriques Cahier
pp. 51-54
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
Imaginer, réaliser : domaine 5
Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.
Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité.
Constituants et fonctionnement d’un circuit électrique simple.
Exemples de bons conducteurs et d’isolants.
Rôle de l’interrupteur.
Règles élémentaires de sécurité.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
L’énergie électrique se présente sous deux formes :
– l’électricité fournie par le secteur. Cette électricité se présente sous un voltage de 220 volts ;
– l’électricité produite par les piles électriques par réaction chimique.
L’électricité du secteur est très dangereuse et peut provoquer la mort par électrocution. En milieu
humide, une tension de plus de 24 volts est dangereuse.
Il faudra insister auprès des élèves pour que les règles élémentaires de sécurité soient associées à l’utili-
sation du courant du secteur :
– ne jamais toucher à la prise d’un appareil branché sur le secteur ; l’enfant doit toujours laisser faire cela
à un adulte ;
– ne jamais toucher un fil électrique abîmé ;
– ne jamais utiliser un appareil électrique, tel un sèche-cheveux, dans une salle de bains avec les pieds
mouillés.
Ces conseils répétés doivent s’inscrire durablement dans la mémoire des élèves.
L’utilisation de l’électricité de la pile ne présente pas de danger. Il peut y avoir un échauffement d’un fil s’il
y a un court-circuit (fil reliant directement une borne de la pile à l’autre borne) ; les élèves doivent alors
immédiatement arrêter leur expérience.
Un circuit électrique est une chaîne fermée, formée de la pile et d’objets reliant une borne de la pile à
l’autre : fils électriques, ampoule, moteur, buzzer… En ce cas, le circuit est dit fermé et la lampe s’allume.
Lorsque cette chaîne est rompue, le courant ne circule plus. Le circuit est alors ouvert.
La pile comporte deux bornes : une borne + et une borne -.
Un circuit comportant une pile, des fils et une ampoule peut être complété par un interrupteur, système
mobile qui permet d’ouvrir ou de fermer le circuit à volonté.
Certains matériaux laissent passer le courant : ils sont dits conducteurs ; d’autres ne laissent pas passer
le courant : ils sont dits isolants.
40
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 40 11/10/2017 15:33
Mais certains matériaux ne sont que faiblement conducteurs et ne laissent pas passer suffisamment
le courant pour que la lampe du circuit simple s’allume.
Ultérieurement, les élèves le constateront avec une LED à la place de l’ampoule.
Ainsi, l’eau est un matériau conducteur, ce qui explique le risque d’électrocution lorsque l’on a les pieds
mouillés et que l’on utilise un appareil électrique.
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 51.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 51 :
– Observation Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Travail sur les documents page 51.
Découvrir le circuit électrique simple et une utilisation du circuit électrique
simple.
Les élèves observent les documents de la page 51.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant. Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Quels éléments électriques
l’enfant a-t-il utilisés ? Comment a-t-il placé l’ampoule pour qu’elle s’allume ?
On précisera de manière impérative aux élèves que l’on peut toucher les bornes
d’une pile parce que le courant électrique est très faible, mais qu’il est très dange-
reux de toucher au courant électrique de la maison.
– Document 2 : décrivez le circuit électrique que vous observez sur le document.
Quels sont les éléments qui le composent ? Pourquoi dit-on que c’est un circuit
électrique ? Hormis la pile, l’ampoule et les fils, quel objet est introduit sur le
circuit ? À quoi sert-il ?
– Documents 3 et 4 : quel objet est présenté sur les documents 3 et 4 ? Quelle
est son utilité ? Selon vous, fonctionne-t-il comme un circuit électrique ? Quels
éléments du circuit électrique reconnais-tu ? Quel élément est caché à l’intérieur
de la torche ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 51.
Corrigés
Document 1 : On a utilisé une pile et une ampoule.
L’ampoule est allumée.
Document 2 : L’interrupteur permet d’ouvrir ou de fermer le circuit électrique.
Le circuit est fermé.
Documents 3 et 4 : C’est une lampe de poche.
Elle permet d’éclairer.
On voit l’ampoule, les piles et l’interrupteur.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 52.
– Expérimentation. – Par élève : Comment s’allume l’ampoule dans un circuit électrique simple ?
1 ampoule, Allumer une ampoule placée à distance de la pile ; découvrir la notion
1 pile plate, des d’interrupteur.
fils électriques, Les élèves mettent en place successivement les trois expériences de la page 52.
1 interrupteur, Expérience 1 : allumer une ampoule avec une pile plate.
des trombones. Les élèves effectuent leurs essais et notent très précisément la position de l’am-
poule pour qu’il y ait circuit électrique.
Leur faire observer l’ampoule et le trajet suivi par le courant électrique, du culot
au filament jusqu’au pas de vis, le culot et le pas de vis étant séparés par la matière
isolante noire.
41
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 41 11/10/2017 15:33
Expérience 2 : allumer l’ampoule avec la pile plate à distance.
Les élèves prendront conscience de l’utilité des fils électriques.
Ils seront confrontés aux problèmes d’accrochage des fils ; à défaut de petites
pinces (mettre à disposition si on a des fils électriques montés avec pinces), utili-
ser des trombones.
Si la classe dispose de culot, commencer par réaliser l’expérience sans, puis avec
culot.
Expérience 3 : mettre en place l’interrupteur.
Découvrir ou redécouvrir les notions de circuit ouvert et circuit fermé ; le courant
passe lorsque le circuit est fermé, la lampe s’allume ; le courant ne passe pas quand
le circuit est ouvert, la lampe reste éteinte.
Les élèves complètent les schémas page 52 à chaque étape de travail.
Demander aux élèves d’être très précis dans la fidélité de représentation des
connexions.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 53.
– Expérimentation. – Par élève : Tous les matériaux laissent-ils passer le courant ?
– Synthèse des 1 ampoule, Distinguer les matériaux isolants des matériaux conducteurs.
connaissances 1 pile plate, des Les élèves mettent en place l’expérience de la page 53 du cahier de l’élève.
acquises. fils électriques, Leur demander de réaliser un circuit ouvert, puis d’essayer de le fermer avec les
1 couteau, des matériaux énoncés.
cuillères et des Ils ont ainsi des objets identiques, ou à peu près dans leur forme, mais différents
règles en bois, en ce qui concerne leur matière.
en plastique, en Ils seront donc amenés à conclure que ce n’est pas le fait que ce soit une cuillère
métal. si la lampe s’allume avec une cuillère en métal, mais parce qu’elle est en métal ;
de même pour la règle.
Ils font leurs observations et complètent le tableau de l’exercice 2.
Corrigé
Exercice 2 : Isolants : bois, plastique.
Conducteur : métal.
Je conclus
Dans un circuit électrique, un interrupteur peut ouvrir ou fermer le circuit.
Lorsque le circuit est fermé, le courant passe et l’ampoule s’allume.
Lorsque le circuit est ouvert, le courant ne passe pas et la lampe reste éteinte. Un
objet qui laisse passer le courant est conducteur. Un objet qui ne laisse pas passer
le courant est isolant.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 54.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : Colorier l’ampoule des schémas 1 et 3.
acquises. Exercice 2 : ouvert – fermé (colorier l’ampoule)
Exercice 3 : vrai – faux – vrai – faux – vrai
Je retiens
42
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 42 11/10/2017 15:33
La matière
Les objets techniques
13
1 Fabriquer des objets Cahier
pp. 55-58
électriques
1 COMPÉTENCES DES PROGRAMMES
8 Socle commun
Pratiquer des démarches scientifiques : domaine 4
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionne-
ment, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.
Imaginer, réaliser : domaine 5
Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.
S’approprier des outils et des méthodes : domaine 2
Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser
une expérience.
Manipuler avec soin.
Pratiquer des langages : domaine 1
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire
tableaux).
8 Connaissances et compétences associées
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité.
2 NOTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Un circuit électrique simple comprend un générateur de courant électrique, une pile par exemple, un
interrupteur, une ampoule reliés par des fils électriques, en un circuit fermé partant d’un pôle de la pile
à l’autre pôle.
La polarité de la pile + ou - n’a pas d’importance dans les circuits électriques simples si ce circuit ne
comporte que des ampoules, les ampoules n’ayant pas de sens de circulation du courant.
Dans le cas du moteur, le choix de la polarité fait tourner le moteur dans un sens ou dans l’autre.
La LED a aussi un sens et ne s’allume que si le pôle + de la pile est relié à la borne la plus longue de la LED.
Dans le cas d’un circuit simple avec une pile, des fils électriques, un interrupteur et une lampe, il y a
discontinuité sur le circuit lorsque l’interrupteur est ouvert. On dit alors que le circuit est ouvert et la
lampe ne s’allume pas.
Si l’interrupteur est fermé, la circulation du courant est continue. Le circuit est alors fermé et la lampe
s’allume.
Il existe deux sortes de circuits.
Un circuit est dit circuit en série, lorsque tous les éléments sont placés les uns après les autres sur la
même ligne fermée. Si l’un des éléments vient à dysfonctionner, le circuit est alors ouvert et le courant
ne passe plus. Tous les autres éléments ne fonctionnent plus non plus. Si un tel circuit comprend deux
éléments, deux lampes par exemple, chaque lampe brille moins que si elle était seule sur le circuit.
Un circuit est dit circuit en dérivation ou circuit en parallèle, lorsque les éléments sont placés sur des
dérivations différentes. Ainsi chaque élément se trouve sur un circuit simple différent, les deux ayant
une partie de circuit commune. Si l’un des éléments vient à dysfonctionner, le fonctionnement de l’autre
n’est pas affecté. Dans le cas où chaque dérivation comporte une lampe, les deux lampes éclairent autant
que si elles étaient seules sur le circuit.
Ces notions de circuit en série ou en dérivation seront éventuellement utilisées de manière intuitive au
cours de la fabrication des phares de voiture et du clown.
43
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 43 11/10/2017 15:33
3 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LA SÉQUENCE
Supports
Démarche Déroulement
et matériel
Séance 1 – Recueil des – Cahier
Je connais déjà
30 min représentations d’activités p. 55.
initiales des élèves. Débat oral autour de la question posée par la grenouille page 55 :
– Observation Comment fonctionne un objet électrique ?
indirecte de Faire émerger les représentations initiales.
situations Les élèves lisent la question posée par la grenouille et y répondent collectivement.
concrètes Leurs réponses sont notées au tableau ; il est ensuite demandé aux élèves de les
représentées organiser, de les regrouper.
(photographies). Les représentations ainsi émises sont notées sur une affiche qui sera conservée
– Questionnement. jusqu’à l’issue de la séquence. Les élèves pourront alors prendre conscience des
acquis de leur travail.
Travail sur les documents page 55.
Faire émerger les notions déjà étudiées par le passé ou connues des élèves.
Observer des objets utilisant la notion de circuit électrique.
Les élèves observent les documents de la page 55.
Ils répondent d’abord aux questions de structuration posées oralement par l’en-
seignant. Ils répondent ensuite par écrit sur le cahier.
Questionnement
– Document 1 : que voyez-vous sur le document ? Avez-vous déjà réalisé un montage
de ce genre ? Quels sont les éléments du circuit électrique ? Décrivez l’interrupteur. La
lampe est-elle allumée ? Pourquoi ? Que faudrait-il pour qu’elle le soit ?
– Document 2 : que voyez-vous sur ce document ? Où se trouve ce phare ? Quand
est-il allumé ? Quelle énergie lui permet d’être allumé ? À quoi sert-il ? Utilise-t-il
l’énergie d’une pile électrique ou du secteur comme à la maison ?
– Document 3 : que voyez-vous sur ce document ? Quel objet leur permet de
voir dans l’obscurité ? Quelle est la particularité de ces lampes ? Quel est l’intérêt
pour les enfants d’avoir la lampe sur la tête plutôt que dans leur main ? Pourquoi
appelle-t-on ces lampes des lampes frontales ? Que fait la lampe quand l’enfant
regarde vers le ciel ? Vers le sol ?
– Document 4 : que voyez-vous sur le document ? Pourquoi le conducteur a-t-il
allumé les phares de la voiture ? Comment fait-il, selon vous, pour allumer les
phares ? En quoi le système d’éclairage de la voiture ressemble à votre circuit
électrique ?
Les élèves répondent par écrit aux questions accompagnant les documents de
la page 55.
Corrigés
Document 1 : Une pile, une ampoule, des fils électriques et un interrupteur.
La lampe n’est pas allumée car l’interrupteur est ouvert ; le courant électrique ne
circule pas.
Document 2 : Ce repère lumineux est un phare.
Il sert de repère la nuit aux bateaux qui approchent de la côte et du port. Sa façon
particulière d’éclairer donne une indication sur le lieu.
Documents 3 : Les deux enfants utilisent une lampe électrique frontale.
Elle permet de garder les deux mains libres et d’éclairer dans le sens du regard.
Document 4 : Quand le conducteur actionne l’interrupteur, les deux phares s’al-
lument en même temps.
Séance 2 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 56.
– Expérimentation. – Par élève : Comment fabriquer des objets électriques qui éclairent ?
2 ampoules, Réaliser un objet utilisant un circuit électrique à une puis deux ampoules.
1 pile Les élèves mettent en œuvre le circuit électrique simple dans une maquette de
plate, 4 fils phare.
électriques, Les élèves lisent, page 56, le cahier des charges et les contraintes qu’ils devront
1 interrupteur, respecter.
2 culots, Les élèves ont à disposition le matériel nécessaire à la réalisation d’un circuit
1 barquette en simple, avec suffisamment de longueur de fil électrique.
polystyrène, Ils imaginent comment réaliser un point lumineux en haut d’un cylindre en carton
2 cylindres et en dessinent le projet.
en carton, Leur demander de rassembler le matériel. Le cylindre en carton peut provenir de
4 bouchons en certains emballages rigides de produits alimentaires.
plastique. Les productions des élèves sont comparées.
44
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 44 11/10/2017 15:33
Approcher intuitivement différentes formes de circuit avec deux ampoules
devant s’allumer en même temps.
Les élèves ont à disposition une pile plate, deux ampoules, deux culots, un inter-
rupteur et quatre fils électriques.
Demander aux élèves de faire un circuit en utilisant tous le matériel à disposition
(sauf le nombre de fils) sans autre consigne.
Plusieurs solutions sont possibles : deux circuits partant de la même pile, deux
ampoules placées en série ou deux ampoules placées en dérivation.
Les réalisations seront comparées.
Les élèves testent plusieurs solutions et dessinent leur projet sur le cahier page 56.
Ils réalisent leur projet et le comparent au cahier des charges.
Séance 3 – Observation et – Cahier
J’observe et j’expérimente
60 min analyse. d’activités p. 57.
– Expérimentation. – Par élève : Comment fabriquer un clown lumineux ?
– Synthèse des 2 ampoules, Réaliser un objet électrique utilisant un ou des circuits électriques à deux
connaissances 1 pile plate, du ampoules, avec un allumage indépendant de chacune.
acquises. fil électrique À ce niveau de la scolarité, les élèves seront plutôt amenés à faire deux circuits
rouge et bleu, électriques alimentés par la même pile.
2 trombones, Leur faire réaliser le montage avec une seule ampoule et un seul interrupteur.
1 plaque Les élèves auront préalablement dessiné et découpé le clown dans une plaque
de carton, de carton.
4 attaches Ils testeront le montage et l’œil qui s’allume et s’éteint dans cette situation.
parisiennes. Leur faire rechercher comment avoir un deuxième œil et un deuxième interrup-
teur branchés sur la même pile.
Leur faire compléter les schémas de l’exercice 1 page 57.
Ils le réalisent ensuite sur le clown.
Corrigés
Exercice 1
4,5 V 4,5 V
Exercice 2 : Les élèves colorient les ampoules et les yeux du clown dans le schéma 1.
Je conclus
Les objets électriques qui éclairent utilisent le principe du circuit électrique.
Chaque circuit comprend une pile, des fils électriques et au moins une ampoule.
Un interrupteur permet d’ouvrir et de fermer le circuit, pour allumer ou éteindre
l’ampoule.
Séance 4 – Remobilisation – Cahier
J’utilise ce que j’ai appris
30 min des connaissances d’activités p. 58.
acquises. Séance bilan.
– Synthèse des Corrigés
connaissances Exercice 1 : Barrer la loupe, la paille, le ballon de baudruche, la bouteille et la
acquises. lampe de poche.
Exercice 2 : Les yeux du clown sont 2 ampoules qui s’allument en même temps.
Exercice 3
Je retiens
45
Sciences_CE1_LDP_01-048.indd 45 11/10/2017 15:33
Vous aimerez peut-être aussi
- (Carole Raby Sylvie Viola) Mod PDFDocument288 pages(Carole Raby Sylvie Viola) Mod PDFTeo Sandu100% (3)
- CitadelleDocument156 pagesCitadellesebastien darques100% (1)
- GP Neo Jedecode JelisDocument192 pagesGP Neo Jedecode Jelismixscha personnePas encore d'évaluation
- A Cup of Tea Ce2Document128 pagesA Cup of Tea Ce2Lida Poghosyan83% (6)
- CE1 Luciole Guide de LenseignantpdfDocument34 pagesCE1 Luciole Guide de LenseignantpdfBouk100% (9)
- Guide Pédago Sciences Et Technologie CM2 IstraDocument48 pagesGuide Pédago Sciences Et Technologie CM2 IstraaudreypucciPas encore d'évaluation
- Istra Sciences cm1Document48 pagesIstra Sciences cm1cuq100% (5)
- 2011 Hassenteufel 4 La Mise en Œuvre de L'action PubliqueDocument2 pages2011 Hassenteufel 4 La Mise en Œuvre de L'action PubliqueNouhaila BasriPas encore d'évaluation
- Element Du Module de La Production Didactique - CRMEF Tanger - SVT - Promotion 2018Document151 pagesElement Du Module de La Production Didactique - CRMEF Tanger - SVT - Promotion 2018yassinePas encore d'évaluation
- Retz - Ateliers PhiloDocument34 pagesRetz - Ateliers Philojulia.duclercqPas encore d'évaluation
- Découvrir Le Monde MaternelleDocument87 pagesDécouvrir Le Monde MaternelleJean-Philippe Solanet-Moulin75% (4)
- Guide Peda QLM Istra CPDocument42 pagesGuide Peda QLM Istra CPflobassmaniac100% (2)
- ISTRA - Questionner Le Monde CE2 - Guide Pédagogique (2017)Document49 pagesISTRA - Questionner Le Monde CE2 - Guide Pédagogique (2017)Laetitia NelsonPas encore d'évaluation
- Cycle 4 - Magnard (2016) - Livre ProfDocument160 pagesCycle 4 - Magnard (2016) - Livre Proflaura.b83Pas encore d'évaluation
- Compréhension en Arts PlastiquesDocument88 pagesCompréhension en Arts PlastiquesStefani MartiniPas encore d'évaluation
- Agut - Julie TempsDocument49 pagesAgut - Julie TempsclémentPas encore d'évaluation
- Physique-Chimie 5e-4eDocument74 pagesPhysique-Chimie 5e-4eLuc BadinPas encore d'évaluation
- Pharmacie 2020 LarradetDocument93 pagesPharmacie 2020 Larradetsamir khadirPas encore d'évaluation
- Corps HumainDocument275 pagesCorps HumainLydorPas encore d'évaluation
- Quelques Outils de La Pédagogie Steiner Utilisables Dans L'enseignement PublicDocument77 pagesQuelques Outils de La Pédagogie Steiner Utilisables Dans L'enseignement PublicRenne Blanc100% (1)
- Accompagnement Palier 1 2006Document55 pagesAccompagnement Palier 1 2006api-3844239100% (1)
- GuideDocument24 pagesGuideAlejandra Genesta OrozcoPas encore d'évaluation
- L' Enfant et son environnement: Une étude fonctionnelle de la première enfanceD'EverandL' Enfant et son environnement: Une étude fonctionnelle de la première enfancePas encore d'évaluation
- STMS Bloc 4Document180 pagesSTMS Bloc 4alexiana.lia25Pas encore d'évaluation
- ́phrologie: Cours CompletDocument28 pageśphrologie: Cours CompletyannickPas encore d'évaluation
- DA Seconde-2Document56 pagesDA Seconde-2Ksenia YankouskayaPas encore d'évaluation
- VILELA Anabelle - FLES PDFDocument252 pagesVILELA Anabelle - FLES PDFcPas encore d'évaluation
- Mémoire Master 2 Ouvrart Vincent Version FinaleDocument76 pagesMémoire Master 2 Ouvrart Vincent Version FinaleAllouani ChaimaePas encore d'évaluation
- Va Rodriguez Suarez SabineDocument408 pagesVa Rodriguez Suarez SabineOumhani MajPas encore d'évaluation
- A 03589 Ba 3 b 3135303738383832323133393538Document5 pagesA 03589 Ba 3 b 3135303738383832323133393538rachidilatifaPas encore d'évaluation
- Document Methode Etude AvifauneDocument24 pagesDocument Methode Etude AvifauneIoana TaterPas encore d'évaluation
- VD2 Rueff Anne-Stephanie 12072011Document104 pagesVD2 Rueff Anne-Stephanie 12072011lazharinoghagPas encore d'évaluation
- Rauch Capucine These Manuscrit 2022Document264 pagesRauch Capucine These Manuscrit 2022lucas.abdelbaki2020Pas encore d'évaluation
- 2017AZUR2013Document335 pages2017AZUR2013Pauxy Gentil-NunesPas encore d'évaluation
- Petits ScientifiquesDocument166 pagesPetits ScientifiquesJade BricaultPas encore d'évaluation
- 1FD1TGPA0012Document134 pages1FD1TGPA0012Frédéric Riviere100% (3)
- Rca Francais Ce1 GPDocument91 pagesRca Francais Ce1 GPMon Cœur AmoureuxPas encore d'évaluation
- S.Altazin theseVersionFinaleDocument124 pagesS.Altazin theseVersionFinalePhoen RichPas encore d'évaluation
- Fichier PédaDocument193 pagesFichier PédacasimiralexaPas encore d'évaluation
- Cycle 4 - Belin (2016) - Livre Prof (5ème)Document59 pagesCycle 4 - Belin (2016) - Livre Prof (5ème)laura.b83Pas encore d'évaluation
- Dokumen - Pub Conquetes Science Et Technologie 1er Cycle Du Secondaire 1re Annee Cahier Dapprentissage Savoirs Et Activites 1-1-9782765216537Document427 pagesDokumen - Pub Conquetes Science Et Technologie 1er Cycle Du Secondaire 1re Annee Cahier Dapprentissage Savoirs Et Activites 1-1-9782765216537Amine MahhouPas encore d'évaluation
- Polycopié UE2 2017-2018 (Définitif)Document239 pagesPolycopié UE2 2017-2018 (Définitif)Romain Bui100% (1)
- Les Sujets de La Recherche: Questions Didactiques: To Cite This VersionDocument145 pagesLes Sujets de La Recherche: Questions Didactiques: To Cite This VersiontidjanigourdinPas encore d'évaluation
- Programme D'etude PhysiqueDocument63 pagesProgramme D'etude Physiquesarahbendechache1Pas encore d'évaluation
- Memoire Elevage Escargot Ecole MaternelleDocument45 pagesMemoire Elevage Escargot Ecole Maternellestephanefouejio389Pas encore d'évaluation
- Fascicule GENETIQUEDocument48 pagesFascicule GENETIQUECho Min SooPas encore d'évaluation
- 2016 FONTAINE ArchivageDocument123 pages2016 FONTAINE ArchivageChaima HmaniPas encore d'évaluation
- Prof TSEXPDocument249 pagesProf TSEXPFousseyni Cisse100% (1)
- 9_MEM_SF_2015_PLOUVIEZ JulieDocument57 pages9_MEM_SF_2015_PLOUVIEZ JulieMatthias BYEMBAPas encore d'évaluation
- HabitatDocument171 pagesHabitatLydorPas encore d'évaluation
- Feuilletage 2114Document17 pagesFeuilletage 2114Yves Hilaire ParasolierPas encore d'évaluation
- KIABOU02 rapport à exploiter pour le projetDocument95 pagesKIABOU02 rapport à exploiter pour le projetbrunonapo97Pas encore d'évaluation
- 41 Mem Ortho 2014 Leturque Catherine-Monnet EstelleDocument79 pages41 Mem Ortho 2014 Leturque Catherine-Monnet EstelleNour ChellyPas encore d'évaluation
- Richard PaulineDocument62 pagesRichard PaulineBouchra BouchraPas encore d'évaluation
- Meef 2021 GourlainDocument65 pagesMeef 2021 Gourlainmed.ing.djPas encore d'évaluation
- Memoire Esfbaudelocque LacorreDocument55 pagesMemoire Esfbaudelocque LacorredarinbouakrifPas encore d'évaluation
- Belair Titouan - Gatineau Savannah Memoire 2021Document35 pagesBelair Titouan - Gatineau Savannah Memoire 2021MOHAMED LAAROUSSIPas encore d'évaluation
- Angers COCHIN Lea CHOUIN Aurore Anglais 2019Document80 pagesAngers COCHIN Lea CHOUIN Aurore Anglais 2019FrançoisPas encore d'évaluation
- Psychologie de l'apprentissage-enseignement: Une approche individuelle ou de groupeD'EverandPsychologie de l'apprentissage-enseignement: Une approche individuelle ou de groupePas encore d'évaluation
- LES CARRIERES EN SCIENCES: Astuces pour éviter les piègesD'EverandLES CARRIERES EN SCIENCES: Astuces pour éviter les piègesPas encore d'évaluation
- Faire équipe pour l'éducation à la santé en milieu scolaireD'EverandFaire équipe pour l'éducation à la santé en milieu scolairePas encore d'évaluation
- Devoir 2 Modele 10 SVT TC Semestre 1Document3 pagesDevoir 2 Modele 10 SVT TC Semestre 1abdettawabe100% (2)
- Tout Savoir Sur L'école Freinet de Québec, Bâtiment Des LoutresDocument13 pagesTout Savoir Sur L'école Freinet de Québec, Bâtiment Des LoutresFrancis DubéPas encore d'évaluation
- Distomatose Hépatique À Fasciola HepaticaDocument8 pagesDistomatose Hépatique À Fasciola HepaticaducPas encore d'évaluation
- Xavier NlateDocument3 pagesXavier NlateDimitri TibatiPas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires.sDocument30 pagesDroit Des Affaires.sHiba AichPas encore d'évaluation
- Rapport PSI 2018Document142 pagesRapport PSI 2018raphael2casaPas encore d'évaluation
- 24BAT27Document4 pages24BAT27nabPas encore d'évaluation
- XML DevoirDocument5 pagesXML DevoirmbohoumounpouyvanlandryPas encore d'évaluation
- Thierry Vaira PDFDocument115 pagesThierry Vaira PDFZineddine El Mehdi MustaphaPas encore d'évaluation
- Compte Rendu MDS FinalDocument59 pagesCompte Rendu MDS FinalrajawimenlekbarPas encore d'évaluation
- Petits DéjeunersDocument5 pagesPetits Déjeunersdoralinador100% (1)
- TP8 Configuration DHCPV4Document5 pagesTP8 Configuration DHCPV4Omar DrissiPas encore d'évaluation
- Gci 111 Exercice 2 A11 PDFDocument4 pagesGci 111 Exercice 2 A11 PDFAmine MakachouPas encore d'évaluation
- Organisation Et Gestion de La Maintenance Des Stérilisateur À Vapeur D'eau - CopieDocument39 pagesOrganisation Et Gestion de La Maintenance Des Stérilisateur À Vapeur D'eau - Copietmh ciPas encore d'évaluation
- ENP-EMSI-2020 Notes de CoursDocument56 pagesENP-EMSI-2020 Notes de CoursMarouan EladiPas encore d'évaluation
- Cours #4 Les Nouveaux Acteurs de La Smart CityDocument30 pagesCours #4 Les Nouveaux Acteurs de La Smart CityjiaathanasiaPas encore d'évaluation
- Mémoire Sureté de FonctionnementDocument144 pagesMémoire Sureté de FonctionnementMohamed hadjadj100% (1)
- Finance Verte MarocDocument21 pagesFinance Verte Marocyamina soudani100% (1)
- Ph3 1induction Magn-CoursDocument5 pagesPh3 1induction Magn-CoursMohamed B'nPas encore d'évaluation
- Copie de Karate FrameWorkDocument12 pagesCopie de Karate FrameWorkchebbimedwassefPas encore d'évaluation
- Devoir Surveille N°1 Semestre 1: Exercice 1Document3 pagesDevoir Surveille N°1 Semestre 1: Exercice 1Ya Cin KhaldiPas encore d'évaluation
- HydroceleDocument2 pagesHydroceleMaher JradPas encore d'évaluation
- J'ai Enfin Cree Mon Personnage Gta 5 RP ! - YoutubeDocument1 pageJ'ai Enfin Cree Mon Personnage Gta 5 RP ! - Youtubezacharylacasse171Pas encore d'évaluation
- Apports Des Sciences Sociales-ActesColloqueHanoi-2011Document243 pagesApports Des Sciences Sociales-ActesColloqueHanoi-2011Imorou YAROUPas encore d'évaluation
- Branding - Construire Une Marque MémorableDocument7 pagesBranding - Construire Une Marque Mémorablesamih.khorchafPas encore d'évaluation
- TD RsaDocument4 pagesTD RsaNdik LipemPas encore d'évaluation
- Mémoire Fin 0123 PDFDocument92 pagesMémoire Fin 0123 PDFSoussou PerlaPas encore d'évaluation
- TD Corrige Analogique NumeriqueDocument14 pagesTD Corrige Analogique Numeriqueheromagic77% (13)
- Aspects Particuliers Des Traumatismes Dans Les Pays Peu Nantis D'afrique. Un Vécu Chirurgical de 20 AnsDocument13 pagesAspects Particuliers Des Traumatismes Dans Les Pays Peu Nantis D'afrique. Un Vécu Chirurgical de 20 AnsKhalil IbrahimPas encore d'évaluation