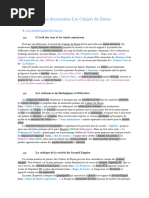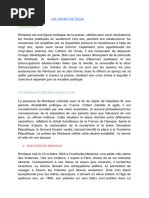Synthèse Rimbaud
Synthèse Rimbaud
Transféré par
emlinaascoreDroits d'auteur :
Formats disponibles
Synthèse Rimbaud
Synthèse Rimbaud
Transféré par
emlinaascoreCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Synthèse Rimbaud
Synthèse Rimbaud
Transféré par
emlinaascoreDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le sonnet
Le sonnet est une forme poétique fixe. Le poète italien Pétrarque (1304-
e
1374) le popularise au XIV siècle dans son Canzoniere, recueil dédié à la
femme qu’il aime, Laure. Clément Marot (1496-1544) importe la forme en
français en 1536. Il sera suivi par les poètes de son temps et
particulièrement ceux de la Pléiade : Joachim Du Bellay, Pierre de Ronsard.
La poésie amoureuse et la tonalité lyrique lui sont fréquemment associées.
Le sonnet est une forme fixe qui a été prisée à presque toutes les
époques. Sa brièveté et son exigence ont stimulé de nombreux poètes
depuis la Renaissance en France, parmi lesquels Rimbaud et Verlaine, les
romantiques et les parnassiens au XIXe siècle.
Le poème compte quatorze vers, répartis en deux quatrains (strophes de 4
vers), suivis de deux tercets (strophes de trois vers). Les vers sont
isométriques (ils ont le même nombre de syllabes) et il s’agit le plus souvent
de décasyllabes (10 syllabes) ou d’alexandrins (12 syllabes). Les rimes sont
disposées selon des schémas prédéfinis : ABBA ABBA pour les quatrains,
tandis que les tercets présentent des formes plus souples : CCD EED (selon
le modèle imposé par Marot) ou CCD EDE (modèle de Jacques Peletier du
Mans), entre autres. Le dernier vers produit souvent un effet de surprise ou
de chute, en italien un « concetto », c’est-à-dire une pointe.
2. Des poèmes de jeunesse et de révolte
1. Une poésie autobiographique
Le « je » qui s’exprime dans le Cahier de Douai est un adolescent, plus précisément
un poète de quinze ans. En effet, « À la musique », qui présente la comédie sociale
du jeudi soir place de la gare à Charleville et raille les bourgeois ridicules, ou « Au
Cabaret-Vert », qui peint un cabaret fréquenté par Rimbaud, témoignent tous
deux de lieux que Rimbaud a fréquentés à l’époque. En ce sens, on prendra garde à
la mention finale du poème « Morts de Quatre-vingt-douze… », « Fait à MAZAS,
3 septembre 1870 », qui renvoie à l’expérience carcérale de Rimbaud à la fin de l’été
1870. De nombreux éléments conduisent ainsi le lecteur à considérer l’ensemble
du recueil comme autobiographique, même si plusieurs poèmes racontent
simplement l’expérience universelle d’un jeune homme à la découverte du
monde, de sa propre liberté et de la sensualité. Si « Je est un autre », comme l’écrira
Rimbaud en 1871, « Je » est ici aussi, sans doute, Arthur, né à Charleville, qui
déteste les Ardennes, s’en échappe et y revient malgré lui.
2. Une « poésie des grandes vacances »
Cette expression de l’universitaire Pierre Brunel, grand spécialiste de Rimbaud, dont
les travaux ont permis de mieux connaître le poète, rend compte d’une grande
partie du Cahier de Douai. De nombreux poèmes abordent effectivement des
thèmes chers à l’adolescence et à l’idée d’un temps suspendu : l’errance, la
fuite, la liberté ou encore la sensualité. Le poète est ainsi souvent présenté en
balade, parfois dans la nature : « j’irai dans les sentiers », « Et j’irai loin, bien loin,
comme un bohémien » (« Sensation »), « On va sous les tilleuls verts de la
promenade » (« Roman »), « Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées »
(« Ma bohème »). Cette poésie du mouvement a participé à la légende de
Rimbaud, notamment incarnée par l’expression « l’homme aux semelles de
vent », généralement attribuée à Verlaine, même si son origine reste incertaine.
Même lorsqu’il évoque les horreurs de la guerre, comme dans « Le Dormeur du
val », le poète demeure un être qui se promène et qui découvre, presque par
hasard, le soldat mort au milieu de la nature.
3. Une expérience de la sensualité
Les femmes et la séduction sont très présentes dans le Cahier de Douai, qu’elles
soient des maîtresses (« Première soirée ») ou des femmes que le poète veut
séduire (« Les Reparties de Nina », « Roman ») ou encore avec des « fillettes » dans
« À la musique ». Le poète est souvent entouré de femmes qu’il cherche à séduire :
Nina ne semble pas le comprendre, comme le montre brutalement la chute du
poème, la servante de « La Maline » joue avec ses nerfs, alors qu’une jeune femme
sans nom, mais « fort déshabillée » (v. 1), partage déjà sa chambre dans « Première
soirée ». Cette quête sensuelle ne se résume pas à la séduction ni même à la
relation charnelle. Une part importante des images rimbaldiennes évoque les
débuts, la création ou encore la fusion, qui font écho à la thématique de la
sensualité. Le poète et la jeune femme se croisent, se cherchent et entrent dans un
jeu de séduction, dans la rue (« Roman ») :
Le cœur fou Robinsonne à travers les romans,
– Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l’ombre du faux-col effrayant de son père…
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif….
– Sur vos lèvres alors meurent les cavatines…
Ou dans un cabaret (« La Maline ») :
– Et la servante vint, je ne sais pas pourquoi,
Fichu moitié défait, malinement coiffée
Et, tout en promenant son petit doigt tremblant
Sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc,
En faisant, de sa lèvre enfantine, une moue,
Elle arrangeait les plats, près de moi, pour m’aiser ;
– Puis, comme ça, – bien sûr pour avoir un baiser, –
La sensualité du Cahier de Douai semble d’abord être celle des adolescents ; elle
correspond au temps du jeu, de la reconnaissance et aux débuts de la séduction.
Dans les deux poèmes cités, c’est la jeune femme qui maîtrise le jeu face à un
poète « naïf », « malinement ».
4. Une poésie de la révolte
De nombreux poèmes tranchent avec le lyrisme qui évoque la fuite adolescente et
la découverte des sensations. Rimbaud affiche sa haine farouche de la
bourgeoise, qu’il ridiculise dans « À la musique » ; il s’indigne du sort fait aux plus
pauvres avec des accents hugoliens et baudelairiens dans « Les Effarés » et, surtout,
dénonce la guerre dans « Le Mal » et le « Dormeur du val », aujourd’hui parmi les
poèmes les plus connus de Rimbaud. Cette horreur de la guerre, de l’Empire et
du pouvoir tyrannique est aussi lisible dans « Morts de Quatre-vingt-douze… »,
« Rages de Césars », « L’Éclatante Victoire de Sarrebrück ». Elle est également
manifeste dans le long poème « Le Forgeron », dans lequel la personne qui donne
son nom au poème interpelle longuement Louis XVI pour dénoncer la misère des
ouvriers avec un souffle lyrique qui n’est pas sans rappeler celui de Victor Hugo
dans Les Châtiments, alors qu’il dénonce Napoléon III : « Oh ! tous les Malheureux,
tous ceux dont le dos brûle / Sous le soleil féroce, et qui vont, et qui vont, / Qui
dans ce travail-là sentent crever leur front ». La tonalité lyrique n’est pas seule à
rappeler Hugo : l’épique n’est jamais bien loin, comme par exemple avec cette
personnification de la Bastille, identifiée à une « bête », également dans « Le
Forgeron » :
Oh ! Le Peuple n’est plus une putain. Trois pas
Et, tous, nous avons mis ta Bastille en poussière
Cette bête suait du sang à chaque pierre
Et c’était dégoûtant, la Bastille debout
Avec ses murs lépreux qui nous racontaient tout
Et, toujours, nous tenaient enfermés dans leur ombre !
Rimbaud porte en définitive un regard critique et sévère sur les oppressions de
son temps, dénonçant le pouvoir et les injustices. En s’inspirant de la poésie
satirique de Hugo, il donne lui aussi un tour politique à ses textes.
3. Émancipations créatrices
1. Rimbaud encore sous influence
Rimbaud, pas encore « voyant » ? - Rimbaud est connu pour la théorie du
voyant, qu’il expose dans deux lettres envoyées à Izambard et Demeny au
printemps 1871. On analyse souvent la poésie de Rimbaud à travers cette grille de
lecture et les recueils que sont Une saison en enfer et Illuminations témoignent de
multiples façons de ce projet de « dérèglement de tous les sens », ou encore de
quête d’une nouvelle langue. Mais le Cahier de Douai est antérieur d’un an à cette
théorie et, si Rimbaud a bien quelques audaces, il n’en reste pas moins un poète
inspiré par la poétique parnassienne et marqué par Victor Hugo et par Charles
Baudelaire, mais aussi par Verlaine qu’il a lu plus récemment, notamment les
Poèmes saturniens (1866) et les Fêtes galantes (1869).
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Cahiers de Douai RimbaudDocument4 pagesLes Cahiers de Douai Rimbaudquentin.villette100% (2)
- Correction Dissertation Analyse Et PlanDocument5 pagesCorrection Dissertation Analyse Et Plans1602sashaPas encore d'évaluation
- Pistes Dissertation Les Cahiers de DouaiDocument4 pagesPistes Dissertation Les Cahiers de Douaidiane.lorang0750% (2)
- L'essentiel À Savoir Sur Rimbaud Et Sur Les Cahiers de DouaiDocument9 pagesL'essentiel À Savoir Sur Rimbaud Et Sur Les Cahiers de Douairania100% (1)
- Cahiers de Douai, Rimbaud Fiche Et Résumé Pour Le BacDocument1 pageCahiers de Douai, Rimbaud Fiche Et Résumé Pour Le Bacrxf784vy5sPas encore d'évaluation
- Cahiers de Douai, Rimbaud fiche et résumé pour le bacDocument2 pagesCahiers de Douai, Rimbaud fiche et résumé pour le bactee.shop2001Pas encore d'évaluation
- Bac de FranaisDocument41 pagesBac de Franaistom sardiPas encore d'évaluation
- Dissertation Rimbaud 2024Document4 pagesDissertation Rimbaud 2024andrea.avogari.de.gentili2Pas encore d'évaluation
- Arthur TombeauDocument5 pagesArthur Tombeauyousbenz0713Pas encore d'évaluation
- Analyse Cahier de DouaiDocument7 pagesAnalyse Cahier de Douaihadrienpoirier07Pas encore d'évaluation
- Dissertation Rimbaud (S.tesson)Document5 pagesDissertation Rimbaud (S.tesson)Victor FoucatPas encore d'évaluation
- BAC CAHIERS DE DOUAI RIMBAUDDocument9 pagesBAC CAHIERS DE DOUAI RIMBAUDdenisaPas encore d'évaluation
- III_DISSERT_R2DIG2EDocument2 pagesIII_DISSERT_R2DIG2Eramyy.ajamayPas encore d'évaluation
- QE Tradition ModernitéDocument3 pagesQE Tradition Modernitéliza.castella.31Pas encore d'évaluation
- DST de Francais RimbaudDocument7 pagesDST de Francais Rimbaudchaudemanche.ombelinePas encore d'évaluation
- 1 - Les Cahiers de Douai Artur RimbaudDocument17 pages1 - Les Cahiers de Douai Artur Rimbaudchicomoro100% (1)
- Cahiers de DouaiDocument7 pagesCahiers de Douaifodillydia2007Pas encore d'évaluation
- Cahiers de Douai RimbaudDocument6 pagesCahiers de Douai RimbaudvalentinePas encore d'évaluation
- Citations Nécessaires Et Plans Pour Une Dissertation À Propos Des Cahiers de DouaiDocument9 pagesCitations Nécessaires Et Plans Pour Une Dissertation À Propos Des Cahiers de Douaiguillaumeguegan2Pas encore d'évaluation
- Dissertation Cahiers de Douais (1)Document7 pagesDissertation Cahiers de Douais (1)mermezbh1999Pas encore d'évaluation
- Bac BlancDocument3 pagesBac BlancsavoyegautierPas encore d'évaluation
- CDD Plan DialectiqueDocument3 pagesCDD Plan DialectiquejadchraibiteraoPas encore d'évaluation
- RIMBAUD - Docx 20241101 131106 0000Document20 pagesRIMBAUD - Docx 20241101 131106 0000nounou nasriPas encore d'évaluation
- À seulement 16 ans , l’auteur Arthur Rimbaud , génie précoce , écrit son recueil Les Cahiers de Douai .Ses poèmes sont souvent considérés comme une œuvre révolutionnaire dans le monde de la poésieDocument3 pagesÀ seulement 16 ans , l’auteur Arthur Rimbaud , génie précoce , écrit son recueil Les Cahiers de Douai .Ses poèmes sont souvent considérés comme une œuvre révolutionnaire dans le monde de la poésieattabsami91Pas encore d'évaluation
- Fleurs Du Mal Notamment. Rêvé Pour L'hiver, Et Ma BohêmeDocument6 pagesFleurs Du Mal Notamment. Rêvé Pour L'hiver, Et Ma BohêmeMatheo MariaPas encore d'évaluation
- Fiche RimbaudDocument4 pagesFiche Rimbaudjuliaballe017Pas encore d'évaluation
- Analyse Poèmes Les Cahiers de DouaiDocument5 pagesAnalyse Poèmes Les Cahiers de Douaidiane.lorang07Pas encore d'évaluation
- Copie de Kit Rimbaud MDD-1Document3 pagesCopie de Kit Rimbaud MDD-1irinie.salibPas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud, Les Cahiers de DouaiDocument19 pagesArthur Rimbaud, Les Cahiers de Douaianas.bennounaPas encore d'évaluation
- Rimbaud DissertationDocument5 pagesRimbaud DissertationframboisezahzamPas encore d'évaluation
- Dissert RimbaudDocument2 pagesDissert RimbaudgvnmanonPas encore d'évaluation
- CahierDouai_ArthurRimbaudDocument2 pagesCahierDouai_ArthurRimbaudAngeloPas encore d'évaluation
- Exemples DissertationsDocument10 pagesExemples DissertationssixtineterrienPas encore d'évaluation
- Correction Dissertation Les Cahiers de Douai Une Révolution PoétiqueDocument4 pagesCorrection Dissertation Les Cahiers de Douai Une Révolution Poétiquevirgil.huguinPas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud Cahiers de DOuaiDocument4 pagesArthur Rimbaud Cahiers de DOuaimalekouakaaPas encore d'évaluation
- Citations, Plan Et Exemples Sujet (Rimbaud)Document6 pagesCitations, Plan Et Exemples Sujet (Rimbaud)antoine.boulant2007100% (1)
- Rimbaud DissertationDocument9 pagesRimbaud DissertationLouis LloloPas encore d'évaluation
- Arture RimbaudDocument2 pagesArture Rimbaudclara.onimusPas encore d'évaluation
- Dissert RimbaudDocument6 pagesDissert RimbaudSirine SPas encore d'évaluation
- Dissertation Rimbaud N°1Document8 pagesDissertation Rimbaud N°1Aurélie HABCHIPas encore d'évaluation
- Ophélie d'Arthur Rimbaud: Commentaire et Analyse de texteD'EverandOphélie d'Arthur Rimbaud: Commentaire et Analyse de textePas encore d'évaluation
- Dissertation RimbaudDocument5 pagesDissertation Rimbaudtomvw07Pas encore d'évaluation
- Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"D'EverandCahiers de Douai d'Arthur Rimbaud: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"Pas encore d'évaluation
- Une Oeuvre D MancipationDocument3 pagesUne Oeuvre D MancipationvalfaillyPas encore d'évaluation
- Cahier de Douai RimbaudDocument6 pagesCahier de Douai RimbaudNicolasPas encore d'évaluation
- S8) Axes D'étude de L'ensemble Du RecueilDocument4 pagesS8) Axes D'étude de L'ensemble Du RecueilAshleyPas encore d'évaluation
- Francais - Bac - General Cahier de DouaiDocument13 pagesFrancais - Bac - General Cahier de DouaiChristophe GourbeyrePas encore d'évaluation
- Les Cahiers de DouaiDocument10 pagesLes Cahiers de Douaialae.ouryagli6Pas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud Fiche AuteurDocument6 pagesArthur Rimbaud Fiche Auteurmajoieamouzou4Pas encore d'évaluation
- Themes RimbaudDocument12 pagesThemes Rimbaudrim nouriPas encore d'évaluation
- Fêtes Galantes Romances Sans Paroles Poèmes Saturniens: VerlaineDocument51 pagesFêtes Galantes Romances Sans Paroles Poèmes Saturniens: Verlainenuhurle.wigielPas encore d'évaluation
- DissertationDocument5 pagesDissertationtheo.mayetPas encore d'évaluation
- Les Poètes Maudits - Paul Verlaine, Arthur Rimbaud: Le Symbolisme Dans La Poésie Française Du XIX SDocument3 pagesLes Poètes Maudits - Paul Verlaine, Arthur Rimbaud: Le Symbolisme Dans La Poésie Française Du XIX SAnežka HnojskáPas encore d'évaluation
- Intro RimbaudDocument10 pagesIntro RimbaudPapa SarrPas encore d'évaluation
- Alcools de Guillaume Apollinaire (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandAlcools de Guillaume Apollinaire (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Romantisme - LyrismeDocument5 pagesRomantisme - LyrismetalmatghilesPas encore d'évaluation
- Dissertation RimbaudDocument5 pagesDissertation Rimbaudirinie.salibPas encore d'évaluation
- Dissertation Poésie Adam 14 MaiDocument5 pagesDissertation Poésie Adam 14 MaiAdam TonsiPas encore d'évaluation
- L'histoire de la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle - 1ère - Cours Français - KartableDocument12 pagesL'histoire de la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle - 1ère - Cours Français - KartablesergiodicaprioPas encore d'évaluation
- Symbolisme C-LDocument6 pagesSymbolisme C-LSalas Salvador DiosdadoPas encore d'évaluation
- RimeDocument3 pagesRimeDina ZaaterPas encore d'évaluation
- Com Quand Vous Serez Bien VieilleDocument2 pagesCom Quand Vous Serez Bien VieillelaskriidirPas encore d'évaluation
- Le sonnetDocument2 pagesLe sonnetairpods2pnmPas encore d'évaluation
- Rimbaud 3 Lecture N°1 Vénus Anadyomène - CopieDocument7 pagesRimbaud 3 Lecture N°1 Vénus Anadyomène - CopiecolinecacaPas encore d'évaluation
- Analyse 1 - Ma Bohème - SensationDocument7 pagesAnalyse 1 - Ma Bohème - SensationemeraudestormPas encore d'évaluation
- Louise Labé Je Vis Je Meurs SYNESTHESIEDocument2 pagesLouise Labé Je Vis Je Meurs SYNESTHESIEMuriel Audrey BalloPas encore d'évaluation
- FR20 Te Wo 27 19Document20 pagesFR20 Te Wo 27 19bayekolameganePas encore d'évaluation
- Yves Bonnefoy Traducteur de Keats y Yeats (Tesis de Maxime Durisotti)Document96 pagesYves Bonnefoy Traducteur de Keats y Yeats (Tesis de Maxime Durisotti)billypilgrim_sfePas encore d'évaluation
- Correction Quiz Renaissance Et HumanismeDocument5 pagesCorrection Quiz Renaissance Et HumanismeFleur Cupertino75% (4)
- Portrait de Jenny Colon (1808-1842) .: Ivanhoé (1819) Un Chevalier Inconnu Se Présente Au Tournoi, AvecDocument7 pagesPortrait de Jenny Colon (1808-1842) .: Ivanhoé (1819) Un Chevalier Inconnu Se Présente Au Tournoi, AvecFatima-Ezzahrae Ben-saifPas encore d'évaluation
- Explication Ma BohèmeDocument3 pagesExplication Ma Bohèmetiti75poloPas encore d'évaluation
- Corrigé 8 Nov Q LL N°2 Le Mal CDDDocument10 pagesCorrigé 8 Nov Q LL N°2 Le Mal CDDvincent.victoria05Pas encore d'évaluation
- Explication Lineaire RIMBAUDDocument7 pagesExplication Lineaire RIMBAUDemmanuelarnalPas encore d'évaluation
- FR DhikrcapislamDocument4 pagesFR DhikrcapislamSwirtyPas encore d'évaluation
- A.L. 5 - La Cloche FêléeDocument3 pagesA.L. 5 - La Cloche FêléeIlayda SPas encore d'évaluation
- LA RonsardDocument3 pagesLA RonsardJulien DeckerPas encore d'évaluation
- Sequence 2 La Poesie en 4emeDocument8 pagesSequence 2 La Poesie en 4ememomostasamiPas encore d'évaluation
- Fiche Bilan Sur La PoesieDocument11 pagesFiche Bilan Sur La PoesiebdsaskinPas encore d'évaluation
- 3 Analyse - Ma - BohémeDocument2 pages3 Analyse - Ma - Bohémeeliott.mdc27Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire de Ma BohemeDocument3 pagesAnalyse Linéaire de Ma BohemedraharrePas encore d'évaluation
- Défence Et Illustration de La Langue Française - Partie 4Document4 pagesDéfence Et Illustration de La Langue Française - Partie 4musso-levyPas encore d'évaluation
- Ma BohemeDocument8 pagesMa Bohemeelisabeth.dumandPas encore d'évaluation
- Synthèse Lecture Analytique #1 - BaudelaireDocument2 pagesSynthèse Lecture Analytique #1 - BaudelaireMarion BibangPas encore d'évaluation
- EL A Une Passante BaudelaireDocument2 pagesEL A Une Passante BaudelairegeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Francisco de Quevedo: Petrarquisme Et AntipetrarquismeDocument4 pagesFrancisco de Quevedo: Petrarquisme Et AntipetrarquismeSamata MachadoPas encore d'évaluation
- Ma Bohã Me Arthur Rimbaud AnalyseDocument6 pagesMa Bohã Me Arthur Rimbaud Analysey5rjhnq7d8Pas encore d'évaluation
- LES TECHNIQUES POETIQUES Ou Comment Analyser Un PoèmeDocument10 pagesLES TECHNIQUES POETIQUES Ou Comment Analyser Un PoèmeamalPas encore d'évaluation
- Ma BohèmeDocument2 pagesMa Bohèmeramouna76Pas encore d'évaluation
- Le Dormeur Du Val - D'arthur RimbaudDocument2 pagesLe Dormeur Du Val - D'arthur RimbaudSiham Bouha50% (2)