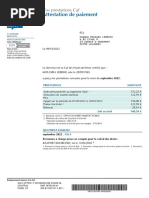Introduction Au Droit Du Multimédia
Introduction Au Droit Du Multimédia
Transféré par
biejf06Droits d'auteur :
Formats disponibles
Introduction Au Droit Du Multimédia
Introduction Au Droit Du Multimédia
Transféré par
biejf06Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Introduction Au Droit Du Multimédia
Introduction Au Droit Du Multimédia
Transféré par
biejf06Droits d'auteur :
Formats disponibles
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
INTRODUCTION
Le droit du multimédia est une branche du droit qui régit les activités
liées aux technologies de l'information, à l'Internet, aux contenus numériques
et aux supports multimédias (textes, images, vidéos, sons, les applications mobiles
etc.). Il recouvre plusieurs domaines juridiques, tels que le Droit d'auteur
et la propriété intellectuelle qui visent à protéger les créations et œuvres
multimédia (logiciels, films, musiques, vidéos, œuvres graphiques, etc.) contre toute
reproduction ou diffusion non autorisée ; le Droit de l'informatique et des
télécommunications qui régi les activités liées aux réseaux de communication,
comme Internet, la téléphonie, et les bases de données. Cela inclut également
la protection des données personnelles et le droit à la vie privée. Nous avons
également le Droit des contrats qui encadre les relations contractuelles
dans le secteur numérique, que ce soit pour la vente de logiciels, les licences
de diffusion, ou les accords de service, comme les contrats de maintenance
et d'hébergement ; la protection des données personnelles qui suppose
que les entreprises et organismes doivent assurer la confidentialité et la sécurité
des données des utilisateurs.
Enfin le droit du multimédia recouvre les domaines de la cybercriminalité
qui lutte contre les infractions commises via Internet, comme le piratage, la fraude
en ligne, et l'usurpation d'identité et le Droit de la consommation qui s'applique
aux plateformes de e-commerce, garantissant les droits des consommateurs (droit
de rétractation, conditions de remboursement, transparence des prix).
Le droit du multimédia est donc essentiel pour encadrer les activités
et les échanges dans le monde numérique, protégeant à la fois les créateurs,
les consommateurs et les utilisateurs. Il importe donc de maîtriser les divers
domaines relevant de cette matière de Droit.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 1
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Chapitre 1 : La propriété intellectuelle et le droit d'auteur
Le droit de la propriété intellectuelle (PI) est une branche du droit qui vise
à protéger les créations de l'esprit. Il se divise principalement en deux grandes
catégories à savoir d’une part la propriété industrielle qui protège les inventions,
les marques, les dessins et modèles, et les indications géographiques.
Ce type de protection est souvent accordé à travers des brevets,
des enregistrements de marques ou des modèles. Elle vise à encourager l'innovation
en offrant une exclusivité d'exploitation au créateur ou inventeur pendant
une période limitée, souvent 20 ans pour un brevet.
D’autre part, nous avons le droit d'auteur et les droits voisins
qui protègent les œuvres littéraires, artistiques et musicales, ainsi que les œuvres
audiovisuelles, les logiciels et certaines bases de données. Le droit d'auteur confère
aux créateurs un ensemble de droits moraux et patrimoniaux, les premiers étant
inaliénables et perpétuels (comme le droit au respect de l'œuvre), tandis que
les secondes sont cessibles et permettent l'exploitation commerciale de l'œuvre pour
une période limitée (par exemple, 70 ans après la mort de l'auteur en France et dans
de nombreux pays).
Le droit d'auteur est donc une branche de la propriété intellectuelle
qui protège les créations originales de l'esprit, telles que les œuvres littéraires,
artistiques et audiovisuelles. Ce droit octroie à l'auteur des droits patrimoniaux
(reproduction, distribution et adaptation) et des droits moraux (droit de paternité
et de respect de l'œuvre).
Ce chapitre nous permettra donc de comprendre en quoi consiste la propriété
industrielle (Section 1) et maîtriser le contenu du droit d’auteur et des droits voisins
(Section 2)
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 2
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Section 1 : La propriété industrielle
La propriété industrielle est un sous-ensemble de la propriété intellectuelle,
qui se concentre sur la protection des créations à finalité industrielle
et commerciale. Elle couvre plusieurs types de droits qui permettent
aux entreprises et aux inventeurs de protéger leurs innovations, leurs signes
distinctifs, et leurs conceptions, garantissant ainsi une exclusivité d'exploitation
sur le marché. Cette section nous permettra d’identifier les différents éléments
qui composent la propriété industrielle (Paragraphe 1) en vue de déterminer
son importance et les procédures de protection et institutions (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les droits de la propriété industrielle
La propriété industrielle protège les inventions, les marques, les dessins
et modèles, et les indications géographiques. Ce type de protection est souvent
accordé à travers des brevets, des enregistrements de marques ou des modèles.
Elle vise à encourager l'innovation en offrant une exclusivité d'exploitation
au créateur ou inventeur pendant une période limitée, souvent 20 ans
pour un brevet. Les principales catégories de droits en matière de propriété
industrielle sont :
Les brevets : Ils protègent les inventions, c'est-à-dire des solutions techniques
nouvelles et inventives à un problème technique. Un brevet donne à son
titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention pour une durée limitée
(généralement 20 ans). En contrepartie, le titulaire doit rendre l'invention
publique, permettant ainsi de contribuer aux avancées technologiques.
Les marques : Une marque protège les signes distinctifs (nom, logo, slogan,
etc.) qui permettent de différencier les produits ou services d'une entreprise
de ceux de ses concurrents. Elle est accordée pour une durée initiale
de 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment tant que la marque
est utilisée. Les marques peuvent inclure des mots, des logos, des sons,
voire des formes (comme celle d'un produit ou de son emballage).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 3
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Les dessins et modèles : Ils protègent l'apparence visuelle d'un produit
ou d'une partie de produit, incluant la forme, la couleur, les lignes
et la texture. Contrairement aux brevets, ils ne protègent pas la fonctionnalité
du produit mais uniquement son design. Ce droit est accordé en côte d’ivoire
pour une durée de 5 ans, renouvelable jusqu'à 15 ans, et offre aux titulaires
l'exclusivité sur l'utilisation de leurs créations visuelles.
Les indications géographiques: Elles protègent les produits qui proviennent
d'une région spécifique et qui tirent une certaine qualité ou réputation
de leur origine géographique (par exemple, le Champagne, le Roquefort,
ou encore le Comté). Ce droit permet de valoriser les produits locaux
et de garantir aux consommateurs une qualité et un savoir-faire traditionnel.
Ces droits de la propriété industrielle peuvent être transférés ou cédés,
permettant à leur titulaire de les vendre, de les exploiter commercialement
(par exemple, via des licences), ou de les faire valoir en justice en cas
de contrefaçon.
Paragraphe 2 : Importance de la propriété industrielle, procédures
et institutions de protection
La propriété industrielle joue un rôle essentiel dans la compétitivité
économique des entreprises. En garantissant des droits exclusifs, elle permet
aux entreprises de rentabiliser leurs investissements en recherche et développement
et de protéger leur image de marque. Cela favorise également la concurrence
en encourageant les entreprises à innover pour se démarquer.
En Côte d'Ivoire, la protection de la propriété intellectuelle (PI) repose
sur un cadre législatif national et régional, avec une adhésion à des conventions
internationales importantes. Le pays est membre de l'Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI), une organisation qui regroupe plusieurs pays
africains pour harmoniser la protection des droits de PI au niveau régional.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 4
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
En effet, la Côte d'Ivoire est membre de l'OAPI, qui regroupe 17 pays africains
francophones et qui offre une procédure unifiée pour le dépôt et la gestion
des droits de propriété intellectuelle. Les droits de PI déposés auprès de l'OAPI
sont automatiquement valables dans tous les pays membres. L'OAPI, basée
au Cameroun, couvre des droits tels que les brevets, les marques, les dessins
et modèles industriels, les indications géographiques et les obtentions végétales.
Elle gère également la protection des droits d'auteur et des droits voisins.
Les brevets doivent être déposés auprès de l'OAPI. Pour qu'un brevet soit octroyé,
l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et avoir une application
industrielle. La protection des marques est également régie par les règles de l'OAPI.
La durée initiale de protection est de 10 ans, renouvelable indéfiniment par périodes
de 10 ans. Les marques permettent aux entreprises de protéger leurs signes
distinctifs (noms, logos, etc.) et de se démarquer sur le marché.
La protection des dessins et modèles industriels permet de protéger l'aspect
esthétique des produits. Ce droit est accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable
jusqu'à 15 ans, et offre aux titulaires l'exclusivité sur l'utilisation de leurs créations
visuelles. La protection des droits d’auteur et droits voisins est accordée
pour la durée de la vie de l'auteur plus 70 ans après son décès.
Les droits voisins, qui couvrent les droits des artistes interprètes, producteurs
de phonogrammes et organismes de radiodiffusion, sont également protégés.
Cette protection est assurée par le Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA),
qui veille au respect et à l'exploitation légale des œuvres des créateurs ivoiriens.
Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est signataire de plusieurs conventions
internationales en matière de propriété intellectuelle, notamment :
La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques
Les accords de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
liés au commerce (ADPIC), qui obligent les membres respecter les normes
minimales de protection en PI.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 5
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
En somme, la propriété industrielle est un levier majeur de la protection
de l'innovation et de la différenciation commerciale, contribuant à l'émergence
d'une économie dynamique et innovante .
Outre la propriété industrielle le droit d’auteur et les droits voisins constituent
la seconde composante de la propriété intellectuelle.
Section 2 : Les principes généraux du droit d’auteur et les droits voisins
Le droit d'auteur est un ensemble de droits exclusifs conférés aux créateurs
d'œuvres originales, comme les écrivains, artistes, musiciens, photographes
et autres créateurs, pour protéger leurs créations. Il comporte deux types
de droits : Les droits moraux qui sont inaliénables et garantissent au créateur
le respect de son œuvre et Les droits patrimoniaux qui permettent au créateur
d'exploiter son œuvre financièrement, généralement pour une durée limitée ?
Après avoir examiné le cadre juridique général du droit d’auteur et les droits
protégés (paragraphe 1), nous verrons en quoi consistent les droits voisins
(paragraphes 2)
Paragraphe 1 : Le cadre juridique général du droit d’auteur
et les droits protégés
En Côte d'Ivoire, le cadre juridique du droit d'auteur est principalement régi par
la Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins. Cette législation établit les droits des auteurs sur leurs œuvres de l'esprit,
ainsi que les droits voisins, tels que ceux des artistes interprètes et des producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes.
La Convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886 constitue également une
source importante du droit d'auteur. Cette Convention établit le principe
de l'assimilation de l'auteur étranger à l'auteur national, qui vise à garantir,
sous certaines conditions, une égalité de traitement entre les auteurs étrangers
et nationaux.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 6
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
D’autre part, la convention établit une protection minimum des auteurs
en prévoyant certains droits minimums au profit de ceux-ci. Cette convention
peut être directement invoquée par un Ivoirien et prime de plus sur le droit interne.
De plus, le respect de cette convention est imposé par deux autres conventions:
l’Accord TRIP’s et le traité OMPI du 20 novembre 1996.
L’Accord TRIP’s, qui constitue une des annexes de l’Accord de Marrakech
instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, a pour philosophie
de promouvoir le respect effectif des droits de propriété intellectuelle
dans le respect du principe de la libre concurrence.
Le traité OMPI sur le Droit d’Auteur adopté à Genève le 20 décembre 1996
a pour ambition d’uniformiser la protection des droits d’auteur et de tenir compte
des développements des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Divers principes concernant l’objet de la protection par le droit d’auteur,
les droits conférés à l’auteur, les sanctions contre les atteintes aux droits d’auteur
etc., y sont énoncés.
En ce qui concerne les droits protégés, il faut retenir que le droit d'auteur
protège toute œuvre originale et coulée dans une certaine forme. Il en résulte
que, pour qu'une création soit protégée par le droit d'auteur, deux conditions doivent
être remplies:
La condition d’originalité : selon la doctrine et la jurisprudence, une œuvre
est originale si elle porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire
apparaît comme le fruit de son effort intellectuel.
Par conséquent, ne seront pas protégées par le droit d’auteur parce que
l’auteur n’aura pas pu exercer sa liberté créative et investir l’œuvre de son
empreinte ; nous avons dans ce cas :
• les formes réalisées exclusivement par une machine ou émanant
spontanément de la nature: ainsi par exemple, un paysage naturel, la mer,
ou un arbre, n'est pas protégé par le droit d'auteur et peut donc être librement
reproduit (mais il n'en ira pas de même de la photographie fixant un tel objet).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 7
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
• les simples reproductions serviles de ce qui existe (qui ne contiennent rien
d'original puisque par hypothèse elles sont serviles) ;
• les informations brutes: l'information en elle-même échappe à la protection
par le droit d'auteur (exemple: les données biographiques sur un peintre, l'adresse
d'un musée, la taille d'un tableau, le nombre de visiteurs d'une exposition,
le nombre de photographies disponibles dans une base de données etc.).
Les données factuelles échappent au droit d'auteur mais le droit d'auteur
s'appliquera à la sélection et à la présentation des données.
Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection, il faut en outre qu'elle soit coulée
dans une certaine forme susceptible d'être appréhendée par les sens (même si cette
perception implique l’intervention d’un appareil, comme c'est le cas d'une œuvre
accessible en ligne et donc qui ne peut être perçue que par une personne possédant
un ordinateur et un accès Internet). Il en résulte que le droit d'auteur ne protège pas:
• les simples idées: une idée, aussi “géniale” ou “originale” qu'elle soit, n'est
jamais susceptible d'appropriation, ni par le droit d'auteur ni par un autre moyen;
• les méthodes ou les styles, même originaux, ne sont pas protégés
par le droit d'auteur: on pourra donc s'inspirer, lors de la création d'un site web,
des styles utilisés par d'autres, pour autant que l'on ne copie aucun élément formel
original.
Par ailleurs, une fois déterminée l’existence d’une œuvre protégée par le droit
d’auteur, il convient d’examiner ce que cette protection signifie concrètement,
c'est-à-dire quels sont les droits de l'auteur (ce qu'il peut interdire) et quelles
sont les limites à ces droits (ce à quoi il ne peut pas s'opposer).
On considère que l’auteur dispose de deux types de droits : d’une part
les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits qui permettent à l'auteur
de retirer le bénéfice économique de l’exploitation de l’œuvre, ils permettent
au créateur d'exploiter son œuvre financièrement, généralement pour une durée
limitée (par exemple, 70 ans après la mort de l'auteur dans de nombreux pays).
D’autre part, il y a les droits moraux, qui visent à protéger l'intégrité
de l’œuvre, la relation de celle-ci avec son auteur et la réputation de celui-ci.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 8
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Comme droits patrimoniaux, nous avons : le droit de reproduction
qui est le droit de copier, imprimer ou enregistrer l'œuvre ; et le droit
de représentation qui suppose le droit de diffuser l'œuvre au public.
Après expiration des droits patrimoniaux, l'œuvre tombe dans le domaine
public, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée librement par tous, sous réserve
du respect des droits moraux, qui perdurent indéfiniment dans certains pays.
Les droits patrimoniaux étant des droits “économiques”, ils peuvent
être cédés ou faire l’objet de contrats de licence. Les droits moraux par contre,
compte tenu de leur lien étroit avec la personnalité de l’auteur, sont définis comme
incessibles et ne peuvent tout au plus que faire l'objet d'aménagements limités dans
le cadre d'un contrat précis.
Le droit d'auteur varie d'un pays à l'autre, bien que de nombreuses nations
aient harmonisé leurs lois avec des traités internationaux, comme la Convention
de Berne.
Le droit d'auteur ainsi présenté, il importe de déterminer en quoi consistent
les droits voisins.
Paragraphe 2 : Les droits voisins
Les droits voisins au droit d'auteur protègent les acteurs qui, bien qu'ils
ne soient pas les créateurs directs d'une œuvre, contribuent de manière significative
à sa diffusion et à sa valorisation. Ces droits voisins s'appliquent principalement à :
Artistes interprètes ou exécutants : Ils ont le droit de contrôler l'utilisation
de leurs performances et de percevoir des redevances. Par exemple,
un chanteur ou un acteur peut décider de la diffusion de ses prestations
et en recevoir une rémunération.
Producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes : Les producteurs
de musique ou de vidéos détiennent les droits d'exploitation
sur les enregistrements sonores ou audiovisuels qu'ils produisent.
Cela signifie qu'ils peuvent autoriser ou interdire la reproduction, la diffusion
ou l'utilisation de leurs enregistrements, et en percevoir des redevances.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 9
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Organismes de radiodiffusion : Les chaînes de radio et de télévision
ont des droits voisins leur permettant de contrôler l'exploitation de leurs
émissions. Cela protège leurs diffusions contre des usages non autorisés,
comme la retransmission ou l'enregistrement sans autorisation.
Les droits voisins permettent donc aux titulaires de contrôler plusieurs aspects
de l'exploitation de leurs œuvres ou performances, comme :
La reproduction : autoriser ou interdire la copie de leurs œuvres enregistrées.
La communication au public : décider si leurs prestations, enregistrements
ou émissions peuvent être diffusées publiquement, à la télévision, en radio
ou sur Internet.
La mise à disposition : permettre ou restreindre l'accès à leurs œuvres
en ligne, souvent par le biais des plateformes de streaming.
En général, les droits voisins sont accordés pour une durée plus courte
que les droits d'auteur classiques. Par exemple, dans de nombreux pays, ces droits
sont valables pendant 50 ans après la réalisation de l'enregistrement
ou de la performance, bien que certains pays offrent une durée plus longue.
Les droits voisins sont donc essentiels pour encourager l'industrie musicale,
audiovisuelle et des médias, en reconnaissant les contributions des interprètes,
producteurs et diffuseurs tout en régulant l'utilisation de leurs œuvres.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 10
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Chapitre 2 : Le droit de l'informatique et des télécommunications
Le droit de l'informatique et des télécommunications est un domaine
juridique qui encadre l'utilisation des technologies de l'information,
des réseaux de télécommunication et de l'Internet. Il traite des questions liées
à la protection des données, à la sécurité des systèmes, aux contrats
informatiques, et aux responsabilités des acteurs dans le secteur numérique.
Avec la montée en puissance de l’informatique, de l’internet
et des télécommunications, ce domaine du droit est devenu essentiel
pour protéger les données, encadrer l’usage des réseaux numériques
et préserver les droits des individus et des entreprises.
Ce chapitre sera consacrée d’une part à au droit de l’informatique (section
1) et d’autre part au droit de la communication (section 2)
Section 1 : Le droit de l'informatique
Le droit de l'informatique, également appelé droit des technologies
de l'information et de la communication (TIC), est une branche du droit
qui encadre l'utilisation des technologies numériques et des systèmes
d'information. Ce domaine est relativement récent et regroupe plusieurs
disciplines juridiques pour traiter des questions liées aux nouvelles
technologies. Ainsi regroupe-t-il d’une part la protection des données
personnelles, la propriété intellectuelle et droit d'auteur ainsi que la cyber
sécurité (paragraphe 1) et d’autre part, le e-commerce et la régulation
de l’intelligence artificielle (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La protection des données personnelles, Propriété
intellectuelle et droit d'auteur et Cyber sécurité
La protection des données personnelles concerne la collecte, le traitement,
et la conservation des informations personnelles des individus.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 11
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
en vigueur dans l'Union européenne depuis 2018, est un cadre juridique
majeur. Il impose des obligations aux entreprises et aux organismes
pour garantir le respect de la vie privée des utilisateurs et des citoyens.
En informatique, la question de la propriété intellectuelle
est primordiale, notamment pour les logiciels, les bases de données,
et les œuvres numériques (images, textes, vidéos). Les logiciels peuvent
être protégés par le droit d'auteur, et dans certains cas, par des brevets.
Les bases de données sont également protégées par le droit sui generis,
ce qui assure un droit exclusif au créateur de la base de données.
Par ailleurs, avec l'augmentation des cyberattaques, le droit
de l'informatique inclut également des lois visant à prévenir, détecter,
et punir les infractions liées aux systèmes d'information.
En effet, la cybercriminalité englobe les activités criminelles impliquant
des systèmes informatiques, des réseaux ou des données. Elle se décline sous
plusieurs formes et constitue une menace majeure pour les individus,
les entreprises et les États. Ainsi avons-nous le piratage qui est l’accès
non autorisé aux systèmes ou données informatiques. Les hackers peuvent
voler des informations, introduire des logiciels malveillants, ou perturber
les services ; l’escroquerie en ligne et phishing qui consiste en l’utilisation
de faux sites web ou e-mails pour tromper les individus et obtenir
leurs données personnelles ou financières. Il y a aussi, la Rançongiciel
(ransomware) qui est un type de malware qui bloque l'accès aux données
jusqu'à ce qu'une rançon soit payée ; l’usurpation d'identité revient à voler
l'identité d'une personne pour réaliser des actions frauduleuses en ligne.
Enfin, nous avons la diffusion de contenus illégaux qui implique
la propagation de contenus illicites, comme des contenus haineux,
de la pornographie illégale, ou des incitations à la violence.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 12
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Le droit prévoit donc des mesures pour renforcer la sécurité
des systèmes et responsabiliser les entreprises dans la protection de leurs
données. Ainsi en Côte d’Ivoire, le législateur a paré à toute éventualité
en mettant sur pied des armes juridique pour protéger les Ivoiriens
dans le domaine général des TIC. Tous les citoyens Ivoiriens devraient avoir
connaissance mais aussi possession, car la règle « Nemo censetur ignorare
legem » s’applique toujours ! Ainsi le législateur Ivoirien a mis en place :
L’ordonnance N° 2012-293 du 21 Mars 2012 relative aux
Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la
Communication, pour régir le secteur des télécommunications/TIC.
La loi N° 2013-450 du 19 Juin 2013 relative à la protection des données
à caractère personnel, pour protéger et réglementer l’utilisation des données
à caractère personnel de tous.
La loi N° 2013-546 du 30 Juillet 2013 relative aux transactions
électroniques, pour réguler le secteur des échanges virtuels.
La loi N° 2013 -451 du 19 Juin 2013 relative à la lutte contre
la cybercriminalité, pour parer aux nouveaux types d’infractions : les Cyber
infractions.
Par ailleurs, pour protéger les systèmes, les données et les identités,
le gouvernement ivoirien s’est doté de lois et de règlements. Il a adopté lors
du Conseil des ministres du 22 décembre 2021, une Stratégie nationale
de Cyber sécurité 2021-2025, qui définit les grands axes dont certains portent
sur la protection du cyberespace, le renforcement la confiance numérique
et la coopération internationale.
Paragraphe 2 : Le e-commerce et la régulation de l'intelligence
artificielle (IA)
Le développement du commerce électronique a conduit à l'apparition
de nouvelles règles pour les transactions en ligne, les paiements électroniques,
et les contrats électroniques.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 13
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
La législation européenne, avec des directives comme la directive
sur le commerce électronique, encadre la vente en ligne, le droit
de rétractation, et les obligations d’information du vendeur.
Internet étant un espace public, il existe des règles spécifiques
pour encadrer la liberté d'expression et la responsabilité des plateformes
en ligne. Cela inclut les réseaux sociaux, les forums, et les moteurs
de recherche. Le droit de l'informatique s’assure que les plateformes respectent
les droits des utilisateurs tout en luttant contre les contenus illégaux, comme
la haine en ligne ou les contenus diffamatoires.
Cette branche du droit vise à protéger les consommateurs contre
les pratiques frauduleuses, les arnaques, et la publicité trompeuse en ligne.
Les consommateurs bénéficient également de droits renforcés, tels que
le droit de rétractation et la protection contre les abus. Par ailleurs, avec les
avancées dans l’IA, de nouvelles réglementations émergent pour encadrer
son usage, notamment en ce qui concerne l’éthique, la transparence,
et la non-discrimination.
En Europe, tout comme en Afrique, un cadre législatif spécifique
est en cours d’élaboration pour définir les normes de sécurité et de respect
des droits fondamentaux dans l’usage de l’IA.
Le droit de l'informatique est en perpétuelle évolution, car il doit
constamment s’adapter aux nouvelles technologies et aux usages numériques.
Ce domaine est aujourd’hui incontournable, car il touche de nombreux
aspects de la vie moderne, tant pour les particuliers que pour les entreprises
et les gouvernements.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 14
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Section 2 : Le droit de la communication
Le droit de la communication est une branche du droit qui régit
l’ensemble des moyens et des canaux de diffusion de l’information, que ce soit
à travers la presse écrite, la télévision, la radio, Internet, ou encore les réseaux
sociaux.
En Côte d’Ivoire, le droit de la communication est régi
par la loi N° 2017-868 du 27 Décembre 2017 portant régime juridique
de la communication audiovisuelle. Avec l'évolution rapide des technologies
et la multiplication des supports numériques, le droit de la communication
s'étend sur de nombreux aspects.
Paragraphe 1 : Les aspects liés aux droits et devoirs des acteurs
La liberté d'expression est un droit fondamental, souvent encadré
par des lois pour garantir la possibilité de s’exprimer librement,
tout en protégeant les autres droits, comme le respect de la vie privée.
Les médias et les journalistes ont le droit de diffuser des informations d’intérêt
public, mais ils doivent aussi respecter certaines limites, notamment
en matière de diffamation, d'incitation à la haine, et de diffusion de fausses
informations.
Aussi, le droit de la communication inclut des règles pour protéger
la vie privée des individus, en particulier lorsqu'il s'agit de médias
et d'informations partagées en ligne. Le droit à l'image est également protégé,
ce qui signifie que l’image d’une personne ne peut être diffusée sans son
consentement, sauf dans certaines situations d’intérêt public.
Le Droit de la presse est par ailleurs un domaine qui régule les activités
des entreprises de presse, en garantissant leur indépendance et en établissant
des règles spécifiques, telles que le respect de l’éthique journalistique,
la protection des sources, et la lutte contre les fausses informations.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 15
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Le droit de la presse impose également des sanctions en cas de dérapages,
comme la diffamation ou l'atteinte à la présomption d'innocence.
Le droit de l’audiovisuel encadre la communication à travers les chaînes
de télévision, les stations de radio, et plus récemment les plateformes
de streaming. Ce domaine inclut la régulation des contenus, des publicités,
et des quotas de diffusion, notamment pour encourager la diversité culturelle
et la protection des mineurs. Des instances de régulation, comme le Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France (devenu l'ARCOM), veillent
à l'application de ces règles.
En Côte d’Ivoire, c’est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
(HACA) qui est l'Institution chargée de la régulation de la Communication
Audiovisuelle. Elle a pour mission principale de garantir et d'assurer la liberté
et la protection de la communication audiovisuelle dans le cadre de la loi.
Paragraphe 2 : Les aspects liés à la responsabilité des acteurs
Avec la montée en puissance des plateformes numériques (réseaux sociaux,
forums, moteurs de recherche), le droit de la communication s’étend également
à la responsabilité des intermédiaires en ligne. Ces plateformes doivent veiller
à lutter contre les contenus illicites, tels que la violence, la haine,
et la désinformation, tout en respectant la liberté d’expression des utilisateurs.
En Europe, la directive sur les services numériques (Digital Services Act)
impose aux plateformes de nouvelles obligations en matière de transparence
et de modération. La publicité en tant que moyen de communication
commerciale est strictement encadrée pour éviter les pratiques trompeuses
ou manipulatrices, notamment en ligne. Le droit de la communication inclut
des règles sur les contenus publicitaires, en particulier pour protéger
les consommateurs, et impose des restrictions dans certains domaines
sensibles (comme l’alcool, le tabac ou les produits pour enfants).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 16
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
La transparence des publicités sur les réseaux sociaux, y compris
les partenariats avec des influenceurs, est également régulée.
Notons aussi que le droit d’accès à l’information permet aux citoyens
de demander et d’obtenir des informations auprès des institutions publiques.
Ce droit est un moyen de garantir la transparence et la responsabilité
des gouvernements et des organisations publiques. Dans certains pays,
des lois garantissent aux citoyens un droit d’accès aux documents
administratifs.
Enfin, le droit de la communication a prévu des mécanismes de lutte contre
la désinformation et les discours de haine. Ainsi, avec la diffusion rapide
de l’information sur Internet, le droit de la communication inclut des mesures
pour lutter contre les fausses informations et les discours de haine. .
Le droit de la communication évolue rapidement pour s'adapter
aux nouvelles technologies et aux nouvelles formes de communication,
et reste essentiel pour garantir un équilibre entre la liberté d'expression,
la protection des droits individuels, et le maintien d’un espace public sain
et sécurisé.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 17
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Chapitre 3 : Le Droit des contrats numériques
Le droit des contrats numériques est une branche du droit
des obligations qui s’applique spécifiquement aux contrats formés, exécutés
ou conclus par voie électronique. Avec la transformation numérique
des échanges commerciaux, les contrats numériques sont devenus essentiels
pour réguler les transactions en ligne. Nous verrons donc les conditions
de formation, la conclusion, les principales caractéristiques et la typologie
des contrats numériques (Section 1), puis nous en déterminerons le cadre
juridique ainsi que les avantages et défis (Section 2)
Section1 : Les conditions de formation, la conclusion, les caractéristiques
et la typologie des contrats numériques
Paragraphe 1 : Les conditions de formation et de conclusion
des contrats numériques
Les contrats numériques désignent les accords juridiquement
contraignants conclus via des supports électroniques, souvent dans le cadre
d'une transaction en ligne. Ils s'inscrivent dans le cadre général du droit
des contrats, mais présentent des spécificités liées à leur nature numérique
et au contexte dans lequel ils sont conclus.
En ce qui concerne la formation des contrats numériques, il faut retenir
que comme pour les contrats traditionnels, les principes de base restent
applicables à savoir : le consentement mutuel qui suppose que les parties
doivent manifester leur volonté de contracter, ce qui peut être exprimé par des
clics (par exemple, un bouton "J'accepte"). Ensuite, il y a l’offre
et acceptation ; en effet, la présentation des conditions générales de vente
(CGV) sur un site web constitue une offre. L’acceptation se matérialise souvent
par une validation électronique. Enfin, la capacité juridique des parties
(mineurs émancipés ou majeurs sains, etc.).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 18
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
La formation des contrats numériques suit également certaines étapes
que sont la présentation de l’offre où le professionnel ou l'une des parties
met à disposition une offre contractuelle claire, souvent accompagnée
de Conditions Générales de Vente (CGV) ou d’un devis en ligne. Ensuite,
l’acceptation qui est souvent matérialisé par :
Le clic sur un bouton.
Une signature électronique.
Un paiement en ligne.
Enfin, l’accusé de réception, obligatoire dans de nombreuses juridictions
pour confirmer la réception de l’acceptation (notamment dans le cadre
du commerce électronique).
La conclusion des contrats numériques se fait généralement à travers
la signature électronique qui joue un rôle central. Elle est revêt trois formes
que sont la signature simple (cocher une case) ; la signature avancée (Basée
sur des certificats numériques) et la signature qualifiée qui est le niveau
le plus élevé, nécessitant une vérification stricte de l’identité (équivalente à une
signature manuscrite). Les contrats électroniques sont juridiquement valides
s'ils respectent les conditions de droit commun
Paragraphe 2 : Les caractéristiques et la typologie des contrats
numériques
Les contrats numériques sont formés et exécutés sans support papier,
généralement via des sites web, applications mobiles ou plateformes
numériques. On parle de dématérialisation. Les contrats numériques sont
également caractérisés par la conclusion qui repose sur des actes
électroniques, comme cliquer sur un bouton "Accepter" ou signer
électroniquement.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 19
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Une autre caractéristique est la facilité d'accès car les parties peuvent
conclure des contrats à distance, souvent en quelques clics, sans nécessité
de se rencontrer physiquement. Les contrats numériques peuvent prendre
plusieurs formes telles que :
- Les achats en ligne : Lorsque vous achetez un produit ou un service sur
un site e-commerce, vous concluez un contrat numérique en acceptant
les conditions générales de vente (CGV).
- Les licences logicielles et abonnements numériques : Exemple :
abonnements à des plateformes de streaming (Netflix, Spotify), utilisation
de logiciels SaaS (Software as a Service).
- Les smart contracts qui sont des programmes informatiques
auto-exécutables sur une blockchain, où les obligations des parties
s’exécutent automatiquement une fois les conditions remplies.
- Les prestations de services numériques telles que la création de sites
web, les services de cloud computing, ou toute prestation dématérialisée
conclue en ligne.
Section 2 : Le cadre juridique, les avantages, enjeux et défis
des contrats numériques
Le cadre juridique des contrats numériques est un domaine clé du droit
des affaires et des technologies, structuré autour de plusieurs normes
et principes juridiques. Les contrats numériques ont plusieurs avantages
(Paragraphe 1) mais font également face à plusieurs enjeux et défis
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le cadre juridique et les avantages des contrats
numériques
Les contrats numériques ont la même force juridique que les contrats
traditionnels sous format papier, tant qu’ils respectent certaines conditions
(identité des parties, consentement libre et éclairé, etc.).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 20
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Aussi, en vertu des règlements comme le Règlement eIDAS qui prévoit
l'interopérabilité des systèmes nationaux d'identification électronique
entre les États membres de l'UE, une signature électronique qualifiée
a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite.
De même, les lois nationales (par exemple, le Code civil français et la loi
ivoirienne n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions
électroniques) incluent des dispositions spécifiques sur les contrats
numériques, comme dans les articles relatifs à la preuve électronique.
En effet, en cas de litige, les données électroniques (logs, e-mails, certificats
numériques) peuvent servir de preuve, sous réserve de leur fiabilité
et de leur intégrité. La convention des Nations unies sur l’utilisation
des communications électroniques dans les contrats internationaux constitue
également une source du droit des contrats numériques
Par ailleurs, les prestataires doivent garantir la sécurité des plateformes
utilisées pour la conclusion des contrats. Les contrats numériques incluent
souvent des clauses de juridiction et de droit applicable pour résoudre
les litiges. Il existe aussi le règlement des différends en ligne comme
la plateforme européenne de résolution des litiges en ligne dénommée
Online Dispute Resolution (ODR). Cette plateforme propose de relier
toutes les entités nationales de règlement alternatif des litiges.
Elle fonctionne dans toutes les langues officielles de l'Union européenne
et est opérationnelle depuis le 15 février 2016.
Comme avantages des contrats numériques, nous pouvons noter la rapidité
et l’efficacité dans la conclusion et l’exécution en raison de la réduction
des coûts (moins de papier, pas de déplacement). Nous avons aussi
l’Accessibilité qui permet de contracter à tout moment et partout
dans le monde.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 21
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Paragraphe 2 : Les enjeux et défis des contrats numériques
Les contrats numériques, bien qu'ils apportent flexibilité et rapidité,
soulèvent plusieurs enjeux et défis d'ordre juridique, technique, économique,
et éthique.
En effet, sur le plan juridique, nous observons d’une part
une sécurisation du consentement à travers l’Authentification des parties
qui permet de s’assurer que les parties impliquées dans un contrat numérique
sont bien celles qu'elles prétendent être (lutte contre l’usurpation d’identité)
et d’autre part, leur consentement éclairé qui permet de garantir
que les utilisateurs comprennent réellement les termes du contrat, souvent
présentés sous forme de conditions générales longues et complexes.
En ce qui concerne la valeur probatoire, l’enjeu est la fiabilité
des preuves électroniques car il faut s’assurer que les documents
numériques, journaux d’activité ou signatures électroniques peuvent
être admis en justice. Aussi, il y a la préservation des preuves
car les technologies évoluent rapidement, ce qui rend nécessaire
une conservation sécurisée et accessible des contrats numériques
sur le long terme. Enfin un enjeu juridique important est l’harmonisation
législative car les lois nationales et internationales peuvent diverger,
notamment en matière de compétence juridictionnelle et de droit applicable,
créant une insécurité juridique dans les transactions transfrontalières.
Au titre des enjeux Techniques, nous pouvons noter la sécurité
qui concerne d’une part la protection contre les cyberattaques
car les contrats numériques sont exposés à des risques de piratage
ou de falsification et d’autre part, l’authentification sécurisée
car les méthodes comme la signature électronique doivent être suffisamment
robustes pour résister aux attaques.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 22
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Il est par ailleurs très important de noter que les contrats numériques
doivent rester lisibles et utilisables malgré les évolutions rapides
des technologies et formats (problème de l'obsolescence numérique).
Comme enjeux économiques, nous pouvons citer l’accès à la technologie
car certaines entreprises ou particuliers, en particulier dans les régions
en développement, peuvent être exclus en raison du manque d’infrastructures
ou de compétences numériques. Aussi, la mise en œuvre de solutions
sécurisées (ex : signature électronique qualifiée, plateformes de gestion
de contrats) peut représenter un coût élevé. Un autre enjeu économique
à ne pas négliger est la concurrence internationale. En effet, la mondialisation
des échanges numériques nécessite de gérer la concurrence entre différentes
juridictions et réglementations, notamment face à des géants technologiques.
Enfin pour ce qui est des enjeux éthiques et sociaux, ils portent
sur la transparence car les conditions générales d’utilisation des contrats
numériques sont souvent trop complexes ou rédigées dans des termes
favorisant une partie (souvent l’entreprise), limitant la compréhension
par l’utilisateur. Aussi, certains contrats numériques peuvent inclure
des clauses abusives ou limitant les droits des consommateurs (par exemple,
via des algorithmes ou des mécanismes de consentement "opt-out").
Les contrats numériques impliquent également très souvent, la collecte
et le traitement de données personnelles, soulevant des questions
sur leur protection et usage éthique.
Les défis liés aux contrats numériques concernent le domaine
de l’innovation et la résolution des conflits.
En effet, les smart contracts, automatisés via la blockchain
(Mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs
liés les uns aux autres et protégés contre toute modification), posent des défis
en termes de compréhension juridique (caractère irréversible des transactions,
absence d’interprétation humaine en cas de litige).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 23
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Ensuite, les législations actuelles peinent parfois à encadrer ces nouvelles
formes de contrats et l’intelligence artificielle peut générer ou exécuter
des contrats, mais cela soulève des questions de responsabilité en cas d'erreur
ou de biais.
En matière de résolution des litiges, les défis résident d’une part
au niveau de la complexité transfrontalière car il faut identifier quelle
juridiction est compétente pour résoudre un litige lié à un contrat numérique
dans un contexte international ; d’autre part, il y a le coût des procédures
car même si le numérique facilite la conclusion de contrats, les litiges peuvent
être coûteux et complexes à résoudre.
Les contrats numériques représentent donc une opportunité majeure
pour la dématérialisation des échanges, mais leur adoption à grande échelle
nécessite de relever les défis liés à la sécurité, à la réglementation et à l'éthique.
Le Droit des contrats numériques continue d’évoluer pour s’adapter aux
innovations technologiques et aux nouveaux usages du commerce
électronique. Une collaboration entre les législateurs, les entreprises
et les experts techniques est essentielle pour construire un cadre à la fois
protecteur et évolutif.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 24
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Chapitre 4 : Le droit du consommateur appliqué au multimédia
Le développement rapide ces dernières années des nouvelles technologies
et l’accès à l’information via la généralisation de l’internet a permis une forte
expansion du e-commerce par l’accroissement du nombre de consommateurs
Ivoiriens. Au moyen d’un marché offrant plusieurs services aussi diversifié
que dynamique, Internet admet une véritable ascension par l’accomplissement
de plusieurs actes sur cette plateforme immatérielle, dont les contrats
électroniques.
Au cours de ces dix dernières années, notre société a été dominée
par une véritable révolution technologique, une révolution en croissance
rapide dans le monde actuel. Les progrès des TIC technologies de l’information
et de la communication ont fait considérablement évoluer le quotidien
de plusieurs en offrant de nouvelles possibilités aux consommateurs
et aux entreprises à travers la fluidité du marché. Cette sphère immatérielle
qu’est internet étant utilisée pour l’exécution de plusieurs opérations
dont l’achat, la communication etc. Le commerce électronique connaît donc
un grand essor en Côte d’Ivoire depuis quelques années.
Autrement appelé e-commerce ou vente en ligne, le commerce en ligne
regroupe les transactions commerciales s’opérant à distance par le biais
d’interfaces électroniques ou digitales connectées à internet.
Au moyen des terminaux connectés à Internet, ce commerce électronique
se matérialise à travers de très nombreux types de prestation dont d’une part
entre entreprises (business to business ou « B to B ») et d’autres part
en ce qui concerne les consommateurs, un commerce dit « résidentiel »,
(business to consumer ou « B to C ». Sachant que le marché ivoirien
est l’un des plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest offrant de nombreuses
opportunités d’investissement avec 40% du PIB de l’UEMOA, au regard
de l’expansion des technologies de l’information et la communication,
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 25
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
de la complexité des produits et services et des difficultés afférentes,
la préoccupante question de protection du consommateur Ivoirien admet
tout son sens.
Le droit du consommateur appliqué au multimédia englobe donc
un ensemble de règles et de protections visant à garantir les droits
des utilisateurs lors de l'achat, de l'utilisation ou de la consommation
de produits et services multimédias, tels que les logiciels, les applications,
les contenus numériques, et les équipements électroniques. Il est donc
important d’en maîtriser le cadre juridique général et les droits spécifiques
au multimédia (section1) afin de déterminer les droits fondamentaux
des consommateurs des produits et services numériques et les voies
de recours en cas de litiges (Section 2).
Section 1 : Le cadre juridique général et les droits spécifiques
au multimédia
Paragraphe 1 : Le cadre juridique général du Droit des consommateurs
appliqué au multimédia
Le cadre juridique général du droit des consommateurs appliqué
au multimédia repose sur des principes fondamentaux du droit
de la consommation, adaptés aux spécificités des produits et services
multimédias. Ces règles garantissent la transparence, la protection
et l'équilibre dans les relations entre consommateurs et professionnels.
Les transactions multimédias sont ainsi encadrées par les lois générales
sur la protection des consommateurs. Ces lois incluent :
Le Droit à l’information claire : Les consommateurs doivent recevoir
des informations complètes sur le produit ou service (fonctionnalités,
compatibilité, limitations éventuelles, prix, conditions d’utilisation).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 26
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Le Droit à la garantie légale : Les produits multimédias doivent
être exempts de défauts et conformes à l’usage prévu.
En cas de problème, le consommateur peut demander réparation,
remplacement ou remboursement.
Le Droit de rétractation : En cas d’achat en ligne, les consommateurs
disposent généralement d’un délai (souvent 14 jours) pour changer
d’avis, sauf exceptions (par exemple, pour les contenus numériques
téléchargés avec accord préalable).
Dans le but d’accorder une protection au consommateur dans
l’accomplissement des actes en ligne et en vue d’adapter la législation interne
aux nouveaux enjeux de la mondialisation et au développement du commerce
électronique, la Côte d’Ivoire s’est doté dans son ordonnancement juridique
de diverses dispositions se rattachant aux transactions électroniques.
A ce titre, nous avons d’une part, la loi n°2013-546 du 30 Juillet 2013
relative aux transactions électroniques pour réguler le secteur des échanges
virtuels, et au niveau communautaire, l’ Acte uniforme de l’Organisation
pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), portant Droit
Commercial Général, adopté à Lomé le 15 décembre 2010, qui a consacré
la signature électronique dans le cadre de l’informatisation du Registre
du Commerce et du Crédit mobilier (RCCM).
D’autre part en droit de la consommation, la loi n°2016‐412 relative
à la consommation. Au sens des dispositions de l’article 1er alinéa 1 et 2
de ladite loi, le législateur Ivoirien défini le consommateur comme
« toute personne qui achète ou offre d’acheter des technologies, des biens
ou services pour des raisons autres que la revente ou l’utilisation à des fins
de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations
de services ; reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services
pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement,
ou tout autre système de paiement différé.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 27
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Cette définition inclut tout utilisateur de technologies, de biens et services
autre que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation
est approuvée par l’acheteur ».
Ainsi à travers ce dispositif juridique existant en Droit Ivoirien, l’Etat entend
combler les insuffisances juridiques en conférant aux consommateurs
les armes pour la prise en main de sa propre défense contre le professionnel
dominant lors des contrats électroniques.
Paragraphe 2 : Les droits spécifiques des consommateurs liés
au multimédia
Au titre des droits spécifiques des consommateurs liés au multimédia,
nous pouvons dire que les contenus numériques comme les films, jeux,
musiques, ou livres numériques obéissent à des règles spécifiques
telles que la licence d’utilisation qui oblige souvent les consommateurs
à acheter une licence, et non un produit physique, ce qui limite certains droits,
comme la revente. Une obligation de fournir des mises à jour nécessaires
à la conformité, sans frais supplémentaires pendant une durée raisonnable
est faite aux fournisseurs, de même que l’obligation de garantir l’accès continu
au contenu, sauf en cas de force majeure ou fin du contrat avec préavis.
Aussi, les fichiers doivent être exempts de défauts (comme des bugs)
et utilisables sur les appareils déclarés compatibles et les éditeurs doivent
veiller à ne pas rendre leurs contenus inutilisables sans mise à jour ou support
adéquat.
En ce qui concerne les logiciels et applications, les développeurs doivent
garantir que leurs produits respectent les normes de sécurité et protègent
les données personnelles des utilisateurs et les applications gratuites
ne doivent pas dissimuler des achats intégrés essentiels au fonctionnement
normal.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 28
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Pour ce qui est des équipements électroniques multimédias, tout appareil
multimédia doit répondre aux attentes annoncées (durée de vie raisonnable,
fonctionnalités promises) et les consommateurs doivent être informés
sur la réparabilité des appareils.
Section 2 : Les droits fondamentaux des consommateurs et les voies
de recours en cas de litiges
Paragraphe 1 : Les droits fondamentaux des consommateurs
appliqués au multimédia
Les consommateurs doivent avoir accès à des informations claires, précises
et complètes avant l'achat, ceci implique la description du produit ou service
multimédia, la compatibilité (exemple : système d'exploitation requis, espace
de stockage nécessaire), les modalités d'utilisation (licence, restrictions, etc.)
et les conditions tarifaires (prix, abonnements, coûts supplémentaires
éventuels). Les consommateurs disposent également d’un droit de rétractation
qui leur donne un délai légal pour annuler leur achat. Ainsi, pour les achats
en ligne ou à distance, c’est généralement 14 jours, sauf exceptions
(notamment pour les contenus numériques si le téléchargement a déjà commencé
avec consentement explicite). Aussi, les produits et services multimédias
doivent être conformes à leur description et fonctionner comme attendu.
Les contrats ne doivent pas non plus inclure de clauses désavantageuses
ou limitatives pour le consommateur, comme les restrictions excessives
sur l’utilisation et la limitation abusive de responsabilité en cas de défaillance.
Il est important de noter aussi que les produits multimédias doivent
respecter les normes de sécurité et que les services doivent protéger
les données personnelles des utilisateurs. Par ailleurs, les professionnels
doivent éviter les pratiques trompeuses (promesses mensongères
sur les fonctionnalités) et les omissions délibérées (coûts cachés).
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 29
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Les abonnements doivent inclure des informations claires sur la durée,
le renouvellement automatique et les modalités de résiliation.
Les consommateurs doivent pouvoir se désabonner facilement.
Pour les applications, jeux et logiciels, les professionnels doivent informer
les utilisateurs des coûts additionnels et les enfants doivent être protégés
contre des achats involontaires (contrôles parentaux).
Paragraphe 2 : Les voies de recours en cas de litiges entre
professionnels et consommateurs de biens
et services multimédia
En cas de litige entre professionnels et consommateurs dans le domaine
des biens et services multimédia, plusieurs voies de recours sont disponibles
pour résoudre le conflit telles que:
La Résolution à l’amiable à travers la médiation qui est une procédure
amiable où un médiateur, indépendant et impartial, aide les parties à trouver
une solution, ce qui est souvent rapide, économique, et souvent gratuit
pour le consommateur.
Il y a aussi la conciliation qui est un processus similaire à la médiation,
mais généralement moins formel. Il peut être conduit par un conciliateur
de justice. En Côte d’Ivoire, certains grands fournisseurs de services
numériques (comme les opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès
internet) mettent en place des mécanismes internes de médiation ;
ainsi, Orange CI, MTN CI, et Moov Africa CI disposent de départements
spécialisés pour le traitement des réclamations.
Par ailleurs, les consommateurs peuvent s’adresser ou faire
des réclamations auprès des organismes spécialisés. A cet effet, plusieurs
organismes et institutions sont impliqués dans le règlement des litiges
entre professionnels et consommateurs de biens et services numériques.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 30
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Il s’agit entre autres de L’ARTCI (Autorité de Régulation
des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire) dont le rôle principal
est la régulation des secteurs des télécommunications et des technologies
de l’information et de la communication (TIC) ; la supervision des relations
entre les opérateurs de télécommunications et les consommateurs.
Ensuite, il y a le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion
des PME qui a pour rôle de superviser les relations commerciales, y compris
celles touchant au numérique, la protection des consommateurs en général,
y compris ceux des biens et services numériques.
Ce ministère dispose d’organes rattachés tels que la Direction
de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie chère
(DCCLCV) qui traite des réclamations des consommateurs et veille à la
transparence des pratiques commerciales ainsi que la plateforme
"Consommons Ivoirien" qui permet aux consommateurs de signaler
des abus ou litiges.
Plusieurs associations jouent également un rôle actif dans la défense
des droits des consommateurs dans le domaine numérique. Nous pouvons
citer à cet effet, la FACACI (Fédération des Associations de Consommateurs
Actifs de Côte d’Ivoire) qui reçoit et traite les plaintes des consommateurs ;
mène des actions de médiation avec les entreprises concernées.
La Ligue Ivoirienne des Consommateurs (LIC) qui assure la protection
des consommateurs contre les abus des fournisseurs de biens et services,
y compris numériques.
Notons pour finir qu’en cas d'échec des démarches amiables
ou administratives, le consommateur peut saisir les tribunaux de commerce
pour les litiges commerciaux et les tribunaux de proximité pour les litiges
de faible montant.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 31
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
Ces structures permettent d'encadrer et de résoudre les litiges
numériques dans un contexte de développement rapide du secteur
en Côte d’Ivoire.
Conclusion
Les contrats électroniques admettent des difficultés spécifiques quant
à la licéité de l’offre, du consentement libre et éclairé, du paiement
électronique, la question de la preuve électronique et plus largement
de la protection du consommateur. Internet ayant atteint une dimension
révolutionnaire sur la personne du consommateur au sein notre société dite
moderne. Toutefois, au regard de son impact grandissant, cette révolution
technologique devrait également entraîner une révolution juridique en vue
de maintenir un équilibre entre la montée des TIC et la protection
des consommateurs Ivoiriens.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 32
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
1. Ouvrages généraux sur le droit du numérique et du multimédia
Bensamoun, A., & Debet, A. (2020). Droit des données personnelles.
Paris : LGDJ.
Ce livre examine les cadres juridiques et réglementaires relatifs
à la protection des données dans les domaines numérique et multimédia.
Trébulle, F.-G., & Marmayou, J. (2019). Droit du numérique et de la
communication. Paris : Lexis Nexis.
Un manuel détaillé sur les aspects juridiques du numérique, incluant
la protection des œuvres multimédia, le droit d'auteur, et les licences.
Vivant, M., & Bruguière, J.-M. (2022). Droit d’auteur et droits
voisins. Paris : Dalloz.
Cet ouvrage explore le droit d’auteur appliqué aux œuvres numériques
et multimédia, en abordant les défis liés à la protection des créations
dans le cadre numérique.
2. Ouvrages spécialisés sur le droit de l’audiovisuel et du multimédia
Caron, C. (2021). Droit de la propriété intellectuelle. Paris : Lexis
Nexis.
En plus des concepts de base, cet ouvrage aborde les implications
spécifiques de la propriété intellectuelle dans le multimédia, notamment pour
la musique, le cinéma, et les jeux vidéo.
Kahn, P. (2018). Droit de l'audiovisuel et de la communication
électronique. Paris : LGDJ.
Ouvrage de référence sur le droit audiovisuel en France, avec une analyse
des nouvelles réglementations sur les plateformes multimédia et les réseaux
sociaux.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 33
Introduction au Droit du multimédia, d’auteur et de patrimoine
3. Articles et études académiques
Gautier, P.-Y. (2021). "Droit d’auteur et œuvres multimédias :
un équilibre fragile". Revue Internationale du Droit d'Auteur, 230(1),
51-70.
Cet article traite des tensions entre la protection des droits d'auteur
et la libre circulation des œuvres multimédia.
Montero, E. (2022). "Les enjeux de la régulation des plateformes
de streaming". Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 218, 15-30.
Analyse de la régulation des services de streaming et de leurs implications
pour le droit d’auteur.
Perrin, J.-M. (2020). "La neutralité du net et les contenus
multimédias". Cahiers de Droit Numérique, 9(4), 213-234.
Étude sur l'impact de la neutralité du net pour les services de diffusion
de contenus multimédias.
4. Ressources en ligne et rapports institutionnels
CNIL. (2022). "Protection des données et nouvelles technologies".
Rapport disponible en ligne sur le site de la CNIL.
Un rapport exhaustif sur la protection des données et les implications
pour les services multimédia et les plateformes numériques.
HADOPI et CSA (2021). Rapport sur la régulation des contenus en
ligne. Disponible sur les sites officiels de la HADOPI et du CSA.
Ce rapport couvre les pratiques de régulation des contenus, en mettant
l'accent sur les défis de la lutte contre le piratage et la protection des droits
d’auteur.
Réalisé par Me Juanitez Octaviano HOUNNOU (Expert-Consultant juridique) 34
Vous aimerez peut-être aussi
- La Protection Des Marques de Fabrique de Commerce Et de ServiceDocument68 pagesLa Protection Des Marques de Fabrique de Commerce Et de ServiceHicham Ouazzani67% (3)
- TIC Et PROPRIETE INTELLECTUELLEDocument6 pagesTIC Et PROPRIETE INTELLECTUELLEDanielle Mama100% (1)
- Cours de DPIDocument4 pagesCours de DPIAndria LarissaPas encore d'évaluation
- Propriété IntellectuelleDocument6 pagesPropriété IntellectuelleArexfjnPas encore d'évaluation
- Introduction Générale À La P.IDocument18 pagesIntroduction Générale À La P.Imaelleobame18Pas encore d'évaluation
- La Protection de La Proprieté Intelectuelle Dans La Société de LinformationDocument36 pagesLa Protection de La Proprieté Intelectuelle Dans La Société de LinformationTIZAOUI100% (1)
- Les Fondamentaux de la propriété intellectuelle 2022Document23 pagesLes Fondamentaux de la propriété intellectuelle 2022Mohamed El-amine BendjoudaPas encore d'évaluation
- La Propriété Intellectuelle:mécanismes Et LégislationDocument6 pagesLa Propriété Intellectuelle:mécanismes Et LégislationJihad El HaitamyPas encore d'évaluation
- Propriété IntellectuelleDocument6 pagesPropriété IntellectuelleYasmine Hammami100% (1)
- Droit de La Propriété Intellectuelle L2 PDFDocument59 pagesDroit de La Propriété Intellectuelle L2 PDFmbekytriphene021Pas encore d'évaluation
- Wipo Pub 450 PDFDocument28 pagesWipo Pub 450 PDFDrinima NezhaPas encore d'évaluation
- Tic Et Propriete Intellectuelle: Chapitre 6Document17 pagesTic Et Propriete Intellectuelle: Chapitre 6Fakery BagayokoPas encore d'évaluation
- Cours 2Document7 pagesCours 2tfbybqjp5yPas encore d'évaluation
- Retranscription PIDocument91 pagesRetranscription PIWavyola DongalaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document4 pagesChapitre 1Ibrahim AbdelkaderPas encore d'évaluation
- Brevet Objet de Licencing VFDocument36 pagesBrevet Objet de Licencing VFmedactPas encore d'évaluation
- Cours Dpi SuiteDocument4 pagesCours Dpi SuiteeliyahlivatianaPas encore d'évaluation
- Les Droits de Propriété IntellectuelleDocument5 pagesLes Droits de Propriété IntellectuelleMohammed Bk-rPas encore d'évaluation
- Cours de Pi l2 PDF 015756Document51 pagesCours de Pi l2 PDF 015756farlonbayimissa464Pas encore d'évaluation
- Propriété IntellectuelleDocument13 pagesPropriété Intellectuelleines zidiPas encore d'évaluation
- Wipo Iptk Rak 16 Presentation VeneroDocument42 pagesWipo Iptk Rak 16 Presentation VeneroJT MarcelloPas encore d'évaluation
- piDocument39 pagespiyasser seenPas encore d'évaluation
- Droit de La Propriété Intellectuelle-1Document18 pagesDroit de La Propriété Intellectuelle-1asmae maddah100% (2)
- Cours droit des marquesDocument28 pagesCours droit des marquesSidibe SeydouPas encore d'évaluation
- Protection Et Valorisation de La Propriété IntellectuelleDocument10 pagesProtection Et Valorisation de La Propriété Intellectuelleasma ouarab100% (2)
- Cours Droit de La Propriété Intellectuelle Fac Droit Tunis 2013 2014 INTRODocument74 pagesCours Droit de La Propriété Intellectuelle Fac Droit Tunis 2013 2014 INTROOns SaidanePas encore d'évaluation
- Dissertation AzzharyDocument12 pagesDissertation AzzharyMaryam El-FakirPas encore d'évaluation
- DEFINITIONDocument5 pagesDEFINITIONYousra ZrPas encore d'évaluation
- Vid Ethiques Et TIC (2) (1)Document2 pagesVid Ethiques Et TIC (2) (1)redafood2003Pas encore d'évaluation
- Vid Ethiques Et TIC 240414 170835Document3 pagesVid Ethiques Et TIC 240414 170835abdellahhaoumalik2Pas encore d'évaluation
- Le Système de La Propriété Intellectuelle Mondiale Et Présentation Du Cas MarocaineDocument37 pagesLe Système de La Propriété Intellectuelle Mondiale Et Présentation Du Cas MarocaineKhalil OutaharPas encore d'évaluation
- Texte 44AF 88E9 CC 0Document2 pagesTexte 44AF 88E9 CC 0achtakenguiePas encore d'évaluation
- Propriete IntellectuelleDocument42 pagesPropriete IntellectuellejjjojhhoPas encore d'évaluation
- COURS PI Christelle SASSARD Marie Moin 2023Document106 pagesCOURS PI Christelle SASSARD Marie Moin 2023julien gourmetPas encore d'évaluation
- Droit de La Propriete Industrielle Et CommercialeDocument30 pagesDroit de La Propriete Industrielle Et CommercialeTarik LaouaniPas encore d'évaluation
- Propriété IntellectuelleDocument92 pagesPropriété IntellectuelleMaryame MOUTAOUKILPas encore d'évaluation
- Pi VFDocument4 pagesPi VFAïcha YarohPas encore d'évaluation
- Wipo Indip RT 98 2 Add-Annex1Document16 pagesWipo Indip RT 98 2 Add-Annex1Karmaini Nour el houdaPas encore d'évaluation
- PI - Cours - Introduction À Propriété IntellectuelleDocument39 pagesPI - Cours - Introduction À Propriété IntellectuelleSteciePeck100% (1)
- Résumer DroitDocument15 pagesRésumer Droithanae.elbahiPas encore d'évaluation
- Chap. 10Document3 pagesChap. 10BEKTESHIPas encore d'évaluation
- Droit 04Document4 pagesDroit 04Žahra Ňah IdPas encore d'évaluation
- Cours N°4 - Ethique Et Deontologie - Master 1 - Structure - VOA PDFDocument15 pagesCours N°4 - Ethique Et Deontologie - Master 1 - Structure - VOA PDFYacine AounallahPas encore d'évaluation
- Les DPI Au Service de l'IE Et de L'économie de La ConnaissanceDocument11 pagesLes DPI Au Service de l'IE Et de L'économie de La ConnaissanceAUDACIEPas encore d'évaluation
- Cours de Droit de Propriété IntellectuelleDocument40 pagesCours de Droit de Propriété IntellectuelleThouraya BenPas encore d'évaluation
- Synthèse Chapitre 10Document3 pagesSynthèse Chapitre 10francoiscalvayracPas encore d'évaluation
- Cours de Droit de La Propriete Intellectuelle 2017 FinalDocument93 pagesCours de Droit de La Propriete Intellectuelle 2017 Finalyaopierre jeanPas encore d'évaluation
- Chapitre préliminaire - Droit de la propriété intellectuelle_9ecd6ca3ed95c5e509f01cacf7aae105Document10 pagesChapitre préliminaire - Droit de la propriété intellectuelle_9ecd6ca3ed95c5e509f01cacf7aae105dcvjhp7pmbPas encore d'évaluation
- chapitre2_ IntervenantsDocument17 pageschapitre2_ Intervenantskeudjeu. muriellePas encore d'évaluation
- Droit de L'industrie Et de L'energieDocument72 pagesDroit de L'industrie Et de L'energiengonoufrank237Pas encore d'évaluation
- Dos06 ProfDocument10 pagesDos06 ProfFrancis TrouvainPas encore d'évaluation
- AddPage - Éxposé LA P I - RemovedDocument51 pagesAddPage - Éxposé LA P I - Removedabderrahim.elmastour1Pas encore d'évaluation
- 1-Droit-de-propriété-intellectuelle-Nguyen-Thai-Cuong (1)Document46 pages1-Droit-de-propriété-intellectuelle-Nguyen-Thai-Cuong (1)2153801015209Pas encore d'évaluation
- PI Résumé InesDocument5 pagesPI Résumé InesBrahim HassamPas encore d'évaluation
- Droit de La ContrefaçonDocument26 pagesDroit de La ContrefaçonKetsia Leda akeyePas encore d'évaluation
- Proprite Intellectuelle 22Document248 pagesProprite Intellectuelle 22Henri paterne BoundioPas encore d'évaluation
- COURS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE_INPHBDocument85 pagesCOURS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE_INPHBKiller N'gbessoPas encore d'évaluation
- Cours de PIDocument51 pagesCours de PIAristode Makaya KissambouPas encore d'évaluation
- Chap1 - Module Introduction Propriété Intellectuelle - UnlockedDocument19 pagesChap1 - Module Introduction Propriété Intellectuelle - UnlockedAhlemPas encore d'évaluation
- La protection internationale et européenne du droit de la propriété intellectuelle: Présentations - Textes - Jurisprudences - SituationsD'EverandLa protection internationale et européenne du droit de la propriété intellectuelle: Présentations - Textes - Jurisprudences - SituationsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Journal Officiel de La République GabonaiseDocument61 pagesJournal Officiel de La République GabonaiseOWA SHOPPas encore d'évaluation
- Règlement Jeu Concours - Calendrier de L'avent - Synergie SoissonsDocument7 pagesRèglement Jeu Concours - Calendrier de L'avent - Synergie SoissonssoissonsPas encore d'évaluation
- HTTPDocument144 pagesHTTPbetserdar52Pas encore d'évaluation
- Esma Ch4et5Document11 pagesEsma Ch4et5Paul Graphic DesignerPas encore d'évaluation
- Loi No028-2Document19 pagesLoi No028-2Zaki KonfePas encore d'évaluation
- Para Enviar Assurance Maladie 3Document6 pagesPara Enviar Assurance Maladie 3javier2761Pas encore d'évaluation
- CnafDocument3 pagesCnafd.rere1983Pas encore d'évaluation
- Cdi Racean - Ribana 218161 2023 06 14 2Document139 pagesCdi Racean - Ribana 218161 2023 06 14 2Wave JõsēphPas encore d'évaluation
- O.R. #973724 MDocument4 pagesO.R. #973724 MrribouletPas encore d'évaluation
- Autorisation Tournage ModeleDocument3 pagesAutorisation Tournage ModeleFlorent PeruginiPas encore d'évaluation
- Banque de France - Particuliers - Formulaire - Dac - Personne - PhysiqueDocument2 pagesBanque de France - Particuliers - Formulaire - Dac - Personne - PhysiquecharingonayPas encore d'évaluation
- Business Plan Boutique de ChaussureDocument38 pagesBusiness Plan Boutique de ChaussurecamgroupesPas encore d'évaluation
- CnafDocument2 pagesCnafkatreytsuPas encore d'évaluation
- Exemple de Mandat de Facturation RevDocument3 pagesExemple de Mandat de Facturation RevOmar BaPas encore d'évaluation
- Preview Cnaf 2Document3 pagesPreview Cnaf 2Julia BauerPas encore d'évaluation
- Reçu Wupos ÉDocument1 pageReçu Wupos ÉcissePas encore d'évaluation
- Preview CnafDocument3 pagesPreview Cnafvivo20x vivoPas encore d'évaluation
- S210 1FK2 Op Instr FR-FRDocument742 pagesS210 1FK2 Op Instr FR-FROussamaa AdjoudjPas encore d'évaluation
- Cga Programme de Fidelite 012023Document7 pagesCga Programme de Fidelite 012023Mouad elhartiPas encore d'évaluation
- Dossier Ia 2024-2025 Cpge Web+Pj+Engagement+Autor+NoticeDocument26 pagesDossier Ia 2024-2025 Cpge Web+Pj+Engagement+Autor+Noticealexandre.frechinPas encore d'évaluation
- Les Donn Es de Paiement Points de Vigilance de La CNIL 1637330444Document2 pagesLes Donn Es de Paiement Points de Vigilance de La CNIL 1637330444chris2260kPas encore d'évaluation
- 2020 Odigo LivreBlanc FR Comment L IA Et L Analyse de Donn Es Vont Elles TransformeDocument40 pages2020 Odigo LivreBlanc FR Comment L IA Et L Analyse de Donn Es Vont Elles TransformeBernardPas encore d'évaluation
- La Premiere Partie La Vrai GUILAINE (2) CORRIGEEDocument22 pagesLa Premiere Partie La Vrai GUILAINE (2) CORRIGEEJean Noël Eya AbessoloPas encore d'évaluation
- Declaration Sur L'honneur Pret Pas Couple MessouyaDocument1 pageDeclaration Sur L'honneur Pret Pas Couple MessouyaYacine MESSOUYAPas encore d'évaluation
- Chapitre 9 Droit de L'immatérielDocument12 pagesChapitre 9 Droit de L'immatérielkpmpfp5xw7Pas encore d'évaluation
- Reglement Jeu Concours Carrefour Banque Janvier 2025Document5 pagesReglement Jeu Concours Carrefour Banque Janvier 2025nathanbils67Pas encore d'évaluation
- Evaluation Protection Des DonnéesDocument64 pagesEvaluation Protection Des DonnéesMOONSON NYEMBPas encore d'évaluation
- BI SPE 2024 InteractifDocument4 pagesBI SPE 2024 Interactifggdm197708Pas encore d'évaluation
- 20120130reunionsitewebcmaslideshare 121115041952 Phpapp02Document25 pages20120130reunionsitewebcmaslideshare 121115041952 Phpapp02Youssef AmariPas encore d'évaluation
- Formulaire FSL Acces Version 2022Document13 pagesFormulaire FSL Acces Version 2022Stéphane Junior DomiPas encore d'évaluation