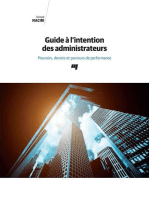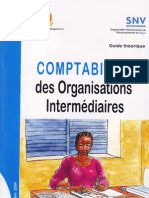Guide de Comptabilisation Et de Présentation Des Immobilisations Corporelles
Guide de Comptabilisation Et de Présentation Des Immobilisations Corporelles
Transféré par
MontacerDroits d'auteur :
Formats disponibles
Guide de Comptabilisation Et de Présentation Des Immobilisations Corporelles
Guide de Comptabilisation Et de Présentation Des Immobilisations Corporelles
Transféré par
MontacerCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Guide de Comptabilisation Et de Présentation Des Immobilisations Corporelles
Guide de Comptabilisation Et de Présentation Des Immobilisations Corporelles
Transféré par
MontacerDroits d'auteur :
Formats disponibles
Indications lintention des
Administrations locales et des
entits des Administrations
locales qui appliquent le Manuel
de comptabilit de lICCA pour le
secteur public
GUIDE
DE COMPTABILISATION
ET DE PRSENTATION
DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Avril 2007
Le prsent guide constitue une rfrence pratique destine aux Administrations locales,
en vue de la mise en uvre des nouvelles obligations dinformation publies par le
Conseil sur la comptabilit dans le secteur public. Il contient des informations prcieuses
sur la raison dtre et les avantages de la comptabilisation des immobilisations
corporelles, les considrations lies la mise en uvre, les exigences comptables
ultrieures, et la faon dont ces informations peuvent tre associes aux pratiques usuelles
de gestion des immobilisations.
Kent Kirkpatrick,
Directeur municipal,
Ville dOttawa
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 1 de 114
Le prsent guide a t prpar par la division Comptabilit dans le secteur public de
lInstitut Canadien des Comptables Agrs (ICCA). Cette division seconde le Conseil sur
la comptabilit dans le secteur public dans sa mission visant servir lintrt public en
tablissant des normes et en donnant des indications concernant linformation financire
et linformation sur la performance fournies par le secteur public. Les indications et les
interprtations qui y sont exprimes sont celles des permanents de la division
Comptabilit dans le secteur public; elles ne sont ni adoptes, ni sanctionnes, ni
approuves ou dsapprouves ni entrines de quelque autre faon que ce soit par un
conseil, un comit, les instances dirigeantes ou les membres de lICCA ou dun ordre
provincial.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 2 de 114
AVANT-PROPOS
Au fil des ans, les Administrations locales ont investi des milliards de dollars dans les
immobilisations corporelles. Ces lments dactif jouent un rle dterminant dans la
capacit dune collectivit de se diversifier, de crotre, de rpondre aux besoins
quengendre laugmentation de la population et damliorer les conditions
environnementales. Malheureusement un nombre croissant de tmoignages indiquent que
les arrirs dentretien, de renouvellement et de remplacement des infrastructures
vieillissantes constituent un lourd fardeau financier pour les Administrations locales et
menacent la viabilit et labordabilit des services.
La question de la capacit financire de maintenir les immobilisations et les services
quelles permettent de fournir ne touche pas seulement les Administrations locales. Elle
est en fait essentielle pour la sant, le bien-tre et le dynamisme conomique de la nation
au complet. Les gouvernements fdral, provinciaux et territoriaux sont donc directement
intresss par la viabilit des services des Administrations locales.
Le rapport de recherche intitul Comptabilisation des infrastructures dans le secteur
public, publi par lICCA en 2002, concluait que pour que lon puisse apprcier la
capacit financire dune Administration locale de maintenir ses niveaux de service
actuels, il est primordial davoir accs des informations financires au sujet de son parc
dimmobilisations et de lutilisation qui en est faite. Pourtant, pour la majorit des
Administrations locales au Canada, linformation financire sur le parc
dimmobilisations, lutilisation qui en est faite et ltat dans lequel ces immobilisations se
trouvent nest habituellement pas accessible.
Cette situation est sur le point de changer. En effet, pour les exercices ouverts compter
du 1
er
janvier 2009, le Conseil sur la comptabilit dans le secteur public (CCSP) exigera
que les Administrations locales prsentent des informations sur la totalit de leur parc
dimmobilisations corporelles et sur lamortissement de celles-ci dans leurs tats
financiers condenss.
Objet du prsent document
Le prsent document vise fournir :
des indications sur la marche suivre pendant la priode transitoire;
un cadre pouvant tre appliqu de faon gnrique.
Le prsent document ne vise pas :
fournir des indications dfinitives que toutes les Administrations pourront
appliquer dans toutes les circonstances;
remplacer les manuels de comptabilit;
servir de source faisant autorit en matire de pratiques ou de normes comptables.
Il est probable que chaque Administration locale sera confronte des problmes qui lui
sont propres, dcoulant par exemple de laccessibilit de linformation, de la nature de
ses activits et de sa taille.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 3 de 114
Organisation du guide
Le document est organis comme suit :
Chapitre 1 Les avantages de la comptabilisation des immobilisations corporelles
Chapitre 2 Analyse dtaille des normes de comptabilisation des immobilisations
corporelles
Chapitre 3 La planification de la mise en uvre des normes sur les immobilisations
corporelles
Chapitre 4 laboration dune mthode comptable exhaustive visant les
immobilisations corporelles
Chapitre 5 Saines pratiques de gestion des immobilisations
Chapitre 6 Des registres des actifs qui rpondent aux besoins en matire de
comptabilit et de gestion
Chapitre 7 Aperu des mthodes dvaluation initiale des immobilisations corporelles
Chapitre 8 Aperu du nouveau modle de prsentation de linformation
Chapitre 9 Consquences pour la vrification externe
Chapitre 10 Leons tires par dautres Administrations
Plusieurs annexes prsentent des informations supplmentaires susceptibles dtre utiles.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 4 de 114
CHAPITRE 1 NCESSIT ET AVANTAGES DE LA PRSENTATION DINFORMATIONS SUR
LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES............................................................................7
1.0 TYPES DIMMOBILISATIONS........................................................................................................... 7
2.0 LES BESOINS DINFORMATION....................................................................................................... 8
3.0 RLE DES NORMES COMPTABLES................................................................................................... 8
4.0 COMPTABILIT GNRALE OU COMPTABILIT DE GESTION?........................................................ 10
5.0 AVANTAGES GESTIONNELS DE LA COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES..... 11
CHAPITRE 2 COMPRENDRE LES NORMES COMPTABLES................................................................ 14
1.0 DFINITION DUN ACTIF .............................................................................................................. 14
1.1 Norme comptable .................................................................................................................14
1.2 Application de la norme SP 3150.........................................................................................15
1.3 Notion de contrle................................................................................................................15
1.4 Matriel informatique et logiciels ........................................................................................16
2.0 UVRES DART ET TRSORS HISTORIQUES.................................................................................. 16
3.0 VALUATION DES IMMOBILISATIONS........................................................................................... 17
3.1 Norme comptable .................................................................................................................17
3.2 Pourquoi le cot historique?................................................................................................17
3.3 valuation du cot................................................................................................................18
3.4 Subventions et dons ..............................................................................................................20
3.5 Capitalisation des intrts dbiteurs ....................................................................................20
4.0 DONS OU APPORTS DIMMOBILISATIONS...................................................................................... 20
5.0 APPROCHE DE LACTIF UNIQUE OU APPROCHE AXE SUR LES COMPOSANTES.............................. 21
5.1 Approche de lactif unique ...................................................................................................21
5.2 Approche axe sur les composantes .....................................................................................22
6.0 INSCRIPTION LACTIF DES MODERNISATIONS ET DES AMLIORATIONS AMLIORATIONS... 22
7.0 SORTIES DU PATRIMOINE............................................................................................................. 23
7.1 Norme comptable .................................................................................................................23
7.2 Application de la norme .......................................................................................................23
8.0 AMORTISSEMENT ........................................................................................................................ 24
8.1 Norme comptable .................................................................................................................24
8.2 Estimation de la dure de vie utile .......................................................................................24
8.3 Rvision de la mthode damortissement et de lestimation de la dure de vie utile............26
8.4 Incidence comptable du report des dpenses dentretien et de renouvellement ...................26
9.0 OBLIGATIONS DINFORMATION ET TABLISSEMENT DES CATGORIES DIMMOBILISATIONS........ 28
9.1 Norme comptable .................................................................................................................28
9.2 Application de la norme .......................................................................................................29
10.0 MOINS-VALUES........................................................................................................................... 30
10.1 Norme comptable .................................................................................................................30
10.2 Application de la norme .......................................................................................................30
10.2.1 Rduction de la valeur du potentiel de service................................................................................ 30
10.2.2 Amoindrissement des avantages conomiques futurs...................................................................... 31
10.3 Test de dprciation .............................................................................................................32
10.4 Comptabilisation de la moins-value dune immobilisation ..................................................32
11.0 IMMOBILISATIONS LOUES.......................................................................................................... 33
11.1 Comptabilisation des contrats de location-acquisition ........................................................33
11.2 Comptabilisation des immobilisations corporelles loues ...................................................35
11.3 Oprations de cession-bail ...................................................................................................37
12.0 DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LVALUATION........................................................ 37
13.0 APPLICATION RTROACTIVE DE LA NOUVELLE NORME COMPTABLE............................................ 38
13.1 Norme comptable .................................................................................................................38
13.2 Application de la norme ......................................................................................................39
14.0 DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE MISE EN UVRE........................................................................ 39
14.1 Norme comptable .................................................................................................................39
14.2 Application de la norme .......................................................................................................39
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 5 de 114
CHAPITRE 3 PLANIFICATION DE LA MISE EN UVRE ...................................................................... 41
1.0 GESTION DU PROCESSUS.............................................................................................................. 41
2.0 PLAN DE MISE EN UVRE............................................................................................................. 41
3.0 PARTICIPATION DU VRIFICATEUR EXTERNE............................................................................... 42
CHAPITRE 4 MTHODES COMPTABLES VISANT LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES. 43
1.0 LABORATION DE MTHODES COMPTABLES VISANT LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES......... 43
2.0 APPROCHE DE LACTIF UNIQUE OU APPROCHE AXE SUR LES COMPOSANTES.............................. 43
2.1 Analyse des avantages et des inconvnients.........................................................................44
2.2 Questions lies la mise en uvre de lapproche axe sur les composantes.......................46
2.3 Segmentation des actifs ........................................................................................................46
3.0 VALUATION DES DURES DE VIE UTILE...................................................................................... 47
4.0 SEUILS DE COMPTABILISATION.................................................................................................... 49
4.1 Seuil dinscription lactif / de prsentation .......................................................................49
4.2 Slection du seuil dinscription lactif / de prsentation ...................................................49
4.3 Inscription lactif de biens dont la valeur est infrieure au seuil dinscription
l'actif / de prsentation .........................................................................................................51
4.4 Comptabilisation des biens portables...............................................................................51
4.5 Seuil de comptabilisation des amliorations ........................................................................52
4.6 Comptabilisation des remplacements selon lapproche axe sur les composantes..............52
CHAPITRE 5 PRATIQUES DE GESTION DES IMMOBILISATIONS ................................................... 54
1.0 PLANS DE GESTION STRATGIQUE DES IMMOBILISATIONS........................................................... 54
2.0 RESPONSABILIT DE LA GESTION DES IMMOBILISATIONS............................................................. 54
3.0 POLITIQUES ET PROCDURES DEXPLOITATION DES IMMOBILISATIONS ....................................... 54
4.0 VALUATION DE LTAT DES IMMOBILISATIONS.......................................................................... 56
5.0 TABLISSEMENT DUN CADRE DE PLANIFICATION ET DINVESTISSEMENT ................................... 59
6.0 LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PLANS DE GESTION DES INFRASTRUCTURES .................. 61
CHAPITRE 6 REGISTRES DES ACTIFS........................................................................................................ 63
1.0 DESCRIPTION ET OBJ ET................................................................................................................ 63
2.0 CONCEPTION ET LABORATION ................................................................................................... 64
3.0 SOURCES DINFORMATION........................................................................................................... 65
4.0 INTGRATION DES REGISTRES DES ACTIFS DANS LE GRAND LIVRE GNRAL ............................... 66
5.0 VALIDATION DES REGISTRES DES ACTIFS..................................................................................... 67
6.0 RSUM....................................................................................................................................... 68
CHAPITRE 7 COMPTABILISATION INITIALE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES......... 70
1.0 TABLISSEMENT DES SOLDES DOUVERTURE SANS DONNES SUR LE COT HISTORIQUE............. 70
2.0 ACTIFS ACQUIS GRATUITEMENT OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE......................................... 71
3.0 IMMOBILISATIONS ENTIREMENT AMORTIES............................................................................... 71
4.0 CATGORIES DIMMOBILISATIONS (AVANT ET APRS ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME
COMPTABLE) ............................................................................................................................... 73
5.0 VALUATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES.................................................................... 73
5.1 valuateurs...........................................................................................................................73
5.2 Mthodes comptables relatives lvaluation......................................................................73
5.3 Ensemble de la population ou chantillon............................................................................74
5.4 Instructions lintention des valuateurs.............................................................................74
5.5 Information requise par les valuateurs...............................................................................75
5.6 Slection des valuateurs .....................................................................................................75
5.7 Examen des valuations par la direction..............................................................................76
5.8 Recherche des moins-values.................................................................................................76
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 6 de 114
CHAPITRE 8 MODLE DE PRSENTATION DE LINFORMATION DES ADMINISTRATIONS
LOCALES..................................................................................................................................... 77
1.0 CADRE CONCEPTUEL ................................................................................................................... 77
2.0 NOTIONS ESSENTIELLES .............................................................................................................. 78
2.1 Composantes des tats financiers.........................................................................................78
2.2 Principaux indicateurs du modle de prsentation de linformation des
Administrations locales ........................................................................................................79
2.2.1 Dette nette / actifs financiers nets.................................................................................................... 79
2.2.2 Surplus/dficit accumul................................................................................................................. 79
2.2.3 Surplus ou dficit de lexercice....................................................................................................... 79
2.2.4 Variation de la dette nette................................................................................................................ 80
2.2.5 Flux de trsorerie............................................................................................................................. 80
3.0 PRSENTATION DES TATS FINANCIERS....................................................................................... 80
3.1 tat de la situation financire ..............................................................................................80
3.2 tat des rsultats ..................................................................................................................81
3.3 tat de la variation de la dette nette / des actifs financiers nets ..........................................81
3.4 tat des flux de trsorerie.....................................................................................................81
3.5 Exemples dtats financiers..................................................................................................81
4.0 PRSENTATION DES MONTANTS BUDGTS................................................................................. 88
4.1 Ensemble d'activits vis par le budget et rgles comptables ..............................................88
4.2 Budgets tablis pour un ensemble dactivits diffrent et selon des rgles diffrentes ........88
4.2.1 Ensemble dactivits diffrent......................................................................................................... 89
4.2.2 Rgles comptables diffrentes......................................................................................................... 89
4.3 Effet de ltablissement de budgets en comptabilit dexercice sur les taux
dimposition et les redevances..............................................................................................89
CHAPITRE 9 QUESTIONS LIES AUX TATS FINANCIERS LA VRIFICATION EXTERNE.. 91
1.0 PRPARATION EN VUE DE LA VRIFICATION EXTERNE................................................................. 91
2.0 RESPONSABILIT DE LA DIRECTION............................................................................................. 91
3.0 SOLDES DOUVERTURE................................................................................................................ 92
4.0 INFORMATIONS FOURNIES DANS LES TATS FINANCIERS ............................................................. 93
5.0 EMBCHES COURANTES.............................................................................................................. 93
CHAPITRE 10 LEONS TIRES PAR DAUTRES ADMINISTRATIONS.............................................. 95
ANNEXE A
PLAN GNRAL DE MISE EN UVRE.......................................................................................................... 96
ANNEXE B
PROCESSUS DE COMPTABILISATION ET DE PRSENTATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES............ 98
ANNEXE C
EXEMPLE DE POLITIQUE SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES........................................................ 101
ANNEXE D
GLOSSAIRE............................................................................................................................................. 107
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 7 de 114
Chapitre 1 Ncessit et avantages de la prsentation
dinformations sur les immobilisations
corporelles
1.0 Types dimmobilisations
Les Administrations locales ont grer une gamme diversifie dimmobilisations. La
figure ci-dessous prsente certaines des principales catgories dimmobilisations
corporelles qui, outre un grand nombre de terrains, soutiennent les services municipaux
de base.
Source : Ville de Hamilton, 2005 Life-Cycle State of the Infrastructure Report On Public Works Assets.
Chacune de ces grandes catgories est compose de nombreux sous-ensembles et
composantes qui contribuent lexploitation globale de la catgorie dimmobilisations.
Catgories
dimmobilisations
Composantes
BTIMENTS ET
MATRIEL
Installations administratives, entrepts, bibliothques,
muses, centres rcratifs, logements sociaux et
installations lies la sant, casernes de pompiers et
camions incendie, postes de police et vhicules
connexes, vhicules de dneigement.
ROUTES Chausses, ponts, tunnels, remblais, talus, abris contre
les avalanches et les boulis, murs de soutnement,
systmes de signalisation et dclairage, installations
dentretien.
Parcs et
espaces verts
Dchets
solides
Assainissement
Eau
Collecteurs
Transport
Parc de vhicules
Routes
difices
publics
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 8 de 114
TRANSPORT EN
COMMUN
Structures des voies en lvation et des stations, ponts,
tunnels, stations de mtro, rampes, alimentation en
nergie des rails, catnaires, systmes de signalisation et
de contrle, matriel roulant et installations dentretien.
EAU ET GOUTS Barrages et ouvrages de prise deau, pipelines, tunnels,
aqueducs, canalisations, rservoirs et citernes, puits,
pompes, matriel mcanique et lectrique, btiments,
nergie lectrique et matriel durgence.
Source : Comptabilisation des infrastructures dans le secteur public (Rapport de recherche), Toronto,
LInstitut Canadien des Comptables Agrs, 2002.
2.0 Les besoins dinformation
On constate de plus en plus que nos collectivits font face dimportants dfis en ce qui a
trait au financement de lentretien diffr, du renouvellement et du remplacement des
immobilisations vieillissantes. Cela pourrait indiquer que les dcideurs nobtiennent pas
linformation suffisante pour comprendre les effets financiers des dcisions de
financement passes sur ltat des immobilisations existantes et sur le cot de leur
utilisation dans le cadre de la prestation des services.
mesure que le parc existant dimmobilisations vieillit et que la population augmente, la
demande accrue de nouvelles immobilisations pse de plus en plus sur la capacit dune
Administration locale dassurer ces services. Linformation sur le parc dimmobilisation
existant, sur le cot de son utilisation et sur les remplacements ncessaires doit tre
lavant-plan de la prise de dcision. Pour quelle soit utile, cette information doit tre
complte, fiable et objective, et elle doit tre fournie lchelle de lAdministration
locale.
Cela ne veut pas dire que les Administrations locales nont pas dinformation sur leurs
actifs pour les grer adquatement. Les ingnieurs municipaux ont mis au point des
systmes de gestion des immobilisations aux fins de la gestion des travaux, des services
la clientle et de ltablissement des budgets dimmobilisations. Ces systmes sont
cependant, dans une large mesure, indpendants des systmes financiers de base. Ils sont
souvent trs spcialiss et incomplets et ils ne sont pas comparables entre eux au sein de
lAdministration locale, ni avec ceux dautres Administrations locales.
La Figure 1 prsente le dficit dinformation constat et le besoin dune information
financire de meilleure qualit sur les immobilisations corporelles.
3.0 Rle des normes comptables
Les normes comptables sur lesquelles reposent les tats financiers jouent un rle essentiel
pour combler ce dficit en portant linformation sur les immobilisations lattention du
public et des autres utilisateurs. Une Administration locale pourrait dcider de ne
conserver que les donnes ncessaires pour produire linformation financire des fins
externes, mais elle se priverait alors de lun des principaux avantages de la comptabilit
dexercice : lobtention dune information de meilleure qualit aux fins de la prise de
dcisions de gestion.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 9 de 114
* GII =gestion intgre des immobilisations
Source : Comptabilisation des infrastructures dans le secteur public, op. cit.
Cadres
hirarchiques
Appels doffres
Contrats
Ordres de travail
Construction
Entretien
Exploitation
DFICIT DINFORMATION FINANCIRE
Budgets fonct./inv.
Gestion des actifs
Performance
Cot unitaire
Contribuable
Autorits de rglementation
Cranciers/investisseurs
Mdias/analystes
Obligation de rendre compte
valuation des programmes
Viabilit
Souplesse
Vulnrabilit
Direction
gnrale
DFICIT DINFORMATION FINANCIRE
Reprsentants
lus
DFICIT DINFORMATION FINANCIRE
Affectation des ressources
Fixation des taux/droits
Abordabilit
Performance
Viabilit
Souplesse
Vulnrabilit
PYRAMIDE DE LA GII*
Utilisateur Dcisions
DFICIT DINFORMATION FINANCIRE
Figure 1
Rapports
externes
Rapports internes
Cot des services
Grance des actifs
Rseaux dinfrastructures
individuels
p. ex. : purification de
leau, traitement des eaux
uses, autoroutes, routes,
ponts, aroports
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 10 de 114
Quand le systme comptable dune Administration locale contient de linformation sur
les immobilisations corporelles et sur leur amortissement, cette Administration locale
peut avoir accs des donnes prcieuses sur les cots de mme qu de linformation
utile pour diverses dcisions de gestion. LAdministration locale profite pleinement des
avantages de la comptabilit dexercice lorsque linformation sur ses immobilisations
corporelles est recueillie, consigne et utilise au niveau des services et/ou des
programmes ou des activits. Cette information peut en effet ensuite servir lvaluation
de la performance et la prise de dcisions sur laffectation des ressources. Elle permet
aussi un contrle comptable des actifs dont chaque gestionnaire est responsable et facilite
lentretien et le remplacement des immobilisations.
Linformation sur les immobilisations corporelles tirera avantage des normes comptables
en vigueur du fait que ces dernires crent un langage commun, compris de tous les
intervenants. Les normes comptables facilitent aussi linterprtation et lanalyse de
linformation en favorisant luniformisation des donnes sur les immobilisations
corporelles. Les normes aident tablir la crdibilit et la confiance, les informations
fournies tant fiables, comparables dune Administration locale une autre et vrifiables.
Les normes liminent galement le parti pris susceptible dinfluer sur les dcisions, car
elles fournissent des dfinitions et des critres dvaluation communs.
Des donnes comparables et fiables sont essentielles pour assurer une planification
adquate, prendre de bonnes dcisions et sacquitter des obligations de rendre compte.
Des donnes peu fiables ou incompltes sont pratiquement toujours sources de dcisions
peu claires et de toutes leurs consquences nfastes.
4.0 Comptabilit gnrale ou comptabilit de gestion?
La comptabilit na pas pour seul objet la prsentation de linformation dans les tats
financiers (comptabilit gnrale). Elle vise aussi fournir une base diverses dcisions
de gestion (comptabilit de gestion), notamment concernant lachat ou la location de
biens, permettre de comprendre les cots dun bien ou dun service en particulier et
valuer la performance de chacun des services et des programmes.
Linformation contenue dans les tats financiers est fonde sur des dfinitions et des
rgles de comptabilisation et dvaluation gnralement reconnues (les principes
comptables gnralement reconnus ou PCGR). Ces rgles servent aussi sassurer que,
dans la mesure du possible, linformation consigne dans le systme dinformation
financire dune Administration locale est communique aux utilisateurs externes de
faon correspondre aux oprations et aux faits qui se sont rellement produits.
Aux fins de la gestion, linformation ncessaire pour prendre des dcisions peut tre
fonde sur toutes les rgles et les autres donnes (comme la quantit produite ou
linformation prospective) juges utiles par la direction.
Les PCGR et les tats financiers mettent laccent sur lvaluation de la situation
financire et des rsultats annuels consolids de lorganisation et non sur la rpartition du
cot entre les diffrentes entits qui la composent, ni sur la prise de dcisions
particulires sur des composantes, des fonctions ou des objectifs. On ne peut sappuyer
sur les PCGR pour valuer le cot complet de chacune des composantes, de chacune des
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 11 de 114
fonctions ou de chacun des objectifs, car ils ne sont pas assez prcis pour rsoudre
nombre des questions de dtail qui peuvent se poser. Par exemple, le cot complet (direct
et indirect) des services de transport dune entit publiante figurera quelque part dans les
tats financiers condenss, mais il ne sera peut-tre pas attribu expressment aux
services de transports.
COMPTABILIT GNRALE COMPTABILIT DE GESTION
Oriente vers les utilisateurs externes Oriente vers les utilisateurs internes
Rapports encadrs par des principes
prescrits
Rapports refltant une certaine souplesse
quant la forme et au contenu
Axe sur les besoins des utilisateurs
externes
Axe sur les besoins de la direction
Linformation fournie doit prsenter une
certaine uniformit tant donn les besoins
des divers utilisateurs
La direction peut prciser le type
dinformation et le contenu requis
Porte sur tous les aspects financiers de
lAdministration locale dans son ensemble,
qui interviennent dans la prise de dcisions
Porte habituellement sur certains aspects de
lAdministration locale intervenant dans la
prise de dcisions
Centre sur la situation financire, les
rsultats annuels et la capacit
dautofinancement
Centre sur des questions comme
ltablissement des prix demander, les
choix quant aux gammes de produits
offertes et la rentabilit des produits
Sappuie sur les oprations et les faits Sappuie sur les oprations et les faits, les
projets futurs et toute autre donne
ncessaire
Repose sur lquation fondamentale
actif passif =actif net
Repose sur trois principes : cot complet,
cots diffrentiels
1
et centres de
responsabilit
2
.
Obligatoire Facultatif
Les normes de comptabilit gnrale peuvent toutefois savrer utiles pour la gestion, car
elles permettent une certaine uniformit des dfinitions, de la comptabilisation et de
lvaluation dans tous les systmes dinformation financire.
5.0 Avantages gestionnels de la comptabilisation des
immobilisations corporelles
Du point de vue de la gestion, ladoption de la comptabilisation des immobilisations
corporelles par les Administrations locales a pour principal avantage dobtenir une
information de meilleure qualit aux fins de la prise de dcisions. Si les tats financiers
eux-mmes ne fournissent pas ncessairement des informations dtailles sur le parc
dimmobilisations de lAdministration locale, son tat et son cot, les informations, les
1
Le cot diffrentiel sentend dun cot qui diffre selon le choix effectu.
2
La comptabilit par centres de responsabilit a pour objet de ventiler les cots en fonction des
responsabilits dvolues chaque centre de responsabilit. Elle est par essence similaire la comptabilit
par activits, qui a pour objet de ventiler les cots en fonction des activits plutt que des responsabilits.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 12 de 114
documents et la discipline qui les sous-tendent permettent aux gouvernements dobtenir
les informations dont ils ont besoin pour prendre des dcisions plus claires
3
.
Le diagramme reprsent la Figure 2 (daprs le rapport de recherche Comptabilisation
des infrastructures dans le secteur public) montre comment les informations sur les
immobilisations qui figurent dans les tats financiers peuvent tre utilises dans
lorganisation.
Selon le rapport de recherche Comptabilisation des infrastructures dans le secteur public,
la comptabilisation lactif du parc dinfrastructures comporte les avantages suivants
4
:
elle fournit un contexte et un inventaire appropris au regard desquels les
dcisions concernant lentretien, les renouvellements, les remplacements, le
financement (par emprunts ou fonds propres) et la fixation des droits peuvent tre
dbattues;
elle cre une base de mesure commune qui permet damliorer la comparabilit;
elle constitue un point de dpart et une base utiles pour valuer priodiquement
ltat des infrastructures et faire ressortir lvolution de cet tat au fil du temps;
elle aide mettre en lumire la capacit du gouvernement de sadapter
lvolution des exigences de la collectivit en matire de services;
elle aide les dcideurs valuer sil sera possible de supporter long terme le
fardeau des dettes actuelles et les cots des programmes actuels et apprcier les
besoins futurs de remplacement ou damlioration des infrastructures;
elle facilite lvaluation des ventualits rattaches aux infrastructures en faisant
ressortir la nature des infrastructures du gouvernement, pour ainsi permettre
didentifier les divers types dvnements imprvus susceptibles de se produire.
En rsum, ces informations permettent une meilleure gestion des immobilisations,
llaboration de politiques dentretien et de remplacement appropries, lidentification et
la sortie du patrimoine des immobilisations excdentaires, ainsi quune meilleure gestion
des risques de pertes attribuables au vol ou aux dommages. Le dnombrement des
immobilisations et ltablissement de la faon dont ils sont amortis aident les
gestionnaires comprendre comment lutilisation des immobilisations influe sur la
prestation des services et les incite valuer dautres faons de grer les cots et
dassurer les services. La mthode de la comptabilit dexercice intgrale fournit de
linformation sur le cot complet des services et permet aux gestionnaires dvaluer les
besoins en matire de revenus futurs, la performance et la viabilit des programmes
existants ainsi que le cot probable et la rentabilit des activits et des services futurs
projets.
3
Comptabilisation des infrastructures dans le secteur public, Toronto, LInstitut Canadien des
Comptables Agrs, 2002, page 2.
4
Ibid., page 30.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 13 de 114
Cycle continu de gestion
Figure 2
tat des
immobili-
sations
tats
financiers
Rapport sur la
performance
Rapport
annuel
valuation
de la
performance
Gestion
financire
interne
Plan
stratgique
Plan de
gestion des
immob.
Gestion des
risques
Budget de
fonctionne-
ment annuel
Budget des
immob.
Plan financier
long terme
Systme intgr de gestion des immobilisations
Systmes de gestion de lentretien
Systme dvaluation de ltat des
immobilisations
Systmes dinformation
gographique
Systmes de gestion du cycle de
vie des immobilisations
Stocks dimmobilisations
Ingnieurs/gestionnaires des
installations
Finance dentreprise
Systme de grand livre
auxiliaire des immobilisations
Assurances
Achats
Grand livre gnral
Interface/intgration
Systmes de conception assiste
par ordinateur
Planification
annuelle b)
Mesure, suivi
et valuation
des rsultats
c)
Rapports de
performance
d)
Planification
stratgique
a)
Apprentissage et
ajustements
Ralisation de
programmes
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 14 de 114
Chapitre 2 Comprendre les normes comptables
Le chapitre SP 3150, Immobilisations corporelles, a pour objet dtablir des normes sur
le traitement comptable des immobilisations corporelles des Administrations locales afin
que les utilisateurs de leurs tats financiers condenss puissent obtenir des informations
sur les investissements consacrs par les Administrations locales leurs immobilisations
corporelles et sur lvolution de ces investissements dans le temps. Les principales
questions abordes sont la comptabilisation des immobilisations, la dtermination de
leurs valeurs comptables et la comptabilisation des charges damortissement et des
rductions de valeur. Le prsent chapitre fournit des explications et des renseignements
de base visant faciliter la comprhension des normes encadrant la comptabilisation des
immobilisations corporelles.
1.0 Dfinition dun actif
1.1 Norme comptable
Le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public contient les dfinitions
suivantes :
Chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des tats financiers :
Les actifs sont les ressources conomiques sur lesquelles le gouvernement exerce un
contrle par suite doprations ou dvnements passs, et qui sont censes lui procurer
des avantages conomiques futurs. (Paragraphe SP 1000.35)
Les actifs non financiers sont constitus des lments dactif acquis, construits,
dvelopps ou mis en valeur qui, normalement, ne produisent pas de ressources servant
rembourser les dettes existantes. Ces lments ont par ailleurs les caractristiques
suivantes :
a) ils sont normalement utiliss pour fournir des services publics;
b) ils peuvent tre consomms dans le cours normal des activits;
c) ils ne sont pas destins tre vendus dans le cours normal des activits.
(Paragraphe SP 1000.42)
Chapitre SP 3150, Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers ayant une existence
matrielle :
a) qui sont destins tre utiliss pour la production ou la fourniture de biens, pour
la prestation de services ou pour ladministration, tre donns en location des
tiers, ou bien servir au dveloppement ou la mise en valeur, la construction,
lentretien ou la rparation dautres immobilisations corporelles;
b) dont la dure conomique stend au-del dun exercice;
c) qui sont destins tre utiliss de faon durable;
d) qui ne sont pas destins tre vendus dans le cours normal des activits.
(Paragraphe SP 3150.05)
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 15 de 114
1.2 Application de la norme SP 3150
Pour quun lment soit constat comme une immobilisation corporelle aux fins de
linformation financire, il doit remplir les deux critres suivants :
1. il doit rpondre la dfinition dune immobilisation corporelle;
2. son cot ou sa valeur doit pouvoir tre mesur de faon fiable.
Voici certains des principaux lments de la dfinition des immobilisations corporelles :
elles constituent des ressources conomiques contrles par une Administration
locale;
elles dcoulent doprations ou de faits passs;
elles reprsentent des avantages conomiques futurs dont la ralisation est
prvue
5
;
elles sont destines tre utilises de faon durable et non tre revendues dans
le cours normal des activits;
leur dure conomique stend au-del dun exercice.
Enfin, les lments dont la valeur nest pas mesurable ou ne peut faire lobjet dune
estimation raisonnable ne peuvent tre comptabiliss dans les totaux des tats financiers.
1.3 Notion de contrle
La notion de contrle exerc sur lavantage conomique que procure un lment dactif
est une question importante pour dterminer si cet actif doit tre inscrit dans les tats
financiers dune Administration locale. Ainsi, dans certaines provinces, les
Administrations locales ne sont pas propritaires des routes et des autoroutes qui
traversent le territoire sur lequel elles ont comptence. Proprit et contrle ne sont
cependant pas synonymes. Ainsi, dans le cas dune immobilisation corporelle loue,
mme si lAdministration nest pas propritaire du bien en question, celui-ci est prsent
dans les tats financiers parce que les avantages conomiques quil procure reviennent en
quasi-totalit lAdministration locale. Cest aussi le cas des partenariats public-priv (p.
5
Le terme prvu est utilis dans son sens gnral usuel et qualifie ce quoi il est raisonnable de
sattendre, ou ce quil est raisonnable denvisager ou de croire sur la foi des lments probants
disponibles ou de la logique, mais qui nest ni certain, ni prouv. Il nest pas employ pour traiter de la
constatation des lments qui ne rpondent pas la dfinition dun actif (voir le paragraphe SP 1000.54,
pour un complment dexplications).
CONSEIL Seuil dinscription lactif
En thorie, un lment qui rpond la dfinition et aux critres de constatation est
comptabilis titre dimmobilisation corporelle. En pratique, la plupart des organisations
dterminent des seuils dinscription lactif ou des montants minimums que les dpenses
doivent dpasser pour pouvoir tre inscrites dans les immobilisations. Les lments dont
la valeur est infrieure ce seuil sont passs dans les charges de lexercice. (Voir la
rubrique 4.0, Seuils de comptabilisation, du chapitre 4.)
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 16 de 114
ex., partenariats de type construction, proprit et exploitation). Pour dterminer si une
Administration locale devrait prsenter une immobilisation, il convient dexaminer les
indicateurs de contrle suivants :
LAdministration locale est-elle la bnficiaire des avantages conomiques futurs
rattachs limmobilisation?
Les dispositions des lois ou les modalits dun contrat transfrent-elles
lAdministration locale la quasi-totalit des avantages et des risques inhrents la
proprit?
LAdministration locale est-elle responsable de la performance, de la disponibilit
et de lentretien de limmobilisation?
LAdministration locale est-elle responsable de la remise neuf et du
remplacement de limmobilisation?
LAdministration locale sexpose-t-elle tous les risques lis lobsolescence,
aux dommages environnementaux, aux dommages non assurs ou la
condamnation de limmobilisation?
LAdministration locale utilise-t-elle lactif de faon continue pour la production
ou la fourniture de biens et services?
Lorsque des tiers ont fait un usage important de lactif, lAdministration locale
est-elle en mesure de restreindre cet usage?
LAdministration locale doit-elle prendre en charge les cots de construction de
limmobilisation ainsi que les consquences financires ou autres des
dpassements de dlais ou des retards dexcution rsultant dvnements
indpendants de sa volont au cours de la priode de construction, ou les cots
des rparations effectues aprs la priode couverte par la garantie?
1.4 Matriel informatique et logiciels
La section Objet et champ dapplication du chapitre SP 3150 indique que le matriel
informatique et les logiciels sont des immobilisations corporelles. On pourrait penser que
les logiciels sont des actifs incorporels, car ils nont pas dexistence matrielle, mais ils
sont considrs comme des immobilisations corporelles parce quils sont essentiels au
fonctionnement des ordinateurs. Leur cot est directement attribuable linstallation du
matriel informatique dans ltat ncessaire son utilisation prvue.
2.0 uvres dart et trsors historiques
Selon le chapitre SP 3150, les uvres dart et les trsors historiques ne sont pas constats
titre dimmobilisations corporelles dans les tats financiers des Administrations locales
du fait quil est impossible de faire une estimation raisonnable des avantages
conomiques futurs qui se rattachent ces biens. La valeur culturelle ou historique des
uvres dart et des trsors historiques est telle que les Administrations locales entendent
les entretenir et les prserver perptuit. Dans bien des cas, il nest mme pas possible
dattribuer une valeur ces biens elle est inestimable. Si certaines uvres dart et
trsors historiques peuvent tre reproduits, ils ne peuvent pas tre remplacs. Les
reproductions ont rarement la mme valeur intrinsque que les originaux.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 17 de 114
Il faut nanmoins faire tat de lexistence de ces biens dans les notes affrentes aux tats
financiers. Les frais lis la conservation, au nettoyage et la restauration qui sont
implicites dans le cas des uvres dart et des trsors historiques doivent tre passs en
charges dans lexercice au cours duquel ils sont engags.
3.0 valuation des immobilisations
3.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 3150 :
Les immobilisations corporelles doivent tre comptabilises au cot.
(Paragraphe SP 3500.09)
3.2 Pourquoi le cot historique?
Du ct du secteur public, nombre dintervenants ont indiqu que lutilisation du cot
historique na aucune signification, tant donn la longue dure de vie des infrastructures.
Il y a essentiellement trois arguments contre lutilisation du cot historique :
1. La comptabilit traditionnelle au cot historique na pas apport de rponse
satisfaisante aux problmes de mesure de la performance des entreprises en
priode de fluctuation des prix et des valeurs montaires.
2. Comme les infrastructures doivent tre remplaces sur une base continue, nombre
dintervenants sont davis que les cots dutilisation des infrastructures devraient
reflter leurs cots actuels, plutt quune rpartition du cot des infrastructures
dorigine. Par consquent, le cot historique peut ne pas constituer linformation
la plus pertinente pour les dcideurs.
3. Les ingnieurs soutiendront que le cot de remplacement est significatif, car cest
le montant quil faut budgtiser pour remplacer les immobilisations. Il sert aussi
de mesure pour valuer les dpenses ncessaires pour lentretien et les
renouvellements par rapport aux dpenses relles.
De manire gnrale, au moment de lacquisition, le cot dune immobilisation quivaut
son cot actuel et sa juste valeur. Aprs son acquisition, toutefois, il y a trois faons
possibles dvaluer une immobilisation corporelle :
1. le cot historique;
2. le cot de remplacement (ou le cot actuel);
3. la juste valeur (ou la valeur de march).
Des valeurs diffrentes servent tayer des dcisions diffrentes. On utilise par exemple
la juste valeur lors de la vente dune immobilisation, tandis quon a recours la valeur de
remplacement des fins dassurance ou, dans le cas dun exercice budgtaire, pour
estimer les besoins de financement. Le cot historique est utilis pour la reddition de
comptes et ltablissement du cot de revient.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 18 de 114
Ces diverses units de mesure ont chacune leurs avantages et leurs inconvnients.
Comme la comptabilit est fonde sur les oprations, la principale mesure des actifs et
des passifs est la valeur quils avaient au moment de leur acquisition, de leur
dveloppement, de leur mise en valeur ou de leur construction. La comptabilisation au
cot historique est par consquent objective et fiable, car elle est fonde sur des
oprations ngocies. Elle limine les incertitudes lies lutilisation dautres bases de
mesure.
Le cot de remplacement mesure la valeur dune immobilisation au cot actuel engager
pour la remplacer. Ce cot tient compte des diffrents usages possibles du bien et
correspond au cot conomique actuel dacquisition du potentiel de service existant. Pour
ses partisans, le cot de remplacement a lavantage dtre une valeur raliste et facile
comprendre pour les immobilisations prsentes dans les tats financiers. Cest
particulirement le cas pour les immobilisations dont la dure de vie est trs longue, car
le montant pass en charges au titre de lamortissement aurait une valeur actuelle qui
saccorderait avec la valeur des autres lments (par exemple les revenus) de ltat des
rsultats. Certains considrent cela comme particulirement utile pour la mise de ct de
fonds en vue du remplacement ultrieur de limmobilisation.
La juste valeur est le montant de la contrepartie dont conviendraient des parties
comptentes agissant en toute libert dans des conditions de pleine concurrence.
Lutilisation de la juste valeur pour les immobilisations a les mmes avantages que
lutilisation de la valeur de remplacement. Lapplication de la juste valeur est toutefois
rendue difficile par labsence de march actif pour certaines immobilisations corporelles.
Sans march actif, les mthodes de substitution utilises pour dterminer les justes
valeurs font une plus grande part au jugement lors de ltablissement des tats financiers.
Sil est parfois utile de recourir une autre mesure pour le financement du remplacement
dune immobilisation corporelle, lutilisation continue de la comptabilisation au cot
historique est approprie. Le cot historique est une mesure fiable au sens quil repose
sur une information qui concorde avec les oprations et les faits auxquelles il a trait, quil
est susceptible de faire lobjet dune vrification indpendante et quil est
raisonnablement exempt derreurs et de partis pris. Le cot historique constitue en outre
une donne constante et vrifiable partir de laquelle la direction peut faire des
estimations des cots de remplacement futurs ou des valeurs de march. La mthode du
cot historique est gnralement reconnue par les normalisateurs du monde entier, son
application est bien comprise, et cest encore la mthode de comptabilisation privilgie
pour toutes les immobilisations.
3.3 valuation du cot
Le cot est le montant brut de la contrepartie donne pour acqurir, construire,
dvelopper ou mettre en valeur une immobilisation corporelle. Le cot englobe tous les
frais directement rattachs lacquisition, la construction ou la mise en valeur de
limmobilisation corporelle, y compris les frais engags pour amener celle-ci lendroit
et dans ltat o elle doit se trouver aux fins de son utilisation prvue. Voici des exemples
de frais directement rattachs :
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 19 de 114
frais lis la prparation du terrain;
frais initiaux de livraison et de manutention;
frais dinstallation et dassemblage;
frais lis la vrification du fonctionnement de limmobilisation avant ou pendant
linstallation;
honoraires.
Lexpression directement rattach est essentielle pour dterminer si un cot peut tre
imput une immobilisation corporelle. Par exemple, les salaires et les charges sociales
des employs du service de la conception qui sont directement lis la ralisation des
plans techniques dune immobilisation construite peuvent tre inclus dans le cot brut de
cette immobilisation. Par contre, on ne considre gnralement pas comme un cot
directement rattach limmobilisation la fraction des frais fixes (p. ex., frais
doccupation ou frais gnraux dadministration associs au service dingnierie de la
ville, etc.).
Lorsque plusieurs immobilisations sont acquises pour un prix dachat global, il est
ncessaire de ventiler celui-ci entre toutes les immobilisations corporelles acquises, selon
leur juste valeur relative au moment de lacquisition. Lexemple le plus courant est celui
de lacquisition dun terrain et damliorations. Lorsque la juste valeur des composantes
nest pas immdiatement disponible, on peut utiliser dautres valeurs de substitution,
comme les valuations aux fins des impts fonciers, la valeur de biens similaires ou le
cot estimatif de reconstitution/remplacement. On peut aussi considrer les valeurs de
march de composantes semblables, comme le prix de vente dun terrain vacant.
Une Administration locale peut faire lacquisition dun bien dont elle nentend pas
utiliser certaines parties. Il se peut ainsi que des btiments se trouvant sur un terrain
acquis afin dy amnager un parc soient destins tre dmolis. Dans ce cas, le prix
dachat global, major de tous les cots, dfalcation faite du produit net de la dmolition,
sera imput au terrain. De la mme faon, une Administration locale peut faire
lacquisition dun bien en sachant quil sera ncessaire dengager des dpenses pour le
prparer aux fins de son utilisation (p. ex., assainissement de lenvironnement). Le cot
de ce bien comprendra toutes les dpenses ncessaires ultrieures pourvu quelles ne
dpassent pas la juste valeur du bien.
Les pices de rechange et le matriel de dpannage sont habituellement classs dans les
stocks et passs en charges mesure de leur utilisation. Les pices importantes et le
matriel de secours peuvent cependant tre considrs comme des immobilisations
corporelles lorsquune Administration locale sattend les utiliser pendant plus dun
exercice. De mme, lorsque les pices de rechange et le matriel de dpannage ne
peuvent tre utiliss quavec une immobilisation corporelle et quil est prvu que leur
utilisation sera irrgulire, ils peuvent alors tre comptabiliss comme des
immobilisations corporelles et amortis sur une priode ne dpassant pas la dure de vie
utile de limmobilisation en question.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 20 de 114
3.4 Subventions et dons
Les Administrations locales reoivent souvent des subventions des gouvernements
dordre suprieur ou des dons lgard du cot dacquisition dune immobilisation. Ces
arrangements peuvent prvoir le remboursement de la totalit ou dune partie du cot.
Une Administration locale peut ainsi recevoir une subvention du gouvernement
provincial et des dons dassociations communautaires en vue de la construction dun
centre communautaire.
Selon la dfinition du cot, les subventions dquipement et les dons ne peuvent tre
dduits du cot de limmobilisation. En fait, la norme SP 3150 indique expressment que
les subventions dquipement ne sont pas dduites du cot des immobilisations
corporelles auxquelles elles se rattachent.
3.5 Capitalisation des intrts dbiteurs
Les intrts dbiteurs peuvent tre compris dans le cot brut dune immobilisation
lorsque lAdministration locale a pour politique de capitaliser ces intrts.
LAdministration locale doit appliquer la politique de faon uniforme toutes les
catgories dimmobilisations, par exemple tous les projets de construction (btiments,
rseaux dalimentation en eau et gouts).
La capitalisation des frais financiers est soumise un certain nombre de restrictions. Les
frais financiers engags pendant quun terrain acquis des fins de construction est dtenu
sans quon y effectue de travaux de construction, de dveloppement ou de mise en valeur
ne peuvent tre capitaliss. La capitalisation des frais financiers cesse aussi lorsque
limmobilisation se trouve en tat dutilisation pour la production de biens et de services.
Une immobilisation corporelle est normalement en tat dutilisation productive lorsque
lacquisition, la construction, le dveloppement ou la mise en valeur est quasi termin. La
dtermination du moment o une immobilisation corporelle ou partie dimmobilisation
corporelle est en tat dutilisation productive exige que lon tienne compte des
circonstances dans lesquelles elle sera utilise. Normalement, lAdministration locale
dtermine ce moment en prenant en considration des facteurs tels que la capacit de
production, le taux doccupation ou lcoulement du temps.
4.0 Dons ou apports dimmobilisations
Les Administrations locales peuvent recevoir des immobilisations corporelles sous forme
dapports. On pense notamment au transfert dimmobilisations corporelles des
gouvernements dordre suprieur aux Administrations locales un cot nul ou
symbolique. On peut aussi citer les contrats de dveloppement ou de mise en valeur qui
exigent souvent que les promoteurs fournissent les immobilisations corporelles comme
les rues, les trottoirs et lclairage des rues.
Les dons et les apports sous forme dimmobilisations rpondent la dfinition dune
immobilisation corporelle, car ils reprsentent un avantage conomique futur sur lequel
lAdministration locale exerce un contrle. Lopration ou lvnement pass qui permet
lAdministration locale dexercer un contrle sur lavantage conomique est le transfert
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 21 de 114
de limmobilisation. Comme dans le cas dune acquisition, le cot de lutilisation dune
immobilisation reue sous forme dapport doit tre prsent dans les tats financiers. La
comptabilisation des immobilisations reues sous forme de dons ou dapports permet de
fournir des informations exhaustives sur le cot des services et accrot la comparabilit
des rsultats financiers tant au sein de lAdministration locale quavec dautres
Administrations locales tout en garantissant que les contribuables comprendront le cot
complet des services fournis.
Dans le cas des immobilisations reues sous forme de dons ou dapports, la difficult
consiste dterminer la valeur laquelle il convient de les comptabiliser. Le chapitre
SP 3150 indique que le cot dune immobilisation reue sous forme de don ou dapport
est considr tre gal sa juste valeur la date de lapport, celle-ci tant le montant de
la contrepartie dont conviendraient des parties comptentes agissant en toute libert dans
des conditions de pleine concurrence. tant donn leur nature, il se peut quil nexiste pas
de march actif pour certaines immobilisations corporelles. Selon le chapitre SP 3150,
lestimation de la juste valeur des immobilisations corporelles reues sous forme
dapports peut se faire au moyen de valeurs de march ou de valeurs dexpertise. Dans
des circonstances inhabituelles o il nest pas possible de faire une estimation de la juste
valeur, limmobilisation corporelle est comptabilise pour une valeur symbolique.
Lorsque lapport consiste en un groupe dimmobilisations, un cot doit tre dtermin
pour chacune des immobilisations du groupe. Par exemple, lapport dun promoteur
constitu des chausses, des bordures de trottoir et caniveaux, de lclairage des rues et
des trottoirs peut comprendre le terrain sur lequel ils sont construits. Il est alors important
que la composante terrain soit identifie et comptabilise, car elle nest habituellement
pas amortissable.
5.0 Approche de lactif unique ou approche axe sur les
composantes
De nombreuses immobilisations corporelles, notamment les rseaux complexes tels que
les systmes dpuration des eaux et de traitement des eaux uses, sont constitues dun
certain nombre de composantes. Par exemple, un rseau dpuration des eaux comprend
des conduites matresses, des canalisations de distribution, des bassins, des postes de
relevage, des usines de filtration et de traitement et des conduites de branchement.
Le chapitre SP 3150 donne aux Administrations locales le choix de comptabiliser ces
rseaux comme un actif unique ou de traiter chaque composante titre dactif distinct.
Pour dterminer si elle comptabilise chaque composante titre dactif distinct,
lAdministration locale se fonde sur lutilit quelle retirerait des informations obtenues
et sur le cot engager pour runir et tenir jour les informations par rapport aux
avantages qui en dcoulent.
5.1 Approche de lactif unique
Selon lapproche de lactif unique, on traite par exemple lensemble dun rseau
dalimentation en eau comme un actif unique. Au fur et mesure que les composantes
sont remplaces, elles sont simplement passes en charges au titre des rparations et de
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 22 de 114
lentretien. On estime galement la dure de vie prvue et lamortissement moyens de
lensemble du rseau. Les principaux avantages de cette approche tiennent son faible
cot et sa simplicit, qui rsultent du fait que lon na pas besoin de tenir des comptes
dtaills et de faire des estimations des dures de vie prvues des composantes.
5.2 Approche axe sur les composantes
Selon lapproche axe sur les composantes, un rseau dalimentation en eau peut tre
subdivis en grandes composantes ayant des dures de vie utile et des profils de
consommation similaires. Une telle approche nexige toutefois pas que chaque lment
du rseau dalimentation en eau soit identifi sparment. Les grandes composantes
doivent tre comptabilises comme des actifs distincts. Il peut ainsi convenir de grouper
les pompes rattaches une installation donne de production deau potable.
6.0 Inscription lactif des modernisations et des amliorations
Amliorations
Le cot dune immobilisation comprend aussi les cots ultrieurs engags au titre des
amliorations. Une amlioration sentend dun cot engag pour accrotre le potentiel de
service dune immobilisation corporelle. En gnral, pour les immobilisations
corporelles, le potentiel de service peut tre accru lorsque :
la capacit de production physique ou de service estime antrieurement est
augmente;
les frais de fonctionnement y affrents sont rduits;
leur dure de vie est prolonge;
la qualit des extrants est amliore.
Les autres dpenses sont considres comme des rparations ou de lentretien et passes
dans les charges de lexercice.
Dans le cas des rseaux dont la dure de vie est trs longue, la distinction entre entretien
et amlioration est plus difficile tablir. Il peut en effet savrer impossible didentifier
les dpenses qui ont pour effet de prolonger la dure de vie des immobilisations. Les
caractristiques de base suivantes peuvent toutefois tre utilises pour distinguer
lentretien des amliorations :
lentretien et les rparations permettent de maintenir le potentiel de service
prdtermin dune immobilisation corporelle pendant une dure de vie utile
donne. Les dpenses ce titre sont passes en charges dans lexercice au cours
duquel elles sont faites;
les amliorations augmentent le potentiel de service (et peuvent augmenter ou non
la dure de vie utile rsiduelle de limmobilisation corporelle). Les dpenses ce
titre sont incluses dans le cot de limmobilisation.
Le fait quune Administration locale comptabilise ses immobilisations selon lapproche
de lactif unique ou selon lapproche axe sur les composantes peut galement se
rpercuter sur le traitement des dpenses ultrieures. Par exemple, si le rseau routier est
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 23 de 114
comptabilis comme un actif unique, les dpenses visant largir les routes ou
augmenter le nombre de voies accroissent la capacit du rseau routier et sont
manifestement des amliorations. Les dpenses consacres aux programmes annuels de
renouvellement des surfaces ou au rebouchage des fissures du revtement qui sont
engages pour maintenir le potentiel de service attendu dune route ou sa dure de vie
utile estimative sont plus de lordre de lentretien (p. ex., renouvellement des surfaces).
En revanche, si le rseau routier est comptabilis selon lapproche axe sur les
composantes, et que la chausse est une composante distincte, les dpenses lies au
renouvellement de la surface sont traites comme une amlioration et la chausse
remplace est comptabilise comme une sortie du patrimoine et supprime du registre des
actifs.
7.0 Sorties du patrimoine
7.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 3150 :
La diffrence entre le produit net ralis sur la sortie dune immobilisation
corporelle du patrimoine et la valeur comptable nette de limmobilisation doit tre
comptabilise titre de revenu ou de charge dans ltat des rsultats. (Paragraphe
SP 3150.38)
7.2 Application de la norme
La sortie dune immobilisation corporelle du patrimoine au cours de la priode peut
rsulter de sa vente, de son change, de sa destruction, de sa perte ou de son abandon.
Une telle sortie reprsente une rduction de linvestissement de lAdministration locale
dans des immobilisations corporelles.
Lorsquune immobilisation corporelle est sortie du patrimoine, son cot et
lamortissement cumul sont supprims des comptes. Tout cart entre le produit net
ralis sur la sortie de limmobilisation et sa valeur comptable est comptabilis titre de
revenu ou de charge dans ltat des rsultats. La valeur de reprise est incluse dans le
produit net ralis sur la sortie de limmobilisation.
Lorsquune composante dun rseau complexe est remplace, la mise hors service de
limmobilisation remplace est traite comme une sortie du patrimoine. Par exemple, si le
renouvellement de la surface est effectu pour un tronon de route, le cot et
lamortissement cumul de la chausse remplace sont supprims des comptes. Lcart
entre la valeur de rcupration et la valeur comptable, sil en est, est comptabilis titre
de revenu ou de charge.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 24 de 114
CONSEIL Sorties rputes du patrimoine
Certaines Administrations locales ont adopt une politique de sortie rpute du
patrimoine pour certaines immobilisations corporelles, lorsque des remplacements ont
lieu intervalle rgulier (p. ex., les ponceaux) et que les frais dadministration engager
pour retracer et comptabiliser sparment chaque opration dacquisition et de sortie sont
prohibitifs. En pareils cas, toutes les nouvelles immobilisations sont comptabilises et
amorties sur la dure de vie utile estimative applicable. Limmobilisation est cense ou
rpute avoir t sortie du patrimoine au cours de sa dernire anne de vie utile
estimative. Au moment de la sortie rpute, le cot complet de la nouvelle
immobilisation et lamortissement cumul connexe sont retirs des documents
comptables.
8.0 Amortissement
8.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 3150 :
Le cot dune immobilisation corporelle dont la dure de vie est limite, dfalcation
faite de sa valeur rsiduelle, doit tre amorti sur sa dure de vie utile dune
manire logique et systmatique approprie la nature de limmobilisation et son
utilisation par le gouvernement. (Paragraphe SP 3150.22)
Lamortissement du cot des immobilisations corporelles doit tre pass en charges
dans ltat des rsultats. (Paragraphe SP 3150.23)
La mthode damortissement ainsi que lestimation de la dure de vie utile de la
fraction non amortie dune immobilisation corporelle doivent tre rvises
priodiquement et modifies lorsque lopportunit dun changement peut tre
clairement tablie. (Paragraphe SP 3150.29)
Les Administrations locales jouissent de lavantage conomique qui se rattache une
immobilisation ou de son potentiel de service principalement en utilisant cette
immobilisation. La mthode damortissement doit reflter la faon dont lAdministration
locale profite de lavantage conomique ou du potentiel de service rattachs
limmobilisation pour assurer la prestation de services. Dautres facteurs, comme
lobsolescence technologique, peuvent aussi amoindrir lavantage conomique ou le
potentiel de service dune immobilisation et influer sur son taux damortissement. Une
charge damortissement est constate mme lorsque la valeur de limmobilisation est
suprieure sa valeur comptable.
8.2 Estimation de la dure de vie utile
En rgle gnrale, la dure de vie utile dune immobilisation corporelle correspond
normalement la plus courte des dures physique, technologique, commerciale ou
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 25 de 114
juridique. La dure de vie utile dune immobilisation est fonction de son utilisation par
lAdministration locale.
Le chapitre SP 3150 ne donne aucune indication expresse cet gard, car il nest pas
possible de dterminer lavance avec certitude la dure de vie utile des immobilisations.
Pour estimer la dure de vie utile dune immobilisation, lAdministration locale doit tenir
compte de son tat actuel, de son utilisation prvue, du type de construction et de la
politique dentretien. Elle doit aussi tenir compte de la dure de la priode au cours de
laquelle il est prvu que limmobilisation rponde aux exigences de la prestation de
services et de la technologie. Lestimation de la dure de vie utile doit reposer sur
lexprience de lAdministration locale et sur ses plans concernant les immobilisations.
Par exemple, une Administration locale peut paver un lot vacant qui servira de terrain de
stationnement pour les activits du centre-ville. Le terrain de stationnement et
lquipement peuvent matriellement tre en mesure de fournir un service pendant
10 ans, mais lAdministration locale prvoit ramnager le terrain dans cinq ans afin de
fournir des logements abordables aux citoyens. Dans ce cas, lutilisation future prvue du
terrain de stationnement est de cinq ans. Par consquent, le cot, dduction faite de la
valeur rsiduelle, sil en est, doit tre amorti sur cinq ans.
Les autres facteurs prendre en compte dans lestimation de la dure de vie utile dune
immobilisation corporelle comprennent :
lutilisation future prvue;
les effets de lobsolescence technologique;
lusure prvue due lusage ou lcoulement du temps;
le programme dentretien;
les conditions gologiques;
la capacit et lutilisation relle de limmobilisation;
les tudes portant sur des biens semblables mis hors service;
un changement dans la demande lgard des services dont limmobilisation
corporelle permet la prestation;
ltat de biens comparables.
Lentretien diffr peut raccourcir la dure de vie utile estimative dun bien. Par exemple,
si les programmes annuels de rebouchage de fissures du revtement des chausses sont
diffrs, leau peut sinfiltrer dans la plateforme, ce qui peut entraner la dtrioration de
la route et raccourcir sa dure de vie (voir le paragraphe 8.4 ci-aprs pour une plus ample
analyse de leffet des programmes dentretien et de renouvellement sur la dure de vie
utile estimative).
Nombre de biens dinfrastructure ayant une trs longue dure, telles les conduites
principales et les canalisations, ont souvent besoin dtre remplacs bien avant la fin de
leur dure physique, en raison des travaux routiers, de la corrosion ou des conditions
climatiques. Il faut tenir compte de tous ces facteurs au moment de dterminer la dure de
vie utile prvue dun bien dinfrastructure.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 26 de 114
8.3 Rvision de la mthode damortissement et de lestimation de la
dure de vie utile
Le chapitre SP 3150 exige que la mthode damortissement et lestimation de la dure de
vie utile soient rvises priodiquement. Cette rvision est fonction des faits. Par ailleurs,
avant de changer de mthode damortissement ou de modifier lestimation de la dure de
vie utile restante dune immobilisation, il doit tre clairement dmontr que ces
changements sont justifis. Le chapitre SP 3150 numre quelques-uns des faits
importants qui peuvent amener une Administration locale modifier la mthode
damortissement ou lestimation de la dure de vie utile restante dune immobilisation
corporelle. Voici ces faits :
changement dans le degr dutilisation de limmobilisation corporelle;
changement dans le mode dutilisation de limmobilisation corporelle;
mise hors service de limmobilisation corporelle pour une priode prolonge;
dommage matriel;
progrs technologiques importants;
changement dans la demande lgard des services dont limmobilisation
corporelle permet la prestation;
modification de la lgislation ou de lenvironnement ayant une incidence sur la
dure dutilisation de limmobilisation corporelle.
La modification du taux damortissement dune immobilisation par suite de la rvision de
lestimation de la dure de vie utile est traite comme une modification destimations
comptables plutt que comme une modification de mthode comptable. Selon le
paragraphe .27 du chapitre SP 2120, Modifications comptables, il convient de ne pas
donner effet rtroactif une modification destimation puisque cette dernire rsulte
dinformations nouvelles ou de faits nouveaux. Leffet dune rvision de lestimation de
la dure de vie dune immobilisation corporelle et son incidence sur la charge
damortissement sont rpartis sur lexercice au cours duquel a lieu la rvision et sur les
exercices futurs touchs par la modification.
8.4 Incidence comptable du report des dpenses dentretien et de
renouvellement
Le chapitre SP 3150 prcise que les dpenses planifies dentretien et de renouvellement
doivent tre prises en compte lors de lestimation de la dure de vie utile dune
immobilisation. Cela signifie que la politique de rparation et dentretien dune
Administration locale peut avoir une incidence sur la dure de vie utile dune
immobilisation. Il se peut que certaines immobilisations soient mal entretenues ou que
lentretien soit diffr indfiniment en raison de contraintes budgtaires. Les figures qui
suivent illustrent la faon dont est trait, d'un point de vue comptable, le report des
dpenses dentretien et de renouvellement. Pour arriver au terme de sa dure de vie utile
prvue, une immobilisation corporelle, en particulier un actif trs longue dure de vie
comme une route, peut ncessiter un entretien continu ainsi que des dpenses de
renouvellement mineures et majeures intervalles rguliers. La figure ci-dessous illustre
le cycle de vie type dune immobilisation ayant une trs longue dure de vie. Pour les fins
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 27 de 114
de lexemple, on a suppos que les immobilisations sont comptabilises selon lapproche
de lactif unique. On obtiendrait les mmes rsultats en utilisant lapproche axe sur les
composantes.
Le report des dpenses dentretien et de renouvellement peut entraner une baisse du
niveau de service et peut rduire lesprance de vie du bien. Cest ce qui se produit dans
la plupart des cas. Un report important des dpenses planifies peut exiger une rvision
des taux damortissement et de lestimation de la dure de vie utile de limmobilisation.
Sil est dtermin que la dure de vie utile estimative a t rduite, le taux
damortissement est accru de telle faon que le cot est pass en charges sur la dure de
vie utile rsiduelle. Le tableau qui suit illustre la faon dont les normes comptables
actuelles traitent de leffet du report de lentretien et du renouvellement des
immobilisations sur leur dure de vie utile estimative.
tat
Fin prvue de
la dure de vie
utile
Renouvellem
ents planifis
On suppose
que lentretien
prvu a t
effectu
tat moyen en supposant que
lentretien et les renouvellements
requis sont faits
Temps
tat
Temps
Fin prvue de
la dure de
vie utile
Effets de
lentretien et du
renouvellement
diffrs
Renouvellements
planifis
Taux et charge
damortissement ajusts
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 28 de 114
Le traitement comptable reflte leffet du report de lentretien et du renouvellement
requis, qui raccourcit la dure de vie utile estimative de limmobilisation et, partant,
touche le cot de lutilisation de lactif aux fins de la prestation de services. Le chapitre
SP 3150 prcise que leffet de ce report sur lestimation de la dure de vie utile nest
comptabilis que lorsque lopportunit dun ajustement est clairement tablie. Bien que le
report de lentretien et du renouvellement puisse ultimement se traduire par une moins-
value permanente de limmobilisation, il ne reprsente pas ncessairement une
diminution permanente de sa capacit de fournir des services.
Dans les faits, il arrive souvent que le report des dpenses dentretien et de
renouvellement nait aucune incidence sur lestimation de la dure de vie utile dune
immobilisation. La dcision de diffrer lentretien et le renouvellement peut nentraner
quune dtrioration du niveau de services que limmobilisation permet de satisfaire. Par
exemple, une Administration locale peut accepter une dtrioration de ltat dune route
(cest--dire un plus grand nombre de nids-de-poule et de dnivellations de la chausse),
sachant que la route continuera de fournir des services. La figure qui suit illustre cette
situation.
Cette situation nest pas traite par les normes comptables. Il ne convient donc pas
dajuster la dure de vie utile estimative et lamortissement.
9.0 Obligations dinformation et tablissement des catgories
dimmobilisations
9.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 3150 :
Les tats financiers doivent fournir les informations suivantes, par grandes
catgories dimmobilisations corporelles et au total :
a) le cot au dbut et la fin de lexercice;
b) les entres dans le patrimoine au cours de lexercice;
tat
Temps
Fin prvue de
la dure de vie
utile
Renouvellements
planifis
Effets de
lentretien et du
renouvellement
diffrs
Degr de
dgradation
du service
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 29 de 114
c) les sorties du patrimoine au cours de lexercice;
d) le montant des rductions de valeur opres au cours de lexercice;
e) le montant de lamortissement du cot des immobilisations corporelles
pour lexercice;
f) lamortissement cumul au dbut et la fin de lexercice;
g) la valeur comptable nette au dbut et la fin de lexercice.
(Paragraphe SP 3150.40)
Les tats financiers doivent aussi fournir les informations suivantes sur les
immobilisations corporelles :
a) la mthode damortissement utilise, y compris la priode ou le taux
damortissement, pour chaque grande catgorie dimmobilisations
corporelles;
b) la valeur comptable nette des immobilisations corporelles qui ne font pas
lobjet dun amortissement, soit parce quelles sont en cours de
construction, de dveloppement ou de mise en valeur, soit parce quelles
ont t mises hors service;
c) la nature et le montant des immobilisations corporelles reues sous forme
dapports au cours de lexercice et constates dans les tats financiers;
d) la nature et lutilisation des immobilisations corporelles constates pour
une valeur symbolique;
e) la nature des uvres dart et des trsors historiques dtenus par le
gouvernement;
f) le montant des intrts capitaliss au cours de lexercice.
(Paragraphe SP 3150.42)
9.2 Application de la norme
Une catgorie dimmobilisations regroupe des biens dont la nature et la fonction sont
similaires dans le cadre du fonctionnement de lAdministration locale; elle est prsente
comme un lment unique dans les tats financiers.
Le chapitre SP 3150 ne prescrit pas de catgories particulires dimmobilisations. En
effet, mme si cela pourrait accrotre la comparabilit et luniformit, il y a tout
simplement trop de variations possibles pour que cela soit faisable.
La slection de catgories dimmobilisations est fonction de la nature et des objectifs de
lAdministration locale. Les Administrations locales diffrant les unes des autres, leurs
catgories dimmobilisations corporelles refltent ces diffrences. Prenons par exemple
les diffrences entre une Administration locale de rang infrieur et une Administration
locale de plus grande envergure, ou rgionale. Le type dimmobilisations corporelles
quutilisent ces deux ordres dAdministrations locales est trs diffrent. Les catgories
doivent tre tablies de faon tre les plus reprsentatives possible des immobilisations
corporelles de lAdministration locale. Il se peut quune Administration locale ait dfini
une catgorie pour son rseau dalimentation en eau qui ne convient pas une autre
Administration locale qui achte de leau potable un organisme gouvernemental local.
Dans ce cas, la meilleure description serait probablement rseau de distribution deau.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 30 de 114
La liste ci-dessous, qui nest ni exhaustive ni obligatoire, peut tre un point de dpart
utile pour tablir des catgories dimmobilisations corporelles. Elle comprend les
catgories suivantes :
les terrains;
les btiments;
le matriel;
les routes;
les rseaux dalimentation en eau, les rseaux dgout et autres systmes de
services publics;
les ponts;
les rseaux de transport dlectricit;
les rseaux de communications;
les vhicules motoriss;
le mobilier et les agencements.
LAdministration locale peut en outre dcider dtablir des catgories distinctes pour
les immobilisations en cours de construction ou de mise en valeur, les
immobilisations mises hors service, les immobilisations excdentaires et les
immobilisations vises par des contrats de location-acquisition.
10.0 Moins-values
10.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 3150 :
Lorsque la conjoncture indique quune immobilisation corporelle ne contribue plus
la capacit du gouvernement de fournir des biens et des services, ou que la valeur
des avantages conomiques futurs qui se rattachent limmobilisation corporelle
est infrieure sa valeur comptable nette, le cot de limmobilisation corporelle
doit tre rduit pour reflter sa baisse de valeur. (Paragraphe SP 3150.31)
Les moins-values nettes sur immobilisations corporelles doivent tre passes en
charges dans ltat des rsultats. (Paragraphe SP 3150.32)
Aucune reprise sur rduction de valeur ne doit tre constate. (Paragraphe SP
3150.33)
10.2 Application de la norme
Il peut y avoir rduction de la valeur dune immobilisation dans les deux cas qui suivent.
10.2.1 Rduction de la valeur du potentiel de service
Il convient de constater une rduction de la valeur dune immobilisation corporelle
lorsque cette dernire ne contribue plus la capacit de lAdministration locale de fournir
des biens et services. Il convient aussi de constater une telle rduction de valeur lorsque
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 31 de 114
lAdministration locale na pas lintention de continuer utiliser limmobilisation aux
fins prvues et quil nexiste aucune autre utilisation pour cette immobilisation. Cela peut
se produire lorsquune immobilisation est mise hors service parce quelle a t
endommage, quelle repose sur une technologie obsolte ou quelle ne respecte pas les
normes environnementales. Sa valeur est alors ramene sa valeur rsiduelle, sil en est.
Il y a aussi lieu de rduire la valeur dune immobilisation lorsque le besoin de services
quelle permet de satisfaire change. Par exemple, le fait quun centre communautaire
attire un moins grand nombre de personnes par suite de la construction de nouvelles
installations peut justifier une rduction de sa valeur.
Lorsquune Administration locale a) peut objectivement estimer une rduction de la
valeur du potentiel de service quune immobilisation corporelle reprsente pour elle et
b) est convaincue, sur la foi dlments probants, quil y a lieu de sattendre ce que la
rduction soit de nature permanente, la valeur de limmobilisation est ramene la valeur
estimative rvise du potentiel de service que limmobilisation reprsente encore pour
lAdministration locale. Aucune rduction de valeur nest constate si lune ou lautre de
ces conditions nest pas remplie.
Lestimation du potentiel de service futur dune immobilisation corporelle peut tre
difficile. La Norme comptable internationale du secteur public IPSAS 21, Dprciation
dactifs non gnrateurs de trsorerie, donne certaines indications. Elle prcise
notamment que la valeur dutilit dune immobilisation peut dterminer sa valeur de
service recouvrable. LIPSAS 21 dfinit la valeur dutilit dun actif non gnrateur de
trsorerie comme la valeur actuelle (actualise) du potentiel de service rsiduel de cet
actif. La norme propose plusieurs mthodes fondes sur la valeur dutilit pour valuer
les avantages conomiques futurs :
le cot de remplacement amorti peut tre utilis pour mesurer la valeur actuelle du
potentiel de service rsiduel dun actif non gnrateur de trsorerie. Lestimation
du cot de remplacement est base sur un actif dont le potentiel de service est
similaire celui de lactif considr;
on peut aussi soustraire le cot de remise en tat de lactif du cot actuel de
remplacement du potentiel de service rsiduel de lactif avant sa dprciation
(habituellement le cot de remplacement amorti). Le cot de remise en tat est le
cot de remise en tat du potentiel de service dun actif son niveau davant
dprciation;
il est galement possible de rduire le cot actualis (habituellement le cot de
remplacement amorti) du potentiel de service rsiduel de lactif avant la
dprciation de manire se conformer au nombre rduit dunits de service
attendues de lactif avant dprciation.
10.2.2 Amoindrissement des avantages conomiques futurs
Il convient de comptabiliser une rduction de valeur lorsque la valeur comptable dune
immobilisation corporelle est suprieure la valeur de ses avantages conomiques futurs.
Il existe diverses faons destimer les avantages conomiques futurs, notamment les
suivantes :
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 32 de 114
dans le cas dun actif gnrateur de trsorerie, on utilise la valeur estimative de la
somme des flux de trsorerie non actualiss (rentres de fonds moins sorties de
fonds correspondantes) qui devrait rsulter de lutilisation et ultimement de la
sortie de cet actif.
Dans le cas o il existe un march actif pour limmobilisation, on utilise la juste
valeur diminue des cots de vente de limmobilisation.
10.3 Test de dprciation
Lobligation dappliquer un test de dprciation aux immobilisations corporelles est
habituellement fonction des vnements. Il nest ncessaire denvisager de comptabiliser
une rduction de valeur que lorsque les conditions indiquent que limmobilisation
corporelle a pu subir une moins-value. Parmi ces conditions, on trouve les suivantes :
changement dans le degr dutilisation de limmobilisation corporelle;
changement dans le mode dutilisation de limmobilisation corporelle;
progrs technologiques importants;
dommage matriel;
mise hors service de limmobilisation corporelle;
diminution ou disparition du besoin de services que limmobilisation corporelle
permet de satisfaire;
dcision de mettre fin la construction de limmobilisation corporelle avant
quelle ne soit termine, utilisable ou vendable;
modification de la lgislation ou de lenvironnement ayant une incidence sur la
mesure dans laquelle limmobilisation corporelle peut tre utilise.
10.4 Comptabilisation de la moins-value dune immobilisation
Une rduction de valeur est un ajustement du cot dune immobilisation. Un ajustement
correspondant est apport lamortissement cumul et lajustement net est prsent
comme une charge dans ltat des rsultats. Le nouveau cot doit tre amorti sur la dure
de vie utile rsiduelle de limmobilisation.
Lexemple qui suit montre comment valuer et comptabiliser la perte de valeur rsultant
dune diminution du besoin de services quune immobilisation corporelle permet de
satisfaire.
Donnes : Une usine de fabrication tablie dans une municipalit a ferm ses portes et de
nombreux rsidents de cette agglomration ont de ce fait perdu leur emploi. Depuis la
fermeture de lusine, la population de la municipalit a diminu de moiti, passant de
30 000 15 000 personnes. Ce changement est probablement permanent. La ville a un
rseau dalimentation en eau dont le cot stablissait lorigine 10 M$. Le rseau a t
conu pour desservir 20 000 branchements (rsidences unifamiliales et commerces) de
mme que lusine de fabrication. Le rseau a une dure de vie utile prvue de 40 ans et
est exploit depuis 20 ans. La municipalit a utilis la mthode de lamortissement
linaire pour passer en charges le cot du rseau sur sa dure de vie utile estimative. La
valeur comptable nette du rseau dalimentation en eau totalise 5,0 M$. La valeur
dutilit de son potentiel de service futur a t value 4,0 M$.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 33 de 114
Traitement comptable calcul de la rduction de valeur
Cot dorigine du rseau
dalimentation en eau
10 000 000
$
Amortissement cumul 10 000 000 $/40*20 5 000 000 $
Valeur comptable nette 5 000 000 $
Nouveau cot du rseau
dalimentation en eau*
4 000 000 $
Rduction nette de la
valeur de limmobilisation
5 000 000 $
- 4 000 000 $
1 000 000 $
* La valeur dutilit est dtermine partir du cot de remplacement amorti dun actif pouvant fournir des
services dalimentation en eau 10 000 clients des secteurs rsidentiel et commercial.
Cot de remplacement estimatif 8 000 000 $
Amortissement cumul (8 000 000 $/40 ans*20 ans) 4 000 000 $
Avantages conomiques futurs estimatifs 4 000 000 $
Le cot du rseau dalimentation en eau est rduit de 6,0 M$ et ramen 4,0 M$.
Lamortissement cumul est abaiss de 5,0 M$ et une charge de 1,0 M$ au titre de la
moins-value est prsente dans ltat des rsultats. Le nouveau cot du rseau
dalimentation en eau stablit 4,0 M$, montant qui est amorti sur la dure de vie utile
rsiduelle du rseau.
11.0 Immobilisations loues
11.1 Comptabilisation des contrats de location-acquisition
Les baux sont classs soit comme des contrats de location-acquisition soit comme des
contrats de location-exploitation. La distinction entre ces deux types de contrats
dtermine le traitement comptable appropri. La NOSP-2, Immobilisations corporelles
loues, contient la dfinition suivante, aux fins de cette distinction :
Une immobilisation corporelle loue est un actif non financier ayant une existence
matrielle, dont la dure de vie utile stend au-del dun exercice et qui est dtenu par le
gouvernement en vertu dun contrat de location (ou bail) afin dtre utilis de faon
durable pour la production ou la fourniture de biens ou de services. En vertu des
conditions du contrat de location, la quasi-totalit des avantages et des risques inhrents
la proprit sont, en substance, transfrs au gouvernement, mais pas ncessairement le
droit de proprit. (NOSP-2, paragraphe 3)
Pour que la quasi-totalit des avantages et des risques soient transfrs lAdministration
locale preneuse, au moins lune des conditions suivantes doit tre remplie :
il existe une assurance raisonnable que lAdministration locale accdera la
proprit du bien lou au terme de la dure du bail;
la dure du bail est telle que lAdministration locale jouira de la quasi-totalit des
avantages conomiques que lon prvoit pouvoir tirer de lutilisation du bien au
cours de sa dure de vie;
le bailleur est assur, en raison du bail, de rcuprer le capital investi dans le bien
lou et de gagner un rendement sur cet investissement.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 34 de 114
Dautres indications quant lapplication de ces conditions sont prcises au
paragraphe 6 de la NOSP-2.
Il peut quand mme tre ncessaire de classer le bien vis par le contrat de location
comme une immobilisation corporelle loue mme lorsque ces conditions ne sont pas
remplies. Il ne convient pas de sarrter un seul facteur pris isolment. Chaque facteur
doit tre considr du point de vue de son importance relative pour un bail donn. Voici
quelques-uns des facteurs prendre en considration :
si le bien lou est utilis pour la prestation dun service essentiel (comme les
prisons, les routes et autoroutes, les installations de services publics) et sil est de
nature tellement spcialise que lAdministration locale nest pas en mesure de
disposer rapidement dun bien de remplacement, il est probable que
lAdministration locale utilisera le bien pendant toute sa dure conomique;
lorsque lAdministration locale apporte une aide financire significative (terrain,
garanties de financement, transferts, etc.) pour le financement du cot de
lacquisition ou de la construction du bien quelle louera, elle assume certains
cots et risques rattachs au bien lou qui sont normalement lis la proprit du
bien;
lAdministration locale exerce un degr de contrle significatif sur la capacit non
utilise du bien lou (par exemple dans le cas o une tierce partie pourrait faire
une utilisation considrable du bien et que lAdministration locale est en mesure
de limiter cette utilisation, quelle paie ou non pour cette capacit);
lAdministration locale assume un risque rsiduel, ou bnficie dun avantage
rsiduel, li la proprit du bien (par exemple, lAdministration locale possde
le terrain sur lequel le bien lou est situ ou en conserve le contrle, et le bien ne
peut tre facilement dplac; lAdministration locale est tenue de trouver un sous-
locataire ou de rembourser des cots significatifs au bailleur pour rsilier le bail
avant son expiration; le bailleur a loption de transfrer lAdministration locale
le bien lou et toute obligation connexe lexpiration du bail; lAdministration
locale assume une part de la perte rsiduelle ou a droit une part du gain rsiduel
sur le bien lou);
lAdministration locale est responsable du fonctionnement, de la disponibilit
et/ou de lentretien du bien;
lAdministration locale assume le risque conomique rattach au bien lou (par
exemple, des loyers qui fluctuent en fonction dindices particuliers comme les
taux dintrt ou lindice des prix la consommation);
lAdministration locale assume la responsabilit du risque de construction (par
exemple, lAdministration locale paie les dpassements de cots ou ne dispose
pas du bien la date convenue);
lAdministration locale est tenue de payer pour des extrants ou une capacit,
quelle en ait besoin ou non (par exemple, lorsquelle garantit un paiement pour
un nombre minimum dutilisateurs dans un centre de loisirs);
lAdministration locale assume dautres risques potentiels dcoulant de la
proprit du bien, notamment lobsolescence, la responsabilit environnementale,
les dommages non assurs et la condamnation du bien.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 35 de 114
La prise en charge par lAdministration locale de ces risques ou dautres risques
significatifs peut tre une indication supplmentaire quelle dtient une immobilisation
corporelle loue.
11.2 Comptabilisation des immobilisations corporelles loues
Les biens qui rpondent la dfinition dune immobilisation corporelle loue doivent tre
comptabiliss en constatant une immobilisation corporelle et un passif. La valeur de
limmobilisation corporelle loue et le montant du passif dcoulant du bail, comptabiliss
au dbut de la dure du bail, correspondent la valeur actualise des paiements
minimums exigibles au titre de la location, abstraction faite de la partie de ces paiements
qui a trait aux frais accessoires
6
.
la date dentre en vigueur du bail, il faut rviser lestimation du taux dactualisation
utilis ainsi que les montants suivants afin de sassurer que tous les chiffres sont
raisonnables et cohrents entre eux :
la valeur actualise des paiements minimums exigibles au titre de la location;
la juste valeur hypothtique du bien;
la valeur rsiduelle hypothtique.
Pour dterminer la valeur actualise des paiements minimums exigibles au titre de la
location, lAdministration locale utilise comme taux dactualisation le moindre des deux
taux que constituent son taux dintrt marginal et le taux dintrt implicite du bail. La
valeur comptabilise au titre de lactif ne doit toutefois pas dpasser la juste valeur du
bien lou.
Les immobilisations corporelles loues sont amorties sur leur dure dutilisation prvue,
selon une formule compatible avec la politique damortissement applique par
lAdministration locale lgard des autres immobilisations corporelles de mme nature.
Si le bail comporte des dispositions daccession la proprit ou contient une option
dachat prix de faveur, la priode damortissement est la dure conomique du bien
lou. Sinon, le bien est amorti sur la dure du bail. Les paiements faits au titre de la
location sont rpartis entre les remboursements du passif, les intrts dbiteurs et tous
frais accessoires connexes. Le total des paiements minimums exigibles au titre de la
location, dduction faite du passif inscrit initialement, reprsente le total des frais
dintrt du bail. La dpense ou la charge dintrts est dtermine au moyen du taux
dactualisation utilis pour le calcul de la valeur actualise des paiements minimums
exigibles au titre de la location, appliqu au solde impay du passif dcoulant du bail au
dbut de la priode de versement des loyers.
6
Les frais accessoires sont les frais lis lutilisation de limmobilisation corporelle loue (par exemple,
assurances, entretien et impts fonciers).
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 36 de 114
Immobilisations corporelles loues
Figure 3
La proprit est cde ou le bail
comporte une option dachat
prix de faveur
Passation dun contrat de location
Le bail couvre une proportion
considrable de la dure
conomique du bien
La valeur actualise des
paiements minimums exigibles
au titre de la location reprsente
la valeur de lactif
Dautres facteurs indiquent que
la quasi-totalit des avantages et
des risques est transfre
lAdministration locale
Comptabilisation titre de contrat
de location-exploitation
Comptabilisation titre
dimmobilisation corporelle
loue
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 37 de 114
11.3 Oprations de cession-bail
Une opration de cession-bail est la vente et la reprise bail, par une Administration
locale, dun bien ou de la fraction dun bien. Lopration peut seffectuer au moyen dune
srie de ventes simultanes faisant intervenir plusieurs tiers ou organismes compris dans
le primtre comptable de lAdministration locale, et elle a pour rsultat que cette
dernire conserve lusage du bien ou dune fraction de celui-ci. Le Manuel de
comptabilit de lICCA pour le secteur public donne des indications sur le traitement
comptable appropri des oprations de cession-bail.
Le traitement comptable de la composante bail de lopration diffre selon quelle
transfre ou non lAdministration locale les avantages et les risques inhrents la
proprit du bien. Lorsque lAdministration locale conserve la quasi-totalit de lusage du
bien, cette composante est traite comme une immobilisation corporelle loue. Lorsque
lAdministration locale conserve lusage dune fraction relativement importante, mais
infrieure la quasi-totalit du bien, elle a dterminer si la partie reprise bail de
lopration doit tre classe comme une immobilisation corporelle loue selon la
NOSP-2.
12.0 Dispositions transitoires concernant lvaluation
Le chapitre SP 3150 prconise que toutes les immobilisations corporelles existantes la
date dentre en vigueur soient enregistres dans le systme comptable de
lAdministration locale. Les dispositions transitoires du chapitre SP 3150 permettent aux
Administrations locales dinscrire le cot dorigine effectif ou estimatif des
immobilisations corporelles de mme que leur amortissement cumul estimatif.
LAdministration locale doit appliquer la mme mthode destimation du cot toutes les
immobilisations corporelles pour lesquelles elle na pas de documents comptables au cot
historique, sauf lorsquil peut tre tabli quune mthode diffrente fournirait une
estimation plus exacte du cot pour un type particulier dimmobilisation corporelle.
Les informations inscrites comprennent le cot dorigine effectif ou estimatif des
immobilisations corporelles, leur dure de vie estimative et leur amortissement cumul
estimatif (lAnnexe B illustre le processus logistique de comptabilisation des
immobilisations corporelles et de prsentation dinformations).
CONSEIL tablir un seuil pour la comptabilisation initiale
Lorsquon dtermine des valeurs initiales, il faut garder lesprit que les normes
comptables nont pas t labores pour sappliquer des lments de valeur ngligeable
ou peu significative. Il importe dtablir un seuil qui permettra de grer leffort
administratif lors du dnombrement et de lvaluation des immobilisations.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 38 de 114
13.0 Application rtroactive de la nouvelle norme comptable
13.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 2120, Modifications comptables :
Les recommandations du prsent chapitre nont pas prsance sur les dispositions
relatives lapplication prospective ou rtroactive des modifications que
renferment les autres recommandations concernant la comptabilit dans le secteur
public. (Paragraphe SP 2120.11)
Lorsquon modifie une convention comptable pour se conformer de nouvelles
recommandations concernant la comptabilit dans le secteur public ou pour
appliquer la premire fois des recommandations concernant la comptabilit dans le
secteur public, les nouvelles recommandations peuvent tre appliques
prospectivement ou rtroactivement. (Paragraphe SP 2120.13)
Lorsquune modification de convention comptable est applique rtroactivement,
les chiffres de tous les tats financiers dexercices antrieurs fournis des fins de
comparaison doivent tre redresss en fonction de la nouvelle convention
comptable sauf dans le cas o lincidence de la nouvelle convention comptable sur
chaque exercice antrieur ne peut tre dtermine au prix dun effort raisonnable.
Dans ce dernier cas, le solde douverture du surplus ou dficit accumul de
lexercice considr ou dun exercice antrieur appropri doit tre redress pour
tenir compte de leffet cumulatif de la modification sur les exercices prcdents.
(Paragraphe SP 2120.17)
Pour chaque modification de convention comptable effectue au cours de
lexercice, les informations suivantes doivent tre fournies :
a) une description de la modification;
b) lincidence de la modification sur les tats financiers de lexercice;
c) le motif de la modification. (Paragraphe SP 2120.18)
Lorsquune modification de convention comptable est applique rtroactivement
avec redressement des chiffres des exercices antrieurs, on doit indiquer que les
tats financiers prsents pour les exercices antrieurs sont redresss et prciser
galement lincidence de la modification sur les chiffres de ces exercices.
(Paragraphe SP 2120.19)
Lorsquune modification de convention comptable est applique rtroactivement
mais sans redressement des chiffres des exercices antrieurs, on doit indiquer que
les tats financiers fournis pour les exercices antrieurs ne sont pas redresss. On
doit galement indiquer le montant du redressement cumulatif apport au solde
douverture du surplus ou dficit accumul de lexercice considr. (Paragraphe
SP 2120.20)
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 39 de 114
13.2 Application de la norme
Le paragraphe SP 2120.13 autorise lapplication prospective des nouvelles normes
comptables, mais le paragraphe SP 3150.44 annule son effet en prcisant que le chapitre
SP 3150 sapplique toutes les immobilisations corporelles. Les Administrations locales
doivent prsenter de linformation sur la totalit de leur parc dimmobilisations
corporelles et sur lamortissement de celles-ci dans leurs tats financiers condenss quel
que soit le moment auquel ces immobilisations ont t acquises.
On sattend ce que la plupart des Administrations locales adoptent les nouvelles
dispositions du chapitre SP 3150 de faon rtroactive, avec redressement des donnes de
tous les exercices antrieurs prsents pour fins de comparaison. Cette application
rtroactive avec redressement assure luniformit des mthodes comptables dune priode
lautre. Elle permet dinterprter les tendances en matire de performance de
l'Administration locale ainsi que les autres donnes analytiques fondes sur des
comparaisons.
Lorsque leffet de la nouvelle mthode comptable ne peut raisonnablement tre dtermin
pour chacun des exercices antrieurs, lAdministration locale peut ajuster le solde
douverture du surplus ou dficit accumul de lexercice considr ou d'un exercice
antrieur appropri pour tenir compte de leffet cumulatif de ladoption des dispositions
du chapitre SP 3150.
14.0 Dispositions transitoires de mise en uvre
14.1 Norme comptable
Selon le chapitre SP 3150 :
Dans le cas o, pendant la priode de transition, une Administration locale dispose
des informations requises pour une partie, mais non la totalit, de ses catgories
dimmobilisations corporelles, elle fournit les informations indiques dans la NOTE
DORIENTATION DU SECTEUR PUBLIC NOSP-7, Immobilisations corporelles
des Administrations locales. (Paragraphe SP 3150.45)
14.2 Application de la norme
Les Administrations locales ne sont pas autorises appliquer les nouvelles normes
comptables de faon fragmentaire. Tant quune Administration locale na pas runi toutes
les informations sur toutes les catgories dimmobilisations corporelles, elle ne peut pas
les prsenter dans ses tats financiers. Lorsquune Administration locale est en mesure de
prsenter des informations compltes sur toutes les catgories, selon les exigences du
chapitre SP 3150, elle peut adopter les nouvelles normes et le nouveau modle de
prsentation de linformation avant la date de mise en uvre prvue, soit le
1
er
janvier 2009. On vite ainsi limbroglio qui surviendrait si une Administration locale
prsentait son information sur la base la fois des immobilisations et des charges.
La NOSP-7, Immobilisations corporelles des Administrations locales, qui sapplique aux
exercices ouverts compter du 1
er
janvier 2007, a pour objet de fournir aux
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 40 de 114
Administrations locales des indications transitoires sur la prsentation dinformations
relatives aux immobilisations corporelles. Selon la NOSP-7, la prsentation
dinformations sur les immobilisations corporelles peut se faire par tapes. Dans le cas ou
une Administration locale dispose des informations fournir selon le chapitre SP 3150
sur une partie, mais non la totalit, de ses catgories dimmobilisations corporelles, elle
fournit ces informations. De plus, elle indique les catgories dimmobilisations
corporelles au sujet desquelles elle ne fournit pas dinformation.
Les informations sont prsentes dans les notes affrentes aux tats financiers jusquau
1
er
janvier 2009. Les obligations dinformation sont gnralement les mmes que celles
nonces dans le chapitre SP 3150.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 41 de 114
Chapitre 3 Planification de la mise en uvre
1.0 Gestion du processus
Le passage la comptabilisation des immobilisations corporelles est un projet important
pour la plupart des Administrations locales. Comme tout projet denvergure, il exige
dtre planifi et gr avec soin. Le passage se fera plus harmonieusement et plus
rapidement si le plan de mise en uvre comprend les lments suivants :
un mandat clair;
un engagement politique;
la mobilisation des services et des organisations centraux, ainsi que des
principaux responsables;
des ressources suffisantes (humaines et financires);
une structure efficace de gestion et de coordination de projet;
une capacit technologique et des systmes dinformation adquats.
2.0 Plan de mise en uvre
Pour prparer un plan de mise en uvre visant la comptabilisation des immobilisations
corporelles et la prsentation dinformations sur ces immobilisations, une Administration
locale doit avoir une certaine ide de ltendue des tches que cela suppose et des
ressources probables que demandera laccomplissement de ces tches. La quantit de
travail requise pour comptabiliser les immobilisations corporelles est fonction de la
mesure dans laquelle lAdministration locale dispose dj dinformation sur ces
immobilisations. Les principales tapes du processus de comptabilisation des
immobilisations sont les suivantes :
dfinir et constater les immobilisations corporelles;
dfinir les exigences en matire de systmes dinformation;
tablir les mthodes comptables pour chacune des catgories dimmobilisations, y
compris en ce qui a trait aux seuils dvaluation et de comptabilisation;
compiler des soldes douverture exacts pour chaque catgorie (identification,
application de la dfinition dun actif et valuation).
Six questions dterminantes
Quavez-vous comme immobilisations corporelles?
O se trouvent-elles?
Quand les avez-vous obtenues?
Combien ont-elles cot?
En quel tat sont-elles?
Quelle est leur dure de vie utile rsiduelle prvue?
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 42 de 114
Un plan de mise en uvre dtaill doit tablir ce qui suit :
la personne ou le poste responsable de chaque tche;
la personne ou le poste responsable de la gestion de cet aspect du plan;
les jalons et les chances du projet;
les lments interdpendants au sein du plan de comptabilisation des
immobilisations et entre la comptabilisation des immobilisations et les autres
parties du projet global;
les processus et les dlais de rsolution des problmes.
Un exemple gnral de plan de travail dtaill est prsent lAnnexe A.
3.0 Participation du vrificateur externe
Bien quil soit essentiel que le vrificateur maintienne son indpendance, ltablissement
dune relation de travail axe sur la collaboration avec le vrificateur au dbut du
processus de transition prsente de nombreux avantages, notamment celui de pouvoir
demander officiellement conseil au vrificateur externe sur les processus de mise en
uvre projets. Il est peu probable quun vrificateur soit en mesure de fournir
lassurance absolue quun systme ou un processus en particulier rpond aux exigences
de la vrification, mais il peut donner des conseils utiles sur les critres susceptibles de
servir valuer le systme ou le processus.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 43 de 114
Chapitre 4 Mthodes comptables visant les
immobilisations corporelles
1.0 laboration de mthodes comptables visant les
immobilisations corporelles
Lune des premires tapes du processus de mise en uvre consiste laborer des
mthodes comptables visant les immobilisations et les faire approuver. La liste de
contrle suivante porte sur les grandes questions quil faut aborder lorsquon dtermine
une mthode comptable pour traiter les immobilisations :
fondement, objet et champ dapplication;
dfinition dun actif;
catgories dactifs;
approche de lactif unique ou approche axe sur les composantes (segmentation);
valuation des actifs (cot, don ou apport sous forme dimmobilisation,
subventions ou dons, etc.);
mthodes dinscription lactif (btiments, livres de bibliothque, logiciels,
terrains et amnagement des terrains);
seuils de comptabilisation;
inscription lactif de cots lis lchelonnement dans le temps;
amliorations ou entretien;
mthodes et taux damortissement;
rvision de lestimation de la dure de vie utile et moins-value;
immobilisations corporelles loues;
grands livres dactifs (contenu, mise jour, dnombrement priodiques);
contrle (parc dimmobilisations, tenue des dossiers et documentation);
immobilisations en cours (moment partir duquel on commence amortir);
actifs excdentaires;
sorties dimmobilisations (vente, abandon, dmantlement, reprise);
gestion des risques, questions lies la sant, la scurit et lenvironnement.
Une mthode comptable visant les immobilisations corporelles peut en grande partie tre
labore partir du chapitre Comprendre les normes comptables du prsent document.
Le prsent chapitre analyse de faon plus approfondie quelques lments qui y ont t
abords.
La bibliographie propose certaines sources de documentation et lAnnexe C prsente un
exemple de mthode comptable tablie sous forme de politique interne.
2.0 Approche de lactif unique ou approche axe sur les
composantes
Pour dterminer sil convient dutiliser lapproche de lactif unique ou lapproche axe
sur les composantes, il faut comparer le cot de la compilation de linformation et la
valeur de cette information pour la direction. Il nest pas ncessaire dadopter la mme
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 44 de 114
approche pour toutes les catgories dimmobilisations. Une approche diffrente peut tre
utilise pour chacune des catgories. Pour choisir lapproche et le niveau de dtails
adopts, les responsables de llaboration de la mthode comptable se fonderont sur leur
jugement et sur lutilit de linformation.
2.1 Analyse des avantages et des inconvnients
Approche de lactif unique
Avantages Inconvnients
Faible cot et simplicit, rsultant du fait
que lon na pas besoin de tenir des
comptes dtaills et de faire des
estimations des dures de vie prvues des
composantes.
Elle ne permet aucun contrle du parc
dimmobilisations et ne donne pas
dinformation sur le cot, lemplacement ou
les attributs physiques de ces biens.
Les informations fournies aux fins des plans
de gestion des actifs et de la planification
financire sont sommaires.
Linformation sur le cot des programmes et
des services peut tre fausse. Si un rseau
d'alimentation en eau est amorti dans son
ensemble sur une dure de vie prvue de
75 ans, par exemple, les cots des
composantes ayant une dure de vie utile
infrieure 75 ans peuvent fort bien tre
sous-valus dans les cots dun exercice et
survalus dans les exercices au cours
desquels on procde des remplacements
importants. Lestimation de la dure de vie
utile prvue dune immobilisation est plus
difficile et, dans le cas des biens
dinfrastructure ayant une trs longue dure
de vie, elle est vraisemblablement arbitraire.
La nature des matriaux utiliss dans les
canalisations de distribution pourrait par
exemple faire en sorte que celles-ci soient en
service pendant bien plus de 100 ans.
Dautres facteurs, comme la capacit et
lutilisation relle dun bien, lentretien et les
rparations diffrs, les effets des temps
morts, les conditions gologiques,
lobsolescence technologique et les
fluctuations de la demande lgard du bien
ont tous une incidence sur sa dure de vie
utile. Il est plus facile dvaluer linfluence
de ces facteurs sur chacune des composantes
plutt que sur lensemble du rseau.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 45 de 114
Approche axe sur les composantes
Avantages Inconvnients
Les principales composantes des rseaux
complexes ont des dures de vie utile prvues
trs diffrentes et leur remplacement se fait
des intervalles diffrents tout au long de la
vie du rseau. La comptabilisation des
composantes permet dobtenir une meilleure
information sur ltat des immobilisations,
leur emplacement et leurs attributs
physiques.
Les renseignements ncessaires pour laborer
les plans de gestion des actifs et les plans
financiers sont facilement utilisables et
peuvent tre compils pour lensemble de
lAdministration locale.
Linformation sur le cot de la ralisation des
programmes et la prestation des services est
plus exacte, car les cots de principales
composantes sont amortis et passs en
charges sur la dure de vie de celles-ci et non
sur celle du rseau. Cela permet aussi
damliorer la prise de dcisions sur la
tarification.
Lutilisation dune approche axe sur les
composantes rend les informations sur les
cots passs en charges plus comparables et
moins susceptibles de variations importantes
puisque chaque composante est
comptabilise individuellement et amortie
sur sa dure de vie utile estimative. Tous les
remplacements sont inscrits lactif.
Lapproche axe sur les composantes accrot
lexactitude des estimations des dures de vie
utile et des cots. Elle permet de tenir compte
plus facilement de lincidence de facteurs
comme les attributs physiques, la capacit,
lutilisation relle, lentretien et les
rparations diffrs, les effets des temps
morts, les conditions gologiques,
lobsolescence technologique et les
fluctuations de la demande pour chacune des
composantes.
Pour utiliser lapproche axe sur les
composantes, il faut tenir des comptes
dtaills et faire des estimations des
dures de vie utile de chacune des
composantes. La comptabilisation des
composantes nexige toutefois pas que
chaque lment soit identifi sparment.
Les composantes ayant des dures de vie
et des profils de consommation
semblables peuvent tre groupes. Un
rseau d'alimentation en eau, par
exemple, peut tre subdivis en
installations de production deau potable,
stations de pompage, conduites
principales et canalisations de
distribution. De plus, les stations de
pompage peuvent tre subdivises en
grandes catgories : pompes,
canalisations et autres.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 46 de 114
2.2 Questions lies la mise en uvre de lapproche axe sur les
composantes
Pour comptabiliser un rseau ou un systme selon lapproche axe sur les composantes,
lAdministration locale peut avoir effectuer les tches suivantes :
laborer une base de donnes pour la gestion des immobilisations;
recenser les composantes appropries du systme ou du rseau;
vrifier lge et ltat des composantes;
valuer la dure de vie utile rsiduelle des composantes existantes;
dfinir les caractristiques des composantes (par exemple le type de revtement
ou le mode de construction pour une route);
tablir les niveaux dutilisation de certains lments du systme ou du rseau;
laborer une mthode pour faire la distinction entre lentretien et la modernisation
ou amlioration de la composante en question;
dterminer la valeur des actifs qui seront inclus dans les documents financiers;
calculer la diminution du potentiel de service (amortissement) pour lexercice;
prvoir un cycle dinspection afin de contrler lexactitude des donnes par
rapport aux donnes relles;
tablir des liens entre les donnes sous-jacentes et les plans de gestion des
immobilisations ainsi quentre linformation contenue dans ces plans et les
documents et tats financiers (cest--dire effectuer un rapprochement avec
linformation du grand livre gnral).
2.3 Segmentation des actifs
Les actifs linaires (les rseaux complexes, comme les rseaux routiers, les rseaux
dalimentation en eau et les rseaux dgout) sont habituellement dfinis en fonction de
dtails comme la longueur, lunit de mesure et les repres gographiques (par exemple,
point de dpart et darrive). Dans le cas de ces actifs, il peut tre appropri dtablir une
segmentation des actifs. Ainsi, lorsque des travaux sont effectus un point donn dun
actif linaire par exemple le remplacement dune partie dune conduite principale ou
dune chausse les cots et les travaux que cela reprsente sont attribus cette partie
de limmobilisation plutt qu limmobilisation au complet.
La segmentation des actifs peut rendre la comptabilisation et la prsentation des
immobilisations plus faciles. Elle permet de faire un suivi plus prcis des immobilisations
en fonction de lge, du type, de lutilisation et dautres attributs utiliss dans lestimation
de la dure de vie utile. Elle peut aussi permettre un suivi plus fiable des amliorations et
de lentretien. Par exemple, si un segment dune conduite deau est remplac, le cot du
remplacement peut tre inscrit lactif et amorti sur la dure de sa vie utile, et la conduite
remplace est alors sortie du bilan.
Un nombre important de systmes de gestion des infrastructures font ainsi le suivi des
biens dinfrastructure. On peut parfois utiliser les systmes existants de gestion des
infrastructures comme registres des actifs et tablir un lien entre ces systmes et les
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 47 de 114
documents comptables pour les besoins de la comptabilisation et de la prsentation
dinformations.
On peut aussi utiliser des coordonnes linaires pour identifier dautres actifs connexes.
Par exemple, lclairage des voies publiques, la signalisation routire, les trottoirs et les
bornes-fontaines peuvent tous tre rattachs aux coordonnes dun tronon de route.
Lutilisation de coordonnes linaires amliore le suivi et la gestion des immobilisations.
(Voir aussi la section 4.0, Intgration des registres des actifs dans le grand livre gnral
du chapitre 6, Registres des actifs.)
3.0 valuation des dures de vie utile
Lune des principales difficults de la comptabilisation des immobilisations corporelles
rside dans lestimation des dures de vie utile des biens.
Les sources dinformation qui suivent facilitent la dtermination de la dure de vie des
immobilisations :
discussions avec ceux qui sont responsables de lutilisation et de lentretien des
immobilisations;
les dures de vie utile dont se servent dautres entits et dautres ordres de
gouvernement pour des immobilisations similaires (les rapports annuels
renferment de linformation sur la dure de vie utile des grandes catgories
dimmobilisations);
les lignes directrices gnrales des associations professionnelles ou sectorielles
(par exemple, les associations professionnelles dingnieurs);
les donnes passes sur lacquisition et la sortie des immobilisations;
les dures de vie utile qui sont implicites dans les taux damortissement autoriss
par le fisc pour la dtermination du revenu. Bien que ces donnes soient tablies
aux fins de la dtermination du bnfice imposable tir dactivits du secteur
priv, elles peuvent constituer un point de dpart ou de comparaison utile.
Il importe dadapter ces informations gnrales la situation particulire de
lAdministration locale.
Les facteurs qui suivent doivent aussi tre pris en compte pour estimer la dure de vie
utile des immobilisations corporelles.
Il peut y avoir une diffrence importante dans la qualit et donc dans la dure de
vie utile dactifs semblables lorsque les matriaux qui les composent, leur
conception et leur excution sont diffrents. Par exemple, une route asphalte
naura pas la mme dure de vie utile quune route en bton. De mme,
lpaisseur du matriau utilis pour paver la route, ou la qualit de la sous-couche
auront une incidence sur la dure de vie utile de la route.
La dure de vie utile dune immobilisation donne peut varier considrablement
selon lutilisation prvue de cette immobilisation. Ainsi, la dure de vie dun
vhicule motoris sera diffrente selon quil est utilis pour assurer la protection
de la population ou affect au service des parcs et des loisirs.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 48 de 114
F
i
g
u
r
e
4
R
o
u
t
e
s
P
l
a
t
e
f
o
r
m
e
C
h
a
u
s
s
e
B
o
r
d
u
r
e
s
,
c
a
n
i
v
e
a
u
x
P
l
a
t
e
f
o
r
m
e
C
h
a
u
s
s
e
B
l
o
c
A
C
o
m
p
o
s
a
n
t
e
S
e
g
m
e
n
t
C
a
t
g
o
r
i
e
/
A
c
t
i
f
u
n
i
q
u
e
I
L
L
U
S
T
R
A
T
I
O
N
D
E
L
A
S
E
G
M
E
N
T
A
T
I
O
N
B
o
r
d
u
r
e
s
,
c
a
n
i
v
e
a
u
x
B
l
o
c
B
B
o
r
d
u
r
e
s
,
c
a
n
i
v
e
a
u
x
P
l
a
t
e
f
o
r
m
e
C
h
a
u
s
s
e
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 49 de 114
Les diffrences de climat dune rgion une autre peuvent aussi avoir une
incidence importante sur les dures de vie utile des immobilisations. Par exemple,
la dure de vie utile dune route soumise des tempratures extrmes sera
probablement diffrente de celle dune route semblable soumise un climat plus
tempr.
Lobsolescence prvue par la rglementation peut raccourcir la dure de vie utile
de certaines immobilisations utilises pour des activits trs rglementes (par
exemple, les services publics).
Pour dterminer la dure de vie utile estimative dune immobilisation, lAdministration
locale doit aussi tenir compte de ltat actuel de cette immobilisation et de la longueur de
la priode pendant laquelle il est prvu quelle permettra de satisfaire la demande de
services. Par exemple, les conduites deau peuvent avoir besoin dtre remplaces bien
avant la fin de leur dure de vie physique si la croissance de la population sature leur
capacit. De mme, un pont peut avoir tre remplac parce quil ne peut supporter
laugmentation de la circulation automobile.
Les dures de vie utile doivent tre rvises rgulirement pour contrler lexactitude des
estimations. Par exemple, le fait quune Administration locale utilise encore des
immobilisations qui sont dj amorties 100 % peut indiquer que les dures de vie utile
estimatives sont trop courtes. Inversement, cela peut aussi indiquer que lAdministration
locale a un arrir important de remplacements ncessaires.
4.0 Seuils de comptabilisation
4.1 Seuil dinscription lactif / de prsentation
Chaque Administration locale doit dterminer la valeur au-dessus de laquelle les biens
sont inscrits lactif et prsents dans les tats financiers. Les biens dont la valeur est
infrieure au seuil dtermin sont passs en charges dans lexercice au cours duquel a eu
lieu lacquisition, tandis que les biens dont la valeur est suprieure ce seuil sont
comptabiliss titre dimmobilisations corporelles dans le bilan. Ltablissement dun
seuil dinscription lactif rduit le cot de la collecte des donnes, car il rduit le
nombre total dimmobilisations corporelles quil faut enregistrer et suivre de faon
dtaille. Cette conomie pour lAdministration locale doit tre value par rapport
limportance des donnes pour les utilisateurs des tats financiers. La Figure 5 prsente
un arbre de dcision portant sur lapplication des seuils dinscription lactif aux
acquisitions de biens.
4.2 Slection du seuil dinscription lactif / de prsentation
Des seuils diffrents conviennent des Administrations locales diffrentes et des
organismes diffrents au sein du mme primtre comptable. Aux fins de la
consolidation, cependant, lAdministration locale consolidante tablira un seuil au-dessus
duquel les biens devront tre inscrits lactif. Bien que lutilisation dun seuil unique
facilite la production de linformation, il est possible dtablir des seuils dinscription
lactif / de prsentation diffrents aux fins de la gestion et de linformation financire.
Ces seuils peuvent aussi varier selon les catgories dactif. Ainsi, une Administration
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 50 de 114
Sa valeur est-elle
suprieure au seuil
dinscription lactif?
Comptabiliser et
prsenter comme
une
immobilisation
corporelle
Sagit-il dune classe
homogne dactifs?
Comptabiliser et
prsenter comme
une classe
homogne dactifs
LAdministration locale
souhaite-t-elle
comptabiliser
limmobilisation?
Passer en charges
et consigner les
dtails concernant
limmobilisation
Passer en charges et ne pas consigner
les dtails concernant limmobilisation
Oui
Oui
Oui
Oui
No
No
No
Figure 5
Seuil de comptabilisation
Acquisition dune
immobilisation
corporelle?
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 51 de 114
locale peut choisir de comptabiliser et de prsenter tous les terrains, que leur valeur
inscrite soit infrieure ou non au seuil dinscription lactif tabli pour dautres
catgories dactifs. Elle peut en outre choisir un seuil plus lev pour les actifs complexes
comme les rseaux que celui pour les biens meubles.
Les seuils sont souvent exprims en valeur absolue, par exemple 10 000 $. Toute
acquisition infrieure ce montant est passe en charges dans lexercice. Le choix de la
valeur montaire du seuil est influenc par la taille de lAdministration locale et le niveau
dinformation ncessaire aux fins de la gestion.
Une autre faon dtablir un seuil dinscription lactif initial (ou seuil minimum)
consiste comptabiliser dans les tats financiers un certain pourcentage (par exemple au
moins 95 %) de lactif total estim en fonction de la valeur. Cette mthode, qui exige que
lAdministration locale fasse une estimation raisonnable de lactif total, peut convenir
pour des immobilisations linaires comme les conduites principales et les routes.
4.3 Inscription lactif de biens dont la valeur est infrieure au seuil
dinscription l'actif / de prsentation
Les biens dont la valeur unitaire est infrieure au seuil dinscription lactif peuvent
avoir une valeur considrable lorsquils sont groups. De tels biens sont gnralement
comptabiliss titre de classe homogne dactifs dont la valeur est la valeur combine de
tous les biens. Voici des exemples de ce type de biens :
les rseaux informatiques;
le mobilier et les agencements;
certains types de biens meubles;
le contenu de bibliothques.
Ces lments peuvent tre enregistrs comme actif unique dans les systmes financiers,
mais lAdministration locale continue de pouvoir surveiller ou contrler leur utilisation et
leur entretien par lintermdiaire dun systme de grands livres auxiliaires des actifs.
Chacun des ordinateurs personnels peut ainsi tre enregistr comme une composante du
rseau informatique.
4.4 Comptabilisation des biens portables
Une Administration locale peut choisir de comptabiliser certains lments dont la valeur
est infrieure au seuil dinscription lactif / de comptabilisation pour des raisons de
contrle et de scurit. On appelle parfois ces lments des biens portables. Selon la
mthode de linscription lactif des immobilisations, ces biens sont passs en charges au
moment de leur acquisition. On peut toutefois consigner une description de ces biens et
de leur emplacement dans les grands livres auxiliaires des immobilisations. Ces biens
peuvent par exemple tre identifis par des codes barres et consigns dans un registre
des actifs distinct. Cette faon de procder convient aux biens comme les magntoscopes,
les scanneurs, les tlcopieurs, les tlphones cellulaires, le matriel informatique et de
communication portatif ainsi que certains outils. Des contrles rguliers de ces biens,
dans le cadre de la prise dinventaire annuelle, peuvent amliorer la gestion des biens et
rduire le risque de vol.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 52 de 114
4.5 Seuil de comptabilisation des amliorations
Un seuil montaire (ou autre) peut aussi tre appliqu aux amliorations ( noter quil
nest pas ncessaire que ce seuil soit le mme que celui utilis pour linscription initiale
lactif de limmobilisation considre). Par exemple, il se peut quune Administration
locale dcide de comptabiliser toutes les modifications ou amliorations qui accroissent
la capacit ou lefficience de plus de 10 %.
Tous les biens remplacs dans le cadre dune amlioration doivent tre sortis du registre
des actifs et des autres documents pertinents. La valeur comptable rsiduelle de ces biens,
sil en est, est alors limine du bilan (voir aussi la rubrique 7.0, Sorties du patrimoine
du chapitre 2, Comprendre les normes comptables).
Il se peut que, dans le cadre de llaboration des mthodes comptables visant les
immobilisations, lAdministration locale ait rdiger des lignes directrices (et fournir
de la formation) aux gestionnaires responsables des immobilisations. Elle pourrait aussi
avoir prsenter des exemples doprations qui sont habituellement inscrites lactif ou
passes en charges.
La Figure 6 prsente un arbre de dcision portant sur linscription lactif des dpenses
effectues aprs lacquisition dun bien et sur lapplication de seuils dinscription
lactif.
4.6 Comptabilisation des remplacements selon lapproche axe sur
les composantes
Lorsque les critres de comptabilisation du chapitre SP 3150 sont remplis, le
remplacement ou le renouvellement dune composante est comptabilis comme
lacquisition dune immobilisation distincte et le bien remplac est sorti du patrimoine.
La comptabilisation des composantes est influence par les facteurs suivants :
le seuil de comptabilisation;
le fait que la composante a ou non une fonction distincte;
le fait que la dure de vie utile de la composante diffre ou non de celle des autres
composantes.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 53 de 114
Des dpenses importantes
ont t consacres lactif
aprs son acquisition?
Inscription lactif des
amliorations
Figure 6
Lactif a-t-il t
remplac?
Les dpenses rpondent-
elles la dfinition
dune amlioration?
Passation en charges
Inscription lactif. Sortie de
lancien actif du patrimoine.
Comptabilisation dun gain
ou dune perte la sortie du
bien.
Passation en charges
Inscription lactif
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 54 de 114
Chapitre 5 Pratiques de gestion des immobilisations
1.0 Plans de gestion stratgique des immobilisations
La comptabilisation et la prsentation des immobilisations constituent un point de dpart
utile, mais elles ne suffisent pas pour :
comprendre ltat des immobilisations corporelles;
valuer la performance des immobilisations corporelles;
prvoir les remplacements effectuer court et long terme;
valuer le cot et la viabilit des programmes existants.
La gestion des immobilisations corporelles et lvaluation de leur tat sinscrivent dans
une dmarche continue et long terme. Les politiques dentretien et de remplacement des
immobilisations doivent se concentrer sur les besoins long terme de lensemble du
rseau.
Les Administrations locales doivent laborer des plans stratgiques long terme en vue
non seulement de rsoudre le problme actuel de lentretien et des renouvellements
diffrs, mais aussi de prvoir les besoins courants dentretien et de remplacement des
biens qui composent le parc dimmobilisations corporelles existant et den planifier
lexpansion future.
2.0 Responsabilit de la gestion des immobilisations
La rponse la question qui incombe la responsabilit de ltat, de lutilisation et du
fonctionnement des immobilisations? est un facteur dterminant dans llaboration des
politiques et des procdures de gestion des immobilisations. Ainsi, lorsque la gestion de
certaines catgories dimmobilisations est centralise, les gestionnaires des diffrents
services nont pas besoin de beaucoup dinformation sur ces immobilisations. En
revanche, si la gestion des immobilisations est dcentralise, la responsabilit des
immobilisations est dlgue aux gestionnaires des services. Chacun des responsables de
la gestion des immobilisations doit alors savoir ce quenglobe exactement cette
responsabilit et qui a le pouvoir de modifier les documents comptables.
3.0 Politiques et procdures dexploitation des immobilisations
Dans lidal, les politiques et procdures mises en uvre par lAdministration locale
devraient couvrir tous les aspects de la gestion des immobilisations, notamment :
les procdures comptables gnrales (voir ci-dessous pour des exemples);
la planification (par exemple, llaboration de politiques sur la fourniture
dinstallations oprationnelles et autres commodits lintention du personnel
comme des caftrias et des gymnases);
les acquisitions;
lexploitation (voir ci-dessous pour des exemples);
les sorties du patrimoine.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 55 de 114
Les procdures comptables gnrales en ce qui concerne les immobilisations corporelles
consistent notamment faire ce qui suit :
inscrire les biens dans le registre des actifs en traant une piste de vrification
approprie (par exemple, en collant une tiquette contenant un code barres sur
chaque bien et en leur attribuant des numros de rfrence uniques);
procder rgulirement un rapprochement des soldes du registre des actifs et du
grand livre gnral;
prvoir une vrification par la direction de lexistence des immobilisations, de
leur utilisation continue, de leur dure de vie rsiduelle et de leur obsolescence;
procder des tests de dprciation annuels;
procder rgulirement des rvisions des dures de vie utile;
appliquer des procdures dacquisition appropries pour veiller ce que toutes les
nouvelles immobilisations soient identifies et enregistres;
appliquer des procdures appropries de vente ou de radiation afin de veiller ce
que toutes les sorties dimmobilisations soient traites et enregistres.
Les procdures dexploitation suivantes peuvent sappliquer aux immobilisations :
tablir des indicateurs de performance (par exemple des seuils de sous-utilisation
de lespace);
laborer des programmes dexploitation et dentretien (en tablissant des priorits
pour lentretien qui font ressortir les travaux essentiels et urgents);
appliquer des procdures de contrle de ltat et de lutilisation des
immobilisations;
laborer des programmes dentretien;
reprer les immobilisations qui ne se trouvent pas sur place (transferts, prts et
rparations effectues hors site);
prserver et protger les immobilisations.
Il nest pas ncessaire que toutes ces politiques et procdures soient en place au dbut de
la priode de transition vers la comptabilisation des immobilisations corporelles.
Certaines dentre elles vont voluer mesure que les gestionnaires se familiariseront avec
lincidence des immobilisations sur linformation financire et avec les questions
concernant la gestion des immobilisations. Ces politiques et procdures ont toutefois une
incidence sur le type de systme de gestion des immobilisations ncessaire et, en
particulier, sur la structure et sur le contenu du registre des actifs (voir le chapitre
suivant). Il est donc utile de les mettre ltude (mme si elles ne sont pas labores) au
dbut de la priode de transition.
Le type de politiques dexploitation ncessaires dpend aussi de ltendue de la
responsabilit de lAdministration locale lgard de la gestion des immobilisations.
Lorsque les fonctions approvisionnement, entretien et cession sont gres de faon
centralise, les services ont pour responsabilit dappliquer les procdures tablies par les
entits centrales plutt que dlaborer leurs propres procdures.
Des plans de gestion des immobilisations ou dautres systmes dinformation appropris
sont ncessaires pour estimer de faon fiable lamoindrissement du potentiel de service
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 56 de 114
(amortissement) et pour assurer la fiabilit de la valeur comptable de ces immobilisations
prsente dans les documents financiers.
En labsence dun plan de gestion des immobilisations, les problmes suivants peuvent se
produire :
mauvaise utilisation des actifs;
gestion dficiente des actifs excdentaires;
cart significatif des frais de fonctionnement dun emplacement un autre;
information de gestion inadquate;
dtrioration de ltat physique du parc dimmobilisations; et/ou
poursuite de lentretien dimmobilisations non rentables.
4.0 valuation de ltat des immobilisations
Le rapport de recherche de lICCA intitul Comptabilisation des infrastructures dans le
secteur public, prcit, indiquait ce qui suit : Ltat et la performance des
infrastructures
7
peuvent tre directement influencs par des facteurs aussi diffrents que
les politiques du gouvernement en matire dentretien et de remplacement, les
mouvements de population, lutilisation passe et actuelle du bien, les conditions
hydrogologiques, le climat, les cycles politiques, et la rglementation en gnral. Ces
facteurs font bien ressortir la ncessit de procder rgulirement des valuations de
ltat des infrastructures, valuation qui permet aux Administrations locales de
dterminer la capacit des immobilisations corporelles dinfrastructure de continuer
fonctionner et de fournir des services dans lavenir. Quelle que soit la mthode utilise
pour la comptabilisation des infrastructures, lvaluation de ltat des immobilisations
reste importante dans le processus global de gestion des infrastructures.
Pour valuer ltat des infrastructures (immobilisations), il faut suivre les tapes
suivantes :
identifier et inventorier toutes les infrastructures en cause;
runir des renseignements sur lge des biens, leur emplacement et les matriaux
dont ils sont faits;
dterminer ltat des biens au moment de leur entre dans le patrimoine;
tablir une norme concernant ltat dans lequel les biens doivent tre maintenus;
dterminer les profils de renouvellement et de remplacement futurs, en se fondant
sur les cots pour le cycle de vie;
mettre au point des systmes pour la collecte de renseignements;
intgrer les renseignements runis avec ceux compils par les autres systmes
dinformation.
7
Les travaux du Groupe dtude nont port que sur les immobilisations corporelles dinfrastructure, mais
un bon nombre de notions sur la gestion des immobilisations sappliquent galement toutes les
catgories dimmobilisations corporelles.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 57 de 114
Lvaluation de ltat des infrastructures est gnralement une fonction technique, mais
lAdministration locale peut galement mettre au point des indicateurs de performance et
des critres dtalonnage de base qui laideront juger de ltat de ses infrastructures.
Ainsi :
on pourrait utiliser des donnes historiques sur les bris des conduites dgout pour
prvoir quel moment des remplacements pourraient tre requis;
on pourrait comparer la quantit deau traite et la quantit deau utilise pour en
dgager un indicateur utile de ltat du rseau, tout comme on pourrait cette fin :
o parcourir routes et ponts en faisant des inspections visuelles et en comptant les
nids-de-poule et les dnivellations dans la chausse;
o revoir les cots pour le cycle de vie et les comparer avec les montants
rellement dpenss pour lentretien et le remplacement des infrastructures.
Les valuations de ltat des infrastructures sont utiles non seulement du point de vue
comptable, mais aussi du point de vue des services fournis, du financement et de
lapprciation des risques. Si lAdministration locale ne connat pas bien ltat du parc
dinfrastructures existant, des problmes majeurs peuvent survenir : effondrement dun
pont, enfoncement de la chausse en raison dun bris de conduite dgout, inondation de
proprits agricoles ou commerciales, ou encore panne de courant par suite de la
dfaillance dun centre de contrle de llectricit.
Au dpart, pour acqurir la connaissance dont elle a besoin, lAdministration locale
pourrait mettre au point, pour chaque type ou catgorie dinfrastructure, une chelle
dvaluation du genre de celle effectue dans les tableaux suivants :
tat des canalisations deau
Cote Description
Excellent Pas de dfaillances. Conforme aux normes techniques.
Bon Peu de dfaillances. Peu de secteurs ne sont pas conformes aux
normes techniques.
Passable Des dfaillances commencent se produire. Des secteurs non
ngligeables ne sont pas conformes aux normes techniques.
Mauvais Dfaillances frquentes et corrosion importante qui accroissent
les cots dexploitation. De nombreuses canalisations doivent tre
remplaces.
Dficient Dfaillances importantes, travaux majeurs de reconstruction
ncessaires.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 58 de 114
tat des routes
Cote Description
Excellent Pas de nids-de-poule. Pas de fissures rparer. Conforme aux
normes techniques.
Bon Quelques nids-de-poule. Quelques petites fissures rparer.
Conforme aux normes techniques.
Passable Preuves de dtrioration. Nombreux nids-de-poule et frquentes
fissures rparer.
Mauvais Dtrioration de la chausse. Multiples nids-de-poule et fissures.
J oints fissurs. Couche de surface refaire.
Dficient Plateformes et surfaces remplacer.
Lchelle dvaluation pourrait tre applique pour divers aspects des infrastructures, par
exemple la taille des canalisations, le type de routes ou lemplacement gographique
dinstallations (segments, par exemple). Les valuations pourraient tre incluses dans
linformation relative lentretien diffr. Le tableau qui suit est prsent titre
dexemple.
valuation de ltat des routes
Catgorie Mthode tat gnral Entretien diffr Seuil critique
Autoroutes
100 km
Vrification de
ltat
Bon
0 $ 0 $
Route de
dgagement
400 km
Vrification de
ltat
Passable
1 000 000 $ 250 000 $
Routes
collectrices
50 km
Vrification de
ltat
Excellent
0 $ 0 $
Routes locales
4 voies
revtues
300 km
Vrification de
ltat
Mauvais
5 000 000 $ 3 000 000 $
Routes locales
2 voies
revtues
800 km
Inspection
visuelle
Mauvais
5 000 000 $ 3 000 000 $
Routes locales
non revtues
100 km
Inspection
visuelle
Mauvais
1 000 000 $ 500 000 $
Les rsultats dvaluation peuvent tre compars dune priode lautre et tre complts
par des informations sur les cots futurs dentretien et de remplacement. Des vrifications
de ltat des biens devraient tre faites rgulirement, de faon cyclique, afin de sassurer
que tous les trois ans, par exemple, une vrification de ltat de la catgorie ou du type de
bien est faite.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 59 de 114
Le Groupe dtude charg de ce rapport de recherche a conclu que des informations sur
ltat des infrastructures offriraient les avantages suivants :
Linformation financire ne peut elle seule fournir aux utilisateurs les lments
ncessaires pour leur permettre de bien comprendre ltat du parc
dinfrastructures qui relve de lAdministration locale. Les informations
contenues dans les tats financiers doivent tre compltes par des informations
non financires, qui pourraient indiquer les catgories et les types de biens, les
mthodes utilises pour valuer ltat de ceux-ci, une valuation globale de
chaque catgorie de biens, les sommes requises pour remettre le bien dans un tat
acceptable et les sommes requises pour une future reconstruction.
Ces informations sont utiles pour linterprtation de linformation en matire de
performance et dtalonnage.
Les informations sur ltat des infrastructures, donnes en complment de
linformation financire, fournissent aux personnes qui ne participent pas
directement aux activits de lAdministration locale une source dinformations
qui, autrement, ne seraient pas ncessairement rendues publiques.
Le Groupe dtude a conclu que des informations sur lentretien diffr devraient tre
fournies dans le cadre des informations sur ltat des infrastructures. Il a aussi fait tat des
avantages suivants :
Lentretien diffr est un enjeu important pour de nombreuses Administrations
locales au Canada. Linformation au sujet des consquences de lentretien diffr
et de son lien avec ltat actuel des infrastructures est essentielle la gestion du
dficit au titre des infrastructures. Le Groupe dtude reconnat que lentretien
diffr nest quun des aspects permettant de comprendre les dficits au titre des
infrastructures et ltat des infrastructures.
Lentretien diffr devrait tre comptabilis comme une charge lorsquil entrane
une perte de valeur ou ncessite une rvision de la dure de vie utile du bien.
J usqu ce moment, il est utile de fournir des informations au sujet de lentretien
diffr pour faire ressortir les besoins dentretien courant et de remplacement des
infrastructures.
Les informations sur l'entretien diffr sont utiles la comprhension et
l'apprciation des besoins futurs de revenus relatifs aux infrastructures de
lAdministration locale.
5.0 tablissement dun cadre de planification et
dinvestissement
Dans le rapport de rechercheComptabilisation des infrastructures dans le secteur public,
il est indiqu quil faut un cadre clair et cohrent pour la planification des infrastructures
et la gestion des investissements quelles commandent, la dtermination des besoins que
gnre leur exploitation courante, et lvaluation de leur tat au fil du temps.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 60 de 114
Ce cadre doit comprendre les lments suivants :
une stratgie gouvernementale qui dfinit lobjectif global en matire
dinfrastructures;
lorganigramme de lAdministration;
un inventaire exhaustif des infrastructures;
un relev des besoins et des cots lis au cycle de vie;
des stratgies de prvention;
divers modles dvaluation de ltat des infrastructures, pour tenir compte des
divers types dinfrastructures;
des outils dvaluation conomique appropris.
Llment central dans llaboration de ces plans est linventaire des infrastructures.
Dans lensemble, les plans de gestion des infrastructures refltent :
les plans stratgiques dfinissant les orientations prendre, qui tiennent compte
de facteurs tels que les valuations des besoins et les attentes en matire de
croissance;
les plans tactiques, qui tiennent compte du dploiement actuel des ressources;
les besoins de financement long terme, dont lapprciation des besoins en
ressources supplmentaires;
la planification de lexploitation, qui comprend la dtermination des cots pour le
cycle de vie ainsi que des estimations de la dure de vie utile, des travaux
dentretien requis et du calendrier des rparations et des remplacements
importants;
les valuations de ltat des infrastructures aux fins de lapprciation de la
performance, des besoins de financement et du risque conomique associ la
dtrioration de ltat des infrastructures.
Toutes ces fonctions doivent tre intgres dans un systme utile pour la prise de
dcisions, qui fournit aux dcideurs les informations dont ils ont besoin pour planifier,
coordonner et valuer le parc dinfrastructures et son utilisation. Un systme intgr de
gestion des infrastructures est essentiel aux fonctions suivantes :
la gestion des infrastructures dans des rgions forte densit et forte croissance
et des rgions caractrises par une rduction de lassiette fiscale ou une volution
des exigences;
lvaluation du risque associ aux infrastructures et de leur viabilit;
la prise en compte des besoins lis laccumulation de dficits au titre des
infrastructures;
ltablissement des budgets de fonctionnement et dinvestissement;
le contrle des cots dutilisation des infrastructures;
la planification financire;
lvaluation de la performance;
lvaluation de latteinte des objectifs;
ladoption dune approche interdisciplinaire pour la gestion dun tel systme.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 61 de 114
La gestion efficace des infrastructures est lun des lments cls de la rduction des
divers risques, tels que le risque financier, le risque environnemental et le risque li
ltat des infrastructures, qui sont particulirement pertinents dans le cas des rseaux
dinfrastructures de trs longue dure. Les infrastructures commandent une gestion dans
une perspective de viabilit et une bonne connaissance des cots dentretien, des cots de
renouvellement et des cots dexploitation marginaux.
La mise en uvre de plans de gestion des infrastructures est fondamentale pour :
la prservation des infrastructures publiques importantes;
la protection des intrts des contribuables;
ltablissement de plans financiers et de plans de gestion des risques connexes.
Les plans de gestion des infrastructures offrent les avantages suivants :
meilleure comprhension des caractristiques et des comportements des
infrastructures;
plus grande confiance dans les hypothses utilises et les informations sous-
jacentes;
meilleure comprhension du niveau de service souhait par le public;
focalisation sur les risques associs la gestion des infrastructures par
lidentification des lments essentiels des rseaux.
6.0 Lignes directrices concernant les plans de gestion des
infrastructures
Un plan de gestion des infrastructures (PGI) doit tre mis au point, et communiqu, pour
chaque grand rseau dinfrastructures. Lorsquun rseau comprend divers sous-rseaux
importants, par exemple, diffrentes zones desservies dans le cas dun rseau de
traitement et de distribution de leau, il peut tre opportun de navoir quun PGI pour le
rseau dans son entier. Si, toutefois, les niveaux de service diffrent considrablement
dune zone lautre, chaque zone desservie doit tre clairement dfinie, le niveau de
service prcis, et les informations comptables ventiles par sous-rseaux importants. Un
inventaire du rseau et de ses composantes doit tre fait rgulirement. Toutes les
hypothses concernant ltat du rseau, sa performance et les prvisions relatives la
demande ou la croissance doivent tre prises en compte dans le plan.
Le PGI doit dfinir les niveaux de service et la performance exigs du rseau du point de
vue de la qualit, de la quantit, de la fiabilit, de la souplesse, de limpact
environnemental, des conditions gologiques, de la dure de vie utile prvue et des cots.
Il doit fournir une description adquate des attributs physiques sur le plan de
lemplacement, des matriaux utiliss et de lanne de construction. Il doit fournir des
informations financires dont le cot historique et le cot de remplacement du rseau, des
estimations de la dure de vie rsiduelle, et le cot de remplacement amorti. Il doit
contenir des informations financires prvisionnelles dcrivant les travaux dentretien et
les remplacements requis, et tablissant clairement un lien avec la stratgie financire
globale long terme de lAdministration locale.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 62 de 114
Le plan doit comporter des informations suffisantes pour permettre de reprer les
rductions de la capacit de service, laide dune description de la capacit de
rendement du rseau dtermine par la quantit et la qualit des services et la dure de vie
utile estimative des biens. Le PGI doit dfinir et dcrire les rsultats attendus des travaux
dentretien, des renouvellements et des travaux de remise en tat requis, avec une
estimation des consquences dcoulant du fait de ne pas procder ces activits de faon
rgulire.
Le PGI doit galement comporter un aperu des amliorations ncessaires apporter aux
rseaux sous-performants du point de vue des zones desservies, des emplacements et de
ltat des biens, prvoir les dlais concernant lachvement des travaux de rparation, et
fournir des estimations des ressources humaines et financires requises pour lexcution
des travaux. Le PGI doit tre revu priodiquement, en raison des changements
significatifs qui surviennent dans la collectivit. La croissance, lvolution de la demande
des diffrents types de services et les catastrophes telles les inondations, sont autant
dlments qui obligent une Administration locale revoir priodiquement son PGI.
Le Groupe dtude a conclu que les Administrations locales devraient fournir des
informations au sujet de leur plan de gestion des infrastructures, faisant valoir les raisons
suivantes :
tant donn limportance des infrastructures, tant du point de vue de
linvestissement initial que des cots associs leur exploitation et leur
entretien, lAdministration locale devrait fournir des informations au sujet de ses
plans de gestion des infrastructures. Ces informations devraient faire tat des
stratgies de base adoptes, des types et catgories dinfrastructures, des
indicateurs utiliss pour valuer la performance, et des hypothses relatives la
croissance, le cas chant.
Ces informations supplmentaires donnent des indications sur la faon dont
lAdministration locale sattaque aux problmes que suscite la gestion des
infrastructures. Elles aident comprendre lincidence des infrastructures sur la
situation financire et les rsultats de lAdministration locale.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 63 de 114
Chapitre 6 Registres des actifs
1.0 Description et objet
Le registre des actifs est une liste exhaustive et prcise des biens que possde une
Administration locale. Il doit tre mis jour et valid rgulirement. On y consigne les
soldes douverture et de clture des catgories dimmobilisations corporelles et on
lutilise pour tayer les chiffres inscrits aux tats financiers. La compilation dun registre
des actifs est lune des tapes les plus importantes du processus de mise en uvre de la
mthode de la comptabilit dexercice intgrale. Le registre des actifs est aussi un
lment essentiel du systme dinformation sur la gestion des immobilisations et il
contient habituellement un plus grand nombre de renseignements quil nest ncessaire
pour tablir linformation financire.
La taille et la complexit dun registre des actifs est fonction des lments suivants :
le nombre et le type de biens que possde lorganisation;
le volume des achats, des transferts et des sorties.
Dans sa forme la plus simple, le registre des actifs peut tre un document manuscrit ou
une feuille de calcul. Il peut cependant aussi se prsenter sous forme de systme
informatis reli directement au grand livre gnral (la plupart des systmes comptables
informatiss ont cette fonction). Il se peut aussi que le registre des actifs ne soit pas un
systme informatis ou un document unique. Il peut en effet aussi tre un ensemble de
sous-systmes relis entre eux et dont le rpertoire est commun. Le modle de registre
des actifs adopt est, en grande partie, dtermin par le contenu des systmes de gestion
dactifs et des bases de donnes en place. La figure qui suit illustre la faon dont divers
systmes peuvent tre relis pour former un registre des actifs.
Systme dentretien des
vhicules et des
installations
Registre du matriel
Registre aux fins des
assurances
Donnes sur les travaux
techniques et dentretien
Bases de donnes de la
gestion des installations et
de lenregistrement foncier
Registre des
actifs
Systme
dinformation
financire
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 64 de 114
2.0 Conception et laboration
Les questions les plus importantes qui se posent lors de la conception et de llaboration
dun registre des actifs sont les suivantes :
Quelles informations doit-il contenir?
Devrait-il tre intgr dans le grand livre gnral ou dans dautres systmes?
Un registre des actifs pertinent doit contenir les renseignements suivants (le cas chant)
pour chacun des biens :
nom du bien;
description matrielle;
numro de srie;
date dacquisition (achat, cration, don, abandon);
emplacement;
personne/poste responsable de la garde et de lentretien du bien;
date laquelle le bien doit tre remplac;
dure de vie utile prvue :
o dure initiale,
o dure coule,
o dure rsiduelle,
o date de la dernire rvision de la dure de vie utile du bien,
o indices de moins-value;
cot historique ou valuation initiale si le cot historique nest pas connu;
mthode et taux damortissement, montant amorti;
valeur comptable;
date de sortie.
Un registre des actifs pourrait aussi contenir (ou tre li) dautres renseignements
pertinents comme des dtails sur les assurances et lentretien prvu. Un bon registre des
actifs possde les caractristiques suivantes :
les informations sur les biens sont mises jour au fur et mesure que les
oprations et les vnements se produisent;
les informations sont rgulirement rapproches des donnes sur lacquisition, des
systmes auxiliaires, sil en est, et du grand livre gnral;
les informations sont faciles utiliser pour les gestionnaires des actifs, au niveau
de dtail ncessaire et de prfrence en ligne;
les informations sont organises de faon permettre la distinction entre les
diffrentes catgories dactifs.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 65 de 114
3.0 Sources dinformation
Les sources possibles dinformation pour les registres des actifs sont les suivantes :
les listes et les systmes dactifs existants (des dtails sur les vhicules et le
matriel informatique sont souvent disponibles);
les listes aux fins des assurances;
les listes des biens fonciers dans les cas o les Administrations locales payent des
impts fonciers, llectricit, leau ou dautres services publics;
des renseignements sur les terrains et les btiments appartenant aux entits des
Administrations locales responsables du nettoyage ou de lentretien.
Ces sources de renseignements peuvent souvent constituer le point de dpart de la
compilation dun registre des actifs. Elles peuvent tre utilises comme donnes
principales ou pour vrifier la concordance des renseignements sur les biens consigns
dans les diffrents systmes. Il est toutefois essentiel que lexactitude et lexhaustivit de
ces documents soient vrifies. Ces documents ne font gnralement pas partie intgrante
du systme comptable, et il se peut quils aient t mis jour de faon priodique plutt
qu mesure de la ralisation des oprations.
Pour compiler la liste initiale des biens, il est souvent utile de vrifier si les informations
consignes dans divers systmes et celles contenues dans les tats financiers concordent.
Dans les cas o linformation consigne dans un registre des immobilisations corporelles
est tire de plusieurs systmes diffrents, il est essentiel que les documents sous-jacents
soient fiables pour tous les lments. Pour pouvoir sappuyer sur les informations des
systmes dj en place, les dtails des entres et des sorties dactifs doivent avoir t
enregistrs adquatement au cours des exercices antrieurs. Les erreurs repres dans les
systmes doivent tre corriges. Si lexactitude et lexhaustivit des systmes dj en
place sont douteuses, une prise dinventaire physique complte ou partielle est requise.
noter toutefois que si son excution est mdiocre, linformation fournie ne sera pas fiable.
Il importe de bien sacquitter de cette tche la premire fois, car dans le cas contraire, il
faudra la reprendre au complet pour obtenir de linformation fiable et une opinion de
vrification sans rserve.
Une fois la comptabilit dexercice intgrale adopte, il sera ncessaire de procder
rgulirement des prises dinventaire. La couverture cyclique des actifs peut varier
selon le type dactifs, leurs profils de risque et le degr de scurit leur gard.
Les droits de proprit sur les actifs, en particulier les terrains, doivent tre vrifis et
toute question ventuelle rgle. Les lments suivants demandent une attention
particulire :
les terrains rquisitionns des fins particulires, mais qui nont jamais t rendus
leurs propritaires dorigine;
les actifs abandonns (qui peuvent ou non appartenir lAdministration locale);
les actifs ayant fait lobjet dun don et les actifs dtenus en fiducie (qui peuvent
comprendre les actifs qui appartiennent lAdministration locale mais qui doivent
tre affects des fins en particulier).
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 66 de 114
Lorsque les donnes ne semblent pas exactes (par exemple, quantit, emplacement, ge)
ou que les questions lies la proprit ne peuvent tre rsolues immdiatement, il
convient de faire ce qui suit :
consigner les donnes dans le registre des actifs (avec linformation sur les
questions rsoudre) en marquant clairement les questions;
prendre note des anomalies et les porter la connaissance de membres du
personnel plus spcialiss (conseillers juridiques, par exemple) qui soccuperont
de leur rglement.
Quand une Administration locale commence recueillir de linformation pour son
registre des actifs, cette information est en principe recueillie sous une forme compatible
aux logiciels et aux systmes devant tre utiliss pour comptabiliser les immobilisations
corporelles. Ces logiciels peuvent cependant ne pas tre encore installs. Il est nanmoins
possible de compiler les donnes de base ncessaires pour le registre des actifs. Dans
certains cas, il faudra peut-tre aussi transfrer les informations du registre des actifs dans
un autre format logiciel. Les avantages quil y a prendre de lavance en ce qui touche au
registre des actifs doivent tre compars au cot et au temps requis pour transfrer les
informations dans un systme diffrent.
Un registre des actifs peut tre compil en plusieurs tapes, la premire consistant
compiler la liste de toutes les immobilisations des entits comprises dans le primtre
comptable de lAdministration locale. Cette information peut tre recueillie avant la
finalisation des mthodes comptables, les questions lies lvaluation et la mesure
pouvant tre rgles dans une deuxime tape. En outre, dans le cas o des informations
sur des catgories donnes dactifs sont difficiles obtenir, ou lorsque la dtermination
du contrle lgard des actifs est un problme, les informations sur ces actifs peuvent
tre recueillies sparment. De mme, lidentification et lvaluation des biens peuvent
tre faites par catgorie.
4.0 Intgration des registres des actifs dans le grand livre
gnral
Les registres des actifs peuvent tre des systmes distincts, mais ils peuvent aussi tre
intgrs dans le grand livre gnral et les autres systmes. Lorsquils sont distincts, les
informations provenant du registre des actifs doivent tre transfres rgulirement (par
intervention humaine ou informatise) au grand livre gnral pour ltablissement des
tats financiers. Lorsque le registre des actifs est intgr dans le grand livre gnral,
linformation sur les soldes douverture et de fermeture est automatiquement reporte au
grand livre gnral, ce qui cre aussi des critures de journal automatiques pour
lamortissement.
Lintgration du registre des actifs dans dautres systmes prsente des avantages
notables. Par exemple, lintgration du registre des actifs dans les systmes dacquisition,
de planification des immobilisations, de lentretien prventif, des comptes crditeurs
(pour saisir les acquisitions) et du grand livre gnral permet notamment :
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 67 de 114
de rduire au minimum lintervention humaine;
de rduire les risques daltration des donnes ou derreurs;
de rduire le nombre de rapprochements requis;
dviter lentre et le traitement de donnes en double;
de gnrer automatiquement les critures damortissement et de rvaluation des
actifs.
Un registre des actifs peut aussi tre intgr dans le systme dinformation li la gestion
des ressources humaines, ce qui permet de faire un suivi des biens portables et attrayants
qui sont en possession des employs.
Au cours des tapes initiales de la mise en uvre, lAdministration locale peut tre
limite par la nature des systmes existants et par le temps et le cot de la rvision de la
conception ou du remplacement de ces systmes. Il se peut que des interfaces humaines
ou informatiques entre les systmes existants et le grand livre gnral soient ncessaires.
Ces interfaces sont une source potentielle derreurs, et il arrive parfois que les donnes
sur les actifs ne soient pas transfres en totalit. Une conception soigne, de la formation
et des essais sont ncessaires pour viter de tels problmes dinterface.
5.0 Validation des registres des actifs
La validation des registres des actifs comprend une vrification visant montrer que
linformation consigne dans les registres est complte et exacte une date donne. La
compilation dun registre peut prendre de un deux ans, priode pendant laquelle il y
aura entre, amlioration et sortie dactifs. Il est donc ncessaire de valider les chiffres
utiliser pour les soldes douverture. Des listes dentres, damliorations et de sorties
dimmobilisations devraient tre produites et leur vraisemblance devrait tre value de
faon centralise. Il convient aussi de les valider systmatiquement.
Dans la plupart des cas, certains mouvements dactifs (entres, amliorations et sorties)
se produisent entre le moment de lvaluation initiale et la saisie dinformation dans le
registre des actifs ou la date dtablissement des tats financiers.
Voici certaines des mthodes utilises pour valider les donnes des soldes douverture :
terrains et immeubles : documenter la source dinformation et les procdures
suivies pour tablir le caractre exhaustif des donnes;
autres immobilisations corporelles : communiquer linformation consigne dans le
registre des actifs aux employs responsables de la garde des actifs et leur
demander de confirmer lexactitude et lexhaustivit des donnes.
De bonnes procdures de validation comprennent ce qui suit :
attribuer la responsabilit de la validation de linformation concernant chaque
catgorie dactifs une personne ou un poste;
veiller ce que les vrifications de lexistence physique des biens soient
effectues par des employs sans liens avec les responsables de la garde de ces
biens;
exiger une confirmation crite des modifications, sil en est;
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 68 de 114
exiger des dclarations crites confirmant lexactitude des informations
consignes dans le registre des actifs (et tenant compte de toutes les
modifications);
conserver les enregistrements des ajustements apports aux registres des actifs
la rception des modifications proposes;
conserver les enregistrements sur les parties du registre qui ont t valides et les
dates auxquelles les donnes ont t valides.
Sil nest pas possible de procder toutes les vrifications la date de clture, il serait
prudent de demander au vrificateur externe de confirmer si un programme progressif de
vrification est acceptable.
Il se peut que lAdministration locale ninclue pas ds le dbut certaines catgories de
biens, peu importantes, dans le registre des actifs. Par la suite, ces actifs devront toutefois
tre identifis (par composante), valus, saisis dans le registre des actifs et inscrits aux
tats financiers. La constatation ultrieure de ces actifs se traduit gnralement par une
augmentation tant des actifs que des actifs nets ou des capitaux propres.
6.0 Rsum
Les points suivants pourraient tre utiles pour laborer un registre des actifs :
en prvision du passage la mthode de la comptabilit dexercice intgrale,
commencer immdiatement recueillir des informations de base sur les actifs,
mme si ces informations sont simplement consignes sur une feuille de calcul;
sassurer que les instructions concernant linventaire physique sont claires et
minutieusement expliques ceux qui prennent linventaire;
ne pas voir trop grand au dbut il vaut mieux crer un registre des actifs simple
mais pratique qui contient les donnes minimums requises pour tous les actifs,
plutt que dessayer de btir un registre plus complexe qui ne sera jamais termin;
attribuer des rles et des responsabilits prcises en ce qui concerne la tenue des
registres des actifs;
tablir des procdures prcises de mise jour des registres des actifs;
communiquer avec les utilisateurs pour vrifier que les registres sont utilisables et
quils sont utiliss;
fournir une formation aux utilisateurs des systmes de comptabilisation ou de
gestion des actifs et des registres dactifs une adoption lente des utilisateurs
appelle des mesures de suivi;
prvoir des dlais suffisants pour la recherche des documents de proprit, y
compris le rapprochement des documents historiques de proprit et des
documents plus rcents cette tche peut demander beaucoup de temps;
laborer un processus visant traiter les biens dont la proprit est conteste ou ne
peut tre tablie avant la date du bilan;
laborer des systmes pour faire un suivi des actifs (comme les composantes
principales ou les pices de rechange) qui appartiennent lAdministration locale,
mais qui sont dtenus par les entrepreneurs des fins de rparation, de remise en
tat ou de modification;
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 69 de 114
vrifier si les biens destins tre sortis ont t valus conformment la
mthode comptable relative lvaluation des biens destins tre sortis;
sassurer que la valeur de linformation justifie le cot de son obtention.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 70 de 114
Chapitre 7 Comptabilisation initiale des
immobilisations corporelles
1.0 tablissement des soldes douverture sans donnes sur le
cot historique
Quand une Administration locale na pas de donnes comptables sur le cot historique de
ses immobilisations corporelles, elle doit utiliser dautres mthodes pour estimer le cot
et lamortissement cumul de celles-ci. Elle peut alors parfois extraire linformation
ncessaire pour comptabiliser les immobilisations corporelles des dossiers des services
municipaux qui grent ces biens.
Elle peut aussi fonder lvaluation initiale sur les lments suivants :
le cot de reconstitution, qui est fond sur les attributs des immobilisations que
lAdministration locale possde actuellement. Il sagit du cot de production dun
bien pratiquement identique celui qui est possd. Il ne permet pas de tenir
compte des effets sur les cots de lvolution de la technologie ou des mthodes
de construction.
le cot de remplacement, ajust afin de tenir compte des carts importants entre
le bien remplac et le bien de remplacement. Il sagit du montant de la
contrepartie en trsorerie ou autre quil faut donner pour acqurir un bien ayant un
potentiel de service quivalent au bien remplac. Il tient compte de lvolution de
la technologie. Il est fond sur le cot actuel estimatif de la construction du bien
remplac ou de la composante du bien remplace selon la mme mthode ou une
mthode similaire de construction au moyen de matriaux identiques ou
similaires. Le cot de remplacement peut tre tabli par rapport au prix dun bien
similaire sur un march actif et liquide.
la valeur de march, lorsquil y a un march libre pour le bien. Elle peut tre
disponible pour un grand nombre dimmobilisations comme les btiments ou les
terrains inoccups et peut reposer sur des valuations (expertises).
la juste valeur, lorsquil ny a pas de march actif pour le bien, mais quun
valuateur expert peut dterminer une valeur en appliquant diffrentes mthodes
dvaluation, en tablissant des comparaisons avec les donnes du march et en
sappuyant sur le raisonnement.
Dans tous les cas, la valeur actuelle estimative est ramene en dollars non indexs afin
destimer le cot historique dorigine du bien au moment de son acquisition, de sa
construction, de son dveloppement ou de sa mise en valeur. Pour ramener la valeur
actuelle estimative en dollars non indexs, on peut appliquer des indices particuliers de
prix, par exemple les indices des cots de construction publis par Statistique Canada.
Lorsque la date exacte de lacquisition est inconnue, une estimation raisonnable est
acceptable. Le cot historique estimatif qui en rsulte, une fois la valeur de rcupration
retranche, est amorti compter de la date dacquisition et jusqu la date courante afin
de reflter la dure de vie utile rsiduelle de lactif.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 71 de 114
De faon gnrale, le modle du cot de reconstitution est prfr au modle du cot de
remplacement pour les raisons suivantes :
le cot de remplacement est fond sur le cot dun bien que le gouvernement ne
possde pas encore. Le cot de prestation du service considr pourrait donc tre
suprieur ou infrieur ce quil tait auparavant. La constatation daugmentations
de cot ou dconomies pourrait aussi fausser les cots de prestation de services
inscrits aux tats financiers;
le cot de reconstitution est fond sur les qualits existantes des biens que le
gouvernement possde actuellement et nintroduit pas des montants ayant trait
des infrastructures nouvelles ou amliores.
Les termes cot de remplacement et cot de remplacement actuel net ne doivent pas
tre confondus avec le cot de remplacement net damortissement. Le cot de
remplacement net damortissement renvoie spcifiquement une mthode utilise par les
valuateurs professionnels pour obtenir un substitut la valeur de march. La mthode
est couramment applique lvaluation dun actif spcialis pour lequel il nexiste pas
de donnes du march faciles trouver ou fiables analyser pour effectuer une
estimation de la valeur de march. Dans ce cas, les valuateurs dsignent par
amortissement toute perte de valeur par rapport lestimation du cot de remplacement
ou de reconstitution total attribuable une dtrioration matrielle ou lobsolescence
fonctionnelle (technique) ou conomique (externe). Il ne sagit pas de la mme notion
que lamortissement comptable (voir la Figure 7).
2.0 Actifs acquis gratuitement ou pour une valeur symbolique
Quand un actif est acquis gratuitement ou pour une valeur symbolique, son cot
correspond sa juste valeur la date de lapport ou de lacquisition. La juste valeur est le
montant de la contrepartie dont conviendraient des parties comptentes agissant en toute
libert dans des conditions de pleine concurrence. La juste valeur peut tre dtermine au
moyen de la valeur de march ou de valeurs dexpertise. Les cots peuvent tre estims
partir des cots de biens acquis ou construits similaires ou partir destimations
techniques du cot du remplacement des diverses composantes. Il importe de
comptabiliser un cot afin de sassurer que le parc dimmobilisations corporelles est
complet. Dans des situations extraordinaires, lorsquil nest pas possible destimer la
juste valeur, limmobilisation corporelle est constate la valeur symbolique. des fins
de comptabilisation, la valeur symbolique est une estimation du cot que
limmobilisation pourrait avoir.
3.0 Immobilisations entirement amorties
Il arrive que le cot de certaines immobilisations corporelles encore utilises soit
entirement amorti du fait de lge de ces immobilisations et de la priode
damortissement tablie pour ce type dimmobilisations corporelles. Il convient
nanmoins de consigner ces immobilisations en dossier des fins de contrle. Lorsque
lAdministration locale possde linformation voulue pour estimer le cot historique et
lamortissement cumul des immobilisations entirement amorties, ces informations sont
consignes dans les livres comptables. Lorsque lAdministration locale ne dispose pas de
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 72 de 114
valuation CCSP
Objectif Estimation de la juste
valeur qua le bien
aujourdhui
Estimation du cot
historique dorigine et de
lamortissement cumul
Mthode
Illustration de la diffrence entre les mthodes de comptabilisation et
dvaluation des actifs spcialiss
(march limit ou inexistant)
Cot de remplacement net
damortissement
estimatif :
- lamortissement est une
provision pour perte de
valeur par rapport
lestimation du cot de
remplacement ou de
reconstitution total
attribuable une
dtrioration matrielle ou
lobsolescence
fonctionnelle (technique)
ou conomique (externe)
du bien.
Cot de reconstitution ou de
remplacement en dollars
non indexs :
- estimation du cot
historique de lactif ou dun
actif similaire;
- lamortissement est une
estimation comptable de la
consommation de lactif sur
sa dure de vie utile
cumule, qui est attribuable
la dtrioration matrielle
ou lobsolescence
fonctionnelle (technique) ou
conomique (externe) du
bien
Illustration
Donnes : LAdministration locale possde une immobilisation spcialise dont
la dure de vie utile estimative est de 10 ans. Lactif a cinq ans.
valuation CCSP
Cot de reconstitution 100 000 $ 100 000 $
Cot S. O. 87 000 $
(en dollars non indexs)
Amortissement 50 000 $ 43 500 $
Cot de remplacement net damortissement/
Valeur comptable nette 50 000 $ 43 500 $
Figure 7
Description
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 73 de 114
ces informations dtailles, elle comptabilise les immobilisations une valeur initiale
gale leur valeur rsiduelle, dans la mesure o la valeur rsiduelle est importante et peut
faire lobjet dune estimation, ou une valeur symbolique.
4.0 Catgories dimmobilisations (avant et aprs adoption de la
nouvelle norme comptable)
LAdministration locale qui souhaite appliquer lapproche par composantes certaines
immobilisations corporelles complexes afin de satisfaire aux exigences de la nouvelle
norme comptable peut prouver des difficults rpartir les cots historiques des
immobilisations existantes entre leurs composantes. LAdministration locale peut diviser
une catgorie dactifs en deux sous-catgories : lune pour les immobilisations
antrieures la date dadoption de la nouvelle norme et lautre pour les immobilisations
postrieures la date dadoption. Lapproche par composantes pourrait alors tre utilise
pour les immobilisations acquises, construites ou mises en valeur aprs la date de
ladoption de la nouvelle norme comptable par lAdministration locale.
5.0 valuation des immobilisations corporelles
5.1 valuateurs
Une fois les immobilisations inventories, il convient de leur attribuer une valeur. Les
valuateurs choisis pour cette tche peuvent tre des employs du service de la
comptabilit, des gestionnaires de biens, du personnel temporaire, des experts ou une
combinaison de ces valuateurs. Ils doivent cependant bien connatre le processus.
Les tapes de lvaluation des actifs sont les suivantes :
laboration des mthodes comptables relatives lvaluation, y compris la
mthode dvaluation pour chaque catgorie dactifs;
slection des actifs valuer au sein de chaque catgorie;
prparation des instructions lintention des valuateurs;
collecte de linformation requise par les valuateurs;
slection des valuateurs;
examen des valuations par la direction.
5.2 Mthodes comptables relatives lvaluation
Lexemple de mthode comptable ci-dessous illustre lutilisation des valuations dans la
dtermination des soldes douverture.
Exemple : Mthode comptable comptabilisation initiale des immobilisations
corporelles
Il arrive parfois que le cot dorigine dune immobilisation soit connu, mais que cette
immobilisation ait subi des amliorations importantes depuis la date de son acquisition.
Prenons lexemple dun centre communautaire pour lequel des cots de mise en valeur
importants ont t engags et inscrits lactif. Si les dtails du contrat initial pass pour
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 74 de 114
ces travaux ne sont pas connus, on peut utiliser des estimations des cots de mise en
valeur pour dterminer les soldes douverture.
5.3 Ensemble de la population ou chantillon
Pour tablir la valeur des immobilisations, lAdministration locale peut employer
lchantillonnage stratifi.
Supposons par exemple quen 2008, une Administration locale compte un sous-rseau de
routes secondaires de 65 km. Si le cot de construction actuel de routes similaires est de
1 M$ par kilomtre de voie, le cot de remplacement actuel total estimatif du rseau de
routes secondaires slve 65 M$ (1 M$ 65). Lge moyen pondr des routes est
estim 15 ans et on considre que lanne dacquisition des routes est 1993. Compte
tenu des indices des cots de construction disponibles, le cot de construction dune route
secondaire en 1993 aurait t gal 69 % du cot engag aujourdhui. Le cot historique
estimatif du sous-rseau de routes secondaires est par consquent de 44,9 M$
(65 M$ 0,69). LAdministration locale comptabiliserait ce montant, dduction faite de
lamortissement cumul, au titre du rseau de routes secondaires dans ses tats financiers.
Il est parfois possible de concevoir un programme informatique qui fournit une
estimation du cot historique des biens immeubles et des biens dinfrastructure. Dans
dautres cas, il faudra peut-tre employer des mthodes actuarielles.
Il arrive que lon ne puisse inscrire lactif certaines immobilisations (les infrastructures,
par exemple) en raison de leur ge. Un grand nombre dAdministrations locales ont ainsi
des infrastructures qui ont t mises en service il y a 50 ou 100 ans, parfois plus. Inscrire
lactif une estimation des cots engags pour certaines immobilisations dinfrastructure
ges naura vraisemblablement que peu dincidence sur le cot des services, les rsultats
et la situation financire de la plupart des Administrations locales aprs le passage la
nouvelle norme. Avant de dcider sil convient dinscrire lactif les cots de ces biens,
lAdministration locale devrait comparer le cot de la cration de linformation par
rapport aux avantages dcoulant dune information plus prcise sur le cot des services,
les rsultats de fonctionnement et la situation financire.
5.4 Instructions lintention des valuateurs
Il faut donner aux valuateurs des instructions dtailles sur les mthodes comptables
relatives lvaluation et des renseignements prcis sur les biens quils doivent valuer.
Le document publi par le bureau national du vrificateur du Royaume-Uni et intitul
Resource Accounts: Preparing for Audit (Londres, United Kingdom National Audit
Office, novembre 1997) donne des exemples des critres dont il faut tenir compte
lorsquon dresse la liste de ces instructions et renseignements. Il faut en particulier garder
lesprit que lefficacit de lvaluation dpend en grande partie de la qualit des
instructions.
Voici quelques suggestions dinstructions lintention des valuateurs :
demander aux valuateurs de dterminer si la liste des biens se trouvant un
endroit donn est exhaustive;
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 75 de 114
demander aux valuateurs de fournir une valeur et une dure de vie utile
estimative pour chaque bien;
utiliser un seuil dinscription lactif relativement bas pour les valuations et
appliquer ce seuil aux valeurs brutes (plutt quaux valeurs nettes). Le seuil utilis
dans le registre des actifs peut tre suprieur, mais il convient de disposer de
donnes suffisantes pour porter un jugement clair;
prciser explicitement si les valuations doivent inclure ou exclure les impts,
taxes ou redevances pertinentes;
prciser le rfrentiel dvaluation professionnel qui doit tre appliqu.
5.5 Information requise par les valuateurs
Dans le cas des terrains, les valuateurs auront vraisemblablement besoin des donnes
suivantes :
la superficie;
les droits et titres de proprits;
les consentements et conventions en matire de planification;
les srets, servitudes et droits de passage;
les utilisations;
les accs.
Dans le cas des btiments, les valuateurs auront vraisemblablement besoin des donnes
suivantes :
le type de construction, de toiture et de systme de chauffage;
lanne de construction;
la superficie extrieure brute;
la superficie intrieure nette;
le nombre dtages;
le cot de remplacement estimatif aux fins des assurances;
les tudes dvaluation de ltat;
les documents et dpenses dentretien.
5.6 Slection des valuateurs
Des valuateurs externes qualifis dlivrent gnralement des valuations fiables et
objectives. En raison du cot des valuations dexperts, on peut toutefois faire appel
certains employs pour lvaluation de certains biens, surtout lorsque lAdministration
locale dispose de programmes informatiques, dindices de prix et de catalogues
susceptibles de lui fournir des valeurs approximatives pour le cot historique ou la valeur
actuelle. Il importe que les valuations effectues par les employs soient en tous points
conformes aux meilleures pratiques suivies par les valuateurs experts et que des pistes
de vrification efficaces soient traces (notamment par des mentions des indices de prix
et catalogues utiliss).
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 76 de 114
5.7 Examen des valuations par la direction
La direction est responsable de lexactitude des valuations, mme quand elles sont
effectues par des valuateurs experts indpendants. La direction doit revoir les rapports
dvaluation avant que leur contenu soit saisi dans les registres des actifs afin den
vrifier le caractre exhaustif et la vraisemblance. La direction doit consigner en dossier
le fait que lexamen a eu lieu, les cas problmes relevs, sil en est, et les mesures prises
cet gard. Voici certains des cas problmes possibles :
des biens nappartenant pas lAdministration locale ont t inclus dans
lvaluation;
des biens appartenant lAdministration locale nont pas t inclus dans
lvaluation;
des biens dfinis comme destins tre sortis ont t valus sur la base de la
continuit de lutilisation.
Des rapprochements entre les documents de la direction, le registre des actifs et les
valuations permettent de sassurer que tous les biens appartenant lAdministration
locale ont t valus et que tous les biens valus appartiennent rellement
lAdministration locale. De tels rapprochements sont une source importante dlments
probants pour la vrification.
Une fois les donnes de lvaluation saisies dans le registre des actifs, seules les
oprations ayant eu lieu aprs la date dvaluation devraient figurer dans le registre. Les
copies des rapports dvaluation constituent des documents justificatifs pour les soldes
douverture.
5.8 Recherche des moins-values
Lors de la comptabilisation de la valeur initiale dune immobilisation corporelle, il faut
valuer si la valeur comptable nette estimative de ce bien est suprieure aux avantages
conomiques futurs que devrait procurer son utilisation et, par consquent, sil convient
den rduire la valeur afin que son cot et lamortissement cumul soient plus
reprsentatifs.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 77 de 114
Chapitre 8 Modle de prsentation de linformation
des Administrations locales
1.0 Cadre conceptuel
Une tude de recherche
8
effectue pour le compte de lICCA en 1980 avait dtermin que
la complexit et les diffrences de prsentation et de terminologie des tats financiers des
gouvernements canadiens taient telles que mme ceux qui connaissaient bien la
comptabilit du secteur public prouvaient des difficults valuer le caractre
significatif de linformation communique. En 1980, au Canada, les gouvernements
dordre suprieur faisaient face dimportants problmes financiers et les utilisateurs
taient davis que les tats financiers publis par ces gouvernements manquaient
duniformit et de transparence. La cration du CCSP remonte lanne de la publication
de cette tude.
Au cours des 25 dernires annes, le CCSP a contribu une nette uniformisation de
linformation financire des gouvernements. Des efforts considrables ont t investis
dans ltablissement dun consensus sur les normes de comptabilit et dinformation
lintention des gouvernements, qui reposent prsent en grande partie sur la codification
des pratiques existantes et des compromis. En octobre 2002, le CCSP a approuv un
cadre conceptuel visant assurer la cohrence et la robustesse du processus de
normalisation.
Le cadre conceptuel tablit ce qui suit :
la nature fondamentale et lobjet des informations qui devraient tre fournies dans
les tats financiers condenss;
les objectifs des tats financiers condenss;
les caractristiques qualitatives de linformation fournie;
la dfinition des composantes des tats financiers condenss;
les normes de constatation, de mesure et de prsentation.
Le cadre conceptuel fournit les lignes directrices ou limites par rapport auxquelles les
questions comptables examines peuvent tre values pour sassurer que le mode de
prsentation de linformation le plus appropri est recommand. Il garantit luniformit
du contenu du Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public ainsi que la
transparence des dcisions prises par le CCSP. Les parties prenantes peuvent ainsi
comprendre les raisons pour lesquelles ces dcisions ont t prises.
Il est tout aussi important que les parties prenantes comprennent comment le cadre
conceptuel est appliqu llaboration des normes dinformation financire. Cette
comprhension les aide interprter linformation contenue dans les tats financiers. Elle
aide aussi les prparateurs et les vrificateurs des tats financiers traiter des questions
dinformation financire quand il nexiste aucune indication prcise.
8
Les rapports financiers des administrations publiques (tude de recherche), Toronto, LInstitut Canadien
des Comptables Agrs, 1980.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 78 de 114
Paralllement la comptabilisation des immobilisations corporelles, les Administrations
locales doivent adopter la mthode de la comptabilit dexercice intgrale et le modle de
prsentation de linformation des gouvernements.
Les sections suivantes traitent de certaines des notions les plus importantes. Pour de plus
amples renseignements sur le cadre conceptuel, se reporter aux chapitres SP 1000
SP 1200 du Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public.
2.0 Notions essentielles
2.1 Composantes des tats financiers
Selon le cadre conceptuel, les tats financiers sont fonds sur un modle de ressources
conomiques. Le modle vise mesurer les ressources conomiques nettes dont le
gouvernement dispose un moment donn.
Les composantes des tats financiers sont de deux ordres : celles qui dcrivent les
ressources conomiques, les obligations et le surplus ou le dficit accumul du
gouvernement une date donne, et celles qui dcrivent les changements intervenus dans
les ressources conomiques, les obligations et le surplus ou le dficit accumul au cours
dune priode donne. Les notes complmentaires, qui servent clarifier ou mieux
expliquer certains postes prsents dans les tats financiers, ne sont pas considres
comme une composante, bien quelles fassent partie intgrante des tats financiers.
Les tats financiers du gouvernement comportent les composantes suivantes : les actifs
(constitus des actifs financiers et non financiers), les passifs, les revenus et les charges.
Les revenus et les charges, et donc les rsultats des activits de lexercice, dcoulent
uniquement des variations du total des actifs et des passifs. Seuls les lments qui
rpondent la dfinition dun actif ou dun passif sont constats dans le bilan. Cest
pourquoi les dfinitions dactif et de passif sont essentielles et constituent les bases du
cadre conceptuel.
Les actifs sont les ressources conomiques sur lesquelles le gouvernement exerce un
contrle par suite doprations ou dvnements passs, et qui sont censs lui procurer
des avantages conomiques futurs. Les passifs sont des obligations actuelles dun
gouvernement envers des tiers, qui rsultent doprations ou dvnements passs et dont
le rglement prvu donnera lieu une sortie future de ressources reprsentatives
davantages conomiques.
Les actifs et les passifs sont les notions principales du cadre conceptuel. Il ne peut y avoir
de revenu ou de gain sans augmentation dactif ou diminution de passif, et il ne peut y
avoir de charge ou de perte sans diminution de lactif ou augmentation du passif. Par
consquent, un surplus correspond une augmentation de lactif net et un dficit, une
diminution de lactif net.
Le surplus ou le dficit accumul correspond la diffrence entre les actifs et les passifs.
La variation nette dune anne sur lautre de lactif et du passif correspond au surplus ou
au dficit dexploitation.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 79 de 114
2.2 Principaux indicateurs du modle de prsentation de
linformation des Administrations locales
Il faut que les tats financiers fournissent des informations qui dcrivent la situation
financire du gouvernement en termes dactif et de passif, de dette nette, de surplus ou de
dficit accumul et dimmobilisations corporelles et autres actifs non financiers la date
de clture. Les tats financiers doivent aussi fournir un rsum significatif des sources, de
la rpartition et de la consommation des ressources conomiques du gouvernement
pendant lexercice considr, de lincidence des activits de lexercice sur la dette nette
du gouvernement, du financement des activits au cours de lexercice et de la faon dont
il a combl ses besoins en trsorerie. Chaque indicateur renseigne le lecteur sur ltat des
finances du gouvernement.
2.2.1 Dette nette / actifs financiers nets
La dette nette (les actifs financiers nets) rsulte de la diffrence entre le passif et les actifs
financiers de lAdministration locale. La dette nette constitue un indicateur des revenus
futurs ncessaires pour couvrir des oprations et des activits passes. Elle donne une
indication de la capacit de financer des dpenses supplmentaires. loppos, les actifs
financiers nets sont un indicateur des ressources financires dont le gouvernement
dispose pour le financement dactivits futures.
2.2.2 Surplus
9
/dficit accumul
Le surplus/dficit accumul du gouvernement reprsente ses ressources conomiques
nettes. Le surplus accumul reprsente le solde rsiduel de ses actifs (financiers et non
financiers) aprs dduction des passifs. La prsence dun surplus accumul indique quun
gouvernement dispose de ressources nettes (financires et matrielles) dont il peut se
servir pour la prestation de services futurs. La prsence dun dficit accumul signifie
quil y a un excdent du passif sur les actifs et que lAdministration a financ le dficit de
fonctionnement de lexercice par des emprunts. La taille du surplus ou du dficit
accumul donne une indication de la capacit de lAdministration de fournir des services
futurs.
2.2.3 Surplus ou dficit de lexercice
Le surplus/dficit de lexercice indique, en termes montaires, la mesure dans laquelle le
gouvernement a prserv son actif net au cours de lexercice. Par exemple, si les revenus
dune Administration locale sont gaux ses charges de lexercice et donc que son
rsultat de lexercice stablit 0 $, cette Administration locale a prserv son actif net au
cours de lexercice. Le surplus ou dficit de lexercice montre si les revenus gnrs au
cours de lexercice ont t suffisants pour couvrir les cots de lexercice. Les cots de
lexercice comprennent le cot de lutilisation des immobilisations corporelles existantes
et nouvelles pour fournir des services.
9
Le terme actifs nets peut servir dsigner le surplus accumul net.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 80 de 114
2.2.4 Variation de la dette nette
La variation de la dette nette est la mesure dans laquelle les dpenses engages par le
gouvernement au cours de lexercice sont compenses par les revenus constats au cours
de lexercice. Les dpenses de lexercice comprennent les acquisitions dimmobilisations
corporelles. Une augmentation de la dette nette signifie quune augmentation des revenus
futurs est ncessaire pour payer des oprations et des vnements passs. Et, si le
gouvernement a des dpenses en immobilisations, ltat de la variation de la dette nette
fait ressortir le niveau rel de ces dpenses pour lexercice et le compare aux dpenses en
immobilisations prvues.
2.2.5 Flux de trsorerie
Les flux de trsorerie sont prsents dans ltat des flux de trsorerie, qui indique la
variation de la trsorerie au cours de lexercice et fait ressortir la provenance et
lutilisation des flux de trsorerie. Cet tat prsente les activits dinvestissement en
immobilisations, notamment les sorties de fonds en vue dacqurir des immobilisations.
LAdministration locale peut prsenter les flux de trsorerie lis aux activits de
fonctionnement selon la mthode directe ou la mthode indirecte. La diffrence entre les
deux modes de prsentation tient seulement la faon dont les flux de trsorerie lis aux
activits de fonctionnement sont prsents : directement, ou indirectement, par
rapprochement avec le surplus ou le dficit de lexercice.
3.0 Prsentation des tats financiers
Le jeu dtats financiers doit tre compos dun tat de la situation financire, dun tat
des rsultats, dun tat de la variation de la dette nette et dun tat des flux de trsorerie.
Ces tats sont obligatoires. Le gouvernement peut fournir des renseignements
supplmentaires dans les tableaux et les notes affrentes aux tats financiers.
3.1 tat de la situation financire
Ltat de la situation financire fait ressortir quatre montants cls qui dcrivent la
situation financire du gouvernement la date de clture :
a) les liquidits du gouvernement, constitues de la trsorerie et des quivalents de
trsorerie;
b) la dette nette du gouvernement, qui correspond la diffrence entre le passif et les
actifs financiers;
c) les actifs non financiers du gouvernement (immobilisations corporelles, stocks de
fournitures et charges payes davance, etc).
d) le surplus ou le dficit accumul du gouvernement (somme de la dette nette du
gouvernement et de ses actifs non financiers). Cet indicateur reprsente l'actif net
du gouvernement.
Chacun des trois autres tats financiers illustre l'volution de l'une des quatre
composantes de la situation financire du gouvernement.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 81 de 114
3.2 tat des rsultats
Ltat des rsultats prsente le surplus ou le dficit de l'exercice li aux activits du
gouvernement. Il prsente le cot, y compris la consommation des actifs non financiers,
des services gouvernementaux fournis au cours de lexercice, les revenus constats au
cours de lexercice et la diffrence entre ces deux lments. Il indique en termes
montaires la mesure dans laquelle le gouvernement a prserv son actif net au cours de
l'exercice.
3.3 tat de la variation de la dette nette / des actifs financiers nets
Ltat de la variation de la dette nette / de lvolution de la situation financire nette
montre la mesure dans laquelle les dpenses de lexercice, y compris les dpenses en
immobilisations corporelles et la variation dans les autres actifs non financiers, ont t
compenses par les revenus constats au cours de lexercice. Pour montrer cette mesure,
le gouvernement prsente les lments qui expliquent la diffrence entre le surplus ou le
dficit de l'exercice li ses activits et la variation de la dette nette au cours de
l'exercice. Cet tat est un rapprochement du surplus ou du dficit de lexercice et de la
variation de la dette nette.
3.4 tat des flux de trsorerie
Ltat des flux de trsorerie prsente la variation de la trsorerie et des quivalents de
trsorerie au cours de lexercice et montre comment le gouvernement a financ ses
activits de lexercice et fait face ses besoins en trsorerie.
3.5 Exemples dtats financiers
Les pages qui suivent prsentent des exemples des nouveaux tats financiers des
gouvernements.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 82 de 114
TAT 1
VILLE DE XYZ
TAT CONSOLID DE LA SITUATION FINANCIRE
31 DCEMBRE 20X9
20X9 20X8
(en milliers de dollars)
Actifs financiers
Trsorerie et quivalents de trsorerie 1 577 1 366
Dbiteurs 1 864 1 708
Placements de portefeuille 7 031 6 932
Participations dans des entreprises
commerciales 331 207
Stocks destins la revente 109 135
10 912 10 348
Passifs
Crditeurs et frais payer 2 383 2 644
Emprunts 9 363 9 796
Obligations au titre des pensions de
retraite et des avantages sociaux 4 813 4 890
Autres charges payer 1 703 1 841
18 262 19 171
Dette nette (7 350) (8 823)
Actifs non financiers
Immobilisations corporelles 87 218 97 215
Stocks de fournitures 112 222
Charges payes davance 30 20
87 360 97 457
Surplus accumul 80 010 88 634
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 83 de 114
TAT 2
VILLE DE XYZ
TAT CONSOLID DES RSULTATS
Exercice termin le 31 dcembre 20X9
20X9 20X9 20X8
Budget Rel Rel
(en milliers de dollars)
Revenus
Impt foncier 8 034 8 628 9 503
Redevances 3 381 3 746 3 788
Paiements de transfert 1 722 1 820 1 648
Droits, permis, licences et amendes 581 651 669
Revenus de placement 409 610 747
Revenus tirs dentreprises 50 525 97
Revenus divers 100 342 402
Total des revenus 14 277 16 322 16 854
Charges
Scurit publique 4 329 4 061 3 938
Eau et gouts 8 541 8 626 8 457
Routes et transport 7 360 7 557 7 449
Loisirs et culture 3 094 3 310 3 269
Administration gnrale 832 899 777
Autres 93 493 413
Total des charges 24 249 24 946 24 303
Dficit de lexercice (9 972) (8 624) (7 449)
Dficit accumul au dbut de lexercice 88 634 88 634 96 083
Dficit accumul la fin de lexercice 78 662 80 010 88 634
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 84 de 114
TAT 3
VILLE DE XYZ
TAT CONSOLID DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE
Exercice termin le 31 dcembre 20X9
20X9 20X9 20X8
Budget Rel Rel
(en milliers de dollars)
Dficit de lexercice (9 972) (8 624) (7 449)
Acquisition dimmobilisations corporelles (294) (294) (250)
Amortissement des immobilisations
corporelles 10 226 10 226 10 230
(Gain) perte sur la vente dimmobilisations
corporelles (5) (19)
Produits de la vente dimmobilisations
corporelles 46 72
Rductions de valeur dimmobilisations
corporelles 24 44
(40) 1 373 2 628
Acquisition de stocks de fournitures (324)
Acquisition de charges payes davance (30) (20)
Consommation des stocks de fournitures 110 102
Utilisation de charges payes davance 20
0 100 (242)
(Augmentation) diminution des actifs financiers nets
/ de la dette nette (40) 1,473 2,386
Actifs financiers nets (dette nette) au dbut de
lexercice (8 823) (8 823) (11 209)
Actifs financiers nets (dette nette) la fin
de lexercice (8 863) (7 350) (8 823)
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 85 de 114
TAT 4
VILLE DE XYZ
TAT CONSOLID DES FLUX DE TRSORERIE (mthode indirecte)
Exercice termin le 31 dcembre 20X9
20X9 20X8
Rel Rel
(en milliers de dollars)
Activits de fonctionnement
Dficit de lexercice (8 624) (7 449)
lments sans effet sur la trsorerie, incluant
lamortissement 10,504 10,522
Charges payes davance (30) (20)
Variation des revenus reports (23) 16
Divers (819) 77
Flux de trsorerie provenant des activits de
fonctionnement 1 008 3 146
Activits dinvestissement en
immobilisations
Produits de la vente dimmobilisations corporelles 46 72
Sorties de fonds relatives l'acquisition
d'immobilisations corporelles (294) (250)
Flux de trsorerie affects aux activits
d'investissement en immobilisations (248) (178)
Activits de placement
Produits de cessions et de rachats de placements
de portefeuille 1 030 4 126
Placements de portefeuille (1 129) (4 369)
Divers (17) (15)
Flux de trsorerie provenant des (affects aux)
activits de placement (116) (258)
Activits de financement
Produits demprunts 13 970 3 694
Remboursements demprunts (14,403) (6,175)
Flux de trsorerie affects aux activits de
financement (433) (2,481)
Augmentation de la trsorerie et des quivalents
de trsorerie 211 229
Trsorerie et quivalents de trsorerie au dbut de
l'exercice 1 366 1 137
Trsorerie et quivalents de trsorerie la fin de
l'exercice 1 577 1 366
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 86 de 114
TAT 4
VILLE DE XYZ
TAT CONSOLID DES FLUX DE TRSORERIE (mthode directe)
Exercice termin le 31 dcembre 20X9
20X9 20X8
Rel Rel
(en milliers de dollars)
Activits de fonctionnement
Rentres de fonds :
Impts et taxes 9 239 8 267
Paiements de transfert 1 541 1 943
Redevances 3 618 4 808
Droits, permis, licences et amendes 581 791
Entreprises 1 401 983
Placements 564 675
Divers 1 176 1 016
18 120 18 483
Sorties de fonds :
Salaires, traitements, contrats de travail et avantages sociaux 7 345 7 276
Matires et fournitures 7 192 5 936
Services sous-traits 2 074 1 290
Cots de financement 501 835
17 112 15 337
Flux de trsorerie provenant des activits de
fonctionnement 1 008 3 146
Activits dinvestissement en
immobilisations
Produits de la vente dimmobilisations corporelles 46 72
Sorties de fonds relatives lacquisition
dimmobilisations corporelles (294) (250)
Flux de trsorerie affects aux activits
d'investissement en immobilisations (248) (178)
Activits de placement
Produits de cessions et de rachats de placements
de portefeuille 1 030 4 126
Placements de portefeuille (1 129) (4 369)
Divers (17) (15)
Flux de trsorerie provenant des (affects aux)
activits de placement (116) (258)
Activits de financement
Produits demprunts 13 970 3 694
Remboursement demprunts
(14 403
) (6 175)
Flux de trsorerie affects aux activits de
financement (433) (2,481)
Augmentation de la trsorerie et des quivalents
de trsorerie 211 229
Trsorerie et quivalents de trsorerie au dbut de
lexercice 1 366 1 137
Trsorerie et quivalents de trsorerie la fin de
lexercice 1 577 1 366
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 87 de 114
V
a
l
e
u
r
c
o
m
p
t
a
b
l
e
n
e
t
t
e
l
a
f
i
n
d
e
l
e
x
e
r
c
i
c
e
2
9
9
0
2
9
0
1
2
6
2
9
6
3
3
7
3
4
8
7
1
0
2
3
3
1
4
2
7
6
3
3
8
4
7
9
3
4
5
5
1
3
4
7
8
7
2
1
8
A
m
o
r
t
i
s
-
s
e
m
e
n
t
c
u
m
u
l
l
a
f
i
n
d
e
l
e
x
e
r
c
i
c
e
0
1
3
3
6
2
0
8
2
8
2
6
7
2
0
3
9
7
8
9
3
4
1
4
7
5
1
1
4
4
5
4
2
3
0
5
9
1
9
5
8
1
8
1
A
m
o
r
t
i
s
-
s
e
m
e
n
t
3
5
5
3
1
9
1
4
0
9
4
1
0
5
7
2
8
3
5
1
9
4
1
3
9
7
5
4
1
6
4
1
0
2
2
6
D
i
m
i
n
u
-
t
i
o
n
s
2
9
2
9
V
a
l
e
u
r
c
o
m
p
t
a
b
l
e
n
e
t
t
e
a
u
d
b
u
t
d
e
l
e
x
e
r
c
i
c
e
3
0
1
5
3
2
7
0
2
9
3
9
5
3
7
7
1
0
9
7
3
6
2
6
0
6
4
7
8
0
3
8
0
1
8
9
0
5
0
2
1
5
1
0
9
7
2
1
5
A
m
o
r
t
i
s
-
s
e
m
e
n
t
c
u
m
u
l
a
u
d
b
u
t
d
e
l
e
x
e
r
c
i
c
e
9
8
1
1
7
6
3
7
2
2
6
2
6
2
9
2
1
6
5
2
9
5
6
7
6
0
4
4
5
2
5
1
7
5
5
4
7
9
8
4
S
o
l
d
e
l
a
f
i
n
d
e
l
e
x
e
r
c
i
c
e
2
9
9
0
4
2
3
7
4
7
1
2
4
6
0
4
5
4
1
2
6
8
7
3
2
6
6
5
7
5
0
4
5
2
8
1
3
3
5
7
6
0
2
2
6
6
1
4
5
3
9
9
R
d
u
c
-
t
i
o
n
s
d
e
v
a
l
e
u
r
2
4
2
4
S
o
r
t
i
e
s
2
5
4
5
7
0
N
o
u
v
e
l
l
e
s
i
m
m
o
b
i
l
i
-
s
a
t
i
o
n
s
1
0
9
2
1
1
8
3
0
8
1
5
1
2
8
1
2
9
4
S
o
l
d
e
d
o
u
v
e
r
-
t
u
r
e
3
0
1
5
4
2
5
1
4
7
0
3
3
6
0
3
3
7
1
2
6
5
7
3
2
5
8
5
7
3
5
4
5
6
1
1
3
3
5
7
5
2
2
2
6
4
1
4
5
1
9
9
T
A
B
L
E
A
U
V
I
L
L
E
D
E
X
Y
Z
T
A
B
L
E
A
U
C
O
N
S
O
L
I
D
D
E
S
I
M
M
O
B
I
L
I
S
A
T
I
O
N
S
C
O
R
P
O
R
E
L
L
E
S
A
U
3
1
D
C
E
M
B
R
E
2
0
X
9
(
e
n
m
i
l
l
i
e
r
s
d
e
d
o
l
l
a
r
s
)
T
e
r
r
a
i
n
B
t
i
m
e
n
t
s
R
o
u
t
e
s
g
o
u
t
s
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
e
t
p
l
u
v
i
a
u
x
P
a
r
c
s
e
t
l
o
i
s
i
r
s
C
o
n
t
r
l
e
d
e
l
a
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
e
t
c
l
a
i
r
a
g
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
P
a
r
c
a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
d
e
g
e
s
t
i
o
n
d
e
s
d
c
h
e
t
s
M
a
t
r
i
e
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
A
u
t
r
e
s
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 88 de 114
4.0 Prsentation des montants budgts
Une autre caractristique essentielle du modle dinformation des gouvernements est
lobligation de prsenter les montants budgts pour lexercice et les montants rels dans
les tats des rsultats et de la variation de la dette nette / des actifs financiers nets. La
cohrence des rsultats budgts et des rsultats rels est considre comme un lment
essentiel de linformation redditionnelle.
La prsentation des montants rels et prvus dans les tats financiers fournit des
informations importantes sur le plan de la reddition de comptes. Les utilisateurs peuvent
la trouver utile pour valuer comment les rsultats rels des activits de lexercice se
comparent ceux initialement prvus et pour juger si les ressources conomiques
publiques sont gres conformment au plan. La communication dinformations sur le
budget permet de reprer les carts, de dterminer les tendances et danalyser le
fonctionnement.
4.1 Ensemble d'activits vis par le budget et rgles comptables
Les montants budgts doivent tre prsents pour le mme ensemble dactivits et selon
des rgles concordant avec celles utilises pour les rsultats rels dans chacun des tats
financiers.
Pour ltat des rsultats, cela signifie que les montants budgts sont prsents selon la
mthode de la comptabilit dexercice intgrale. Les montants budgts sont prsents
selon les mmes rgles de consolidation que les rsultats rels, cest--dire que ltat
comprend les montants budgts pour tous les organismes gouvernementaux compris
dans le primtre comptable de lAdministration locale.
4.2 Budgets tablis pour un ensemble dactivits diffrent et selon
des rgles diffrentes
Selon une rcente tude sur les pratiques en matire dtablissement de budgets des
gouvernements dordre suprieur, pour lexercice termin le 31 mars 2004, les budgets,
les budgets des dpenses et les tats financiers condenss de la plupart des
gouvernements ont t tablis selon la mthode de la comptabilit dexercice
10
. Les
Administrations locales sont rticentes adopter la mthode de la comptabilit dexercice
intgrale pour ltablissement de leurs budgets. Elles sont nombreuses soutenir que
ltablissement des budgets en comptabilit de trsorerie permet un suivi rigoureux des
flux de trsorerie et prend en compte les effets court terme des mthodes comptables
sur leur position de trsorerie. Ltablissement de budgets en comptabilit de trsorerie
permet aux lus de mieux contrler les dpenses. Les lois sur lquilibre budgtaire en
vigueur peuvent obliger les Administrations locales augmenter prmaturment les
impts et les taxes pour financer lamortissement et dautres lments comme les
avantages sociaux futurs. Elles pourraient ensuite avoir rduire des programmes et des
10
Paul-Emile Roy, Rgles comptables suivies par les gouvernements au Canada dans leur processus
budgtaire, CAmagazine, janvier-fvrier 2005, pages 18 20.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 89 de 114
services pour quilibrer les budgets et maintenir les impts fonciers des niveaux
stratgiquement acceptables.
Si les Administrations locales tablissent leurs budgets selon des rgles diffrentes ou
pour un ensemble dactivits diffrent de ce qui est appliqu aux fins de ltablissement
des tats financiers, le CCSP exige quelles fassent le lien avec les tats financiers pour
que leurs conseils puissent voir comment les rsultats rels se comparent aux rsultats
prvus.
4.2.1 Ensemble dactivits diffrent
Quand lensemble des activits prsent dans le plan financier nest pas le mme que
celui prsent dans les tats financiers, il peut tre ncessaire de limiter la comparaison
des rsultats rels et budgts prsents dans les tats des rsultats et de la variation de la
dette nette lensemble dactivits vis par le budget ou les principales estimations de
dpenses. La comparaison des rsultats budgts et rels tablis pour le mme ensemble
dactivits serait prsente dans une note ou un tableau complmentaire. Pour permettre
le rapprochement de cette information et des informations prsentes dans les tats
financiers, le gouvernement indique les diffrences entre le primtre comptable adopt
aux fins de l'tablissement des tats financiers et celui adopt aux fins de la prparation
du plan financier.
4.2.2 Rgles comptables diffrentes
Quand le plan financier de lAdministration locale na pas t prpar selon les rgles
appliques aux fins de la prsentation des rsultats rels, il faut que les rsultats prvus
soient ajusts en fonction des rgles appliques aux fins de la prsentation des rsultats de
l'exercice. En pareil cas, les montants budgts sont retraits selon les rgles comptables
utilises pour les rsultats rels. Il est alors ncessaire de fournir un rapprochement de
linformation retraite et de linformation initialement prsente dans le plan financier.
4.3 Effet de ltablissement de budgets en comptabilit dexercice sur
les taux dimposition et les redevances
Ltablissement des taux dimposition doit tre considr comme un exercice
dtablissement de la tarification. Les Administrations locales ne sont pas tenues de
dterminer les taux en fonction dun budget tabli en comptabilit dexercice. Elles
peuvent continuer les tablir en comptabilit de trsorerie. Cest--dire que les
Administrations locales doivent tablir les taux en fonction de la trsorerie dont elles ont
besoin pour sacquitter des obligations de lexercice et des autres besoins en matire de
financement des activits futures, compte tenu des dpenses dexploitation, des rserves,
des dpenses en immobilisations financer au moyen des revenus de lexercice, etc.
Les rgles traditionnelles dtablissement de budgets ne tiennent pas compte de la gestion
de la dette nette et de lactif net des Administrations locales. Or, la gestion de la situation
financire est un facteur essentiel de la responsabilit des Administrations locales et le
surplus ou le dficit de lexercice nest quune facette de lobligation redditionnelle.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 90 de 114
Comme le modle dinformation reposant sur la comptabilit dexercice intgrale
prsentera les effets des dcisions stratgiques sur ltablissement des taux budgts, les
Administrations locales devraient envisager de prparer des tats financiers pro forma
partir du budget tabli en comptabilit dexercice. Cela leur permettrait de montrer
lincidence des dcisions en matire de budget et de taux sur les principaux indicateurs de
leur situation financire.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 91 de 114
Chapitre 9 Questions lies aux tats financiers la
vrification externe
1.0 Prparation en vue de la vrification externe
Le prsent chapitre se penche sur la faon dont les Administrations locales peuvent se
prparer en vue dune vrification externe, une fois la comptabilisation des
immobilisations corporelles mise en uvre. Il vise principalement permettre aux
Administrations locales de sassurer que les vrificateurs externes peuvent excuter la
mission de vrification avec efficience et dlivrer une opinion sans rserve sur les tats
financiers condenss. Afin daider les Administrations locales tirer avantage des efforts
quelles ont consacrs au passage la comptabilisation des immobilisations corporelles,
le prsent chapitre analyse diverses responsabilits de la direction lgard de la
comptabilisation des immobilisations corporelles et de la prsentation dinformations
leur sujet. Cette analyse nest pas exhaustive et a essentiellement pour but dillustrer par
des exemples les tches de planification et de prparation qui peuvent tre ncessaires
pour la dlivrance dune opinion de vrification sans rserve.
Pour que la vrification soit harmonieuse et pour aider rduire le risque quun rapport
de vrification avec rserve soit dlivr, la direction et les employs peuvent faire ce qui
suit :
comprendre la responsabilit de la direction;
tracer des pistes de vrification;
prparer lavance les documents justificatifs et les tableaux;
connatre les embches les plus courantes et prendre des mesures pour les viter.
2.0 Responsabilit de la direction
Ltablissement des tats financiers incombe la direction, qui est responsable des
assertions faites dans les tats financiers ainsi que des systmes et des contrles mis en
place par lAdministration locale et des validations et examens, qui fournissent une
assurance lgard de ce qui suit :
exhaustivit toutes les immobilisations et tous les faits les concernant sont
recenss et comptabiliss;
exactitude le cot et les autres informations concernant les immobilisations sont
exacts;
existence les immobilisations existent une date donne;
droits et obligations les immobilisations appartiennent lAdministration locale
une date donne;
valeur la valeur comptable inscrite au titre des immobilisations est approprie;
prsentation et communication de linformation les lments sont prsents,
classs et dcrits selon les normes comptables et les rglements en vigueur.
La direction doit documenter les pistes de vrification traces depuis lorigine de chaque
opration ou solde jusquau compte et inversement. La capacit de remonter la piste
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 92 de 114
depuis les tats financiers jusquaux enregistrements comptables initiaux des oprations
et vnements sous-jacents (et de revenir ensuite aux tats financiers) permet au
vrificateur de corroborer les chiffres pour chacun des comptes. Les pistes de vrification
comprennent aussi les pices justificatives dorigine tayant les oprations.
Parmi les documents justificatifs ncessaires pour ltablissement et la vrification des
tats financiers, on retrouve :
un exemplaire du registre des actifs, prsent par catgorie dactifs;
le rapprochement des soldes douverture et de clture de chaque catgorie
dactifs;
un exemplaire des procdures de prise dinventaire et le relev dinventaire;
le rapprochement du relev dinventaire et du registre des actifs;
une liste des biens sortis du patrimoine et des biens viss par une rduction de
valeur;
un tableau des dpenses effectues aprs lachat, indiquant les dpenses inscrites
lactif conformment la mthode comptable correspondante;
un tableau des revenus et des charges quil convient dinscrire ltat des
rsultats du fait de la vente dimmobilisations;
des rapports dvaluation, le cas chant, renfermant la mthode et la date
dvaluation ainsi que les titres de comptences de lvaluateur.
La direction doit sentendre avec le vrificateur sur les documents quelle doit fournir
pendant la planification de la mise en uvre.
3.0 Soldes douverture
Les documents et procdures qui suivent peuvent servir justifier les soldes douverture
concernant les immobilisations :
le rapprochement des totaux initiaux du registre des actifs et des rapports
dvaluation;
des copies des dclarations rdiges par ceux qui dtiennent les actifs et
confirmant que les registres des actifs sont exacts et complets;
un relev des ajustements apports au registre des actifs aprs sa rvision par les
dtenteurs dactifs;
les listes des entres, des amliorations et des sorties dimmobilisations
corporelles, y compris la documentation des procdures de validation appliques
leur gard;
les contrles de vraisemblance visant lamortissement et la rvaluation (qui
comprennent des comparaisons avec les donnes de lexercice prcdent, sil en
est).
Les soldes douverture doivent :
tre comptabiliss et valus selon les mthodes comptables choisies;
tre enregistrs avec exactitude dans le systme comptable;
concorder avec tout montant report des comptes tablis en comptabilit de
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 93 de 114
trsorerie, par exemple les comptes dattente;
provenir de sources clairement identifiables et documentes;
tre tays par des lments probants attestant que la direction a vrifi les droits
de proprit, lexactitude et lexhaustivit des comptes;
tre tays par des lments probants attestant lexistence dune vrification
physique, sil y a lieu.
4.0 Informations fournies dans les tats financiers
LAdministration locale doit sassurer que ses systmes et documents financiers peuvent
fournir linformation requise dans le cadre des obligations dinformations prescrites par
les normes comptables. Elle doit aussi surveiller et valuer les risques financiers
potentiels auxquels lexposent les actifs (par exemple, cots de remise en tat des lieux)
et fournir des donnes aux fins de la communication volontaire dinformations.
Voici des exemples dinformations fournir en vertu des normes comptables :
toutes les catgories dimmobilisations corporelles non constates en vertu des
dispositions transitoires du chapitre SP 3150 et de la NOSP-7;
les restrictions, sil en est, et le montant de ces restrictions, qui visent les droits de
proprit sur les immobilisations corporelles donnes en garantie demprunts;
le montant des dpenses en immobilisations corporelles dans le cadre de travaux
de construction (travaux en cours);
le montant des engagements visant lacquisition dimmobilisations corporelles.
5.0 Embches courantes
Voici les embches les plus frquentes :
la prise dinventaire nest pas effectue conformment aux instructions (incluant
les faiblesses du contrle interne comme lexcution de la prise dinventaire par
des employs responsables des immobilisations inventories);
des procdures de prise dinventaire dficientes et des anomalies non corriges;
il manque des dpenses correspondant des amliorations postrieures la date
initiale dacquisition (en particulier lorsque lapproche par composante est
adopte cela peut entraner des inexactitudes dans lge et ltat des
composantes, ces dernires pouvant avoir t modernises ou remplaces depuis
la constatation initiale des immobilisations);
la mise en uvre des registres des actifs est dficiente (donnes manquantes,
erreurs dans la saisie initiale, programmes de conversion inefficaces, etc.);
les registres des actifs ne sont pas intgrs dans les systmes financiers ou
dautres systmes, ce qui entrane la redondance et la saisie en double de donnes;
les tiquettes ou autocollants servant enregistrer les rfrences du registre des
actifs sur des biens comme des meubles et du matriel sont inexactes ou alors ne
sont pas visibles;
les politiques, les procdures et la formation ncessaires pour assurer la viabilit
du registre des actifs (ou de ses composantes) nont pas t mises en uvre;
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 94 de 114
lemplacement auquel les biens sont rattachs est inexact;
les taux damortissement et les dures de vie utile ne sont pas rvises
rgulirement (ce qui se traduit par un grand nombre dimmobilisations
entirement amorties mais ayant encore une valeur);
les acquisitions et les sorties ne sont pas enregistres en temps voulu dans les
registres des actifs ou elles ne sont pas traites dans le grand livre gnral;
la documentation de sorties dimmobilisations est manquante;
les donnes consignes dans le registre des actifs ne sont pas documentes;
les chiffres soumis la vrification nont pas t revus au pralable par la
direction;
les donnes sur les dates dacquisition (ncessaires pour le calcul de
lamortissement) sont incompltes;
il y a des erreurs dans lestimation de la dure de vie utile des immobilisations;
les rapprochements des registres des actifs et des documents des filiales sont faits
intervalles irrguliers;
les rapprochements des registres des actifs et du grand livre gnral sont faits
intervalles irrguliers;
les rapports dvaluation sont peu crdibles.
viter ces embches peut aider viter la dlivrance dun rapport avec rserve par le
vrificateur.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 95 de 114
Chapitre 10 Leons tires par dautres Administrations
Voici certaines leons tires par dautres Administrations qui comptabilisent dj leurs
immobilisations :
Commencer tt il est essentiel de disposer de dlais suffisants.
Obtenir lappui de tous ceux qui sont concerns.
Travailler en troite collaboration avec les vrificateurs externes.
Sattendre faire quelques erreurs.
tre pragmatique.
Savoir que le processus est volutif.
La comptabilisation progressive de catgories dimmobilisations comporte la
fois des avantages et des inconvnients.
La mise en place de systmes intgrs limine un certain nombre de questions de
vrification lies aux interfaces.
Sassurer quil y a une bonne piste de vrification, qui comprend la
documentation des estimations et des hypothses.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 96 de 114
ANNEXE A
Plan gnral de mise en uvre
Dbut du projet
Documenter le projet et le faire approuver
Former le comit de direction
Prparer des plans dtaills du projet
Composer lquipe de projet
o Promoteur du projet
o Gestionnaire du projet
o quipe du projet (chef dquipe / gestionnaire et autre personnel)
Dfinir les ressources ncessaires
Obtenir les ressources ncessaires
Dlimitation et planification dtailles
Documenter les processus et les procdures ainsi que les obligations lgislatives
dj en place (y compris les mthodes et systmes comptables existants)
Identifier les changements projets ou les secteurs pour lesquels des changements
sont prvus (y compris les mthodes et systmes comptables prvus)
Effectuer la planification des systmes
tablir la structure/responsabilit des systmes projets
tablir le cahier des charges pour les systmes (existants et nouveaux)
tablir les exigences en matire de contrle
Identifier les interfaces ncessaires
laborer le plan de comptes
Mettre au point les interfaces (sil y a lieu)
Dfinir de nouvelles exigences en matire dinformation
Vrification
Communiquer avec le vrificateur externe afin dvaluer lincidence des
changements sur le processus de vrification
Dfinir le rle de la vrification interne pendant la transition
tablir un plan de communications
laborer des stratgies de formation (par exemple, quipe de projet, comptabilit
dexercice et connaissances informatiques)
laborer une stratgie de gestion du changement
Mise en uvre
Attribuer les responsabilits en matire de gestion du projet et mettre en place les
structures dinformation
Mettre en uvre les systmes nouveaux ou modifis
Installer les interfaces
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 97 de 114
Rdiger des mthodes comptables dtailles
Rdiger ou modifier les politiques et procdures de gestion financire
correspondantes
Attribuer les rles et les responsabilits
Assurer la formation
Obtenir lautorisation de passer aux nouveaux systmes
Mettre progressivement en uvre dautres projets (par exemple, la constatation de
catgories en particulier dactifs ou de passifs)
Information
Produire une information externe et interne de meilleure qualit
tablir des mesures de performance financire et non financire
valuer les contrles et les procdures qui assurent lintgrit de linformation
financire et non financire
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 98 de 114
ANNEXE B
Processus de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
tape 1 tablissement des mthodes :
se familiariser avec les normes comptables, notamment avec les
dfinitions et les critres de constatation;
dfinir les catgories dactif, les composantes et les segments (sil y a
lieu);
tablir les seuils dinscription pour chaque catgorie/composante;
tablir les mthodes dvaluation pour chaque catgorie/composante;
tablir des mthodes permettant de distinguer les amliorations des
charges aux fins des dpenses en immobilisations ultrieures;
tablir des politiques en matire damortissement et slectionner des
mthodes damortissement pour chacune des catgories ou
composantes;
tablir des mthodes relatives la moins-value des immobilisations.
tape 2 Exigences en matire dinformation :
tablir les exigences en matire dinformation pour chacune des
mthodes;
tablir les exigences en matire dinformation aux fins de la gestion
des actifs;
tablir des chanciers pour la collecte et la vrification des donnes;
tablir des chanciers pour llaboration et la mise en uvre des
systmes.
tape 3 tablissement du registre des actifs :
valuer les systmes et les pratiques de gestion des actifs utiliss;
dcider sil convient de conserver ou de modifier les
dossiers/systmes existants ou de mettre au point de nouveaux
systmes;
dcider si un registre des actifs, nouveau ou existant, doit tre intgr
dans le grand livre gnral;
concevoir et mettre en uvre des systmes;
dsigner des gestionnaires de biens responsables au sein de
lAdministration locale;
recenser et classer des actifs (note 1);
valider les donnes (systmatiquement) et rgler les questions;
valuer et tablir les pratiques de gestion des actifs.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 99 de 114
tape 4 Dterminer les soldes douverture :
tablir des mthodes visant obtenir de linformation sur le cot
historique ou le cot historique estimatif;
obtenir le cot historique (note 2);
estimer le cot historique en employant dautres mthodes
dvaluation (note 3).
En
perma-
nence
Questions dinformation permanentes :
consigner en dossier tous les mouvements dactifs au cours de
lexercice ainsi que les informations devant tre communiques
(note 4);
calculer lamortissement;
valuer rgulirement ltat des immobilisations, lestimation des
dures de vie utile et les taux damortissement;
valuer rgulirement sil y a eu moins-value des immobilisations.
Note 1 :
Pour tenir un registre dactifs, lAdministration locale doit :
sassurer que tous les actifs potentiels sont identifis compltement au moyen de
ce qui suit :
o dfinitions des immobilisations corporelles;
o critres de constatation;
o seuils dinscription lactif;
recueillir des donnes sur les actifs existants :
o description de lactif;
o identification des catgories dactifs et des composantes;
o vrification des titres de proprit sil y a lieu;
o identification des restrictions/srets grevant la proprit;
o anne dacquisition;
o dure de vie utile au moment de lacquisition;
o valuation de ltat et de la dure de vie utile rsiduelle;
o tablissement des heures dutilisation, de la production ou du kilomtrage
cumulatif, sil y a lieu;
o identification des amliorations importantes apportes aux immobilisations
(date et dure de vie utile estimative de lamlioration);
o valeur rsiduelle estimative.
Note 2 :
Le collationnement des donnes sur le cot historique comprend le relev de tous les
cots permettant de mettre en service limmobilisation et de toutes les amliorations
depuis son acquisition.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 100 de 114
Note 3 :
Lestimation du cot historique comprend lvaluation de toutes les immobilisations au
moyen de lune des mthodes dvaluation acceptables (cot de reconstitution en dollars
non indexs, cot de remplacement en dollars non indexs, etc.). Lvaluation des actifs
comprend ce qui suit :
dcider sil convient dvaluer tous les actifs ou un chantillon;
dsigner les valuateurs appropris pour chacune des catgories dactifs;
prparer des instructions lintention des valuateurs;
recueillir linformation demande par les valuateurs;
prvoir lexamen des valeurs estimatives par la direction.
Note 4 :
Ltablissement des soldes douverture pour des immobilisations corporelles nest que la
premire tape du processus de comptabilisation et de prsentation des immobilisations
corporelles. Les autres tapes sont les suivantes :
tablissement des soldes de clture;
relev de tous les mouvements survenus au cours de la priode;
calcul de lamortissement;
dtermination des questions de vrification et laboration des plans visant rgler
ces questions;
mise au point et essai des interfaces entre le registre des actifs et le grand livre
gnral;
collecte des autres renseignements sur les immobilisations qui doivent tre
prsents dans les tats financiers.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 101 de 114
ANNEXE C
Exemple de politique sur les immobilisations corporelles
Avertissement :
La prsente politique nest pas exhaustive et a pour seul objet de fournir des exemples de
types de biens susceptibles dtre viss par une politique standard sur les immobilisations
corporelles. Elle ne doit tre utilise qu titre indicatif dans le cadre de la rdaction
dune politique sur les immobilisations dune Administration locale. Les politiques
relles et leur contenu sont fonction de la taille de lAdministration locale, de ses
objectifs spcifiques en ce qui a trait la comptabilisation des immobilisations
corporelles, de sa situation, etc.
Ville de XYZ
OBJET : Comptabilisation des immobilisations corporelles
TYPE : Politique administrative N
o
DE POLITIQUE : XXXXXX-06
AUTORIT : Trsorier de la ville
OBJET :
La prsente politique a pour objet de prescrire le traitement comptable des
immobilisations corporelles afin que les utilisateurs du rapport financier puissent
discerner linformation sur les investissements en immobilisations corporelles et sur les
variations de ces investissements. Les principales questions lies la comptabilisation
des immobilisations corporelles sont la comptabilisation des biens, la dtermination de
leur valeur comptable et des charges damortissement ainsi que la constatation des
rductions de valeur connexes, sil en est.
La politique porte galement sur les procdures visant :
a) protger et contrler lutilisation de toutes les immobilisations corporelles;
b) tablir le processus de reddition de comptes lgard des immobilisations
corporelles;
c) recueillir linformation ncessaire ltablissement des tats financiers et la tenir
jour.
CHAMP DAPPLICATION :
La prsente politique sapplique tous les services, conseils et commissions, bureaux et
autres organismes de la ville qui entrent dans le primtre comptable de la ville.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 102 de 114
DFINITIONS
Immobilisations corporelles
Actifs ayant une existence matrielle :
a) qui sont utiliss de faon durable dans le cadre des activits de la ville;
b) dont la dure de vie utile stend au-del dun exercice;
c) qui ne sont pas destins tre vendus dans le cours normal des activits.
Amliorations
Cots ultrieurs engags pour des immobilisations corporelles en vue :
daugmenter la capacit de production physique ou de service estime
antrieurement;
de rduire les frais de fonctionnement y affrents;
de prolonger la dure de vie utile de limmobilisation; ou
damliorer la qualit des extrants.
Toutes les autres dpenses sont au titre des rparations et de lentretien et sont passes
dans les charges de lexercice.
Classes homognes dactifs
Les immobilisations qui, prises individuellement, ont une valeur infrieure au seuil
dinscription lactif, mais qui, prises collectivement, ont une valeur importante sont
habituellement comptabilises comme un actif unique, ayant une seule valeur combine.
Mme si un seul actif est comptabilis dans les systmes financiers, chaque pice
dimmobilisation composant cet actif peut tre enregistre dans le registre des actifs aux
fins du suivi et du contrle de lutilisation et de lentretien. Exemples : ordinateurs
personnels, mobilier et agencements, petits appareils transportables, etc.
Juste valeur
Montant de la contrepartie dont conviendraient des parties comptentes agissant en toute
libert dans des conditions de pleine concurrence.
Contrat de location-acquisition
Contrat de location ayant pour effet de transfrer la ville la quasi-totalit des avantages
et des risques inhrents la proprit du bien lou. Pour que la quasi-totalit des
avantages et des risques inhrents la proprit soient transfrs au preneur, au moins
lune des conditions suivantes doit tre remplie :
a) il existe une assurance raisonnable que la ville accdera la proprit du bien lou
au terme de la dure du bail;
b) la dure du bail est telle que la ville jouira de la quasi-totalit des avantages
conomiques que lon prvoit pouvoir tirer de lutilisation du bien au cours de sa
dure de vie.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 103 de 114
c) le bailleur est assur, en raison du bail, de rcuprer le capital investi dans le bien
lou et de gagner un rendement sur cet investissement.
NONCS DE PRINCIPES
Inscription lactif
Les immobilisations corporelles doivent tre inscrites lactif (consignes dans le grand
livre auxiliaire des immobilisations corporelles) en fonction des seuils suivants :
a) tous les terrains;
b) tous les btiments;
c) les rseaux dinfrastructure (actifs construits comme les routes, les ponts, les
gouts, le rseau dalimentation en eau, le transport en commun, les parcs, etc.)
dont le cot unitaire est dau moins 25 000 $;
d) tous les autres biens dont le cot unitaire est dau moins 5 000 $.
Des seuils diffrents peuvent tre utiliss pour les classes homognes dactifs. Les
amliorations sont inscrites lactif au titre des immobilisations existantes quand le cot
unitaire est suprieur au seuil tabli.
Catgories
Une catgorie dactif est un ensemble de biens de mme nature ou fonction dans le cadre
des activits de la ville. Les catgories utilises par la ville sont les suivantes :
terrains;
btiments;
matriel;
routes;
eau;
gout;
ponts;
rseaux de communication;
matriel roulant;
mobilier et agencements;
rseaux informatiques (matriel et logiciel).
valuation
Les immobilisations corporelles doivent tre comptabilises au cot, major des frais
accessoires ncessaires pour les amener lendroit et dans ltat o elles doivent se
trouver aux fins de leur utilisation prvue.
1.1 Immobilisations acquises
Le cot correspond au montant brut de la contrepartie donne pour acqurir le bien.
Il englobe toutes les taxes et redevances non remboursables, les frais de transport et
de livraison, les frais dinstallation et damnagement du terrain, etc. Il est net de
tout rabais ou remise.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 104 de 114
Le cot des terrains comprend le prix dachat, major des frais juridiques, des frais
denregistrement foncier, des droits de mutation, etc., ainsi que les cots engags
pour prparer le terrain son utilisation prvue (assainissement, dmolition et
amliorations qui font partie du terrain).
Lorsque plusieurs immobilisations corporelles sont acquises dans le cadre dun
achat global, il convient de ventiler le prix dacquisition total entre toutes les
immobilisations corporelles acquises selon leur juste valeur au moment de
lacquisition, ou selon toute autre base raisonnable si la juste valeur ne peut tre
dtermine facilement.
1.2 Immobilisations corporelles acquises, construites, dveloppes ou mises
en valeur
Le cot comprend tous les cots directs (construction, honoraires des architectes et
autres professionnels) rattachs lacquisition, la construction, au dveloppement
ou la mise en valeur de limmobilisation. Les cots lis lchelonnement dans le
temps (conception en interne, inspection, administration et autres) peuvent tre
inscrits lactif, mais pas les frais gnraux dadministration.
Linscription lactif des cots lis lchelonnement dans le temps cesse
lorsquon neffectue plus de travaux de construction, de dveloppement ou de mise
en valeur ou lorsque limmobilisation corporelle se trouve en tat dutilisation.
1.3 Capitalisation des frais financiers
Les cots demprunts engags lorsque lacquisition, la construction et la production
dune immobilisation sont chelonns dans le temps doivent tre capitaliss au titre
du cot de limmobilisation.
La capitalisation des frais financiers commence au moment o les cots sont
engags, o les cots demprunt sont engags et o les activits ncessaires pour
prparer limmobilisation aux fins de son utilisation prvue sont en cours. La
capitalisation des frais financiers doit tre suspendue pendant les priodes au cours
desquelles les activits sont interrompues. La capitalisation doit cesser lorsque la
quasi-totalit des activits ncessaires pour prparer limmobilisation aux fins de
son utilisation prvue ont pris fin. On considre que la quasi-totalit des activits
sont termines lorsquil ne reste que quelques modifications mineures effectuer.
1.4 Dons ou apports dimmobilisations
Le cot des immobilisations reues sous forme de dons ou dapports qui rpondent
aux critres de constatation est considr comme tant gal leur juste valeur la
date du don ou de lapport. Lestimation de la juste valeur peut tre faite au moyen
de valeurs de march ou de valeurs dexpertise. La dtermination du cot peut se
faire en estimant le cot de remplacement. Les frais accessoires doivent tre inscrits
lactif.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 105 de 114
Approche par composantes
Les immobilisations corporelles peuvent tre comptabilises au moyen de lapproche de
lactif unique ou au moyen de lapproche par composantes. Pour dterminer si elle utilise
lapproche par composantes, la ville se fonde sur lutilit quelle retire des informations
obtenues par rapport au cot engager pour runir et tenir jour les informations sur les
composantes.
Les facteurs dont il faut tenir compte pour dterminer sil convient dutiliser lapproche
par composantes sont les suivants :
a) les dures de vie utile et les modes de consommation des principales
composantes, qui sont en gnral trs diffrents de ceux des immobilisations
corporelles qui sy rattachent;
b) la valeur des composantes par rapport celle des immobilisations corporelles
connexes.
Les rseaux dinfrastructure doivent tre comptabiliss selon lapproche par
composantes. Les composantes principales doivent tre regroupes lorsque les
caractristiques des immobilisations, leurs dures de vie utile estimatives ou leurs modes
de consommation sont similaires.
Amortissement
Le cot dune immobilisation corporelle dont la dure de vie est limite, dfalcation faite
de sa valeur rsiduelle, doit tre amorti sur sa dure de vie utile dune manire logique et
systmatique approprie la nature de limmobilisation et son utilisation par la ville. La
mthode damortissement ainsi que lestimation de la dure de vie utile de la fraction non
amortie dune immobilisation corporelle doivent tre rvises priodiquement et
modifies lorsque lopportunit dun changement peut tre clairement tablie.
La dure de vie utile dune immobilisation corporelle correspond normalement la plus
courte des dures physique, technologique, commerciale et juridique.
La ville utilise gnralement la mthode de lamortissement linaire pour calculer la
charge annuelle damortissement. La liste complte des dures de vie utiles estimatives
des immobilisations et des taux damortissement est fournie en annexe. (LAdministration
locale doit dresser la liste des mthodes et taux damortissement appropris pour chaque
catgorie ou classe dimmobilisations, dtermine en fonction de leur nature et de leur
utilisation.) Il incombe aux services, conseils et commissions, bureaux et autres
organismes de la ville dtablir et dutiliser la mthode et le taux damortissement qui
conviennent pour les immobilisations acquises. Il incombe aussi aux services, conseils et
commissions, bureaux et autres organismes dtablir et dutiliser la dure de vie utile
estimative qui convient pour les immobilisations acquises.
Sorties du patrimoine
Les sorties dimmobilisations corporelles qui sont des biens meubles relvent du
directeur du service des achats, moins que ce pouvoir ait t dlgu aux units
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 106 de 114
dexploitation. Les chefs de service doivent prvenir le directeur quand les actifs
deviennent excdentaires pour le fonctionnement.
Les sorties de biens immeubles relvent du service des installations.
Dans le cas des autres immobilisations corporelles construites qui sont mises hors
service, dtruites ou remplaces en raison de leur obsolescence, de leur mise au rebut ou
de leur dmantlement, le chef de service ou son dlgu transmet aux services gnraux
une description des immobilisations vises ainsi que la date de mise hors service, de
destruction ou de remplacement. Les services gnraux sont chargs dajuster les
registres des actifs et les livres comptables et de comptabiliser une perte ou un gain la
sortie dimmobilisations.
Immobilisations corporelles loues
Les contrats de location-acquisition sont comptabiliss en constatant une acquisition
dimmobilisation corporelle et un passif. Les immobilisations corporelles loues sont
comptabilises comme des contrats de location-exploitation quand la valeur actualise
nette des paiements minimums exigibles au titre de la location ou la juste valeur, selon la
moins leve des deux, est infrieure 10 000 $.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 107 de 114
ANNEXE D
Glossaire
Actifs (assets) : ressources conomiques sur lesquelles lAdministration locale exerce un
contrle par suite doprations ou de faits passs, et qui sont susceptibles de lui procurer
des avantages conomiques futurs. Un actif a trois caractristiques essentielles :
a) il reprsente un avantage futur en ce quil pourra, seul ou avec dautres actifs,
contribuer aux flux de trsorerie nets futurs ou la fourniture de biens ou de
services;
b) lAdministration locale est en mesure de contrler laccs cet avantage;
c) lopration ou le fait lorigine du contrle qua lAdministration locale sur cet
avantage a dj eu lieu.
Actifs financiers (financial assets) : lments dactif qui pourraient tre consacrs
rembourser les dettes existantes ou financer des activits futures et qui ne sont pas
destins la consommation dans le cours normal des activits. Les actifs financiers
comprennent les liquidits, les placements, les crances, les stocks destins tre vendus.
Actifs non financiers (non-financial assets) : ils comprennent les immobilisations
corporelles, ainsi que dautres actifs tels que les charges payes davance et les stocks de
fournitures. Ils sont constitus des lments dactif acquis, construits, dvelopps ou mis
en valeur qui sont normalement utiliss pour fournir des services publics, peuvent tre
consomms dans le cours normal des activits et ne sont pas destins tre vendus dans
le cours normal des activits
Amlioration (betterment) : cot engag pour accrotre le potentiel de service dune
immobilisation corporelle. Les amliorations augmentent le potentiel de service (et
peuvent augmenter ou non la dure de vie utile restante de limmobilisation corporelle).
Les dpenses ce titre sont incluses dans le cot de limmobilisation.
Amortissement (amortization ou depreciation accounting) : procdure comptable
consistant rpartir, dune manire logique et systmatique approprie la nature de
limmobilisation et son utilisation, le cot dune immobilisation corporelle, diminu de
sa valeur rsiduelle, en le passant en charges sur la dure de vie utile de limmobilisation.
La charge damortissement est une composante importante du cot associ la prestation
des services de lAdministration locale, quel que soit le mode de financement employ
pour lacquisition des immobilisations corporelles. Il sagit dune procdure se rapportant
la rpartition et non lvaluation.
Amortissement linaire (straight-line amortization) : mthode damortissement
selon laquelle le cot dune immobilisation corporelle, dduction faite de sa valeur
rsiduelle estimative, est rparti sur la dure de vie utile estimative de limmobilisation de
manire donner une charge damortissement constante dun exercice lautre.
Application prospective (prospective application) : La nouvelle convention
comptable nest applique quaux vnements et oprations se produisant aprs la date de
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 108 de 114
la modification et tout solde connexe existant la date du changement. Il ny a pas de
redressement cumulatif de ces soldes.
Application rtroactive avec redressement des tats financiers des
exercices antrieurs (retroactive application with restatement of prior periods) : La
nouvelle convention comptable est applique aux vnements et oprations qui ont eu
lieu antrieurement. Les chiffres relatifs chaque exercice antrieur pour lequel on donne
des tats financiers des fins de comparaison sont redresss en fonction de la nouvelle
convention. Le solde du surplus ou dficit accumul la date douverture du plus ancien
exercice pour lequel on prsente des tats financiers est redress de faon montrer
leffet cumulatif de la modification sur les exercices antrieurs cette date.
Application rtroactive sans redressement des tats financiers des
exercices antrieurs (retroactive application with no restatement of prior periods) :
La nouvelle convention comptable est applique aux vnements et oprations qui ont eu
lieu antrieurement et un redressement cumulatif reprsentant leffet de la modification
de convention comptable sur les exercices antrieurs vient modifier les tats financiers du
dernier exercice. Le redressement cumulatif prend la forme soit dun lment des
rsultats de lexercice soit dun redressement du solde douverture du surplus ou dficit
accumul.
Charge damortissement (amortization expense ou depreciation expense) : charge
dcoulant de la procdure damortissement inscrite lgard dune priode.
Charges (expenses) : elles comprennent les pertes et sont les diminutions des ressources
conomiques, sous forme de sorties de fonds, de diminutions dactifs ou de constitutions
de passifs, qui dcoulent des activits et des oprations de lexercice, ainsi que des
vnements survenus au cours de celui-ci. Les charges comprennent les paiements de
transfert verss sans contrepartie directe. Elles comprennent galement le cot des
ressources qui sont consommes dans le cadre des activits de fonctionnement de
lexercice et qui peuvent tre rattaches ces activits. Par exemple, le cot des
immobilisations corporelles est amorti par passation en charges mesure que les
immobilisations sont utilises pour la ralisation des programmes de lAdministration
locale. Les paiements en remboursement du principal de la dette et les transferts des
services de lAdministration locale compris dans le primtre comptable de
lAdministration locale ne sont pas des charges.
Classe homogne dactifs (group assets) : ensemble de biens de mme nature et
ayant chacun approximativement la mme utilisation et la mme dure de vie utile
prvue. La charge damortissement est calcule au moyen dun taux composite dtermin
en fonction de la dure de vie utile moyenne des diffrents biens composant la classe
dactifs.
Composante (component) : partie dune immobilisation dont le cot est significatif par
rapport au cot total de cette immobilisation. Selon lapproche par composantes, chaque
partie peut avoir une dure de vie utile diffrente et les composantes ayant une dure de
vie diffrente de celle de limmobilisation doivent tre comptabilises de faon distincte.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 109 de 114
Comptabilit par centres de responsabilit (responsibility cost) : comptabilit qui
a pour objet de ventiler les cots en fonction des responsabilits dvolues chaque centre
de responsabilit. Elle est par essence similaire la comptabilit par activits, qui a pour
objet de ventiler les cots en fonction des activits plutt que des responsabilits.
Cot (cost) : montant brut de la contrepartie donne pour acqurir, construire,
dvelopper ou mettre en valeur, ou amliorer une immobilisation corporelle. Le cot
englobe tous les frais directement rattachs lacquisition, la construction, au
dveloppement ou la mise en valeur, ou lamlioration de limmobilisation corporelle,
y compris les frais engags pour amener celle-ci lendroit et dans ltat o elle doit se
trouver aux fins de son utilisation prvue. Le cot des immobilisations corporelles reues
sous forme dapports, y compris celles reues en lieu et place de droits damnagement,
est rput tre gal leur juste valeur la date de lapport. Les subventions dquipement
ne sont pas dduites du cot des immobilisations corporelles auxquelles elles se
rattachent. Le cot dune immobilisation corporelle loue est dtermin en conformit
avec la Note dorientation du secteur public NOSP-2, Immobilisations corporelles loues.
Cots directs (direct costs) : cots diffrentiels engags par une Administration locale
pour lacquisition, la construction, le dveloppement ou la mise en valeur dune
immobilisation corporelle. Les frais directs ne sont engags quaux fins de lacquisition,
de la construction, du dveloppement ou de la mise en valeur de limmobilisation
corporelle. Exemples de frais directs : salaires et charges sociales, matires premires et
fournitures, matriel, btiments de chantier temporaires, frais juridiques et autres
honoraires.
Cots indirects (indirect costs) : cots engags dans un but commun ou conjoint qui
ne peuvent, par consquent, tre imputs immdiatement et spcifiquement une activit
lie lacquisition, la construction, le dveloppement ou la mise en valeur dune
immobilisation corporelle. Exemples : salaires de la direction, frais doccupation des
immeubles administratifs, services gnraux (comptabilit, paie, services juridiques,
technologie, etc.), frais gnraux de lAdministration locale.
Cots indirects directement attribuables (directly attributable overhead costs) :
cots diffrentiels engags directement pour les activits techniques et administratives
lies la construction dune immobilisation corporelle. Ces frais peuvent comprendre les
salaires et les avantages sociaux du personnel interne affect la conception du projet de
construction, mais ils ne comprennent pas une attribution au titre des frais fixes engags
par les Administrations locales comme les frais doccupation du service de conception ou
une attribution au titre des frais des services gnraux comme les ressources humaines,
les services juridiques, lapprovisionnement et la comptabilit. Ces derniers frais sont
engags que le projet de construction soit ou non entrepris et, par consquent, ne sont pas
des frais indirects diffrentiels directement attribuables au projet. Voir aussi les
dfinitions de frais directs et de frais indirects.
Cots lis lchelonnement dans le temps (carrying costs) : comprennent les
cots directement rattachs lacquisition, la construction, au dveloppement ou la
mise en valeur de limmobilisation lorsque, du fait de la nature de l'immobilisation, son
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 110 de 114
acquisition, sa construction, son dveloppement ou sa mise en valeur sont chelonns
dans le temps. Ces cots comprennent habituellement :
les cots du travail technique et administratif effectu avant le dbut et au cours
de la construction;
les frais indirects directement rattachs la construction ou la mise en valeur;
les intrts dbiteurs.
Dure de vie utile (useful life) : priode estimative pendant laquelle une
immobilisation corporelle est cense servir l'Administration locale, ou nombre estimatif
dunits de production (ou dunits analogues) que lAdministration locale pourra tirer de
limmobilisation corporelle. La dure de vie dune immobilisation corporelle ne se limite
pas ncessairement sa dure de vie utile pour lAdministration locale. Les
immobilisations corporelles, sauf les terrains, ont une dure de vie limite qui correspond
normalement la plus courte des dures physique, technologique, commerciale et
juridique.
Entretien et rparations (maintenance and repairs) : cot permettant de maintenir le
potentiel de service prdtermin dune immobilisation corporelle pendant une dure de
vie utile donne. Les dpenses ce titre sont passes en charges dans lexercice au cours
duquel elles sont faites.
Gains (gains) : revenus pouvant dcouler doprations et dvnements priphriques ou
accessoires qui ont un effet sur lAdministration locale. Ces oprations et vnements
peuvent notamment revtir la forme dune cession dactifs acquis dans le but dtre
utiliss et non revendus, et du rglement ou du refinancement dune dette.
Immobilisations corporelles (tangible capital assets) : actifs non financiers ayant
une existence matrielle :
qui sont destins tre utiliss pour la production ou la fourniture de biens, pour
la prestation de services ou pour ladministration, tre donns en location des
tiers, ou bien servir au dveloppement ou la mise en valeur, la construction,
lentretien ou la rparation dautres immobilisations corporelles;
dont la dure conomique stend au-del dun exercice;
qui sont destins tre utiliss de faon durable;
qui ne sont pas destins tre vendus dans le cours normal des activits.
Juste valeur (fair value) : selon les normes comptables, montant pour lequel un actif
serait chang ou un passif serait rgl et dont conviendraient des parties comptentes
agissant en toute libert dans des conditions de pleine concurrence.
Mthode de la comptabilit dexercice intgrale (Full accrual basis of
accounting) : mthode qui consiste constater leffet financier des oprations et des faits
dans lexercice au cours duquel les oprations ont t ralises et les vnements sont
survenus, quil y ait eu ou non transfert dune contrepartie en trsorerie ou en quivalents
de trsorerie. Selon cette mthode, les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan
(tat de la situation financire) au cot historique et passes en charges (amorties) dans
les rsultats de fonctionnement annuels sur leur dure de vie utile estimative.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 111 de 114
Modle de prsentation de linformation des Administrations locales (local
government reporting model) : sentend de lensemble de rgles, de paramtres et
dexigences de contenu qui prescrit ce qui doit tre prsent dans les tats financiers
condenss. Le modle prescrit le nombre et le type dtats financiers publier, leur
forme, linformation quils devraient prsenter, le moment et la faon de prsenter cette
information, ainsi que les notes ncessaires pour expliquer les lments prsents dans les
tats financiers. Il fixe les rgles suivre pour tablir les comptes de lAdministration
locale.
Moins-value (asset impairment) : tat qui survient lorsque la conjoncture indique
quune immobilisation corporelle ne contribue plus la capacit de lAdministration
locale de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages conomiques
futurs qui se rattachent limmobilisation corporelle est infrieure sa valeur comptable
nette.
Passifs (liabilities) : obligations actuelles dune Administration locale envers des tiers,
qui rsultent doprations ou dvnements passs et dont le rglement prvu donnera
lieu une sortie future de ressources reprsentatives davantages conomiques. Les
passifs ont trois caractristiques essentielles :
a) ils reprsentent un engagement ou une responsabilit envers des tiers qui ne laisse
que peu ou pas de pouvoir discrtionnaire lAdministration locale pour se
soustraire au rglement de lobligation;
b) lengagement ou la responsabilit envers des tiers entrane un rglement futur, par
transfert ou utilisation dactifs, fourniture de biens ou prestation de services ou
toute autre cession davantages conomiques, une date dtermine ou
dterminable, lorsque surviendra un vnement prcis, ou sur demande;
c) les oprations ou vnements lorigine de lobligation de lAdministration locale
se sont dj produits.
Pertes (losses) : charges pouvant dcouler doprations et de faits priphriques ou
accessoires qui ont un effet sur lAdministration locale. Ces oprations et faits peuvent
notamment revtir la forme dune cession dactifs acquis dans le but dtre utiliss et non
revendus, et du rglement ou du refinancement dune dette.
Potentiel de service (service potential) : capacit de production ou de service dune
immobilisation corporelle, cette capacit tant normalement dtermine en fonction
dattributs tels que la capacit de production physique, la qualit des extrants, les frais de
fonctionnement y affrents et la dure de vie utile.
Rduction de valeur (write-down) : rduction opre sur la valeur comptable dune
immobilisation corporelle afin de rendre compte dune moins-value durable.
Revenus (revenues) : ils comprennent les gains et peuvent tre gnrs par la
perception de taxes ou dimpts, la vente de biens, la prestation de services, lutilisation
de certaines ressources de lAdministration locale par des tiers moyennant un loyer, des
intrts, des redevances ou des dividendes, ou par la rception dapports tels que des
subventions, des dons et des legs. Ils ne comprennent pas les produits provenant
demprunts, comme les produits dcoulant de lmission de titres de crances, les
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 112 de 114
transferts provenant des services de lAdministration locale compris dans le primtre
comptable de lAdministration locale.
Seuil dinscription lactif (capitalization threshold ou recognition threshold) :
valeur au-dessus de laquelle un lment est inscrit lactif et prsent dans les tats
financiers.
Valeur comptable (carrying amount) : montant pour lequel une immobilisation
corporelle est comptabilise, dduction faite de lamortissement cumul et des rductions
de valeur cumules.
Valeur comptable nette dune immobilisation corporelle (net book value of a tangible
capital asset) : cot de limmobilisation diminu de lamortissement cumul et du
montant de toutes les rductions de valeur dont elle a fait lobjet.
Valeur de march (market value) : Montant estimatif pour lequel un bien serait
chang et dont conviendraient, la date dvaluation, un acheteur et un vendeur
comptents agissant en toute libert et prudemment dans des conditions normales de
concurrence.
Valeur rsiduelle (residual value) : valeur de ralisation nette estimative dune
immobilisation corporelle la fin de sa dure de vie utile pour lAdministration locale.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 113 de 114
Bibliographie
Australian Accounting Standards Board, Accounting Standard AASB 116, Property,
Plant and Equipment (version modifie), http://www.aasb.com.au/.
Governmental Accounting Standards Board (Etats-Unis), GASB Implementation
Guide, chapitre 7 : Statement No. 34, Basic Financial Statements and
Managements Discussion and Analysis for State and Local Government
(version modifie et prises de positions connexes), (disponible sur abonnement
payant), http://www.gasb.org/repmodel/index.html;
Local Governmental Accounting Standards Board, Statement No. 34,Basic
Financial Statements and Managements Discussion and Analysis for State and
Local government (disponible sur abonnement payant),
http://www.gasb.org/repmodel/index.html;
Gruenwald, Paul. E., Local Governmental Accounting Focus; Estimating Useful
lives for Capital Assets, GAAFR Review, octobre 2001,
http://www.gfoa.org/services/gaafr/GAAFRmay-2002-
focusarticle.pdf#search=%22estimating%20useful%20lives%20for%20capital%2
0assets%22.
International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting
Standards, IAS 16, Immobilisations corporelles (disponible sur abonnement
payant), http://www.iasb.org/standards/summaries.asp.
International Federation of Accountants, International Public Sector Accounting
Standards Board, IPSAS 17, Immobilisations corporelles (disponible sur
abonnement payant), http://www.ifac.org/PublicSector/#Guidance;
Study 14, Transition to the Accrual basis of Accounting: Guidance for Local
governments and Local government Entities, 2
e
dition, chapitre 6
(tlchargement gratuit ladresse
http://www.ifac.org/Store/Details.tmpl?SID=102026702640546).
LInstitut Canadien des Comptables Agrs, Comptabilisation des infrastructures
dans le secteur public (Rapport de recherche), Toronto, 2002;
Comptabilisation et prsentation des biens durables des gouvernements (tude
de recherche), Toronto, 1989.
Province de la Saskatchewan, Manuel de gestion financire,
http://www.gov.sk.ca/finance/FAM/manual.html.
Ville dEdmonton (Alberta), Canada,
http://www.edmonton.ca/portal/server.pt?open=space&name=CommunityPage&i
d=cached&psname=CommunityPage&psid=0&in_hi_userid=2&cached=true&co
ntrol=SetCommunity&CommunityID=220&PageID=0.
Guide de comptabilisation et de prsentation
des immobilisations corporelles
Indications lintention des Administrations locales et des entits des Administrations locales
qui appliquent le Manuel de comptabilit de lICCA pour le secteur public
Page 114 de 114
Ville de Hamilton (Ontario), Canada,
http://www.myhamilton.ca/myhamilton/CityandLocal
government/CityDepartments/PublicWorks/CapitalPlanning/Asset+Management.
htm.
Autres informations utiles
Associations de municipalits :
Ontario Municipal CAO's Benchmarking Initiative (OMBI),
http://www.ombi.ca/accounting.asp.
The Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers (AMCTO),
http://www.amcto.com/db/assetmgmt.asp.
Estimation de la dure de vie utile des immobilisations,
http://www.imtausa.org/polGASBusefulLife.doc.
Exemples de politques (mthodes),
http://policy.ciu10.com/article.php?story=20040514120229415,
http://mainegov-images.informe.org/osc/pdf/saammanual/ch30capitalassets.pdf.
Indices de prix, http://www.fhwa.dot.gov/programadmin/pt2006q1.cfm.
Vous aimerez peut-être aussi
- Bien Voir Pour Mieux Gérer, Le LivreDocument7 pagesBien Voir Pour Mieux Gérer, Le LivreYassine Meziane33% (3)
- Mémoire MASTER 2 Communication Des Entreprises - NASSARA Joenny IssaDocument79 pagesMémoire MASTER 2 Communication Des Entreprises - NASSARA Joenny Issaideas4 real89% (9)
- Compte Rendu Du Conseil Des Ministres - Mercredi 7 Juin 2017Document12 pagesCompte Rendu Du Conseil Des Ministres - Mercredi 7 Juin 2017Fred AliPas encore d'évaluation
- Guide à l'intention des administrateurs: Pouvoirs, devoirs et parcours de performanceD'EverandGuide à l'intention des administrateurs: Pouvoirs, devoirs et parcours de performancePas encore d'évaluation
- Le Cadre ConceptuelDocument50 pagesLe Cadre ConceptuelBrahim BouaichaPas encore d'évaluation
- L'audit ExportDocument306 pagesL'audit ExportAnonymous SVOjPTDIJGPas encore d'évaluation
- Plan de Formation Integrale Sage Paie I7Document3 pagesPlan de Formation Integrale Sage Paie I7Elie fontenel MoubedaPas encore d'évaluation
- AA Gestion Compétence 12 Manuel TPDocument56 pagesAA Gestion Compétence 12 Manuel TPAhmed AllaouiPas encore d'évaluation
- AA GESTION Compétence 12 TFE Manuel FormateurDocument73 pagesAA GESTION Compétence 12 TFE Manuel FormateurAhmed AllaouiPas encore d'évaluation
- VB.NETDocument352 pagesVB.NETJoseph EdwardsPas encore d'évaluation
- Usgaap MicrosoftDocument63 pagesUsgaap MicrosoftAbdelilah MinraouiPas encore d'évaluation
- UCMBusinessPlan2019 PDFDocument116 pagesUCMBusinessPlan2019 PDFWazi-malkia de Mab100% (1)
- Plan Comptable Des OrmvaDocument118 pagesPlan Comptable Des OrmvaMahamane Kamaloudini0% (1)
- Comptabilite Par ActicvitesDocument109 pagesComptabilite Par ActicvitesHiba HoobaPas encore d'évaluation
- Pratique de Silverlight - Conception D'applications Interactives RichesDocument505 pagesPratique de Silverlight - Conception D'applications Interactives RichesAce AhceenPas encore d'évaluation
- GC AAOG T Module 204 Gestion Administrative Du Personnel - STGDocument60 pagesGC AAOG T Module 204 Gestion Administrative Du Personnel - STGasmaerad738Pas encore d'évaluation
- Database JBuilderDocument284 pagesDatabase JBuilderpericlayPas encore d'évaluation
- PME 31 - 2019 Haithem Abdi - VD1Document39 pagesPME 31 - 2019 Haithem Abdi - VD1Alex AlexPas encore d'évaluation
- Manuel de Formation Comptabilite MPMEsDocument153 pagesManuel de Formation Comptabilite MPMEsayissi jean100% (1)
- WebappDocument234 pagesWebappIMANE NAFIRPas encore d'évaluation
- Mise en Oeuvre de L'audit - Support de CoursDocument257 pagesMise en Oeuvre de L'audit - Support de CoursmariamaPas encore d'évaluation
- Gestion de Trésorerie 2Document21 pagesGestion de Trésorerie 2samassafatoumata59Pas encore d'évaluation
- 18 Manuel Des Procedures ComptablesDocument71 pages18 Manuel Des Procedures ComptablesDENIS MEKONTSO FONKAMPas encore d'évaluation
- Un ERP Simple V1 2Document308 pagesUn ERP Simple V1 2najlae alfathiPas encore d'évaluation
- Rapport NBDocument70 pagesRapport NBImpact IdeasPas encore d'évaluation
- Memoire ReductionDesCouts DJARIRI Lowres PDFDocument86 pagesMemoire ReductionDesCouts DJARIRI Lowres PDFFousseni TourePas encore d'évaluation
- Imp Ts Taxes Redevances Et PR L Vement Divers 2022 RCI 1658407459Document117 pagesImp Ts Taxes Redevances Et PR L Vement Divers 2022 RCI 1658407459Lamifi Florel KonanPas encore d'évaluation
- Bilan SMT Agt Service 2022 OkbDocument118 pagesBilan SMT Agt Service 2022 OkblassinabacPas encore d'évaluation
- AllDotBlog Tome 8 Silverlight PDFDocument404 pagesAllDotBlog Tome 8 Silverlight PDFYoussefPas encore d'évaluation
- Memoire DSCGDocument73 pagesMemoire DSCGGuillaumePas encore d'évaluation
- CentralisationDocument9 pagesCentralisationSalmane AbadanePas encore d'évaluation
- La Pratique Du Controle Budgetaire Marsa Maroc PDFDocument122 pagesLa Pratique Du Controle Budgetaire Marsa Maroc PDFLahboub MounaimPas encore d'évaluation
- Impact de La Lite Clients Pour Le Controle de Gestion BancaireDocument73 pagesImpact de La Lite Clients Pour Le Controle de Gestion Bancairedonafifi0% (1)
- Access 2007Document79 pagesAccess 2007Philippe AndrePas encore d'évaluation
- C 'E C 'I S C 'A E: Mémoire en Vue de L'obtention Du Diplôme National D'expert ComptableDocument198 pagesC 'E C 'I S C 'A E: Mémoire en Vue de L'obtention Du Diplôme National D'expert ComptableSoufianePas encore d'évaluation
- Memo CuteDocument178 pagesMemo Cuteselma yukiPas encore d'évaluation
- Vers Une Gestion Dynamique de La Trésorerie Cas D'un Établissement PublicDocument75 pagesVers Une Gestion Dynamique de La Trésorerie Cas D'un Établissement PublicHamza FadlaPas encore d'évaluation
- Cas SPCDocument4 pagesCas SPCSoukaina MoumenPas encore d'évaluation
- M0017MPTCF06Document84 pagesM0017MPTCF06Amine MJ BouyzemPas encore d'évaluation
- Memoiire Final FokouDocument104 pagesMemoiire Final FokouNANA Emmanuel100% (1)
- Rapport de Sage Comptabilite de HajarDocument20 pagesRapport de Sage Comptabilite de HajarHajarita JaklinePas encore d'évaluation
- PFE TAIR FATIMA ZAHRAE LEAR CorporationDocument77 pagesPFE TAIR FATIMA ZAHRAE LEAR Corporationghazouanianass77Pas encore d'évaluation
- Audit BancaireDocument90 pagesAudit BancaireManassé SalePas encore d'évaluation
- 460-104 Acomba 7 PDFDocument366 pages460-104 Acomba 7 PDFpetitfm100% (1)
- Rapport Audit Des StocksDocument28 pagesRapport Audit Des Stocksayoub safrouiPas encore d'évaluation
- Introduction Gestion PortefeuilleDocument2 pagesIntroduction Gestion Portefeuillebencharki100% (1)
- Normes Comptables InternationalesDocument23 pagesNormes Comptables InternationalesRachid MaghniwiPas encore d'évaluation
- Module 4 Operations Specifiques 270418 PPTX (1) - Ilovepdf-CompressedDocument545 pagesModule 4 Operations Specifiques 270418 PPTX (1) - Ilovepdf-Compresseds53267485Pas encore d'évaluation
- Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc BnaDocument255 pagesControle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc BnamadjidaknPas encore d'évaluation
- Cours Gestion ComptableDocument21 pagesCours Gestion Comptablezakariae elazzouziPas encore d'évaluation
- PDF Sdi Definitif Dgat Et PFDocument68 pagesPDF Sdi Definitif Dgat Et PFElkanouni MohamedPas encore d'évaluation
- Medaf UQUAMDocument39 pagesMedaf UQUAMAbdeladim Baâllal0% (1)
- Yooz LivreBlanc 2016-04 HorecaDocument12 pagesYooz LivreBlanc 2016-04 HorecaJames DjomouPas encore d'évaluation
- Cours Comptabilité Générale Suite (Supports Comptables Et Facturation)Document115 pagesCours Comptabilité Générale Suite (Supports Comptables Et Facturation)Anonymous MbYmehoZgxPas encore d'évaluation
- La Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerD'EverandLa Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Diversité en milieu de travail: de l'exclusion à l'inclusionD'EverandDiversité en milieu de travail: de l'exclusion à l'inclusionPas encore d'évaluation
- Les Défis des PME du Sud et du Nord: Vers leur développement durableD'EverandLes Défis des PME du Sud et du Nord: Vers leur développement durablePas encore d'évaluation
- Je ne sais rien... mais je dirai tout!: Mémoires d'un relationnisteD'EverandJe ne sais rien... mais je dirai tout!: Mémoires d'un relationnistePas encore d'évaluation
- Voitures de société et mobilité durable: Diagnostic et enjeuxD'EverandVoitures de société et mobilité durable: Diagnostic et enjeuxPas encore d'évaluation
- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation
- Capital humain: Libérer le capital humain, la voie de la prospérité et de l’innovationD'EverandCapital humain: Libérer le capital humain, la voie de la prospérité et de l’innovationPas encore d'évaluation
- Guide D'audit Financier de La CDCDocument66 pagesGuide D'audit Financier de La CDCtanaa.ouatiqPas encore d'évaluation
- Ra 2022Document96 pagesRa 2022Martin PrillardPas encore d'évaluation
- Séance 2 Larchivage Des DocumentsDocument21 pagesSéance 2 Larchivage Des DocumentsPROVIDENTIAL CONSULTING100% (1)
- Cours BDD (MCD - MLD)Document83 pagesCours BDD (MCD - MLD)Georges Le Mignon Ole100% (1)
- Cours 2021 Lcomu1125Document3 pagesCours 2021 Lcomu1125Agaba AzontoPas encore d'évaluation
- Mise en Place D'une Application Client Serveur de Gestion D'un CybercaféDocument65 pagesMise en Place D'une Application Client Serveur de Gestion D'un CybercaféHarouna CoulibalyPas encore d'évaluation
- AO Management de ProjetDocument27 pagesAO Management de ProjetAdil KhalilPas encore d'évaluation
- AESTQ Cahier de Science Fiche Pedagogique 31564Document3 pagesAESTQ Cahier de Science Fiche Pedagogique 31564MemeSs31Pas encore d'évaluation
- Sujet06 Portrait MP2021Document3 pagesSujet06 Portrait MP2021felix issaPas encore d'évaluation
- Monitoring and Evaluation Guide FRDocument160 pagesMonitoring and Evaluation Guide FRDaaray Cheikhoul XadimPas encore d'évaluation
- ChapitreFabbe-Costes 2007 LogistiqueDocument26 pagesChapitreFabbe-Costes 2007 LogistiqueAmine NejjariPas encore d'évaluation
- FG Revue PresseDocument2 pagesFG Revue PresseambinintsoaPas encore d'évaluation
- Rapport EDIDocument25 pagesRapport EDIZakii Ben100% (1)
- Essai D'analyse de L'impact Des Technologies de L'information Et deDocument212 pagesEssai D'analyse de L'impact Des Technologies de L'information Et detebibhanane560Pas encore d'évaluation
- TSDI - Programme de Formation - 03-2006Document107 pagesTSDI - Programme de Formation - 03-2006Said MouradiPas encore d'évaluation
- M01-Situation Au Regard Du Métier Et de La Démarche de Forma BTP-TSGTDocument51 pagesM01-Situation Au Regard Du Métier Et de La Démarche de Forma BTP-TSGTMacrem MacremPas encore d'évaluation
- Sarra Fatima AbbaciDocument158 pagesSarra Fatima AbbaciaamalPas encore d'évaluation
- 1.LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS (Document18 pages1.LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS (Cliff Daniel DIANZOLE MOUNKANAPas encore d'évaluation
- Comptabilite Des OiDocument58 pagesComptabilite Des OiArou N'aPas encore d'évaluation
- Si Portnet Scm1Document23 pagesSi Portnet Scm1Hicham ZahlouPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument95 pagesAudit Comptable Et FinancierHicham Messid0% (1)
- Industries Laitieres Et Des Corps GrasDocument38 pagesIndustries Laitieres Et Des Corps GrasassmilerPas encore d'évaluation