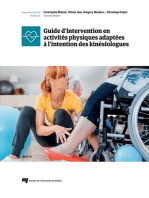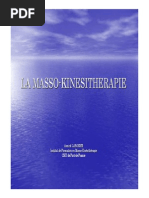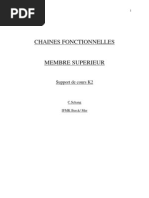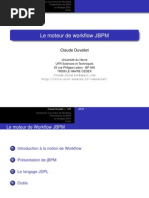Coif Rot Rap
Coif Rot Rap
Transféré par
Jedidi AmirDroits d'auteur :
Formats disponibles
Coif Rot Rap
Coif Rot Rap
Transféré par
Jedidi AmirTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Coif Rot Rap
Coif Rot Rap
Transféré par
Jedidi AmirDroits d'auteur :
Formats disponibles
PATHOLOGIES NON OPEREES
DE LA COIFFE DES ROTATEURS
ET MASSO-KINESITHERAPIE
A VRIL 2001
Service des recommandations et rfrences professionnelles
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procds, rservs pour tous pays.
Toute reproduction ou reprsentation intgrale ou partielle, par quelque procd que ce soit du prsent ouvrage, faite
sans l'autorisation de l'ANAES est illicite et constitue une contrefaon. Conformment aux dispositions du Code de la
proprit intellectuelle, seules sont autorises, d'une part, les reproductions strictement rserves l'usage priv du
copiste et non destines une utilisation collective et, d'autre part, les courtes citations justifies par le caractre
scientifique ou d'information de l'uvre dans laquelle elles sont incorpores.
Ce document a t ralis en Avril 2001 ; il peut tre command (frais de port compris) auprs de :
lAgence Nationale dAccrditation et dvaluation en Sant (ANAES)
Service Communication et Diffusion
159, rue Nationale - 75640 Paris cedex 13 - Tl. : 01 42 16 72 72 - Fax : 01 42 16 73 73
2001, Agence Nationale dAccrditation et dvaluation en Sant (ANAES)
I.S.B.N.
Prix net
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-2 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
AVANT-PROPOS
La mdecine est marque par laccroissement constant des donnes publies et le dveloppement
rapide de nouvelles techniques qui modifient constamment les stratgies de prise en charge
prventive, diagnostique et thrapeutique des malades. Ds lors, il est trs difficile pour chaque
professionnel de sant dassimiler toutes les informations nouvelles apportes par la littrature
scientifique, den faire la synthse critique et de lincorporer dans sa pratique quotidienne.
LAgence Nationale dAccrditation et dvaluation en Sant (ANAES), qui a succd lAgence
Nationale pour le Dveloppement de lvaluation Mdicale (ANDEM), a notamment pour mission
de promouvoir la dmarche dvaluation dans le domaine des techniques et des stratgies de prise
en charge des malades, en particulier en laborant des recommandations professionnelles.
Les recommandations professionnelles sont dfinies comme des propositions dveloppes
mthodiquement pour aider le praticien et le patient rechercher les soins les plus appropris dans
des circonstances cliniques donnes . Leur objectif principal est de fournir aux professionnels de
sant une synthse du niveau de preuve scientifique des donnes actuelles de la science et de
lopinion dexperts sur un thme de pratique clinique, et dtre ainsi une aide la dcision en
dfinissant ce qui est appropri, ce qui ne lest pas ou ne lest plus, et ce qui reste incertain ou
controvers.
Les recommandations professionnelles contenues dans ce document ont t labores par un groupe
multidisciplinaire de professionnels de sant, selon une mthodologie explicite, publie par
lANAES dans le document intitul : Les Recommandations pour la Pratique Clinique - Base
mthodologique pour leur ralisation en France 1999 .
Le dveloppement des recommandations professionnelles et leur mise en application doivent
contribuer une amlioration de la qualit des soins et une meilleure utilisation des ressources.
Loin davoir une dmarche normative, lANAES souhaite, par cette dmarche, rpondre aux
proccupations de tout professionnel de sant soucieux de fonder ses dcisions cliniques sur les
bases les plus rigoureuses et objectives possibles.
Professeur Yves MATILLON
Directeur gnral de l ANAES
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-3 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Les recommandations pour la pratique clinique sur le thme Pathologies non opres de
la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie ont t labores par lAgence Nationale
dAccrditation et dvaluation en Sant la demande de lAssociation Franaise de
Recherche et dvaluation en Kinsithrapie, avec la participation de reprsentants de :
lAssociation Franaise de Recherche et dvaluation en Kinsithrapie ;
la Socit Franaise de Chirurgie Orthopdique et Traumatologique ;
la Socit Franaise de Rducation Fonctionnelle, de Radaptation et de Mdecine
Physique ;
la Socit Franaise de Rhumatologie ;
la Socit Franaise de Traumatologie du Sport ;
la Socit Franaise de Radiologie et dImagerie Mdicale.
La mthode de travail utilise a t celle dcrite dans le guide Recommandations pour la
pratique clinique Bases mthodologiques pour leur ralisation en France 1999 publi
par lAgence Nationale dAccrditation et dvaluation en Sant.
Lensemble du travail a t coordonn par M. Pierre TRUDELLE, chef de projet, sous la
responsabilit de M. le Dr Patrice DOSQUET, responsable du service recommandations et
rfrences professionnelles.
La recherche documentaire a t effectue par Mme Emmanuelle BLONDET, avec laide
de Mlle Sylvie LASCOLS.
Le secrtariat a t ralis par Mlle Isabelle LE PUIL.
LAgence Nationale dAccrditation et dvaluation en Sant tient remercier les
membres du comit dorganisation, les membres du groupe de travail, les membres du
groupe de lecture et les membres du Conseil scientifique qui ont particip la ralisation
de ce travail.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-4 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
COMITE DORGANISATION
M. Patrick COLN, charg de projet,
kinsithrapeute, PARIS
P r Henry COUDANE, chirurgien orthopdiste,
VANDOEUVRE-LS-NANCY
Dr Yves DEMARAIS, rhumatologue, PARIS
M. Marin-Philippe DURAFOURG, kinsithrapeute,
BOULOGNE
P r Olivier GAGEY, prsident, chirurgien
orthopdique, LE KREMLIN-BICTRE
Dr Marc GENTY, mdecine physique et radaptation,
SAINTE-ADRESSE
GROUPE DE TRAVAIL
P r Olivier GAGEY, chirurgien orthopdique, LE KREMLIN-BICTRE Prsident du groupe de travail
M. Patrick COLN, kinsithrapeute, PARIS Charg de projet
M. Pierre TRUDELLE, chef de projet, ANAES
Dr Johann BEAUDREUIL, rhumatologue, PARIS
Dr Yolande ESQUIROL, mdecin du travail,
TOULOUSE
Mme Marie-Thrse FROISSART,
kinsithrapeute, PARIS
P r Philippe HARDY, chirurgien orthopdique,
BOULOGNE
Dr Gilles KEMOUN, mdecine physique et
radaptation, WATTRELOS
M. Patrick LOUVRIER, kinsithrapeute, PARIS
M. Thierry MARC, kinsithrapeute,
MONTPELLIER
Dr Yves MAZAS, mdecine physique et
radaptation, SAINT-SBASTIEN-DE-MORSENT
Dr Pierre MCHALY, gnraliste, CHILLYMAZARIN
M. Philippe SEYRES, kinsithrapeute,
BORDEAUX
Dr Thierry THOMAS, rhumatologue, SAINTTIENNE
M. Jacques VAILLANT, kinsithrapeute,
CHIROLLES
GROUPE DE LECTURE
P r Bernard AUGEREAU chirurgien orthopdique,
PARIS
Dr Andr AUTHIER, mdecine physique et
radaptation, RENNES-LES-BAINS
P r Thomas BARDIN, rhumatologue, PARIS
Dr Philippe BEAUFILS, chirurgien orthopdique,
LE CHESNAY
Dr BOULATE, chirurgien orthopdique, MASSY
M. Franois BREGEON, kinsithrapeute, PARIS
Dr Jacques CARZON, mdecine physique et
radaptation, SAINT-OUEN
M. Christophe DAUZAC, kinsithrapeute,
PARIS
M.
Julien
DEDEKEN,
kinsithrapeute,
BORDEAUX
Dr Catherine DORMARD, mdecin gnraliste,
LONGJUMEAU
P r Bernard DUQUESNOY, rhumatologue, LILLE
M. Philippe DURAFOURG, kinsithrapeute,
COURBEVOIE
Dr Violaine FOLZ, rhumatologue, PARIS
P r Bernard FOUQUET, mdecine physique et
radaptation, TOURS
Dr Philippe GALLIEN, rducation et radaptation
fonctionnelle, RENNES
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-5 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Dr Jean-Louis GARCIA, mdecine physique et
radaptation, NANCY
M. ric GILBERT, kinsithrapeute, PARIS
M. Pascal GOUILLY, kinsithrapeute, METZ
M. Thierry HAUTEFAYE, kinsithrapeute,
ARS
P r Christian HRISSON, mdecine physique et
radaptation, MONTPELLIER
Dr Jean-Michel HERPE, radiologue, SAINTES
Dr Jean-Nol HEULEU, mdecine physique et
radaptation, PARIS
M. Rmy HIGNET, kinsithrapeute, RENNES
Dr Jean-Louis JULLY, mdecine physique et
radaptation, BAGNRES-DE-BIGORRE
Dr Thierry KAPANDJI, chirurgien orthopdique,
LONGJUMEAU
M. Patrick LE ROUX, kinsithrapeute SAINTSBASTIEN-SUR-LOIRE
Dr Claudie LOCQUET, mdecin gnraliste,
BOURG-DE-PLOURIVO
Dr Philippe MAS, mdecine physique et
radaptation, MANOSQUE
M. Philippe MASSOU, kinsithrapeute, TOURS
M. ric MATHERON kinsithrapeue, DIJON
M. Jean-Pierre MERCIER, kinsithrapeute, MONTDE-MARSAN
Dr Franoise MESNARD, mdecin du travail,
NIORT
Dr Patrice MORRIER, rhumatologue, BORDEAUX
Dr Jean-Louis MOULIN, mdecin gnraliste,
SAINT-JUNIEN
Dr Eric NOEL, rhumatologue, LYON
Serge OLIVARES, kinsithrapeute, MONTREUIL
Jean-Marc OVIVE, kinsithrapeute, PARIS
Dr Jacques PARIER mdecine physique et
radaptation, PARIS
M. Gilles PNINOU kinsithrapeute, PARIS
M. Bernard PETITDANT, kinsithrapeute, NANCY
M.
Michel
POCHOLLE,
kinsithrapeute,
MONTPELLIER
Dr Marie Jeanne TRICOIRE, mdecin gnraliste,
CARNOUX-EN-PROVENCE
Dr Isabelle VANONI, mdecin gnraliste, NICE
M. Philippe VOISIN, kinsithrapeute, LILLEHELLEMMES
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-6 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
SOMMAIRE
M THODE GNRALE............................................................................................................................ 8
STRATGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE....................................................................................... 10
SYNTHSE DES RECOMMANDATIONS .................................................................................................... 12
TEXTE DES RECOMMANDATIONS .......................................................................................................... 14
INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 19
CHAPITRE I - B ILANS ............................................................................................................................ 21
I.
Lvaluation des muscles de la coiffe et les tests de conflits ........................................................................................... 21
II.
Le bilan masso-kinsithrapique ........................................................................................................................................... 23
III.
Tableau de synthse.................................................................................................................................................................. 33
IV.
Fiche de transmission ............................................................................................................................................................... 34
CHAPITRE II - LES TUDES CONCERNANT LA RDUCATION DE L PAULE........................................ 35
I.
Les programmes de traitement masso-kinsithrapiques (tableau 2 ) ......................................................................... 35
II.
Les diffrentes techniques ou concepts (techniques tudies individuellement)....................................................... 40
CHAPITRE III - QUELLE RDUCATION PROPOSER EN FONCTION DU TYPE DE LSION DE LA
COIFFE DES ROTATEURS ? ..................................................................................................................... 53
I.
Dans la tendinopathie calcifiante de la cdr ......................................................................................................................... 53
II.
Dans les tendinopathies simples et dans les ruptures tendineuses de la cdr .............................................................. 53
CHAPITRE IV - PROPOSITIONS DACTIONS FUTURES ........................................................................... 55
ANNEXE 1 EXAMEN DE TYPE CYRIAX ET DIAGNOSTIC DE L PAULE................................................ 56
ANNEXE 2. VALUATION TENDINEUSE DES MUSCLES DE LA COIFFE.................................................... 58
ANNEXE 3. TESTS DE CONFLITS DES MUSCLES DE LA COIFFE DES ROTATEURS ................................... 60
ANNEXE 4. SCORE D VALUATION SCAPULAIRE DE CONSTANT .......................................................... 64
ANNEXE 5. S HOULDERS PAIN SCORE ................................................................................................... 68
ANNEXE 6. EXEMPLE DE FEUILLE DONNE AU PATIENT POUR LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
(DAPRS WIRTH, 1997) (88) ................................................................................................................. 69
RFRENCES .......................................................................................................................................... 71
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-7 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
METHODE GENERALE
Ces recommandations professionnelles ont t labores selon la mthode des recommandations
pour la pratique clinique, publie par lANAES. Les socits savantes concernes par le thme,
runies au sein du comit dorganisation, ont t consultes pour dlimiter le thme de travail,
connatre les travaux raliss antrieurement sur le sujet et proposer des professionnels susceptibles
de participer aux groupes de travail et de lecture. Les recommandations ont t rdiges par le
groupe de travail, au terme dune analyse de la littrature scientifique et dune synthse de lavis
des professionnels consults.
LANAES a constitu un groupe de travail en runissant des professionnels multidisciplinaires,
ayant un mode dexercice public ou priv, et dorigine gographique varie. Ce groupe de travail
comprenait un prsident, qui en a coordonn les travaux, et un charg de projet, qui a identifi,
slectionn, analys et synthtis la littrature scientifique utilise pour rdiger largumentaire et les
recommandations, discutes et labores avec le groupe de travail.
Un groupe de lecture, compos selon les mmes critres que le groupe de travail, a t consult par
courrier et a donn un avis sur le fond et la forme des recommandations, en particulier sur leur
lisibilit et leur applicabilit. Les commentaires du groupe de lecture ont t analyss par le groupe
de travail et pris en compte chaque fois que possible dans la rdaction des recommandations.
Les recommandations ont t discutes par le Conseil scientifique, section valuation, de lANAES,
et finalises par le groupe de travail.
Un chef de projet de l ANAES a coordonn lensemble du travail et en a assur lencadrement
mthodologique.
Une recherche bibliographique automatise a t effectue par interrogation systmatique des
banques de donnes MEDLINE, HealthSTAR, EMBASE, PASCAL et Cochrane Library. En
fonction du thme trait, elle a t complte par linterrogation dautres bases de donnes. Dans un
premier temps, elle a identifi sur une priode de 10 ans les recommandations pour la pratique
clinique, les confrences de consensus, les articles de dcision mdicale, les revues systmatiques et
les mta-analyses concernant le thme tudi. Elle a ensuite t complte par une recherche
dtudes cliniques, publies en langue franaise ou anglaise, pouvant clairer les diffrents aspects
du thme pris en compte. La littrature grise (cest--dire les documents non indexs dans les
catalogues officiels ddition ou dans les circuits conventionnels de diffusion de linformation) a t
systmatiquement recherche (par contacts directs auprs de socits savantes, par Internet ou par
tout autre moyen).
La bibliographie obtenue par voie automatise a t complte par une recherche manuelle. Les
sommaires de revues gnrales et de revues concernes par le thme tudi ont t dpouills sur
une priode de 6 mois pour actualiser linterrogation en ligne des banques de donnes. De plus, les
listes de rfrences cites dans les articles slectionns ont t consultes. Enfin, les membres des
groupes de travail et de lecture ont transmis des articles de leur propre fonds bibliographique. Par
ailleurs, les dcrets, arrts et circulaires du ministre de la Sant pouvant avoir un rapport avec le
thme ont t consults.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-8 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
La stratgie de recherche propre chaque thme de recommandations est prcise dans le chapitre
Stratgie de la recherche documentaire .
Chaque article slectionn a t analys selon les principes de lecture critique de la littrature
laide de grilles de lecture, ce qui a permis daffecter chacun un niveau de preuve scientifique. Sur
la base de cette analyse de la littrature, le groupe de travail a propos, chaque fois que possible, des
recommandations. Selon le niveau de preuve des tudes sur lesquelles elles sont fondes, les
recommandations ont un grade variable, cot de A C selon lchelle propose par l ANAES (voir
tableau). En labsence dtudes, les recommandations sont fondes sur un accord professionnel.
Tableau . Grade des recommandations.
Niveau de preuve scientifique fourni par la Grade des recommandations
littrature (tudes thrapeutiques)
Niveau 1
A
Essais comparatifs randomiss de forte
puissance
Mta-analyse
dessais
comparatifs Preuve scientifique tablie
randomiss
Analyse de dcision base sur des tudes
bien menes
Niveau 2
B
Essais comparatifs randomiss de faible
puissance
tudes comparatives non randomises bien Prsomption scientifique
menes
tudes de cohorte
Niveau 3
tudes cas-tmoins
Niveau 4
tudes comparatives comportant des biais Faible niveau de preuve
importants
tudes rtrospectives
Sries de cas
Des propositions dtudes et dactions futures ont t formules par le groupe de travail.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
-9 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
STRATEGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Recherche automatise :
La recherche documentaire a t ralise par interrogation des banques de donnes MEDLINE ,
HealthSTAR, EMBASE, PEDro, AMED, REDATEL et Pascal. Elle a t limite aux publications
de langue anglaise ou franaise.
La stratgie de recherche a port sur :
Les recommandations pour la pratique clinique, les confrences de consensus, les articles
danalyse de dcision mdicale, les revues de littrature et mta-analyses (de 1990 mai 2000 en
toutes langues).
Les mots-cls initiaux :
Rotator cuff OU Frozen shoulder OU Shoulder dislocation OU Shoulder joint OU Shoulder pain
OU Shoulder impingement syndrome
Ont t croiss :
Guideline(s) OU Practice guideline(s) OU Health planning guidelines OU Consensus development
conferences OU Consensus development conferences, NIH OU Medical decision making OU
Decision support techniques OU Decision trees OU Decision analysis (dans le titre) OU Metaanalysis OU Review literature.
24 rfrences ont t obtenues sur MEDLINE, 10 sur HealthSTAR et 12 sur EMBASE.
Le diagnostic des pathologies de lpaule :
Les mots-cls initiaux ont t associs :
Severity of illness index OU Disability evaluation OU Shoulder assessment (en texte libre)
Reproducibility of results OU Reproducibility OU Physical examination OU Diagnostic value OU
Sensitivity and specificity OU Quality control OU Reference standards OU Diagnostic errors OU
False negative reactions OU False positive reactions OU Observer variation OU Reliability OU
Diagnostic accuracy OU Predictive value of tests OU Quality criter* (texte libre) OU Diagnosis
differential.
197 rfrences ont t obtenues sur MEDLINE, 6 sur HealthSTAR, 21 sur EMBASE et 10 sur
Pascal.
Lutilisation de la kinsithrapie dans les pathologies de lpaule :
Les mots-cls initaux ont t croiss :
Kinesiology OU Rehabilitation medicine OU Kinesiotherapy OU Exercise therapy OU
Physiotherapy OU Physical therapy.
62 rfrences ont t obtenues sur MEDLINE, 5 sur HealthSTAR, 50 sur EMBASE.
21 rfrences ont t retenues sur PEDRo.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 10 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
La littrature franaise sur la coiffe du rotateur sur PASCAL et REDATEL (depuis
1990) :
107 rfrences ont t obtenues sur PASCAL et 33 sur REDATEL
La Banque de donnes AMED a t interroge sur le sujet :
Le mot-cl rotator cuff a t utilis.
54 rfrences ont t retenues.
Recherche manuelle :
Les sommaires des revues suivantes ont t dpouills davril 2000 dcembre 2000
Revues gnrales : Annals of Internal Medicine, Archives of Internal Medicine, British Medical
Journal, Canadian Medical Association Journal, Concours Mdical, JAMA, Lancet, New England
Journal of Medicine, Presse Mdicale, Revues de Mdecine Interne, Revue du Praticien MG.
Revues spcialises : Physical Therapy, Kinsithrapie Scientifique, Annales de Kinsithrapie.
443 articles ont t analyss dont 117 ont t utiliss pour la rdaction des recommandations.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 11 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS
Le terme de pathologie de la coiffe des rotateurs est un terme gnrique qui sous-tend une lsion de
type dgnratif ou traumatique localise lun des tendons de la coiffe des rotateurs (suprapineux, infra-pineux, subscapulaire, petit rond), ses annexes (bourse synoviale) mais aussi la
partie proximale du tendon du chef long du muscle biceps brachial.
La traduction clinique des lsions de la coiffe des rotateurs est le plus souvent une paule
douloureuse avec une impotence fonctionnelle variable suivant latteinte.
Le traitement de cette pathologie est habituellement fonctionnel.
LE BILAN MASSO-KINSITHRAPIQUE
Il apporte deux types de renseignements :
des informations lies l'examen de dbut et de fin de traitement kinsithrapique ;
des informations recueillies au cours des sances de kinsithrapie.
LE BILAN INITIAL ET LE BILAN FINAL
Il est recommand d'apprcier lactivit des muscles de la coiffe avec les manuvres de Jobe pour
le supra-pineux ; de Patte pour les rotateurs externes ; de Gerber ou belly press-test pour le
subscapulaire. Le Palm-up test pour le tendon du long biceps est sujet caution du fait de sa faible
spcificit.
Il est recommand d'effectuer des tests de douleur provoque qui localisent la douleur au sein du
complexe scapulo-humral et permettent den suivre lvolution (Hawkins ; Yocum ; Neer ; Cross
arm).
Il est recommand d'utiliser un score fonctionnel en dbut et en fin de traitement. Le score de
Constant est actuellement largement diffus et utilis.
LE BILAN AU COURS DES SEANCES DE KINESITHERAPIE
Il est recommand de suivre l'volution de la douleur en utilisant une chelle visuelle analogique de
100 mm (EVA).
Il est utile d'tudier les mouvements de la scapula lors des mouvements actifs de l'paule. Si les
mouvements sont limits, il convient d'en tenir compte pour la conduite thrapeutique.
Il est recommand de mesurer les amplitudes actives et passives de manire globale et de mesurer
les amplitudes passives de larticulation scapulo-humrale.
La palpation douloureuse des tendons n'a pas de signification, tant donn le nombre de tissus
douloureux dans la rgion de l'paule dans le contexte d'une lsion de la coiffe des rotateurs.
L'apprciation non instrumentale de la force musculaire est subjective, il est souhaitable de
lobjectiver par l'utilisation de charges ou de dynamomtres.
Une fiche de transmission est adresse au prescripteur en dbut et en fin de traitement. Elle
synthtise les lments lis aux rsultats thrapeutiques. Le score de Constant rassemble les
informations transmettre aux prescripteurs. Si le praticien souhaite utiliser un autre score
fonctionnel, ce score devra comporter des rubriques sur : la douleur, la mobilit, la force, les
activits de la vie quotidienne et les rsultats des tests et manuvres dcrits prcdemment.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 12 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
LE TRAITEMENT KINESITHERAPIQUE
Lintensit de la douleur nest pas directement en relation avec la gravit des lsions. La douleur
nest pas en soi une contre-indication la kinsithrapie, elle doit tre interprte. La mise au repos
et limmobilisation ventuelle de lpaule douloureuse ne sont pas recommandes en dehors des
crises hyperalgiques.
Il existe un effet de la kinsithrapie lorsquelle est compare labsence de traitement ou lors
dtudes de cas.
Il est recommand d'associer en fonction du bilan des techniques antalgiques, articulaires,
musculaires et de reprogrammation neuro-musculaire au cours du traitement.
Leffet des ultrasons ; de llectrothrapie (courant bipolaire basse frquence) ; de
llectromagntothrapie et du laser sur la douleur dans les pathologies de la coiffe des rotateurs
nest pas dmontr. Ces techniques ne sont pas recommandes.
Dans l'tat actuel des connaissances, l'application de froid ou de chaleur ne peut pas tre
recommande au cours du traitement de kinsithrapie. Il sagit dun adjuvant qui ne peut tre
utilis quen dehors des sances.
Les techniques de massage n'ont fait l'objet d'aucune tude. Il s'agit d'un adjuvant aux autres
techniques de kinsithrapie. Le massage transversal profond des tendons de la coiffe des rotateurs
n'est pas recommand.
Les techniques de mobilisations passives, de mobilisations spcifiques, de tenu-relch , d'autotirement appliques l'ensemble des articulations de la ceinture scapulaire (articulation scapulothoracique, scapulo-humrale, sterno-claviculaire, acromio-claviculaire) sont recommandes pour
rcuprer les amplitudes articulaires limites.
Les techniques spcifiques de rducation telles que : le recentrage dynamique de la tte humrale ;
le recentrage passif ; le renforcement des muscles abaisseurs ; la rducation du rythme scapulohumral ou autres ; ont des justifications biomcaniques divergentes. De nouvelles tudes sont
attendues sur les rsultats cliniques de ces techniques spcifiques.
Les techniques de renforcement musculaire ont pour but d'augmenter la force des muscles
scapulaires et plus particulirement celle des muscles rotateurs de la scapulo-humrale et de mieux
stabiliser l'articulation. Il est recommand d'inclure dans tout protocole de kinsithrapie des
techniques de renforcement musculaire.
Q UELLE REEDUCATION EN FONCTION DU TYPE DE LESION ?
Dans le cadre de rupture de la coiffe des rotateurs, l'utilisation de techniques de renforcement des
muscles rotateurs est recommande. En cas d'chec du renforcement il faut mettre en place des
compensations articulaires (surtout scapulo-thoraciques).
Le kinsithrapeute a pour objectif d'amener le patient un niveau fonctionnel en adquation avec
ses activits socio-professionnelles. Si le patient est en arrt de travail il faut lui conseiller de se
mettre en relation avec le mdecin du travail pour organiser prcocement les modalits de la reprise
de ses activits professionnelles.
En l'absence d'amlioration significative du score fonctionnel utilis au terme des 20 premires
sances de kinsithrapie, il est recommand de rvaluer l'indication thrapeutique.
En cas de stagnation des rsultats ou d'aggravation des symptmes, il convient d'informer le
prescripteur.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 13 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
TEXTE DES RECOMMANDATIONS
Le terme de pathologie de la coiffe des rotateurs est un terme gnrique qui sous-tend une lsion de
type dgnratif ou traumatique localise lun des tendons de la coiffe des rotateurs (suprapineux, infra-pineux, subscapulaire, petit rond) et/ou lun de ses annexes (bourse synoviale).
Il englobe galement les atteintes de mme type localises la partie proximale du tendon du chef
long du muscle biceps brachial.
La traduction clinique des lsions de la coiffe des rotateurs est le plus souvent une paule
douloureuse avec une impotence fonctionnelle variable suivant latteinte. Cette impotence peut
voluer favorablement assez spontanment notamment lorsque la question de la douleur est rsolue.
Le traitement de cette pathologie est habituellement fonctionnel.
Ces recommandations excluent la question de la prise en charge des pathologies de la coiffe des
rotateurs secondaires survenant dans un contexte dpaule instable par laxit ligamentaire, ainsi que
celles qui ont t opres.
LE BILAN MASSO-KINSITHRAPIQUE
Il apporte deux types de renseignements :
- des informations lies l'examen de dbut et de fin de traitement kinsithrapique ;
- des informations recueillies au cours des sances de kinsithrapie.
LE BILAN INITIAL ET LE BILAN FINAL
Il est recommand d'apprcier lactivit des muscles de la coiffe avec les manuvres de :
- Jobe pour le supra-pineux ;
- Patte pour les rotateurs externes ;
- Gerber ou belly press-test pour le subscapulaire.
Le Palm-up test pour le tendon du long biceps est sujet caution du fait de sa faible spcificit
(accord professionnel).
Il est recommand d'effectuer des tests de douleur provoque qui localisent la douleur au sein du
complexe scapulo-humral et permettent den suivre lvolution :
- Hawkins ;
- Yocum ;
- Neer ;
- Cross arm.
Il est recommand d'utiliser un score fonctionnel en dbut et en fin de traitement. Le score de
Constant est actuellement largement diffus et utilis (accord professionnel).
LE BILAN AU COURS DES SEANCES DE KINESITHERAPIE
Ce bilan a pour but :
- de choisir les techniques en fonction de ltat du patient ;
- de suivre lvolution de la pathologie ;
- de mesurer les rsultats thrapeutiques.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 14 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
La douleur
Il est recommand de suivre l'volution de la douleur en utilisant une chelle visuelle analogique de
100 mm (EVA) (accord professionnel).
Le bilan de la mobilit
Il est utile d'tudier les mouvements de la scapula lors des mouvements actifs de l'paule. Si les
mouvements sont limits, il convient d'en tenir compte pour la conduite thrapeutique (accord
professionnel).
Il est recommand (accord professionnel) :
- de mesurer les amplitudes actives et passives de manire globale (comparatif et mesure en
degrs) ;
- de mesurer les amplitudes passives de larticulation scapulo-humrale (comparatif et mesure en
degrs).
Le bilan neuro-musculaire
La palpation douloureuse des tendons n'a pas de signification, tant donn le nombre de tissus
douloureux dans la rgion de l'paule dans le contexte d'une lsion de la coiffe des rotateurs (accord
professionnel).
L'apprciation non instrumentale de la force musculaire est subjective, il est souhaitable de
lobjectiver par l'utilisation de charges ou de dynamomtres (accord professionnel).
Un tableau de synthse rsume les informations du bilan masso-kinsithrapique.
Indicateurs de choix
des techniques
Prsence dun arc douloureux
Amplitude articulaire (analytique et
globale)
Apprciation de la mobilit (rythme
scapulo-humral, position de la
scapula en fin dlvation)
Apprciation de la consistance et de
la sensibilit musculaire
Apprciation de la force musculaire
Tests et manuvres
Indicateurs
de surveillance
EVA
Amplitude articulaire (globale
et fonctionnelle)
Prsence dun arc douloureux
Apprciation de la force
musculaire
Tests et manuvres
Indicateurs
de rsultats
Score de Constant
EVA
Amplitude articulaire fonctionnelle
Prsence dun arc douloureux
Geste le plus gnant dans la vie
quotidienne ou professionnelle
Fiche de synthse
Une fiche de transmission (obligatoire par dcret) est adresse au prescripteur en dbut et en fin de
traitement. Elle synthtise les lments lis aux rsultats thrapeutiques. Le score de Constant
rassemble les informations transmettre aux prescripteurs. Si le praticien souhaite utiliser un autre
score fonctionnel, ce score devra comporter des rubriques sur : la douleur, la mobilit, la force, les
activits de la vie quotidienne et les rsultats des tests et manuvres dcrits prcdemment (accord
professionnel).
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 15 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Nom et ge du patient :
Diagnostic mdical :
Rsultats par rubriques du score de constant
Douleur : noter sur 15
Niveau dactivits quotidiennes : noter sur 10
Niveau de travail avec la main : noter sur 10
Mobilit : noter sur 40
Force musculaire : noter sur 25
SCORE TOTAL : noter de 0 100
Valeur fonctionnelle normale selon lge du patient :
Objectifs et propositions thrapeutiques :
Date de
prescription :
Date :
initial
Date :
intermdiaire
Nombre de
sances
effectues :
Date :
final
Commentaires :
LE TRAITEMENT KINESITHERAPIQUE
Lintensit de la douleur nest pas directement en relation avec la gravit des lsions. La douleur
nest pas en soi une contre-indication la kinsithrapie, elle doit tre interprte. La mise au repos
et limmobilisation ventuelle de lpaule douloureuse ne sont pas recommandes en dehors des
crises hyperalgiques (accord professionnel). Il existe un effet de la kinsithrapie lorsquelle est
compare labsence de traitement ou lors dtudes de cas (grade C).
Il est recommand d'associer en fonction du bilan des techniques antalgiques, articulaires,
musculaires et de reprogrammation neuro-musculaire au cours du traitement (accord
professionnel).
Les techniques vise antalgique ou anti-inflammatoire
Certaines de ces techniques de kinsithrapie ont t values individuellement.
Les ultrasons en mode puls
Leffet des ultrasons sur la douleur dans les pathologies de la coiffe des rotateurs nest pas dmontr
(grade C). L'effet des ultrasons sur l'lasticit ou la cicatrisation des tissus reste dmontrer. En
l'tat actuel des connaissances l'utilisation des ultrasons n'est pas recommande.
Llectrothrapie
Leffet de llectrothrapie (courant bipolaire basse frquence) sur la douleur dans les pathologies
de la coiffe des rotateurs nest pas dmontr (grade C). En l'tat actuel des connaissances,
lutilisation de llectrothrapie antalgique dans les pathologies de la coiffe des rotateurs n'est pas
recommande.
Llectromagntothrapie et le low laser
Leffet de llectromagntothrapie et du laser sur la mobilit et la douleur na pas t dmontr
(grade C). En ltat actuel des connaissances lutilisation de l lectromagntothrapie et du low
laser dans les pathologies de la coiffe des rotateurs nest pas recommande.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 16 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Lapplication de chaleur ou de froid
Dans l'tat actuel des connaissances, l'application de froid ou de chaleur ne peut pas tre
recommande au cours du traitement de kinsithrapie. Il sagit dun adjuvant qui ne peut tre
utilis quen dehors des sances (accord professionnel).
Le massage
Les techniques de massage n'ont fait l'objet d'aucune tude. Il s'agit d'un adjuvant aux autres
techniques de kinsithrapie.
Le massage transversal profond des tendons de la coiffe des rotateurs n'est pas recommand (accord
professionnel).
Les techniques vise de gain de mobilit
Les techniques de mobilisations passives, de mobilisations spcifiques, de tenu-relch , d'autotirement appliques l'ensemble des articulations de la ceinture scapulaire (articulation scapulothoracique, scapulo-humrale, sterno-claviculaire, acromio-claviculaire) sont recommandes pour
rcuprer les amplitudes articulaires limites (accord professionnel).
Les techniques spcifiques
Les techniques de rducation telles que :
- le recentrage dynamique de la tte humrale ;
- le recentrage passif ;
- le renforcement des muscles abaisseurs ;
- la rducation du rythme scapulo-humral ou autres ;
ont des justifications biomcaniques divergentes. Le groupe de travail attend des tudes sur les
rsultats cliniques de ces techniques spcifiques.
Le renforcement musculaire
Pratiquement toutes les tudes comparatives comprennent des techniques de renforcement
musculaire dans leurs protocoles. Aucune modalit (concentrique, isomtrique, excentrique,
isocintique) n'a dmontr sa supriorit.
Les techniques de renforcement musculaire ont pour but d'augmenter la force des muscles
scapulaires et plus particulirement les muscles rotateurs de la scapulo-humrale et de mieux
stabiliser l'articulation.
Il est recommand d'inclure dans tout protocole de kinsithrapie des techniques de renforcement
musculaire (accord professionnel).
Q UELLE REEDUCATION EN FONCTION DU TYPE DE LESION ?
Dans le cadre de rupture de la coiffe des rotateurs, l'utilisation de techniques de renforcement des
muscles rotateurs est recommande. En cas d'chec du renforcement il faut mettre en place des
compensations articulaires (surtout scapulo-thoraciques) (accord professionnel).
Le kinsithrapeute a pour objectif d'amener le patient un niveau fonctionnel en adquation avec
ses activits socio-professionnelles. Si le patient est en arrt de travail il faut lui conseiller de se
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 17 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
mettre en relation avec le mdecin du travail pour organiser prcocement les modalits de la reprise
de ses activits professionnelles (accord professionnel).
En l'absence d'amlioration significative du score fonctionnel utilis au terme des 20 premires
sances de kinsithrapie, il est recommand de rvaluer l'indication thrapeutique.
En cas de stagnation des rsultats ou d'aggravation des symptmes, il convient d'informer le
prescripteur (accord professionnel).
CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DACTIONS FUTURES
Le groupe de travail a constat l'absence d'essais randomiss sur la kinsithrapie des pathologies
de la coiffe des rotateurs en France. Il encourage la recherche franaise dans ce domaine.
Le plurimtre de Rippstein est peu disponible en France alors qu'il est couramment utilis dans les
pays anglo-saxons ; il est souhaitable qu'il soit mieux diffus chez nous car il est simple d'utilisation
et rapporte des donnes fiables.
En ce qui concerne les techniques de recentrage, de renforcement des muscles abaisseurs ou de
rducation du rythme scapulo-humral, les rsultats cliniques quelles permettent dobtenir doivent
faire lobjet dtudes comparatives.
La participation du patient son traitement en dehors des sances et lentretien de ce qui a t
acquis larrt du traitement pourrait tre davantage dvelopp. Une rflexion en termes
dducation du patient est mener dans ce domaine.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 18 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
INTRODUCTION
Le terme de pathologie de la coiffe des rotateurs (CDR) est un terme gnrique qui sous-tend une
lsion de type dgnratif ou traumatique localise aux tendons de la CDR (supra-pineux, infrapineux, sub-scapulaire, petit rond) et/ou leurs annexes (bourse synoviale). Il englobe
galement les atteintes de mme type localises la partie proximale du tendon du chef long du
muscle biceps brachial (ou sa synoviale, tnosynovite). Ces lsions peuvent prendre des allures
diverses, tant du point de vue clinique que pathologique, et vont de la tendinopathie simple la
rupture tendineuse avre.
Cette pathologie correspond l'une des 3 formes suivantes :
- tendinopathie avec calcification ;
- tendinopathie non calcifiante sans rupture ;
- tendinopathie avec rupture (partielle, transfixiante, complte) accompagne ou non darthrose
scapulo-humrale, en fonction de ltendue, de lanciennet et de lvolution de la rupture qui
entrane une dgnrescence graisseuse du muscle rompu.
La traduction clinique des lsions de la CDR est le plus souvent une paule douloureuse pas ou peu
enraidie et une impotence fonctionnelle variable suivant latteinte. Cette impotence peut voluer
favorablement spontanment, notamment lorsque la question de la douleur est rsolue.
Ce travail exclut la prise en charge des pathologies de la CDR secondaires survenant dans un
contexte dpaule instable par laxit ligamentaire, ainsi que celles qui ont t opres.
Les problmes cervicaux ont parfois un retentissement sur les douleurs de lpaule, ils ne font pas
lobjet de ce travail.
Ltude pidmiologique prcise de ce syndrome est difficile faire (1) du fait de lexistence de
nombreuses lsions asymptomatiques, de labsence frquente de diagnostic lsionnel exact
(lorsquune atteinte de lpaule est recense) et que la corrlation anatomoclinique ncessite de
recourir parfois des examens complmentaires (coteux ou invasifs) peu pratiqus en premire
intention (2).
Dans une tude rtrospective mene en Hollande, sur une anne, auprs de 18 mdecins gnralistes
(reprsentant un total de 35 150 patients dans lanne), van der Windt (3) estime la frquence des
consultations pour une pathologie de lpaule 11,2/1000 patients/an. Dans cette tude le syndrome
le plus couramment diagnostiqu (48 %) est le syndrome sous-acromial (tendinite, bursite
chronique, rupture ou syndrome mixte), les bursites aigues (17 %) tant classes part, le reste des
atteintes ne correspondant pas une lsion de la CDR.
La population typiquement concerne par cette pathologie est une femme ou un homme (un peu
plus souvent), entre 40 et 60 ans (1,3). Lutilisation rpte du membre suprieur hauteur de
lpaule apparat comme un facteur favorisant (1), notamment dans la pratique des sports requrant
darmer le bras, et dans les professions de maon, peintre en btiment et agriculteur (4). Notons que
plus on avance en ge, plus le risque de rupture est important et que le tendon du supra-pineux est
le plus frquemment atteint.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 19 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Ltiologie de cette pathologie reste controverse ; plusieurs causes sont avances et semblent plus
complmentaires que rellement opposes (5-15) :
un conflit mcanique (compression et frottement) rsultant dun contact anormal entre la vote
coraco-acromiale et les tendons de la coiffe et/ou leurs annexes (divers facteurs anatomiques et
physiopathologiques tant susceptibles de favoriser ce conflit) ;
la dgnrescence prcoce des tendons de la coiffe du fait de la pauvret naturelle de leur
vascularisation et de sa diminution avec lge (en particulier la face profonde du tendon et
proximit de son insertion distale), dgnrescence favorise aussi par la surcharge fonctionnelle ;
une insuffisance fonctionnelle de la CDR qui nassure pas efficacement son rle dabaisseur de la
tte humrale pour sopposer la composante de glissement de lhumrus vers le haut lors de la
contraction du muscle deltode, ou encore un dsquilibre (entre muscles rotateurs mdiaux et
latraux) responsable dun mauvais contrle positionnel (antro-postrieur) de la tte humrale sur
la cavit glnode de la scapula, lors des mouvements de lpaule ;
une surcharge mcanique occasionnelle ou rgulire sur un terrain dgnratif et/ou conflictuel.
Signalons aussi le rle damortisseur et de stabilisateur passif de la tte humrale jou par la vote
coraco-acromiale en prsence dune rupture de la CDR (5), et la capacit du deltode stabiliser la
tte humrale vers le bas, signale par Duchenne de Boulogne (16), puis par Dolto (17) et rtudie
rcemment par Gagey (18).
Le traitement de cette pathologie est habituellement fonctionnel (3,7,8,19,20). Il comporte une
priode de repos, la prise de mdications antalgiques et anti-inflammatoires (parfois en injection,
infiltration de corticodes), la prescription de masso-kinsithrapie ou de physiothrapie. Il semble
quassez peu de cas ncessitent une intervention chirugicale, celle-ci nintervenant le plus souvent
quen deuxime intention, aprs chec du traitement fonctionnel (5,12,13). Pour Revel (21), il faut
attendre au moins 6 mois et se rsoudre lchec dun traitement masso-kinsithrapique bien
conduit, avant denvisager de recourir la chirurgie. Cependant, sil ne sagit pas dune urgence
chirurgicale, les ruptures survenant chez un sujet jeune sont opres, volontiers, plus rapidement
afin de limiter le risque de survenue dune dgnrescence musculaire graisseuse dont on sait
quelle est un des facteurs pronostics dchec du rsultat fonctionnel de la chirurgie
(dgnrescence graisseuse > stade II) (22).
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 20 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CHAPITRE I - BILANS
Sil existe un consensus (23-25) sur la dfinition clinique des pathologies de la CDR, les examens et
diagnostics mdicaux correspondants, il nen est pas de mme pour le bilan de massokinsithrapie.
Dans la littrature, le bilan porte le plus souvent sur la douleur, les amplitudes articulaires de
larticulation scapulo-humrale (abduction, rotation latrale et flexion), la fonction de lpaule et
parfois la force musculaire en abduction et/ou rotation (26).
Par ailleurs, les techniques dexamen clinique de lpaule douloureuse dcrites par Cyriax sont
fortement reproductibles (kappa = 0,875) et corrles aux diffrents diagnostics des pathologies
classiquement regroupes sous le terme dpaule douloureuse (annexe 1) (27).
Deux types de renseignements semblent devoir tre utiles au masseur kinsithrapeute pour prendre
en charge des pathologies de la CDR :
des informations (faisant partie classiquement du diagnostic mdical) qui permettront de reconnatre
la pathologie traiter. Il sagit des rponses obtenues la pratique des principales manuvres
d'valuation des muscles ou des tests diagnostiques de conflits ;
des informations propres au sujet rduquer, qui permettront de choisir les techniques les plus
appropries au traitement et de suivre l'volution des symptmes. Ces donnes concernent
notamment la douleur et les possibilits analytiques (amplitude articulaire, force musculaire) et
fonctionnelles de lpaule.
I.
LEVALUATION DES MUSCLES DE LA COIFFE ET LES TESTS DE CONFLITS
I.1.
Les diffrentes manuvres pour tester les muscles de la coiffe
Diffrentes manuvres sont utilises pour localiser l'atteinte tendineuse (Jobe, Patte,
Gerber, belly press test, palm up test, signes du clairon et du rappel automatique, etc.) ou
la rupture tendineuse (annexe 2). Ceux reconnus comme les plus sensibles et les plus
spcifiques (tableau 1) sont :
- Jobe pour le supra-pineux ;
- Patte pour le petit rond et l'infra-pineux ;
- Gerber et le belly press test (pas dvaluation de la sensibilit ou de spcificit
retrouve pour ce test) pour le subscapulaire ;
- Le palm up test pour le tendon du long biceps, sujet caution du fait de sa faible
spcificit (accord professionnel).
Il faut savoir que la valeur diagnostique de ces tests est fortement dpendante de
lexprience de lexaminateur et de la prsence de douleur. En prsence de douleurs
aigus, linterprtation de ces tests devient particulirement difficile ou hasardeuse. ce
Le test de Kappa est un test statistique utilis pour mesurer la concordance entre des variables qualitatives. Dans le
cadre tudi ici, le test de Kappa value la reproductibilit dune mesure entre plusieurs observateurs. Un indice
suprieur 0,6 est considr comme bon ; un indice suprieur 0,8 est considr comme trs bon.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 21 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
propos, il faut signaler que les signes du clairon et du rappel automatique sont
respectivement corrls la dgnrescence graisseuse et la rupture irrparable du petit
rond et de linfra-pineux (28).
Il faut signaler aussi quil nest pas possible dobtenir une contraction isole du muscle
supra-pineux avec le test de Jobe (signant une tendinopathie de ce muscle) (29, 30) (tude
EMG). On ne peut viter la participation des muscles infra-pineux et deltode antrieur et
moyen. Il en est probablement de mme pour les autres tests dcrits comme isolant laction
de tel ou tel muscle.
Par ailleurs, daprs Kelly (31), les positions qui permettent dobtenir, au mieux, une
contraction slective des muscles de la CDR (avec la participation la plus faible des
muscles synergiques valu par EMG) sont respectivement :
la combinaison dune abduction 90 (plan de la scapula) et dune rotation latrale de 45
pour le supra-pineux ;
le bras le long du corps ( 0 dabduction) en rotation mdiale (45) pour linfra-pineux ;
la rotation mdiale du bras, lavant-bras tant plac dans le dos du sujet (position dite de
Gerber) pour le subscapulaire.
La sensibilit et la spcificit de ces manuvres restent en gnral leves (tableau 1) (10,
25, 28).
Tableau 1. Sensibilit et spcificit des principales manuvres diagnostiques de lsion tendineuse cites par
Schaeverbeke, 1996 (25).
Auteur, anne,
(rf.)
Manoeuvre de / muscle
test
Nol, 1989/Walch, 1993
(32, 33)
I.2.
Jobe/supra-pineux
Sensibilit
(probabilit dobtenir
un rsultat positif
chez le sujet malade)
90/100
Spcificit
(probabilit dobtenir
un rsultat ngatif
chez un sujet sain)
90/100
Leroux, 1995
(34)
Jobe/supra-pineux
86/100
50/100
Leroux, 1995
(34)
Patte/infra-pineux
79/100
30/100
Walch, 1993
(33)
Patte/infra-pineux
92/100
67/100
Gerber, 1991
(35)
Gerber/subscapulaire
100/100 si rupture complte
Walch, 1993
(33)
Gerber/subscapulaire
59/100 si rupture incomplte
85/100
Leroux, 1995
(34)
Palm up test/long biceps
brachial
63/100
35/100
Walch, 1993
(33)
Palm up test/long biceps
brachial
87/100
47/100
Les tests de douleur de l'articulation scapulo-humrale
Certains tests permettent de mettre en vidence une douleur du complexe scapulo-humral.
Ils permettent d'objectiver des douleurs dans des positions spcifiques.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 22 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Les tests de Hawkins et de Neer sont recommands (accord professionnel) car ils sont les
plus souvent utiliss (annexe 3). Il faut interprter avec prcaution le cross arm
( adduction horizontale ou adduction de l'paule dans une position flchie 90) et le
test de Yocum car ils explorent aussi l'articulation acromio-claviculaire.
II.
LE BILAN M ASSO -KINESITHERAPIQUE
Le bilan masso-kinsithrapique doit recueillir des informations au dbut et la fin du
traitement afin de juger du rsultat thrapeutique. Pour cela il existe de nombreux scores et
indices fonctionnels (36) permettant dapprcier les rpercussions des pathologies de la
CDR sur les fonctions de lpaule et du membre suprieur. Ces tests peuvent tre utiliss
comme bilan de dbut et de fin de traitement.
Dautres informations plus spcifiques sont ensuite recueillies au fil des sances pour
valuer la douleur, la mobilit articulaire, les capacits musculaires, les possibilits
fonctionnelles et pour mettre en place une stratgie thrapeutique adapte. Ces
informations vont permettre de choisir des techniques thrapeutiques, de surveiller la
pathologie ou de mesurer le rsultat thrapeutique.
II.1.
Score fonctionnel utilis en dbut et en fin de traitement
Quatre rubriques sont utilises dans ces grilles dvaluation : la douleur, le niveau
dactivit (diffrents gestes fonctionnels), lamplitude articulaire et la force musculaire (37,
38).
Dans ces grilles, lvaluation des indicateurs est parfois purement subjective ; certaines
intgrent une mesure objective de lamplitude et de la force. Le score le plus utilis est
celui de Constant (annexe 4). Les rubriques utilises dans ces grilles sont en gnral bien
corrles avec le rsultat final, excepte la force, et il apparat que la mobilit (amplitude)
et la fonction sont biens corrles entre elles et avec le rsultat final (37).
Revel (21) fait remarquer que le poids des diffrents indicateurs utiliss varie avec les
grilles, ce qui rend difficile la comparaison des rsultats obtenus par tel ou tel traitement
lorsque les rsultats sont mesurs avec des grilles diffrentes. Par ailleurs, il fait aussi
remarquer que la notion de handicap fonctionnel varie avec le sujet (ge, niveau personnel
dactivit exig) et la motivation individuelle face une mme activit.
Enfin, dans cette partie du bilan la prsence de perte de sommeil et dindemnit
compensatoire devrait peut-tre tre considre, puisque ces deux facteurs apparaissent
comme dterminants dans la prdiction dun chec du traitement conservateur (39).
Dans une tude comparative de 4 grilles fonctionnelles, Boussagol (37) rapporte que la
dure ncessaire pour remplir une fiche test de Constant est la plus courte (5 minutes pour
un examinateur entran). Il rapporte aussi que cest le score le plus svre. La svrit de
cette grille est due au poids de la rubrique force et limportance de leffort exig pour
obtenir le maximum de points dans cette rubrique.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 23 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Il est recommand dutiliser un score fonctionnel en dbut et en fin de traitement. Le
groupe de travail propose le score de Constant (23) qui a t mis au point pour valuer les
pathologies de lpaule, couvre les diffrents domaines du bilan et est largement diffus et
utilis (accord professionnel).
II.2.
Douleur
La douleur est un paramtre valu dans le score de Constant. Elle peut tre tudie plus
prcisment au cours des sances.
Winters (40), aprs en avoir vrifi la validit, propose dutiliser lchelle dite du
shoulder pain score , (annexe 5). Dans cette chelle, sept questions permettent de
distinguer les aspects passif et actif de la douleur. Chaque question est value par une note
chiffre de 1 4. Ces questions sont classiques mais napportent pas vraiment
dinformations supplmentaires qui soient utiles au masseur kinsithrapeute.
Moyen de mesure
Il est recommand dutiliser au cours des sances une chelle visuelle analogique (EVA)
(100 mm) pour suivre lvolution de la douleur, douleur spontane (repos, jour, nuit) ou
douleur provoque (mouvements, gestes tests) car elle est dutilisation simple et rapide
(accord professionnel).
II.3.
Articulaire
La mobilit articulaire est un paramtre valu dans le score de Constant. Elle peut tre
tudie plus prcisment au cours des sances. Le bilan articulaire concerne la ceinture
scapulaire et larticulation scapulo-humrale. Il est qualitatif et quantitatif.
II.3.1.
Mobilit analytique et globale
Pour Dougados (23) il ny a pas ou peu de limitation des amplitudes passives dans les
pathologies de la CDR.
Leroux puis Cole (41,42) constatent chez des sujets atteints dune lsion de la CDR que
lamplitude totale dlvation du bras se trouve diminue par rapport celle de sujets
normaux. Cette diminution trouve son origine au niveau des articulations scapulothoracique et scapulo-humrale. Langle douverture scapulo-humral est diminu (10
sujets sains compars 10 sujets atteints dun syndrome de conflit sous-acromial, p <
0,001) (41).
Ltude de la mobilit passive globale permet de dterminer la mobilit fonctionnelle de
l'paule (amplitude totale des articulations scapulo-thoracique et scapulo-humrale).
Lors de lexamen analytique de larticulation scapulo-humrale, il est ncessaire de
maintenir la scapula pour viter toute compensation. Cet examen reste fondamental mme
sil nest pas toujours parfaitement reproductible, car il permet au moins dliminer une
capsulite et de dtecter s'il existe une compensation de la mobilit scapulo-thoracique ou
scapulo-humrale.
Llvation fonctionnelle normale du bras se fait dans le plan de la scapula, ou tout au
moins ncessite-t-elle que lhumrus et la scapula soient aligns, chacun des deux os
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 24 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
pouvant tre mobile lun par rapport lautre ou simultanment selon le plan effectif du
mouvement (43). Il est admis que lamplitude totale de llvation latrale du bras est en
moyenne de 170 (60 de mobilit scapulaire et 110 de mobilit humrale) (43, 44).
Moyens de mesure
La mesure goniomtrique ou centimtrique de certaines de ces amplitudes semble
reproductible (coefficient de corrlation intraclasse intra-valuateur de 0,88 et 0,93,
coefficient de corrlation intra-classe intervaluateurs de 0,85 et 0,80) sous rserve dune
pratique rigoureuse et de possder lappareillage adquat (45,46). Les techniques utilises
dans ces tudes ne semblent pas toujours faciles pratiquer seules ou rapidement.
Par ailleurs laspect technique et la ralisation pratique des mesures goniomtriques et
centimtriques de lpaule ont t dcrits par divers auteurs (47).
Neiger (48) a dcrit une technique, simple et facile raliser, pour diffrencier la mesure
de labduction scapulo-humrale et celle de la sonnette latrale de la scapula, avec un
goniomtre plastique de Cochin.
Lutilisation du plurimtre de Rippstein1 (malheureusement difficile trouver en France)
parat la technique de mesure la plus rapide et la plus simple. Ltude de Green (49)
rapporte dailleurs que cette dernire technique possde une bonne reproductibilit intra- et
inter-valuateurs (coefficient de corrlation intraclasse intra-valuateur variant de 0,62
0,80 et coefficient de corrlation intraclasse intervaluateurs variant de 0,62 0,95 selon
les mouvements).
Lexamen articulaire comprend une valuation chiffre des amplitudes globales et
analytiques des mouvements du complexe de lpaule comparativement au ct sain. Cet
examen est ralis de manire active (le patient ralise seul le mouvement) et de manire
passive (le praticien ralise le mouvement) (accord professionnel).
Les mouvements dabduction, de flexion et de rotation sont les plus importants valuer
parce quils sont souvent directement impliqus dans la douleur et que leur limitation
entrane la gne fonctionnelle la plus importante. L'ordre de notation le plus souvent utilis
est : flexion/extension/abduction/adduction/rotation latrale /rotation mdiale.
Il est utile d'tudier les mouvements de la scapula lors des mouvements actifs de l'paule.
Si les mouvements sont limits, il convient d'en tenir compte pour la conduite
thrapeutique (accord professionnel).
II.3.2.
Mobilit spcifique
Pour tayer lexistence dune diminution damplitude dlvation de lpaule
accompagnant les lsions de la CDR, on peut noter qu Hjelm (50) rapporte une limitation
de lamplitude dabduction de larticulation scapulo-humrale et une diminution de
Le coefficient de corrlation intraclasse est un test statistique utilis pour valuer la concordance entre des variables
quantitatives. Dans le cadre tudi ici, ce coefficient value la reproductibilit des mesures obtenues par un ou plusieurs
observateurs. Un indice suprieur 0,6 est considr comme bon ; un indice suprieur 0,8 est considr comme trs
bon.
1
Le plurimtre de Rippstein est constitu dun cadran gradu en degrs. Il possde une aiguille leste qui permet de
donner la verticale. Le support du cadran permet celui-ci de changer la position 0 de rfrence. Le support est plac
directement sur le segment mobilis. Langle obtenu est la diffrence entre la position de dpart et la position darrive.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 25 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
lextensibilit de la partie antro-infrieure de la capsule de cette mme articulation, chez
156 patients atteints de diverses lsions de lpaule (paule douloureuse, lsion de la CDR,
paule gele). Dans cette tude lamplitude dabduction tait mesure par goniomtrie
(sans rotation) et en contrlant les compensations de la scapula, lextensibilit capsulaire
tait apprcie cliniquement par des techniques manuelles dcrites par Cyriax et Maitland
(dtails de lexamen cits dans lannexe 1) (51).
Signalons aussi que Warner (52) rapporte une diminution de lextensibilit de la partie
postro-infrieure de la capsule de larticulation scapulo-humrale en prsence dun conflit
sous-acromio-coracodien. Dans cette tude lextensibilit capsulo-ligamentaire tait
apprcie par goniomtrie et par des tests de glissements infrieur, antrieur et postrieur.
Il sagissait dune tude prospective comprenant 15 sujets asymptomatiques, 10 sujets
atteints dun conflit et 28 sujets lpaule instable. Seuls les sujets atteints dun conflit
possdaient une amplitude limite et une laxit capsulo-ligamentaire plus faible.
Moyens de mesure
Chesworth (51) rapporte une certaine reproductibilit (voir infra) intra et interobservateurs
de lvaluation manuelle de lamplitude de rotation latrale de lpaule, chez des patients
atteints de diverses pathologies de lpaule (fracture, paule gele, tendinopathie, aprs
traitement conservateur ou chirurgical). Cette apprciation clinique est base sur lexamen
de larrt du mouvement et des sensations quil produit. Ces sensations concernent la
douleur manifeste par le patient et la rsistance ressentie par lexaminateur en fin
damplitude. Elles sont classes suivant des modalits dcrites par Maitland et par Cyriax
(annexe 1). Cette tude comportait 34 patients, deux thrapeutes ont examin (tour tour)
les paules concernes deux reprises et trois jours dintervalle. La reproductibilit de la
technique de Cyriax tait value par un test de Kappa (k intra-observateurs 0,48 et 0,88,
k interobservateurs 0,62 et 0,76), celle de Maitland par un test de corrlation (coefficient
de corrlation intraclasse interobservateurs de 0,83 et 0,90, et intra-observateur de 0,74 et
0,86).
Dans le mme esprit signalons aussi que daprs Tyler (53) une mesure chiffre de
lextensibilit de la partie postrieure de la capsule de larticulation scapulo-humrale est
reproductible (coefficient de corrlation intraclasse interobservateurs de 0,80, et intraobservateurs de 0,92 et 0,95). Cette tude effectue sur deux groupes de sujets jeunes sans
pathologie de lpaule (23 lanceurs dans une quipe de baseball et 43 ne pratiquant pas ce
sport) montre aussi que le groupe de lanceurs prsente une extensibilit capsulaire
postrieure plus faible la fois du ct dominant et par rapport lautre groupe. Le groupe
des lanceurs possde aussi une amplitude de rotation latrale suprieure et une rotation
mdiale diminue (amplitudes mesures 90 dabduction). Il faut relativiser la
Le test de Kappa est un test statistique utilis pour mesurer la concordance entre des variables qualitatives. Dans le
cadre tudi ici, le test de Kappa value la reproductibilit dune mesure entre plusieurs observateurs. Un indice
suprieur 0,6 est considr comme bon ; un indice suprieur 0,8 est considr comme trs bon.
Le coefficient de corrlation intraclasse est un test statistique utilis pour valuer la concordance entre des variables
quantitatives. Dans le cadre tudi ici, ce coefficient value la reproductibilit des mesures obtenues par un ou plusieurs
observateurs. Un indice suprieur 0,6 est considr comme bon ; un indice suprieur 0,8 est considr comme trs
bon.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 26 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
transposition de ces rsultats au strict domaine du bilan des pathologies de la CDR car il
sagit de sujets sans pathologie.
Vermeulen (54) a trouv des rsultats semblables pour des paules possdant des
limitations articulaires.
Une tude franaise de Marc (55, 56) prconise dtudier le dcentrage suprieur,
postrieur et infrieur de la tte humrale avec les techniques dcrites par Sohier (57). Le
dcentrage de la tte humrale ainsi tudi est corrl la prsence dun conflit sousacromial et/ou dune tendinopathie du muscle supra pineux (55). Lapprciation du
dcentrage de la tte humrale comme celle de ses possibilits de glissement reste du
domaine subjectif et n'a pas fait l'objet d'tude de reproductibilit.
Ces deux types dexamen se rapprochent quant aux rsultats recherchs mais utilisent des
techniques diffrentes.
II.4.
Bilan neuromusculaire
La force musculaire est un paramtre valu dans le score de Constant. Elle peut tre
tudie plus prcisment au cours des sances.
Dans la littrature le bilan musculaire sintresse essentiellement la force musculaire des
flchisseurs, abducteurs et rotateurs, parfois lamplitude active. Le bilan musculaire
concerne les points suivants.
II.4.1.
Apprciation du volume musculaire
Le volume musculaire des fosses supra et infra-pineuses et du deltode (24, 25) est
apprci visuellement et manuellement comparativement au ct sain (lorsque cest
possible). La prsence dune amyotrophie tmoigne dune volution plutt ancienne et peut
tre masque en cas de dgnrescence graisseuse (rupture complte ancienne).
II.4.2.
Apprciation de la consistance et de la sensibilit du muscle la palpation
Cette apprciation qualitative est effectue par la palpation. Deux aspects sont pris en
compte dans cet examen : la sensation subjective du MK qui palpe comparativement
les cts droit et gauche, et la raction douloureuse manifeste (ou dcrite) par le patient. Il
parat opportun que le patient indique clairement ses sensations (sensations identiques
droite et gauche, ou plus douloureuse dun ct). La reproductibilit de ces mesures na
pas t retrouve dans la littrature.
La palpation des tendons de la CDR est dcrite et couramment pratique (58). On
recherche une douleur la palpation. Cependant on peut douter de la signification clinique
de cette palpation, tant donn le nombre de tissus douloureux dans la rgion de lpaule
dans le contexte dune lsion de la CDR (accord professionnel).
II.4.3.
La contraction analytique
La contraction analytique non rsiste des muscles moteurs des articulations scapulothoracique et scapulo-humrale est effectue par le patient. On recherche une diffrence
damplitude active entre les cts droit et gauche et la prsence dun arc douloureux. Puis
on procde lexamen de la contraction analytique rsiste. La connaissance des
mouvements douloureux permet de suivre lvolution de la symptomatologie douloureuse.
Les tests de conflit ou d'valuation de la coiffe sont en gnral les plus utiliss.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 27 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
II.4.4.
Le bilan de la force musculaire
La douleur perturbe lvaluation de la force musculaire. Il est souhaitable que la douleur
soit tolrable pour procder la recherche de force maximale dune faon fiable. En effet,
Brox (59) rapporte quune contraction isomtrique maximale en abduction (dans le plan de
la scapula) est diminue en moyenne de 37 % par rapport au ct sain, chez des patients
atteints dun conflit sous-acromial, depuis au moins 3 mois, et possdant un score moyen
de seulement 10 mm/100 mm sur une chelle visuelle analogique de la douleur. Cette
diminution correspondrait une inhibition dorigine centrale. Dans cette mme tude le
maintien jusqu puisement dune contraction isomtrique sous-maximale (25 % de la
force maximale volontaire isomtrique) ne parat pas faire lobjet dune inhibition.
Apprciation manuelle
La mesure est habituellement effectue en isomtrique et contre rsistance manuelle (break
test), par groupe musculaire et en adoptant les positions les plus slectives
correspondantes. Cette apprciation manuelle concerne les muscles moteurs des
articulations scapulo-thoracique et scapulo-humrale. Elle est subjective mme si en
prsence de douleur elle est plus adaptable. Lvaluation manuelle de la fonction
musculaire (testing) ne convient pas lvaluation en rhumatologie mais celle des
pathologies du systme nerveux priphrique.
Mesure chiffre
Ce bilan peut aussi tre pratiqu avec un dynamomtre qui permettra davoir une valeur
chiffre ; il concerne alors plus particulirement les moteurs de la scapulo-humrale (cf.
score de Constant).
L'apprciation non instrumentale de la force musculaire est subjective et il est souhaitable
de lobjectiver par l'utilisation de charges ou de dynamomtres (accord professionnel).
Mesure isocintique
La force des groupes musculaires de larticulation scapulo-humrale peut aussi tre
value en mode isocintique. Le matriel isocintique permet d'effectuer une valuation
musculaire sans risque pour le patient. Il est classique de mesurer les paramtres suivants :
pic de couple (valeur maximale du produit de la force musculaire par son bras de levier
osseux), puissance moyenne notamment pour les muscles rotateurs mdiaux (RM) et
latraux (RL) (34) . Les valeurs normales du rapport RM/RL sont respectivement pour ces
deux paramtres de 1,3 et 1,5 (sujet assis bras dans le plan de la scapula 45
dabduction).
En prsence dun conflit sous-acromial on constate une diminution de ces valeurs. Pour
Leroux (34) le fait que la valeur du rapport RM/RL scarte de la norme (en plus ou en
moins) est prendre en compte en rducation par un travail musculaire spcifique destin
remdier cet cart.
Malerba (60) rapporte que la mesure de la force des rotateurs de lpaule en mode statique
et concentrique a une plus grande reproductibilit que la mme mesure en mode
excentrique (24 sujets atteints de diverses pathologies unilatrales de lpaule au moins
cinq mois dvolution). Notons aussi que les rsultats obtenus avec des tests isocintiques
sont influencs par la position adopte au cours du test (61). Pour effectuer ces tests le
placement du bras 45 dabduction dans le plan de la scapula semble prfrable la fois
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 28 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
parce quil permet dobtenir de meilleurs rsultats (62) mais aussi parce quil est moins
contraignant pour larticulation (63).
Enfin Brox (64) rapporte que les rsultats des tests isocintiques peuvent galement tre
fausss par la douleur. Ceci est en particulier vrai pour le groupe des muscles flchisseurs
de la scapulo-humrale.
Le matriel isocintique est actuellement plutt utilis dans le cadre de recherches
cliniques.
II.4.5.
La mesure de lendurance statique
En labsence de moyen de quantification de la force musculaire, il est possible deffectuer
une mesure de lendurance musculaire qui consiste chronomtrer la dure du maintien
dune contraction statique. La mesure de lendurance statique des groupes musculaires de
lpaule (dfinie comme limpossibilit de maintenir un niveau de force donn) peut faire
partie du bilan musculaire, et survenir assez tt dans la prise en charge MK puisque ce type
dactivit semble moins influenc par la douleur en condition de maintien sous-maximal
(59). La littrature na pas permis de dterminer lintrt de ces mesures chiffres lors dun
bilan initial et final.
II.4.6.
Lextensibilit musculaire
Cette apprciation concerne essentiellement les muscles qui sont susceptibles de placer la
scapula en position favorisant le risque de conflit. Des techniques de mesure
centimtriques ont t proposes pour valuer lextensibilit de ces muscles (47).
Lutilisation pratique de cette mesure est difficile. La reproductibilit na pas t value.
II.5.
Bilan fonctionnel
La fonction est un paramtre valu dans le score de Constant. Elle peut tre tudie plus
prcisment au cours des sances.
La mobilit fonctionnelle de l'paule permet d'tudier le fonctionnement articulaire
(coordination des mouvements articulaires entre eux, recherche de compensations) et
musculaire (activit musculaire, compensation) sur des gestes tests ou des activits de la
vie quotidienne.
Il est possible aussi d'tudier le mouvement physiologique d'abduction de l'paule.
Diffrentes explications biomcaniques ont tent d'expliquer la mobilit de l'paule et le
rle de la coiffe des rotateurs dans la pathologie de la CDR. Nous avons synthtis trois
concepts : la diminution de l'espace sous-acromial, la perturbation du rythme scapulohumral et les troubles posturaux. ces concepts s'ajoute l'analyse des gestes de la vie
courante.
II.5.1.
La diminution de l'espace sous-acromial
Solem Bertoft (65) constate, chez des sujets normaux, que la hauteur de lespace sousacromial (mesure dans le plan sagittal par IRM) est diminue par lantposition
(abduction, bascule antrieure) de lpaule (p < 0,01, 4 sujets sans pathologie de lpaule)
alors quelle augmente en rtroposition (adduction, bascule postrieure).
Dans le travail de Bohmer (66) 32 sur 45 des sujets atteints dune lsion de la CDR (stades
II et III de Neer) prsentent une attitude de lpaule en antposition.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 29 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Graichen (67) a tudi leffet dune contraction isomtrique des muscles abducteurs sur la
hauteur de lespace sous-acromial chez dix sujets sains et dix sujets atteints dun syndrome
de conflit. La hauteur minimale de lespace sous-acromial tait tudie dans trois positions
dabduction de lpaule (60, 90, 120, dans le plan de la scapula), sans et avec contraction
musculaire, et aprs reconstruction en trois dimensions par rsonance magntique. Cette
tude rapporte que chez le sujet sain la contraction musculaire entrane une diminution de
la hauteur sous-acromiale moyenne 60 dabduction, alors quelle augmente pour 120 et
quelle nest pas modifie de faon significative 90. Chez le sujet atteint dun conflit, la
contraction musculaire se traduit par une diminution significative de la hauteur sousacromiale en particulier 90 dabduction. Ceci apparat dautant plus vrai quil sagit dun
conflit de stade I ou II. La hauteur de lespace sous-acromial est moins influence par la
contraction des muscles abducteurs en prsence dune rupture de stade III.
Ceci est mettre en parallle avec le fait que la diminution de hauteur de lespace sousacromial, au repos, est corrle avec lexistence dune rupture tendue de la CDR (rupture
localise aux tendons des muscles supra, infra-pineux et subscapulaire) (68). Elle lest
aussi avec la dgnrescence graisseuse du muscle infra-pineux qui serait le principal
abaisseur de la tte humrale (68).
Nordt (69) a mesur la pression sous-acromiale diffrentes amplitudes dabduction
passive de lpaule (dans le plan de la scapula), chez 25 patients atteints dun conflit sousacromial. La pression la plus faible est retrouve bras le long du corps et 90 dabduction
la pression est toujours augmente. Les pressions les plus leves sont retrouves 180
dabduction, en position dabduction force et lors du test de cross arm qui consiste
croiser la poitrine par une adduction horizontale du bras. Dans cette tude ces deux
dernires positions correspondent aux positions qui sont les plus douloureuses pour les
patients. On peut remarquer quelles sont proches des positions des tests de conflit de Neer
et Hawkins. Ces 2 tests semblent donc pouvoir tre de bons indicateurs de lvolution
dune lsion de la CDR par conflit.
Chen (70) a mesur (mesure radiologique) la hauteur de l'espace sous-acromial avec ou
sans fatigue des muscles de la CDR et du deltode chez 12 sujets jeunes (moyenne de 27
ans). Il a mis en vidence que la hauteur de l'espace sous-acromial augmentait en prsence
de fatigue lorsque le bras tait situ le long du corps (au repos), et que par contre elle
diminuait lors des mouvements d'abduction.
Mesure chiffre
L'valuation des possibilits d'abaissement de la tte humrale est subjective.
II.5.2.
La perturbation du rythme scapulo-humral
Llvation latrale du bras met en jeu de faon plus ou moins synchrone les mobilits de
lhumrus et de la scapula. On parle de rythme scapulo-humral. Ce rythme varie en
fonction des individus, de lamplitude effective du mouvement et des conditions de
ralisation (force dveloppe, fatigue).
Chez des patients
Cole (42) a constat que la bascule postrieure de la scapula tait moins importante chez
des sujets atteints dun syndrome de conflit (17 sujets) quelle lest chez des sujets sains
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 30 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
(20 sujets) la fin de llvation latrale. Chez les sujets atteints dune lsion de la CDR,
Leroux puis Cole ont constat que lamplitude totale dlvation du bras se trouvait
diminue par rapport celle de sujets normaux (41, 42). Ceci est d une diminution de
langle douverture scapulo-humral (10 sujets sains compars 10 sujets atteints dun
syndrome de conflit sous-acromial, p < 0,001) (41).
Bohmer (66) constate quil existe un dysfonctionnement du rythme scapulo-humral (45
sujets sur 48 atteints dun conflit).
Warner (71) rapporte aussi une modification du rythme scapulo-humral en prsence dun
conflit sous acromio-coracodien. Dans cette tude 100 % des sujets atteints dun conflit
unilatral ont une saillie de la scapula (en aile dange) plus marque du ct atteint contre
18% des sujets asymptomatiques et 64 % des sujets lpaule instable (mesure effectue
avec un procd en photographie Moir). Ce constat tait effectu lors du maintien statique
dune flexion comparative bilatrale des bras 90 (plan sagittal, coudes tendus, un poids
de 4,5 kg dans chaque main) et aussi au cours dune srie de mouvements de flexion
rpts entre 0 et 120 (photo faite au passage du bras 90).
Chez des sujets sains
De la Caffinire a dcrit les dplacements de la scapula, au cours de llvation latrale du
bras (72). La scapula est anime dun mouvement compos dune lvation, dune sonnette
latrale, dune bascule postrieure et dune rotation latrale (rduction de langle form par
les plans scapulaire et frontal au repos). Ces trois derniers mouvements ont t confirms
par Ludewig (73) dans une tude opto-cintique.
Mc Quade (74) rapporte que la mise en place (exprimentale) dun tat de fatigue
musculaire locale des muscles trapze suprieur et infrieur entrane une modification du
rythme scapulo-humral ainsi que de la mobilit scapulaire. Dans cette tude la fatigue
musculaire rsultait de la rptition (jusqu impossibilit) dun mouvement dlvation
latrale du bras dans le plan de la scapula, contre une charge de 8,5 livres, et elle tait
atteste par la baisse de la frquence moyenne du spectre de lEMG de surface des mmes
muscles. En prsence de fatigue lamplitude de mobilit de la scapula en bascule
postrieure et en sonnette latrale est diminue par rapport ce quelle est sans fatigue.
Selon lauteur cette diminution de la mobilit scapulaire pourrait favoriser la survenue dun
conflit sous-acromio-coracodien notamment en cas de rptition prolonge de gestes
professionnels ou sportifs du mme type, mais cette diminution demande tre tudie
plus avant, tant donn le petit nombre de sujets [4] contenus dans cette tude.
Mesure chiffre
propos du rythme scapulo-humral Kibler (75) dcrit un test (latral scapular sliding
test) (76) qui permettrait selon lui de reprer une anomalie du rythme scapulo-humral en
prsence dun conflit. Ce test consiste mesurer la distance entre langle infrieur de la
scapula et le processus pineux le plus proche, dans trois positions diffrentes du bras (au
repos le long du corps, puis mains places sur les hanches avec les pouces en arrire, enfin
bras 90 dabduction et en rotation mdiale). Selon Kibler, ce test est reproductible
(coefficient de corrlation intraclasse intra-valuateur de 0,84 0,88 et intervaluateurs
de 0,77 0,85), et le marquage clinique de langle infrieur de la scapula est bien corrl
avec son reprage radiographique (r = 0,91).
Les rsultats du test, rapports par Kibler (75), semblent montrer quen labsence de conflit
sous-acromial la distance mesure de chaque ct (dans ces trois positions) tend devenir
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 31 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
symtrique en position 3, ce qui nest pas le cas en prsence dun conflit unilatral, au
contraire. En prsence dun conflit la diffrence entre les distances mesures de chaque
ct est toujours dau moins 0,83 cm (0,83 1,75 cm). Lauteur propose de retenir 1,5 cm
comme seuil de la valeur considre comme normale pour cette diffrence. Kibler
interprte ces rsultats comme la manifestation dune insuffisance de force des muscles qui
doivent stabiliser la scapula lors du maintien du bras en position 3 du test (dentel
antrieur, trapze suprieur et infrieur, rhombode). Il propose galement de vrifier si la
manifestation du conflit diminue lorsque lexaminateur aide la scapula rester en sonnette
latrale (par un appui dirig vers le dehors sur la partie infrieure du bord mdial de la
scapula, la sonnette latrale ainsi renforce permettant daugmenter la hauteur de lespace
sous-acromial). Dans cet article qui est plutt un travail de synthse sur le rle potentiel de
la scapula dans les syndromes de conflit, le nombre de sujets ayant particip ltude nest
pas mentionn.
II.5.3.
Les troubles posturaux
Chez des patients
Greenfield (77) a compar, en position debout, chez trente sujets sains et trente sujets
prsentant une paule douloureuse (surmenage fonctionnel), la mesure clinique de la
posture de la tte, de la cyphose thoracique et de la ceinture scapulaire (antposition et
sonnette), en position debout. Cet auteur a aussi mesur lamplitude passive dlvation du
bras (plan de la scapula). Il rapporte que le groupe des paules douloureuses prsente un
maintien de la tte plus antrieur et une amplitude dlvation du bras plus limite. Ces
diffrences sont significatives (p < 0,001). Lamplitude de lpaule ct douloureux est
aussi limite par rapport au ct sain (p < 0,01). Dans cette tude la courbure thoracique
tend tre plus importante dans le groupe des paules douloureuses (38 contre 34) mais
cette diffrence nest pas significative.
Warner (71) rapporte que la scapula est en attitude dabduction plus marque (aile dange)
en prsence dun conflit sous acromio-coracodien. Dans cette tude la position de la
scapula est mesure avec un procd photographique en Moir, 57 % des sujets atteints
dun conflit ont une attitude en abduction contre 14 % des sujets sains et 32 % des sujets
lpaule instable (population compose de 7 sujets atteints dun conflit, 22 sujets
asymptomatiques et 22 sujets lpaule instable).
Chez des sujets sains
Chez la femme, lge (au-del de 40 ans) et limportance de la cyphose thoracique sont des
paramtres qui peuvent influencer la position de repos de la scapula dans les plans
transversal et sagittal (44). Cliniquement cet auteur constate que la bascule antrieure de la
scapula et la rtroposition de la ceinture scapulaire sont plus marques aprs 40 ans et en
prsence dune cyphose thoracique importante. Lattitude en sonnette nest pas influence
par ces paramtres.
Sans juger le fait quil sagisse dune cause ou dune consquence, dun phnomne
favorisant, aggravant ou entretenant, Kibler (75) constate quune population de sportifs,
suivie pour un conflit sous-acromio-coracodien, prsente une attitude en antprojection du
moignon de lpaule (abduction de la scapula) plus marque par rapport des sportifs sans
conflit.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 32 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Mesure chiffre
Lattitude de repos de la scapula dpend pour une part de lquilibre musculaire priarticulaire et de la courbure thoracique. Une ide de la norme peut tre fournie par le
travail de Pninou (78,79).
II.5.4.
Les gestes-tests
Indpendamment de lutilisation des tests proposs dans les grilles des scores fonctionnels
pour juger du niveau dactivit fonctionnel, il est toujours possible, au cours des sances de
rducation, de recourir aux tests fonctionnels habituels de lpaule (main bouche / tte,
nuque, paule oppose et main / fesse, dos, scapula). Lvaluation chiffre du test main dos
possde une reproductibilit inter et intra-valuateur acceptable (respectivement 0,75 et
0,90) (49). Dans ce test il semble prfrable de mesurer la distance doigt processus pineux
avec lindex pour supprimer linfluence de louverture de la premire commissure (80).
Boussagol (37) propose dutiliser les tests suivants : se coiffer davant en arrire, enfiler
ou ter un chandail par la tte, soulever une bouteille pleine deau bras tendu et se servir
boire .
II.5.5.
Conclusions du bilan fonctionnel
Pour conclure, lexamen du complexe articulaire de lpaule en abduction commence par
ltude du mouvement actif global (sans rsistance) qui permet un abord progressif et
dobserver :
le rythme scapulo-humral (contrle manuel comparatif du dpart de la scapula notamment
en lvation latrale) ;
la prsence dun arc douloureux ;
une ventuelle limitation damplitude lie la douleur, l'articulation ou une rupture
tendineuse ;
les mouvements de la vie quotidienne qui posent problme au patient.
III.
TABLEAU DE SYNTHESE
Au total, les dficits le plus frquemment constats, dans la littrature, en prsence dune
lsion de la CDR sont : la prsence de douleur, une perte (variable) de lamplitude de
llvation latrale du bras, une perturbation du rythme scapulo-humral, une perte de
force musculaire et un dsquilibre entre certains groupes musculaires antagonistes de
lpaule (notamment les rotateurs).
Il est possible de synthtiser les informations fournies par le bilan dans un tableau. Les
lments de bilan retenus sont classs en fonction de laide quils apportent au choix des
techniques, au suivi de la pathologie et lvaluation des rsultats.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 33 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Synthse des indicateurs du bilan kinsithrapique.
Indicateurs de choix des techniques
Indicateurs de surveillance
Prsence dun arc douloureux
Amplitude articulaire (analytique et
globale)
Apprciation de la mobilit (rythme
scapulo-humral, position de la
scapula en fin dlvation)
Apprciation de la consistance et de
la sensibilit musculaire
Apprciation de la force musculaire
Tests et manuvres
IV.
Indicateurs de rsultats
EVA
Score de Constant
Amplitude articulaire (globale
et fonctionnelle)
Prsence dun arc douloureux
EVA
Apprciation
musculaire
Geste le plus gnant dans la vie
quotidienne ou professionnelle
de
la
force
Amplitude articulaire fonctionnelle
Prsence dun arc douloureux
Tests et manuvres
FICHE DE TRANSMISSION
Une fiche de transmission (obligatoire par dcret) est adresse au prescripteur en dbut et
en fin de traitement. Elle synthtise les lments lis aux rsultats thrapeutiques. Le score
de Constant rassemble les informations transmettre aux prescripteurs. Si le praticien
souhaite utiliser un autre score fonctionnel, ce score devra comporter des rubriques sur : la
douleur, la mobilit, la force, les activits de la vie quotidienne et les rsultats des tests et
manuvres dcrits prcdemment.
Nom et ge du patient :
Diagnostic mdical :
Rsultats par rubriques du score de constant
Date de
prescription :
Nombre de
sances
effectues:
Date :
Date :
Date :
initial
intermdiaire
final
Douleur : noter sur 15
Niveau dactivits quotidiennes : noter sur 10
Niveau de travail avec la main : noter sur 10
Mobilit : noter sur 40
Force musculaire : noter sur 25
SCORE TOTAL : noter de 0 100
Valeur fonctionnelle normale selon lge du
patient:
Objectifs et propositions thrapeutiques :
Commentaires :
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 34 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CHAPITRE II - LES
LEPAULE
ETUDES CONCERNANT LA REEDUCATION DE
Lanalyse de la littrature (tableaux 2, 3 et 4) montre que la prise en charge des pathologies de la
CDR comporte au dbut lapplication de techniques kinsithrapiques rputes antalgiques et
anti-inflammatoires en complment du repos et du traitement mdical prescrits dans la mme
intention. Puis la rducation fait appel aux techniques de rcupration damplitude (mobilisation
passive, tirement), de renforcement musculaire et de restitution dun rythme scapulo-humral
normal. Ces techniques sont dbutes prcocement et deviennent progressivement plus intenses
avec la diminution de la douleur et de linflammation.
La prise en charge rapporte dans ces tudes peut durer de 1 2 ou 4 mois. Elle est trs souvent
effectue par le sujet lui-mme qui doit excuter (quotidiennement) un programme dexercices
enseign par un kinsithrapeute au dbut de la prise en charge, puis contrl loccasion des
consultations prvues pour suivre lvolution (annexe 6). Lintervention du kinsithrapeute
prdomine au dpart et consiste essentiellement informer le patient sur sa pathologie et sur les
techniques qui permettent de protger lpaule (apprendre viter ou prvenir la survenue du
conflit sous-acromial au cours de la vie quotidienne...). Le kinsithrapeute applique, enseigne et
fait pratiquer les exercices que le patient devra poursuivre domicile.
I.
LES PROGRAMMES DE TRAITEMENT MASSO -KINESITHERAPIQUES (TABLEAU 2)
Dans les tudes prsentes dans le tableau 2, il faut noter que :
la mobilisation passive et active, les tirements passifs, le stretching sont cits tels quels
(sans prcision sur leurs modalits dapplication) pour rcuprer les amplitudes
articulaires. Ces techniques ne concernent en gnral que larticulation scapulo-humrale ;
le renforcement musculaire sadresse le plus souvent aux muscles rotateurs mdiaux et
latraux et vise rendre plus efficace leur fonction de stabilisation de la tte humrale. Il
peut tre isomtrique et dynamique, et est le plus souvent excut contre rsistance
lastique progressivement croissante. Il ne sintresse que rarement aux muscles moteurs et
fixateurs de la scapula ;
les techniques de rcupration dun rythme scapulo-humral normal ne sont pas toujours
prsentes et elles ne sont pas dtailles ;
lvaluation de lefficacit des techniques utilises porte le plus souvent sur la douleur, les
scores obtenus sur des chelles fonctionnelles de lpaule, sur la rcupration de la force et
des amplitudes ou encore sur la satisfaction globale du sujet aprs traitement.
Deux tudes ont compar leffet de la rducation celui de la chirurgie.
Pour Brox (81, 82), la chirurgie ou la rducation sont suprieures labsence de
traitement.
Rahme (83) trouve un effet lgrement suprieur aprs chirurgie compar la rducation
dans le cas de douleur chronique. Sur ce travail, il faut faire des rserves mthodologiques
car une partie de la population a chang de groupe en cours dtude. Vecchio (84) a
effectu un suivi longitudinal de patients gs sur trois ans. Il trouve des patients dont les
douleurs persistent aprs diffrents traitements (infiltration, prise anti-inflammatoire,
rducation). Il en dduit que lvolution naturelle de la maladie est identique avec ou sans
traitement. Dans ce travail, il y a trop de perdus de vue pour conclure.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 35 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 2. Les tudes concernant les techniques masso-kinsithrapiques.
Auteur,
Pathologie
anne,
ou diagnostic
(rf.)
Ginn, 1997 (85) douleur paule
Prospectif
unilatral (sens
randomis
large + surtout
tendinite et
atteinte de
coiffe)
Morrison, 1997
(8)
Rtrospectif
conflit /
pas de rupture
Vecchio, 1995
(86)
Suivi
longitudinal
conflit /
tendinite /
rupture
Population
Traitement tudi
Traitement
comparatif
71 sujets / >18 ans /
rpartition en 2
groupes / groupe
physiothrapie /
groupe sans
traitements /
physiothrapie base
sur stretching /
tirement /
renforcement /
gain damplitude /
(4 10 sances
sur un mois)
+ travail domicile
absence de
traitement
(un mois)
616 sujets / 636
paules / rpartition
en trois groupes /
groupe aigu (douleur
< un mois) / groupe
non aigu (un six
mois) / groupe
chronique
(> six mois)
136 sujets gs
(elderly) prsentent
des douleurs d'paule
/ 3 ans aprs, 108
sujets sont revus /
l'examen clinique
montre une
persistance de signes
pour 80 sujets (74 %)
Indices
mesurs
Rsultats
Conclusion
auteurs
douleur EVA 2 / amlioration peu significative
pas de
gne fonctionnelle pour la douleur (p = 0,10) et rcupration sans
/ amplitude
gne fonctionnelle (p = 0, 03) / traitement / un
abduction, flexion
augmentation de mobilit
mois physioth.
/ force abduction
(abduction :
entrane une
p = 0,006 ; flex :
amlioration
p = 0,04)/ augmentation de
fonctionnelle
force (ns : p = 0,27) perdus de
vue 7 %
questionnaire sur 67 % rsultats > 0 / diffrence
pas de
la douleur / statut significative (p < 0, 018) en
commentaires
prof / rcidive /
faveur Groupe 1 (78 %) /
spcifiques
satisfaction /
Groupes 2 et 3
chelle
(63 et 67 %) / 28 %
fonctionnelle
non amliors
paule UCLA
AINS 3 trois semaines + non applicable
physiothrapie aprs
phase inflammatoire /
tirement tissus mous /
gain ampl /
renforcement muscles
RM / RL / 4
renforcement du
deltode viter
47 ont suivi un
pas de traitement douleur (repos, 3 ans aprs pas de diffrence pour ce type de
traitement / 33 n'en ont
nuit, mouvement, entre ceux qui ont t traits et sujets les douleurs
pas suivi / peut avoir
contraction
ceux qui ne l'ont pas t
dpaule semblent
t : injection de
rsiste) EVA /
persister avec ou
strodes / AINS /
activits
sans traitement
physiothrapie (sans
fonctionnelles /
plus de prcisions)
amplitude active /
passive / arc
douloureux
chelle Visuelle Analogique
anti-inflammatoire non strodien
4
rotation mdiale/rotation latrale
3
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / avril 2001
- 36 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 2 (suite). Les tudes concernant les programme de traitement masso-kinsithrapiques.
Auteur,
anne,
(Rf.)
Conroy,
1998,
(87)
prospectif
randomis
Rahme,
1998,
(83)
prospectif
randomis
Pathologie
ou diagnostic
Population
Traitement
tudi
Traitement
comparatif
Indices mesurs
Rsultats
Conclusion
auteurs
conflit
8 hommes
groupe mobilis =
6 femmes / ge
chaleur / actif /
moyen 50 et 55
stretching /
ans / rpartition
renforcement des
en groupes
muscles rm et rl / mob
mobilis et non tissulaire / massage /
mobilis
ducation protection
paule / mobilisation
type Maitland
(ressemble mobilit
spcifique) dure 30 s.
par direction
(antrieure, post, bas,
axe humrus)
conflit / douleur
42 sujets /
chronique /
rpartition en
dure moyenne groupe a opr
(21) / groupe b
4 ans / non
physioth. (21) /
amliore par
6 mois 11
physiothrapie sujets passent de
ou injection de
a b / 1 an
corticodes
idem 2 sujets /
11 + 2 = groupe
c / 1 an 3
perdus
en b et c
acromioplastie
antrieure
groupe non
mobilis = idem
sauf technique
Maitland
douleur sur 24 h
chelle visuelle
analogique / douleur
test de compression
sous-acromiale /
amplitude / test
fonctionnel
physiothrapie =
douleur repos chelle
infos sur
visuelle analogique /
fonctionnel anat douleur provoque aux
paule / comment
tests "pour out of a
protger l'paule /
pot" = bras 90 de
rtablisement du flex verser un pot d'eau
rythme scapulo/ main nuque
humral /
renforcement /
correction posture
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 37 -
groupe mobilis
douleur sur 24 h
et au test de
compression sont
amliores /
diffrence
significative
(p < 0, 008 et p < 0,
032) / amlioration
sans diffrence entre
les 2 groupes
pour le reste
mobilisation type
Maitland semble
agir sur douleur,
d'autres tudes
sont ncessaires
rsultats considrs
pour douleur
comme > 0 si
chronique
diminution douleur >
traitement
ou = 50 % / 6 mois opratoire semble
rsultats > 0 : groupe meilleur / douleur
a 12/21 / groupe b
semble lie
6/18 / diffrence non bourse synoviale
significative / 1 an
groupe a 16/21 /
groupe b 4/6 / groupe
a + b 23/33
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 2 (suite). Les tudes concernant les techniques masso-kinsithrapiques.
Auteur,
anne,
(rf.)
Wirth,
1997,
(88)
prospectif
(suivi de cohorte)
Brox,
1999,
(81)
prospectif
randomis
Pathologie
ou diagnostic
Population
Traitement tudi
rupture coiffe des 60 sujets ayant une
programme
rotateurs /
rupture (avec
d'orthothrapie
syndrome voluant
diagnostic
progressive base
depuis 19 mois en
radiologique) sur
d'tirements / de
moyenne
une population de
renforcement des
721 sujets vus entre muscles de la cdr, du
1981 et 1992 / ge
deltode et des
moyen 64 ans
stabilisateurs de la
scapula / programme
s'talant sur 4 mois
conflit de stade II
Traitement
comparatif
non applicable
Indices mesurs
Rsultats
chelles
amlioration
d'valuation
significative pour
fonctionnelle de
tous les sujets et
l'paule : UCLA et les deux chelles /
american shoulder
l'valuation
and elbow surgeon compare les scores
evaluation form
de dbut et 2 ans
minimum
125 sujets / ge
groupe chirurgical = groupe placebo =
principal =
moyen 48 ans (18
acromioplastie
laser non branch
score chelle
66) / douleur depuis
antrieure sous
12 sances en 6
fonctionnelle
paule
au moins 3 mois /
arthroscopie +
semaines
de
Neer
/
rsultats
rpartition alatoire
physioth. j1 postconsidrs comme
/ groupe chirurgie
opratoire
bons si score > 80
(45) / groupe
placebo (30) /
groupe exercices =
groupe exercices
mouvements
relaxants
(50)
en suspension /
progressivement
renforcement muscles
coiffe et fixateurs
scapula / dure 3 6
mois exercices
domicile
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 38 -
Conclusion
auteurs
un programme de
rducation simple
peut amliorer
douleur et fonction
de l'paule
taux de russite 2, 2, 5 ans chirurgie
5 ans > pour groupe et traitement non
chirurgical (26/38)
opratoire
et groupe exercices (exercices) ont plus
(27/44) / groupe grande russite que
placebo (7/28) /
placebo
diffrence
significative
(p < 0,01)
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 2 (suite). Les tudes concernant les techniques masso-kinsithrapiques.
Auteur,
anne,
(rf.)
Brox, 1993
(82)
prospectif
randomis
Hawkins,
1995,
(39)
suivi
longitudinal
Pathologie
ou diagnostic
Population
Traitement
comparatif
Indices mesurs
conflit stade II /
125 sujets /
MK = manuvres
douleur paule
rpartition
dcontracturantes /
depuis au moins 3
alatoire en
reprogrammation du
mois / rsistante
groupe MK,
rythme scapulo-humral /
traitement
groupe
renforcement musculaire
conventionnel
chirurgical. et progres. fixateurs scapula.
(physiothrapie / groupe placebo Chirurgical = bursectomie
AINS et strodes)
/ rsection acromion
placebo = laser
dbranch
(12 sances en
6 semaines)
score fonctionnel
paule de Neer
(valuation en
aveugle) /
valuation
subjective de la
douleur (jour,
activit, nuit)
6 mois score moyen de MK = solution pour
Neer groupe placebo
traiter lsion cdr /
diminue de 0,3 / groupe
Chirurgical =
chirurgical augmente de solution alternative
20 / groupe mk augmente
de 10,8 /
p < 0,001 entre groupes
placebo et groupes
chirurgicaux et mk / pas de
diffrence significative
entre groupes
chirurgicaux et MK
douleur paule non
aigu / en rapport
avec rupture de la
coiffe des rotateurs
(full thickness tears
of the rotator cuff)
non applicable
chelle
fonctionnelle paule
de constant / ampl
active, passive /
capacit maintien
lv, rl passive,
force (abduction, rl)
/ indice de
satisfaction (chelle
0 10 )
21 sont satisfaits du
perte sommeil /
traitement / 12 non
indemnit
satifaits dont10 optent
compensatoire /
pour chirurgical / pas de
semblent
diffrence significative au prdictrices dun
score initial de Constant / chec du traitement
score final force groupe 1
non op / non
> groupe 2 (p = 0, 008) / douleur, utiliser bras
score d'ensemble groupe 1
hauteur p,
porter15 livres = le
> groupe 2
mieux corrls
satisfaction
(p = 0, 038)
traitement non op /
pas de corrlation
avec variables
objectives
50 sujets / 33
l'analyse finale /
recul moyen 3, 8
ans / ge moyen
59, 6 /
rpartition en
groupe 1 =
satisfait du
traitement non
opr / groupe 2
= non satisfait
(= opte pour
chirurgical ou
note < 2 sur
chelle de 0
10)
Traitement tudi
physiothrapie /
augmentation progressive /
programme d'exercices
quotidiens 10/sem. puis
3/sem / comporte rot m/l,
f/e petite ampl, add scap
bilat, ducation
abduction (f/rm), f/e gde
ampl, pnf avec charges
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 39 -
Rsultats
Conclusion
auteurs
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Trois auteurs ont ralis des revues de synthses (26, 89, 90). Ces auteurs constatent
notamment que les tudes qui cherchent valider lutilisation des techniques massokinsithrapiques dans les pathologies de lpaule douloureuse ne sont pas assez
nombreuses, que celles qui existent ne respectent pas suffisamment les critres
mthodologiques ncessaires lobtention de rsultats objectifs permettant de conclure
fermement lefficacit ou linefficacit des techniques employes.
Selon van der Heijden (90) la seule conclusion qui semble devoir simposer concerne
linefficacit des techniques physiothrapiques (ultrasons et lectrothrapie) testes dans
les diffrentes tudes revues, ou la faiblesse relative de leur effet (lectromagntothrapie)
sur lpaule douloureuse et sa symptomatologie. Ceci semble bien confirm par ltude
prospective de van der Heijden (80) qui montre que les courants interfrentiels et les
ultrasons pulss nont pas plus deffet sur lpaule douloureuse quun placebo de ces
techniques ou la simple attente.
Les programmes de kinsithrapie (mobilisation, tirement musculaire, renforcement
musculaire, reprogrammation neuromotrice) ont t tudis par des tudes comparatives
(85, 87). Ils montrent des rsultats sur le gain d'amplitude et la rcupration fonctionnelle
de l'paule. D'autres tudes sont promouvoir.
II.
LES
DIFFERENTES TECHNIQUES OU CONCEPTS
INDIVIDUELLEMENT)
(TECHNIQUES
ETUDIEES
Le traitement masso-kinsithrapique labore un programme thrapeutique pour agir sur
les ventuels dficiences de l'paule susceptibles de participer lexistence dune lsion de
la CDR. La lutte contre la douleur ou l'inflammation, la rcupration ou l'augmentation de
la mobilit articulaire, le renforcement musculaire et la reprogrammation neuromusculaire
sont les principaux mode d'action de la kinsithrapie.
Nous prsentons les diffrentes techniques de kinsithrapie avec leurs objectifs et les
tudes disponibles ayant tudi leur efficacit.
II.1.
Les agents physiques antalgiques ou anti-inflammatoires
Lintensit de la douleur nest pas directement en relation avec la gravit des lsions. La
douleur nest pas en soi une contre-indication la kinsithrapie, elle doit tre interprte
(accord professionnel).
II.1.1.
Les diffrents agents physiques
Les ultrasons en mode puls, llectrothrapie agissant sur le systme du gate control, le
laser, llectromagntothrapie, lapplication de glace, le massage notamment de type
friction sont parfois voqus pour lutter contre la douleur et l'inflammation.
II.1.2.
Les ultrasons en mode puls (tableau 3)
Ils sont habituellement utiliss dans cette indication pour leurs effets antalgique et antiinflammatoire.
Leffet des ultrasons (en mode puls) sur la douleur a t compar celui dun appareil
dbranch dans quatre tudes. Dans tous les cas aucune diffrence significative na t
retrouve. Ces tudes sont dune faible puissance statistique et ne portent que sur la
douleur (et pas sur la cicatrisation). Leffet des ultrasons sur la douleur dans les
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / avril 2001
- 40 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
pathologies de la CDR nest pas dmontr (grade C). En ltat actuel des connaissances
lutilisation des ultrasons nest pas recommande.
Ebenbilcher (91) rapporte que lapplication dultrasons en mode puls (24 sances sur 6
semaines) aide faire disparatre ou diminuer les calcifications tendineuses et permettent
ainsi damliorer la qualit de vie plus rapidement quun traitement placebo comparatif (p
= 0,03 6 semaines et p = 0,002 9 mois). Il faut remarquer quil ne sagit l que dune
seule tude (aucune autre tude na t retrouve). Si cette tude est mthodologiquement
bien conduite, le rythme des sances y est assez astreignant, et elle ne met en vidence que
des effets sur le court terme.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 41 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 3. Les tudes concernant les ultrasons.
Auteur,
anne,
(rf.)
Gam,
1998,
(92)
prospectif
randomis
Nyknen,
1995,
(93)
prospectif
randomis
Van der Heijden,
1999,
(80)
prospectif
randomis
Pathologie
ou diagnostic
Population
myofascial trigger 67 sujets /18 60
point (mtrp )
ans / rpartition
paule, cou /
alatoire / 3
mtrp = duret et
groupes a b c /
consistance
perdus 9
altres la
palpation
tendinite supra
pineux / conflit
sous-acromial /
douleur > 2 mois
Traitement
tudi
groupe a = ultrasons
/massage/exercices
(2 sances/semaine)
dure 5 semaines
(semaine 1 = test)
Traitement
comparatif
groupe b =
index douleur
placebo ultrasons
mtrp / douleur
massage exercices (repos, activits de
/
la vie quotidienne)
groupe c = rien
/ amlioration
ressentie par les
sujets
67 sujets /
ultrasons pulss (dure 10 placebo ultrasons
rpartition
min) / 10 12 sances en 3
+ idem
alatoire / groupe 4 semaines + physiothrapie
a ultrasons (35) /
(massage / tirement /
groupe b placebo
renforcement muscles
(32)
scapulo-humraux et
cervicaux)
douleur paule
180 sujets / ge > groupe 1 lectrothrapie +
provoque par le
18 ans / inclus
ultrasons / groupe 2
mouvement ou
dans tude si
lectrothrapie + placebo
une partie du
douleur pas
ultrasons / groupe 3 placebo
mouvement /
amliore par 6
lectro + ultrasons
mobilit restreinte
sances de
par lsion des
physioth. en 2
parties molles
semaines /
rpartition
alatoire en 5
groupes
Indices
mesurs
groupe 4 placebo
lectrothrapie +
placebo ultrasons /
groupe 5 rien / +
au max 12 sances
d'exercices en 6
semaines
Rsultats
Conclusion
auteurs
pour groupes (a et
ultrasons pas
b) / c, index mtrp
efficaces /
plus bas (p < 0,05)
massage +
/ pas de diffrence exercices ont effet
pour le reste
lger sur mtrp
douleur chelle
amlioration
lefficacit des
visuelle
significative pour ultrasons est mise
analogique /
tous les indices /
en doute
amplitude
pas de diffrence
abduction / arc entre les 2 groupes
douloureux / test
suprapineux
valuation sur
chelle de Lickert
(1 7) / 1 = very
much worse / 7 =
very large
improvement /
suivi 6 semaines
/ 3, 6, 9, 12 mois /
shoulder disability
questionnaire /
val. par praticien
(chelle visuelle
analogique) aprs
examen clinique
standard
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / avril 2001
- 42 -
6 semaines vont llectrothrapie et
mieux =
les ultrasons ne
sont pas efficaces
chelle 7 : 20 %
groupe 5 / 23 %
et 22 % groupe
lectrothrapie
relle et placebo /
26 % et 19 %
ultrasons rels et
placebo / 3 mois
ces chiffres
montent 40 %
environ puis se
stabilisent
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 3 (suite). Les tudes concernant les ultrasons.
Auteur,
anne,
(rf.)
Berry, 1980
(94)
prospectif
randomis
Pathologie ou
diagnostic
Population
Traitement
tudi
Traitement
comparatif
douleur paule lie
60 sujets /
groupe 1
placebo ultrasons
lsion coiffe des rpartition alatoire
acupuncture /
rotateurs / paule en 5 groupes de 12 groupe 2 injection
raide exclue
strodes + placebo
tolmdine (AINS) /
groupe 3 injection
strodes +
tolmdine / groupe
4 physio = ultrasons
(8 sances de 10
min) / groupe 5
placebo ultrasons +
tolmdine
Indices
mesurs
douleur chelle
visuelle analogique
/ amplitude
abduction /
amlioration
ressentie par sujet et
note par valuateur
/ russite ou chec
si valuateur dcide
injection strodes /
effets secondaires
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 43 -
Rsultats
Conclusion
auteurs
rsultats > 0 pour amlioration lie
tous les groupes et volution naturelle
pour tous les
du phnomne /
indicateurs / pas de aucun traitement ne
diffrence
semble efficace
significative inter
groupe / tendance
rsultats > pour
groupe placebo
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 3 (suite). Les tudes concernant les ultrasons.
Auteur,
anne,
(rf.)
Ebenbilcher,
1999,
(91)
prospectif
randomis
Elleuch,
1992,
(95)
Pathologie
ou diagnostic
Population
Traitement
tudi
tendinopathie
calcifiante de
lpaule (dense
et bien
circonscrite la
radiographie) /
sujet non retenu
si injection de
corticodes au
cours des 3 mois
prcdents ou
prise rgulire
dantalgiques
54 sujets (61 paules)
/ rpartition alatoire
par paule en groupe
ultrasons (32) et
groupe placebo (29)
paule
douloureuse par
conflit (rupture
exclue) /
voluant depuis
2 mois 5 ans
100 sujets / 54
physiothrapie / 5
hommes/ 46 femmes/ 10 min ultrasons /
ge moyen 49 ans / 9 prise de conscience
atteintes bilatrales / scapulo-thoracique /
96 paules retenues
apprentissage
(recul 4 30 mois) /
recentrage tte
humrale
13 limins
proprioception /
radaptation vie
(recul insuffisant))
quotidienne
Traitement
comparatif
Indices
mesurs
ultrasons pulss (1/4) placebo ultrasons
volution
/ frquence 0,89 mhz
radiographique
/ intensit 2,5 cm2 /
calcification 6
tte us = 5 cm2 / 24
semaines et 9
sances en 6 semaines
mois / score de
(15 sances
Constant / douleur
quotidiennes puis 3 /
score de Binder
semaine)
(douleur
subjective /
mouvement
contrari / score
de 0 52)
non applicable
intensit douleur
(chelle subjective
0 6) / impotence
fonctionnelle
(apprciation
subjective 0 3) /
impression
globale sujet (0
3) / total le +
mauvais = 12
Rsultats
Conclusion
auteurs
6 semaines groupe
ultrasons pulss
ultrasons : calcification
permet volution
disparue, 6 paules (19 %) /
et rcupration
diminue de 9 paules
fonctionnelle plus
(23 %) / groupe placebo : rapide en prsence
disparue, 0 paule /
de calcification
diminue de , 3 (10 %) / p
tendineuse
= 0,003 entre les 2 groupess
/ 9 mois groupe ultrasons
disparue, 13 paules (32 %)
/ amliore, 7 (23 %)
/groupe placebo disparue 2
(8 %) / amliore 3 (12 %)/
p = 0,002 / douleur
amlioration > et meilleure
qualit de vie pour groupe
ultrasons / score de Constant
p = 0,002 6 semaines
et p = 0,52 9 mois
72 % bons rsultats
(< ou = 4) / 12, 5 %
rsultats moyens
5 8) / 15, 5 %
mauvais rsultats (> 9)
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 44 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
II.1.3.
Llectrothrapie
Van der Heijden (80) (tableau 3) a mesur leffet de llectrothrapie sur la douleur
(courant bipolaire de basse frquence) en comparant les effets obtenus dans quatre groupes
de sujets traits diffremment (lectrothrapie + us , us + lectrothrapie placebo, us
placebo + lectrothrapie placebo, groupe tmoin). Aucune diffrence significative na t
retrouve sur lvolution de la douleur entre les groupes (grade C). Ltat des
connaissances actuelles ne permet pas de recommander lutilisation de llectrothrapie
antalgique dans les pathologies de la CDR.
II.1.4.
Llectromagntothrapie (tableau 4)
Deux tudes ont des rsultats contradictoires (grade C). Le groupe de travail attend la
parution dtudes complmentaires. En ltat actuel des connaissances lutilisation de
llectromagntothrapie nest pas recommande.
II.1.5.
Le low laser (tableau 4)
Vecchio (84) a tudi leffet du low laser associ diffrents exercices, compar un
placebo. Il ny a pas de diffrence significative entre les rsultats obtenus dans les deux
groupes malgr lamlioration des paramtres mesurs. Saunders (96) rapporte que le low
laser a un effet positif dans le traitement de la douleur des tendinites du supra-pineux et
de ses rpercussions fonctionnelles (p < 0,05) par rapport leffet obtenu sur la mme
pathologie avec un laser dbranch. Cependant comme le fait remarquer lauteur, le
nombre de sujets observs dans cette tude est insuffisant pour permettre de conclure
fermement lintrt du laser dans le traitement des tendinopathies. (voir van der Heijden
(97) ce propos). Leffet du laser sur la mobilit et la douleur na pas t dmontr (grade
C). En ltat actuel des connaissances lutilisation du low laser nest pas recommande.
II.1.6.
Lapplication de source de chaleur
Aucune tude na t retrouve sur lintrt dutiliser la chaleur dans les pathologies de la
CDR. Lutilisation de la chaleur est prconise par Hjelm (50) pour faciliter les tirements
des structures priarticulaires (augmentation de lextensibilit tissulaire lie
laugmentation de temprature). Lapplication de chaleur au cours du traitement de
kinsithrapie nest pas recommande (accord professionnel). Cette application peut
seffectuer comme adjuvant en dehors des sances de traitement.
II.1.7.
Le froid
La cryothrapie (massage la glace, application de froid) est un adjuvant qui na pas fait
lobjet dtude prcise dans les lsions de la CDR. Lapplication de froid au cours du
traitement de kinsithrapie nest pas recommande (accord professionnel). Cette
application peut seffectuer comme adjuvant en dehors des sances de traitement.
II.1.8.
Le repos
La mise au repos de lpaule au moins par la suppression des activits qui occasionnent la
souffrance de la CDR est sans doute un facteur qui participe une volution favorable de
la douleur. Par contre linactivit prolonge participe la perte de mobilit et de force
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 45 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
musculaire. La mise au repos et limmobilisation ventuelle de lpaule douloureuse ne
sont pas recommandes en dehors des crises hyperalgiques (accord professionnel).
II.1.9.
Le massage
Lutilisation des techniques de massage na fait lobjet daucune tude. La pratique du
massage est en gnral apprcie par les patients et il est probablement intressant de
lutiliser, ne serait-ce qu ce titre. dfaut de permettre dagir directement sur la
pathologie elle-mme, le massage autorise un abord progressif de la rgion de lpaule, il
permet de diminuer les contractures rgionales qui accompagnent les lsions de la CDR et
il contribue ainsi librer la mobilit articulaire (scapula par rapport au thorax). Il permet
aussi de pratiquer progressivement des techniques de mobilisation passive douce et de
dbuter lducation du patient. Lensemble de ces techniques peut tre mis en place
prcocement, la priode douloureuse. La pratique du massage transversal profond dcrit
par Cyriax pour ses effets antalgique, anti-inflammatoire et cicatrisant est sans doute assez
illusoire tant donn la difficult de labord palpatoire direct des tendons de la CDR. Les
techniques de massage n'ont fait l'objet d'aucune tude. Il s'agit d'un adjuvant aux autres
techniques de kinsithrapie.
Le massage transversal profond des tendons de la coiffe des rotateurs n'est pas
recommand (accord professionnel).
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 46 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tableau 4. Les tudes concernant llectromagntothrapie et le low laser.
Auteur,
anne,
(rf.)
Leclaire,
1995,
(98)
prospectif
randomis
Vecchio,
1993,
(84)
prospectif
randomis
Saunders,
1995,
(96)
prospectif
randomis
Chard,
1988,
(99)
prospectif
randomis
Pathologie
Population
ou diagnostic
Traitement
tudi
Traitement
comparatif
Indices
mesurs
douleur chelle
visuelle
analogique /
douleur (repos,
mouvement,
allong) chelle
visuelle
analogique /
amplitude
Rsultats
Conclusion
auteurs
priarthrite
paule /
excluant les
limitations
d'amplitude
svres
dfinies
comme suit :
flex. < 100 /
abduction <
90 / rot
globales = 20
tendinite du
supra-pineux
/ dure
moyenne
douleur 14,9
mois
(4 48 mois)
47 sujets /
lectromagnrpartition
tothrapie +
alatoire /
chaleur /
groupe
tirement
lectromagnt
passif /
o-thrapie / poulithrapie
groupe
(circuit aidant)
placebo
/ actif
appareil
placebo +
idem
35 patients /
low laser +
ge moyen 54 exercices de
ans /
mouvements
rpartition pendulaires de
alatoire /
l'paule
groupe laser
domicile en
(19) / groupe
flexion /
placebo (16)
extension /
abduction /
add
appareil
placebo +
idem
arc douloureux /
amlioration
le low laser
amplitude artic. / dans les deux n'est pas plus
douleur au
groupes / pas de efficace que
mouvement
diffrence
placebo
contrari / chelle
significative
visuelle
entre les deux
analogique
groupes
douleur (nuit,
jour, repos,
mouvement) /
fonctionnel
tendinite du
supra-pineux
/ depuis au
moins 4
semaines /
sans
traitement
depuis la
mme dure /
amplitude
articulaire
normale : /
signe de
conflit > 0
avec
rpercussion
sur test
isomtrique
tendinite
chronique de
la coiffe des
rotateurs
(> 3 mois)
/rupture
exclue
24 sujets / ge low laser (820
35 65 /
nm, 40 mw ,
rpartition
5000hz, 30j
alatoire en
cm2) / 9
groupe laser et sances en 3
groupe laser
semaines /
dbranch
dure
application
=180 s.s
appareil
placebo
douleur chelle
diminution
le low laser
visuelle
significative de
est indiqu
analogique / test la douleur pour
dans le
isomtrique du groupe laser (p < traitement des
supra-pineux /
0,05) / test de
tendinites du
douleur la
force :
supra-pineux
pression exerce
amlioration
sur le tendon
significative
(p < 0,01)
43 sujets /
pemf 8 heures pemf 2 heures
douleur (nuit,
rpartition
/ application
repos,
alatoire /
sur l'paule
mouvement)
groupe 1
chelle visuelle
pulsed
analogique / arc
electromagnet
douloureux
ic fields
abduction /
(pemf) 2
amplitude active,
heures /
passive / douleur
groupe 2 pemf
mouvement rsist
8 heures
/ amlioration
ressentie par sujet
2 et 8 semaines
diminution
llectro
significative
magntodouleur /
thrapie ne
augmentation fait pas preuve
significative
d'efficacit
ampl et
fonctionnelle /
pas de diffrence
entre les deux
groupes
2 et 4 sem.
rsultats > 0
pour groupe 2
diffrence
significat. / 8
sem. rsultats >
0 pour les 2
groupes sur tous
les indices sans
diffrence
significative
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 47 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
II.2.
Techniques destines rcuprer ou augmenter les amplitudes articulaires
II.2.1.
Les techniques de mobilisations articulaires de la ceinture scapulaire et de larticulation
scapulo-humrale
Leroux (41) rapporte que la rducation de dix sujets atteints dun conflit sous-acromial,
base sur la correction dune attitude de protection de lpaule (antpulsion, lvation)
et les techniques de recentrage de la tte humrale (100) ont permis dobtenir :
- une modification du rythme scapulo-humral lors du mouvement dlvation latrale
du bras (p < 0,001, avant et aprs rducation), le rythme scapulo-humral des sujets
rduqus se rapprochant de celui des sujets normaux ;
- une augmentation de langle douverture scapulo-humral (environ 40, p < 0,001,
avant et aprs rducation).
II.2.2.
Les techniques de dgagement ou de recentrage de la tte humrale
tudes portant sur le patient
Dans une tude rtrospective (72 dossiers, 93 paules souffrant dune lsion de la CDR au
stade I et II), Marc (101) rapporte que lapplication de techniques de mobilisations passives
(spcifiques) visant tirer la partie postro-infrieure de lappareil capsulo-ligamentaire
de larticulation scapulo-humrale, couples une mobilisation du bras (dans les 3 plans de
lespace), ainsi que la pratique dexercices de tonification des muscles rotateurs latraux de
lpaule (lectrostimulation et exercices dynamiques rsists) ont permis de corriger de
faon significative le dcentrage de la tte humrale ainsi que damliorer les rsultats
obtenus certains tests diagnostiques dune pathologie de la CDR (Jobe, Yocum, Hawkins
et cross arm). Dans cette tude le dcentrage antrieur de la tte humrale semble tre en
rapport avec les tests de Hawkins et du cross arm et le dcentrage de la tte humrale en
rotation mdiale parat tre en rapport avec les tests de Jobe et de Yocum.
Hjelm (50) rapporte que la pratique de manuvres de mobilisation passive manuelle de la
tte humrale en glissement infrieur (bras 90 dabduction) a permis daugmenter
lamplitude du mouvement dabduction de larticulation scapulo-humrale chez des sujets
atteints de pathologies diverses de lpaule. Dans cette tude les rsultats taient apprcis
sur une chelle de 0 3, 1 point tait attribu pour lamlioration de lamplitude articulaire,
celle de lexcution de certains tests fonctionnels ou pour la diminution de la douleur.
Lamplitude articulaire tait apprcie la fois par un examen clinique et par une mesure
goniomtrique. Les techniques de mobilisation taient appliques durant 20 30 minutes et
visaient amliorer lextensibilit de la partie infrieure de la capsule de cette articulation
(dans cette tude la pratique de ces techniques pouvait conduire des sensations
douloureuses pouvant durer parfois jusqu 24 heures aprs la sance).
Conroy (87) dcrit des rsultats similaires en utilisant la technique de Maitland (tableau 2).
tudes portant sur le sujet sain
Wang (102) rapporte que la pratique dexercices dtirement (stretching) des muscles
pectoraux et de renforcement des muscles rotateurs latraux du bras, lvateurs de la
ceinture scapulaire, abducteurs et adducteurs horizontaux de lpaule (ce dernier exercice
met en jeu les adducteurs de la scapula) a permis notamment de modifier le rythme
scapulo-humral par augmentation de la bascule postrieure de la scapula en fin de
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 48 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
mouvement (tendance non significative) ainsi que de redresser la courbure thoracique (p <
0,01).
II.2.3.
Les techniques d'tirements des muscles de la ceinture scapulaire
Pour cela on utilise essentiellement les techniques dtirement et de tenu relch
(contraction isomtrique contre rsistance manuelle sur une position dallongement
maximal pralable suivie dun relchement et dun tirement manuel progressif). Ces
techniques sadressent aux groupes musculaires dont lextensibilit semble diminue
(parmi les muscles mettre plus particulirement en cause on peut citer le petit et le grand
pectoral, le dentel antrieur et llvateur de la scapula). On fait appel aussi aux
techniques dauto-tirement pratiques par le sujet au cours de la sance et domicile.
Enfin il est ncessaire de procder au renforcement des muscles correcteurs.
Lefficacit des techniques dauto-tirement et du renforcement musculaire sur le
redressement de la colonne thoracique a t rapporte chez le sujet sain par Wang (102).
Notons que selon Girouard (103) la pratique dun renforcement musculaire en parallle la
pratique dtirements (destins amliorer amplitude articulaire et extensibilit
musculaire) diminue le gain damplitude effectif. 31 sujets non entrans (sans pathologie)
participent cette tude (ge moyen 61 ans), 14 suivent un programme de renforcement
musculaire et de stretching, 10 ne font que du stretching (13 exercices dtirement statique
portant sur divers groupes musculaires du corps et tenus chacun 30 sec) et 7 ne font rien.
Le gain damplitude est apprci sur les mouvements dabduction et de flexion de lpaule
(en contrlant la mobilit de la scapula) ainsi que sur celui de flexion de hanche. Aprs 10
semaines dentranement les rsultats de cette tude rapportent une augmentation
significative de la force musculaire (p < 0,001) pour le groupe renforcement et stretching,
un gain damplitude suprieur (p < 0,001) pour le groupe qui na fait que du stretching (par
rapport au 2 autres). Le groupe renforcement et stretching amliore ses amplitudes
seulement au niveau de lpaule (p < 0,01) alors que le groupe contrle lui ne progresse
pas.
Les techniques de mobilisations passives, de mobilisations spcifiques, de tenu-relch,
d'auto-tirement appliques l'ensemble des articulations de la ceinture scapulaire
(articulation scapulo-thoracique, scapulo-humrale, sterno-claviculaire, acromioclaviculaire) sont recommandes pour rcuprer les amplitudes articulaires limites
(accord professionnel).
II.3.
Les techniques de renforcement musculaire
La pratique du renforcement musculaire apparat consensuelle et est prsente dans la
plupart des tudes. Il est logique de dire que le renforcement musculaire doit sadresser aux
muscles qui ont t trouvs faibles lors du bilan.
Brox (81, 82) et Bohmer (66) qui ont montr lintrt de leur traitement kinsithrapique
dans la prise en charge des lsions de la CDR adoptent un protocole de renforcement
progressif (adapt aux possibilits du patient). Les objectifs de ces auteurs sont dabord de
diminuer les contraintes appliques la CDR, de restaurer un programme moteur normal,
et de renforcer la trophicit du tissu collagne. Dans un deuxime temps le renforcement
musculaire mis en place vise amliorer la force et lendurance des muscles scapulaires et
des rotateurs de larticulation scapulo-humrale.
Leur protocole de traitement comporte, au dbut, lapplication de techniques de
dcontraction et de relaxation (techniques manuelles et exercices actifs en suspension
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 49 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
visant reprogrammer le mouvement dlvation latrale) suivies par un travail actif en
suspension, dabord aid puis progressivement rsist et portant notamment sur les muscles
adducteurs et rotateurs de larticulation scapulo-humrale ainsi que sur les adducteurs de la
scapula et le dentel antrieur. La dure de la prise en charge varie de 3 6 mois, les
sances sont quotidiennes et durent une heure. Deux sances par semaine sont effectues
chez un MK, les autres sont pratiques domicile par le sujet seul. La prise en charge
comporte aussi 3 sances dinformation sur la pathologie comprenant notamment des
notions concernant lanatomie, la mcanique fonctionnelle de lpaule et les moyens de
mnager son paule.
Au total il semble que rducation et renforcement musculaires doivent avoir pour
objectifs :
- la restauration du contrle (moteur) effectif de la mobilit physiologique de la scapula
et de lhumrus lors du mouvement dlvation latrale du bras ;
- le rquilibrage des forces musculaires (agonistes et antagonistes) qui assurent la
stabilit de la scapula (lors du mouvement dlvation du bras) et qui contrlent le
placement (vertical et antro-postrieur) de la tte humrale sur la cavit glnodale.
Selon le cas il peut sagir aussi de renforcer les muscles qui corrigent les attitudes (cyphose
thoracique, antprojection de la ceinture scapulaire) susceptibles de favoriser la survenue
dune lsion de la CDR.
Pour lunit scapulo-thoracique le renforcement musculaire sadresse le plus souvent aux
muscles adducteurs de la scapula et au couple dentel antrieur trapze (notamment le
faisceau infrieur) qui assurent la stabilit et la mobilit de la scapula en sonnette latrale
(66, 75, 81, 104, 105).
Pour lunit scapulo-humrale il sagit essentiellement (et plus classiquement) de restaurer
lquilibre entre muscles rotateurs mdiaux et latraux. Il sagit aussi de procder au
renforcement des muscles abaisseurs de la tte humrale (muscles de la CDR et abaisseurs
longs) (51, 100).
Pour conclure, il parat logique de mettre en place un travail musculaire dynamique et
statique destin dvelopper le contrle de la mobilit segmentaire (mobilit de la scapula,
abaissement actif de la tte humrale). Ce travail fait appel des exercices guids
manuellement (non rsist), ventuellement en chane ferme pour fixer lhumrus (75).
Paralllement un travail plutt orient vers le renforcement musculaire est mis en place. Il
doit tre progressif, notamment quand il sadresse aux muscles de la CDR (en fonction de
ltat lsionnel et de la douleur) et ne doit pas entraner de ractions douloureuses ni sur
linstant ni distance.
Le placement des muscles en course interne (secteur de moindre force si lon se rfre la
relation force/longueur) peut tre un moyen dtablir une contraction modre des muscles
lss.
Toutes les techniques permettant dobtenir la contraction musculaire dsire sont
utilisables. Les courants excito-moteurs, les techniques de contraction en chane
(faiblement rsiste au dpart) peuvent aussi tre un moyen intressant pour dbuter le
travail des muscles de la CDR. Ds que possible le renforcement musculaire se poursuit
par un travail analytique (par groupe musculaire), plutt statique et contre rsistance
manuelle (plus adaptable).
Paralllement on met aussi en place un programme dexercices (dynamiques et statiques)
de types fonctionnels en chane ferme (pompes pour le dentel antrieur, tractions bras en
abduction horizontale pour les adducteurs de la scapula, sustentation en appui sur les 2
mains bras le long du corps pour les abaisseurs) contre la rsistance de tout ou partie du
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 50 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
poids du corps (rsistance progressivement croissante) et aussi en chane ouverte.
Rappelons toutefois quil ne sagit pas ncessairement, ici, de faire un athlte du sujet
rduqu.
Sur le plan du renforcement musculaire, aucun des diffrents modes de contraction ne
parat plus particulirement privilgi.
Middleton (106) recommande plutt le travail musculaire excentrique tout comme Stanish
(107). Ce mode de contraction permettrait, selon ces auteurs, dobtenir une cicatrisation
tendineuse de meilleure qualit, il permettrait aussi de mieux prparer les structures
tendineuses subir des contraintes du mme type. Deux remarques simposent ici, dune
part le travail de Stanish concerne plutt le milieu sportif et sadresse aux tendinopathies
en gnral (pas seulement aux tendinopathies de la CDR), dautre part ladaptation des
structures tendineuses lexercice excentrique ne survient qu long terme (9 12 mois),
daprs Woo (108).
Pour terminer, dans beaucoup dtudes, le travail musculaire rsist est pratiqu en tirant
sur des bandes lastiques de raideur variable, progressivement croissante. Les exercices
sont entrepris au dbut sous contrle dun kinsithrapeute puis poursuivis domicile
(annexe 6).
Dans ces conditions, la surveillance de la pratique effective ainsi que la faon de raliser
les exercices sont difficiles.
Pratiquement toutes les tudes comparatives comprennent des techniques de renforcement
musculaire dans leurs protocoles. Aucune modalit (concentrique, isomtrique,
excentrique, isocintique) n'a dmontr sa supriorit.
Les techniques de renforcement musculaire ont pour but d'augmenter la force des muscles
scapulaires et plus particulirement les muscles rotateurs de la scapulo-humrale et de
mieux stabiliser l'articulation.
Il est recommand d'inclure dans tous les protocoles de kinsithrapie des techniques de
renforcement musculaire (accord professionnel).
II.4.
Les techniques de reprogrammation neuromusculaire
Certains auteurs insistent sur la ncessit dobtenir le contrle moteur effectif de la
cintique normale du mouvement dlvation du bras, cest--dire le rtablissement du
rythme scapulo-humral (66, 75) et labaissement de la tte humrale, avant denvisager le
renforcement musculaire proprement dit. Il sagit en fait dobtenir le rapprentissage, la
reprogrammation dun mouvement dont le programme moteur (pattern) est perturb.
Ceci sobtient notamment par la rptition du geste jusqu son automatisation.
II.4.1.
Les voies de passage
En ce qui concerne les techniques dites dapprentissage des voies de passage dcrites
par Sohier (ces techniques visent viter le frottement des tendons de la CDR sous la
vote acromio-coracodienne), seule la voie latrale est justifie affirme Vaillant (109).
Pour cela, Vaillant sappuie sur des travaux de Gagey qui rapporte que lors des
mouvements de larticulation scapulo-humrale le tubercule majeur sengage sans
problme sous la vote acromio-coracodienne quelle que soit la position de lhumrus,
sauf si celui-ci est en rotation mdiale maximale (43). Nanmoins, pour Vaillant la voie
de passage latrale ne peut tre quune tape de la rducation puisque le membre
suprieur est essentiellement utilis en lvation rotation mdiale (109).
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 51 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
II.4.2.
Le recentrage actif
Les techniques d'abaissement de la tte humrale cherchent suppler au dficit de la CDR
(au cours du mouvement dlvation latrale) et diminuer les contraintes exerces sur les
tendons de la CDR. En fonction du stade dvolution de la lsion et des rsultats de
lexamen clinique on cherche soit duquer la mise en jeu (volontaire puis automatise)
des muscles abaisseurs longs (grand pectoral, grand dorsal et grand rond) lors du
mouvement, soit enseigner le placement de la scapula en sonnette mdiale (position
privilgie de lpaule dcrite par Gagey (110) avant de procder llvation du bras
grce la mobilit de larticulation scapulo-thoracique, la contraction du deltode se
chargeant de verrouiller larticulation scapulo-humrale en abduction.
Barbier (111) rapporte que labaissement actif de la tte humrale nest efficace, pour
augmenter la hauteur de lespace sous-acromial, quen prsence dune sonnette mdiale
(20 sujets jeunes et sans pathologie p < 0,003). La hauteur de lespace sous-acromial est
mesure sur une radiographie au repos et au cours dun exercice dabaissement actif de la
tte humrale. Lauteur fait remarquer que les muscles responsables de labaissement actif
de la tte humrale sont aussi moteurs du mouvement de sonnette mdiale, et pose la
question de la ncessit de procder lducation en parallle des mouvements de sonnette
mdiale et dabaissement actif de la tte humrale, pour obtenir leffet escompt par cet
apprentissage.
Afonso (112) rapporte que lapprentissage de labaissement actif de la tte humrale (6
sances de 20 min rparties sur 3 semaines) peut tre efficace (p < 0,001). 22 sujets jeunes
et sans pathologie ont particip cette tude qui consistait comparer la mesure de la
hauteur de lespace sous-acromial (sur une radiographie) au cours de la manuvre de
Leclerq (mesure radiographique de la hauteur de lespace sous-acromial bras maintenu
20 dabduction de lpaule contre une charge de 2 kg tenue dans la main) double dun
effort dabaissement actif de la tte humrale, avant et aprs la priode dapprentissage.
En conclusion, les rsultats de ces auteurs semblent plaider (au moins dun point de vue
thorique) pour l'utilisation des techniques de dgagement de la tte humrale prconises
par divers auteurs (113-115). Aucune tude comparative portant sur des patients n'a t
ralise. Actuellement il ny a pas de consensus sur lintrt de labaissement actif de la
tte humrale. Si ces techniques semblent tre justifies au moins sur le plan thorique, des
tudes complmentaires sont ncessaires.
II.4.3.
La rcupration d'un rythme scapulo-humral physiologique
Dans ce cas, le patient doit effectuer un mouvement proche de la normale. Le patient est
guid pour placer sa scapula au cours des mouvements d'lvation latrale, le but tant
d'utiliser un quilibre entre la mobilit scapulo-humrale et scapulo-thoracique. Cette
technique est utilise dans les programmes de traitement prsents dans le tableau 2.
Comme pour le recentrage actif, il est demand d'abaisser le moignon de l'paule (sonnette
mdiale de la scapula) avant d'effectuer l'lvation latrale.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 52 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CHAPITRE III - Q UELLE REEDUCATION PROPOSER EN FONCTION
DU TYPE DE LESION DE LA COIFFE DES ROTATEURS ?
I.
DANS LA TENDINOPATHIE CALCIFIANTE DE LA CDR
La tendinopathie calcifiante de la CDR est dfinie comme le dpt de cristaux dapatite
dans lpaisseur dun des tendons de la CDR (116,117). Dtiologie mal connue (faisant
intervenir des facteurs dgnratif, ischmique et mtabolique), bien circonscrite ou plus
diffuse, cette affection touche le plus souvent le tendon du muscle supra-pineux. Souvent
asymptomatique (1 fois sur 2), douleur et gne fonctionnelle en sont les manifestations les
plus courantes lorsque cette affection sexprime.
La tendinopathie calcifiante volue en gnral spontanment vers la disparition (vacuation
dans la bourse sous-acromiale) sur une dure assez longue (en moyenne 3 5 ans),
comprenant des priodes de souffrance aigu sur fond de douleur chronique (une crise
hyperalgique voque la vidange de la calcification dans la bourse sous-acromiale) (116).
Cette pathologie relve avant tout dun traitement mdical, parfois accompagn dune prise
en charge kinsithrapique lorsque lon retrouve des limitations damplitude.
II.
DANS LES
TENDINOPATHIES SIMPLES ET DANS LES RUPTURES TENDINEUSES
DE LA CDR
Nous navons pas retrouv dans la littrature de prise en charge masso-kinsithrapique
particulire suivant le degr de latteinte des tendons de la CDR. Wirth (88) et Hawkins
(39) ont tudi lapplication des techniques de renforcement musculaire sur des patients
atteints de rupture totale et ont montr un rsultat positif. En ce qui concerne labaissement
actif de la tte humrale, et suivant le type de lsion de la CDR, il est possible de
privilgier plutt le travail de supplance active par les abaisseurs longs ou plutt
lapprentissage de la position privilgie de lpaule dcrite par Gagey (110) lorsque la
rupture est importante, nanmoins ces deux techniques ne sont somme toute pas si
diffrentes.
Dans le cadre de rupture de la coiffe des rotateurs, l'utilisation de techniques de
renforcement des muscles rotateurs est recommande. En cas d'chec du renforcement il
faut mettre en place des compensations articulaires (surtout scapulo-thoracique) (accord
professionnel).
II.1.
Particularits des patients en arrt de travail
Diffrentes situations professionnelles nocives peuvent tre lorigine de pathologies de la
coiffe des rotateurs :
- les contractions statiques ralises par des postures prolonges, rptes, les bras au
niveau des paules, ou a fortiori au-dessus ;
- les contractions dynamiques ralises de manire rpte par les muscles de lpaule ;
- le soulvement ou le maintien doutils pesants au niveau ou au-dessus du niveau des
paules ;
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 53 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
lutilisation manuelle dengins anims de vibrations, bras levs lhorizontale ou audessus.
ces facteurs prdisposants, il convient dassocier la comprhension de lorganisation du
travail (rendement, pauses).
Le kinsithrapeute a pour objectif d'amener le patient un niveau fonctionnel en
adquation avec ses activits socioprofessionnelles. Si le patient est en arrt de travail il
faut lui conseiller de se mettre en relation avec le mdecin du travail pour organiser
prcocement les modalits de la reprise de ses activits professionnelles (accord
professionnel).
II.2.
Comment sorganise la rducation ?
La dure des traitements varie de deux quatre mois, car les programmes de renforcement
musculaire ncessitent un dlai assez long pour modifier la structure musculaire.
Le rythme des sances est en gnral de deux trois sances par semaine, ce qui semble
correspondre une prise en charge raisonnable, avec la ncessit pour le patient de
pratiquer quotidiennement les exercices dtirement (stretching) et de renforcement
musculaire progressif que lui aura indiqus le kinsithrapeute. Ce rythme peut varier en
fonction de l'tat du patient.
En l'absence totale d'amlioration du score fonctionnel utilis au terme des 20 premires
sances de kinsithrapie, il est recommand de rvaluer l'indication thrapeutique.
En cas de stagnation des rsultats ou d'aggravation des symptmes, il convient d'informer
le prescripteur (accord professionnel).
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 54 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CHAPITRE IV - PROPOSITIONS DACTIONS FUTURES
Le groupe de travail a constat l'absence d'essais randomiss sur la kinsithrapie des pathologies
de la coiffe des rotateurs en France. Il encourage la recherche franaise dans ce domaine.
Le plurimtre de Rippstein est peu disponible en France alors qu'il est couramment utilis dans les
pays anglo-saxons ; il est souhaitable qu'il soit mieux diffus chez nous car il est simple d'utilisation
et rapporte des donnes fiables.
En ce qui concerne les techniques de recentrage, de renforcement des muscles abaisseurs ou de
rducation du rythme scapulo-humral, les rsultats cliniques quelles permettent dobtenir doivent
faire lobjet dtudes comparatives.
Du point de vue gnral, les causes profondes de la survenue des douleurs de lpaule sont
explorer, de manire mieux les traiter.
Dans les pays anglo-saxons, des fiches dexercices sont donnes aux patients pour complter le
traitement (annexe 6). Le contrle de ce travail est difficile effectuer par le thrapeute.
Toutefois, la participation du patient son traitement en dehors des sances et lentretien de ce qui a
t acquis larrt du traitement sont encourager. Une rflexion en termes dducation du patient
est mener dans ce domaine.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 55 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANNEXE 1 E XAMEN
LEPAULE
DE TYPE
CYRIAX
ET DIAGNOSTIC DE
Tableau. Les techniques dexamen clinique des paules douloureuses selon Cyriax, dcrites par Pellechia,
1996 (27)
Diagnostic
Observations lexamen primaire
Arthrite (capsulite)
Mobilit limite en schma capsulaire, cest--dire perte damplitude de la
rotation latrale plus importante que labduction, plus importante que la rotation
mdiale
Tendinite du sus-pineux
Abduction contrarie douloureuse. Signes complmentaires : Arc* douloureux,
douleur en lvation passive complte.
Bursite chronique sous-deltodienne
Arc* douloureux
Tendinite du sous-pineux
Rotation latrale contrarie douloureuse. Signes complmentaires : arc*
douloureux, douleur llvation passive complte
Entorse acromio-claviculaire
Mouvements passifs douloureux en fin de course. Adduction horizontale
passive gnralement plus douloureuse.
Tendinite du sous-scapulaire
Rotation mdiale contrarie douloureuse. Signes complmentaires : arc*
douloureux, adduction horizontale passive.
Tendinite du biceps
Douleur en flexion contrarie du coude et supination contrarie
Nvrite du sus-scapulaire
Rotation latrale contrarie et abduction contrarie faibles et indolores
*Un arc douloureux est lapparition de la douleur pendant labduction lorsque le bras approche de lhorizontale, la
douleur disparaissant lorsque la position horizontale passe dans lune ou lautre direction.
Examen de lpaule (daprs Cyriax). Dcrit par Chesworth, 1998 (51)
1)
2)
3)
*
Amplitude active de mouvement (position debout)
flexion : douleur, mouvement asymtrique
Amplitude passive de mouvement (position debout, comprenant pression accentue et sensation
terminale)
abduction en immobilisant lomoplate
abduction
rotation externe en position neutre
manoeuvre main-dos
Manuvres contre rsistance
abduction, rotation interne, rotation externe, abduction, flexion du coude, extension du coude
Rtraction capsulaire et test de provocation
1)
La progression de llvation active demandait des mouvements rpts en nombre croissant
dabduction et de rotation externe. Ces positions imposent des contraintes progressives sur la face antrieure
des ligaments glno-humraux antro-infrieurs. Si la capsule nest pas assez longue, lpaule atteinte sera
plus haute, le ligament glno-humral antro-infrieur tendu empchera le glissement plus avant dans
larticulation, et le mouvement sera assur par larticulation scapulo-thoracique. On peut aussi observer
dautres signes tels que arc douloureux, impingement , accrochage ou craquement.
flexion
elvation dans le plan de lomoplate (mains devant le trochanter)
abduction pouces levs mains commenant au niveau du trochanter
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 56 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
hyperabduction pouces levs (mains commenant derrire le trochanter)
2)
Les mouvements actifs consistant en flexion avec rotation interne et manuvre main-dos placent la
tension primaire sur la capsule postrieure et la bande postrieure du complexe ligamentaire glno-humral
infrieur. Le ct atteint prsentera une diminution de lamplitude active de mouvement et une douleur.
manuvre main-dos
flexion avec rotation interne maximale
3)
Quadrant : Maitland dcrit une manuvre avec le patient couch en dcubitus dorsal en abduction de
90 avec rotation externe complte. Laisser le bras pendre ses limites passives et glisser le bras en lvation
complte tout en observant le trajet du mouvement du bras. Accrotre la pression sur une position slective
du bras. Le ct atteint prsentera un arc de mouvement qui slve avec une sensation terminale fibreuse
( leathery ) La reproduction de la douleur peut tre due la compression des structures supra-humrales.
4)
Mesures goniomtriques : sassurer de 90 dadduction sans compensation scapulaire avant
deffectuer la rotation externe de lhumrus.
5)
Capsule postrieure 90/90 : en dcubitus dorsal, abduction 90, rotation interne jusqu ce que
lpaule antrieure commence se soulever de la table. Exercer une pression accentue pour obtenir une
sensation terminale et la reproduction des symptmes. Le ct atteint se lvera de la table plus tt en rotation
interne et sera plus ferme et douloureux avec sensation terminale.
6)
Rotation externe en dcubitus ventral : en dcubitus ventral, doigts croiss paumes vers le bas. Le
front repose sur la face dorsale des mains. La gouttire delto-acromiale entre lacromion et la tte humrale
est examine visuellement, palpe et appuye en pression accentue pour observer la profondeur symtrique,
la sensation terminale et la reproduction des symptmes. Le ct atteint prsentera un pli plus petit, moins
despace la palpation entre lacromion et la tte humrale, et prsentera une sensation terminale ferme et
ventuellement douloureuse.
7)
Rotation externe maximum en dcubitus ventral : Comme prcdemment, sauf que la position de
dpart consiste croiser les doigts et placer les mains au sommet de la tte du patient pour augmenter la
tension sur le complexe ligamentaire glno-humral infrieur, pour accrotre la sensibilit ce test.
Tableau. Catgories de sensations terminales articulaires utilises dans cette tude.
Catgorie de sensation terminale
Description de la sensation terminale
Os contre os
Arrt brusque du mouvement lorsque deux surfaces dures
se touchent
Spasme Capsulaire
Contraction vibrante dure
Normale
Arrt assez brusque du mouvement avec une certaine
lasticit, amplitude complte
Anormale
Arrt assez brusque du mouvement avec une certaine
lasticit, amplitude incomplte
Bute lastique
Rebond visible et senti en fin damplitude possible
Rapprochement de tissus
Embotement de membres, mais pourrait aller plus loin
Vide
Trs douloureux avant la fin de lamplitude, pas de
rsistance, le patient dit darrter.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 57 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANNEXE 2. VALUATION
COIFFE
TENDINEUSE DES MUSCLES DE LA
Tendon du supra-pineux :
Test de Jobe
Lexaminateur, face au sujet, tente de baisser
les bras qui sont placs 90 dabduction
et 30 du plan frontal, avec les coudes tendus
et les pouces vers le bas. Le test est positif
si le sujet ne peut rsister labaissement.
Il traduit une rupture du supra-pineux.
Tendon de linfra-pineux :
Test de Patte
Lexaminateur soutient le bras examin en
abduction de 90, coude flchi 90, et soppose
la rotation externe demand au sujet.
Le test est positif quand il reproduit des douleurs
et/ou dvoile un dficit de la force musculaire. Il
traduit une tendinopathie (douleur) ou une
rupture (dficit) de linfra-pineux.
Signe du clairon. Il est demand au sujet de mettre sa main la bouche. Le signe est positif quand le
sujet est oblig de lever son coude plus haut que la main. Il traduit une rupture ou une paralysie de
linfra-pineux.
Signe du battant de cloche. Le sujet met son coude au corps, lavant-bras 90, lexaminateur lui
demande de faire une rotation interne force contre rsistance partir dune position de rotation
neutre, puis lche soudainement la rsistance. Le signe est positif quand le sujet ne peut freiner son
mouvement, et que sa main vient frapper brutalement son ventre. Il traduit une rupture ou une
paralysie de linfra-pineux.
*
dessins issus de : De Lecluse J. Tests et examen clinique en pathologie sportive. J Traumatol Sport 1997;HS et
reproduits avec laimable autorisation de Masson Editeur.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 58 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Tendon du subscapulaire :
Lift-off test de Gerber. Le sujet place sa main dans le dos au niveau de la ceinture, lexaminateur
dcolle la main en tenant le coude flchi 90 et 5-10cm de la ceinture. Il est demand au sujet de
tenir la position. Le test est positif quand la main part comme un ressort frapper le dos. Il traduit une
rupture totale du subscapulaire.
Belly press-test. Le sujet place sa main sur le ventre et exerce une pression. En cas dimpossibilit
dappui, le test est positif.
Anterior slide test de Kibbler
Le sujet met sa main sur sa hanche avec le coude
un peu en arrire. Lexaminateur plac derrire
le sujet exerce une pousse dans laxe du bras
qui propulse en haut et en avant la tte humrale.
Le test est positif quand il reproduit une douleur
ou un ressaut la face antro-suprieure de
lpaule. Il tmoigne dun slap lesion
(arrachement de linsertion du biceps et de son
attache sur le bourrelet glnodien).
Tendon du long biceps :
Palm up test
Lexaminateur soppose llvation
antrieure du bras positionn en lvation
antrieure 90, avant-bras en extension et
main en supination. Le test est positif quand
il reproduit une douleur sur le trajet du long
biceps. Il traduit une tendinopathie ou une
tnosynovite.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 59 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANNEXE 3. TESTS DE CONFLITS DES MUSCLES DE LA COIFFE DES
*
ROTATEURS
CONFLIT ANTRO-SUPRIEUR
Test de Hawkins
Le sujet ayant le bras positionn en lvation antrieure 90, coude
flchi 90 et avant-bras lhorizontale, lexaminateur effectue des
mouvements de rotation interne du bras.
Le test est positif quand il reproduit des douleurs antrieures.
dessins issus de : De Lecluse J. Tests et examen clinique en pathologie sportive. J Traumatol Sport 1997;HS et
reproduits avec laimable autorisation de Masson Editeur.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 60 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CONFLIT ANTRO-SUPRIEUR
Impingement sign de Neer
Lexaminateur, plac derrire le sujet, fixe lomoplate et la ceinture scapulaire dune main et
effectue de lautre main une lvation passive du bras dans un plan situ entre llvation
antrieure et llvation latrale, la main en pronation.
Le signe est positif lorsquil reproduit des douleurs vers 80-100 dlvation. Les douleurs sont
exacerbes lorsque le bras est plac en rotation interne.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 61 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CONFLIT ANTRO-INTERNE
Cross arm test ou Cross body adduction
Lexaminateur
met
en
adduction
horizontale force le bras 90 dlvation
antrieure et en rotation interne.
Le test est positif quand il reproduit des
douleurs antrieures.
Test de Yocum
Le sujet repose sa main sur son paule
controlatrale. Lexaminateur soppose
llvation du coude au-dessus de
lhorizontale.
Le test est positif quand il reproduit des
douleurs antrieures.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 62 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
CONFLIT POSTRO-SUPRIEUR
Test de larm
Lexaminateur, plac derrire le sujet, porte le bras 100 dabduction et 90 de rotation externe et
fixe par son autre main lpaule examine. Lexaminateur accentue le mouvement de rtropulsion et
de rotation externe du bras.
Le test est positif quand il reproduit des douleurs postrieures.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 63 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANNEXE 4. SCORE DEVALUATION SCAPULAIRE DE CONSTANT
Douleur :
0= intolrable
5= moyenne
10= modre
15= aucune
chelle algomtrique
0 __________________________________________________________________ 15
absence
douleur
de douleur
svre
Total :../15
Niveau dactivits quotidiennes
Activits professionnelles ou occupationnelles (4 points)
Travail impossible ou non repris (=0)
Gne importante (=1)
Gne moyenne (=2)
Gne modre (=3)
Aucune gne (=4)
Sil sagit dune femme au foyer ou dun patient retrait : valuation de la capacit effectuer des
travaux physiques (bricolage, mnage,)
Activits de loisirs (4 points)
Impossible (=0)
Gne importante (=1)
Gne moyenne (=2)
Gne modre (=3)
Aucune gne (=4)
Gne dans le sommeil (2 points)
Douleurs insomniantes (=0)
Gne modre, exemple : aux changements de position (=1)
Aucune gne (=2)
Total ./10
Niveau de travail avec la main
A quelle hauteur le patient peut-il utiliser sa main sans douleur et avec une force suffisante ?
Taille (=2)
Xiphode (=4)
Cou (=6)
Tte (=8)
Au-dessus de la tte (=10)
Total :/10
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 64 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Mobilit
Evaluation des amplitudes articulaires possibles activement et sans douleur (patient assis)
Antpulsion (10 points)
0-30 (=0)
31-60 (=2)
61-90 (=4)
91-120 (=6)
121-150 (=8)
>150 (=10)
abduction (10 points)
0-30 (=0)
31-60 (=2)
61-90 (=4)
91-120 (=6)
121-150 (=8)
>150 (=10)
Rotation latrale (10 points)
Mains derrire la tte, coudes en avant (=2)
Mains derrire la tte, coudes en arrire (=2)
Mains sur la tte, coudes en avant (=2)
Mains sur la tte, coudes en arrire (=2)
Elvation complte depuis le sommet de la tte (=2)
Rotation mdiale (10 points)
Dos de la main niveau fesse (=2)
Dos de la main niveau sacrum (=4)
Dos de la main niveau L3 (=6)
Dos de la main niveau T12 (=8)
Dos de la main niveau T7-T8 (=10)
Total :../40
Force musculaire
Mesure de la force dabduction isomtrique, le patient tant assis, le bras lhorizontale avec une
antpulsion de 30.
Evaluation du poids auquel rsiste le patient pendant 5 secondes. Le test est rpt 5 fois (500g=1
point).
Le maximum thorique pour une force de 12 kg est gal 25 points.
Etude de la force controlatrale si lpaule na pas t opre.
Total :../25
SCORE TOTAL :
Mode de calcul et de prsentation des rsultats
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 65 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Pour le domaine de la douleur, une double apprciation est ncessaire.
On demande au patient dindiquer lintensit de sa douleur selon une chelle verbale. En labsence
de douleur, la note de 15 lui est attribue. Autrement, la note sera de 10,5 ou 0 selon que la douleur
est modre, moyenne ou intolrable. Puis, on utilise une chelle visuelle analogique mesurant 15
cm. Celle-ci sera complte par le patient aprs que lexaminateur lui ait expliqu de couper dun
trait lendroit qui correspond lintensit de sa douleur. Prcisons lexistence de part et dautre de
cette chelle des chiffres 0 et 15 o 0 signifie labsence de douleur et 15 une douleur extrme. Le
score douloureux dfinitif sera obtenu en soustrayant le chiffre obtenu du nombre 15 sur lEVA,
pour retomber sur la mme chelle de cotation que lchelle verbale. Puis, les 2 chiffres seront
additionns et leur somme divise par 2. On obtient ainsi une moyenne des deux apprciations
correspondant au score douloureux dfinitif.
Dans la rfrence princeps le score douloureux est effectu sur le degr de douleur le plus svre
survenant au cours des activits de la vie courante, telles que le travail, la dtente, le repos ou la
douleur survenant la nuit .
Pour les domaines concernant lactivit, le mdecin note linformation recueillie linterrogatoire
du patient.
En ce qui concerne le domaine mobilit , les amplitudes considrer sont celles qui sont
possibles, activement et sans douleur, le patient tant assis sur une chaise sans accoudoir. Lpaule
ntant pas bloque, on comprend que labduction puisse dpasser 90.
En ce qui concerne le domaine de la force musculaire, son valuation ncessite davoir recours du
matriel dynamomtre dont la sensibilit est dau moins 500 g fix au poignet par une bande. Le
patient est assis, le bras tendu dans le plan de lomoplate, cest--dire 30 dantpulsion. Le
patient doit rsister la pousse vers le bas exprime par lexaminateur, pendant 5 secondes. Le test
est rpt 5 fois.
Pour chacun des autres domaines, on attribue les scores dispenss chacun des items. Le score total
est sur 100 points.
Pour la prsentation des rsultats, 3 possibilits :
- soit prsenter sparment chacun des 5 domaines
- soit prsenter la somme en valeur absolue
- soit prsenter la somme en valeur relative par rapport la normale pour lge et le sexe.
Cette technique a lavantage de pouvoir quantifier au mieux les anomalies (diffrence dun individu
par rapport la valeur normale dun groupe de mme ge et de mme sexe) et ensuite de proposer
une moyenne de ces valeurs dans une tude de groupe de patients htrognes (hommes et femmes,
jeunes et vieux). Par exemple, si la valeur absolue obtenue chez un homme de 35 ans est de 40,
alors que la norme pour les hommes de cette tranche dge est de 97, alors la valeur normalise
sera de 57.
En ce qui concerne la capacit physiologique dpendant du sexe et de lge, il a t propos des
normes partir des valeurs observes chez des centaines de volontaires, hommes et femmes de tous
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 66 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ges (tude des amplitudes articulaires actives et de la force musculaire en abduction dans le plan de
lomoplate. La valeur normale infrieure est la suivante :
valeur fonctionnelle normale de lpaule selon lindice de Constant en fonction de lge et du sexe.
Hommes
Femmes
ge
droit
gauche
moyenne
droit
gauche
moyenne
21-30
97
99
98
98
96
97
31-40
97
90
93
90
91
90
41-50
86
96
92
85
78
80
50-60
94
87
90
75
71
73
61-70
83
83
83
70
68
70
71-80
76
73
75
71
64
69
81-90
70
61
66
65
64
64
91-100
60
54
56
58
50
52
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 67 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANNEXE 5. SHOULDERS PAIN SCORE
Shoulders pain score daprs Winters, 1996 (40).
Aucune
Lgre
Moyenne
Svre
Douleur au repos
Douleur la
mobilisation
Douleur nocturne
Insomnies causes
par la douleur
Impossibilit de se
coucher du ct
douloureux
Aucune
Jusqu la moiti
du bras
Jusquau coude
Au-del du coude
Degr dirradiation
EVA de 0 100
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 68 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANNEXE 6. E XEMPLE DE FEUILLE DONNE AU PATIENT POUR LE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE (D APRS WIRTH, 1997) (88)
nb. La marque de bande lastique utilise a t volontairement masque pour cet exemple.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 69 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 70 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
REFERENCES
1. Dromer C. pidmiologie des lsions de la coiffe
des rotateurs. Rev Rhum [Ed Fr] 1996;63 (Suppl):7SP9SP.
2. Caroit M, Augereau B, Bernageau J, Blotman F,
Duquesnoy B, Gazielly D, et al. Recommandations de
la confrence de consensus sur l'imagerie dans la
pathologie mcanique et dgnrative d'une paule non
opre, 15 novembre 1996. Rev Rhum [Ed Fr]
1997;64:127S-32S.
3. Van der Windt DAWM, Koes BW, De Jong BA,
Bouter LM. Shoulder disorders in general practice:
Incidence, patient characteristics, and management.
Ann Rheum Dis 1995;54:959-64.
4. Walch G. Synthse sur l'pidmiologie et l'tiologie
des ruptures de la coiffe des rotateurs. In: Journes
Lyonnaises de l'paule. Lyon: Brailey; 1993. p. 25665.
5. American Academy of Orthopaedic Surgeons. The
rotator cuff. Current concepts and complex problems.
Rosemont (Ill): AAOS; 1999.
6. Frieman BG, Albert TJ, Fenlin JM. Rotator cuff
disease. A review of diagnosis, pathophysiology, and
current trends in treatment. Arch Phys Med Rehabil
1994;75:604-9.
7. Fongemie AE, Buss DD, Rolnick SJ. Management
of shoulder impingement syndrome and rotator cuff
tears. Available from http://www.aafp. org
8. Morrison DS, Frogameni AD, Woodworth P. Nonoperative treatment of subacromial impingement
syndrome. J Bone Jt Surg [Am] 1997;79A:732-7.
9. Walch G, Nol E, Liotard JP, Boileau P. Pathognie
des ruptures de la coiffe des rotateurs. Rev Rhum [Ed
Fr] 1996;63 (Suppl):10SP-3SP.
10. Leroux JL, Revel M. Traitement "fonctionnel" de la
pathologie de la coiffe des rotateurs de l'paule. Rev
Rhum [Ed Fr] 1996;63:82-7.
11. Sauzires P. Les tendinopathies du sus-pineux:
aspects
lsionnels,
cliniques
et
indications
thrapeutiques. In: Stratgie devant une pathologie
dgnrative de la coiffe des rotateurs de l'paule. Xe
journe de Menucourt, 25 septembre 1999. Boisemont:
Tenaillon; 1999.
12. Gagey O. Stratgie thrapeutique devant une
rupture de coiffe. In: Stratgie devant une pathologie
dgnrative de la coiffe des rotateurs de l'paule. Xe
journe de Menucourt, 25 septembre 1999. Boisemont:
Tenaillon; 1999. p. 83-91.
13. McConville OR, Iannotti JP. Partial-thickness tears
of the rotator cuff: evaluation and management. J A m
Acad Orthop Surg 1999;7:32-43.
14. Uhthoff H, Loehr J, Sarkar K. The pathogenesis of
rotator cuff tears.
In: Proceedings at the third
International Conference on surgery of the shoulder.
Fukuora, Japan 1986 October 27. p. 211-2.
15. Lohr JF, Uhthoff HK. The microvascular pattern of
the supraspinatus tendon. Clin Orthop 1990;254:35-8.
16. Duchenne de Boulogne GB. Physiologie des
mouvements. Ann Med Phys 1967;HS.
17. Dolto BJ. Une nouvelle kinsithrapie. In: Le
corps entre les mains. Paris: Hermann; 1978. p. 133-42.
18. Gagey O, Hue E. Mecanics of the deltode muscle.
A new approach. Clin Orthop Relat Res 2000;250-7 .
19. Beaudreuil J, Revel M, Dorfmann H.
Physiopathologie et rducation des lsions de la coiffe
des rotateurs. Actual Rhum 1998;422-35.
20. Schmitt L, Snyder-Mackler L. Role of scapular
stabilizers in etiology and treatment of impingement
syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 1999;29:31-8.
21. Revel M. Pathologies musculo-tendineuses de
l'paule (de la clinique la lsion, de la lsion au
handicap et au traitement). Rev Rhum [Ed Fr]
1995;62:405-8.
22. Lewertowski JM. La dgnrescence graisseuse:
intrt pronostique dans la rparation des muscles de la
coiffe des rotateurs. In :
Stratgie devant une
pathologie dgnrative de la coiffe des rotateurs de
l'paule. Xe journe de Menucourt, 25 septembre 1999.
Boisemont: Tenaillon; 1999.
23. Dougados M. La mesure. Mthodes d'valuation
des affections rhumatismales. Paris: Expansion
Scientifique; 1997.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 71 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
24. Boyer T, Vitale C. Les manoeuvres cliniques
d'exploration de l'paule. Actual Rhum 1996;249-60.
25. Schaeverbeke T, Leroux JL. L'examen clinique de
l'paule dgnrative. Rev Rhum [Ed Fr] (Suppl)
1996;63:15SP-21SP.
26. Green S, Buchbinder P, Glazier R, Forbes A.
Systematic review of randomised controlled trials of
interventions for painful shoulder: selection criteria,
outcome assessment, and efficacy. BMJ 1998;316:35460.
27. Pellecchia GL, Paolino J, Connell J. Intertester
reliability of the cyriax evaluation in assessing patients
with shoulder pain. J Orthop Sports Phys Ther
1996;23:34-8.
28. Walch G, Boulahia A, Calderone S. Le signe du
clairon et le "dropping sign" dans les ruptures de la
coiffe des rotateurs. J Traumatol Sport 1999;16:50-6.
37. Boussagol B, Plissier J, Hrisson C, Simon L.
valuation des pathologies de la coiffe des rotateurs:
analyse comparative de quatre scores. Ann Radapt
Med Phys 1996;39:79-88.
38. Roddey TS, Olson SL, Gook KF, Gartsman GM,
Hanten W. Comparison of the university of CaliforniaLos Angeles shoulder scale and the simple shoulder
test with the shoulder pain and disability index. Singleadministration reliability and validity. Phys Ther
2000;80:759-68.
39. Hawkins RH, Dunlop R. Nonoperative treatment of
rotator cuff tears. Clin Orthop 1995;321:178-88.
40. Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, Arendzen JH,
Meyboom-De JB. A shoulder pain score: a
comprehensive questionnaire for assessing pain in
patients with shoulder complaints. Scand J Rehabil
Med 1996;28:163-7.
29. Rowlands LK, Wertsch JJ, Primack SJ, Spreitzer
AM, Roberts MM. Kinesiology of the empty can test.
Am Phys Med Rehabil 1995;74:302-4.
41. Leroux JL, Micallef JP. Analyse des mouvements
de l'paule en 3D dans la pathologie de la coiffe des
rotateurs. In: Pathologie de la coiffe des rotateurs.
Paris: Masson; 1993. p. 8-16.
30. Malanga GA, Jenp YN, Growney ES, An KN.
EMG analysis of shoulder positioning in testing and
strengthening the supraspinatus. Med Sci Sports Exerc
1996;28:661-4.
42. Cole A, McClure P, Pratt N. Scapular kinematics
during arm elevation in healthy subjects and patients
with shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports
Phys Ther 1996;23:68.
31. Kelly BT, Kadrmas WR, Speer KP. The manual
muscle examination for rotator cuff strength. An
electromyographic investigation. Am J Sports Med
1996;24:581-8.
43. Gagey O, Bonfait H, Gillot C, Mazas F. Anatomie
fonctionelle et mcanique de l'lvation du bras. Rev
Chir Orthop 1988;74:209-17.
32. Nol E, Walch G, Bochu M. La manoeuvre de
Jobe. propos de 227 cas. Rev Rhum [Ed Fr]
1989;56:803-4.
44. Culham EG, Peat M. Functional anatomy of the
shoulder complex. J Orthop Sports Phys Ther
1993;18:342-50.
33. Walch G. L'examen programm de l'paule
douloureuse chronique. In: Les Journes Lyonnaises
de l'paule. Lyon: Brailey; 1993. p. 169-89.
45. MacDermid JC, Chesworth BM, Patterson S, Roth
JH. Intratester and intertester reliability of goniometric
measurement of passive lateral shoulder rotation. J
Hand Ther 1999;12:187-92.
34. Leroux JL, Thomas E, Bonnel F, Blotman F.
Valeur diagnostique des tests cliniques utiliss dans le
syndrome du dfil sous-acromial. Etude prospective.
Rev Rhum [Ed Fr] 1995;62:447-52.
46. Schenkman M, Laub KC, Kuchibhatla M, Ray L,
Shinberg M. Measures of shoulder protraction and
thoracolumbar rotation. J Orthop Sports Phys Ther
1997;25:329-35.
35. Gerber C, Krushell RJ. Isolated tear of the tendon
of the subscapularis muscle. Clinical features in 16
cases. J Bone Jt Surg [Br] 1991;73B:389-94.
47. Leroy A, Pierron G, Pninou G, Dufour M, Neiger
N, Gnot G. Kinsithrapie. 3.Membres suprieurs.
Bilans, techniques passives et actives. Paris:
Flammarion. Mdecine et Sciences; 1986.
36. Thomas T. valuation fonctionelle en matire de
pathologie de la coiffe des rotateurs. Rev Rhum [Ed Fr]
1996;63 (Suppl):56SP-68SP.
48. Neiger H, Gnot C, M'Tir H. Goniomtrie
diffrencie de l'abduction d'paule. In: Journes de
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 72 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
Mdecine Physique et de Rducation. Paris:
Expansion Scientifique Franaise; 1983. p. 100-2.
shoulder external and internal. J Orthop Sports Phys
Ther 1993;18:543-52.
49. Green S, Buchbinder R, Forbes A, Bellamy N. A
standardized protocol for measurement of range of
movement of the shoulder using the Plurimeter-V
inclinometer and assessment of its intrarater and
interrater reliability. Arthritis Care Res 1998;11:43-52.
61. Tata GE, Ng L, Kramer JF. Shoulder antagonistic
strength ratios during concentric and excentric muscle
in the scapular plane. J Orthop Sports Phys Ther
1993;18:654-60.
50. Hjelm R, Draper C, Spencer S. Anterior-inferior
capsular length insufficiency in the painful shoulder. J
Orthop Sports Phys Ther 1996;23:216-22.
51. Chesworth BM, MacDermid JC, Roth JH, Patterson
SD. Movement diagram and "end-feel" reliability when
measuring lateral rotation of the shoulder pathway.
Phys Ther 1998;593-601.
52. Warner JJP, Micheli LJ, Arslanian LE, Kennedy J,
Kennedy R. Patterns of flexibility, laxity, and strength
in normal shoulders with instability and impingement.
Am J Sports Med 1990;18:366-75.
53. Tyler TF, Roy T, Nicholas SJ, Gleim GW.
Reliability and validity of a new method of measuring
posterior shoulder tightness. J Orthop Sports Phys Ther
1999;29:262-74.
54. Vermeulen HM, Oberman WR, Burger BJ, Kok GJ,
Rozing PM, van den Ende CHM. End-range
mobilization techniques in adhesive capsulitis of the
shoulder joint. A multiple-subject case report. Phys
Ther 2000;80:1204-13.
55. Marc T, Gerardi JL, Vittori MJ, et al.
Tendinopathies de la coiffe des rotateurs et dcentrages
articulaires scapulo-humraux.
In: Journes de
Mdecine Physique et de Rducation. Paris:
Expansion Scientifique Franaise; 1992. p. 174-81.
56. Marc T, Kedad N, Gaudin T, Teissier J. valuation
de l'paule. Ann Kinsithr 1997;24:146-51.
57. Sohier R, Sohier J. Rducation des affections de
l'paule. Encycl Md Chir Kinsithrapie 1983;26210
A:A10,4-10-06:1-18.
62. Croisier JL, Crielaard JM. valuation isocintique
des rotateurs internes et externes de l'paule: valeurs
normales et pathologiques. Actual Sports Med
1993;26:30-2.
63. Codine P, Pocholle M, Leroux JL, Maihl D,
Fournau H. Apport de l'isocintisme dans le bilan et le
traitement du conflit sous-acromial. In: Pathologie de
la coiffe des rotateurs de l'paule. Paris: Masson; 1993.
p. 199-206.
64. Brox JI, Holm I, Ludvigsen P, Steen H. Pain
influence on isokinetic shoulder muscle strength in
patients with rotator tendinosis (impingement
syndrome stage II). Eur J Phys Med Rehabil
1995;5:196-9.
65. Bertoft ES. Painful shoulder disorders from a
physiotherapeutic view. A review of literature. Crit
Rev Phys Rehabil Med 1999;11:229-77.
66. Bohmer AS, Staff PH,
exercices in relation to
(impingement syndrome stage
regimen and its rationale.
1988;14:93-105.
Brox JI. Supervised
rotator cuff disease
I and II). A treatment
Phys Theory Pract
67. Graichen H, Bonel H, Stammberger T, Haubner M,
Rohrer H, Englmeier K, et al. Three-dimensional
analysis of the width of the subacromial space in
healthy subjects and patients with impingement
syndrome. AJR Am J Roentgenol 1999;172:1081-6.
68. Nov-Josserand L, Lvigne C, Nol E, Walch G.
L'espace sous acromial. tude des facteurs influenant
sa hauteur. Rev Chir Orthop 1996;82:379-85.
58. De Lecluse J. Tests et examen clinique en
pathologie sportive. J Traumatol Sport 1997;HS.
69. Nordt WE, Garretson RB, Plotkin E. The
measurement of subacromial contact pressure in
patients with impingement syndrome. Arthroscopy
1999;15:121-5.
59. Brox JI, Roe C, Saugen E, Vollestad NK. Isometric
abduction muscle activation in patients with rotator
tendinosis of the shoulder. Arch Phys Med Rehabil
1997;78:1260-7.
70. Chen SK, Simonian PT, Wickiewicz TL, Otis JC,
Warren RF. Radiographic evaluation of glenohumeral
kinematics: a muscle fatigue model. J Shoulder Elbow
Surg 1999;8:49-52.
60. Malerba JL, Adam ML, Harris BA, Krebs DE.
Reliabililty of dynamic and isometric testing of
71. Warner JJP, Micheli LJ, Arslanian LE, Kennedy J,
Kennedy R. Scapulothoracic motion in normal
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 73 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
shoulders and shoulders with glenohumeral instability
and impingement sundrome. Clin Orthop Relat Res
1992;285:191-9.
72. De la Caffinire JY. Les dplacements angulaires
de l'omoplate. In: Journes de l'paule. Lyon, 2-4 mars
1978;7-17.
73. Ludewig PM, Cook TM, Nawoczenski DA. Threedimensional scapular orientation and muscle activity at
selected positions of humeral elevation. J Orthop
Sports Phys Ther 1996;24:57-65.
74. McQuade KJ, Wei SH, Smidt GL. Effects of local
muscle fatigue on three-dimensional scapulohumeral
rhythm. Clin Biomech 1995;10:144-8.
75. Kibler B. The role of the scapula in athletic
shoulder function. Am J Sports Med 1998;26:325-37.
76. Odom CJ, Taylor AB, Hurd CE, Denegar CR.
Measurement of scapular asymetry and assessment of
shoulder dysfunction using the Lateral Scapular Slide
Test. A reliability and validity study. Phys Ther
2001;81:799-809.
77. Greenfield B, Catlin PA, Coats PW, Green E,
McDonald JJ, North C. Posture in patients with
overuse injuries and healthy individuals. J Orthop
Sports Phys Ther 1995;21:287-95.
78. Pninou G, Dufour M. Mesure de la position
spontane de l'omoplate dans le plan sagittal et frontal.
Ann Kinsither 1985;12:365-9.
79. Pninou G. Le placement de la scapula: clef de la
rducation de l'paule. In: L'paule musculaire.
Montpellier: Sauramps Mdical; 1995. p. 173-81.
80. Van der Heijden GJMG, Leffers P, Wolters PJMC,
Verheijden JJD, van Mameren H, Houben JP, et al. No
effect of bipolar interferential electrotherapy and
pulsed ultrasound for soft tissue shoulder disorders: a
randomised controlled trial. Ann Rheum Dis
1999;58:530-40.
81. Brox JI, Gjengedal E, Uppheim G, Bohmer AS,
Brevik JI, Ljunggren AE, et al. Arthroscopic surgery
versus supervised exercises in patients with rotator cuff
disease (stage II impingement syndrome): a
prospective, randomized, controlled study in 125
patients with a 2 1/2-year follow-up. J Shoulder Elbow
Surg 1999;8:102-11.
82. Brox JI, Staff PH, Ljunggren AE, Brevik JI.
Arthroscopic surgery compared with supervised
exercices in patient with rotator cuff disease (Stage II
impingement syndrome). BMJ 1993;307:899-903.
83. Rahme H, Solem-Bertoft E, Westerberg CE,
Lundberg E, Srensen S, Hilding S. The subacromial
impingement syndrome. A study of results of treatment
with special emphasis on predictive factors and paingenerating mechanisms. Scand J Rehabil Med
1998;30:253-62.
84. Vecchio P, Cave M, King V, Adebajo AO,
Hazleman BL. A double-blind study of the
effectiveness of low level laser treatment of rotator cuff
tendinitis. Br J Rheumatol 1993;32:740-2.
85. Ginn KA, Herbert RD, Khouw W, Lee R. A
randomized, controlled clinical trial of a treatment for
shoulder pain. Phys Ther 1997;77:802-9.
86. Vecchio PC, Kavanagh RT, Hazleman BL, King
RH. Community survey of shoulder disorders in the
elderly to assess the natural history and effects of
treatment. Ann Rheum Dis 1995;54:152-4.
87. Conroy DE, Hayes KW. The effect of joint
mobilization as a component of comprehensive
treatment for primary shoulder impingement syndrome.
J Orthop Sports Phys Ther 1998;28:3-14.
88. Wirth MA, Basamania C, Rockwood CAJ.
Nonoperative management of full-thickness tears of the
rotator cuff. Orthop Clin North Am 1997;28:59-67.
89. Grauer JL, Coste J. Pathologie dgnrative de la
coiffe des rotateurs. Place de la physiothrapie. Rev
Rhum [Ed Fr] 1996;63 (Suppl):69SP-73SP.
90. Van der Heijden GJMG, van der Windt DAWM, de
Winter AF. Physiotherapy for patients with soft tissue
shoulder disorders: a systematic review of randomised
clinical trials. BMJ 1997;315:25-30.
91. Ebenbilcher GR, Erdogmus CB, Resch KL,
Funovics MA, Kainberger F, Barisani G, et al.
Ultrasound therapy for calcific tendinitis of the
shoulder. N Engl J Med 1999;340:1533-8.
92. Gam AN, Warming S, Hordum LL, Jensen B,
Hoydalsmo O, Allon I, et al. Treatment of myofascial
trigger-points with ultrasound combined with massage
and exercise: a randomised controlled trial. Pain
1998;77:73-9.
93. Nyknen M. Pulsed ultrasound treatment of the
painful shoulder a randomized, double-blind, placebocontrolled study. Scand J Rehabil Med 1995;27:105-8.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 74 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
94. Berry H, Fernandes L, Bloom B, Clark RJ,
Hamilton EBD. Clinical study comparing acupuncture,
physiotherapy, injection and oral anti-inflammatory
therapy in shoulder-cuff lesions. Curr Med Res Opin
1980;7:121-6.
95. Elleuch MH, Baklouti S, Abid F, et al. Apport de la
rducation du syndrome du dfil sous-acromiocoracodien non opr ( propos de 100 cas). In:
Journes de Mdecine Physique et de rducation.
Paris: Expansion Scientifique Franaise; 1992. p. 2403.
96. Saunders L. The efficacy of low-level laser therapy
in supraspinatus tendinitis. Clin Rehabil 1995;9:12634.
97. Brockow T, Franke A, Resch KL, Saunders L, van
der Heijden GJMG, van der Windt DAWM, et al.
Physiotherapy for soft tissue shoulder disorders
(letters). BMJ 1998;316:555-6.
98. Leclaire R, Bourgoin J. Electromagnetic treatment
of shoulder periarthritis: a randomized controlled trial
of the efficiciency and tolerance of magnetotherapy.
Arch Phys Med Rehabil 1991;72:284-7.
99. Chard MD, Hazleman BL, Devereaux MD.
Controlled study to investigate dose-response patterns
to portable pulsed electromagnetic fields in the
treatment of rotator cuff tendinitis. J Orthop Rheumatol
1988;1:33-40.
100. Leroux JL, Azema MJ, Chuong VT, Barrault JJ,
Bonnel F, Blotman F. La rducation en recentrage
dynamique de la tte humrale dans le conflit sousacromial. Ann Radapt Md Phys 1988;31:187-94.
101. Marc T, Bouges S, Gaudin T, et al. valuation de
l'effet du recentrage scapulo-humral sur les signes de
conflit et de tendinopathie. In: Journes de Mdecine
Physique et de Rducation. Paris: Expansion
Scientifique Franaise; 1996. p. 228-33.
102. Wang CH, McClure P, Pratt NE, Nobilini R.
Stretching and strenghtening exercices: their effect on
three-dimensional scapular kinematics. Arch Phys Med
Rehabil 1999;80:923-9.
103. Girouard CK, Hurley BF. Does strength training
inhibit gains in range of motion from flexibility
training in older adults? Med Sci Sports Exerc
1995;27:1444-9.
104. Nuber GW, Jobe FW, Perry J, Moynes DR,
Antonelli D. Fine wire electromyography analysis of
the shoulder during swimming. Am J Sports Med
1986;14:7-11.
105. Kamkar A, Irrgang JJ, Whitney SL. Nonoperative
management of secondary shoulder impingement
syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 1993;17:212-24.
106. Middleton P, Trouv P, Puig P. Travail
musculaire excentrique et physiopathologie des lsions
de la coiffe des rotateurs chez le sportif. J Traumatol
Sport 1996;13:64-8.
107. Stanish WD, Rubinovich RM, Curwin S.
Excentric exercise in chronic tendinitis. Clin Orthop
1986;208:65-8.
108. Woo SLY, Gomez MA, Woo YK, Akeson WH.
Fourth international congress of biorheology.
Symposium on mechanical properties of living tissues.
Mechanical properties of tendon and ligaments. The
relationships of immobilization of tendons and
ligaments. Biorheology 1982;19:397-408.
109. Vaillant J. Les paules douloureuses par conflit
sous acromio-coracodien. Kinsither Sci 1994;331:713.
110. Gagey O, Gagey N, Mazas F. L'abaissement
pralable du moignon de l'paule: physiologie et intrt
dans la rducation de la ceinture scapulaire. In:
Journes de Mdecine Physique et de Rducation.
Paris: Expansion Scientifique Franaise; 1992. p. 32-9.
111. Barbier C, Caillat-Miousse JL. tude radiologique
prliminaire de l'influence de l'abaissement actif de la
tte humrale, sur la variation de l'espace sousacromial. Ann Kinsither 2000;27:12-20.
112. Afonso C, Vaillant J, Santoro R. Apprentissage du
recentrage actif de la tte humrale : tude
radiologique de la hauteur de l'espace sous-acromial.
Ann Kinsither 2000;27:21-7.
113. Samuel J, Gallou JJ. Importance de l'abaissement
de la tte humrale au cours des mouvements de
l'paule: applications kinsitrapiques. In: Journes de
Mdecine Physique et de Radaptation. Paris:
Expansion Scientifique Franaise; 1983. p. 93-111.
114. Revel M. tude lectrocinsiologique mettant en
vidence le rle des adducteurs dans le centrage de la
tte humrale et droulement kinsithrapique de leur
sollicitation dans le traitement des conflits de la coiffe.
In: Stratgie devant une pathologie dgnrative de la
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 75 -
Pathologies non opres de la coiffe des rotateurs et masso-kinsithrapie
coiffe des rotateurs de l'paule. Xe journe de
Menucourt, 25 septembre 1999. Boisimont: Tenaillon;
1999. p. 24-32.
116. Levigne C. Les tendinopathies calcifiantes de la
coiffe des rotateurs de l'paule. J Md Lyon
1993;1488:248-51.
115. Leroux JL, Azema MJ, Chuong VT, et al. La
rducation "dite en dcoaptation" en pathologie de
l'paule (recentrage dynamique de la tte). In: Journes
de Mdecine Physique et de Radaptation. Paris:
Expansion Scientifique Franaise; 1986. p. 251-5.
117. Wainner RS, Hasz M. Management of acute
calcific tendinitis of the shoulder. J Orthop Sports Phys
Ther 1998;27:231-7.
ANAES / Service Recommandations et Rfrences Professionnelles / Avril 2001
- 76 -
Vous aimerez peut-être aussi
- DCL FLE 0117 18 Situation Et Documents EcritsDocument10 pagesDCL FLE 0117 18 Situation Et Documents Ecritsnadine50% (2)
- Sylvie Besch and Jacques Rodineau (Auth.) - 31e Journée de Traumatologie Du Sport de La Pitié (2013)Document216 pagesSylvie Besch and Jacques Rodineau (Auth.) - 31e Journée de Traumatologie Du Sport de La Pitié (2013)toaldoPas encore d'évaluation
- TP 2Document17 pagesTP 2Houda fleurPas encore d'évaluation
- Evaluation Et Suivi de La Douleur Chronique Ches Des Patients en AmbulatoirDocument124 pagesEvaluation Et Suivi de La Douleur Chronique Ches Des Patients en AmbulatoirJérôme RouyardPas encore d'évaluation
- Impertinente ostéopathie: Comprendre ses possibilités et ses limitesD'EverandImpertinente ostéopathie: Comprendre ses possibilités et ses limitesPas encore d'évaluation
- La Hanche Du Joueur Professionnel de Tennis PDFDocument4 pagesLa Hanche Du Joueur Professionnel de Tennis PDFkhaoulaPas encore d'évaluation
- Theses Sante Sur Microfiches - BUM Avril 2009Document118 pagesTheses Sante Sur Microfiches - BUM Avril 2009SKPACAPas encore d'évaluation
- Evaluation du dommage, responsabilité civile et assurances: Liber amicorum Noël Simar (Droit belge)D'EverandEvaluation du dommage, responsabilité civile et assurances: Liber amicorum Noël Simar (Droit belge)Pas encore d'évaluation
- relaxation 1Document34 pagesrelaxation 1bejaiaPas encore d'évaluation
- Entorse ReeducatinDocument66 pagesEntorse ReeducatinAlexiPas encore d'évaluation
- Guide d'intervention en activités physiques adaptées à l'intention des kinésiologuesD'EverandGuide d'intervention en activités physiques adaptées à l'intention des kinésiologuesPas encore d'évaluation
- Le manuel complet sur la scoliose et la chirurgie pour les patients: Un regard impartial en profondeur : qu’attendre avant et pendant l’opération de la scolioseD'EverandLe manuel complet sur la scoliose et la chirurgie pour les patients: Un regard impartial en profondeur : qu’attendre avant et pendant l’opération de la scoliosePas encore d'évaluation
- La dysfonction ostéopathique: Ses origines, ses facteurs d'installation et ses modes de compensationD'EverandLa dysfonction ostéopathique: Ses origines, ses facteurs d'installation et ses modes de compensationPas encore d'évaluation
- L' APPAREIL DIGESTIF: Des sciences fondamentales à la clinique. Deuxième édition revue et augmentéeD'EverandL' APPAREIL DIGESTIF: Des sciences fondamentales à la clinique. Deuxième édition revue et augmentéePas encore d'évaluation
- L' INTEGRATION DES SERVICES EN SANTE: Une approche populationnelleD'EverandL' INTEGRATION DES SERVICES EN SANTE: Une approche populationnellePas encore d'évaluation
- Evaluation de L'efficacité de La Pratique en Ostéopathie PDFDocument194 pagesEvaluation de L'efficacité de La Pratique en Ostéopathie PDFkiné conseilsPas encore d'évaluation
- TD Protocole SensibilitéDocument5 pagesTD Protocole Sensibilitéarnaudchoplin50% (2)
- La Kinesitherapie 2Document40 pagesLa Kinesitherapie 2Marina Gincu100% (2)
- Kinésithérapie Et Dépression PDFDocument9 pagesKinésithérapie Et Dépression PDFkhaoula100% (1)
- GeriatrieDocument21 pagesGeriatrieDiaco ArmellePas encore d'évaluation
- Le Bilan Morphologique ModifiéDocument11 pagesLe Bilan Morphologique ModifiéJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Rééducation Des Transferts Tendineux Au Membre SupérieurDocument14 pagesRééducation Des Transferts Tendineux Au Membre Supérieurblood_stream100% (2)
- Rééducation Rutpure Tendon D'achilleDocument10 pagesRééducation Rutpure Tendon D'achilleAndrei MiliPas encore d'évaluation
- 10 - Prothèses Du GenouDocument151 pages10 - Prothèses Du GenouMiha Miha100% (1)
- 11 - Vascularisation Du Coeur 2013Document33 pages11 - Vascularisation Du Coeur 2013Jasmine Ait OuzeganePas encore d'évaluation
- gp09009 Delaere Trigger 1ere Partie PDFDocument4 pagesgp09009 Delaere Trigger 1ere Partie PDFIulian IvasciucPas encore d'évaluation
- Asia ScoreDocument1 pageAsia ScorechoplinPas encore d'évaluation
- Thèse Tensegrite Vers Une Biomecanique Osteopathique Jean-Francois MEGRETDocument135 pagesThèse Tensegrite Vers Une Biomecanique Osteopathique Jean-Francois MEGRETMélanie LE ROYPas encore d'évaluation
- MémoireDocument60 pagesMémoirearnaudchoplin8712100% (1)
- Traité de Médecine Ostéopathique Du Crâne Et de Larticulation Temporomandibulaire (François Ricard)Document1 064 pagesTraité de Médecine Ostéopathique Du Crâne Et de Larticulation Temporomandibulaire (François Ricard)c.theuillonPas encore d'évaluation
- Chaines Fonctionnelles MSDocument50 pagesChaines Fonctionnelles MSSimona Alice Onea100% (1)
- Institut Upsa Ouvrage Therapies Mediation Corporelle DouleurDocument290 pagesInstitut Upsa Ouvrage Therapies Mediation Corporelle DouleurnellyPas encore d'évaluation
- Avis de Consentement Éclairé PDFDocument1 pageAvis de Consentement Éclairé PDFAnonymous EeAS6epPas encore d'évaluation
- Reeducation de La Marche de L'hemiplegiqueDocument8 pagesReeducation de La Marche de L'hemiplegiqueahmadsarrajPas encore d'évaluation
- Referentiel Metiers KINESITHERAPIEDocument32 pagesReferentiel Metiers KINESITHERAPIEAnonymous JGLBtiwvD100% (1)
- La Rééducation de L'épaule Douloureuse Non Opérée Par L'unité de Chirurgie de L'épaule de La Clinique Capio Fontvert À Avignon Vaucluse 84 À Proximité de Carpentras Et OrangeDocument5 pagesLa Rééducation de L'épaule Douloureuse Non Opérée Par L'unité de Chirurgie de L'épaule de La Clinique Capio Fontvert À Avignon Vaucluse 84 À Proximité de Carpentras Et Orangerajiv1211Pas encore d'évaluation
- Essai GeriatrieDocument43 pagesEssai GeriatrieKHAOULA WISSALE HARIKIPas encore d'évaluation
- Le Concept Sohier - Necunoscut (A)Document4 pagesLe Concept Sohier - Necunoscut (A)Simona Alice OneaPas encore d'évaluation
- Reeducation Polycopie Complet SAUF MODULE 4Document35 pagesReeducation Polycopie Complet SAUF MODULE 4zozo002Pas encore d'évaluation
- Polycop Park Pour ÉtudiantsDocument15 pagesPolycop Park Pour ÉtudiantschoplinPas encore d'évaluation
- 131 Bases Neurophysiologiques, Mécanismes Physiopathologiques D'une Douleur Aiguë Et D'une Douleur Chronique - 0Document1 page131 Bases Neurophysiologiques, Mécanismes Physiopathologiques D'une Douleur Aiguë Et D'une Douleur Chronique - 0ReNaudPas encore d'évaluation
- Physiopathologie de La Lombalgie ChroniqueDocument57 pagesPhysiopathologie de La Lombalgie Chroniquebenben31Pas encore d'évaluation
- Cancers Gynecologiques Pendant La GrossesseDocument16 pagesCancers Gynecologiques Pendant La GrossessetuanguPas encore d'évaluation
- ARTHROSEDocument43 pagesARTHROSEMarlenePas encore d'évaluation
- PCEM1 2008 Cours 3 Col VertebralDocument44 pagesPCEM1 2008 Cours 3 Col Vertebralphilippefr100% (1)
- (Cahiers D'enseignement de La SOFCOT, 98) Pascal Boileau - Gilles Walch - Et Al-Prothèses D'épaule. État Actuel-Elsevier-Masson (2008)Document451 pages(Cahiers D'enseignement de La SOFCOT, 98) Pascal Boileau - Gilles Walch - Et Al-Prothèses D'épaule. État Actuel-Elsevier-Masson (2008)Kiné OstélpathePas encore d'évaluation
- Anatomie Et Fonctionnement de L'œil - DR LeiningerDocument9 pagesAnatomie Et Fonctionnement de L'œil - DR LeiningerGeorges IntalePas encore d'évaluation
- L'IRM Ano-PérinéaleDocument19 pagesL'IRM Ano-PérinéaleSid MezgPas encore d'évaluation
- ECG Pour Les Nuls Partie 3Document4 pagesECG Pour Les Nuls Partie 3Moustapha DialloPas encore d'évaluation
- La MésothérapieDocument4 pagesLa MésothérapieAmì GhàPas encore d'évaluation
- Ks452p25 Eq SepDocument9 pagesKs452p25 Eq Sepchoplin100% (1)
- Protocole de Traitement 4Document11 pagesProtocole de Traitement 4Andrei MiliPas encore d'évaluation
- Cours Kiné en Soins IntensifsDocument46 pagesCours Kiné en Soins IntensifsjimmyreevesPas encore d'évaluation
- MémoireDocument32 pagesMémoiremouhcine berarePas encore d'évaluation
- Résumé Écrit Ostéologie Membre SupDocument16 pagesRésumé Écrit Ostéologie Membre SupJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Staff Rehazenter Prothèses GenouDocument28 pagesStaff Rehazenter Prothèses GenouMarina GincuPas encore d'évaluation
- Vade-Mecum de Kinésithérapie Et de Rééducation Fonctionnelle Télécharger, Lire PDFDocument6 pagesVade-Mecum de Kinésithérapie Et de Rééducation Fonctionnelle Télécharger, Lire PDFAchraf RabadiPas encore d'évaluation
- Mémo-Guide de BioDocument338 pagesMémo-Guide de BioEmir OueslatiPas encore d'évaluation
- Douleurs lombaires, dorsales et cervicales (Traduit): Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir un dos sainD'EverandDouleurs lombaires, dorsales et cervicales (Traduit): Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir un dos sainPas encore d'évaluation
- Actualités Sur La Rééducation Dans Les Prothèses D'épaule PDFDocument12 pagesActualités Sur La Rééducation Dans Les Prothèses D'épaule PDFkhaoulaPas encore d'évaluation
- Physiologie de L'appareil Locomoteur-Le Système MusculaireDocument6 pagesPhysiologie de L'appareil Locomoteur-Le Système MusculaireEmy DesreumauxPas encore d'évaluation
- Tres Important Sportif Rehab Membre SupDocument195 pagesTres Important Sportif Rehab Membre SupDr-Rodrigue HadchityPas encore d'évaluation
- Orthese PlantaireDocument9 pagesOrthese PlantaireGhita ArradPas encore d'évaluation
- Reeducation Hanche OpéréDocument32 pagesReeducation Hanche OpéréJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Hydro Kines It Her A PieDocument28 pagesHydro Kines It Her A PieJedidi Amir100% (1)
- Réadaptation CardiaqueDocument4 pagesRéadaptation CardiaqueJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Traumatologi eDocument30 pagesTraumatologi eHela MtirPas encore d'évaluation
- L'algodystrophieDocument48 pagesL'algodystrophieJedidi AmirPas encore d'évaluation
- L'algodystrophieDocument48 pagesL'algodystrophieJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Reeducation Raideur GenouDocument27 pagesReeducation Raideur GenouJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Technique de McKenzie Dans La LombalgieDocument12 pagesTechnique de McKenzie Dans La LombalgieJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Reeducation Raideur CoudeDocument11 pagesReeducation Raideur CoudeJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Reeducation Canal Lombaire Etroit Non OpéréDocument14 pagesReeducation Canal Lombaire Etroit Non OpéréJedidi Amir100% (1)
- Alimentation Anti InflammatoireDocument22 pagesAlimentation Anti InflammatoireJedidi Amir100% (3)
- Cours Etude de La Marche LuuxeeeDocument26 pagesCours Etude de La Marche LuuxeeeJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Renforcement Manuel MIsdffsdsdfDocument4 pagesRenforcement Manuel MIsdffsdsdfJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Kiné en Réanimation RrkkrettDocument27 pagesKiné en Réanimation RrkkrettJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Technique Du Renforcement Musculaire Farhani Zouhaier 1Document37 pagesTechnique Du Renforcement Musculaire Farhani Zouhaier 1Jedidi AmirPas encore d'évaluation
- Renforcement Manuel MIsdffsdsdfDocument4 pagesRenforcement Manuel MIsdffsdsdfJedidi AmirPas encore d'évaluation
- Nutrition & KinésithérapieDocument20 pagesNutrition & KinésithérapieJedidi Amir100% (1)
- Exercices de Musculatidfgdon Avec HalteresDocument1 pageExercices de Musculatidfgdon Avec HalteresJedidi AmirPas encore d'évaluation
- 1167675738Document3 pages1167675738Jedidi AmirPas encore d'évaluation
- Cas SOMAB Analyse Des ÉcartsDocument2 pagesCas SOMAB Analyse Des Écartsyoussef126Pas encore d'évaluation
- TP ForageDocument6 pagesTP Forageعبد العزيز مروى100% (2)
- Cours de VBA Excel - AKDocument75 pagesCours de VBA Excel - AKadil.31.05.2003Pas encore d'évaluation
- Pour Envoyer de L Argent Copie Client PoDocument2 pagesPour Envoyer de L Argent Copie Client Pomadamelinconnue00Pas encore d'évaluation
- Parametres de Choix Du Moteur ThermiqueDocument10 pagesParametres de Choix Du Moteur ThermiquewatsopPas encore d'évaluation
- TD ELECTROMAGNETISME (Corrigé) - Pr. HINAOUI (CPGE IBN EL KHATIB PRIVEE RABAT)Document65 pagesTD ELECTROMAGNETISME (Corrigé) - Pr. HINAOUI (CPGE IBN EL KHATIB PRIVEE RABAT)Douae BelhilaliPas encore d'évaluation
- ACO Cours Anglaises Brochure CompleteDocument16 pagesACO Cours Anglaises Brochure CompleteJulien MauricePas encore d'évaluation
- Fiche - Marketing Digital 2023Document2 pagesFiche - Marketing Digital 2023Leonel NebouPas encore d'évaluation
- Théorie de La GRH, Cycle B-GRHDocument52 pagesThéorie de La GRH, Cycle B-GRHmarc soubeigaPas encore d'évaluation
- Histoire Naturelle VIHDocument15 pagesHistoire Naturelle VIHOumar BaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Magnétostatique (NMJ)Document23 pagesChapitre 2 - Magnétostatique (NMJ)ejslebestPas encore d'évaluation
- 1 - Présentation DActive DirectoryDocument12 pages1 - Présentation DActive Directoryhocine faliPas encore d'évaluation
- Fiche Méthode Dissertation Bac SchoolmouvDocument8 pagesFiche Méthode Dissertation Bac Schoolmouvtolmone wardiPas encore d'évaluation
- Georges Barbarin - Le Livre de La Mort DouceDocument104 pagesGeorges Barbarin - Le Livre de La Mort DouceMichel Labelle100% (1)
- 1 Introduc Histo Climato L1Document19 pages1 Introduc Histo Climato L1coolnaoPas encore d'évaluation
- Écriture Figurée Des Différents ThéorèmesDocument8 pagesÉcriture Figurée Des Différents ThéorèmesnzalakandaguymydhaPas encore d'évaluation
- Débit Volumique: QV: Avec Si L'écoulement Est Laminaire Re 2100 Si L'écoulement Est Turbulent Lisse 2100 ReDocument2 pagesDébit Volumique: QV: Avec Si L'écoulement Est Laminaire Re 2100 Si L'écoulement Est Turbulent Lisse 2100 Reouissal electroPas encore d'évaluation
- Programme Des Cours de Biochimie Clinique 4éme AnnéeDocument2 pagesProgramme Des Cours de Biochimie Clinique 4éme AnnéewiamePas encore d'évaluation
- Fiche - Les Colchiques - Guillaume ApollinaireDocument4 pagesFiche - Les Colchiques - Guillaume ApollinaireGgbPas encore d'évaluation
- Marguerite Yourcenar - Extrait Des "Mémoires D'hadrien"Document5 pagesMarguerite Yourcenar - Extrait Des "Mémoires D'hadrien"France CulturePas encore d'évaluation
- Ethernet IEEE 802 - 3Document22 pagesEthernet IEEE 802 - 3neji jlassiPas encore d'évaluation
- IsostatismeDocument6 pagesIsostatismeHoucine TelmesliPas encore d'évaluation
- Manuel Dauto-Défense Contre Les Violences Psychologiques (Ariane Calvo (Calvo, Ariane) ) (Z-Library)Document238 pagesManuel Dauto-Défense Contre Les Violences Psychologiques (Ariane Calvo (Calvo, Ariane) ) (Z-Library)Profaris100% (1)
- Commentaire 1 JOB PDFDocument22 pagesCommentaire 1 JOB PDFV. Isaïe Modeste GANDOPas encore d'évaluation
- Communication Et Lecture Critique ScientifiquesDocument25 pagesCommunication Et Lecture Critique ScientifiqueslordcryptoairdropPas encore d'évaluation
- Les AdverbesDocument2 pagesLes AdverbesJean JerryPas encore d'évaluation
- Cours JBPMDocument22 pagesCours JBPMRose HugoPas encore d'évaluation