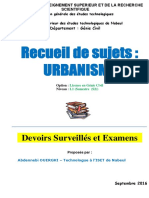5480 p29 41 Chap4
5480 p29 41 Chap4
Transféré par
Aurelien Essembion EwaneDroits d'auteur :
Formats disponibles
5480 p29 41 Chap4
5480 p29 41 Chap4
Transféré par
Aurelien Essembion EwaneTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
5480 p29 41 Chap4
5480 p29 41 Chap4
Transféré par
Aurelien Essembion EwaneDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Roman de Renart,
4 L’aventure du puits
pages 56 à 76 du manuel
Dans la rubrique « Littérature du Moyen Âge (on connaît quatorze versions du texte). La plupart
et de la Renaissance », les programmes du col- des éditions, notamment celles pour la jeunesse,
lège citent Le Roman de Renart comme une proposent un choix d’aventures, évinçant celles qui
des œuvres à faire lire « intégralement ou par pourraient présenter des difficultés de lecture (car le
extraits » (BOEN n° 6 du 28 août 2008, pro- texte du Roman de Renart est écrit dans une langue
gramme pour la classe de cinquième). très savante), mais aussi celles qui s’articulent autour
de situations scabreuses. Les adaptations sont plus
Objectifs du chapitre nombreuses que les traductions.
– Découvrir les caractéristiques du Roman de Renart • Nous avons choisi la traduction de Pierre Mezinski
à travers une de ses aventures.
(Le Roman de Renart, Gallimard Jeunesse, « Folio
– Appréhender le rapport entre Le Roman de Renart
Junior », 2009) pour sa clarté et sa fidélité au texte
et la société médiévale.
– Découvrir que le motif de l’animal est présent dans
original. Le traducteur n’a retenu que huit aventures
tous les arts du Moyen Âge (Histoire des arts). dont il a choisi l’ordre pour créer une « progression
dramatique ».
Les choix didactiques • Pour une lecture du texte intégral, on se reportera
Plutôt que de proposer des extraits de différentes à l’édition de Jean Dufournet dans La Pléiade qui
aventures de Renart, nous avons choisi de montrer donne au bas de chaque page le texte original en
le personnage dans une seule de ses histoires, « Le vers. Les vingt-six branches sont accompagnées de
Puits », que nous donnons en lecture presque inté- notices et de notes qui témoignent de l’érudition du
grale. Ce choix nous permet de centrer l’analyse médiéviste.
sur les procédés du conteur que l’on retrouve dans • L’ouvrage de Jean Verdon, S’amuser au Moyen
toutes les histoires de Renart. Âge (Points Seuil, 2007) offre une étude intéressante
« Le Puits » comporte tous les invariants de l’œuvre : sur la culture des loisirs, des plaisirs et des jeux des
rapport de complicité entre le narrateur et le lecteur, hommes du Moyen Âge.
mise en scène de Renart et d’Ysengrin, ancrage dans
la société médiévale, moyens rhétoriques utilisés par Entrer dans Le Roman
Renart pour tromper son éternel ennemi, dimension de Renart par l’image
parodique. Le programme de 2008 cite l’enluminure
En complément de ce parcours, nous proposons une comme support d’analyse de l’image en cin-
page pour guider la lecture intégrale de l’œuvre (voir quième. La fonction descriptive de l’image est
page 68 du manuel) et pour répondre au souhait privilégiée.
des professeurs qui souhaiteraient que leurs élèves
connaissent toutes les aventures de Renart. Un arrêt 1. Sur cette image, extraite du Livre de chasse de
sur « Renart et les anguilles » permettra aux élèves Gaston Phébus, on voit le renard dans différentes
d’approfondir les échos et les similitudes d’une aven- situations. L’ouvrage est en effet destiné à informer
ture à l’autre. le lecteur sur les habitudes et les comportements des
animaux dont il compte faire la chasse.
Bibliographie On peut relever (de haut en bas et de gauche à
Il existe des éditions très variées du Roman de droite) : le renard emportant une poule noire dans sa
Renart. En effet, le texte est d’abord un recueil gueule, guettant un oiseau (un pigeon ?) depuis son
© Éditions Belin 2010
constitué de vingt-cinq ou vingt-six épisodes, les terrier, en alerte, le cou ou le corps tendu, empor-
« branches », qui, dès le Moyen Âge, ont été présen- tant une poule ensanglantée, en embuscade derrière
tées dans des ordres et sous des formes différentes deux oies.
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 29
5480_ldp_francais5.indd 29 12/08/10 09:41
2. La miniature produit une impression : Selon le narrateur, lorsque le lecteur écoute une his-
– de mouvement en raison du nombre de renards toire, il veut « des choses qui [lui] plaisent » (l. 5) et
saisis dans différentes postures de chasse : le renard pas des sermons ou des « merveilles de la vie des
est toujours montré en action, en alerte. Le chasseur saints » (l. 4).
qui consulte l’ouvrage doit apprendre à se méfier Le narrateur cherche à donner de lui-même l’image
d’un animal qui est lui-même un fin chasseur et qui d’un conteur habile et inspiré (« Je me sens en veine
ne baisse jamais la garde ; pour les histoires, et Dieu qui me guide sait que j’en
– de fraîcheur en raison de la prédominance de la connais ! », l. 6-7) mais aussi d’un moraliste caché der-
couleur verte ; rière le bouffon (« On me prend souvent pour un fou ;
– de luxuriance en raison des formes des motifs flo- mais j’ai appris cela à l’école : c’est souvent de la bouche
raux et du fond ornementé. des fous que sortent les paroles de sagesse », l. 9-10).
2. Plusieurs expressions montrent que le narrateur
se comporte comme un conteur face à un audi-
toire : « Maintenant, il faut que je vous raconte
La présentation quelque chose qui puisse vous faire rire. […] vous
vous en moquez » (l. 1-3) ; « Alors, taisez-vous, tout
de Renart par le narrateur le monde ! » (l. 5-6) ; « Si vous vouliez bien m’écou-
ter » (l. 7) ; « Je vous raconterai, sans plus attendre »
pages 60-61 du manuel (l. 11-12) ; « vous aviez deviné, je pense, vous connais-
sez le personnage, vous savez sa réputation »
La torture de la faim (l. 14-15) ; « Je vous dirai donc » (l. 23).
Comme dans la plupart des aventures de Renart,
le personnage est d’abord présenté par le nar- Le personnage de Renart
rateur à la fois comme un animal torturé par la 3. La phrase montrant que le conteur estime que
faim et comme un humain capable de raisonne- le lecteur connaît déjà le personnage de Renart
ment, de sentiments et d’émotions. est « vous connaissez le personnage, vous savez sa
Ce premier extrait constitue le début de l’aven- réputation » (l. 14-15). En effet, Renart revient d’une
ture. branche à l’autre et les lecteurs du Moyen Âge le
connaissaient parfaitement.
Dans les lignes 16 à 21, le narrateur trace un portrait
Avant de lire le texte contrasté de Renart : c’est un animal solitaire (« seul,
sans compagnie »), possédant un pouvoir magique
Dans le récit oral, le conteur interpelle régulière- sur les autres (il « ensorcelle qui il veut ») qu’il uti-
ment ses lecteurs pour s’assurer de leur écoute (la lise pour mener ceux qui succombent à son charme
narration peut parfois durer longtemps) mais aussi à des actions répréhensibles (il « vous met à mau-
pour les faire adhérer à son projet narratif (faire rire, vaise école »). Bien qu’« habile », « prudent » et discret
réfléchir, etc.) et les faire entrer dans son système (il « n’aime guère le tapage »), il peut manquer de
de valeurs. Aussi les adresses au lecteur sont-elles discernement au point de tomber lui-même dans un
fréquentes lorsque le narrateur veut que ses lecteurs piège (« il n’y a de si sage qui ne fasse de sottise un
partagent ses jugements sur les événements ou sur jour ou l’autre »).
les personnages qu’il met en scène.
4. Renart est présenté comme un animal dans les
deux derniers paragraphes. Sa faim est animale tout
Lecture du texte comme ses techniques de chasse et son rapport à
l’environnement.
Objectif Le portrait moral tracé par le narrateur fait de Renart
Découvrir la présentation de Renart par le narrateur. un personnage anthropomorphe.
5. À la fin du texte, Renart quitte sa terre pour cher-
Les adresses du conteur au lecteur cher de la nourriture car il meurt de faim. Ce motif,
© Éditions Belin 2010
1. Le prologue définit les désirs du lecteur et annonce habituel dans les aventures du personnage, fait écho
la visée du récit : il s’agira avant tout de répondre à aux préoccupations des paysans du Moyen Âge qui
l’attente du lecteur en le faisant rire. connaissaient de nombreuses famines.
30
5480_ldp_francais5.indd 30 12/08/10 09:41
6. Vocabulaire. Le verbe « pâturer » est un dérivé de
pastura, « la pâture », issu du verbe pascere, « paître ». L’art du conteur
Il est synonyme de « paître ». La racine latine et la
pages 62-63 du manuel
racine française ont donné de nombreux dérivés.
Mots de la même famille formés sur le radi-
Renart pris au piège !
cal pât- : pâture, pâturage, pâturable (qui peut être
employé comme pâture), pâturin (plante qui consti- Entre ce deuxième extrait et le premier, le nar-
tue une grande partie des bonnes pâtures), pâturon rateur a montré Renart en chasseur prudent
(partie de la jambe d’un cheval, autrefois utilisée par et avisé. Tenaillé par la faim, il finit par arriver
le pâtre pour attacher l’animal), pâtre (gardien de aux abords d’une ferme où il repère des poules.
bétail), appât. Après en avoir mangé deux, il emporte la troi-
Mots de la même famille formés sur le radical sième. Le lecteur a déjà vu Renart tenté par un
past- : pasteur (dans le sens de berger ou de gardien
volatile dans l’épisode de Chantecler le coq ou
des âmes), pastoral (relatif aux activités des pasteurs,
de la mésange et échouer dans l’une et l’autre
des bergers, ou synonyme de bucolique, champêtre),
pastoureau (vx. petit berger), pastourelle (chanson tentative.
de bergère).
Avant de lire le texte
Lecture de l’image Les élèves doivent se souvenir de la fable, autre
genre littéraire qui met en scène « des animaux qui
7. Les détails de la gravure qui montrent le renard à agissent comme des hommes », et plus particulière-
l’affût sont les oreilles dressées à l’écoute du moindre
ment de Jean de La Fontaine (« Je me sers d’animaux
bruit, le regard qui fixe l’espace pour découvrir une
pour instruire les hommes »).
proie, le corps tendu et la position des pattes qui
indiquent que l’animal est prêt à bondir.
La silhouette roux et blanc du renard est mise en Lecture du texte
valeur par l’arrière-plan gravé en noir et blanc évo-
quant un paysage de neige. Objectif
Analyser l’art du conteur dans l’organisation du récit
et dans le jeu avec les références culturelles.
Expression orale
Un récit bien mené
8. On pourra demander à deux ou trois élèves seu- 1. Dans l’aventure du « Puits », le narrateur ne cesse
lement de s’entraîner en autonomie, et de venir pré- de jouer de son art dans la conduite du récit. Ici, il
senter leur lecture au reste de la classe. use de méthode pour conduire Renart au fond du
puits :
Activité supplémentaire d’orthographe – Renart sort de la grange après avoir mangé deux
poules.
Autodictée – Soudain, il est saisi par une grande envie de boire.
On demandera à chaque élève de relever dans le – Il trouve un puits et se penche à la margelle. Ce
texte dix mots qu’il trouve difficiles à écrire. Chacun puits comporte deux seaux : quand l’un monte,
apprendra la graphie des dix mots qu’il a relevés et l’autre descend.
en fera une autodictée. – Il croit apercevoir Hermeline, sa femme, au fond
du puits puis il croit l’entendre.
– Profondément troublé, il monte dans l’un des
seaux et descend dans le puits.
Les élèves ne manqueront pas d’imaginer que
Renart va tout faire pour amener un autre person-
© Éditions Belin 2010
nage (Ysengrin ?) à monter dans le seau resté en
haut et à le sortir ainsi du mauvais pas dans lequel
il se trouve.
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 31
5480_ldp_francais5.indd 31 12/08/10 09:41
2. À la fin du deuxième paragraphe, Renart se sent Lecture de l’image
triste, il est mal à l’aise parce qu’il croit voir au fond
du puits sa femme. Cet état d’âme – qui parodie ici 9. La phrase correspondant à l’image est : « Avant de
l’amour courtois – va le précipiter au fond du puits. comprendre ce qui lui arrive, le voilà qui dévale dans
3. Si le lecteur peut ressentir de l’admiration en le puits, jusqu’au fond… » (l. 27-29).
écoutant cette histoire « étonnante », il est surtout Les éclaboussures et les cercles autour du seau repré-
admiratif de l’art du conteur qui sait parfaitement sentent la violence de l’impact du seau sur l’eau.
organiser la matière narrative pour amener son per-
sonnage là où il veut tout en créant un vrai suspens.
Activité supplémentaire d’orthographe
Une situation comique
Réécriture
4. Les jeux avec les références de l’Antiquité grecque
On demandera aux élèves de réécrire le dernier para-
ou romaine sont fréquents dans Le Roman de Renart.
graphe du texte à l’imparfait de l’indicatif (l. 31 à
L’image de Renart penché sur son reflet dans l’eau
36). Cette réécriture sera suivie d’un temps d’analyse
fait songer à Narcisse.
Le passage qui fait allusion au personnage d’Écho de la valeur des formes « aimerait » (l. 33) et « serait »
est le suivant : « Sa voix remonte du fond du puits. (l. 36) qui restent identiques (irréel du présent pour
[…] Il appelle sa femme de nouveau… Et la voix de « aimerait » et potentiel pour « serait »).
nouveau remonte » (l. 24-26).
5. Les conséquences du plongeon dans l’eau sont de
l’ordre de la farce : après les nobles sentiments qui
l’ont attiré au fond du puits et l’allusion aux mythes La stratégie de Renart
de Narcisse et d’Écho, le personnage est brutale-
ment ramené à sa nature animale dans la pire des
pages 64-65 du manuel
situations pour lui (l. 31 à 36).
Le paradis à portée de voix
6. Exemples de moquerie à l’égard de Renart :
« Notre roi des menteurs est tout aise » (l. 1) ; « Dieu ! Entre le deuxième extrait et celui-ci, on voit
qui peut savoir parfois ce qui nous passe par la Ysengrin arriver aux abords du puits dans lequel
tête ? » (l. 16) ; « C’est ce qui s’appelle un coup de le goupil est retenu prisonnier. Le loup se penche
malchance ! » (l. 29) ; « Notre héros est dans de à la margelle et découvre Renart au fond du
beaux draps ! Une belle chausse-trappe du démon ! » puits mais aussitôt il voit à ses côtés une image
(l. 31-32) ; « Pas de problème, là où il est, il serait à qu’il croit être celle d’Hersent, son épouse (ce
l’aise pour pêcher ! » (l. 35-36).
n’est en fait que son propre reflet). Fou de jalou-
L’expression « Notre héros » est ironique : le narrateur
sie à l’égard de Renart (l’adultère d’Hersent est
utilise le mot « héros » au moment précis où le per-
sonnage apparaît placé dans une situation particuliè- donné traditionnellement comme la cause prin-
rement humiliante. Le déterminant possessif « notre » cipale de la rivalité entre Ysengrin et Renart),
présuppose une entente parfaite entre le lecteur et il l’insulte et le menace.
le narrateur pour se moquer de Renart.
7. Vocabulaire. « Être dans de beaux draps » au Avant de lire le texte
sens propre pourrait signifier « être couché dans un
lit paré de beaux draps » mais l’expression (familière) On pourra faire la liste au tableau des propositions
est généralement employée au sens figuré où elle des élèves pour les confronter ensuite au texte.
signifie « être dans une situation difficile ».
Lecture du texte
Expression écrite
Objectif
© Éditions Belin 2010
8. On pourra préparer la rédaction par un temps Comprendre la stratégie de Renart pour calmer la
d’échange à l’oral au cours duquel on invitera les colère d’Ysengrin et le persuader de monter dans
élèves à illustrer leur choix au moyen d’exemples. le seau.
32
5480_ldp_francais5.indd 32 12/08/10 09:41
Les inventions d’un beau parleur
1. Renart prétend être au paradis (« mon âme est 2. Cette question vise à aider les élèves à dégager la
installée juste aux pieds de Jésus », l. 21) parce qu’il progression des arguments utilisés par Renart pour
est mort (« Désormais, on m’appelle “feu Renart, qui persuader Ysengrin de monter dans le seau.
savait tant de ruses et d’arts” », l. 3-4).
lignes bref résumé des propos de Renart sentiments éprouvés par Ysengrin
1 à 15 Renart annonce sa propre mort. Touché par les propos de Renart, Ysengrin
Il énonce une morale chrétienne : la mort est accorde son pardon.
inévitable mais c’est une délivrance. Il se dit triste de la mort du Goupil.
Il se repent des péchés qu’il a commis envers
Ysengrin.
16 à 30 Renart prétend être heureux d’être mort parce Séduit, Ysengrin « se verrait bien dans ce pays-
qu’il a tout ce qu’il veut, en particulier des là » (l. 29-30).
proies à profusion.
31 à 43 Renart fait croire à Ysengrin que les deux seaux Ysengrin est impatient de rejoindre Renart
sont les plateaux d’une balance qui sert à peser au paradis.
le bien et le mal.
Il invite Ysengrin à confesser ses péchés avant
de monter dans le « plateau ».
3. Renart se montre particulièrement habile envers plus fréquentes) : « Dieu », « appeler », « mon âme »,
Ysengrin en lui donnant à imaginer les animaux que « le Seigneur » (l. 10) ; « délivrée de ses épreuves »
l’on peut voir au paradis (il cite une dizaine de noms (l. 11) ; « Que tout cela vous soit pardonné ici dans
pour rendre son propos plus concret). Cette évo- ce monde, et devant Dieu » (l. 14-15) ; « mon âme est
cation d’un paradis riche en nourritures terrestres installée juste aux pieds de Jésus » (l. 21) ; « peser le
achève en effet de persuader Ysengrin de monter bien et le mal » (l. 34) ; « Au nom de Dieu, notre père
dans le seau car sa nature de carnassier lui fait entre- spirituel » (l. 35) ; « la puissance céleste est infinie »
voir une satisfaction totale de ses instincts. (l. 35-36) ; « confesser [ses] péchés » (l. 40).
Une imitation comique
Expression écrite
du discours religieux
4. Si l’on se situe sur le plan de la morale, Renart 6. Dans Le Roman de Renart, le goupil demande
est très mal placé pour tenir un discours chrétien à Ysengrin de prier, ce que le loup s’empresse de
à Ysengrin. En effet, d’une part il vient de voler et faire de manière comique. On pourra lire le passage
de dévorer des poules, d’autre part il se sert de reproduit ci-dessous après que les élèves auront fini
la religion pour mieux tromper le loup et met les d’écrire.
croyances chrétiennes au service de son hypocrisie. « Renart, prenant son temps, se met à l’étudier.
Avec le discours de Renart, le narrateur réussit un – D’abord, il vous faut prier Dieu. Le remercier
brillant exercice de parodie religieuse : parodie du d’avance, très pieusement, en lui demandant son
discours de la faute et du repentir (l. 10-13), paro- vrai pardon et la rémission de vos péchés. C’est le
die du sermon religieux (l. 7-10) ; jeu avec l’image seul moyen d’entrer ici.
chrétienne des élus assis aux pieds de Jésus (l. 21) ; Ysengrin ne peut plus y tenir. Il tourne son cul vers
reconstitution d’un paradis « céleste » parfaitement l’orient et sa tête vers l’occident et se met à chanter
adapté aux désirs terrestres d’Ysengrin (l. 24-28) ; et à hurler le plus fort qu’il peut. Renart, qui fait tant
usage comique de la balance du Jugement dernier. de choses étonnantes, est dans le seau, au fond du
5. Vocabulaire. Les termes appartenant au voca- puits. Il a vraiment joué de malchance en s’installant
© Éditions Belin 2010
bulaire de la religion sont utilisés de manière paro- dans l’appareil. Mais, sous peu, ce sera le tour du
dique (la plupart de ces mots et expressions relèvent loup de remâcher la même amertume.
du dogme catholique et sont extraits des prières les – J’ai prié Dieu, dit enfin le loup.
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 33
5480_ldp_francais5.indd 33 12/08/10 09:41
– Et moi, je l’ai remercié, dit Renart. Ysengrin, vois-tu 2. La phrase montrant que Renart reviendra est :
ces merveilles ? Ces chandelles qui brûlent devant « Ysengrin a retrouvé son mordant et sachez qu’il
moi ? Jésus te donnera son vrai pardon, il remettra saura punir [Renart] » (l. 33-34).
gentiment tes fautes… ».
Le Roman de Renart, traduction de Pierre Mezinski, La double humiliation d’Ysengrin
Gallimard jeunesse, « Folio Junior », 2009. 3. Ysengrin subit une double humiliation. D’une part,
il se retrouve au fond du puits après avoir cru atteindre
le paradis, d’autre part, il est battu par les moines et
Activité supplémentaire de conjugaison
obligé de rentrer chez lui dans un piteux état.
On demandera aux élèves de conjuguer le verbe 4. La scène des coups de bâton fait songer au genre
« mourir » à la troisième personne du singulier puis de la farce. Elle existe dans le théâtre comique depuis
du pluriel des temps simples de l’indicatif. l’Antiquité.
5. Avant tout, Ysengrin fait preuve de naïveté à
l’égard de Renart (« pourquoi t’en vas-tu ? », lui
dit-il stupidement au début du texte). Pour Renart,
Le fin mot de l’histoire Ysengrin n’est d’ailleurs qu’un sot qui, pour toute
réponse, ne mérite qu’une réplique cinglante d’ironie
pages 66-67 du manuel (l. 9 à 14). La jubilation d’avoir défait son ennemi est
flagrante dans l’« ardeur belliqueuse » qui « brûle » à
Ysengrin trompé et battu nouveau Renart (l. 15-16). Le narrateur se situe clai-
Le texte de la page 66 est situé immédiatement rement du côté du goupil : « Ysengrin est fait comme
après l’extrait cité ci-dessus. un rat » (l. 16).
Dans les passages résumés (en italique violet), Plus loin, à l’arrivée des moines, le lecteur est témoin
le narrateur fait une satire féroce des moines de l’humiliation d’Ysengrin et de l’énergie employée
par les moines à le battre. Cependant, la scène est
« blancs », les Cisterciens, dont l’ordre, fondé en
un tel poncif du genre que le lecteur ne ressent
1098 par Robert de Molesme, prône la fruga- aucune pitié pour le loup. Pourtant, dans le dernier
lité, la pauvreté et le travail manuel. Le narrateur paragraphe, le lecteur ne peut qu’être content de la
les montre au contraire comme de bons vivants, guérison d’Ysengrin et de sa pugnacité recouvrée
paresseux (le matin, le cuisinier a du mal à les (« Que maître Renart essaie de revenir ! », l. 32) car
sortir du lit), peu respectueux des objets du culte elles donneront à un autre conteur l’occasion d’in-
(l’un d’eux prend un chandelier comme arme venter une nouvelle aventure.
contre le loup), et particulièrement cruels pour 6. À travers l’usage de phrases exclamatives (le pas-
des représentants de l’Église chrétienne. sage s’apparente à du discours indirect libre), le nar-
rateur montre que la guerre entre Ysengrin et Renart
Objectif de lecture n’est pas finie, que le loup a retrouvé son orgueil et
Saisir les caractéristiques de la fin de l’aventure qui sa pugnacité.
met Ysengrin à mal et, une nouvelle fois, proclame La fin de cette aventure, qui en annonce une nou-
Renart vainqueur.
velle, est caractéristique du Roman de Renart.
Le dernier mot de Renart
1. Dans l’extrait précédent, Renart avait affirmé à Lecture de l’image
Ysengrin « quand le bien est assez pesant, il dévale
ici jusqu’au fond » (l. 37-38, p. 65, « ici » désignant La lithographie consiste à graver une pierre que l’on
le fond du puits et le paradis) ; désormais il annonce enduit d’encre. Lorsqu’on applique une feuille de
au pauvre goupil qu’il va « en enfer en bas » et qu’il papier sur cette pierre gravée, seules les parties en
est « tombé au lieu infâme » (l. 11-13). relief sont imprimées.
Son art de la parole, sa capacité à trouver des expli- 7. Le « petit matin » qui se lève est représenté par
© Éditions Belin 2010
cations à ce qui, au fond, n’a pas de réalité, le ren- une bande blanche qui cerne les contours des élé-
dent supérieur à Ysengrin qui, par comparaison, ments noirs ou gris du dessin et suggère la lumière
apparaît comme un naïf incapable de raisonnement. du jour qui vient chasser la nuit.
34
5480_ldp_francais5.indd 34 12/08/10 09:41
La représentation des moines est conforme à la tra- à chanter et abandonne sa prudence (p. 29). Au
dition médiévale : ils sont montrés comme de bons moment où il ferme les yeux pour se concentrer sur
vivants, qui consacrent leur vie aux nourritures ter- sa chanson, Renart l’attrape par le cou et s’enfuit.
restres (ils sont gros). b. Vrai. Vers la fin de l’aventure, Renart, « presse
son cheval de l’éperon » pour s’enfuir (p. 39). Les
liens entre Le Roman de Renart et la société féodale
Expression écrite sont fréquents dans le texte. Renart y est présenté
comme un petit hobereau.
8. On pourra donner aux élèves une trame dont ils c. Faux. Dans l’histoire de Tiécelin le corbeau,
pourront s’inspirer pour écrire le passage : décou- Renart parvient à manger le fromage mais « sa plaie
verte du loup en une phrase ou deux ; échange ne s’envenima pas pour autant » (p. 53).
stupéfait entre les moines (deux ou trois répliques) ; d. Vrai. L’adultère de la louve Hersent revient à
procédure adoptée pour faire remonter le loup qui plusieurs reprises dans l’œuvre. Elle est à l’origine
hurle de terreur ; fuite du loup au moment où le seau de la haine d’Ysengrin envers Renart, son éternel
atteint la margelle du puits. rival. Certains conteurs n’hésitent d’ailleurs pas à
raconter en détail comment Renart « s’occupe » phy-
Activité supplémentaire d’orthographe siquement de la louve (p. 61 à 63).
e. Vrai. Le lion Noble est favorable à Renart, veut
Dictée préparée la paix dans son royaume et tente de dissuader
On demandera aux élèves d’expliquer l’orthographe Ysengrin de porter plainte contre lui. Le procès de
des participes passés des lignes 27 à 31. Ils devront Renart est l’occasion d’une satire de la société féo-
ensuite écrire le passage sous la dictée. Les erreurs dale, des querelles entre les nobles et du pouvoir
portant sur les participes passés pourront être péna- monarchique.
lisées plus sévèrement. f. Faux. À la fin du procès, Renart part en pèlerinage
pour l’expiation de ses péchés. La reine lui donne
son alliance en signe d’allégeance (p. 230-231), selon
un motif propre à l’amour courtois.
Œuvre intégrale g. Vrai. Les marchands d’anguilles ramassent Renart
qu’ils croient mort pour vendre sa peau (p. 104).
h. Faux. C’est Tibert le chat que les deux prêtres
Le Roman de Renart prennent pour le diable (p. 149-153).
i. Vrai. Renart fait tellement boire le loup Primaut
page 68 du manuel qu’il accepte de se faire tonsurer puis se met à
Pour cette page, nous avons choisi de faire lire sonner les cloches sans distinguer entre le glas et le
l’intégralité des huit aventures proposées par carillon (page 164).
j. Faux. Le blaireau est le meilleur allié de Renart
les éditions Gallimard dans la collection « Folio
mais il s’appelle Grimbert. Frobert est le nom du
junior ». Le texte y est en effet très abordable et
grillon.
les huit aventures retenues font partie des plus
célèbres. Arrêt sur Renart et les Anguilles
1. Renart a repéré une charrette chargée de pois-
Vrai ou faux sons et d’anguilles. Il se couche sur la route et fait le
mort. Les marchands le ramassent et le jettent dans
Remarque. Le questionnaire, qui peut être donné la charrette : ils espèrent vendre sa peau très cher.
en évaluation de lecture, comporte dix questions. Renart mange les poissons puis recouvre son corps
a. Faux. Flatté par Renart qui se présente comme d’anguilles. Il saute de la charrette et s’enfuit non
son « cousin germain », Chantecler le coq se met sans avoir lancé un quolibet aux marchands.
© Éditions Belin 2010
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 35
5480_ldp_francais5.indd 35 12/08/10 09:41
2. Ce travail permettra aux élèves de consolider leur connaissance des invariants de l’œuvre d’une aventure
à l’autre.
Le Puits Les Anguilles
Situation de Renart Il est torturé par la faim et se met à l’affût Renart est tourmenté par la faim :
au début de la pour manger. il cherche de la nourriture et se couche
branche pour « attendre les occasions ».
Usage de la ruse et Renart feint d’être au paradis pour attirer Après avoir vu la charrette, Renart fait le
du mensonge Ysengrin dans le puits, ce qui lui permettra mort pour inciter les marchands à le jeter
d’en sortir. dans la charrette.
Usage de la parole Renart quitte le puits en se moquant de la Dans sa fuite, Renart ne manque pas de
pour se moquer naïveté d’Ysengrin et en lui souhaitant un lancer un quolibet aux marchands : « Dieu
bon séjour. vous garde, Messieurs-des-poissons ! Les
anguilles que j’emmène sont les miennes !
Celles qui resteront sont toutes à vous ! »
3. À la différence de l’aventure du Puits, Ysengrin pour s’attaquer à lui, tandis que Renart quitte les
est absent et l’histoire se déroule entre un animal, lieux, dans un geste d’adieu qui laisse deviner l’ironie
Renart, et des humains. Par ailleurs, on voit surtout cruelle de ses propos.
Renart en action (il ne prononce que deux répliques)
contrairement au Puits où tout repose sur le langage.
4. Passages dans lesquels le narrateur admire son
personnage : « Renart, qui sait si bien tromper le Lexique
monde » (p. 103) ; « Renart ne s’émeut pas de leurs
menaces. Cela le ferait plutôt rire. Il sait bien, ce
damné vaurien, qu’entre dire et faire, il y a loin » (p. Le vocabulaire du Roman
104) ; « Qu’importe qu’on le prenne pour un fou !…
Sa tête va très bien, je vous assure » (p. 106).
de Renart page 69 du manuel
Passages dans lesquels il s’en amuse : « Je n’ai pas le
moindre doute là-dessus : « Renart est un persévé- La ruse et la tromperie
rant » (p. 104) ; « Renart-la-ruse-incarnée » (p. 105). 1. Le mot « ruse » désigne la capacité à utiliser des
moyens physiques ou intellectuels pour tromper
quelqu’un. En vénerie, il désigne le détour par lequel
Lecture de l’image un animal cherche à échapper à ses poursuivants. La
« traîtrise » suppose une confiance trahie.
Les deux plus récentes adaptations des aventures de
Synonymes de ruse : artifice, astuce.
Renart en bande dessinée sont les suivantes :
Synonymes traîtrise : perfidie, trahison, fourberie.
– Bruno Heitz, Le Roman de Renart, 2 volumes,
Gallimard jeunesse, 2007 et 2009. 2. Les adjectifs qui peuvent qualifier une personne
– Jean-Marc Mathis / Thierry Martin, 3 volumes (« Les rusée sont : malin (qui a de la ruse et de la finesse
jambons d’Ysengrin », « Le Puits », « Le jugement de pour se divertir aux dépens de quelqu’un), filou (qui
Renart »), Delcourt, 2007, 2008, 2009. vole avec ruse), habile (dans le sens de rusé, futé),
5. La situation dans laquelle se trouve Ysengrin est retors (plein de ruse, d’une habileté tortueuse),
parfaitement mise en valeur par le dessinateur : on finaud (qui cache de la finesse sous une apparente
voit Ysengrin assis au milieu d’une vaste étendue de simplicité), roublard (fam. qui fait preuve de ruse
glace, le derrière un peu enfoncé (il est retenu pri- dans la défense de ses intérêts).
sonnier par sa queue à laquelle un seau lourd de 3. Synonymes en niveau de langue soutenu : berner,
poissons est attaché), regardant dans la direction de duper, leurrer, mystifier.
Renart, sans doute pour l’insulter (on voit ses crocs En niveau de langue courant ou familier : rouler,
© Éditions Belin 2010
qui sortent de sa mâchoire). Des chiens arrivent blouser, faire marcher.
36
5480_ldp_francais5.indd 36 12/08/10 09:41
La moquerie Champêtre : qui appartient aux champs, à la cam-
pagne cultivée.
5. Les verbes qui appartiennent au champ lexical de Paysan : qui réside à la campagne et vit des travaux
la moquerie sont : se gausser, railler, persifler, rire
des champs.
de, ridiculiser.
Rustique : autrefois, nom désignant quelqu’un
6. Les mots ou expressions appartenant au champ vivant à la campagne (voir « Le Rat de ville et le Rat
lexical de la moquerie sont : « il lui rit au nez » ; « ridi- des champs » de Jean de La Fontaine). Aujourd’hui,
culiser » ; « Il lui lance des quolibets » ; « le tourner en l’adjectif qualifie du mobilier ou des manières
ridicule » ; « ses railleries ». simples (dans ce cas, il comporte parfois une valeur
7. 1. Comment, vous avez peur, se moquait Renart péjorative).
avec ironie (ou arrogance) ! 2. Je m’en moque, Rustre : qualifie un homme grossier et brutal.
s’écria le goupil avec arrogance (ou ironie). 3. Vous 11. Au Moyen Âge (dès le xie siècle), un « vilain » est
vous moquez du monde, dit Renart avec colère. 4. Il un paysan libre. L’origine du nom est villanus, l’habi-
s’est bien moqué de vous, dit Hersent à son mari tant d’une villa, c’est-à-dire d’une ferme.
avec reproche. 5. Il se moque que je sois battu, dit Par extension et par rapprochement avec l’adjectif
le loup avec dépit. « vil », caractérisant quelqu’un ou quelque chose qui
inspire le mépris, l’adjectif « vilain » a caractérisé ceux
Le monde rural qui ont des sentiments laids, communs, et a signifié
8. L’adjectif « rural » vient du latin rus, ruris, qui méprisable, déshonorant.
désigne la campagne. Il caractérise la vie dans les En français moderne, l’adjectif « vilain » peut qualifier
campagnes, la vie des paysans. quelqu’un qui n’est pas gentil (un vilain garnement).
9. Campagnard : caractéristique de quelqu’un qui On utilise aussi l’adjectif « vilain » à propos d’un phy-
vit à la campagne ou de quelque chose qui rappelle sique désagréable à voir, ou de quelque chose qui
la campagne (un air, un mode de vie). n’est pas beau à regarder (un vilain nez, un vilain
papier, une vilaine écriture, etc.) ou encore comme
équivalent de « mauvais » (un vilain temps).
12.
Espaces cultivés ou Séparations entre Espaces plantés d’arbres
Bâtiments
entretenus par l’homme des espaces cultivés ou d’arbustes
pâture, herbage, champ, clôture, lisière, barrière haie, forêt, taillis, sous-bois, clos, masure, ferme,
prairie, terre, pâturage, pré futaie, broussailles, fourré domaine, cabane
13. 1. Au Moyen Âge, les paysans avaient le plus 1. il descendit / ils descendirent ; il ressortit / ils res-
souvent du mal à se nourrir. 2. L’ensemble des pay- sortirent ; il monta / ils montèrent ; il découvrit / ils
sans constitue la paysannerie. 3. En regardant vers découvrirent ; il sentit / ils sentirent ; il reconnut / ils
l’ouest, on peut voir un paysage champêtre. 4. On reconnurent ; il comprit / ils comprirent ; il fut / ils
appelle paysagistes les peintres de paysages. furent ; il eut / ils eurent.
2. Lorsque Renart comprit que les moines allaient
le poursuivre, il s’enfuit dans un sous-bois où il
se cacha pendant un moment. Mais il fut bientôt
Atelier d’expression délogé par un chien de chasse. Renart prit par un
chemin creux, courut le plus vite qu’il put et s’ar-
pages 70-71 du manuel rêta devant un mur.
3. Lorsque Renart et Hersent comprirent que
Activités de langue les moines allaient les poursuivre, ils s’enfuirent
dans un sous-bois où ils se cachèrent pendant un
Les 3es personnes du passé simple moment. Mais ils furent bientôt délogés par un
© Éditions Belin 2010
Ces exercices aideront les élèves pour les chien de chasse. Renart et Hersent prirent par un
sujets 1 et 2 de la page 71 du manuel (écriture chemin creux, coururent le plus vite qu’ils purent
de récits au passé simple). et s’arrêtèrent devant un mur.
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 37
5480_ldp_francais5.indd 37 12/08/10 09:41
4. Par exemple. Renart vit l’ours qui s’approchait de – Vous avez tort de douter de moi, je suis votre ami,
lui. Il recula et son poil se hérissa. Il songea alors à je vous le jure.
s’enfuir mais il eut une meilleure idée. 9. L’ordre des répliques est : e – c – a – d – f – b.
5. Par exemple. Réveillé en sursaut par une idée
lumineuse, Renart convoqua ses amis au beau milieu
de la nuit pour leur faire part de son projet.
La ponctuation du dialogue
Sujets d’expression
Ces exercices aideront les élèves pour les écrite et orale
sujets 4 et 5 de la page 71 du manuel (écriture
Les sujets proposés s’inscrivent dans les consignes
de dialogues).
ministérielles. En effet, les programmes de 2008
6. 1. Lorsque Renart comprend qu’Ysengrin va s’en- (BOEN n°6 du 28 août) indiquent que l’élève « doit
fuir, il lui crie : être capable, en cinquième, de maîtriser la narration
– Que le diable t’emporte ! [et la description]. Les récits qu’il écrit peuvent éga-
– C’est toi qui iras en enfer, lui répond Ysengrin. lement inclure des dialogues ».
2. Noble le lion se tourne vers Renart :
– Que réponds-tu pour ta défense ? Écrit Rédiger au passé un récit
– Sire, répond Renart, je n’ai eu de cesse de vous inspiré du Roman de Renart
servir fidèlement.
1. La séquence narrative demandée aux élèves
– Certes, réplique le lion, mais de cela il n’est pas n’existe pas dans l’aventure du Puits.
question ici.
Conseils pour la mise en œuvre de l’activité
7. 1. Cher Renart, je ne te remercierai jamais assez ! Le travail en petits groupes (voir le premier « Conseil
2. Quand cesseras-tu de chasser sur mes terres ? de méthode ») peut se clore par un temps de mise en
3. C’est pitié de voir Ysengrin dans un tel état ! commun et de comparaison des trames obtenues.
4. Quoi, tu prétends que tu me donneras ce jambon ? Les élèves pourront ensuite rédiger individuellement
5. Que Renart cesse de jouer de mauvais tours, c’est à partir de la trame qui leur semblera la plus intéres-
impossible ! sante ou la plus facile à développer (et pas nécessai-
8. – Si j’étais certain de trouver en vous un ami, je rement celle de leur groupe).
vous donnerais tout le miel que vous pouvez désirer ! Pour que les élèves maîtrisent les formes du passé
– Comment, répond l’ours, vous n’avez pas confiance simple, on pourra leur demander de se regrouper,
en moi ? dans un tableau comme celui qui est proposé ci-
– Si, j’ai confiance en vous, mais j’ai été si souvent dessous, des verbes au passé simple qu’ils auront
trahi que je me méfie… rencontrés lors de leurs lecture.
Passé simple en -a / -èrent -it / -irent -ut / urent -int / -inrent
Exemples il marcha / Il partit / Il voulut / Il tint /
ils marchèrent ils partirent ils voulurent ils tinrent
Verbes trouvés
personnellement lors
de diverses lectures
2. Conseils pour la mise en œuvre de l’activité Oral Raconter une nouvelle
On pourra inviter les élèves à se reporter à la aventure de Renart
page « Lexique » (page 69 du manuel) pour ce qui
concerne le vocabulaire de la ruse mais aussi celui de 3. Conseils pour la mise en œuvre de l’activité
la campagne et de ses paysages et à la page 70 pour Le sujet est assez difficile à réussir. On pourra pro-
© Éditions Belin 2010
l’usage de la 3e personne du passé simple. poser aux élèves de travailler en groupes et de venir
raconter le combat à plusieurs. La recherche d’exa-
gérations épiques peut se faire en classe entière
38
5480_ldp_francais5.indd 38 12/08/10 09:41
après que les élèves auront imaginé la trame de leur La double page permettra d’apporter aux
récit. élèves des informations sur :
– les types de supports médiévaux pouvant com-
Écrit Rédiger un dialogue porter des images : bréviaires, livres de chasse, livres
4. Conseils pour la mise en œuvre de l’activité d’heures, tapisseries ;
L’activité d’expression écrite pourra être préparée – le style des miniatures médiévales : supports, tech-
par un temps de dialogue oral entre deux élèves qui niques, couleurs, graphismes ;
endosseront le rôle de Renart et d’Ysengrin. Durant – l’art de la miniature en général (on trouvera une
cette phase de préparation, la qualité et le ton des documentation intéressante sur le site www.cosmo-
répliques constitueront les deux principaux critères visions.com/artMiniature.htm)
de réussite. Pendant la phase d’écriture qui suivra, – la vie quotidienne au Moyen Âge à travers ce que
on demandera aux élèves de conserver en mémoire nous en dit l’art de l’époque.
ces deux critères.
5. Conseils pour la mise en œuvre de l’activité 1 Une miniature du XIIIe siècle : le cochon
Ce sujet est une variante du précédent. Il permet Le cochon constitue une ressource alimentaire indis-
de donner aux élèves un sujet qui reste proche du pensable au Moyen Âge. Chaque paysan veille à bien
Roman de Renart par le thème mais sans les obliger engraisser ses cochons.
à prendre Renart ou Ysengrin comme personnage(s). On voit ici une scène où deux cochons sont nourris
avec des glands de chêne qu’un paysan fait tomber
Oral Mettre en scène avec un bâton. Le cochon de droite attend que les
un passage du Roman de Renart glands tombent tandis que l’autre se régale.
6. Conseils pour la mise en œuvre de l’activité G Cette scène peut étonner de nos jours : d’une part,
ces cochons d’élevage ne ressemblent pas à ceux
On peut imaginer une véritable mise en scène du
que nous pouvons voir aujourd’hui mais ils s’appa-
procès de Renart : tribune derrière laquelle siègent
rentent davantage à des sangliers ou à des cochons
les juges, témoins à charge ou de la défense, avo-
sauvages. D’autre part, le mode de nourriture des
cats, procureur du roi. Cette activité peut être déve-
cochons présenté sur l’image a totalement disparu
loppée jusqu’à devenir un petit spectacle théâtral
de nos jours. La miniature témoigne d’une époque
pour d’autres classes.
où le lien entre l’homme, la nature et l’animal était
très étroit.
Comme souvent dans la miniature, le fond est
Histoire des arts constitué d’un motif stylisé qui met en relief le sujet
représenté.
pages 72-73 du manuel
2 Une miniature du XIVe siècle : le chien
Au Moyen Âge, la chasse est réservée aux nobles,
Les animaux à ceux qui possèdent la terre. Le chien joue un rôle
dans l’art médiéval de premier plan dans cette activité essentielle à l’ali-
mentation, à l’habillement et à l’aménagement des
Au Moyen Âge, l’animal joue un rôle de premier lieux de vie.
plan dans la vie quotidienne. Indispensable pour se Les livres de chasse sont des sortes de manuels
nourrir, il est aussi nécessaire pour les travaux des destinés aux chasseurs qu’ils documentent sur
champs, la chasse ou comme moyen de transport. le gibier et sur les techniques de chasse. Celui de
De ce fait, l’animal est très présent dans l’art, notam- Gaston Phœbus est un des plus célèbres (on trouvera
ment celui de la miniature. une documentation sur le site http://classes.bnf.fr/
Le thème choisi s’inscrit dans le domaine phebus)
« arts du visuel » du document « Organisation G Selon le Livre de la chasse de Gaston Phœbus, le
de l’histoire des arts » (BOEN n°32 du 28 août chien, de grande taille par rapport à l’homme qui
© Éditions Belin 2010
2008 téléchargeable sur le site du M.E.N.). le tient, est tenu en laisse souplement, sans trop de
Il relève de la thématique « Arts, créations, tension au niveau du cou. La manière de placer les
cultures ». mains autour de la laisse est à noter : il s’agit d’éviter
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 39
5480_ldp_francais5.indd 39 12/08/10 09:41
de lâcher le chien au cas où il se mettrait brutale- du cheval. Plusieurs faucons sont représentés en vol,
ment à courir. sans doute pour des raisons décoratives surtout.
On pourra amener les élèves à faire des remarques G Les animaux diffèrent sensiblement de ceux qui
sur la représentation de la forêt qui sert de décor sont représentés sur les miniatures de la page 73 :
(simplicité des formes des arbres, effet de couver- à l’inverse du cochon, du chien et des bœufs repré-
ture des fûts, contrastes de couleurs entre les bandes sentés sans aucun ornement, les chevaux frappent
horizontales). par la richesse de leur harnachement, à la hauteur
de celle des seigneurs qui les montent.
3 Une miniature du XVe siècle : le bœuf G Les miniatures de la page 72 présentent des pay-
Le manuscrit des Très Riches Heures du duc de Berry sans occupés à des tâches essentielles mais jugées
est un livre de prières conçu par l’atelier des frères sans noblesse : nourrir les cochons, mener un chien,
de Limbourg, sur une commande de Jean de Berry. labourer un champ. Les animaux y remplissent
Sa réalisation s’étend de 1410 à 1485. Il est conservé des fonctions purement utilitaires. Les décors sont
au musée Condé, à Chantilly. simples, sauf celui de la miniature tirée du manuscrit
Le manuscrit présente soixante-cinq petites minia- des Très Riches Heures du duc de Berry. Au contraire,
tures et soixante-six miniatures en pleine page, dont chaque détail des animaux représentés sur la tapis-
les douze premières illustrent les mois de l’année serie est un indicateur de la richesse des hommes
et les constellations. Les couleurs viennent de pig- qui les entourent.
ments d’origine végétale ou minérale, en particulier
le minium, oxyde de plomb de couleur rouge d’où
dérive le mot miniature. Leur éclat est rehaussé par Lecture de l’image
l’application d’or peint, or bruni ou argent.
On pourra voir l’ensemble de ces miniatures sur le Départ pour la chasse au faucon
site www.herodote.net/galeries/TRH_00.php 1. La diagonale qui suit la pente de la colline est
G Sur cette miniature consacrée au mois de mars, essentielle dans l’organisation de la tapisserie. Elle
le second bœuf est représenté en noir derrière le sépare les bâtiments du domaine seigneurial des
premier, en beige clair. La forme des deux bœufs chevaux et des personnages.
étant strictement identique, il en résulte un effet de 2. Le personnage principal à cheval est placé au
duplication, comme si le second bœuf était l’ombre centre de la scène et son corps, prolongé par un
du premier. arbre au second plan, forme une ligne verticale qui
G Le château du duc de Berry occupe toute la partie équilibre l’ensemble de l’image.
haute de la miniature. Les chemins et les murs qui Les vêtements de ce jeune seigneur sont très luxueux,
prolongent sa forme ovoïde donnent l’impression notamment les broderies qui ornent le manteau.
qu’il domine de toute sa puissance le paysage dans
3. Le décor est particulièrement foisonnant. Chaque
son entier (champs, paysans au travail, animaux).
espace entre les bâtiments, les chevaux et les per-
4 Une tapisserie du début du XVIe siècle : sonnages est recouvert de végétation, la ramure du
pommier à gauche est parsemée de fruits rouges,
le cheval et le faucon
les lignes des collines en arrière-plan sont plantées
La tapisserie, destinée à un château, représente une
d’arbres. Au premier plan, le sol semble recouvert
scène de départ à la chasse au faucon. Ce type de
d’un tapis de fleurs légères selon la technique du
chasse, réservée aux nobles à qui on l’enseignait,
style « mille fleurs » qui apparaît à la fin du Moyen
était très codifié.
Âge.
G La scène rassemble les éléments caractéristiques
d’une chasse prestigieuse. À l’arrière-plan de la
tapisserie, plusieurs bâtiments laissent deviner un
vaste domaine seigneurial. Les seigneurs qui s’ap-
prêtent à partir à la chasse, richement vêtus, sont Évaluation page 75 du manuel
placés au premier plan d’un paysage foisonnant. Les
animaux requis pour la chasse sont eux-mêmes d’un Ma commère la mésange
© Éditions Belin 2010
grand raffinement. Bien que très court, l’extrait permet de vérifier la
Les chasseurs à cheval tiennent le faucon sur leur connaissance et la compréhension de l’œuvre par
main tandis qu’un écuyer veille sur le comportement les élèves.
40
5480_ldp_francais5.indd 40 12/08/10 09:41
Lecture du texte
1. Le Roman de Renart porte ce titre en raison de la langue utilisée par ses auteurs, le roman, qui est le
français du Moyen Âge.
2.
Univers des hommes Univers des animaux
« la salue » + le fait que Renart parle « perchée sur la branche »
« Ma commère » « ayant caché ses œufs dans l’arbre »
« donner un baiser » « trompé tant de biches, tant d’oiseaux »
« dit la mésange » + le fait que la mésange parle
« vous êtes le parrain de mon fils »
« un brigand d’une telle envergure »
« Vous avez joué tant de tours à tant de monde… »
3. L’expression qui résume la réputation de Renart mation indiquent le ton encourageant employé par
est la suivante : « Vous avez joué tant de tours à tant Renart pour amadouer la mésange.
de monde » (l. 8-9). Renart est présenté d’une aven- « Taisez-vous, Renart ! » (l. 6) : le point d’exclamation
ture à l’autre comme un personnage très rusé, très marque le ton péremptoire employé par la mésange
intelligent, expert dans l’art du langage, mais la plu- pour refuser la proposition de Renart.
part du temps animé de mauvaises intentions.
6. « vous avez tellement trompé », « vous avez berné
4. Renart est toujours attentif à sa manière d’abor- tant de monde ».
der ceux qu’il veut persuader. En général, il fait
appel à leurs sentiments ou à leur sensibilité pour
les séduire. Avec l’expression « Ma commère » qui Expression écrite
rappelle à la mésange ses liens avec lui, il espère
gagner son affection. 7. Il serait bien d’avoir fait faire aux élèves les exer-
5. « Ma commère, vous tombez à point ! Descendez cices de la page 70 (La ponctuation du dialogue)
me donner un baiser ! » (l. 4-5) : les points d’excla- avant la tâche d’écriture demandée.
© Éditions Belin 2010
4. Le Roman de Renart, L’aventure du puits • 41
5480_ldp_francais5.indd 41 12/08/10 09:41
Vous aimerez peut-être aussi
- Les 3 Vagues de Volontaires - Dolores Cannon by Dolores CannonDocument475 pagesLes 3 Vagues de Volontaires - Dolores Cannon by Dolores Cannonsylvie100% (11)
- Je Crée Mon Premier Torrent Sur Ygg (Pour Les Nuls)Document61 pagesJe Crée Mon Premier Torrent Sur Ygg (Pour Les Nuls)Aurelien Essembion Ewane100% (1)
- Martin-Gaillard Genres Litteraires RomeDocument248 pagesMartin-Gaillard Genres Litteraires RomeEpistêmôn Empéïrôs100% (2)
- COMMENTAIRE - INTRODUIRE - ExercicesDocument4 pagesCOMMENTAIRE - INTRODUIRE - ExercicesElia DjamadarPas encore d'évaluation
- Neuvaine de Protection Spirituelle de Jean PlyaDocument8 pagesNeuvaine de Protection Spirituelle de Jean PlyaFrançois100% (1)
- Walter Benjamin - Philosophie Du LangageDocument76 pagesWalter Benjamin - Philosophie Du Langagegaloport974100% (2)
- Contes Du Chat PerchéDocument41 pagesContes Du Chat PerchéМария КураеваPas encore d'évaluation
- Rituel Conse PDFDocument9 pagesRituel Conse PDFfbneqqahPas encore d'évaluation
- RITUEL POUR LA GUERISON D'un Malade PDFDocument7 pagesRITUEL POUR LA GUERISON D'un Malade PDFprince romanel67% (3)
- Le Roman de RenartDocument30 pagesLe Roman de RenartgrasselorikPas encore d'évaluation
- La fableDocument5 pagesLa fablediemexavier988Pas encore d'évaluation
- FarcesDocument2 pagesFarcesNoréline JanacPas encore d'évaluation
- Mourlevat PDFDocument21 pagesMourlevat PDFSafa OJEILPas encore d'évaluation
- PoésiefableDocument38 pagesPoésiefableAziz DassilvaPas encore d'évaluation
- NRPC HS 1605 619-2 P Les Extraits Des Revues2872Document36 pagesNRPC HS 1605 619-2 P Les Extraits Des Revues2872monique gearaPas encore d'évaluation
- Etude D'oeuvre Intégrale. ElvisDocument26 pagesEtude D'oeuvre Intégrale. ElviskanjeanelvisPas encore d'évaluation
- Fiche Defi Le Vilain Petit Canard Cycle 3Document7 pagesFiche Defi Le Vilain Petit Canard Cycle 3emiriollaPas encore d'évaluation
- NRPC HS 1605 619-2 P Les Extraits Des Revues2872Document36 pagesNRPC HS 1605 619-2 P Les Extraits Des Revues2872Sylvie COLY100% (3)
- Seq Renart DeiddaDocument15 pagesSeq Renart DeiddaZineb LogdaliPas encore d'évaluation
- La Cigogne Et Le Renard Jean de La Fontaine, ÉsopeDocument13 pagesLa Cigogne Et Le Renard Jean de La Fontaine, ÉsopeCentre de littérature de jeunesse de la CreusePas encore d'évaluation
- 2ND Culture LitteraireDocument3 pages2ND Culture LitteraireÉlie roch100% (2)
- JixogofatogigetamDocument3 pagesJixogofatogigetamHambinintsoa RindratianaPas encore d'évaluation
- Le Petit Poucet 3Document2 pagesLe Petit Poucet 3steph.patouPas encore d'évaluation
- L'art Du Récit 2Document3 pagesL'art Du Récit 2yoan tancelinPas encore d'évaluation
- Ronsard Quand Vous Serez Bien VieilleDocument4 pagesRonsard Quand Vous Serez Bien VieillePatPas encore d'évaluation
- Eleve cm2Document29 pagesEleve cm2Gwen JolivetPas encore d'évaluation
- Yvain, Le Chevalier Au LionDocument13 pagesYvain, Le Chevalier Au LionmallietPas encore d'évaluation
- Analyse La FontaineDocument14 pagesAnalyse La FontaineMeriem BRIKIPas encore d'évaluation
- Genre Littéraire Et Genre NarratifDocument8 pagesGenre Littéraire Et Genre NarratifNassim DjenanePas encore d'évaluation
- FablesDocument6 pagesFablesrrrsPas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument6 pagesChapitre Imanel hamzaouiPas encore d'évaluation
- Corrigé Le Medecin Malgre LuiDocument86 pagesCorrigé Le Medecin Malgre LuiJoelle Finocchiaro100% (2)
- Ile Mysterieuse SequenceDocument11 pagesIle Mysterieuse SequenceHelene Di marcantonioPas encore d'évaluation
- Le Roman de RenartDocument34 pagesLe Roman de RenartAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Manuel-Houry Sixieme PDFDocument876 pagesManuel-Houry Sixieme PDFimranfle100% (2)
- 6 Séances de Lecture Pour Découvrir Le Genre FantastiqueDocument15 pages6 Séances de Lecture Pour Découvrir Le Genre FantastiquesirinPas encore d'évaluation
- Francais5e Sourcepdf LL 140124034808 Phpapp01 PDFDocument151 pagesFrancais5e Sourcepdf LL 140124034808 Phpapp01 PDFIGHANIMENPas encore d'évaluation
- Appel_sauvage_4449252_fiche2pdfDocument2 pagesAppel_sauvage_4449252_fiche2pdfManon GutzwillerPas encore d'évaluation
- Essai Sur La Valeur Symbolique de La Genette Dans La Littérature Et L'art Médiéval OccidentalDocument17 pagesEssai Sur La Valeur Symbolique de La Genette Dans La Littérature Et L'art Médiéval OccidentalArchibald Bruno von PecznaczynyPas encore d'évaluation
- les_albums_de_jeunesse_au_service_de_lapprentissageDocument19 pagesles_albums_de_jeunesse_au_service_de_lapprentissageorientations29Pas encore d'évaluation
- Chretien Troyes Chevalier CharretteDocument16 pagesChretien Troyes Chevalier CharretteDante DarmawangsaPas encore d'évaluation
- Sequence 8 Les Réecriture Du XVI Jusqu'a Nos JoursDocument71 pagesSequence 8 Les Réecriture Du XVI Jusqu'a Nos JoursOcéane LegrosPas encore d'évaluation
- cours-2025-01-15Document4 pagescours-2025-01-15Imane ElmahiPas encore d'évaluation
- AL4FR51TEWB0112 SommaireDocument2 pagesAL4FR51TEWB0112 SommaireFLEURIERPas encore d'évaluation
- Etude Fables, Livre 1Document3 pagesEtude Fables, Livre 1kathyPas encore d'évaluation
- RAY MAL PERTUIS Aux Sources de MalpertuisDocument7 pagesRAY MAL PERTUIS Aux Sources de MalpertuisrebuPas encore d'évaluation
- Le - Horla - Et - Autres - Nouvelles - Fantastiques de MaupassantDocument26 pagesLe - Horla - Et - Autres - Nouvelles - Fantastiques de Maupassantvandewalle.dominique100% (1)
- fableetnouvelle (1) (2)Document9 pagesfableetnouvelle (1) (2)fahd.bellakhderPas encore d'évaluation
- Projet 2 Séquence3 de 2èmeDocument13 pagesProjet 2 Séquence3 de 2èmeDjamel Seba100% (1)
- COLLEGE - 4 Nouvelles de MaupassantDocument32 pagesCOLLEGE - 4 Nouvelles de MaupassantA. SchwartzPas encore d'évaluation
- Ra18 c3 Lexculture Ruse 1094127Document8 pagesRa18 c3 Lexculture Ruse 1094127doudalamyPas encore d'évaluation
- MandarineCE2 Guide Pedagogique Chapitre02Document15 pagesMandarineCE2 Guide Pedagogique Chapitre02Camille CousinPas encore d'évaluation
- Fables Au Cycle 3 CM PDFDocument29 pagesFables Au Cycle 3 CM PDFcapt captPas encore d'évaluation
- GargantuaDocument193 pagesGargantuaCécile BOUYE100% (2)
- Dialogue NarratifDocument8 pagesDialogue NarratifMohamed EnnouriPas encore d'évaluation
- Progression Annuelle - Seconde GTDocument2 pagesProgression Annuelle - Seconde GTkarle317Pas encore d'évaluation
- Les Synonymes Et Les PériphrasesDocument2 pagesLes Synonymes Et Les PériphrasesMohaChebi100% (1)
- Typologie Des DiscoursDocument38 pagesTypologie Des Discourslilbaby7100% (1)
- Henri Pena-Ruiz-Le Roman Du Monde-légendes Philosophiques-JerichoDocument452 pagesHenri Pena-Ruiz-Le Roman Du Monde-légendes Philosophiques-Jerichoyves delesse amaniPas encore d'évaluation
- Lancelot Le Chevalier A La Charrette-Fiche EnseignantDocument13 pagesLancelot Le Chevalier A La Charrette-Fiche EnseignantMohamed ToukPas encore d'évaluation
- F5e Livreduprofesseur Chap05Document19 pagesF5e Livreduprofesseur Chap05h944m7sbvvPas encore d'évaluation
- 4FR41TEWB0124U02 CoursFrancais-U02Document25 pages4FR41TEWB0124U02 CoursFrancais-U02Sirine LoukiliPas encore d'évaluation
- 2AS - P3 - Séquence - Vingt Mille Lieues Sous Les Mers, Jules VerneDocument12 pages2AS - P3 - Séquence - Vingt Mille Lieues Sous Les Mers, Jules Vernelycinal.fr5Pas encore d'évaluation
- Tle EOI Oeuvre Narr Cut Litt S1 Le Genre RomanesqueDocument3 pagesTle EOI Oeuvre Narr Cut Litt S1 Le Genre Romanesquengorankoffitoussaint553Pas encore d'évaluation
- Le Roman de Renart (anonyme): Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLe Roman de Renart (anonyme): Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Support de Travaux Pratique E.E.PDocument41 pagesSupport de Travaux Pratique E.E.PFarid KhouchaPas encore d'évaluation
- Ds-Ex UrbDocument28 pagesDs-Ex UrbAurelien Essembion EwanePas encore d'évaluation
- MEDIAGRAPHIEDocument2 pagesMEDIAGRAPHIEAurelien Essembion EwanePas encore d'évaluation
- Cours MLD1Document3 pagesCours MLD1Elja MohcinePas encore d'évaluation
- Brasaf RapportDocument2 pagesBrasaf RapportAurelien Essembion EwanePas encore d'évaluation
- CV BabyDocument1 pageCV BabyAurelien Essembion EwanePas encore d'évaluation
- Annale Info ESGDocument46 pagesAnnale Info ESGAurelien Essembion Ewane100% (2)
- 30 08 14 Arret Moteur SouffranceDocument312 pages30 08 14 Arret Moteur Souffrancepolomacqueen100% (1)
- 51 0718 - LAnge Du SeigneurDocument28 pages51 0718 - LAnge Du SeigneurAdony Ndinga NdingaPas encore d'évaluation
- Le GenieDocument232 pagesLe Genielucaspouplard100Pas encore d'évaluation
- Le Revêtement de Puissance Pour La Croissance de L'égliseDocument2 pagesLe Revêtement de Puissance Pour La Croissance de L'égliseaureliengagoum75Pas encore d'évaluation
- Neuvaine A Sainte RitaDocument12 pagesNeuvaine A Sainte RitalalaaleguePas encore d'évaluation
- Bible New Testament Matthew Peshitta LamsaDocument234 pagesBible New Testament Matthew Peshitta Lamsakonan michaelPas encore d'évaluation
- File 001314Document20 pagesFile 001314Rodrick MabialaPas encore d'évaluation
- Jean Traduction SynoptiquesDocument12 pagesJean Traduction SynoptiquespanagiaguadalupisPas encore d'évaluation
- Critère D'un Vrai PropheteDocument13 pagesCritère D'un Vrai ProphetedavidPas encore d'évaluation
- 65 Comment Eprouver Les Esprits Aiden Wilson TozerDocument22 pages65 Comment Eprouver Les Esprits Aiden Wilson TozerTRAOREPas encore d'évaluation
- Ado Definitif Modifié Ok OkDocument85 pagesAdo Definitif Modifié Ok Okmoussa.gbanetPas encore d'évaluation
- Les Quatres Saisons de La VieDocument11 pagesLes Quatres Saisons de La VieYvesPas encore d'évaluation
- Initiation Au Sacerdoce Du FaDocument18 pagesInitiation Au Sacerdoce Du FaAymericPas encore d'évaluation
- 63-0317E La Brêche Entre Les Sept Âes de L'eglise Et Les Sept SceauxDocument30 pages63-0317E La Brêche Entre Les Sept Âes de L'eglise Et Les Sept SceauxGRACEFUL BIHPas encore d'évaluation
- AUTEL DE PRIERE Attendre L'epouxDocument3 pagesAUTEL DE PRIERE Attendre L'epouxpradier kipPas encore d'évaluation
- S'exprimer Sur Le Divorce Et Le Remariage - Tony EvansDocument52 pagesS'exprimer Sur Le Divorce Et Le Remariage - Tony EvansDodo Cherie AllouPas encore d'évaluation
- 2017 Graham Cooke Occupy FRDocument3 pages2017 Graham Cooke Occupy FRkiasalathierryPas encore d'évaluation
- La Voie de L'émerveillementDocument160 pagesLa Voie de L'émerveillementAnaksa Nort100% (2)
- Catéchèse Familiale 13Document4 pagesCatéchèse Familiale 13SaréPas encore d'évaluation
- (Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Abd-Al-Karim Jossot Et Le Sentier D'allahDocument13 pages(Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Abd-Al-Karim Jossot Et Le Sentier D'allahRoger MayenPas encore d'évaluation
- le bonheur de servir....Document22 pagesle bonheur de servir....Win ROSEPas encore d'évaluation
- Neuvaine - Je Suis Une Merveille Aux Yeux de DieuDocument9 pagesNeuvaine - Je Suis Une Merveille Aux Yeux de DieuSECHET100% (2)
- 4 5843635853288541872Document271 pages4 5843635853288541872TatianaCaraim100% (1)
- Lettre de Descartes À ChanutDocument3 pagesLettre de Descartes À Chanutlaotrasociologia129Pas encore d'évaluation
- Les Pouvoire de La Sourate IkhlassDocument2 pagesLes Pouvoire de La Sourate Ikhlassbangaly camaraPas encore d'évaluation
- La Priere de LassembleeDocument1 pageLa Priere de LassembleeNax StéphaniePas encore d'évaluation