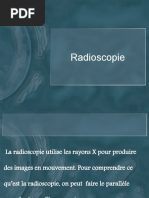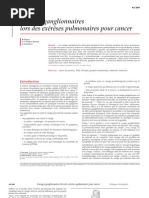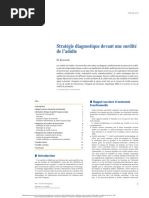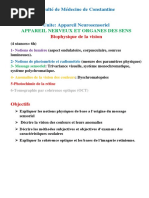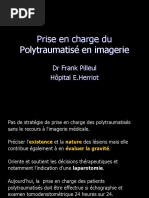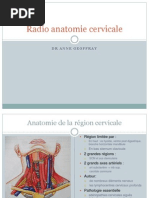Chirurgie ORL Assistée Par Ordinateur PDF
Chirurgie ORL Assistée Par Ordinateur PDF
Transféré par
naruto kakmDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chirurgie ORL Assistée Par Ordinateur PDF
Chirurgie ORL Assistée Par Ordinateur PDF
Transféré par
naruto kakmTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Chirurgie ORL Assistée Par Ordinateur PDF
Chirurgie ORL Assistée Par Ordinateur PDF
Transféré par
naruto kakmDroits d'auteur :
Formats disponibles
¶ 46-545
Chirurgie ORL assistée par ordinateur
B. Lombard
L’avènement d’une technologie nouvelle a fréquemment constitué dans l’histoire moderne de la
médecine le point de départ d’un progrès sensible, soit en augmentant l’acuité perceptive du médecin –
source de nouvelles possibilités diagnostiques – soit en s’interposant entre la main du thérapeute et le
corps malade, source d’affinement de l’acte thérapeutique. Ainsi en est-il, par exemple, du microscope, de
l’électrocardiographe, ou encore des rayons X, chacun à l’origine de spécialités médicales majeures.
L’application à la chirurgie ORL des possibilités immenses de la technologie numérique est encore trop
récente pour mesurer objectivement son impact. Mais, outre le fait qu’elle risque de devenir rapidement
incontournable, il se pourrait qu’elle conduise non seulement à une nouvelle manière d’opérer mais aussi,
à une façon différente de penser la chirurgie. Nouvelle manière d’opérer : grâce à l’association des
possibilités de l’endoscope-laveur panoramique et de micro-instruments motorisés couplés au guidage
numérique, élargissant le champ d’application de notre spécialité tout en offrant la possibilité de voies
d’abord de plus en plus subtiles. Façon nouvelle de penser la chirurgie : par la possibilité de planifier l’acte
opératoire, d’analyser ses écueils prévisibles, de l’optimiser, voire de le simuler à partir des données
acquises par une imagerie, elle aussi numérique et en perpétuelle amélioration. Le but du présent article
est de présenter dans leurs grandes lignes les concepts qui président à la chirurgie à assistance
numérique, certains aspects techniques inévitables pour concevoir la manière d’utiliser ces systèmes, et ce
qu’il est raisonnable d’en attendre en l’état actuel du savoir-faire technologique.
© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Chirurgie assistée par ordinateur ; Chirurgie infodromique ; Chirurgie des sinus ;
Chirurgie de la base du crâne ; Stéréotaxie
Plan ■ Introduction
¶ Introduction 1 La chirurgie assistée par ordinateur a pour but d’offrir au
chirurgien une assistance sous forme de guidage lors d’interven-
¶ Histoire de la chirurgie infodromique 2
tions portant sur des régions anatomiques complexes, à haut
Chirurgie stéréotaxique sur cadre 2
risque fonctionnel ou vital et où l’étroitesse de la voie d’abord
Radiologie cranioencéphalique 2 pratiquée ne permet pas un repérage direct constant, visuel et
Stéréotaxie sans cadre 2 tactile. Cette définition élimine les situations périopératoires où
Chirurgie craniofaciale assistée par ordinateur 3 l’ordinateur est présent, comme il l’est d’ailleurs devenu dans la
¶ Concepts fondateurs de la chirurgie assistée par ordinateur 3 plupart des actes, même les plus courants, de toute activité
Systèmes de localisation spatiale 3 professionnelle. Nous écartons également de ce cadre la cyber-
Mise en œuvre d’un système de navigation chirurgicale 4 chirurgie ou chirurgie réalisée par robot, car elle pose des
¶ Précision 6 problèmes différents, encore imparfaitement résolus, et qu’elle
n’est pas chirurgie puisque, étymologiquement, la chirurgie est
¶ Navigation couplée à un microscope opératoire 7 un acte manuel.
¶ Indications de la chirurgie infodromique en ORL 7 D’un point de vue sémantique, cette technologie encore
Chirurgie endoscopique des sinus de la face et de la base neuve n’a pas de nom définitif. Le terme de « chirurgie guidée
antérieure du crâne 7 par l’image » est souvent utilisé, mais il ne permet pas d’en
Chirurgie neurotologique et de la base latérale du crâne 10 distinguer la chirurgie vidéoendoscopique qui se pratique sans
Chirurgie pédiatrique 12 ordinateur. Les termes « neuronavigation » et « sinusonaviga-
¶ Règles d’utilisation 12 tion » sont trop restrictifs. Le terme franglais surgétique parfois
avancé, quoique concis, est vide de toute étymologie et donc de
¶ Conclusion : intérêt et limites de la chirurgie infodromique 13 sens. L’acronyme CAO est déjà réservé pour signifier la concep-
tion assistée par ordinateur. Nous proposons le terme de
« chirurgie infodromique » (de « info », en référence à la nature
intrinsèquement numérique de cette technique, et « dromos » :
trajet, chemin, en grec).
Techniques chirurgicales - Tête et cou 1
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
■ Histoire de la chirurgie
infodromique
La chirurgie assistée par ordinateur a pour objet essentiel
d’offrir à l’opérateur une assistance sous forme de guidage, dans
le but d’améliorer la précision de son geste. Pour cette raison, il
semble logique de la considérer comme le prolongement naturel
de la chirurgie stéréotaxique, née bien avant l’ère des ordina-
teurs puisque les premiers cadres stéréotaxiques sont apparus à
la fin du siècle dernier.
Chirurgie stéréotaxique sur cadre
En 1908, Clarke et Horsley décrivent une méthode de topo-
graphie rectilinéaire du cerveau de macaque Rhésus et mettent
au point le premier cadre stéréotaxique moderne, dont la
complexité préfigure le problème général du référencement et
du recalage que nous reverrons plus loin (Fig. 1). Ce cadre leur
permet d’appliquer des courants électriques lésionnels en Figure 2. Cadre stéréotaxique de Perry (1980). Conçu pour fonctionner
différents points du cerveau à travers des aiguilles isolées et avec un scanner, il comporte des tiges diagonales radio-opaques permet-
guidées. En 1947, Spiegel reprend les travaux de Clarke et tant de retrouver son référentiel géométrique à partir de l’imagerie. Des
Horsley et décrit une méthode alternative à l’effroyable loboto- abaques trigonométriques permettent de calculer sur les coupes scanner
mie frontale d’Egas Moniz, en générant des lésions électriques la position d’un instrument placé dans le cadre. C’est le premier véritable
du nucleus médian et du thalamus, sécurisées grâce à un cadre système de chirurgie infodromique... sans ordinateur.
stéréotaxique [1]. Ses résultats ne sont guère meilleurs que ceux
de Moniz, mais aboutissent à une psychochirurgie moins
hémorragique et donc moins létale. encéphalique traditionnelle comparée aux possibilités d’explo-
À Paris, Talairach publie, en 1949, son célèbre atlas stéréo- ration d’autres organes et souligne le danger des méthodes
taxique basé sur une série de dissections cérébrales soigneuse- d’encéphalographie iodée, gazeuse ou d’angiographie cérébrale.
ment mesurées dans un repère cartésien triplanaire et qui, Il suggère l’utilisation d’un ordinateur pour piloter avec
50 ans plus tard, constitue toujours une référence, parfois précision les rotations d’un radiotomographe et recueillir ses
intégré aux applications neurochirurgicales des systèmes de données. Mais le problème est complexe et les ordinateurs
navigation actuels. encore rudimentaires. Il faut attendre 1972 pour que la pugna-
cité de l’ingénieur anglais Hounsfield, prix Nobel de médecine,
Radiologie cranioencéphalique aboutisse à la première coupe transversale de la tête d’un
patient obtenue en seulement 5 minutes. La médecine numéri-
Mais les travaux précités ignorent le potentiel formidable de que est née, et la chirurgie assistée par ordinateur n’en sera
l’imagerie médicale et s’appuient sur une analyse statistique de qu’une conséquence. L’apparition ultérieure de l’IRM étendra le
la topographie encéphalique humaine, acquise à travers la champ de l’imagerie, mais sa précision est encore limitée
dissection post mortem. C’est probablement Cushing, vers 1914, comparée à celle de la tomodensitométrie : l’imagerie par
qui le premier a pressenti l’intérêt considérable de la radiogra- résonance magnétique (IRM) fait de belles images, mais elles
phie craniofaciale. Pour déterminer une stratégie d’abord de la sont peu précises topographiquement [3].
selle turcique en vue d’hypophysectomie, il développe une Désormais, la stéréotaxie ne sera plus envisagée autrement
méthode de mensuration de clichés radiologiques pris sous des que couplée au scanner : Leksell imagine un nouveau cadre [4]
incidences précises [2]. Et ainsi, pendant un demi-siècle, les que perfectionnent Berstrom et Greitz. Le cadre de Brown [5, 6]
techniques vont s’affiner peu à peu, aboutissant à une multi- permet de placer une sonde cérébrale avec une précision
tude d’indices, repères et autres ratios utilisés comme guides par moyenne de 1,8 mm, précision que Perry améliore encore grâce
les neurologues qui deviendront peu à peu neurochirurgiens à des marqueurs opaques repérés avec plus de finesse (Fig. 2).
avec l’individualisation de cette discipline. L’idée d’utiliser un Aujourd’hui, les cadres stéréotaxiques sont peu à peu abandon-
ordinateur pour piloter un générateur de rayons X remonte au nés au profit de systèmes dits « frameless ».
début des années 1960 avec le neurologue californien Olden-
dorff, qui publie un rapport sur l’insuffisance de l’imagerie Stéréotaxie sans cadre
Les cadres précédemment décrits, quoique fiables et précis,
sont encombrants pour le chirurgien, douloureux et angoissants
pour le patient qui doit rester la tête emprisonnée plusieurs
heures dans un carcan métallique avant d’entrer en salle
d’opération. De plus, leurs possibilités se limitent à guider
précisément une aiguille poussée sur une certaine distance et
selon un angle déterminé, à partir d’un point d’entrée de
coordonnées relatives connues. Il ne s’agit pas à proprement
parler de système de navigation, mais plutôt d’accessoires de
visée balistique. Les neurochirurgiens qui les utilisent savent le
temps consommé par leur installation et les calculs trigonomé-
triques qui s’y associent obligatoirement. On comprend dès lors
le formidable intérêt suscité en 1987 par la publication des
travaux de Watanabe, neurochirurgien du Tokyo General
Hospital [7]. Le NeuroNavigator qu’a mis au point son équipe
pour pratiquer l’exérèse de tumeurs cérébrales diverses utilise un
bras mécanique relié à un ordinateur dans lequel ont été
Figure 1. Cadre stéréotaxique de Horsley et Clarke (1908). Ce cadre est préalablement introduites les images tomodensitométriques du
la première tentative d’utilisation de valeurs numériques pour guider un patient (Fig. 3). La précision est médiocre, l’erreur atteint parfois
geste opératoire, et à ce titre, peut être considéré comme l’ancêtre des 10 mm. L’ordinateur ne peut stocker que huit images. La
systèmes de chirurgie infodromique. présence d’un ingénieur en salle d’opération est indispensable
2 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
Écran d'affichage
Station
informatique
Imagerie Système
TDM de localisation
IRM spatiale
Figure 4. Principe général de la chirurgie infodromique. TDM : tomo-
densitométrie ; IRM : imagerie par résonance magnétique.
possibilités d’affichage graphique des micro-ordinateurs moder-
nes, pour mettre en correspondance, en temps réel, les coor-
données d’un capteur spatial solidaire de l’instrument utilisé par
l’opérateur, avec le point homologue situé sur l’imagerie du
Figure 3. Le Neuronavigator de Watanabe. Premier système de chirur-
patient. Le résultat de cette opération est exprimé sur un écran
gie assistée par ordinateur, le NeuroNavigator permit d’optimiser les voies
visible du chirurgien, qui a ainsi l’illusion de naviguer au sein
d’abord neurochirurgicales en réduisant la taille des volets de craniotomie.
des structures anatomoradiologiques du patient qu’il opère. Au
Malgré sa précision très modeste, c’est une machine révolutionnaire qui
fur et à mesure de sa progression, il peut ainsi connaître avec
aida au traitement de près de 800 patients.
précision la position de son instrument, y compris dans des
régions exiguës, noyées par l’hémorragie, remaniées par la
au fonctionnement de l’appareil. Le NeuroNavigator, trop cher et pathologie ou encore la fibrose d’un geste chirurgical antérieur.
peu précis, ne sera jamais commercialisé, mais la chirurgie Cette technologie suppose donc la mise en œuvre d’un
assistée par ordinateur est inventée. système de localisation spatiale, d’une station informatique, et
la réalisation d’une imagerie adéquate : tomodensitométrie ou
IRM (Fig. 4).
Chirurgie craniofaciale assistée
par ordinateur Systèmes de localisation spatiale
Initialement développés pour leurs applications en neurochi- Ils constituent un maillon très important de cette technologie
rurgie, les systèmes de navigation suscitent très vite l’intérêt en convertissant en coordonnées cartésiennes relatives la
d’équipes chirurgicales oto-rhino-laryngologiques (ORL) et position d’un capteur assujetti à un instrument.
maxillofaciales, elles aussi confrontées aux problèmes du
repérage anatomique peropératoire. En effet, l’avènement de Systèmes électromécaniques
l’endoscope moderne permet une chirurgie « mini-invasive » Ils ont été les premiers utilisés en raison de leur simplicité.
permettant l’accès à des régions très enclavées comme le Une potence supporte un bras constitué de plusieurs segments
labyrinthe ethmoïdal et la base antérieure du crâne ou encore articulés entre eux de manière à offrir 5 ou 6 degrés de liberté.
la fosse ptérygomaxillaire. Des interventions comme celle de De Les articulations contiennent un encodeur de précision rensei-
Lima, abandonnées pour leur très haut risque fonctionnel ou gnant sur l’angle relatif formé par chaque segment. Quoique
vital, sont alors repensées sous l’angle de l’endoscopie par des robustes et peu onéreux, ils ne peuvent fonctionner qu’avec un
équipes comme celle de l’Autrichien Messercklinger, avec des patient parfaitement immobilisé. Aussi ont-ils été abandonnés
résultats autrement meilleurs et une morbidité raisonnable. La en raison de leur ergonomie médiocre et de leur précision
chirurgie endoscopique s’impose. Mais elle a aussi ses désavan- intrinsèque qui tend à se dégrader par usure.
tages : les optiques panoramiques modernes entraînent une
déformation sphérique de l’image aboutissant à des erreurs de Systèmes à faisceau ultrasonore
perception spatiale du champ opératoire qui peuvent atteindre Ils sont constitués d’un émetteur piézoélectrique fixé sur
1 cm pour un opérateur non entraîné. Les voies d’abord l’instrument et d’une baie d’au moins trois microphones située
utilisées, essentiellement endonasales, sont très exiguës et à distance du champ opératoire et analysant le temps de vol
rendent difficile un geste hémostatique [8]. La chirurgie infodro- d’impulsions ultrasonores émises par l’émetteur. Connaissant le
mique craniofaciale, introduite vers 1997, apparaît comme une temps de propagation du son dans l’air, on peut en déduire la
solution très intéressante à ces problèmes de repérage topogra- position relative de l’instrument à partir d’une triangulation
phique, d’autant plus qu’ils concernent des régions associées à quadratique. Malheureusement, ce temps de propagation est
un cadre anatomique osseux et donc rigide. largement dépendant de la température et de l’hygrométrie
ambiantes, entraînant des erreurs cumulées de plusieurs centi-
mètres, même après un calibrage soigneux. En outre, l’interpo-
■ Concepts fondateurs sition d’objets (mains de l’opérateur, instrumentation) entraîne
des aberrations difficilement détectables. Pour cette raison, ces
de la chirurgie assistée systèmes sont restés à l’état de prototypes.
par ordinateur Systèmes optoélectroniques
La chirurgie assistée par ordinateur consiste à utiliser la Ils sont apparus un peu plus tard. Ils reposent sur l’emploi
puissance de calcul, la capacité à stocker de l’information et les d’une baie de deux ou trois caméras CCD (charge coupled service)
Techniques chirurgicales - Tête et cou 3
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
à haute résolution situées à distance du champ opératoire. Ces • recalage de ces images pour les placer dans le même système
caméras analysent par stéréotriangulation la position d’un de coordonnées que celui du localisateur spatial ;
minimum de deux à trois diodes électroluminescentes émettant • calibrage de l’instrument chirurgical : en effet, le localisateur
dans le proche infrarouge et fixées sur l’instrument chirurgical. ne connaît que la position de son capteur fixé à l’instrument.
Ces diodes peuvent éventuellement être remplacées par des Le chirurgien, lui, ne s’intéresse qu’à la position de l’extré-
sphères recouvertes de microprismes réfléchissant la lumière mité active de son instrument. Il convient donc d’indiquer à
infrarouge émise par un projecteur placé dans la baie de caméra la machine les caractéristiques dimensionnelles de cet
(système passif), ce qui permet de s’affranchir du câble alimen- instrument. C’est le calibrage, opération simple et rapide mais
tant les diodes. Leur précision est excellente, de l’ordre du demi- qui doit être renouvelée chaque fois que l’instrument chirur-
millimètre pour les systèmes à diodes électroluminescentes, un gical choisi comme sonde par l’opérateur est modifié ;
peu moins bonne pour les systèmes passifs. Mais ils ont • enfin, vérification de la cohérence des informations retour-
l’inconvénient d’interrompre leur fonctionnement dès qu’un nées par le système avant de débuter l’intervention.
objet s’interpose entre la ligne de vue des caméras et les diodes
émettrices. Il en résulte une ergonomie difficile à gérer, puisque Recalage des images
le chirurgien n’est plus libre de positionner ses aides, ses
Principe général
instruments et ses mains à sa guise. La baie de caméra est
encombrante et surtout fragile car elle contient un système de La position et l’orientation de la tête du patient sur les
lentilles cylindriques susceptibles de se défocaliser lors de chocs, images dépendent de la manière dont celui-ci a été installé sur
entraînant une perte de précision. Aussi, si ces systèmes la table radiologique vis-à-vis du tube radiogène. Il n’y a bien
apparaissent très adaptés à la gestuelle quasi statique de la sûr aucune raison pour que, une fois allongé sur la table
neurochirurgie pour laquelle ils ont été primitivement conçus, d’opération, sa position vis-à-vis du localisateur soit identique.
ils semblent l’être beaucoup moins pour la dynamique gestuelle Le but du recalage est de déterminer les équations de transfert
des interventions ORL. permettant de convertir les coordonnées de tout point retourné
par le localisateur, de sorte qu’il corresponde exactement au
Systèmes électromagnétiques point homologue dans le système de coordonnées des images.
C’est un problème complexe. La manière la plus simple de le
Ils sont d’apparition récente. Ils reposent sur la génération résoudre consiste à fournir à la machine les coordonnées d’un
d’un champ magnétique alternatif selon trois axes orthogonaux. certain nombre de points pris sur le visage et le crâne du
Un capteur constitué de bobinages également orthogonaux patient, et à sélectionner ces mêmes points sur les images. Pour
déduit sa position et son orientation vis-à-vis de l’émetteur en ce faire, on peut utiliser, soit des repères anatomiques naturels
fonction du champ relatif induit dans chacun de ses bobinages. (nasion, canthis interne et externe, tragus, jonction nasolabiale),
Les champs magnétiques décroissant selon une puissance soit des marqueurs radio-opaques collés sur la peau ou vissés
cubique de la distance à la source, la sensibilité et la résolution dans la table externe du crâne. Cette deuxième technique est la
de ces systèmes sont excellentes, de l’ordre du dixième de plus contraignante pour le patient comme pour l’opérateur
millimètre. L’avènement d’échantillonneurs électroniques à puisqu’elle nécessite un examen radiologique spécifique suivi du
haute résolution et grande cadence, intégrés à des processeurs geste chirurgical dans un délai aussi court que possible, pour
digitaux de signal, devrait encore accroître ces performances. éviter la gêne entraînée par des plots vissés ou le risque de
Cette technologie est très robuste et suffisamment miniaturisa- déplacement de marqueurs collés. Mais elle est plus précise que
ble pour pouvoir faire oublier au chirurgien sa présence sur le la précédente puisqu’elle n’est pas tributaire de l’habileté de
site opératoire. Autre avantage, ils fonctionnent sans restriction l’opérateur à repérer un point tridimensionnel sur l’imagerie et
quelle que soit la position de l’opérateur, de ses instruments ou à viser avec exactitude ce même point sur le patient.
de ses aides, puisqu’ils ne sont pas tributaires d’un axe de vision
à préserver. L’émetteur, mesurant généralement 1 ou 2 cm3, Recalage surfacique
peut être fixé directement sur le patient, supprimant le capteur
Certains systèmes (VectorVision II®, BrainLab, Allemagne ;
de référence requis par les systèmes infrarouges et divisant ainsi
Système DigiPointeur®, Collin-ORL, France) résolvent élégamment
par un facteur 2 l’erreur de mesure. Les premiers systèmes
ce problème grâce à un algorithme de recalage surfacique. Son
avaient un inconvénient majeur, celui d’être sensibles aux
principe consiste à recréer un modèle surfacique tridimension-
masses métalliques inévitablement présentes dans le champ
nel interpolé à la résolution désirée à partir du volume d’ima-
opératoire. Ce défaut est à présent largement corrigé grâce à une
ges, puis, après acquisition de quelques centaines de points
technologie complexe de génération et de traitement du signal
prélevés aléatoirement sur le visage du patient à l’aide d’une
éliminant la plupart des distorsions métalliques. Cette techni-
sonde assujettie au localisateur, d’ajuster rotations et transla-
que électronique peut aussi être combinée à des algorithmes
tions de manière itérative, jusqu’à obtenir la superposition
capables de prédire avec une très forte probabilité l’occurrence
optimale des points sur le modèle surfacique. Des artifices
d’une distorsion et, sur la base d’un modèle mathématique
algorithmiques permettent d’éviter une convergence erronée
préétabli, de corriger l’erreur ainsi détectée, par exemple par la
vers un minimum local. Cet ajustage qui ne réclame que
méthode des éléments finis. L’emploi d’un capteur témoin
quelques secondes de calcul est réalisé automatiquement par
additionnel permet d’accroître encore la fiabilité du système en
l’ordinateur. Cette technologie présente des avantages pratiques
avertissant l’utilisateur de la survenue d’une erreur non corrigée.
importants :
Cette technologie confère désormais à ces localisateurs une
• il n’est pas nécessaire de prévoir un examen radiologique
fiabilité au moins égale à celle des systèmes infrarouges, sans
spécial pour l’intervention ;
leurs inconvénients.
• le procédé, simple et très rapide, est peu opérateur-
dépendant ;
Mise en œuvre d’un système de navigation • l’appariement des points est réalisé avec une précision
mathématique théorique plusieurs milliers de fois supérieure
chirurgicale à la main d’un opérateur ;
Quel que soit le type de système considéré, sa mise en œuvre • mais surtout, le nombre de points mis en jeu pour le recalage
requiert invariablement les étapes suivantes : peut être très élevé comparativement aux quelques 5 ou
• réalisation d’une imagerie, transfert de la série d’images sur la 10 points des méthodes traditionnelles. L’optimisation
station informatique du navigateur (via un réseau ou un mathématique du recalage dépendant de la racine carré du
support tel qu’un CD-rom) et traitement de ces images, nombre de points mis en jeu, il en résulte un gain sensible
généralement livrées au format DICOM (norme internationale de précision.
des systèmes d’imagerie médicale digital imaging and commu- L’utilisation d’un faisceau laser (VectorVision II®, BrainLab,
nication in medicine), pour les rendre accessibles à la naviga- Allemagne) améliore encore la simplicité de cette opération
tion ; mais son usage est limité à des zones cutanées parfaitement
4 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
Tableau 1.
Systèmes de chirurgie infodromique disponibles et, à titre indicatif, leurs caractéristiques essentielles.
Système VectorVision II® DigiPointeur 6300-V® Instatrack® LandMarx® SNS®
(Fig. 8) (Fig. 5) (Fig. 7) (Fig. 6)
Fabricant Brainlab, Heimstetten, Hôpital Desgenettes / Société GEMS/VTI, Wilmington, Medtronic-SNT, Louis- Strycker-
Allemagne Collin-ORL, Cachan, France États-Unis ville, États-Unis Leibinger, Por-
tage, États-Unis
Technologie du localisateur Optique passive Électromagnétique super- Électromagnétique Optique active ou pas- Optique active
pulsée sive
Système de référencement Bandeau frontal ou Bandeau frontal ou pièce buc- Casque temporofrontal ou Arceau métallique péri- Trépied frontal
trépied vissé cale autostatique broche vissée crânien ou trépied vissé Masque collé
Applications couvertes Neurochirurgie ORL- chirurgie latérale ORL ORL ORL-CMF
ORL de la base du crâne Neurochirurgie Neurochirurgie
Orthopédie Orthopédie Orthopédie
Adaptation instrumentale Tous instruments Tous instruments Instruments spéciaux Instruments spéciaux Instruments
ou à usage unique spéciaux
Type de recalage Recalage automatique Recalage automatique Recalage préétabli Recalage manuel sur Recalage manuel
surfacique surfacique sur casque points de repères sur points de re-
pères
Nécessité de porter un Non Non Oui : casque Oui : marqueurs Oui : marqueurs
dispositif spécial durant
l’imagerie pour une Clichés standards Clichés standards
précision optimale
Capacités de planning Mensurations et analyse Mensurations et analyse 3D Non Mensurations Non
chirurgical 3D volumique volumique
Mode de pilotage per- Écran tactile Souris Souris Souris Stylet
opératoire du système Télécommande IR Télécommande IR Écran tactile Pédalier Pédalier
Commandes vocales
Temps d’installation (selon 9 min [9] 6 min [10] 10 min [11] 20 à 40 min [12] NC
référence bibliographique citée)
IR : infrarouge ; NC : non communiqué. CMF : cranio-maxillo-facial.
glabres et semble moins précis que l’acquisition au moyen d’un machine. C’est là une philosophie essentielle, sans laquelle
palpeur [9], le spot laser pouvant se trouver à cheval sur des l’usage d’un système de navigation peut s’avérer plus dangereux
points à forte déclivité. que bénéfique.
Problème du référencement Systèmes disponibles
Après recalage, la tête du patient doit être maintenue dans Il existe essentiellement cinq modèles de navigateurs chirur-
une position constante vis-à-vis du système localisateur, faute de gicaux disponibles pour la chirurgie craniofaciale. Leurs perfor-
quoi les informations délivrées par le navigateur deviendront mances sont variables d’un modèle à l’autre et pour un même
inexactes au moindre déplacement. Les systèmes destinés à la modèle, selon les options qui les équipent.
neurochirurgie résolvent cette difficulté en immobilisant la tête Le Tableau 1 et les Figures 5 à 8 présentent ces systèmes et
du patient dans une têtière à pointes (étrier de Mayfield). Cette leurs caractéristiques essentielles. Des efforts considérables ont
modalité est inapplicable dans les spécialités cranio-maxillo- été faits par les concepteurs pour tenter de simplifier en
faciales, lesquelles requièrent une dynamique gestuelle très apparence une technologie complexe et la rendre suffisamment
différente. Pour maintenir valide le recalage malgré la mobilisa- conviviale pour être utilisable dans des actes de pratique
tion de la tête du patient, on fixe sur celle-ci un capteur quotidienne. Cet aspect nous paraît essentiel, car seul un
secondaire dit capteur de référencement, qui renseigne le matériel utilisé en pratique de routine, donc simple et rapide à
système de tout déplacement relatif vis-à-vis du localisateur, installer, sera suffisamment maîtrisé pour des interventions plus
pour permettre sa compensation. La manière dont ce capteur est lourdes où la machine devient significativement contributive.
fixé sur le patient est cruciale puisqu’elle doit être à la fois très Le choix d’un système, à notre sens, doit prendre en compte
stable, ne pas gêner l’opérateur et autoriser tout type de voie divers paramètres, parfois contradictoires :
d’abord. Selon les systèmes, le capteur de référencement peut • l’ergonomie globale du système. De ce point de vue, les
être solidarisé au crâne du patient par un arceau métallique, un systèmes électromagnétiques sont très performants [11, 13-15] ;
casque, un bandeau, un trépied vissé dans la table externe de la • la fiabilité et la précision réelles du système, souvent très
calvaria ou encore une petite pièce buccale autostatique éloignées des prétentions du constructeur ;
immobilisée entre maxillaire et mandibule.
• sa simplicité de mise en œuvre et plus précisément le temps
effectif requis par un utilisateur ordinaire pour installer et
Navigation lancer le système. Un appareillage trop compliqué ne sera
Une fois réglé et opérant, un système de navigation ne doit qu’exceptionnellement utilisé et donc, peu fiable entre les
pas être utilisé aveuglément. Au début de l’intervention, il mains d’un utilisateur occasionnel ;
importe à l’opérateur de vérifier la pertinence et la précision des • sa capacité à s’adapter à tous types de procédures chirurgica-
informations graphiques renvoyées par le système, sur des les, quelle que soit la voie d’abord choisie ;
repères anatomiques fiables et indiscutables. Il y a lieu de • ses possibilités d’adaptation instrumentale : le fait de pouvoir
multiplier ces vérifications sur des repères variés, de manière à utiliser l’instrumentation à laquelle l’opérateur est habitué est
valider cette fiabilité sur les trois axes de l’espace. Tout au long une donnée importante ;
de l’intervention, il est souhaitable d’observer le comportement • sa capacité à être piloté directement par l’opérateur d’une
du système de manière à connaître sa pertinence et savoir le façon simple et efficace. Les systèmes utilisant un pédalier de
moment venu, face à un problème de repérage ou d’identifica- commande nous semblent peu pratiques, quoique ceci relève
tion anatomique crucial, quelle confiance accorder à la d’un choix personnel ;
Techniques chirurgicales - Tête et cou 5
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
Figure 5. Système DigiPointeur®, Collin-ORL-CMF, France. Figure 7. Instatrack®, GEMS, Wilmington, Ma, États-Unis.
Figure 6. LandMarx®, Medtronic-SNT, Louisville, Co, États-Unis.
Figure 8. VectorVision®, BrainLab, Heimstetten, Allemagne.
• l’encombrement, le poids, la fragilité globale du système sont
à considérer avant de les faire pénétrer dans des blocs
opératoires déjà surchargés de consoles d’anesthésie, micro- ■ Précision
scopes, lasers, moteurs suspendus et autres amplificateurs de
brillance ; Les spécifications techniques des constructeurs de navigateurs
• enfin, le coût d’un système de navigation n’est pas nécessai- chirurgicaux, tout comme certaines études menées par des
rement corrélé à sa performance. La pression commerciale cliniciens, s’avèrent souvent fantaisistes quant à la précision et
étant devenue très forte dans le domaine des équipements ne s’appuient généralement sur aucune méthodologie métrolo-
médicaux, il importe de pouvoir essayer un matériel avant gique [1, 11, 13-15]. La plupart des chiffres exprimés représentent
que de l’acquérir, et de ne se fier qu’à son jugement ou à la valeur moyenne RMS (root mean square) [6], ou moyenne
l’expérience de confrères. Pour minimiser en apparence les géométrique représentant une distance euclidienne, d’un
coûts d’acquisition, certaines marques proposent des systèmes vecteur-erreur apprécié empiriquement par l’utilisateur, sur les
multiapplications, à partager entre ORL, neurochirurgiens, trois axes x, y, z, pour n échantillons (où i représente un échan-
orthopédistes et stomatologistes. Cette formule nous semble tillon de mesure renvoyé par le système de navigation, et r la position
poser le problème de la gestion du partage et d’autre part, réelle de ce même point, après correction).
conduit à des systèmes plus complexes car devant épouser le
cahier des charges de spécialités aux besoins très différents. La
diminution régulière des prix permet désormais de préférer
des systèmes spécifiquement dédiés à l’ORL ;
• le coût des consommables est également un point important Une telle formulation a l’avantage d’exprimer par une valeur
à considérer. numérique unique des données à trois dimensions. Mais elle
6 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
■ Navigation couplée
“ Causes fréquentes à un microscope opératoire
d’imprécision pour un système L’emploi d’un microscope opératoire en tant qu’instrument
de navigation pose un certain nombre de problèmes tendant à
de navigation dégrader la performance du repérage spatial et qui doivent être
connus de l’utilisateur.
Imagerie mal réalisée : L’extrémité de l’instrument habituellement utilisée comme
• protocole non respecté sonde est ici remplacée par un point virtuel projeté dans
• bougé patient. l’oculaire du microscope et correspondant à peu près (mais pas
exactement) au centre du champ optique. Cet oculaire muni
Recalage imprécis :
d’un réticule en forme de croix doit être installé du côté de l’œil
• procédure mal respectée dominant de l’opérateur. Après calibrage, le système de naviga-
• prise de repères inconsistants. tion renvoie la position de ce point virtuel lorsque l’opérateur
Déplacement de l’ancillaire de référencement : fait parfaitement coïncider, et avec une mise au point optimale,
• ancillaire inadapté au geste programmé la mire de l’oculaire sur une structure anatomique.
• traction excessive sur l’ancillaire. Cependant, pour les bons microscopes ayant une profondeur
Instrument mal calibré : de champ de plusieurs centimètres, il est difficile d’effectuer un
• capteur mal assujetti à l’instrument pointage précis le long de l’axe optique. À cette limitation
• positionnement incorrect de l’instrument vis-à-vis du s’ajoutent les imperfections optiques (mauvaise superposition
plot de calibrage des champs lors du changement de grossissement, distorsion
optique, jeu dans les mécanismes de zoom ou de mise au point)
• pression excessive sur l’instrument
qui diminuent sensiblement la précision globale du couple
• utiliser des instruments rigides navigateur + microscope. Plusieurs études [20-22] montrent que
• ne pas déformer l’instrument durant la mesure. l’intégration d’un microscope dans la chaîne de navigation y
ajoute une erreur systématique, de l’ordre de 2 à 3 mm.
Certains microscopes équipés d’un sondeur laser peuvent
améliorer le problème de visée, mais leur coût est prohibitif.
tend à minimiser l’erreur et ne permet pas de connaître la En pratique, nous pensons que la navigation avec microscope
pertinence ou fiabilité du système, même associée, ce qui n’est ne se justifie que pour les applications neurochirurgicales avec
pas toujours le cas, à l’écart-type, au minimum et au maximum injection d’image. Dans ce cas, une cible définie lors du
de ces mesures. Exprimer la précision sous une forme d’espé- planning chirurgical est visée par l’opérateur qui voit simulta-
rance probabiliste (par exemple au 95e percentile) serait plus nément le champ opératoire et la projection des contours de la
contributif, même si le bruit d’erreur des systèmes de navigation cible dans l’oculaire. En ORL, où les exigences de précision sont
n’a généralement pas une distribution normale, c’est-à-dire de souvent plus élevées et où les systèmes électromagnétiques
type gaussienne, en raison de biais nettement orientés dans la offrent une grande liberté d’installation et de gestuelle, la
chaîne de mesure. L’usage de quantiles, plus conforme aux navigation au microscope nous semble dénuée d’intérêt
canons de la métrologie, aurait l’avantage de donner à l’opéra- pratique.
teur un intervalle de confiance utilisable [4, 16, 17]. Une norme
devra sans doute être créée pour éviter à des fabricants
d’annoncer une précision globale nettement meilleure que la ■ Indications de la chirurgie
taille du pixel (ou point élémentaire) des images ! infodromique en ORL
Le volume englobé dans la mesure est également important
à préciser : cent mesures prises à quelques millimètres de Même si le champ d’application de cette technologie tend à
distance n’apprécient pas la précision de la même manière que augmenter de jour en jour, les principales indications ORL
cent autres mesures réparties dans un volume de 1 dm3. Or, ce concernent d’une part la chirurgie des sinus et de la base
volume de mesure n’est qu’exceptionnellement rapporté dans antérieure du crâne, d’autre part l’otoneurochirurgie et la
les études disponibles. chirurgie latérale de la base du crâne (Tableau 2).
Par ailleurs, les études de précision menées par des équipes
chirurgicales indépendantes ne reposent le plus souvent que sur Chirurgie endoscopique des sinus de la face
une appréciation visuelle perendoscopique du vecteur-erreur,
avec néanmoins des résultats parfois exprimés en centièmes de et de la base antérieure du crâne
millimètre. Seuls des protocoles utilisant des marqueurs de
référence implantés de manière stable dans l’os permettent une
Chirurgie ethmoïdale (Fig. 9)
analyse rigoureuse de la distribution volumique de l’erreur. Mais Le problème posé par la perte habituelle des repères lors de
de telles études sont bien sûr lourdes à mener et éthiquement reprises chirurgicales d’évidements ethmoïdaux est facilement
discutables car sans bénéfice direct pour le patient ; et celles résolu avec l’aide du navigateur. Même pour des gestes de
menées en laboratoire sur des pièces fantômes sont trop première intention, celui-ci reste d’un bénéfice certain pour
éloignées de la réalité chirurgicale pour être intéressantes. accéder rapidement à une cellule de l’agger nasi à réséquer ;
À ces remarques près, la plupart des systèmes de navigation situer exactement le plan du toit ethmoïdal parfois confondu
ont une précision globale inférieure à 2 mm. Les machines de avec le plan de cellules suprabullaires d’une résistance atypique
dernière génération ont même une précision qui peut aller en (néo-ostéogenèse densifiante) ; repérer le trajet des artères
deçà du millimètre dans le volume opératoire utile, lorsqu’elles ethmoïdales antérieures (très souvent identifiables en corrélant
sont correctement mises en œuvre. Il convient cependant de les coupes triplanaires) ; réaliser un évidement régulier et
remarquer que cette précision dépend d’une chaîne où inter- complet notamment le long de la lame orbitaire où l’optique à
viennent de nombreux facteurs : qualité de l’imageur, de son 45° manipulée côté droit par un opérateur droitier (et vice
calibrage et de ses paramètres de réglage [18, 19]; immobilité plus versa) tend à mésestimer les cellules les plus latérales du groupe
ou moins complète du patient durant l’examen ; précision bullaire ; ou encore ouvrir largement une cellule ethmoïdale
intrinsèque du localisateur spatial ; précision de l’opérateur postérieure reculée jouxtant un nerf optique dangereusement
réalisant le recalage ; performance de l’algorithme de calcul du exposé. Enfin, lorsque les conditions sont hémorragiques, il
recalage ; précision du calibrage dimensionnel de l’instrument, demeure possible, dans les limites de la prudence et du bon
lequel doit être parfaitement rigide pour n’induire aucune erreur sens, de poursuivre un évidement ethmoïdal qui aurait dû, sans
supplémentaire due à sa déformation. cette assistance, être abandonné.
Techniques chirurgicales - Tête et cou 7
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
Tableau 2.
Principales indications de la chirurgie infodromique en oto-rhino-laryngologie.
Sinus et base antérieure du crâne Base latérale du crâne Indications marginales
Éthmoïdectomie Chirurgie de l’angle pontocérébelleux Infiltrations tronculaires sous guidage stéréotaxique
(branches V2 et V3 du nerf trijumeau)
Sinusotomie frontale (Draf II-III) - Voie sus-pétreuse Extraction de corps étrangers
Sphénoïdotomie - Voies postérieures Traumatologie faciale
Hémostase d’épistaxis majeures Indications spécifiquement pédiatriques :
- atrésies choanales
- agénésies du méat acoustique externe
- syndromes polymalformatifs
Dacryo-cysto-rhinostomie Décompression de sac endolymphatique
Orbitotomie décompressive
Décompression de nerf optique Implants cochléaires (en phase d’étude)
Hypophysectomie transsphénoïdale
Fermeture de brèches méningées
Résection de carcinomes limités
Abord des fosses ptérygopalatine et infratemporale (kys-
tes, corps étrangers, fibromes nasopharyngiens)
Repérage de limites de volets frontaux ostéoplastiques
Figure 9. Cure de mucocèle ethmoïdo-
orbitaire droite. Mucocèle de 32 mm de grand
axe, responsable d’un télécanthus inesthéti-
que associé à une diplopie modérée par at-
teinte du petit oblique droit. Ce type de lésion,
plus spectaculaire que difficile à traiter, re-
quiert cependant une marsupialisation aussi
large que possible pour prévenir sa récidive. La
lame orbitaire est ouverte sur une charnière
postérieure, puis remise en place pour prévenir
une énophtalmie secondaire. Le système de
navigation permet un contrôle des limites pos-
térieure et supérieure de l’ouverture mucocéli-
que, en toute sécurité.
Sphénoïdotomies Parfois, son utilisation lors de l’extraction de truffes aspergillai-
res et/ou d’un corps étranger dentaire concernant la cuvette
Le repérage de la zone la plus mince de la paroi antérieure du
sinus sphénoïdal est aidé par le navigateur et permet une antérieure du sinus maxillaire permet un contrôle complet dans
trépanation douce et sûre, évitant, plus avant, la blessure de cette région habituellement aveugle, évitant de recourir à une
l’artère ethmoïdale postérieure et plus arrière, la rencontre d’une trépanation de la fosse canine.
paroi osseuse généralement plus résistante, dont l’effraction
avec pénétration brutale peut être dramatique en cas de Chirurgie endoscopique du sinus frontal
procidence optique ou carotidienne. Lorsqu’un abord isolé de ce
sinus est nécessaire, le guidage du navigateur permet très C’est peut-être là que les systèmes de navigation apportent
souvent de se faufiler dans le récessus sphénoethmoïdal, même leur meilleure contribution. Même entre des mains expertes,
rétréci, autorisant un geste très peu invasif (Fig. 10). le repérage de l’ostium du sinus frontal peut être problémati-
que et confondu d’abord avec une cellule supraorbitaire, de
Chirurgie du sinus maxillaire l’agger nasi, ethmoïdofrontale, ou encore pneumatisant le
L’antrostomie maxillaire est un geste simple ne posant pas de septum interfrontal. Le navigateur permet une étude préopéra-
problème particulier de repérage. Mais puisqu’un scanner est toire de ces écueils possibles et une aide peropératoire pour
souvent disponible dans cette indication, elle constitue une discerner ces éléments et aborder directement l’ostium frontal
occasion de se familiariser avec un système de navigation. (Fig. 11). La résection d’une éventuelle cellule ethmoïdofrontale
8 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
Figure 10. Biopsie du toit du sinus sphénoï-
dal gauche. Lésion ostéolytique de la paroi
supérolatérale du sinus sphénoïdal gauche.
Cette lésion, quoique de petite taille, est située
à 4,3 mm du nerf optique. Son caractère os-
téolytique fait craindre un processus néoplasi-
que ou fungique nécrosant. L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) n’apporte pas
d’orientation étiologique supplémentaire.
L’injection d’agent de contraste n’a pas pu être
réalisée. Une biopsie est indispensable pour
préciser la nature exacte de cette lésion, mais
fait courir un risque certain pour le pédicule
optique de ce patient. Le système de naviga-
tion permet de situer exactement les limites et
rapports de la lésion simultanément dans les
trois plans de l’espace et de l’aborder avec une
précision inframillimétrique par voie du réces-
sus sphénoéthmoïdal.
Figure 11. Repérage de l’ostium frontal. La
confusion de l’ostium frontal (flèche noire)
avec une cellule ethmoïdale intrafrontale (flè-
che blanche) est relativement fréquente, no-
tamment lors de reprises chirurgicales. Le sys-
tème de navigation lève facilement cette am-
biguïté, évitant un geste obstiné dans une
cellule « en cul-de-sac », avec risque de péné-
tration cérébrale.
peut être menée avec une grande précision et déconfiner à peu significatifs nombreux (toit ethmoïdal antérieur, parois du sinus
de frais un sinus frontal pathologique. frontal, lame orbitaire) permet de vérifier avec certitude la
La résection du plancher des sinus frontaux (« Lothrop précision du guidage selon les trois axes de l’espace. Il est dès
endoscopique » modifié par Draf, type III) doit satisfaire deux lors possible de s’appuyer sur des données certaines pour fraiser
critères essentiels mais contradictoires : aménager les meilleures latéralement tout l’os possible vers l’orbite puis réséquer le
conditions de redrainage de ce sinus, c’est-à-dire être aussi septum interfrontal sans atteindre le plan méningé (Fig. 12). Les
généreuse que possible, tout en respectant formellement les instruments longs et fins généralement requis pour progresser
structures nobles immédiatement avoisinantes : méninge, au-delà de l’ostium frontal étant plus flexibles, il convient de
placodes olfactives, cône orbitaire. Plus souvent indiquée chez s’assurer qu’aucune contrainte excessive ne leur est appliquée
des patients multiopérés, elle s’adresse à des zones fréquemment avant de noter leur position sur l’écran. En fin d’intervention,
bloquées par une fibrose hémorragique. La proximité de repères l’utilisation d’un pointeur effilé nous permet de relever exacte-
Techniques chirurgicales - Tête et cou 9
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
Figure 12. Résection du plancher du sinus
frontal (Intervention de Lothrop – Draf type III).
Le pointeur, positionné ici à cheval sur le sep-
tum interfrontal en cours de fraisage, permet
de connaître avec exactitude l’épaisseur de la
paroi postérieure du sinus frontal et limiter le
risque de brèche durale iatrogène. Latérale-
ment, en avant et en arrière, il permet une
sécurité accrue lors du fraisage osseux. L’exis-
tence éventuelle d’une cellule ethmoïdofron-
tale peut également être retrouvée et réséquée
avec précision.
ment la surface de l’orifice de drainage et de l’enregistrer afin Abord de la fosse infratemporale et de l’espace
d’en surveiller plus tard l’évolution sur l’imagerie post- ptérygomaxillaire
opératoire.
L’utilisation d’un système de navigation rend obsolète Les lésions abordées peuvent être de nature très variable :
l’intérêt du clou de Lemoyne en tant que moyen de repérage de extraction de corps étrangers tels que projectiles, dent de sagesse
l’ostium frontal. En revanche, s’il reste indiqué pour procéder à migrée ou foret dentaire cassé, kystes de la grande aile du
un lavage rétrograde d’un sinus frontal, le navigateur facilite sa sphénoïde (Fig. 14), ou encore s’inscrire dans le cadre du
mise en place. traitement d’un fibrome nasopharyngien (Fig. 15). La conjonc-
tion de l’endoscope et du navigateur permet ainsi de traiter par
Hypophysectomie transsphénoïdale un abord peu invasif certaines des lésions relevant généralement
de voies transfaciales, transzygomatiques, ou infratemporales,
La résection des macroadénomes hypophysaires par voie autrement plus lourdes [26-28]. Compte tenu des risques cicatri-
endonasale, proposée dès 1992 par Jankowski [23], permet un ciels et de croissance faciale perturbée propres à cette chirurgie
abord sans incision cutanée ni gingivale, avec une dissection concernant plus spécifiquement l’enfant, il s’agit là d’un
minimale. L’emploi d’optiques à vision plus ou moins oblique, avantage sensible. Même lorsqu’un abord strictement endosco-
combinées éventuellement à une ethmoïdectomie, permet de pique n’est pas envisageable en raison de l’extension tumorale,
s’adapter à la topologie de l’adénome. La chirurgie infodromi- la chirurgie infodromique devrait permettre des abords plus
que est le complément naturel de cette technique mini-invasive, ciblés et donc moins iatrogènes [29, 30].
permettant un contrôle optimal de la position relative des nerfs
optiques et des carotides internes. Elle remplace avantageuse- Voies d’abord externes craniofaciales
ment les clichés de profils pris à l’amplificateur de brillance
pour vérifier la profondeur de pénétration sellaire et son Les voies externes bénéficient également de la navigation,
caractère strictement médian [24, 25]. sous réserve que l’ancillaire de référencement soit compatible
avec l’incision et le décollement du lambeau musculocutané
Fermeture de brèches méningées envisagés. L’utilisation d’un ancillaire de référencement buccal
permet de réaliser sans gêne un abord de sinus frontal, par
Une brèche identifiée sur l’imagerie peut ainsi être rapide-
exemple pour le combler ou le crânialiser. Le navigateur permet
ment retrouvée in situ. Le navigateur est également utile pour
le repérage exact des contours des sinus frontaux, optimisant
s’assurer du positionnement optimal du greffon réparateur en
ainsi la découpe du volet ostéoplastique. Enfin, les résections de
évitant, lors de la réparation de brèches antérieures, qu’il vienne
tumeurs du complexe ethmoïdo-fronto-orbitaire devraient être
obstruer le récessus frontal.
plus sûrs lorsqu’un navigateur apporte une appréciation rigou-
reuse de profondeur et renseigne sur la proximité immédiate
Chirurgie des épistaxis subintrantes d’un pédicule neuro-optique ou de la méninge.
Les systèmes équipés d’une fonction de guidage stéréotaxique
permettent de repérer précisément le point d’émergence du
pédicule sphénopalatin, même dans des conditions peropératoi- Chirurgie neurotologique et de la base
res très hémorragiques (Fig. 13). L’utilisation de pinces bipolai- latérale du crâne
res aspiratrices assujetties à un capteur de navigation permet
une électrocoagulation de la région sphénopalatine hémorragi-
Voie sus-pétreuse
que, complétée par une dissection et un clippage plus électif du
pôle artériel sphénopalatin. Le même geste guidé peut aussi bien Cette voie d’abord nécessite une grande expérience pour
assurer l’hémostase d’artères ethmoïdales antérieures ou posté- repérer la zone de projection du conduit auditif interne sur la
rieures si une voie d’abord endonasale est choisie. face supéroexterne du rocher, seule visible de l’opérateur.
10 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
Figure 13. Hémostase de l’artère sphénopa-
latine droite. Le point d’émergence du pédi-
cule sphénopalatin a préalablement été repéré
sur les coupes triplanaires et désigné comme
cible stéréotactique. Une pince bipolaire peut
alors être dirigée exactement sur ce point,
même en conditions très hémorragiques. De
manière complémentaire à l’affichage radiolo-
gique, un indicateur numérique renseigne
l’opérateur sur l’orientation et la progression
de l’instrument.
Figure 14. Kyste de la grande aile du sphénoïde droit. À l’origine d’un syndrome comitial majeur avec état de mal épileptique, ce kyste dermoïde du
processus ptérygoïde droit étendu à la grande aile du sphénoïde et comprimant la portion antérieure du lobe temporal pose le problème de son abord
chirurgical. On décide un abord endoscopique de la fosse infratemporale par voie transantrale avec fraisage de la paroi postérieure du sinus maxillaire puis
ligature du pédicule sphénopalatin. La tumeur kystique est largement marsupialisée et sa matrice épidermique réséquée au maximum. Le système de
navigation permet d’optimiser la voie d’abord et de contrôler l’évidement kystique, geste essentiellement aveugle. Les sensations tactiles de contact osseux
sont confrontées aux données affichées par le navigateur et permettent un contrôle des limites de la lésion.
L’étroitesse du champ de vision liée au danger d’une rétraction multiplicité des repères proposés par maints auteurs rend
trop importante du lobe temporal, la pauvreté des repères compte de cette difficulté opératoire. Les navigateurs apportent
anatomiques de la face supéroexterne de la pyramide pétreuse une aide contributive pour cette chirurgie et devraient permet-
rendent complexe l’appréciation de cette zone de projection. La tre un fraisage à la fois optimal et sécurisé, limitant le risque de
Techniques chirurgicales - Tête et cou 11
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
Figure 15. Exérèse d’un fibrome nasopha-
ryngien. L’apport d’un système de navigation
pour ce type de chirurgie est évident : noter la
contiguïté de l’angiofibrome avec le nerf opti-
que gauche (enfant de 7 ans). Il devrait per-
mettre de traiter certaines formes par voie
endoscopique exclusive, limitant les séquelles
esthétiques pour cette pathologie survenant
essentiellement chez l’enfant (cliché profes-
seur Tran Ba Huy, Hôpital Lariboisière, Paris).
lésion du nerf facial et réduisant le traumatisme mécanique d’imperforation choanale bilatérale [34], il n’existe à ce jour
imposé à la cochlée par les vibrations de la fraise [31, 32]. aucun système de référencement correctement adapté à la
morphologie du nouveau-né ou du jeune enfant. Les bandeaux
Voies rétrosigmoïdes frontaux n’offrent pas nécessairement le même degré de
Lors de l’incision méningée et de la vidange subséquente plus stabilité que chez l’adulte, tandis que les trépieds vissés sont
ou moins importante de liquide céphalorachidien, les structures inexploitables en raison de la minceur de la table externe du
neurologiques et vasculaires pontocérébelleuses sont déplacées, crâne de l’enfant. Seul le système Instatrack ® (Tableau 1)
ce qui rend leur repérage difficile, le brain-shift pouvant intégrait des casques de référencement pédiatriques, mais leur
atteindre 15 mm selon un axe craniocaudal. Par ailleurs, les emploi est désormais interdit par la Food and Drug Administra-
techniques de vision endoscopique développées par Magnan et tion en raison de lésions neuropathiques durables intéressant le
Chays [33] modèrent l’intérêt de la navigation pour repérer territoire du nerf auriculaire postérieur. Les concepteurs ont
vaisseaux et nerfs crâniens émergents. Son apport réside donc un effort certain à faire pour étendre les capacités des
essentiellement dans la capacité de préciser, entre berge posté- systèmes de navigation à une catégorie de patients qui devraient
rieure du méat acoustique interne et canal semi-circulaire pourtant être les premiers à bénéficier de cette avancée
postérieur, l’espace disponible pour fraisage, si le canal auditif technologique.
interne doit être abordé.
Chirurgie du sac endolymphatique
L’utilisation d’un système de navigation pour repérer le sac
■ Règles d’utilisation
endolymphatique par voie transmastoïdienne est ici anecdoti- • Chaque équipe chirurgicale a, bien sûr, ses préférences
que (Fig. 16), mais illustre l’intérêt d’un guidage pour optimiser personnelles. Mais le fait de réserver à des situations d’excep-
le fastidieux temps de fraisage mastoïdien, inévitable pour la tion un système de navigation est un frein certain à sa bonne
plupart des interventions otologiques. maîtrise et conduit l’utilisateur à devoir découvrir ou redé-
couvrir son matériel au moment où, précisément, il est le
Implantation cochléaire
plus accaparé par les exigences d’une chirurgie difficile. Aussi,
Cette application est encore en phase de recherche et déve- nous pensons que les navigateurs devraient être utilisés de
loppement. Elle devrait sécuriser la tympanotomie postérieure manière quasi systématique, y compris pour des indications
notamment chez l’enfant et dans le cas de cochlées malformées qui ne posent pas a priori de gros problèmes de repérage.
ou ossifiées, assurer le positionnement du porte-électrodes au • Lorsque le système de navigation en dispose, les outils de
plus près des structures neurosensorielles à stimuler. Ce type manipulation de l’imagerie (navigation virtuelle dans les
d’application est cependant très exigeant, puisqu’il requiert une trois plans de l’espace, mensurations, reconstructions avec
précision nettement submillimétrique et un degré de fiabilité rendu surfacique, etc.) permettent une analyse beaucoup plus
très élevé. La fusion multimodale d’images IRM et tomodensi- fine de la pathologie du patient que les quelques planches
tométriques devrait permettre une maximalisation de l’informa- fournies par le service d’imagerie (Fig. 17, 18). Leur utilisation
tion radiologique. Cette méthode requiert néanmoins des préopératoire quasi systématique permet quelquefois d’affiner
protocoles d’acquisition spéciaux et des imageurs à haute l’indication chirurgicale et constitue toujours un moyen
résolution. L’avènement imminent des scanners à faisceau d’enseignement et d’autoperfectionnement [10, 35].
conique et détecteur-plan présente ici des perspectives • Ne jamais faire aveuglément confiance au système de naviga-
séduisantes. tion. Aucune décision importante ne doit être prise sans s’être
préalablement assuré de la validité du guidage sur des repères
Chirurgie pédiatrique limitrophes.
Même si les navigateurs sont régulièrement utilisés en • Si l’opérateur et la machine sont en désaccord quant à la
pédiatrie, parfois même dès les premières heures de la vie lors position effective de l’instrument, toujours considérer que la
12 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
Figure 16. Décompression de sac endolym-
phatique. Après mastoïdectomie, le pointeur
permet de situer la position relative de la fos-
sette unguéale entre sinus latéral et canal semi-
circulaire postérieur, avant de fraiser la corti-
cale interne. Préalablement, la précision est
vérifiée, et si nécessaire affinée, sur des repères
triviaux (cliché professeur Bordure, centre hos-
pitalier universitaire de Nantes).
Figure 17. Mucocèle frontale : planning
préopératoire. Reconstruction volumique avec
superposition sélective de transparences.
Cette méthode permet une analyse très pré-
cise des limites de l’érosion mucocélique de la
paroi postérieure de ce sinus frontal gauche.
Ce type d’imagerie volumique est d’interpré-
tation délicate, mais permet une conceptuali-
sation de lésions impossibles à appréhender
par les seules coupes planaires.
machine a tort jusqu’à preuve du contraire. Mais chercher dité et mortalité opératoires, problèmes pour lesquels ils ont été
cette preuve, même au prix de quelques secondes rajoutées au initialement conçus. La raison en est d’ordre éthique et tend
temps opératoire. implicitement à démontrer l’intérêt de ces systèmes puisque les
services qui en sont équipés tendent à les utiliser systématique-
ment, empêchant dès lors toute étude comparative prospective.
■ Conclusion : intérêt et limites Les études rétrospectives sont d’intérêt moindre, puisqu’elles
comparent généralement des résultats à différentes périodes
de la chirurgie infodromique (avant, puis après acquisition d’un navigateur) de groupes
Depuis ses premières apparitions dans les blocs opératoires, la d’opérateurs dont l’expérience s’est accrue au fil des années [1,
14] . Toutes ces études en revanche, expriment un bénéfice
chirurgie assistée par ordinateur a considérablement évolué dans
ses performances, en même temps que sa mise en œuvre s’est sensible pour l’opérateur, plus détendu dans la réalisation de
simplifiée. Son coût, il y a encore peu, n’était accessible qu’à de son acte, lequel est généralement plus complet [1, 10] avec
gros services universitaires occidentaux. Aujourd’hui, du même parfois un gain de temps non négligeable [10]. Toutes aussi,
ordre de grandeur que celui d’un microscope opératoire, il est insistent sur les capacités didactiques indiscutables de ces
accessible à tout bloc chirurgical de moyenne capacité. systèmes, susceptibles d’améliorer la performance d’un opéra-
À ce jour, aucune étude prospective contrôlée n’a pu apporter teur confirmé et d’accélérer la formation d’opérateurs en
la preuve que les navigateurs chirurgicaux aient réduit morbi- apprentissage [10, 35].
Techniques chirurgicales - Tête et cou 13
46-545 ¶ Chirurgie ORL assistée par ordinateur
Figure 18.
A, B, C. Reconstructions 3D avec rendu surfa-
cique. Ces reconstructions peuvent être utiles
pour analyser un traumatisme facial, simuler
une vue endoscopique ou encore étudier la
structure des sinus frontaux avant interven-
tion.
Les limites actuelles de la chirurgie infodromique sont essen- [10] Cassou L. Le système de navigation DigiPointeur : application à la
tiellement liées à celles de l’imagerie. Les actuels scanners chirurgie cranio-faciale à propos de 200 interventions. [thèse méde-
multibarrettes à très haute résolution permettent d’obtenir des cine], Lyon-I, 2004.
images dont la résolution spatiale, quasiment isométrique, est de [11] Koele W, Stammberger H, Lackner A, Reittner P. Image guided surgery
l’ordre de 0,2 mm. Les tomodensitomètres mobiles à faisceau of the paranasal skull base. Five years experience with the InstaTrak-
conique et détecteur plan en cours de développement devraient System. Rhinology 2002;40:1-9.
accroître encore sensiblement résolution spatiale et résolution de [12] Garry G. Surgical navigation systems. ENT 2001;9:40-3.
densité pour aboutir à des images à ultrahaute définition [36]. [13] Fried MP, Kleefeld J, Gopal H, Reardon E, Ho BT, Kuhn F. Image
Mais les systèmes de contention des imageurs sont encore trop guided endoscopic surgery: results of accuracy and performance in a
rudimentaires pour immobiliser totalement le crâne et empêcher multicenter clinical study using an electromagnetic tracking system.
tout micromouvement, même si les temps d’acquisition sont Laryngoscope 1997;107:594-601.
désormais inférieurs à la minute. Il est probable que les généra-
[14] Fried MP, Moharir V, Shin J, Taylor-Becker M, Morrison P.
tions de système d’imagerie à venir vont intégrer peu à peu un
Comparison of endoscopic sinus surgery with and without image
ensemble de moyens destinés à optimiser l’acquisition chirurgi-
guidance. Am J Rhinol 2002;16:193-7.
cale d’images, devenues non plus de simples outils diagnostiques
mais d’authentiques instruments à visée thérapeutique. [15] Metson R, Gliklich R, Cosenza M. A comparison of image guidance
Il ne fait aucun doute que la chirurgie infodromique va systems for sinus surgery. Laryngoscope 1998;108:1164-70.
constituer peu à peu un standard difficilement contournable dans [16] Lombard B. L’aide au geste chirurgical par les navigateurs et les robots.
la prise en charge de nombreuses pathologies chirurgicales ORL, Navigateurs des sinus et de la base du crâne. Bull Acad Natl Med 2002;
combinant à des voies d’abord de plus en plus petites un gain de 186:1091-102.
sécurité et de qualité du geste opératoire. Mais cette technologie [17] Maciunas RJ, Galloway Jr. RL, Latimer JW. The application accuracy
émergeante ne sera un réel progrès qu’à la condition qu’elle of stereotactic frames. Neurosurgery 1994;35:682-95.
vienne augmenter les performances d’opérateurs se voulant [18] Zamorano L, Dujovny M, Malik G, Mehta B, Yakar D. Factors
toujours aussi exigeants quant à la qualité de leur formation affectings measurements in computed tomography-guided stereotactic
anatomique et opératoire. Si tel n’est pas le cas, la machine procedures. Appl Neurophysiol 1987;50:53-6.
n’aura fait qu’amputer l’homme en le remplaçant médiocrement. [19] Zinreich J, Tebo SA, Long D, Rem H, Mattox D, Loury ME, et al.
Frameless stereotactic integration of CT imaging data: accuracy and
initial applications. Radiology 1993;188:735-42.
[20] Hauser R, Westermann B, Probst R. Noninvasive tracking of patient’s
.
■ Références head movements during computer-assisted intranasal microscopic
surgery. Laryngoscope 1997;107:491-9.
[1] Reardon E. Navigational risks associated with sinus surgery and the [21] Hauser R, Westermann B. Optical tracking of a microscope for image-
clinical effects of implementing a navigational system for sinus surgery. guided intranasal sinus surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999;108:
Laryngoscope 2002;112(7Pt2suppl99):1-9. 54-62.
[2] Cushing H. The Weir Mitchell lecture. Surgical experiences with [22] Zheng G, Caversaccio M, Bachler R, Langlotz F, Nolte LP, Hausler R.
pituitary disorders. JAMA 1914;63:1515-25. Frameless optical computer-aided tracking of a microscope for
[3] Kondziolka D, Dempsey PK, Lunsford LD, Kestle JR, Dolan EJ, otorhinology and skull base surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
Kanal E, et al. A comparison between magnetic resonance imaging and 2001;127:1233-8.
computed tomography for stereotactic coordinate determination. [23] Jankowski R, Auque J, Simon C, Marchal JC, Hepner H, Wayoff M.
Neurosurgery 1992;30:402-7. Endoscopic pituitary tumor surgery. Laryngoscope 1992;102:198-202.
[4] Leksell l. Jernberg B. Stereotaxis and tomography: a technical note. [24] Thomas R, Monacci W, Mair E. Endoscopic image-guided
Acta Neurochir (Wien) 1980;52:1-7. transethmoid pituitary surgery. Otolaryngol Head Neck Surg 2002;127:
[5] Brown RA, Roberts T, Osborn AG. Simplified CT-guided stereotaxic 409-16.
biopsy. AJNR Am J Neuroradiol 1981;2:181-4.
[25] Walker D, Ohaegbulam C, Black P. Frameless stereotaxy as an alterna-
[6] Carrau R, Curtin H, Snydermann C, Bumpous J, Stechison M. Practical
tive to fluoroscopy for transsphenoidal surgery. J Clin Neurosci 2002;
applications of image-guided navigation during anterior cranio-facial
resection. Skull Base Surg 1995;5:51-5. 9:294-7.
[7] Watanabe E, Watanabe T, Manaka S, Mayanagi Y, Takakura K. Three [26] Herman P, Hervé S, Portier F, Tran Ba Huy P. Chirurgie du fibrome
dimensional digitizer (Neuronavigator): a new equipment for nasopharyngé. Encycl Méd Chir (Elsevier SAS, Paris), Techniques chi-
CT-guided stereotaxic surgery. Surg Neurol 1987;27:543-7. rurgicales – Tête et cou, 46-210, 2004.
[8] Klossek JM, Serrano E, Dessi P, Fontanel JP. Chirurgie endonasale [27] Klimek L, Wenzel M, Mösges R. Computer-assisted orbital surgery.
sous guidage endoscopique. Paris: Masson; 2004. Ophthalmic Surg 1993;24:411-7.
[9] Schlaier J, Warnat J, Brawanski A. Registration accuracy and [28] Lombard B. Chirurgie craniofaciale assistée par ordinateur. Encycl
practicability of laser-directed surface matching. Comput Aided Surg Méd Chir (Elsevier SAS, Paris), Stomatologie, 22-360-A-30, 2003 :
2002;7:284-90. 8p.
14 Techniques chirurgicales - Tête et cou
Chirurgie ORL assistée par ordinateur ¶ 46-545
[29] Schramm A, Gellrich NC, Gutwald R, Schipper J, Bloss H, Hustedt H, [33] Magnan J, Sanna M. Endoscopy in neuro-otology. Stuttgart: Thieme;
et al. Indications for computer-assisted treatment of cranio- 1999.
maxillofacial tumors. Comput Aided Surg 2000;5:343-52. [34] Schweinfurth J. Image guidance-assisted repair of bilateral choanal
[30] Wickham J. Minimally invasive surgery. BMJ 1994;308:193-6. atresia. Laryngoscope 2002;112:2096-8.
[31] Pons Y. Étude anatomique des repères traditionnels de la voie sus- [35] Gorman P, Meier A, Krummel T. Computer-assisted training and
pétreuse à l’aide du Système DigiPointeur. [thèse médicine], Lyon-I, learning in surgery. Comput Aided Surg 2000;5:120-30.
2004. [36] Rafferty M, Siewerdsen J, Chan Y, Moseley DJ, Daly MJ, Jaffray DA,
[32] Sargent E, Bucholz R. Middle cranial fossa surgery with image-guided et al. Investigation of C-Arm cone-beam CT-Guided surgery of the
instrumentation. Otolaryngol Head Neck Surg 1997;117:131-4. frontal recess. Laryngoscope 2005;115:2138-43.
B. Lombard, Chirurgien spécialiste des hôpitaux des Armées (dr.bl@wanadoo.fr).
Service ORL et chirurgie cervicofaciale, Hôpital d’instruction des Armées Desgenettes, 108, boulevard Pinel, 69275 Lyon cedex 03, France.
Toute référence à cet article doit porter la mention : Lombard B. Chirurgie ORL assistée par ordinateur. EMC (Elsevier SAS, Paris), Techniques chirurgicales -
Tête et cou, 46-545, 2006.
Disponibles sur www.emc-consulte.com
Arbres Iconographies Vidéos / Documents Information Informations Auto-
décisionnels supplémentaires Animations légaux au patient supplémentaires évaluations
Techniques chirurgicales - Tête et cou 15
Vous aimerez peut-être aussi
- Encephale 2022 DR MANOUDocument123 pagesEncephale 2022 DR MANOUMahamat Abakar Bérémi MahamatPas encore d'évaluation
- RadioscopieDocument41 pagesRadioscopiezakaria abedPas encore d'évaluation
- Memoire de Fin D'Etudes: ThèmeDocument115 pagesMemoire de Fin D'Etudes: Thèmenourhen bounemchaPas encore d'évaluation
- 2015 Chabbert EMC ORLDocument9 pages2015 Chabbert EMC ORLMihaela BorzaPas encore d'évaluation
- Neurinome de L'acoustiqueDocument55 pagesNeurinome de L'acoustiqueammar eidPas encore d'évaluation
- Le PriapismeDocument39 pagesLe Priapismedieynaba ba100% (1)
- Guide Pratique de Maintenance DDocument11 pagesGuide Pratique de Maintenance DGustave BarutiPas encore d'évaluation
- IRM cérébrale et angio-IRM du polygone de Willis : interprétation des résultats et implications cliniques.D'EverandIRM cérébrale et angio-IRM du polygone de Willis : interprétation des résultats et implications cliniques.Pas encore d'évaluation
- Acouphènes ObjectifsDocument10 pagesAcouphènes ObjectifsZineb BelmejdoubPas encore d'évaluation
- Consultation CervicofacialeDocument11 pagesConsultation CervicofacialeRodrigue Ebozoa100% (1)
- Bases Physique Radiologie p2 2010Document97 pagesBases Physique Radiologie p2 2010des rimPas encore d'évaluation
- DacryocystorhinostomieDocument10 pagesDacryocystorhinostomieAbdou Latif RachidPas encore d'évaluation
- Stratégies Diagnostique Et Thérapeutique Devant Une Surdité de L'enfantDocument15 pagesStratégies Diagnostique Et Thérapeutique Devant Une Surdité de L'enfantMoncef PechaPas encore d'évaluation
- Curages Ganglionnaires Lors Des Exérèses Pulmonaires Pour CancerDocument10 pagesCurages Ganglionnaires Lors Des Exérèses Pulmonaires Pour CancerCristian BivoleanuPas encore d'évaluation
- Stratégie Diagnostique Devant Une Surdité de L'adulte: Rappel Succinct D'anatomie FonctionnelleDocument13 pagesStratégie Diagnostique Devant Une Surdité de L'adulte: Rappel Succinct D'anatomie FonctionnelleMoncef PechaPas encore d'évaluation
- Compte Rendu Echo Denis MedeganDocument1 pageCompte Rendu Echo Denis MedeganCrios M100% (1)
- Appareillage Auditif ConventionnelDocument14 pagesAppareillage Auditif ConventionnelZineb BelmejdoubPas encore d'évaluation
- 2013-2014 - S1 - 4int - QCMDocument26 pages2013-2014 - S1 - 4int - QCMISSAM El morabetPas encore d'évaluation
- Surdités Brusques 2023Document11 pagesSurdités Brusques 2023gassem100% (1)
- Examen Final EL80: CorrectionDocument10 pagesExamen Final EL80: Correctionmohamed ali ben amorPas encore d'évaluation
- Angiographie Cérébrale NormaleDocument21 pagesAngiographie Cérébrale Normaleskyclad_21Pas encore d'évaluation
- Medecine NucleaireDocument12 pagesMedecine Nucleairea cheumagPas encore d'évaluation
- PDF Intoxication Au CODocument17 pagesPDF Intoxication Au CONour BidPas encore d'évaluation
- Cours Ecg.Document107 pagesCours Ecg.Aliou MaigaPas encore d'évaluation
- FC 1 - Physiologie PulmonaireDocument30 pagesFC 1 - Physiologie PulmonaireArié AmzallagPas encore d'évaluation
- Imagerie de L'oreille Partie 2Document244 pagesImagerie de L'oreille Partie 2Doc Zak100% (1)
- TD 2 - Rhumatologie - Raideur ArticulaireDocument15 pagesTD 2 - Rhumatologie - Raideur ArticulairefuharaPas encore d'évaluation
- RésonanceMagnétiqueNucléaireetsonapplicationdansl Imagerie (1) CompressedDocument28 pagesRésonanceMagnétiqueNucléaireetsonapplicationdansl Imagerie (1) CompressedkaotarPas encore d'évaluation
- Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë - EMC Réa 11Document19 pagesSyndrome de Détresse Respiratoire Aiguë - EMC Réa 11Amouri AyoubPas encore d'évaluation
- Emc OrlDocument23 pagesEmc OrlYassine Moussa100% (1)
- Imagerie de L'oreille Moyenne Normale Et PathologiqueDocument22 pagesImagerie de L'oreille Moyenne Normale Et PathologiqueMoukarroim AnliPas encore d'évaluation
- CAT Devant Nodule Du Sein - ToPODocument62 pagesCAT Devant Nodule Du Sein - ToPOHind Essalim100% (1)
- Les Examens Visceraux - Mimsp - Infspm - SaidaDocument4 pagesLes Examens Visceraux - Mimsp - Infspm - SaidaKader Hanache100% (1)
- Imagerie Par Résonance MagnétiqueDocument28 pagesImagerie Par Résonance MagnétiqueCedric AndriambeloPas encore d'évaluation
- Irm 2021Document27 pagesIrm 2021Moussa IbrahimPas encore d'évaluation
- L Intubation Difficile SFARDocument13 pagesL Intubation Difficile SFARAyoub LilouPas encore d'évaluation
- ITEM 223 - AOMI - IsCHEMIE AIGUE M - V4.PDF#Viewer - Action DownloadDocument6 pagesITEM 223 - AOMI - IsCHEMIE AIGUE M - V4.PDF#Viewer - Action DownloadbibouPas encore d'évaluation
- Papillomatose LaryngeeDocument5 pagesPapillomatose Laryngeeadelmiringui2Pas encore d'évaluation
- Révision Pneumo (Radio)Document11 pagesRévision Pneumo (Radio)Royd Jesse Kwibisa JrPas encore d'évaluation
- Meatotomie Moyenne GuideDocument30 pagesMeatotomie Moyenne GuideZineb BelmejdoubPas encore d'évaluation
- MD QCM Diue Janvier 20141Document41 pagesMD QCM Diue Janvier 20141AYENA FULBERTPas encore d'évaluation
- Technique ChirurgicaleDocument100 pagesTechnique ChirurgicaleCharly MitanoPas encore d'évaluation
- (Collection ORL) Legent, François - Malard, Olivier - L'Otoscopie en Pratique Clinique-Elsevier-Masson, Educa Books (2015)Document183 pages(Collection ORL) Legent, François - Malard, Olivier - L'Otoscopie en Pratique Clinique-Elsevier-Masson, Educa Books (2015)Thibault DEDIEUPas encore d'évaluation
- Biophysique2an Vision2021 PDFDocument18 pagesBiophysique2an Vision2021 PDFMeker NesPas encore d'évaluation
- Smiologie OrlDocument75 pagesSmiologie OrlLucian Vasile100% (1)
- HyponatrémieDocument4 pagesHyponatrémieepoptae100% (1)
- Imagerie Du PolytraumatiséDocument33 pagesImagerie Du PolytraumatiséBenzaoui Djemana100% (1)
- Traumatismes Du Rachis Cervical SupérieurDocument9 pagesTraumatismes Du Rachis Cervical SupérieurespritdeboisPas encore d'évaluation
- Chapitre 19 - IRM de La Cheville Et Du Pied - 2017 - IRM en Pratique CliniqueDocument31 pagesChapitre 19 - IRM de La Cheville Et Du Pied - 2017 - IRM en Pratique CliniqueAbderrazek ZeraiiPas encore d'évaluation
- Traumatismes Craniens 2020Document52 pagesTraumatismes Craniens 2020iliass chekrouniPas encore d'évaluation
- Semiologie Radiologique Des Affections Maxillaires Et MandibulairesDocument146 pagesSemiologie Radiologique Des Affections Maxillaires Et MandibulairesAymn KmlPas encore d'évaluation
- Chapitre 6-RNI-Les Rayonnements UltrasonoresDocument12 pagesChapitre 6-RNI-Les Rayonnements UltrasonoresKhadidjaPas encore d'évaluation
- CHESONDocument34 pagesCHESONLlvrlPas encore d'évaluation
- Anesthésie Du Patient AmbulatoireDocument19 pagesAnesthésie Du Patient Ambulatoirekajol14Pas encore d'évaluation
- Item 234 Troubles de La Conduction Intra-CardiaqueDocument5 pagesItem 234 Troubles de La Conduction Intra-CardiaqueHelene QuachPas encore d'évaluation
- Traumatismes Thoraciques Graves PDFDocument12 pagesTraumatismes Thoraciques Graves PDFsarah h100% (1)
- Infection Aiguë Des Parties MollesDocument17 pagesInfection Aiguë Des Parties MollesAbdou RahmouniPas encore d'évaluation
- AOMI 1-s2.0-S1166456818791122 (1) 3740587597734523566Document20 pagesAOMI 1-s2.0-S1166456818791122 (1) 3740587597734523566Angelina Darine100% (1)
- Bandage Pour AmputesDocument8 pagesBandage Pour AmputesZi ChirazPas encore d'évaluation
- Séquences FLAIR Et T2° PDFDocument54 pagesSéquences FLAIR Et T2° PDFNdiaga Matar GayePas encore d'évaluation
- Radio Anatomie CervicaleDocument42 pagesRadio Anatomie CervicaleNguyen Tran CanhPas encore d'évaluation
- Les Troubles du Rythme Cardiaque : Comprendre, Diagnostiquer et TraiterD'EverandLes Troubles du Rythme Cardiaque : Comprendre, Diagnostiquer et TraiterPas encore d'évaluation
- Assemblage D'un OrdinateurDocument41 pagesAssemblage D'un OrdinateurAMINE BEN100% (2)
- Cours 1Document3 pagesCours 1el karamPas encore d'évaluation
- Configuration Et Depannage de PCDocument5 pagesConfiguration Et Depannage de PCBakary BolaPas encore d'évaluation
- Syllabus AssembleurDocument41 pagesSyllabus Assembleuraelghazi100% (1)
- ACF98Document22 pagesACF98abou abdouPas encore d'évaluation
- Cours 1 IntroductionDocument37 pagesCours 1 IntroductionZel DrisPas encore d'évaluation
- Systeme de SupervisonDocument118 pagesSysteme de SupervisonazizhamdiPas encore d'évaluation
- Cours de CinquiemeDocument31 pagesCours de CinquiemeAurele OndouaPas encore d'évaluation
- TP1 Info2Document21 pagesTP1 Info2Med Amine TAHIRIPas encore d'évaluation
- Cours Microprocesseur MicroControleur M1 GI Chap 2Document13 pagesCours Microprocesseur MicroControleur M1 GI Chap 2Hassan MohamedPas encore d'évaluation
- 2 Supports Visuels 5è PDFDocument301 pages2 Supports Visuels 5è PDFsouissi_mohsenPas encore d'évaluation
- Poste de TravailDocument10 pagesPoste de Travailkamal infPas encore d'évaluation
- Syst Manuf Flexibles V1Document50 pagesSyst Manuf Flexibles V1Hanane TASMANTPas encore d'évaluation
- 1.-Introduction A L'informatique de AlcimaDocument173 pages1.-Introduction A L'informatique de AlcimaChristopher SinvilPas encore d'évaluation
- Frances Speaking PreguntasDocument16 pagesFrances Speaking PreguntasStudent Luis Villanueva VelazquezPas encore d'évaluation
- Fiche de Travaux Diriges D'informatique N°4 - Terminale Cde - CamerounDocument4 pagesFiche de Travaux Diriges D'informatique N°4 - Terminale Cde - Camerounclarence100% (1)
- Chapitre 2Document5 pagesChapitre 2Jamel Ben AmmarPas encore d'évaluation
- TD2 - Corrigé - Suite Chapitre 2Document2 pagesTD2 - Corrigé - Suite Chapitre 2patrickzagoh5Pas encore d'évaluation
- Cours Pratique Module 1Document3 pagesCours Pratique Module 1Zainoudine OUSSAMATPas encore d'évaluation
- MaterielDocument74 pagesMaterielZozer Mbula LwangaPas encore d'évaluation
- Réparation Iphone GenèveDocument1 pageRéparation Iphone GenèvejashleyminePas encore d'évaluation
- Initiation Info - 2023 2024Document94 pagesInitiation Info - 2023 2024arielkolia100% (2)
- CS F 22Document24 pagesCS F 22Imad SimoPas encore d'évaluation
- Epreuve Professionnelle de SyntheseDocument2 pagesEpreuve Professionnelle de SyntheseWaffo lele rostandPas encore d'évaluation
- Informatique 3eme Eval4Document20 pagesInformatique 3eme Eval4youlouedraogo99Pas encore d'évaluation
- Inside Usi2017 FR Web 1Document64 pagesInside Usi2017 FR Web 1split_2002Pas encore d'évaluation
- Informatique de Base: ENCG de Kenitra Semestre Autonome S1 PR S.Moqqaddem AU: 2023/2024Document21 pagesInformatique de Base: ENCG de Kenitra Semestre Autonome S1 PR S.Moqqaddem AU: 2023/2024ᙢᓎᕼᗅᙢᙢᙍᗫ ᙍᒪPas encore d'évaluation
- 4.langage AssembleurDocument60 pages4.langage AssembleurAmine NafidPas encore d'évaluation