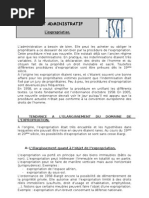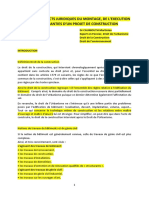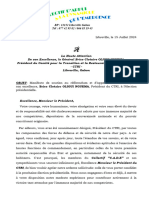Bulletin de Liaison 4
Bulletin de Liaison 4
Transféré par
clavoie2103Droits d'auteur :
Formats disponibles
Bulletin de Liaison 4
Bulletin de Liaison 4
Transféré par
clavoie2103Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Bulletin de Liaison 4
Bulletin de Liaison 4
Transféré par
clavoie2103Droits d'auteur :
Formats disponibles
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
Bulletin de liaison
n°4
Regroupement 3
Corrigé des exercices à traiter : Cas pratiques : Le pays lillois
1) La France des ronds-points
Le conseil départemental du Nord a voté la construction sur un rond-point d’un cornet de frites géant, et non
loin de ce rond-point, d’un pont reliant ledit rond-point à une zone d’activités, autrefois isolée par un cours
d’eau. Pour ce faire, le département, maître d’ouvrage, a fait appel à plusieurs sociétés qui ont réalisé les
travaux.
Madame Michelle, qui gère un élevage de chats du Bengal, reproche au département l’apparition de fissures
sur sa maison depuis le début des travaux et l’effondrement d’une partie de son domicile qui seraient dus,
selon elle, aux vibrations importantes causées par les engins.
Selon le maître d’ouvrage, ces dégâts n’ont pas été provoqués par les travaux mais par la fragilité du bien de
Madame Michelle et la nature du terrain.
Madame Michelle souhaite saisir le tribunal compétent. Qui doit-elle saisir et que peut-elle développer
devant la juridiction ?
Réponse
Il faut commencer par qualifier l’ouvrage : il faut rappeler la définition de l’ouvrage public : il s’agit d’un
ouvrage immobilier, aménagé par l’homme, appartenant ici à une personne publique (département) et
pour le coup affecté à une utilité publique ; ici plus précisément l’usage direct du public. D’où cet
ensemble immobilier constitue un ouvrage public et non un ouvrage privé.
Il faut aussi qualifier les travaux effectués car si des travaux effectués sur un ouvrage public sont le plus
souvent des travaux publics, ce n’est pas toujours le cas. Il est donc nécessaire de qualifier les travaux en
eux-mêmes. Il existe deux définitions alternatives possibles.
1. Constituent des travaux publics les travaux immobiliers réalisés par une personne privée pour le
compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général
Définition posée par le CE, dans un arrêt du 10 juin 1921, Cne de Monségur. Les critères cumulatifs
dégagés par les juges :
- Travail immobilier = réalisé sur un immeuble. Peu importe la nature ou l’ampleur des travaux. Ex:
démolition, entretien, travaux préparatoires, l’enlèvement des ordures ménagères, tondre le gazon,
etc.
- Travail réalisé pour le compte d’une personne publique, qui doit être maître d’ouvrage des
travaux. C’est le cas quand la personne publique est propriétaire de l’immeuble sur lequel est réalisé
le travail (s’applique aussi aux biens de retour, lorsque la personne publique va devenir propriétaire à
la fin du contrat). Ou lorsque la personne publique contrôle, dirige et finance les travaux.
- Travail réalisé dans un but d’intérêt général. Notez que s’il y a plusieurs intérêts, dont des intérêts
économiques ou particuliers, mais qu’il y aussi un intérêt général, ce dernier l’emporte et permet aux
travaux d’entrer sous le régime des travaux publics.
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
ATTENTION ! Ici, le CE ne recherche pas si l’église au cœur du litige faisait partie ou non du domaine
public. Ainsi, domaine public et travaux publics sont deux notions dissociées (voir en ce sens, TC, 24
octobre 1942, Préfet des Bouches-du-Rhône).
2. Constituent également des travaux publics les travaux immobiliers réalisés par une personne
publique pour le compte d’une personne privée dans un but de service public
TC, 28 mars 1955, Effimieff (GAJA) : sur les travaux de reconstruction d’immeubles propriétés privées
abîmés par la guerre, réalisés par des personnes publiques dans un but de SP de reconstruction et de
logement notamment. Cet arrêt vient étendre la notion de travaux publics.
Le CE a repris cette définition (voir, CE, 20 avril 1956, Consorts Grimouard (SP reboisement) et 12 avril
1957, Mimouni (SP police des immeubles menaçant ruine).
Les critères cumulatifs dégagés par les juges :
- L’immeuble appartient à une personne privée.
- Les travaux sont réalisés par une personne publique qui en contrôle l’exécution.
- Les travaux sont réalisés dans un but de service public. Pour déterminer un service public, il va
falloir appliquer les critères dégagés par la jurisprudence Narcy de 1963 et surtout CE 2007 APREI.
Pour rappel, les 3 conditions dégagés par l’arrêt APREI = activité ayant un intérêt général + sous le
contrôle de la personne publique + prérogative de puissance publique ou obligations de service public
à la charge de la personne privée.
En l’espèce, les travaux sont réalisés par des personnes privées pour le compte d’une personne publique
dans un but d’intérêt général. Il s’agit donc de travaux publics.
Question de droit : Il faut donc vérifier d’abord quel est le juge compétent pour connaitre de ces actions
en responsabilité du fait de dommages causés par la réalisation de travaux publics.
Règles de droit :
En matière de dommages de travaux publics, le juge compétent est en principe le juge administratif (loi
du 28 pluviôse an VIII et désormais, depuis l’abrogation de cette loi, l’arrêt du CE 7 août 2008, « SA de
gestion des eaux de Paris, no 289329). Mais il peut y avoir des exceptions à ce principe qui conduisent à
reconnaitre la compétence du juge judiciaire. Il s’agit de l’hypothèse où le dommage est causé à un usager
d’un service public industriel et commercial (SPIC) (T. confl., 24 juin 1954, no 1.457, Guyomar, Minodier
et autres c/ EDF et CE, 19 févr. 2009, no 293020, Beaufils, TC 17 octobre 1966, Dame veuve Canasse), celle
où le dommage trouve son origine dans une voie de fait (TC 17 juin 2013, Bergoend et CE ord. 23 janvier
2013, Cne de Chirongui), celle où le dommage trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule
de travaux publics (Loi du 31 décembre 1957 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 et Trbl. confl., 21 févr.
2001, no 03243, Cne de Courdimanche et compagnie Groupama Ile de France c./ Agent judiciaire du Trésor)
et encore celle où le dommage trouve son origine dans la faute personnelle d’un agent public).
Application au cas d’espèce : Madame Michelle reproche au département l’apparition de fissures sur sa
maison depuis le début des travaux et l’effondrement d’une partie de son domicile qui seraient dus, selon
elle, aux vibrations importantes causées par les engins. Dans ce cas pourrait être retenue la compétence
du juge judiciaire. Le dommage trouverait sa cause déterminante dans l’action des véhicules de travaux
publics. Si l’on estime au contraire, que le dommage trouve sa cause principale dans la réalisation de
travaux publics (mauvaise organisation du chantier) le juge administratif sera compétent.
Quelles règles s’appliqueront ?
Soit le juge judiciaire est compétent et il appliquera les règles de droit privé.
Soit la compétence du juge administratif conduit alors à l’application des règles de la responsabilité pour
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
dommages de travaux publics.
Le dommage est un dommage causé par la réalisation de travaux publics, le dommage est causé à un tiers
par rapport aux travaux et non un occupant du domaine public, et non à une entreprise participant aux
travaux. S’applique en la matière la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges
publiques. La victime devra démontrer l’existence d’un fait générateur (la réalisation de travaux), un
dommage anormal (particulièrement grave) et spécial (dommage causé à un ou quelques administrés
identifiés) et un lien de causalité. L’administration pourra s’exonérer totalement ou partiellement de sa
responsabilité si elle parvient à démontrer l’existence d’un cas de force majeure (événement extérieur,
imprévisible et irrésistible) ou l’existence d’une faute de la victime. Le fait du tiers n’est pas exonératoire
de responsabilité.
Application au cas d’espèce : il y a en l’espèce dommage anormal et spécial, un fait générateur et un lien
de causalité. La commune mentionne que ces dégâts n’ont pas été provoqués par les travaux mais par la
fragilité du bien de Madame Michelle et la nature du terrain. De telles causes ne sont pas constitutives
d’un cas de force majeure ni d’une faute de madame Michelle, elles ne devraient donc pas pouvoir
constituer une cause exonératoire.
2) Jamais deux sans trois ?
Après une soirée bien arrosée, le fils de Madame Michelle, Jean-Eudes, ainsi que ses amis ont décidé de
vagabonder dans les rues de la ville afin d’exprimer leur passion commune pour les graffitis. Apercevant le
cornet de frites géant sur le rond-point, les amis ont entrepris de dessiner sur l’œuvre d’art un pot de
mayonnaise. Un gendarme, qui patrouillait près de la forêt voisine depuis la tombée de la nuit, a surpris la
scène. Il a rattrapé les quatre amis pour dresser un procès-verbal qu’il a ensuite adressé au président du
conseil départemental.
Peu découragés par cette première interpellation, les amis ont continué de se promener dans la commune et
sont arrivés devant le mur d’un terrain militaire. Le maire de la commune, qui promenait son chien, a surpris
les amis dessinant des fleurs sur la façade. Mécontent, il a ainsi dressé un procès-verbal qu’il a envoyé au
délégué militaire départemental.
Que risquent Jean-Eudes et les autres jeunes ?
Il faut d’abord qualifier le rond-point (le cornet de frites)
Il appartient au domaine public routier en vertu d’une qualification légale et du fait aussi des critères de
qualification conceptuelle : propriété publique affectée à l’usage direct du public (rappel des critères
d’appartenance directe, posés par le CG3P). Il faut aussi qualifier le mur du terrain militaire (domaine
public en vertu de la loi mais aussi en application des critères d’appartenance directe du CG3P, propriété
publique, affectée à un service public).
Les amis ont dessiné sur l’œuvre d’art puis sur le mur du terrain militaire. Il y a donc atteinte à l’intégrité
matérielle du domaine public.
Question de droit : de quels moyens disposent les personnes publiques (département et Etat) pour
sanctionner les atteintes portées à l’intégrité matérielle du domaine public ?
Enoncé des règles de droit :
1) L’Etat (le préfet) peut tout d’abord utiliser une action pénale qui peut être portée soit devant le juge
administratif (en cas de contravention de grande voirie) soit devant le juge pénal (en cas de contravention
de petite voirie). Cette action pénale ne joue que si un texte prévoit une telle protection.
Rappel du champ et de la définition de la contravention de petite voirie (domaine public routier, atteinte
à l’intégrité physique et matérielle du domaine public ou atteinte ou gêne portée à l’affectation du
domaine public) et du champ et de la définition de la contravention de grande voirie (domaine public
maritime, aéronautique, ferroviaire, militaire.. et atteinte à l’intégrité physique et matérielle du domaine
public ou atteinte ou gêne portée à l’affectation du domaine public).
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
Y-a-t-il en l’espèce, contravention de grande voirie ou de petite voirie ?
Application au cas d’espèce : Dans le premier cas l’atteinte est constitutive d’une CPV, puisqu’elle porte
sur le domaine public routier). Dans le second cas, il y a CGV (car domaine militaire protégé par la loi).
Une action pénale est possible devant le juge pénal pour ces contraventions de petite voirie et devant le
juge administratif pour les contraventions de grande voirie.
Elle sera même menée par le préfet qui y est tenu en vertu d’une obligation de poursuite (CE 1979,
Association des amis des chemins de la Ronde) sauf lorsque des motifs d’intérêt général le justifient. Il ne
peut en toute hypothèse tenir compte de considérations tirées de convenance personnelle ou
administrative. Les amis ne pourront ainsi échapper aux sanctions applicables en la matière.
Quelles sont ces sanctions ?
Le juge pénal ou administratif prononcera une amende (rappel du montant de l’amende) et une mesure
de réparation qui devrait consister dans le nettoyage des deux biens, ou dans le versement d’une
indemnité due pour le nettoyage de ces deux biens.
3) Une sombre histoire de glisse
En ce mois de décembre, en marchant vers un magasin de bricolage pour acheter des cartons et préparer
son départ pour Sète, Madame Théchaud a glissé sur une plaque de verglas, formée juste à côté d’une
canalisation d’eaux pluviales qui fuit depuis plusieurs mois.
Depuis un an, la compétence de gestion des eaux pluviales a été confiée à la communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole.
A l’hôpital, Madame Théchaud appelle la communauté d’agglomération pour se plaindre et réclamer
réparation. La responsable du service des eaux au sein de l’intercommunalité lui retorque que celle-ci,
commerçante dans les remparts de la ville, connaissait très bien la voie publique et la fuite : elle aurait dû y
faire attention.
Furieuse, Madame Théchaud entend se rapprocher de son avocat. A-t-elle raison d’espérer obtenir gain de
cause devant la justice ?
Réponse :
Il faut commencer par rappeler ici que la voie publique comme les ouvrages de canalisation des eaux
pluviales constituent des ouvrages publics car ils répondent à la définition de l’ouvrage public : ce sont
des biens immobiliers, appartenant à la commune, faisant l’objet d’un aménagement de l’homme
(construits par l’homme) et affectés à l’usage direct de tous, et à un service public (service public des eaux
usées). Madame Théchaud s’est fait mal en glissant sur une plaque de verglas sur la chaussée. Elle est
donc victime d’un dommage causé par un ouvrage public.
Question de droit : Il faut vérifier d’abord quel est le juge compétent pour connaitre de ces actions en
responsabilité.
Règles de droit :
En matière de dommages de travaux publics, le juge compétent est en principe le juge administratif (loi
du 28 pluviôse an VIII et désormais, depuis l’abrogation de cette loi, l’arrêt du CE 7 août 2008, « SA de
gestion des eaux de Paris, no 289329). Mais il peut y avoir des exceptions à ce principe qui conduisent à
reconnaitre la compétence du juge judiciaire. Il s’agit de l’hypothèse où le dommage est causé à un usager
d’un service public industriel et commercial (SPIC) (T. confl., 24 juin 1954, no 1.457, Guyomar, Minodier
et autres c/ EDF et CE, 19 févr. 2009, no 293020, Beaufils, TC 17 octobre 1966, Dame veuve Canasse), celle
où le dommage trouve son origine dans une voie de fait (TC 17 juin 2013, Bergoend et CE ord. 23 janvier
2013, Cne de Chirongui), celle où le dommage trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule
de travaux publics (Loi du 31 décembre 1957 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 et Trbl. confl., 21 févr.
2001, no 03243, Cne de Courdimanche et compagnie Groupama Ile de France c./ Agent judiciaire du Trésor)
et encore celle où le dommage trouve son origine dans la faute personnelle d’un agent public).
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
Application au cas d’espèce : aucune de ces exceptions ne joue. C’est donc la compétence de principe du
juge administratif qui doit être retenue.
Cette compétence conduit alors à l’application des règles de la responsabilité pour dommages de travaux
publics.
Question de droit : Quelles sont les règles de responsabilité applicables ?
Madame Théchaud est victime d’un dommage trouvant son origine dans un ouvrage public. Elle peut être
qualifiée d’usager de l’ouvrage public et tiers par rapport au service public des eaux usées.
Le juge applique, dans ce cas, la théorie du défaut d’entretien normal : le défaut d’entretien de l’ouvrage
public est présumé et il appartient à la personne publique de démontrer l’inverse. C’est un régime de
présomption de faute. La victime n’a pas à démontrer une faute de la personne publique, elle doit juste
démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain, et un lien de causalité entre son dommage et le
défaut d’entretien de l’ouvrage public. La personne publique pourra toutefois s’exonérer d’une partie ou
de la totalité de sa responsabilité, si elle démontre une faute de la victime (inattention, imprudence par
exemple ou situation illégitime de la victime) ou un cas de force majeure (fait extérieur, imprévisible et
insurmontable).
Application au cas d’espèce : en l’espèce, il est indiqué que la plaque de verglas s’est formée juste à côté
d’une canalisation d’eaux pluviales qui fuit depuis plusieurs mois. La fuite, qui dure depuis longtemps,
semble donc à l’origine de cette plaque ; il y a donc bien un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Il sera
donc difficile à la commune de démontrer le contraire, et de renverser la présomption de faute à sa
charge. Madame Théchaud subit un dommage sérieux, direct et certain, puisqu’elle subit un préjudice
physique. Il n’y a pas non plus de doute sur le fait que son dommage trouve sa cause dans la fuite, la
plaque de verglas.
En revanche, la commune pourra peut-être faire valoir pour s’exonérer au moins partiellement de sa
responsabilité la faute d’inattention de Madame Théchaud. Elle connaissait très bien la voie publique et
la fuite : elle aurait dû y faire attention. Il pourrait ainsi y avoir un partage de responsabilité décidé par le
juge. La personne responsable devrait rester la commune, car elle ne peut pas opposer le fait du tiers (la
communauté d’agglomération en charge de la gestion des canalisations). En revanche, elle pourra dans
le cadre d’une action récursoire ou d’un appel en garantie se retourner ensuite contre la communauté qui
n’a pas bien entretenu les canalisations.
4) Vacances solidaires à Malo les Bains ?
La commune de Malo les Bains souhaite créer un centre d’accueil pour jeunes sur l’une de ses parcelles,
localisée au bord du littoral, classée zone naturelle sur le plan local d’urbanisme et située sur la bande
littorale des cent mètres. La collectivité dispose pourtant de nombreux terrains à 500 mètres de là, dans les
terres.
La parcelle en question est actuellement destinée à la promenade et à la préservation d’espèces classées.
La commune peut-elle construire librement ce bâtiment ? Pourrait-elle être contrainte de démolir
l’ensemble ? Eclairez le maire de la commune.
Réponse
Il faut rappeler la définition de l’ouvrage public : il s’agit d’un ouvrage immobilier, aménagé par l’homme,
appartenant ici à une personne publique (commune) et pour le coup affecté à une utilité publique ; ici
plus précisément un service public d’accueil pour les jeunes. D’où cet ensemble immobilier constitue un
ouvrage public et non un ouvrage privé.
Il faut ensuite vérifier si cet ouvrage peut être construit légalement. Il apparait à la lecture du cas pratique
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
que cet ouvrage devrait être construit sur une zone classée zone naturelle et qui plus est sur la bande
littorale des cent mètres (domaine public naturel). Il n’est donc pas possible de construire un tel centre
sans méconnaitre les règles du droit de l’urbanisme. L’ouvrage serait ainsi entaché d’une illégalité
interne.
La question qui se pose est celle de savoir si la commune pourrait être contrainte de démolir
l’ensemble de l’ouvrage illégalement construit ?
Il faut tout d’abord identifier le juge compétent. La compétence du juge pour prononcer son éventuelle
démolition est bien le juge administratif, car il faut appliquer ici la jurisprudence du TC 6 mai 2002 Binet
C./ EDF, (extraits) : « Considérant que des conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer
un ouvrage public, et le cas échéant à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression, relèvent par
nature de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer
dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire
aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au
fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de
l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose
l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ».
Il n’y a pas de voie de fait. Il revient donc au juge administratif de se prononcer sur la destruction de cet
ouvrage public dans le cadre d’un recours qui est un recours de plein contentieux, qui lui donne le pouvoir
d’enjoindre la démolition de l’ouvrage si les conditions de sa destruction sont réunies, sans forcément
être saisi de conclusions en ce sens (CE 29 novembre 2019, Ecole nationale des Beaux-Arts). Avant cet
arrêt, le juge s’estimait saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de démolir l’ouvrage
public puis enjoignait à l’administration de démolir l’ouvrage si les conditions de sa destruction étaient
réunies et s’il était saisi de conclusions en ce sens.
D’où une nouvelle question de droit : cet ouvrage public pourrait-il être détruit et à quelles conditions ?
Rappel de la règle de droit : le principe d’intangibilité de l’ouvrage public qui interdit la destruction d’un
ouvrage public illégal mais qui a été atténué par l’arrêt du CE 29 janvier 2003, Syndicat départemental de
l’électricité et du gaz des Alpes maritimes et Commune de Clans.
Il faut rappeler le considérant de principe de l’arrêt : « Lorsque le juge administratif est saisi d'une
demande tendant à l’ annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public
dont une décision juridictionnelle a jugé qu’il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit
ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la
date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard
notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative,
il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de
l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant,
pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition
pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une
atteinte excessive à l'intérêt général »
Application au cas d’espèce :
1°) La première étape est celle de savoir si l’illégalité qui entache la construction de l’ouvrage est
régularisable ou non.
En l’espèce, l’illégalité n’est pas régularisable, car l’ouvrage public a été construit en violation des règles
de l’urbanisme qui protègent les espaces naturels et interdisent, dans ces espaces, toute construction qui
ne serait pas légère. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la construction n’étant pas légère. Par conséquent, il
est tout simplement impossible de reconstruire le même ouvrage à cet emplacement, l’illégalité n’est pas
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne
régularisable. C’est une illégalité interne et non externe. Seules les illégalités de procédure et de forme
sont régularisables.
2°) Comme l’illégalité n’est pas régularisable, le juge administratif ne pourra pas proposer à
l’administration de régulariser l’ouvrage public. Il doit alors dans un second temps opérer un contrôle du
bilan : c’est-à-dire mettre en balance les avantages et les inconvénients respectifs de la présence de
l’ouvrage public. Et il prononcera la démolition de l’ouvrage au terme de ce bilan que si « la démolition
n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général »
Application au cas d’espèce : En l’espèce, les avantages de l’ouvrage consistent dans l’accueil et la prise
en charge des enfants et des jeunes. Les inconvénients de la présence de l’ouvrage sont les atteintes
portées à l’environnement, au domaine public maritime naturel inconstructible, et atteintes portées aux
loisirs (promenade). La destruction de l’ouvrage emporterait peu de conséquences négatives dans la
mesure où il est précisé dans le cas que la commune dispose de nombreux terrains qui lui permettraient
de réaliser son projet autrement.
Donc solution : le juge pourrait ordonner la démolition de l’ouvrage puisqu’en l’espèce, l’atteinte portée
à l’affectation de l’ouvrage public, c’est-à-dire l’accueil et la prise en charge des jeunes, n’est pas excessive
au regard de la protection de l’environnement et des loisirs. Il faut donc conseiller au maire d’envisager
de construire ce centre sur un autre terrain appartenant à la commune. Cela sera moins risqué en termes
contentieux.
Droit administratif des biens – Licence 3 en droit – S3 - BL n° 4
Année universitaire 2022/2023
Vous aimerez peut-être aussi
- Copie de 412818416 Virement BNPDocument1 pageCopie de 412818416 Virement BNPAnne Marie HoaroPas encore d'évaluation
- GUID-GIR-CT Assiette 1er PallierDocument42 pagesGUID-GIR-CT Assiette 1er PallierBti Sam100% (2)
- FactureDocument1 pageFacturefarda.2055Pas encore d'évaluation
- Fiche de Révision Droit Administratif PDFDocument26 pagesFiche de Révision Droit Administratif PDFLucie Taillebois-BertinPas encore d'évaluation
- Correction Séance 4Document9 pagesCorrection Séance 4Laurie MrtPas encore d'évaluation
- Jurisprudences S4 - Droit AdministratifDocument36 pagesJurisprudences S4 - Droit AdministratifTRADUCTIONS ASSERMENTEESPas encore d'évaluation
- Contrôle Juridictionnel de LDocument4 pagesContrôle Juridictionnel de LBruno Acézat-Pellicer100% (3)
- Jurisprudence AdministrativeDocument12 pagesJurisprudence AdministrativeSophie100% (2)
- JP DaDocument16 pagesJP DaVictorPas encore d'évaluation
- Devis Descriptif DaoDocument57 pagesDevis Descriptif Daolimmoud2j100% (1)
- Bulletin de Liaison 3Document9 pagesBulletin de Liaison 3clavoie2103Pas encore d'évaluation
- Bulletin de Liaison 5Document7 pagesBulletin de Liaison 5clavoie2103Pas encore d'évaluation
- Canevas 3-2Document47 pagesCanevas 3-2abdouyayemahazatou582Pas encore d'évaluation
- Responsabilité (Administrative) Pour Des Dommages Des Travaux PublicsDocument35 pagesResponsabilité (Administrative) Pour Des Dommages Des Travaux PublicsSophie100% (1)
- Exposé ADM Ogn-3Document9 pagesExposé ADM Ogn-3saidouhabibou1122Pas encore d'évaluation
- Cas Pratique Responsabilité Pour Faute de L'administrationDocument7 pagesCas Pratique Responsabilité Pour Faute de L'administrationNaomi ZakpaPas encore d'évaluation
- Exposé ADM Ogn-1Document9 pagesExposé ADM Ogn-1saidouhabibou1122Pas encore d'évaluation
- TD 3 Droit Administratif ÉtudiantsDocument6 pagesTD 3 Droit Administratif ÉtudiantsYoussouf MAIGAPas encore d'évaluation
- Les Travaux PublicsDocument7 pagesLes Travaux Publicstoubibred18Pas encore d'évaluation
- Ch04 - CoursDocument10 pagesCh04 - CourshamdibaghdadiPas encore d'évaluation
- Droit Des Contrats AdministratifsDocument8 pagesDroit Des Contrats AdministratifsEtienne S. CotPas encore d'évaluation
- Cas Pratique La Responsabilit Du Fait Des ChosesDocument15 pagesCas Pratique La Responsabilit Du Fait Des ChosesJros Premier AbessoloPas encore d'évaluation
- Subiecte Drept Roman 2011Document7 pagesSubiecte Drept Roman 2011Raluca MateiPas encore d'évaluation
- Droit Administratif Des BiensDocument98 pagesDroit Administratif Des BiensSophie100% (1)
- Coloc 2111-8779 2017 Num 37 1 3093Document5 pagesColoc 2111-8779 2017 Num 37 1 3093Ervyn C.Pas encore d'évaluation
- L'expropriationDocument12 pagesL'expropriationXavier BrunetierePas encore d'évaluation
- Droit AdministratifDocument7 pagesDroit Administratifadele.gilletPas encore d'évaluation
- G Pellissier, L'injonction Dans La Responsabilité AdministrayiveDocument27 pagesG Pellissier, L'injonction Dans La Responsabilité AdministrayivelaureineerikaPas encore d'évaluation
- Arret BlancoDocument9 pagesArret BlancoTidiane Wagué Soumaila (Tidi)Pas encore d'évaluation
- Droit Administratif 02Document5 pagesDroit Administratif 02Othniel GbaliaPas encore d'évaluation
- Cours Sur Les Sanctions en Droit de L'urbanismeDocument3 pagesCours Sur Les Sanctions en Droit de L'urbanismediacrefelice100% (1)
- Droit de La Construction CiDocument61 pagesDroit de La Construction CiBijio FreddPas encore d'évaluation
- L'expropriation Pour Cause D'utilité PubliqueDocument4 pagesL'expropriation Pour Cause D'utilité PubliqueMaurrel NdongPas encore d'évaluation
- Problemes de Droit en Droit AdministratifDocument10 pagesProblemes de Droit en Droit AdministratifDesnosassi08Pas encore d'évaluation
- Fiche-Propriété PubliqueDocument32 pagesFiche-Propriété Publiquemohamedrazin.chekroudPas encore d'évaluation
- Fiches de Revision de Fou Furieux (Récupération Automatique)Document17 pagesFiches de Revision de Fou Furieux (Récupération Automatique)Marylou CharlotPas encore d'évaluation
- Cas Pratique de Droit Administratif Avec La Police AdministrativeDocument2 pagesCas Pratique de Droit Administratif Avec La Police Administrativeguyherve andrianantenainaPas encore d'évaluation
- Correction TD9Document5 pagesCorrection TD9Pixelrex XenosPas encore d'évaluation
- DROITDocument6 pagesDROITjadakhmiss30Pas encore d'évaluation
- Arrêts Pour Le Service PublicDocument7 pagesArrêts Pour Le Service Publicpapapoum100% (1)
- Guindo Seydou - Expose - Regime Domanial IvoirienDocument17 pagesGuindo Seydou - Expose - Regime Domanial IvoirienSeydou GUINDO100% (5)
- Droit Administratif 2Document35 pagesDroit Administratif 2ASSOGBA Dègninou CarlosPas encore d'évaluation
- CoproDocument39 pagesCoproofib.videos2Pas encore d'évaluation
- Controle Des Mesures de Police AdministrativeDocument5 pagesControle Des Mesures de Police AdministrativefatouPas encore d'évaluation
- Dame NGUE SIPORADocument2 pagesDame NGUE SIPORAKertis BertrandPas encore d'évaluation
- Le Trouble Anormal de Voisinage - Éléments Constitutifs Et Régime JuridiqueDocument4 pagesLe Trouble Anormal de Voisinage - Éléments Constitutifs Et Régime Juridiqueh nPas encore d'évaluation
- activité ch9Document4 pagesactivité ch9loan.tisserandPas encore d'évaluation
- Arrets Da Semestre 2Document7 pagesArrets Da Semestre 2Francia SuzyPas encore d'évaluation
- Droit Des Contrats PublicsDocument14 pagesDroit Des Contrats Publicshb620Pas encore d'évaluation
- PGDCA Cas PratiquesDocument9 pagesPGDCA Cas PratiquesLenuta SeremetPas encore d'évaluation
- Fiche Responsabilité Du Fait Des ChosesDocument4 pagesFiche Responsabilité Du Fait Des ChosesSwannPas encore d'évaluation
- Droit Des Obligations S2Document46 pagesDroit Des Obligations S2TinkietePas encore d'évaluation
- Dadm CM1Document39 pagesDadm CM1APas encore d'évaluation
- Titre III. Les Travaux PublicsDocument15 pagesTitre III. Les Travaux PublicsGueye MaguiPas encore d'évaluation
- Fiche 6 Droit Administratif L2Document4 pagesFiche 6 Droit Administratif L2bouferda4Pas encore d'évaluation
- FICHE 3 Et 4Document8 pagesFICHE 3 Et 4gqztd8q2jyPas encore d'évaluation
- Fiches Arrets DABDocument13 pagesFiches Arrets DABjephte NonouPas encore d'évaluation
- La Police AdministrativeDocument9 pagesLa Police AdministrativeMehdiChadliPas encore d'évaluation
- Dab ArrêtDocument9 pagesDab Arrêtsbqj9hch2dPas encore d'évaluation
- L - Affaire Du SiècleDocument7 pagesL - Affaire Du SiècleggggPas encore d'évaluation
- AdministratifDocument144 pagesAdministratifds5rfypsj8Pas encore d'évaluation
- Incendies de conduits de cheminée: Devoirs et DroitsD'EverandIncendies de conduits de cheminée: Devoirs et DroitsPas encore d'évaluation
- Loi sur la continuité des entreprises en pratique : regards croisés, ajustements et bilanD'EverandLoi sur la continuité des entreprises en pratique : regards croisés, ajustements et bilanPas encore d'évaluation
- Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)D'EverandProcédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)Pas encore d'évaluation
- Retranscription DS2 - Format WordDocument105 pagesRetranscription DS2 - Format Wordclavoie2103Pas encore d'évaluation
- IHD Bulletin de Liaison 1Document3 pagesIHD Bulletin de Liaison 1clavoie2103Pas encore d'évaluation
- Velo Ville Femme 26p Acier Haut Basic SportDocument1 pageVelo Ville Femme 26p Acier Haut Basic Sportclavoie2103Pas encore d'évaluation
- L3 - S5 - DS1 - Document de Travail - 2324Document234 pagesL3 - S5 - DS1 - Document de Travail - 2324clavoie2103Pas encore d'évaluation
- 1592 PDFDocument24 pages1592 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Senegal - Avantages en NatureDocument1 pageSenegal - Avantages en Natureousmane mbaye100% (2)
- Actes Schema A Partir Acte LegislatifDocument4 pagesActes Schema A Partir Acte LegislatifchakirboukhorssaPas encore d'évaluation
- Annales Concours Cycle D'expertise Comptable - Groupe ISCAEDocument386 pagesAnnales Concours Cycle D'expertise Comptable - Groupe ISCAEHafsa MahradyPas encore d'évaluation
- Canevas Des Epreuves BTS Secteur TertiaireDocument527 pagesCanevas Des Epreuves BTS Secteur Tertiairembotchack950Pas encore d'évaluation
- SUJET TRAITE DIE Responsabilité Environnementale Et RèglementationDocument25 pagesSUJET TRAITE DIE Responsabilité Environnementale Et RèglementationmamadouPas encore d'évaluation
- 27116NCJRSDocument103 pages27116NCJRSkabungulumashimangoPas encore d'évaluation
- Demande D'attribution D'un Nouveau Code Secret' PourDocument2 pagesDemande D'attribution D'un Nouveau Code Secret' PourBzne Abhan100% (3)
- Le Modèle IS-LM-BB, La Structure Et La Politique ÉconomiqueDocument2 pagesLe Modèle IS-LM-BB, La Structure Et La Politique Économiquea1z2e3r4t5y6u7bPas encore d'évaluation
- Projet Cafétéria GKDocument109 pagesProjet Cafétéria GKgaudenskayPas encore d'évaluation
- TapageAlgerie 1pageDocument20 pagesTapageAlgerie 1pageSali LeaderPas encore d'évaluation
- Bob Fauve Patron Us LetterDocument4 pagesBob Fauve Patron Us LetteryasounehalPas encore d'évaluation
- 914 PDFDocument28 pages914 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Cloud StackDocument14 pagesCloud StackImen Ben Massaoud100% (1)
- CourrierDocument2 pagesCourrierakoredebakary13Pas encore d'évaluation
- Fiche 2 DPFDocument10 pagesFiche 2 DPFo5955178Pas encore d'évaluation
- La Facture 2021Document84 pagesLa Facture 2021elwahabiferdawsPas encore d'évaluation
- WN HOLDING - Actes Du 01-09-2021Document25 pagesWN HOLDING - Actes Du 01-09-2021Abdelhadi KaoutiPas encore d'évaluation
- Description de L'afrique Contenant (... ) Dapper Olfert Bpt6k104385vDocument604 pagesDescription de L'afrique Contenant (... ) Dapper Olfert Bpt6k104385vSab NaPas encore d'évaluation
- Initiation Au Management de La GRHDocument56 pagesInitiation Au Management de La GRHjacquesaimegueiPas encore d'évaluation
- Crise de La Dette Publique Grecque - Wikipédia PDFDocument188 pagesCrise de La Dette Publique Grecque - Wikipédia PDFJonathan DagoPas encore d'évaluation
- La Société AnonymeDocument36 pagesLa Société Anonymesr9ofzki100% (1)
- Christophe Bourseiller Ultra Gauche PDFDocument22 pagesChristophe Bourseiller Ultra Gauche PDFAnonymous va7umdWyh100% (1)
- Loi Eau Texte Juridique PDFDocument5 pagesLoi Eau Texte Juridique PDFMouhameth DIOPPas encore d'évaluation
- Glossaire Des Termes FinanciersDocument4 pagesGlossaire Des Termes FinanciersvatacfilePas encore d'évaluation
- 1° Partie GRH 3Document5 pages1° Partie GRH 3Taha ZahiriPas encore d'évaluation