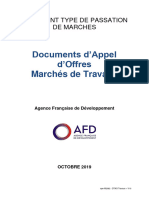Rapport GOUDOU Roger - Compressed
Rapport GOUDOU Roger - Compressed
Transféré par
Abdul KasamiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rapport GOUDOU Roger - Compressed
Rapport GOUDOU Roger - Compressed
Transféré par
Abdul KasamiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Rapport GOUDOU Roger - Compressed
Rapport GOUDOU Roger - Compressed
Transféré par
Abdul KasamiDroits d'auteur :
Formats disponibles
REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(MESRS)
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI
OPTION : GENIE CILVIL
RAPPORT DE FIN DE STAGE POUR L’OBTENTION DE
LA LICENCE PROFESSIONNELLE
« Travaux de Construction du Collecteur P
d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième
Arrondissement de Cotonou »
Réalisé et soutenu par :
GOUDOU ROGER
Sous la Direction de :
MAITRE DE MEMOIRE TUTEUR DE STAGE
Dr Ing. Taofic BACHAROU M. oumar camara
Enseignant chercheur à l’EPAC Ingénieur Topographe
Année académique : 2009 – 2010
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Dédicaces
A mon DIEU,
Loué soit ton nom SEIGNEUR pour l’accomplissement de ce travail qui n’est
rien d’autre que la manifestation de ton amour. Sois béni à jamais !
A mon père à titre posthume,
Tu as su guider mes premiers pas vers l’école. Du haut des cieux, regarde ce
travail comme le fruit de tes conseils. Que Dieu t’accorde la lumière éternelle !
A vous braves femmes de mon père,
Je ne saurai jamais vous remercier assez pour ce que vous êtes et faites encore
pour moi. Je vous dédie donc ce travail pour que vous sachiez que je vous aime
et je prie DIEU pour qu’il vous accorde longue vie afin que vous puissiez jouir
des fruits de vos sacrifices.
A mes frères et sœurs, leurs conjoints et conjointes,
Dans les moments difficiles que j’ai traversés, vous n’avez cessé de
m’encourager, de me manifester votre indéfectible soutien. Sachez que je vous
aime beaucoup.
A toi Simon GOUDOU,
Tu as su me conseiller, soutenir aussi bien moralement que financièrement dans
mes moments difficiles. Regarde ce travail comme le fruit, la récompense de tes
multiples conseils. Que Dieu le Père te bénisse et te comble de grâces.
A mes neveux et nièces,
Sachez que vous représentez des joyaux à mes yeux. Recevez ici l’expression de
la profonde affection que j’ai pour vous. Que Dieu vous bénisse !
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU i
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
A toi ma bien aimée,
Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je te dédie ce travail en
témoignage de ma profonde gratitude.
A tous mes amis (es) et camarades,
Vous méritez de partager avec moi la joie de voir ce travail achevé car votre
soutien m’a été d’un grand réconfort au cours de sa rédaction.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU ii
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
REMERCIEMENTS
Ce travail, n’a pu être possible que grâce à Dieu, le tout puissant, qui nous a aidé jusqu’à la
fin de notre formation ; nous le remercions infiniment et le prions à jamais de guider
perpétuellement nos pas dans le bon chemin.
Nous tenons à adresser nos sincères remerciement à :
Tout le personnel administratif de l’école polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC)
plus précisément au personnel du centre autonome de perfectionnement qui n’a ménagé
aucun effort pour assurer un cadre favorable à nos études et qui a été à notre chevet
durant toute la formation, en particulier :
Au Professeur FELICIEN AVLESSY directeur de l’Ecole Polytechnique
D’Abomey Calavi.
Au Docteur Christophe AWANTO directeur du Centre Autonome De
Perfectionnement (CAP)
A mon maître de mémoire, le Docteur Taofic BACHAROU qui malgré ses multiples
occupations s’est donné du temps de m’assister durant la rédaction de ce document.
Recevez ici ma profonde gratitude.
A nos chers professeurs pour tous les sacrifices consentis durant notre formation, en
particulier :
Professeur Gérard DEGAN, Responsable de l’Ecole Doctorale de l’EPAC
Monsieur François de Paule CODO, Ing. Master of Sc., PhD ; Professeur à
l’EPAC ;
Monsieur Gérard GBAGUIDI AÏSSE, Dr. Ing en Génie Civil Maître Assistant des
Universités, Professeur à l’EPAC ;
Monsieur ZEVOUNOU Crépin Dr. Enseignant à l’EPAC Maître assistant des
Universités ;
Monsieur Mohamed GIBIGAYE, Dr Ing en Génie Civil, Maître Assistant des
Universités, Professeur à l’EPAC ;
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU iii
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Monsieur Léopold DEGBEGNON, Dr Ing en Géodésie, Maître Assistant des
Universités, Professeur à l’EPAC ;
Monsieur AINA Martin, Dr. Maître Assistant des Universités Enseignant à
l’EPAC ;
Monsieur Mathias SAVY, Dr Ing en Génie Civil, Maître Assistant des Universités,
Professeur à l’EPAC ;
Monsieur Adolphe TCHEHOUALI, Dr. Ing en Génie Civil, Maître Assistant des
Universités, Professeur à l’EPAC ;
Monsieur KOWANOU Houénou Ing. Enseignant à l’EPAC ;
Nos remerciements vont aussi à l’endroit de Monsieur BOCOVE MARCELIN,
Directeur Technique de L’AGETUR, qui, malgré ses multiples occupations, s’est donné
du temps pour nous orienter et nous offrir un stage en excellente adéquation avec notre
domaine de compétence.
Enfin, nous remercions également l’Entreprise CGE dans laquelle nous avons
effectué notre stage à travers son personnel :
Monsieur ADAMA THIOMBIANO, Directeur des Travaux de L’Entreprise CGE
Notre tuteur de stage Monsieur CAMARA OUMAR Ingénieur Topographe
conducteur des travaux de l’entreprise CGE qui, quand bien même tenu par le temps,
trouvait toujours le temps nécessaire pour dénouer avec nous les difficultés auxquelles
nous nous confrontions. De ce fait, qu’il reçoive à travers ce rapport l’expression de
notre profonde gratitude.
Monsieur GNIMAVO MODESTE, chef chantier chargé du terrassement
Monsieur RODOLPHE, chef chantier chargé du Béton Armé.
Monsieur HOUINDO CHRISTIAN, Ingénieur de conception en Génie Civil, chef
de Mission du Bureau d’Etudes AUXI-BTP
A tous les membres de mon jury et à son président pour l’honneur que vous me faites
en acceptant de lire ce rapport, de l’apprécier et d’y apporter votre précieux savoir
indispensable à l’amélioration du travail malgré vos multiples occupations.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU iv
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
SOMMAIRE
I. Dédicaces
II. Remerciements
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE
D’ACCUEIL
I. Historique et situation géographique de l’entreprise
II. Domaine et type d’intervention
III. Organigramme
DEUXIEME PARTIE : LES TRAVAUX DU CHANTIER
I. Présentation de la zone de projet
II. Présentation du projet
Description du projet
Rappel des résultats de l’Avant-projet Sommaire (APS)
Résultats de restitution sur l’Avant-projet Sommaire et orientation
des études de l’Avant-projet Détaillé (APD)
III. Méthodologie adoptée
IV. Travaux topographiques
V. Les travaux géotechniques
VI. Modes d’exécution des travaux
TROISIEME PARTIE : ETABLISSEMENT DES DEBOURSES SECS
DES MATERIAUX
I. Débourses secs des collecteurs de sections 16.80*14*1.40
II. Estimation du coût des travaux
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU v
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
QUATRIEME PARTIE : DIFFICULTES ET SUGGESIONS
I. Difficultés
II. Suggestions
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU vi
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
LISTE DES FIGURES
Figure N°1 : Plan de Situation de l’entreprise CGE
Figure N°2 : Organigramme de l’entreprise CGE
Figure 3 : Coupe transversale du Collecteur
Figure 4 : Analyse des charges (Canal Vide)
Figure 5 : Analyse des charges
LISTE DES PHOTOS
Photo n°1 : vue de la façade principale de l’entreprise
Photo n°02 : vue de l’extraction de la boue sur l’emprise du collecteur
Photo n° 03: vue du tapis drainant
Photo n°04: vue du coulage du béton de propreté
Photo n°05 : vue du ferraillage du radier
Photo n° 06 : coulage de la voile
Photo n°07 : vue du coffrage de la bêche
Photo n°08: Vue du ferraillage de la voile
Photo n°9 : Eprouvette de béton pour les essais
LISTE DES TABLEAUX
Tableau N°1 : Détermination de volume des différentes parties du collecteur
Tableau N°2: détermination des quantités des matériaux
Tableau N°3 : Détermination des quantités d’aciers
Tableau N°4 : déboursé sec d’un mètre linéaire de collecteur de dimension
16,80 x 14 x1, 40
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU vii
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
DEFINITION DES SIGLES ET ACRONYMES
AGETUR : AGence d’Exécution des Travaux URbains
AID : Association Internationale de Développement
Alt : Altitude
APD : Avant Projet Détaillé
APS : Avant Projet Sommaire
CFE : Côte Fil d’Eau
CGE : Compagnie Générale des Entreprises
CNERTP : Centre National d’Etudes et de Recherche en Travaux Public
CTN : Cote Terrain Naturel
Lar : lecture arrière
Lev : Lecture avant
PD : Pénétration Dynamique
RN : Repère de Nivellement
SC : Sondage Carotté
TDR : Termes De Références
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU viii
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
INTRODUCTION GENERALE
L’émergence d’une nation passe inévitablement par la réalisation des
infrastructures telles que les travaux d’assainissement, la réalisation d’ouvrages
à usage éducatif, sanitaire, commercial et social. La construction de ces
différents types d’ouvrages fait donc obligatoirement appel à des hommes du
génie civil bien formés sur le plan théorique et pratique. C’est dans cette optique
que les autorités en charge de la licence professionnelle ont prévu un stage
pratique de fin de formation en entreprise, dans un bureau d’études ou dans un
cabinet d’architecture afin d’accompagner les cours théoriques de pratiques
fiables afin que l’étudiant s’imprègne des réalités de la vie professionnelle.
Le stage permet également à l’étudiant de parfaire son savoir-faire et de
comprendre les différents mécanismes des études, des conceptions et des
réalisations des travaux qui sont les piliers de son métier. C’est ce qui explique
notre séjour dans l’entreprise C.G.E. (COMPAGNIE GENERALE DES
ENTREPRISES) où nous avions effectué notre stage pratique. Le présent
rapport rend compte des travaux suivis et des différentes activités que nous
avons menées au cours de ce stage d’une durée de trois mois allant du 04 juillet
2010 au 04 octobre 2010.
Notre rapport se consacrera aux divers travaux de réalisation d’un chef
d’œuvre d’assainissement qui nous a inspiré et que nous avions libellé sous le
thème : «Travaux de Construction du Collecteur P d’assainissement d’eau
pluviale dans le 10ième Arrondissement de Cotonou».
Nous essayerons de vous présenter dans ce document ce que nous avons
pu retenir au sein de cette entreprise lors de la Réalisation des Travaux de
Construction du Collecteur P01.
Le présent rapport s’articulera donc autour de quatre (04) parties.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 1
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Dans la première partie, nous présenterons la structure d’accueil, à
travers son historique et sa situation géographique, son domaine, son type
d’intervention et la manière dont l’entreprise est structurée.
Dans la seconde partie, après avoir présenté la zone de travail et le
projet proprement dit le document se consacrera à la méthodologie adoptée, aux
travaux topographiques, les travaux geotechniques et au mode d’exécution des
travaux.
La troisième partie de notre document se penchera sur les éléments
constitutifs du prix unitaire de l’ouvrage et du cout d’investissement.
Quant à la quatrième partie, elle s’intéressera aux difficultés
rencontrées sur le terrain et à nos suggestions.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 2
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE
LA STRUCTURE D’ACCUEIL
I. HISTORIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DE
L’ENTREPRISE
A- Historique
Créée en 1995 au BURKINA-FASO, l’entreprise dénommée Compagnie
Générale des Entreprises (CGE) a son siège social à l’avenue Babangida, rue
2946 BP : 1337 Ouagadougou Burkina-Faso. De par son dynamisme, son
savoir-faire et sa rigueur dans la réalisation des travaux de génie civil, elle a
voulu contribuer au développement des autres pays de la sous-région en
installant un peu partout dans l’Afrique de l’ouest des entités. Ainsi l’une des
entités a vu le jour au BENIN et a son bureau à Ste Rita carré 1367 maisons
POUMANGUE Gilbert 01BP 3922 Cotonou 01.
Photo n°1 : vue de la façade principale de l’entreprise
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 3
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
B- Situation géographique
Figure N°1 : Plan de Situation de l’entreprise CGE
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 4
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
II. DOMAINE ET TYPE D’INTERVENTION
A- Domaines d’intervention
La Compagnie Générale des Entreprises est spécialisée dans la
construction des bâtiments, des infrastructures de tous genres telles que les
infrastructures scolaires, industrielles, les hôtels et les habitations. Elle est
également spécialisée dans la construction des infrastructures de transport
(routes et ouvrages d’art, aérodrome etc.)
Type d’Intervention
La Compagnie Générale des Entreprises s’occupe également de:
Etude générale : enquêtes, études économiques, faisabilité,
planification etc.
Etudes techniques : préliminaires et détaillées avec élaboration des
plans d’exécution, bâtiments, routes et ouvrages d’art, aménagement,
topographie etc.
Contrôle et surveillance des travaux : contrôle et suivi permanent de
la qualité de l’exécution des de bâtiments, routes et ouvrages d’art.
Expertises : de biens meubles et immeubles, industriels pour la
dénomination de la valeur vénale, expertise de sinistres en vue de
dédommagements par les compagnies d’assurances, expertises judiciaires.
Etudes environnementales : gestion environnementale ; gestion des
ressources naturelles ; modération des ateliers.
Assistance et conseils : élaboration des termes de références,
contrats, évaluation des projets, surveillance et contrôle techniques, assistance
technique, coordination, post évaluation, expertise etc.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 5
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
III. ORGANIGRAMME
Directeur
des
travaux
Assistant
technique
Chef Chef Conducteur Chef
personnel comptable des travaux garage
Chef Chef Chef chantier Chef
approvisionnement Topographe chargé du B.A. chantier
terrassement
Chef Chef
Topographe
commis terrassement
Figure N°2 : Organigramme de l’entreprise CGE
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 6
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
DEUXIEME PARTIE : LES TRAVAUX DU
CHANTIER
I. PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET
De par sa position géographique sur un cordon littoral entre le lac Nokoué
et l’océan atlantique, la ville de Cotonou est construite sur des terrains
essentiellement sablonneux. La ville présente dans l’ensemble un relief assez
plat, dépourvu de point de vue hydraulique de toute déclivité motrice. Les côtes
du terrain oscillent entre 1.02 et 6.52 par rapport au zéro hydraulique. La partie
de la ville édifiée sur le littoral est la plus élevée et les côtes varient autour de
5.02 mètres. Mais au nord de cette zone la ville est parsemée de nombreuses
dépressions, généralement allongée en direction ouest-est. La côte moyenne de
cette partie est de 3.52 m environ. Ainsi le relief de la ville, caractérisé par
l’absence de toute déclivité, n’est pas favorable à l’écoulement des eaux de
pluie. Il favorise plutôt la stagnation et l’infiltration. Le collecteur étudié est
localisé au Nord Est de la ville de Cotonou, une zone très marécageuse. Cette
zone est classée parmi les plus basses de la ville. Le collecteur débute du
quartier de sainte Rita aux abords immédiats des caniveaux existants, et il
aboutit la digue de Fifadji par un tronçon en coude avant d’échouer dans la
lagune de Vossa où il a son exutoire. Dans la plupart de ces quartiers, la
profondeur de la nappe phréatique dépasse rarement 3 mètres.
II. PRESENTATION DU PROJET
Après la réalisation du projet de gestion urbaine décentralisé (PGUD1) et
dans le soucis de pallier aux problèmes d’inondation, de pollution et
d’amélioration des conditions socio-économiques des habitants du 10ème
arrondissement de la ville de Cotonou, l’Etat béninois a initié un second projet
intitulé : Projet de Gestion Urbaine Décentralisé (PGUD2).
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 7
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Avec la paupérisation grandissante due à l’exode rural, les exutoires
d’eaux de ruissellement sont aujourd’hui transformés en quartier de ville. Tel est
le cas de certaines zones des quartiers Sainte Rita et Vêdoko. Du coup, ces
populations exercent une pression sans cesse grandissante sur la nature et se
retrouvent confrontées à d’innombrables problèmes de pollutions, d’inondation
et à la stagnation des flaques d’eau qui couvrent par endroit les tas d’ordures et
les marécages. Cet état de chose engendre des problèmes de santé tels que le
paludisme, les parasitoses mais aussi le choléra et d’autres maladies diarrhéiques
dont les habitants sont malheureusement victimes.
La République du Bénin a donc obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (AID) ; ce financement servira à la réalisation
des travaux de construction d’ouvrage de collecte et drainage des eaux de
ruissellement à Cotonou lot COLP 01.
Les travaux sont financés 85% par l’AID, à 10 % par le budget national, à 5%
par la mairie de Cotonou.
L’entreprise CGE dans laquelle notre stage dans laquelle nous avons
effectué notre stage, a été déclarée adjudicataire pour le lot COLP 01.
Le présent projet des travaux de construction de collecteurs
d’assainissement pluviale à Cotonou dessert le 10ème arrondissement de la ville
de Cotonou. Ce collecteur est linéaire d’environ 800 m dont 400 m avec
protection en gabion, 277 m en Béton Armé (BA) et le reste est une fosse sans
protection pour permettre le drainage des eaux vers la lagune de Vossa. Il est à
noter qu’une digue sera réalisée au niveau du marché de Vossa. Afin de
permettre à la population d’exploiter ce réseau routier, il est aménagé une voie
en sable silteux à 11 m du bord extérieur du collecteur et ayant une largeur de
4 ,5 m.
La Mairie de Cotonou est le maître d’ouvrage et AGETUR (l’AGence
d’Exécution des Travaux Urbains) assure le rôle de maître d’ouvrage délégué;
l’AGETUR a confié l’exécution du lot COLP 01 à l’Entreprise CGE
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 8
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
(Compagnie Générale des Entreprise) puis la surveillance et le contrôle au
bureau d’études AUXI- BTP.
La qualité des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ont été
confiées au le Centre National d’Essai et de Recherche en Travaux Publique
(CNERTP). Ce lot dont nous avons suivi l’exécution comprend :
la réalisation du collecteur de forme trapézoïdale en béton armé d’environ
277 m avec 14 m pour la largeur au fond et 1,40 m de hauteur d’eau ou
tirant ;
la réalisation de collecteur de forme trapézoïdale avec protection en
gabion d’environ 400 ml ;
la réalisation de fosse de forme trapézoïdale sans protection d’environ
200ml ;
la réalisation d’un passage pour véhicule d’une largeur de 4,5m ;
la réalisation d’un dalot ;
la pose des gardes corps. ;
Le délai d’exécution du projet est de 18 mois conformément au planning
d’exécution des travaux et la garantie est de 12 mois.
A- Description du projet
L’ouvrage à construire a la forme d’un trapèze et est surmonté d’une
bèche. Il est en béton armé de 15 cm d’épaisseur. Il a une largeur à la base de 14
mètres et une hauteur du trapèze de 1.40 mètre. La hauteur de la bèche varie de
30 à 40 cm. Des drains latéraux sont prévus pour le drainage derrière les parois.
L’aménagement repose sur un remblai hydraulique de 100 mètres de large (50
mètres de chaque côté de l’axe du canal).
Entre le coude et la digue de FIFADJI et au-delà, il s’agit de protéger les
berges avec des matelas de gabion constitués de cailloux emprisonnés dans les
cages en grillage métallique. Les matelas ont une épaisseur de 17 cm environ.
La partie inclinée des matelas forme un ensemble avec le bloc de remblai armé
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 9
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
qui la supporte. La liaison se fait grâce aux armatures encastrées dans le remblai.
Des éléments spéciaux détachables sont prévus pour pouvoir connecter des
caniveaux à amorcer dans le futur sans créer des dommages à la structure mis en
place. L’aménagement prévu pour chaque berge s’appuie sur un remblai
hydraulique de 35 mètre environ de large, en partant de la limite des riverains.
B- Rappel des résultats de l’avant projet sommaire
Les études d’Avant Projet Sommaire (APS) après les différentes
vérifications et études hydrauliques ont donnés les résultats rappelés ci-après :
1. Tracé
Les tracés ainsi retenus sont représentés sur le plan de situation N°
BVP01. Le tracé général tient compte des éléments suivants :
- Les Termes De Références (TDR) et les plans ;
- Les visites de terrains surtout en temps de pluie.
2. Exutoire collecteur
Ce collecteur traverse une zone très marécageuse classée parmi les zones
basses de la ville. La hauteur maximum d’eau dans le canal est fixée à 2.00
mètres. La côte du radier en bout accepte une remontée d’eau de la lagune dans
le collecteur sur une certaine distance pendant les périodes de montée des eaux
de la lagune.
3. Prise en compte des ouvrages existants
L’étude a tenu compte des contraintes ci-après :
- Respect des côtes des collecteurs ou caniveaux existants proximité de
notre ouvrage projeté ;
- Respect des limites imposées par la digue de FIFADJI rehaussée à une
hauteur de 1.00 mètre en année 2000 ;
- Respect de pente minimum et de la vitesse minimale.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 10
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
4. Type de collecteur
Le choix du type caractéristique du collecteur a tenu compte de la
configuration des terrains (côtes générales, les pentes, sol en place), ainsi les
types suivants ont été considérés :
- Poursuivre en collecteur trapézoïdo-rectangulaire l’ouvrage existant en
béton armé pour atteindre le bras primaire principal ;
- Construire le bras primaire principal en collecteur en terre ;
- Construire le bras primaire principal en collecteur sans fond mais avec
des parois en matelas de gabion.
La solution retenue en ce qui concerne le bras primaire principal est celle
des parois en matelas de gabion bien adaptée pour les sols d’assise
compressibles. Des matelas constitués de cages métalliques remplis de cailloux
protègent les berges du canal sans fond. Des dispositions sont prévues pour
éviter le fluage de terre du côté du canal. Le remblai derrière les parois est
constitué de matériaux sélectionnés insensibles à l’eau. Le remplacement des
armatures en treillis est effectué avec de l’acier galvanisé et mis en œuvre par
couches compactes entre les armatures.
C- Résultats de restitution sur l’APS et orientation des études avant
projet détaillé
La séance de restitution et de discutions sur les résultats de l’APS a
abouti sur les observations et contributions ci-après à prendre en compte sur les
études APD :
1. Inclure le rapport du laboratoire (CNERTP) dans le rapport APD
2. Aborder les questions suivantes :
- Justification de l’utilisation de la méthode rationnelle ;
- Entretien (surtout à cause de la largeur de l’ouvrage) et coût ;
- Destination des matériaux non utilisables ;
- Hauteur de purge ;
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 11
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
- Hauteur de remblai ;
- Disponibilité des matériaux de remblai ;
- Disponibilité des matériaux pour la confection des matelas de gabion ;
- Stabilité de la solution gabion dans le temps ;
- Précautions à prendre vis-à-vis de la stabilité de l’ouvrage lors de
l’entretien.
3. Prévoir un système pour retenir le remblai du côté des riverains (muret de
clôture)
4. Tenir compte de l’agressivité des eaux pour les ouvrages en béton armé
(protection des aciers)
5. Prévoir les réservations nécessaires dans les matelas pour pouvoir
connecter des amorces de caniveaux plus tard.
III. TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
Les Travaux Topographiques réalisés sont : l’Implantation et le
Nivellement.
A. Implantation
L’implantation est une opération qui consiste à matérialiser à l’aide de
piquets l’ouvrage à réaliser. Comme travaux d’implantation nous avons :
- L’implantation de l’axe du collecteur ;
- L’implantation des fouilles ;
- La réimplantation de l’axe du collecteur ;
- L’implantation du collecteur ;
- L’implantation des Voiles ;
Implantation de l’axe du collecteur
Pour implanter l’axe du collecteur un travail préliminaire a été réalisé. Ce
travail consiste à déterminer toutes les coordonnées des points de profils à l’axe.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 12
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
A l’aide de la station totale TS- 06, les travaux ont été simplifiés. L’implantation
se fait comme suit :
- Nous insérons les coordonnées du point de station de l’appareil puis les
coordonnées du point à implanter.
- A l’aide de la touche F2 de la station totale nous obtenons le gisement et
la distance à laquelle le point doit être stationné. Nous tournons le théodolite
vers la droite jusqu’à l’obtention de la valeur du gisement indiqué.
- En regardant dans la lunette de l’appareil, nous visons le réflecteur tenu
par l’ouvrier.
- A l’aide des mouvements de va-et-vient de l’ouvrier dirigé par
l’opérateur, nous implantons le point à la distance indiquée par la station totale.
- Nous fixons un piquet sur ce point et nous le peignons en blanc pour ne
pas le confondre avec les piquets des ferrailleurs.
Implantation des fouilles
L’implantation des fouilles consiste à délimiter la zone des fouilles en vue
de réaliser la fouille. Pour ce faire, nous insérons les coordonnées des points
fond de fouille dans la station totale. Mais au préalable nous déterminons les
coordonnées.
Avec la calculatrice programmable:
- Insérer les coordonnées du point au profil à l’axe considéré du
collecteur ;
- Puis après le gisement du profil à droite qui a une valeur de 297,229 gr et
aussi la distance du point dont nous voulons déterminer le gisement ;
- Suite à ces opérations, la calculatrice nous donne les coordonnées X, Y,
du point situé à 7m du point à l’axe du profil du collecteur à droite. La
même opération se répète pour l’obtention des coordonnés à gauche, mais
cette fois ci nous retranchons 200 gr à la valeur 297,229 gr et
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 13
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
l’implantation se fait suivant la même procédure que l’implantation de
l’axe du collecteur.
Réimplantation de l’axe du collecteur
Nous procédons à la réimplantation des piquets d’axe du collecteur dans
les fouilles puisqu’ils ont été détruits lors de l’excavation des terres. Pour ce
faire, nous stationnons le théodolite sur l’un des bords extrêmes du collecteur à
une distance d’au moins 2m où la visée est plus facile pour l’implantation des
piquets. Ensuite nous répétons la même opération qui avait été effectuée lors de
l’implantation. Nous faisons le piquetage successif à tous les profils et demi
profils conformément à la vue en plan tout en respectant les distances partielles
entre ces profils et demi profils. Les piquets sont ensuite alignés, bien enfoncés
et scellés. Nous différencions ces piquets par la peinture.
Implantation du fond de fouille et des voiles
Nous reprenons la même procédure que nous avons effectuée au cours de
l’implantation de la fouille. Mais cette fois-ci on implante le radier à 7m et les
voiles à 8 ,40m à partir de l’axe du collecteur. Les piquets sont ensuite alignés,
bien enfoncés et scellés. Nous différencions ces piquets en les peinturant en
blanc.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 14
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Photo n°02 : vue de l’extraction de la boue sur l’emprise du collecteur
B. Nivellement
Le nivellement est l’ensemble des opérations qui permettre de
déterminer la hauteur des points au-dessus d’une surface de référence, de
mesurer la différence d’altitude entre deux points en connaissant l’altitude d’un
point repère (RN). Il permet aussi, de fixer :
- Les côtes drainage ;
- Les côtes béton de propreté ;
- Les côtes radier.
Pour faire un nivellement, nous avons besoin d’un niveau et d’une mire,
mais dans ce cas nous avons utilisé la station totale.
Nivellement du terrain naturel
Le relevé du terrain naturel a une importance capitale dans l’exécution des
projets routiers. Il permet de déterminer les quantités de déblais, de remblais et
de vérifier les probables variations entre la période d’avant-projet et celle du
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 15
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
démarrage du projet. La détermination de la cote naturelle se fait à chaque profil
et demi-profil. Nous avons procédé par nivellement différentiel par
rayonnement. Nous avons stationné le niveau à un point quelconque et nous
avons visé la mire placée sur le repère de nivellement (RN). La lecture obtenue
est la lecture arrière notée ( ). Nous déplaçons la mire que nous posons sur le
point dont on veut déterminer l’altitude et on fait une seconde lecture. C’est la
lecture avant notée ( ). De cette station nous avons visé le maximum de point
possible en prenant soin d’éviter les grandes visées. Nous avons progressé dans
l’ordre croissant des profils.
Nous obtenons les lectures avant sur l’axe du collecteur, sur le bord
intérieur à 7m, sur le bord extérieur à 8,40m, sur le début de la rue à 19.40m, à
la fin de la rue à 23,60m du collecteur.
La cote terrain naturel est donnée par :
CTN =cote bleu -
Avec cote bleu = Alt RN +
Nivellement des piquets
Le nivellement des piquets consiste à placer des piquets dont les cotes
indiquent soit la cote drainage, béton de propreté, radier ou cote file d’eau.
Dans notre cas toutes les cotes étaient déjà calculées. Et comme nous
utilisons la station totale, après l’implantation nous faisons en même temps le
nivellement. Pour la vérification de la profondeur de fouilles pour le radier, nous
avons procédé comme suit : à l’aide de la station totale, après avoir fait la lecture
arrière sur un repère de nivellement, nous rayonnons tous les piquets d’axe pour
la lecture avant. La mire étant posée sur le sol à côté des piquets d’axe,
- On calcule la lecture avant à savoir sur la mire pour respecter les côtes du
fond de fouilles, par la formule
=Alt RN + CFF
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 16
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
- Nous comparons la lecture avant et la lecture arrière pour les cotes
radiers, nous plaçons les piquets dans le fond de la fouille de manière à ce
que la lecture avant faite sur la mire posée sur celui –ci respecte la lecture
= Alt RN + - CFF
: Lecture avant radier à avoir
Après avoir placé des piquets à tous les profils et demi profils, nous procédons
par interpolation.
IV. LES TRAVAUX GEOTECHNIQUES
Le programme de reconnaissance de sols a consisté en la réalisation des
travaux suivants :
- Trois (3) essais de pénétration dynamique jusqu’à 10m de profondeur, y
compris les zones instables ;
- Deux (2) sondages carottés.
En plus de ces essais nous avons également réalisé
- Des séries d’essais de laboratoire ;
- La recherche d’emprunt.
Les résultats des essais sont donnés en annexes.
Par ailleurs, il ressort de ces investigations que :
Les sols sont constitués d’argile et de tourbe jusqu’à 12m de profondeur.
Ils résistent peu au poinçonnement.
En ce qui concerne les matériaux utilisables pour le remblai hydraulique
général de la zone de travaux, il faut noter que plusieurs sites ont reçu une
autorisation pour l’extraction du sable lagunaire en prévision de la
fermeture des carrières d’exploitation du sable marin dans le cadre de la
lutte contre l’érosion côtière. On peut citer entre autres le site de dragage
de Dèkoungbé et celui de So-Akassato dans la commune d’Abomey-
Calavi.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 17
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
En la disponibilité des cailloux nécessaires à la confection des matelas de
gabions, des entreprises exploitent actuellement à Dan, Seto et Covè (155
km) de Cotonou des carrières de granites.
V. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux proprement dits démarreront par le débroussaillage et le
décapage de la terre végétale à partir de la limite des riverains. L’exécution des
remblais jusqu’à la cote de 1.30 m après tassement démarrera simultanément. Le
remblai servira en même temps de plate-forme de travail pour les engins. Du
côté des riverains, lorsque le terrain naturel est plus bas que le niveau des
remblais, un talus de 2 (verticalement) sur 3 (horizontalement) sera exécuté.
Eventuellement des murets en maçonnerie de mortier seront construits sur la
limite de riverains.
Au fur et à mesure de l’exécution des remblais, des repères y seront
installés. Les tassements seront appréciés en suivant la variation des repères. La
construction des ouvrages commencera après constatation de la stabilisation des
remblais.
Après réalisation des fouilles, on s’assurera que sous l’assise des
ouvrages, il y a une épaisseur suffisante de remblai (01 mètre). Dans le cas
contraire, une purge sera nécessaire sur une épaisseur permettant de garantir 01
mètre de remblai sous l’assise des ouvrages. Le matériau de remblai de purge
sera le même que celui utilisé pour le remblai général de la zone.
Pour gagner du temps, pendant la mise en place du remblai,
l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la confection des matelas de
gabion démarrera. Il en sera de même pour l’approvisionnement des éléments
importés.
Après l’exécution des fouilles, la construction des ouvrages commencera
par la construction des semelles sur un béton de propreté, suivie de la
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 18
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
construction des parois également sur un béton de propreté pour ce qui concerne
la partie de l’ouvrage en béton armé (fin de l’ouvrage existant jusqu’au coude).
Pour la partie en matelas, la construction commence par le réglage de la plate-
forme suivie de la construction de la semelle ou matelas de gabions sur du
géotextile anti contaminant. Le bloc de remblai armé supportant la paroi en
matelas de gabions sera mise en place par couches successives compactées
convenablement ente les armatures constituées de grillage en acier galvanisé.
A-Travaux préliminaires
Démarrés officiellement le 12 Novembre 2009, les travaux de
construction du collecteur ont connus une grande évolution.
A notre arrivée sur les lieux nous avons constaté que les travaux suivants
ont été exécutés :
- Installation du chantier ;
- Une partie du sondage des réseaux de la SBEE et de BENIN
TELECOM sur le lot COLP01 ;
- Dégagement des emprises ;
- Implantation du collecteur ;
- Nivellement ;
- Décaissement de la boue sur environ 200 mètres de l’emprise du
collecteur ;
- Fouille pour collecteur réalisée à hauteur de 60% soit environ 177ml ;
- Les travaux de construction du collecteur P01 proprement dits ont
connu une avancée de 42% soit environ 120ml.
B- Réalisation du collecteur
Les collecteurs se définissent comme étant un dispositif ou ouvrage en
béton armé ou non qui collecte les eaux usées (eaux météoriques, eaux
domestiques, eaux industrielles) et les drainent vers un milieu approprié (cours
d’eau par exemple). Dans le cadre de notre projet, il reçoit les eaux venues de
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 19
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
VEDOKO, FIFADJI, Ste RITA et environs qu’il jette dans le lac Nokoué à
travers l’exutoire. D’une longueur de 800 m environ, de forme trapézoïdale,
(dans le cadre de ce projet), il a les caractéristiques dimensionnelles ci-après :
B= 16,80m, b= 14m, h= 1,40m. Il se différencie par différents matériaux entrant
dans sa réalisation :
I- P0+000 au P0+263 en béton armé de longueur d’environ 263 ml
II- P0+263 au P0+725 avec protection en gabion de longueur d’environ
400ml + 50 ml après la digue de FIFADJI.
III- P0+ 725 au P0+800 fouille sans protection d’environ 200ml.
Alimenté par plusieurs caniveaux, vu l’inondation que subissent les riverains
et compte tenu de la pente maximale du terrain, on met en place une pente de 0,
33%. Réaliser un collecteur consiste à réaliser chacun de ces éléments.
1. Les drains
Ils constituent des mesures de sécurités. Deux types de drains sont réalisés
sur le Chantier à savoir:
-Les drains horizontaux ;
-Les drains verticaux.
Tapis drainant ou drains horizontaux
Elles consistent à faire un apport de gravier de classe (15-25) sur une
épaisseur de 15 cm dans la fouille pour faciliter la circulation de l’eau au-dessus
du radier.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 20
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Photo n° 03: vue du tapis drainant
Drains verticaux
Suivant le plan, ils sont disposés verticalement dans la fouille. Des tuyaux
PVC de diamètre 75mm coupés sur une longueur de 50 cm et remplis de gravier
de classe (5-15) jusqu'au niveau du fil d’eau, permettent de réduire la pression
de l’eau qui circule dans le radier et par voie de conséquence diminuer les
risques les risques de soulèvement de l’ouvrage.
2. Béton de propreté
Le béton de propreté sert d’intermédiaire entre le tapis drainant et le
radier. Avant le coulage, nous avons, à l’aide de la station totale et de la mire,
placé les piquets de manière à faciliter la lecture correspondant à la cote fil
d’eau ou cote tête radier (CFE). Un contrôle permet quelques heures après, de
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 21
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
corriger les éventuelles modifications. Après cette opération nous passons à la
matérialisation du niveau du béton de propreté à15cm de la tête de chacun des
piquets ayant servi à l’implantation des cotes fil d’eau. Ce n’est qu’après cette
opération que le maçon peut passer une première couche de béton. Il est dosé à
150 kg/m3 et est coulé sur une épaisseur de 5cm.
Pour un (1) dosage de 150Kg/cm3sur le chantier, on utilise un paquet de
ciment, deux (2) brouette de sable de 50l et quatre (4) quatre brouettes de
graviers de 50l; le tout donnant un mélange homogène sur lequel on verse une
certaine quantité d’eau de gâchage. Le coulage se fait jusqu’à ce que le piquet
qui était à 20cm du sol n’en soit plus qu’à15. IL est à noter qu’à tous les 12m,
on réalise des joints de dilatation et sous ces joints on étale des géotextiles pour
éviter la remontée du sable à travers ceuxci.
Photo n°04: vue du coulage du béton de propreté
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 22
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
3. Coulage du radier
Le radier est la plateforme réalisée en béton armé et supportant les voiles, il
est réalisé et exécuté le long du béton de propreté. Les différentes étapes de sa
réalisation sont : ferraillage du radier, le bétonnage du radier.
Ferraillage du radier
Après le coulage du béton de propreté, on pose le ferraillage du radier
qui est en double –nappe, on prend soin de placer un distancié en mortier de
ciment de 3 cm d’épaisseur à tous les mètres. Ce ferraillage conformément aux
plans est en double – nappe dont les deux nappes sont supportées par des
chevalets. La nappe supérieure est constituée d’un quadrillage de 18 10cm2 ;
avec des barres de 10 pour armatures principales et des barres de 8 pour
armature de répartition et la nappe inferieure est constituée d’un quadrillage de
10 10 cm2 ; avec des barres de 14 pour armatures principales et des barres de
8 pour armature de répartition. Les barres sont laissées en attente pour le
ferraillage de la voile.
Photo n°05 : vue du ferraillage du radier
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 23
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Bétonnage
Après la réception du ferraillage, on passe au coulage du béton de radier.
Le dosage du radier est de 350kg/m3 c’est-à-dire pour un paquet de ciment on a,
une brouette de sable de 50l et deux (2) brouette de gravier de 50l. Le béton est
confectionné ; le tout mélangé et malaxé dans la bétonnière donne le béton. Le
béton est coulé et vibré à l’aide d’une aiguille vibrante pour réduire les vides
dans le béton. Au cours du coulage on fait attention aux piquets pour avoir à la
fin de l’ouvrage la pente et la hauteur requises (15cm).
4. Coulage des parois
Les parois représentent la partie oblique se trouvant de part et d’autre du
radier sur toute la longueur du collecteur. Elles servent à canaliser l’écoulement
des eaux.
Leur ferraillage étant déjà en place, nous plaçons les distanciés à chaque
mètre. Après cela nous procédons au coulage de la paroi (voile) dont le dosage
est de 350 kg/m 3 et veillons à ce que l’épaisseur puisse atteindre 15cm.
Photo n° 06 : coulage de la voile
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 24
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
5. Bèches
Elles servent à contre caler un tant soit peu les mouvements des terres et
servent de socle au garde-corps. Son ferraillage en L est réalisé en double –
nappe et est continu tout le long de la paroi à l’aide des barres de la paroi qui
sont laissées en attente. Le coffrage est fait à l’aide des panneaux métalliques
spéciaux de 2 m 45 de long et 1m de hauteur. Ces panneaux sont rendus
consolidés par des tiges appelées tiges attegnon. Mais avant de poser ces
panneaux on coule d’abord la partie horizontale appelée palier.
Le béton est mis en œuvre dans le coffrage et soigneusement vibré en
offrant ainsi une surface soignée après décoffrage.
Notons également que des réservations de 20 cm x 20 cm sur 15 cm de
profondeur sont faites tout le long de la bêche pour éventuellement permettre la
pose des gardes corps. A chaque 12 m sont prévues des gouttières pour recueillir
les eaux d’écoulement provenant des chaussées.
Photo n°07 : vue du coffrage de la bêche
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 25
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Photo n°08: Vue du ferraillage de la voile
6. Garde-corps
C’est un dispositif de protection qui est constitué de tuyau en fer de
diamètre 60 qui file le long du collecteur et sert à protéger les riverains contre
les chutes libres. Des trous sont laissés dans les bêches pour servir de socle pour
les gardes corps.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 26
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Photo n°9 : Eprouvette de béton pour les essais
VI. CALCULS DE LA STABILITE DES OUVRAGES
Le but de cette note est de calculer la stabilité des parois du collecteur
trapézoïdal. Nous nous appuierons sur la méthode utilisée dans le fascicule 62
dont le titre est : « Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
construction en béton armés suivant la méthode des états limités » Titre I
Section I.
REGLEMENT
Règles BAEL 91 modifiées 99. Béton armé aux états limites.
MATERIAUX
- Béton
Dosage 350kg/m3 de CPA.
- Fissuration très préjudiciable
Les propriétés mécaniques principales du béton.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 27
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
- Résistance caractéristique
En compression : c28 = 25 [Mpa] Résistance caractéristique du béton à
28 jours.
En traction : ft28 = 2,1 [MPa] Résistance du béton à la traction à 28 jours.
Contrainte normale admissible du béton :
Gb = 15 [Mpa] en ELS 5Etat Limite de Service).
= 0,6 c28 = 15[MPa].
Facteur d’Equivalence n = 15
- Acier
Acier à haute adhérence HA, classe Fe E 400 type 1
Limite élastique fe = 400 MPa.
γs = 1,15 = Coefficient de sécurité
η = 1,6 = Coefficient d’adhérence de fissuration
Nous allons calculer notre collection à la fissuration très préjudiciable.
- Calcul de la contrainte de l’acier à l’ELS
Si fissuration très préjudiciable contrainte admissible
σs = 0,8 x Min [(2/3)fe ; Max (0,5 x fe ; 110 x f t 28 ]
2 2 400
fe 266.67 MPa
3 3
1 400
fe 200MPa
2 2
110 x f t 28 110 1.6 2.1 201.63MPa
σs = 0,8 x 200
σs = 160 MPa
- Caractéristiques des terrains
Ø° γ (t/m3) K
35 1,8 0,27
Ø° = Angle de frottement du sol
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 28
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
γ (t/m3) = Poids volumique des remblais
K = Coefficient de poussée active de terre.
- Géométrie du collecteur
Le collecteur a une forme trapézoïdale, 1,40m en hauteur 14m en largeur,
il sera dimensionné sur un mètre (1m) de long par l’élément voile.
15
15
25
25
15 5 5 15
140
15
1400
1412
Figure 3 : Coupe transversale du Collecteur
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 29
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
70 140 70
140
15 15
155
15
Poussée Poussée
des terres des terres
Figrue 4 : Analyse des charges (Canal Vide)
Charges permanentes
PO
PO
P1 P1
P P
1,01 P2
1,77 14,06
Figrue 5 : Analyse des charges
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 30
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
- Semelle de fondation
2 0.100
Garde corps 2 x PO = 0.01t / m²
14.12
2 2.5 0.40
Parois 2 x P1 = 0.14t / m²
14.12
Total = 0,15 t/m2
Majoration = 1,35
P2 = 0,20 t/m2
P2 = 0,20 t/m2
- Surcharges du remblai, poussée du remblai
Surcharges du remblai : P = 1,0 t/m2 γs = 1,50
A l’Etat Limite Ultime (ELU)
P3 = 1,0 x 1,5 x 0,27 = 0,405 t/m2
P3 P4 1.40 0.405. 1.32 1.40
Q 1.21t
2 2
Q = 1,21 t appliqué à x = 0,58m
- A l’Etat Limite de Service (ELS)
P3 ser = 1,0 x 0,27 = 0,270 t/m2
P4ser = (1,40 x 1,8 x 0,27) + (1,0 x 0,27) = 0,95 t/m2
P3ser P4 ser
Qser = Qser 1.40 0.85t
2
Qser = 0,85t appliqué à x = 0,57m
- Calcul des efforts à l’ELU
M1 = M2 = - 0,135 x 1,77 - 1,35 x 1,01 + 1,21 x 0,58 = - 0,90 t/m
M1 = M2 = - 0,90t/m
- Calcul des Efforts à l’ELS
M1ser = M2 = - 0,100 x 1,77 - 1,00 x 1,01 + 0,85 x 0,57
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 31
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
M1ser = M2 = - 0,70t.m
- Calcul de la section d’armature
Parois
Mu fe
As = avec fed =
Z b f ed s
d'
h d
Zb = d – 0,4y1 avec y1 = d
Zb = d - 0,4 d soit Zb = d(1 - 0,4 )
= 1,25 (1 – 1 2bu )
Mu
avec µbu =
b d ² f bu
0.85 f C 28
f bu
b
0.85 25
fbu = f bu 14.17 MPa
1 1.5
Fbu = 14,17 [MPa] en ELU est la contrainte normale admissible sous ces
combinaisons d’actions fondamentales Ɵ = 1,0 ; b = 1,5
Mu 9.10 3
µbu = = 0.0525MN
b d ² f bu 1 0.11² 14.17
µbu = 0,0525MN
donc
α = 1,25 (1 - 1 2 0.0525 )
= 0,0674
Zb = d (1 – 0,4 α) → Zb = 0,11 (1 – 0,4 x 0,0674)
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 32
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Zb = 0,107 → Zb = 10,70cm
fe 400
f ed ; f ed 374.83MPa
s 1.15
9.10 3
Donc As
0.107 347.83
As = 2,42. soit As = 2,42 cm2.
As = 2,42cm2 Nous prenons HAØ10 e = 18cm
- Vérification à l’ELS
Parois
- Calculons le moment résistant Mrb.
1 y bc
Mrb = by1 (d - 1 ) bc avec y1 d
2 3 s bc
bc = 0,60 fc28 =15MPa.
y1 0.11
15 15
160 15 15
y1 = 0,064m
1 0.064
Mrb = 0,11 x 0,064 (0,11 – 15 )
2 3
Mrb = 4,12. MN.m
M ser
Or Aser
Zb s
y1 0.063
Zb = d - → Zb = 0,11 – 0.089m
3 3
7.10 3 MN .m
Aser =
0.089 160
Aser = 4,920. .10 4 m² ou 4,92cm2
Aser = 4,92cm2
s = 153,46 MPa admissible
bc admissible
Par conséquent nous conservons HAØ10 e = 18cm.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 33
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
TROISIEME PARTIE : ETABLISSEMENT
DES DEBOURSES SECS DE MATERIAUX
Le choix des sections des collecteurs dépend de l’importance du débit
hydraulique, la forme du lit du cours d’eau, de la hauteur disponible entre la cote
du projet et le fond du thalweg, de la facilité de la mise en œuvre, de l’entretien
et du financement etc.
Ainsi nous avons des collecteurs de forme rectangulaire, trapézoïdale,
circulaire. Notons que le collecteur que nous avons suivi est en trois Volets.
Nous effectuons nos calculs sur la partie Béton armé de section : 16,80 x 14 x
1,40.
I. DEBOURSES SECS DES COLLECTEURS DE SECTIONS
16.80 x 14 x 1.40
Sur le chantier de construction de collecteur de VEDOKO, il n’a été utilisé
que des collecteurs en forme trapézoïdale à ciel ouvert de 16.80 x 14 x 1.40.
II. ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
Nous avons considéré pour notre estimation les prix unitaires hors taxes et
hors douanes pratiqués par les entreprises pour des travaux similaires au Bénin.
Ces éléments de prix sont obtenus à partir des marchés exécutés ou en cours
d’exécution aves l’Agetur ou avec d’autres structures administratives. Nous
avons également tenu compte de l’augmentation du coût de la vie après la
signature des marchés en cours d’exécution.
Le coût des travaux est de 4.684.745.100 FCFA dont 1.528.002.000FCFA
pour le tronçon en béton armé qui s’étend de la fin de l’ouvrage existant
jusqu’au coude et de 3.156.743.100 pour le tronçon en matelas de gabions qui va
coude à la digue de Fifadji.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 34
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
L’examen de ces coûts montre que le montant hors taxe des travaux, évalué
par les études, dépasse le montant prévu par les Travaux de Recherches
(3.941.731.274 francs CFA) de :
4.684.745.100 – 3.941731274 =743.013.826 francs CFA
Cependant, en arrêtant l’aménagement à la digue de Fifadji, les 200 m
après la digue de Fifadji devant être aménagés ultérieurement, on réalise une
économie de 913.083. 465 francs CFA sur le montant des travaux. Ce montant
est alors ramené à : 4.684.745.100 – 913.083.465 = 3.771.661.635 francs CFA.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 35
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
QUATRIEME PARTIE : DIFFICULTES ET
SUGGESTIONS
I- DIFFICULTES
Au cours de notre stage nous avons relevé certains faits et détails qui
entravent le bon fonctionnement du chantier et l’avancement des travaux. Nous
pouvons citer entre autres :
Le manque de prise de conscience des riverains sur l’importance des
travaux qui se réalisent.
Le non-respect des panneaux de déviation par les populations ; ce qui
retarde le plus souvent les travaux topographiques.
La pluie qui occasionne des éboulements de terre et rend l’accès au
chantier difficile aux camions ou aux engins chargés de l’approvisionnement et
du rapprochement des matériaux, ce qui nous empêche de suivre le planning
élaboré.
Les casses répétées des tuyaux de canalisation par les engins de
terrassement (tuyaux d’évacuation des eaux usées des riverains et ceux du
réseau d’adduction d’eau de la SONEB) constituent également l’une des
difficultés que nous avons rencontrées.
La panne des engins existants ;
Le manque de certains engins adéquats ;
L’Analphabétisme et l’ignorance des ouvriers ;
La routine, la paresse et l’inattention ;
L’Excès de fatigue.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 36
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
II- SUGGESTIONS
Nous suggérons et ceci de façon modeste à tous les acteurs intervenant sur
ces genres de projets ce qui suit :
Mener au niveau de la mairie, une politique de sensibilisation auprès de la
population pour qu’elle prenne conscience des avantages et inconvénients de
l’assainissement ;
Sensibiliser les riverains pour qu’ils sachent où orienter leur tuyau
d’évacuation ;
Tenir compte des saisons pour définir la période de démarrage des
travaux et leur durée une fois le financement bouclé afin de pallier aux
problèmes de pluie ;
Effectuer une bonne organisation au niveau des sous-traitants afin de
favoriser l’avancée des travaux ;
Autoriser les stagiaires de l’entreprise à prendre part aux réunions du
chantier afin qu’ils apportent leur pierre à l’édifice ;
Concevoir le plan d’installation du chantier en ayant à l’esprit la sécurité
des personnes et des biens et organiser les déplacements sur le chantier en
fonction de l’importance des moyens utilisés ;
Savoir les règles de sécurité et de prévoyance dans son domaine d’activité
et les appliquer soi-même de façon rigoureuse pour donner le bon exemple ;
Faire exécuter les tâches strictement par les personnes qualifiées et
habilitées et les faire utiliser le matériel adapté aux travaux tout en respectant les
normes des constructeurs ;
Vérifier le bon fonctionnement du matériel avant l’usage ;
Inculquer aux ouvriers la notion de sécurité en le sensibilisant et en lui
indiquant les risques ;
Mettre des panneaux de signalisation partout où peut exister un danger et
les faire respecter ;
Isoler les zones dangereuses (dépôts de carburants, de dynamite,...) ;
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 37
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Réglementer l’accès au chantier;
Assurer une police du chantier;
De jour comme de nuit, signaler le chantier par des panneaux de
signalisation, pré-signalisation, barrières réglementaires placées aux distances
d’usage.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 38
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
CONCLUSION
Les expériences acquises au cours de ce stage sont multiples. La
construction de ce collecteur nous a permis de comprendre la rigueur nécessaire
face à un ouvrage de cette envergure. De même, l’esprit d’équipe a été un
facteur très important dans le quotidien de toutes les personnes qui ont travaillé
sur ce chantier.
Somme toute, ce stage qui est venu compléter la phase théorique de notre
formation, nous a permis de comprendre et de toucher du doigt les différentes
étapes la réalisation d’un collecteur. Nous avons assisté aux travaux tels que
ceux de la réalisation de la phase préliminaire ainsi que la réalisation du
collecteur proprement dit.
Quant à l’établissement des déboursés secs, nous avons compris
l’importance que revêt la méthode d’actualisation des prix unitaires sur le
marché des matériaux, puisqu’au cours de la réalisation des ouvrages, les prix
peuvent changer. L’étape du slump test a été une expérience très importante que
nous avons partagée avec l’équipe du CNERTP.
Cependant, notre stage ne s’est pas déroulé sans difficultés. Nous avons
aussi essayé des approches de solutions face à ces difficultés.
Loin de voir cette œuvre comme une parfaite réalisation, et conscient
qu’aucune œuvre humaine ne peut s’identifier comme telle, nous restons ouverts
aux critiques et osons compter sur votre disponibilité pour des remarques et
suggestions en vue de l’améliorer.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 39
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
BIBLIOGRAPHIE
AGETUR, (2008). – ‘’Etudes techniques d’exécution des collecteurs du
programme complémentaire PGUD-2 LOT M00748 PGUD-2’’.
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 40
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
ANNEXE 1
PLAN DE SITUATION
DU COLLECTEUR
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 41
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
ANNEXE 2
RESULTATS DES
ESSAIS
GEOTECHNIQUES
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 42
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
ANNEXE 3
ETABLISSEMENT
DES DEBOURSES
SECS DE
MATERIAUX
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 43
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
TABLEAU N°1 : Détermination de volume des différentes parties du collecteur
N° Désignation UNITE NPS DIMENSIONS VOLUME VOLUME OBSERVATION
longueur largeur hauteur Partiel définitif
Béton de m3 1 1 14.40 0.05 0.72 (14.40 x 0.05 x1)
propreté
I.1 Pour radier
0.989
Béton de
(2 x 0.70 x 0.05)
I.2 propreté m3 2 1 0.70 0.05 0.07
pour bèche
Béton de
propreté (2 x 1.99 x 0.05)
I.3 m3 2 1 1.99 0.05 0.199
pour voile
0.597 (2 x 1 x 1.99 x
II voile m3 2 1 1.99 0.15 0.597 0.15)
2.145 (1 x 1 x 14.30
III Radier m3 1 1 14.30 0.15 2, 145
x0.15)
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 1
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
(2 x 1 x 0.70 x
3
Pa m 0.15)
2 1 0.70 0.15 0.21
lier
IV 0.37
Bèche
m3 2 1 0.20 0.40 0.16 (2 x 1 x 0.20 x
Bor
0.40)
dure
V Tapis
1 1 14.5 0.10 1.45 1.45 (14.5 x0.10 x1)
drainant m3
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 2
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Tableau N°2: détermination des quantités des matériaux
N° DESIGNATION UNITE QTE CIMENT SABLE GRAVIER EAU
3
I Béton de m 0.989
propreté
I-1 ciment kg 148.35
I-2 sable m3 0.395
I-3 gravier m3 0.79
I-4 eau m3 0.168
II Béton m3 2.145
Pour radier
II-1 ciment kg 750.75
II-2 sable m3 0.858
II-3 gravier m3 1.716
II-4 eau m3 0.429
III Béton m3 0.597
pour voile
III-1 ciment kg 208.95
III-2 sable m3 0.238
III-3 gravier m3 0.478
III-4 eau m3 0.119
IV Béton m3 0.37
pour bêches
IV-1 ciment kg 129.50
IV-2 sable m3 0.148
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 3
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
IV-3 gravier m3 0.296
IV-4 eau m3 0.074
IV Tapis
drainant m3 1.45
IV-1 gravier m3 1.16
1237.55
TOTAL
1.639 4.43 0.79
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 4
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
TABLEAU N°3 : Détermination des quantités d’aciers
Poids
Nbres Long Long Poids total
N° DESI GNATION UNITE schéma Poids/ml Total partiel/
d’elts développée total définitif/ ml
ml
01 kg 8 15,92 127,3 1,2 152.832 152.832
02
10 kg 4 15,34 61,36 0,616 37,80 37.80
03
8 kg 10 2,33 23.3 0,39 9.087
04
8 kg 10 2,58 25.8 0,39 10.062
05 8 kg 10 3,24 32.4 0,39 12.636
06 8 kg 10 1,42 14.2 0,39 5.538
07 8 kg 30 1 30 0,39 11.7 156.603
08 8 kg 276 1 276 0,22 107.64
09 6 kg 32 1 32 0,39 7.04 7.04
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 5
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
Tableau N°4 : déboursé sec d’un mètre linéaire de collecteur de dimension 16,80 x 14 x1, 40
N° DESIGNATION UNITE QTITE Prix Prix
Unitaire (CFA) Total (CFA)
1 ciment kg 1237.55 83 102717
2 sable m3 1.639 6250 10244
3 gravier m3 4.43 18200 80626
4 eau m3 0.79 465 368
acier kg
kg 7.04 145
kg 156.603 240
5 kg 37,80 435 145235
kg 152.832 590
coffrage m2
8 bêches 0,36 3000 3000
9 Main d’œuvre Forfait 65000 65000
total 367190
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 6
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
TABLE DES MATIERES
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 1
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
DEDICACES. ....................................................................................................... i
REMERCIEMENTS .......................................................................................... iii
SOMMAIRE ........................................................................................................ v
LISTE DES FIGURES...................................................................................... vii
LISTE DES PHOTOS ....................................................................................... vii
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................. vii
DEFINITION DES SIGLES ET ACRONYMES .......................................... viii
INTRODUCTION GENERALE ....................................................................... 1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE
D’ACCUEIL ........................................................................................................ 3
I. Historique et situation géographique de l’entreprise ............................ 3
A. Historique………………………………………………………3
B. Situation géographique…………………………………………4
II.Domaine et type d’intervention .............................................................. 5
A. Domaines d'intervention…………………………………………..5
B. Types d'intervention……………………………………………….5
III.Organigramme .......................................................................................... 6
DEUXIEME PARTIE : LES TRAVAUX DU CHANTIER ........................... 7
I.Présentation de la zone de projet ............................................................. 7
II.Présentation du projet ............................................................................. 7
Description du projet……………………………….……………9
Rappel des résultats de l’Avant-projet Sommaire (APS)..............10
1. Tracé……………………………….………….…………….10
2. Exutoire collecteur…………………………………………..10
3. Prise en compte des ouvrages existants……………………..10
4. Type de collecteur…………………………………………….11
Description du projet……………………………….……………….11
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 2
Travaux de Construction du collecteur P d’assainissement d’eau pluviale dans le 10ième arrondissement de Cotonou
III.Travaux topographiques ........................................................................ 12
A. Implantation……………………………….…………………….…12
B. Nivellement………………………………………………...............15
IV.Travaux géotechniques .......................................................................... 17
V.Méthodologie d'exécution des travaux .................................................. 18
A. Travaux préliminaires………………….………………..…….…19
B. Réalisation du collecteur………………………………...............19
1. Les drains……………………….…………..…………….20
2. Le béton de propreté…………………….…….…………..21
3. Le coulage du radier……………………………………….23
4. Le coulage des parois……………………..……………….24
5. Les bèches……………………….…………..…………….25
6. Le garde-corps……………………………………………..26
VI. Calcul de la stabilité des ouvrages……………………………….….27
TROISIEME PARTIE : ETABLISSEMENT DES DEBOURSES SECS DE
MATERIAUX .................................................................................................... 34
I. Débourses secs des colleccteurs de section 16.80*14*1.40 .................. 34
II.Estimation du coût des travaux ............................................................ 34
QUATRIEME PARTIE : DIFFICULTES ET SUGGESTIONS ................. 36
I.Difficultés ................................................................................................. 36
II.Suggestions .............................................................................................. 37
CONCLUSION .................................................................................................. 39
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................ 40
ANNEXES1 ........................................................................................................ 41
ANNEXES 2....………………..……………………………………………….44
ANNEXES 3………..…………...……………………………………………..53
TABLE DES MATIERES ................................................................................ 64
Présenté et soutenu par Roger GOUDOU 3
Vous aimerez peut-être aussi
- Drainages LatérauxDocument13 pagesDrainages LatérauxDario de jesusPas encore d'évaluation
- Technicien Supérieur Dessinateur Projecteur en ArchitectureDocument51 pagesTechnicien Supérieur Dessinateur Projecteur en Architecturefarid khelifiPas encore d'évaluation
- Cahier Des Prescriptions TechniquesDocument126 pagesCahier Des Prescriptions TechniquesEl Andro Dela VegaPas encore d'évaluation
- Ceremonie Du Crime - Nora Roberts PDFDocument378 pagesCeremonie Du Crime - Nora Roberts PDFAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Aux Sources Du Crime - Nora RobertsDocument359 pagesAux Sources Du Crime - Nora RobertsAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Mémoire TCHAGWA Armel Cyrille PDFDocument111 pagesMémoire TCHAGWA Armel Cyrille PDFSoumana Abdou100% (3)
- Rapport de Stage LaboratoireDocument88 pagesRapport de Stage LaboratoireMarouane100% (2)
- OLOUKOU Amour Ribert Anselme PDFDocument141 pagesOLOUKOU Amour Ribert Anselme PDFASSANIPas encore d'évaluation
- Rapport BOKO Raoul Brice - CompressedDocument59 pagesRapport BOKO Raoul Brice - CompressedAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- RoutesDocument55 pagesRoutesSoumana Abdou100% (1)
- Mémoire YANOGO EliezerDocument39 pagesMémoire YANOGO EliezerSoumana AbdouPas encore d'évaluation
- 10.08.2021 - G10 Projet Tutoré 2020-2021 FinalDocument53 pages10.08.2021 - G10 Projet Tutoré 2020-2021 FinalYE Yavé JuniorPas encore d'évaluation
- MEMOIRE BERGER Et EMMANUEL 1Document66 pagesMEMOIRE BERGER Et EMMANUEL 1Florian HOUNGUEPas encore d'évaluation
- Correction Mémoire HOUNGAN - G Version DéfinitiveDocument97 pagesCorrection Mémoire HOUNGAN - G Version DéfinitivebrunogassogbaPas encore d'évaluation
- Mémoire KOTY S. DamienDocument113 pagesMémoire KOTY S. Damiensteeven ngassaki100% (2)
- Rapport Final À Imprimer 2 PDF 2Document62 pagesRapport Final À Imprimer 2 PDF 2Kader NimiPas encore d'évaluation
- Note YssinDocument41 pagesNote Yssinadmin rebeiPas encore d'évaluation
- Rapport Final À Imprimer 2 PDF 2Document60 pagesRapport Final À Imprimer 2 PDF 2Kader NimiPas encore d'évaluation
- Memoire RN4Document79 pagesMemoire RN4Abdoul Kader SawadogoPas encore d'évaluation
- Soumahoro IbrahimDocument83 pagesSoumahoro IbrahimIng.esdras ABLYPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage de Genie Civil 3ème Année-EpacDocument32 pagesRapport de Stage de Genie Civil 3ème Année-EpacEzechias Steel83% (6)
- Note YssinDocument41 pagesNote Yssinadmin rebeiPas encore d'évaluation
- Mémoire ABOUBAKAR Fadel - CompressedDocument191 pagesMémoire ABOUBAKAR Fadel - CompressedRa OufPas encore d'évaluation
- Rapport TONOUKOUIN Voltaire Gbênontossi Vidjinnangni - CompressedDocument48 pagesRapport TONOUKOUIN Voltaire Gbênontossi Vidjinnangni - CompressedYassine El HabibPas encore d'évaluation
- Mémoire DJOSSOU Nougnon Berthelot - CompressedDocument150 pagesMémoire DJOSSOU Nougnon Berthelot - CompressedBilaal Djaneye BoundjouPas encore d'évaluation
- UntitledDocument146 pagesUntitledALAIN PETITPas encore d'évaluation
- NNNNDocument158 pagesNNNNKLM100% (1)
- Rapport en Cour de Correction PDFDocument81 pagesRapport en Cour de Correction PDFElfrid Elfrid75% (4)
- Memoire de Fin D Etude L3EA PDFDocument96 pagesMemoire de Fin D Etude L3EA PDFlouati100% (3)
- Rapport Corrigé POULI Espoir Et WANTI LucrèceDocument97 pagesRapport Corrigé POULI Espoir Et WANTI LucrèceEspoir PouliPas encore d'évaluation
- Inbound 4686561617860207700Document20 pagesInbound 4686561617860207700Kola FtkPas encore d'évaluation
- Mémoire TOSSA Gino - CompressedDocument165 pagesMémoire TOSSA Gino - CompressedMAHOUNON TCHANOUPas encore d'évaluation
- Memoire Sakina 3 FinalDocument168 pagesMemoire Sakina 3 FinalBilaal Djaneye BoundjouPas encore d'évaluation
- Rapport AnselmeDocument17 pagesRapport Anselmemedardd1985Pas encore d'évaluation
- Rapport ACCLOMBESSI Shalom - CompressedDocument68 pagesRapport ACCLOMBESSI Shalom - Compressedrandolphehlavo12Pas encore d'évaluation
- COULIBALY Donadrigué MamadouDocument63 pagesCOULIBALY Donadrigué MamadouPaul Nathanaël KOUAKOUPas encore d'évaluation
- TAPSOBA Romaric BriceDocument129 pagesTAPSOBA Romaric BriceSerge Modeste KaborePas encore d'évaluation
- PFE - Projet Dagodio-CORRIGéDocument75 pagesPFE - Projet Dagodio-CORRIGéBadra Ali SanogoPas encore d'évaluation
- ZINZINDOHOUE J. William R.Document127 pagesZINZINDOHOUE J. William R.Elfrid ElfridPas encore d'évaluation
- KONE Fernand KatchaDocument76 pagesKONE Fernand KatchaCédric Bruel Bahoue100% (1)
- Rapport ATONDEH Thierry M. C. - CompressedDocument74 pagesRapport ATONDEH Thierry M. C. - CompressedFadel AlimPas encore d'évaluation
- Ma Reference Du ProjetDocument115 pagesMa Reference Du ProjetcarolePas encore d'évaluation
- Rapport Borov 1Document82 pagesRapport Borov 1dramane boroPas encore d'évaluation
- Méthode de Dimensionnement Des CannauxDocument76 pagesMéthode de Dimensionnement Des CannauxOussama Ezzitouni100% (1)
- Mc3a9moire - Dingc3a9nieur - Klotoe - Cc3a9dric1 HB) IntroductionDocument142 pagesMc3a9moire - Dingc3a9nieur - Klotoe - Cc3a9dric1 HB) IntroductionFisso Ben BenPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D Études Patrick Antonin KIBA Corrigé PDFDocument125 pagesMémoire de Fin D Études Patrick Antonin KIBA Corrigé PDFSena Soro100% (1)
- Rapport FINALISéDocument24 pagesRapport FINALISéEzechias SteelPas encore d'évaluation
- Tfe N'ziDocument85 pagesTfe N'ziN'ZI KOUASSI JEAN JACQUESPas encore d'évaluation
- Mémoire KPODJI Ives Tchègnon - CompressedDocument140 pagesMémoire KPODJI Ives Tchègnon - Compressedpapou simporePas encore d'évaluation
- PFE Alico&DavidDocument106 pagesPFE Alico&DavidModeste MinquilanPas encore d'évaluation
- Memoire de Soutenance Sankara AmadouDocument67 pagesMemoire de Soutenance Sankara AmadouNewton SankaraPas encore d'évaluation
- Dayamba Eva PDFDocument123 pagesDayamba Eva PDFYou BelPas encore d'évaluation
- Mémoire Version Corrigée MaryamDocument176 pagesMémoire Version Corrigée MaryamJohnson noutche100% (1)
- Etudes Techniques D'amenagement Et deDocument119 pagesEtudes Techniques D'amenagement Et deBilaal DjaneyePas encore d'évaluation
- KONE Fernand Katcha PDFDocument76 pagesKONE Fernand Katcha PDFCédric Bruel BahouePas encore d'évaluation
- Rapport Stage Mois 08 2014Document30 pagesRapport Stage Mois 08 2014Tfarah ChekradPas encore d'évaluation
- Mémoire HOUNGLA Archimede - CompressedDocument113 pagesMémoire HOUNGLA Archimede - CompressedRulliamPrince ZakouPas encore d'évaluation
- Proposition D'une Structure de ChausseeDocument95 pagesProposition D'une Structure de ChausseeBilaal DjaneyePas encore d'évaluation
- RebozaZafindraveloA ESPA ING 07Document146 pagesRebozaZafindraveloA ESPA ING 07BL DRAGOSPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage de Fin de Formation Pour L'obtention de Diplome de Licence Professionnelle de THALES ET KOKOUDocument68 pagesRapport de Stage de Fin de Formation Pour L'obtention de Diplome de Licence Professionnelle de THALES ET KOKOUFaouziathsylla SYLLAPas encore d'évaluation
- Bachabi Memoire Definif1Document92 pagesBachabi Memoire Definif1athena7redPas encore d'évaluation
- Mémoire OLOULADE Saobane Fahd - CompressedDocument158 pagesMémoire OLOULADE Saobane Fahd - Compressedamal tahirPas encore d'évaluation
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- L' organisation d’un événement, édition revue et augmentée: Guide pratiqueD'EverandL' organisation d’un événement, édition revue et augmentée: Guide pratiqueÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Projet Transaqua : Transfert des Eaux du Bassin du fleuve Congo au lac Tchad: Ses Conséquences, ses Enjeux et Pistes de solutionsD'EverandProjet Transaqua : Transfert des Eaux du Bassin du fleuve Congo au lac Tchad: Ses Conséquences, ses Enjeux et Pistes de solutionsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Mémoire Zountchémè ElieDocument74 pagesMémoire Zountchémè ElieAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- DTAO TravauxDocument294 pagesDTAO TravauxAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- DTAO FournituresDocument122 pagesDTAO FournituresAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Demande de Propositions ConsultantsDocument89 pagesDemande de Propositions ConsultantsAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Pre-Qualification Marches de TravauxDocument68 pagesPre-Qualification Marches de TravauxAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Conspiration Du Crime - Nora Roberts PDFDocument676 pagesConspiration Du Crime - Nora Roberts PDFAbdul Kasami100% (1)
- Au Coeur Du Crime - Nora RobertsDocument411 pagesAu Coeur Du Crime - Nora RobertsAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Candeur Du Crime - Nora RobertsDocument483 pagesCandeur Du Crime - Nora RobertsAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Au Nom Du Crime - Nora RobertsDocument630 pagesAu Nom Du Crime - Nora RobertsAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Au Benefice Du Crime - Nora RobertsDocument284 pagesAu Benefice Du Crime - Nora RobertsAbdul KasamiPas encore d'évaluation
- Methodologie D'executon Barr de LelexeDocument25 pagesMethodologie D'executon Barr de LelexemidoukoulPas encore d'évaluation
- Bpu Aoo 504-2022 V2Document24 pagesBpu Aoo 504-2022 V2laasriPas encore d'évaluation
- Guide CanalisateursDocument51 pagesGuide CanalisateurselamigosolitarioPas encore d'évaluation
- Forage C1 MZ2 2021Document10 pagesForage C1 MZ2 2021arezkidino.1994Pas encore d'évaluation
- 03 - Classification Des Sols GTRDocument12 pages03 - Classification Des Sols GTRMed SalemPas encore d'évaluation
- Cubature Des TerrassementsDocument5 pagesCubature Des TerrassementsEl Youbi MohammedPas encore d'évaluation
- MétréDocument87 pagesMétréAmenzou Mohamed100% (1)
- CH1 VRD PDFDocument8 pagesCH1 VRD PDFAbdennour MammerinePas encore d'évaluation
- TFC Actualise Philippe Musonda PhilippeDocument60 pagesTFC Actualise Philippe Musonda PhilippeNewton MusondaPas encore d'évaluation
- III.1 Terrassements, Mise en Décharge, Blindages SignéDocument11 pagesIII.1 Terrassements, Mise en Décharge, Blindages Signéchemex.gpe1Pas encore d'évaluation
- Ouvrage de Traversee Du Chemin de Fer Ou Route Bitumee (En TDocument4 pagesOuvrage de Traversee Du Chemin de Fer Ou Route Bitumee (En TAmir BakarPas encore d'évaluation
- Offre Shee System Bertoua - 000Document72 pagesOffre Shee System Bertoua - 000wilfriedmbolo4Pas encore d'évaluation
- PFE MASTER Mohammed Ouhaggou Ilham SahriDocument61 pagesPFE MASTER Mohammed Ouhaggou Ilham SahriSeLMA 12Pas encore d'évaluation
- RedacvfinDocument4 pagesRedacvfinAnass OuraghniPas encore d'évaluation
- Méthodes D Extraction SouterraineDocument6 pagesMéthodes D Extraction SouterraineAbdoulaye Djibril CamaraPas encore d'évaluation
- CPS Ao 03-2023 - 2Document195 pagesCPS Ao 03-2023 - 2YYOUNOS_MAPas encore d'évaluation
- 2.2 Metré de Terrassemnt.Document19 pages2.2 Metré de Terrassemnt.Mosty AgrestPas encore d'évaluation
- C.C.T.P.Terrassement, Voirie Et Assainissement PDFDocument34 pagesC.C.T.P.Terrassement, Voirie Et Assainissement PDFmolk kallelPas encore d'évaluation
- Stabilité des talusDocument32 pagesStabilité des talusDRIZ HAFIDAPas encore d'évaluation
- Manuel Pratique Des Chemins de FerDocument339 pagesManuel Pratique Des Chemins de FerHenniMohamedPas encore d'évaluation
- Étude Du Comportement Des Fondations de Ponts Sur Sols Compressibles Renforcés Par Des Colonnes Ballastées ( Sovo Odilon)Document94 pagesÉtude Du Comportement Des Fondations de Ponts Sur Sols Compressibles Renforcés Par Des Colonnes Ballastées ( Sovo Odilon)Vivien Odilon SOVOPas encore d'évaluation
- Cps Travaux Rn4 Rect TracéDocument50 pagesCps Travaux Rn4 Rect TracéhassanPas encore d'évaluation
- Cours Route TransparentDocument38 pagesCours Route TransparentZakaria ChakirPas encore d'évaluation
- A ImprimerDocument14 pagesA ImprimerhsnghhPas encore d'évaluation
- 4 BpuDocument14 pages4 BpuHamedPas encore d'évaluation
- Guide Pratique D'amenagementDocument15 pagesGuide Pratique D'amenagementKHADY SALLPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument35 pagesRapport de StageYassin IazlPas encore d'évaluation