Katherine M.D. Dunbabin, Theater and Spectacle in the Art of the Roman Empire, Ithaca and London, Cornell University Press, 2016.
Chacun connaît les travaux de K. Dunbabin (KD) sur la mosaïque romaine, en particulier africaine, et les diverses études qu’elle a déjà consacrées au thème des jeux et des spectacles dans le monde romain. Mais c’est ici une somme et une véritable synthèse qu’elle nous livre sur ce sujet. Le titre de l’ouvrage semble donner au théâtre une place prépondérante, surtout si on le rapproche du récent Blackwell Companion au titre parallèle (Sport and Spectacle…), mais d’une part on saura gré à l’auteur de n’avoir pas oublié cette question dans un livre sur les spectacles romains, une absence qu’on a pu constater avec surprise dans d’autres ouvrages, et d’autre part c’est bien l’ensemble des spectacles qui sont envisagés ici, autrement dit en utilisant la terminologie latine les ludi circenses, les ludi scaenici, les munera et les certamina graeca.
Par ailleurs, le fait que l’analyse soit menée ici à partir des images, des représentations figurées, avec toutes les questions d’interprétation qui résultent de cette approche, n’empêche pas que ce thème des spectacles romains soit traité dans toute sa complexité. L’auteur est bien trop modeste lorsqu’elle indique (p. 4), certes à juste titre, qu’ elle est « less concerned here with the details of the spectacles themselves than with the ways in which they are deployed in art » : il est vrai que l’analyse du rôle de ces images est essentielle, comme l’est celle de leur contexte archéologique, par exemple lorsque KD s’interroge sur la fonction des images gladiatoriennes dans la sphère domestique, mais un appareil de notes impressionnant, qui atteint souvent la moitié de la page, permet précisément d’ouvrir sur un luxe de détails quant au contenu des spectacles –ou tout au moins de lancer le lecteur sur des pistes qu’il lui suffira ensuite d’explorer. Parmi les nombreuses questions que soulève l’approche iconographique privilégiée par KD, il y a bien sûr celle-ci : faut-il considérer que la fréquence d’un type de spectacle dans les productions artistiques reflète la popularité de celui-ci dans la réalité ? Mais KD relève ou au moins effleure au passage bien d’autres sujets essentiels comme celui du caractère religieux des jeux romains ou plutôt de son impact véritable sur l’attitude des spectateurs dont on peut penser qu’ils voyaient surtout là (et seulement là ?) une source de plaisir. Il n’est pas certain même que l’importance de ces aspects religieux ait progressivement diminué (p. 142) et on sera plutôt d’accord avec sa remarque à propos du symbolisme cosmique et religieux du cirque : « The crowds in the circus may have been familiar with at least the basic elements of this symbolism, but when they roared their support for their favorite drivers or exulted in the victory of their faction, such complex concepts are likely to have been far from their minds. » (p. 170).
Un autre trait frappant qui apparaît immédiatement à la lecture de ce livre et qui ne peut que susciter l’admiration est que KD a su et pu prendre en compte toute une série de découvertes très récentes : c’était d’ailleurs capital puisque ces nouveautés sur le motif des spectacles romains se sont multipliées ces dernières années, et que dans certains cas elles ont apporté beaucoup, et parfois même renouvelé notre connaissance des pièces de théâtre et de la pantomime (p. 95 sq.). L’exemple des mosaïques de la désormais célèbre villa de Noheda en Espagne, datant des années 400 de notre ère, est mis en évidence dès le chapitre 1 et c’est bien normal puisqu’on retrouve dans ce document toute la panoplie des spectacles romains, à l’exception des munera de gladiateurs, ce qui n’est pas sans susciter une certaine perplexité quand on constate le déclin affiché pour cette époque par les autres sources, archéologiques, épigraphiques et littéraires: est-il possible de brosser sur ce point un portrait de la culture de l’Antiquité tardive qui irait au-delà des sources écrites (p. 17) ? Plus loin, KD décrira la mosaïque de Noheda comme hybride –c’est un adjectif essentiel pour le domaine envisagé dans tout l’Empire romain- avec des éléments occidentaux greffés sur une iconographie grecque. Mais Noheda n’est pas la seule nouveauté prise en compte : au détour d’une note (p. 148, n. 44), KD signale même la mise au jour à Chypre, dans l’été 2015 ( !), d’une troisième mosaïque de cirque dans le monde grec, à Akaki près de Nicosie, un document très intéressant qui nous donne aussi, en grec, toute une série de noms de cochers et de chevaux dont certains étaient déjà attestés. La plupart du temps, ces documents récents sont accompagnés de photos et de dessins, ce qui n’est pas un mince exploit quand on connaît les réticences des inventeurs désireux de conserver, parfois longtemps, l’exclusivité de leur découverte…
Le premier volet analysé du quatuor des spectacles est celui des festivals grecs, des certamina, qui n’est sans doute pas le plus important mais qui a fait l’objet de plusieurs découvertes (Baten Zammour) ou études récentes mettant entre autres l’accent sur les interactions entre identités grecque et romaine. KD passe en revue les peintures de la Tomba dei Ludi de Cyrène et la mosaïque des athlètes de Patras qui ne sont pas encore des documents très connus malgré leur grand intérêt (cf. cependant le livre d’A. Bohne) ; elle note une différence entre les parties occidentale et orientale de l’Empire : cette iconographie se trouve souvent dans l’Est dans l’art public, officiel, funéraire, et dans l’Ouest dans la sphère domestique et surtout dans les thermes, et là il s’agissait d’abord de mettre en lumière l’évergétisme du donateur qui aurait pu tout aussi bien offrir des gladiateurs dans le même esprit. En Italie et en Afrique, c’est le programme athlétique des concours grecs qui a été favorisé, aux dépens des programmes hippique, théâtral et musical : et c’est l’occasion pour KD de rappeler, comme nous l’avons souvent souligné nous-même, que les Romains étaient bien loin de mépriser l’athlétisme, en particulier les sports de combat, et qu’il ne faut pas être dupe ici encore des sources littéraires, même s’il est vrai que les citoyens romains ne voulaient pas participer en public à des compétitions. Une mosaïque récemment publiée ne correspond cependant pas tout à fait à ce schéma puisqu’elle offre bien une combinaison de spectacles athlétiques, musicaux et théâtraux : il s’agit de celle de la villa de Lucius Verus à Acquatraversa sur la via Cassia au nord de Rome, à laquelle KD a d’ailleurs consacré un article très pertinent dans ce même JRA, et qui renvoie certainement aux Capitolia –ce qui n’est pas le cas de toutes les mosaïques (Ostie) qui illustrent sans doute assez souvent des matches-exhibitions avec des athlètes d’origine grecque qui étaient en effet des vedettes au même titre que certains cochers ou gladiateurs.
Comme on pouvait s’y attendre, les spectacles dramatiques se taillent la part du lion avec quelque 80 pages et 3 chapitres, et du point de vue archéologique on connaît le nombre, la richesse et les diverses fonctions des théâtres dans tout l’Empire. Avec une question essentielle qui a suscité des réponses divergentes : s’il est sûr que la pantomime et le mime sont devenus les genres les plus populaires, jouait-on encore, après le Ier siècle de notre ère, du théâtre classique, créait-on même de nouvelles pièces ? Même dans l’Ouest, la disparition des « grands » genres n’est pas assurée et il faut refuser les a priori sur la décadence du goût. Après Pompéi et les cités campaniennes, plusieurs mosaïques et peintures (Zeugma, Ephèse, Crète, Mytilène et bien d’autres) souvent datées du IIIe siècle, et souvent de découverte récente, montrent une (re)connaissance culturelle des classiques grecs et en particulier une étonnante popularité de Ménandre et de ses comédies. Mais la tragédie n’était pas totalement négligée, et il ne faut pas oublier les très nombreuses représentations de masques qui montrent parfois une connaissance précise des genres dramatiques. Et KD d’affirmer avec force en conclusion de ce chapitre : « …nothing justifies the assumption that the performances of full plays had entirely disappeared. »
Après quelques pages très éclairantes sur l’histoire de la pantomime, KD en vient aux sources visuelles qui étaient rares jusqu’à une époque récente et limitées aux arts « mineurs » : quoi de plus difficile que de montrer en une image figée la complexité des mouvements de la danse ? Si le masque de terre cuite à la bouche fermée de la fig. 4.2, p. 91, est remarquable, ce sont maintenant les mosaïques de Zeugma, avec l’extraordinaire figure de Théonoè, et celles de Noheda qui nous donnent les plus belles images de danseurs de pantomime, que KD décrit ici avec précision et maestria. Il est vrai que pour toutes les scènes myhologiques de l’Antiquité tardive, si fréquentes sur tous les supports, revient l’éternelle question de l’influence sur ces images des représentations théâtrales et en particulier de la pantomime, une question qui bien sûr n’est pas réservée à cette période mais que l’on se pose aussi pour la peinture sur vases grecs ou pour les reliefs des urnes hellénistiques de Volterra par exemple.
Avec le mime, immensément populaire –dans tous les sens du terme- et cela encore au VIe siècle, où en Orient on pouvait voir des mimes lors d’interludes entre deux courses de chars, on descend d’un degré dans la hiérarchie culturelle. KD ne manque pas d’humour en traitant des origines du genre (… « performers who specialized in the imitation of professors or lawyers or pigs. » (belle association…) Ce genre, qui ne refusait pas l’obscénité, admettait aussi des actrices –tout le monde connaît le cas de Théodora- et les mimes ne portaient pas de masques. Là encore, la mosaïque de Noheda a apporté une illustration révélatrice puisqu’une scène assez drôle est identifiée par une inscription indiquant certainement qu’il s’agit du mime du mari jaloux : on est en plein vaudeville… Dans les scènes de mime, c’est le personnage du stupidus qui est le plus aisément identifiable, avec sa tête chauve, ses grandes oreilles et parfois un phallus artificiel. On voit souvent des nains sur différentes statuettes de bronze ou de terre cuite, mais le mime qui apparaît le plus souvent dans l’iconographie, par exemple sur les peintures du columbarium de la Villa Doria Pamphili, peut-être parce qu’il était aussi facilement reconnaissable, est le danseur grotesque aux longs bâtons et au chapeau pointu : au passage, le fait que l’on rencontre deux danseurs grotesques de ce type sur la mosaïque ostienne de la Caupona d’Alexander montre bien que le combat des pancratiastes Helix et Alexander était une exhibition de stars en-dehors de tout certamen ou agôn. Et il n’est pas sûr que l’arche représentée sur la mosaïque de l’Aventin (p. 130) figure des gradins ou un lit de banquet : n’est-ce pas plutôt un élément du spectacle utilisé pour pimenter les danses des jongleurs ?
Le chapitre 6 sur les courses du cirque peut paraître court avec sa trentaine de pages, eu égard à la richesse du sujet. Mais KD a su à son habitude donner un résumé succint mais très bien informé et sans erreur des principaux traits de ces ludi circenses et du Circus Maximus (on corrigera le totum…Romam de la n.1) Elle sait déjà qu’on vient de mettre au jour le siège de la faction rouge (au Largo Perosi), et on ajoutera que ces factions sont désormais connues aussi en Bétique. KD donne une très bonne description du relief de Foligno et, s’agissant des sarcophages à scènes de cirque, ses positions sont très sensées lorsqu’elle fait appel comme S. Bell à l’histoire sociale. Dans le corpus iconographique, ce sont évidemment les grandes mosaïques de cirque (une douzaine) qui l’emportent, pour la plupart liées aux provinces occidentales (Lyon, Barcelone, Gerone, Piazza Armerina…) mais dont certaines proviennent aujourd’hui de la partie grecque, ce qui a pu constituer une surprise au départ. Le cas de Piazza Armerina est spécialement étudié : cette villa était dans les années 330 la propriété de membres de l’aristocratie romaine qui célèbrent avec ce pavement les jeux fastueux qu’ils ont présidés à Rome. KD n’oublie pas les chevaux et les cochers qui, du fait de leur statut de vedettes, bénéficient aussi d’une abondante iconographie (mosaïques, lampes…) mais il n’est pas sûr que les noms de chevaux figurant sur les images soient surtout ceux du funalis de gauche : d’ailleurs à Mérida, c’est un iugalis qui est appelé Inluminator, et sur la mosaïque de Trèves le cocher rouge Polydus l’a emporté grâce à son iugalis au nom évocateur de Compressor. Quant à la statue de marbre de Carthage (p.157), qui doit dater du milieu du IIIe siècle, il est impossible que ce soit celle d’un cocher en raison de son habit et de son amphore, ce ne peut être qu’un sparsor dont le rôle était plus important qu’on ne le croit souvent, ce qui explique sa présence presque obligatoire sur toutes les grandes images de cirque.
Le chapitre 7 sur les munera est plus long mais il est vrai qu’il comporte deux volets, les gladiateurs et les chasses de l’amphithéâtre. A propos de l’introduction, j’ai personnellement du mal à admettre des idées souvent reprises aujourd’hui, à savoir que la gladiature renforcerait les vertus romaines de courage et le sens de l’identité romaine chez les spectateurs de tout l’Empire. Le fait que des notables décoraient, comme Trimalcion, sols et murs de leurs domus et villas avec des images gladiatoriennes (mais ce n’était pas le cas en Afrique ni en Espagne) est-il la preuve qu’ils adhéraient à la culture et aux valeurs de Rome ? Ne pouvait-on être un fan du cirque et de l’amphithéâtre sans pour autant entrer dans ce schéma idéologique ? En tout cas, la bibliographie de KD est ici encore très à jour, en particulier en ce qui concerne de superbes reliefs funéraires d’Asie mineure, entre autres ceux de Kibyra. Les stèles funéraires révèlent l’orgueil de ces gladiateurs qui pour être des déclassés se présentaient dans la pose d’athlètes victorieux. Dans les mosaïques de villas, une place spéciale doit être accordée à celles du Wadi Lebda près de Lepcis Magna, datant du début du IIIe s. : on y voit en effet des images de gladiateurs au style extraordinaire (« …among the most impressive works of all Roman art », p. 193), avec des vainqueurs manifestement de type germanique.
Les chasses sont le spectacle par excellence du munus africain : le fait qu’un venator ait pu avoir une belle statue de marbre (Sidi Ghrib) est révélateur de la popularité de ces personnages pourtant décriés, à l’instar du sparsor de Carthage cité plus haut. D’autres venatores semblent porter des costumes moins canoniques (Hadrumète, Maison des Autruches). Même lorsqu’elle aborde des documents très connus (Thysdrus, Smirat, Carthage, Piazza Armerina), la description de KD est exhaustive, elle rappelle les diverses interprétations et opte elle-même pour un point de vue très sensé, sachant bien montrer en tout cas l’impossibilité de telle ou telle hypothèse. Les images de capture et de transport de ces Africanae de l’amphithéâtre ne sont pas oubliées, mais on revient surtout aux gladiateurs avec les mosaïques romaines du IVe s. (mosaïques Borghese venant de Torrenuova, et du Caelius) qui posent la question de la fréquence de la mort dans les combats : même si, comme le pense KD, l’issue fatale n’était pas la norme, il n’en reste pas moins que celle-ci était toujours à la fois espérée et crainte par les spectateurs; par là-même, la gladiature ne saurait être considérée comme un sport, même si la part d’escrime n’était pas absente et si d’autres sports pouvaient être dangereux (cf. le cosidetto « naufrage » des cochers).
Avant une conclusion courte mais ferme qui revient sur trois points (la répartition de ces images de jeux et spectacles si nombreuses, leur caractère conventionnel, générique ou leur renvoi éventuel à la réalité, leur traduction d’une culture commune), un dernier chapitre concernait ces jeux dans l’Empire chrétien. Pour KD, et à juste titre, tout va dans le sens d’une très relative influence du christianisme dans la fin des spectacles, cette pompa diaboli, et même dans celle des combats de gladiateurs : ce sont des raisons économiques qui ont d’abord joué et on en revient à l’article de G. Ville de 1960 qui a été quelque peu gauchi dans son livre posthume paru à Rome 21 ans plus tard. Sont passés en revue des documents sur lesquels la thématique des jeux est essentielle, les diptyques consulaires en ivoire, entre autres celui de Flavius Anastasius consul en 517, les panneaux en opus sectile de la basilique de Junius Bassus consul en 331, les statues de magistrats à la mappa, les contorniates sur lesquels on voit en particulier beaucoup de scènes de cirque, l’obélisque de l’hippodrome de Constantinople.
Nous avons déjà signalé plusieurs qualités éminentes de cet ouvrage tout à fait remarquable, mais on pourrait en souligner bien d’autres : une pensée limpide qui ne se complaît pas dans des digressions fumeuses, un style direct et précis, un choix raisonné des hypothèses les plus vraisemblables, des interprétations personnelles judicieuses, par exemple sur les actes des pièces de théâtre, une illustration abondante et de qualité mais qui a d’abord une visée pédagogique. Le livre se termine par un utile glossaire (s’il faut trouver à toute force une critique, on peut se demander pourquoi KD a choisi dans le pentathlon la « long race » et non pas la course du stade), une liste des illustrations et trois index. Quant à la copieuse bibliographie de 24 pages, elle ne mérite aucun reproche et a su donner toute leur place à de multiples publications venues d’horizons très divers.
Jean-Paul Thuillier
Ecole normale supérieure, Paris

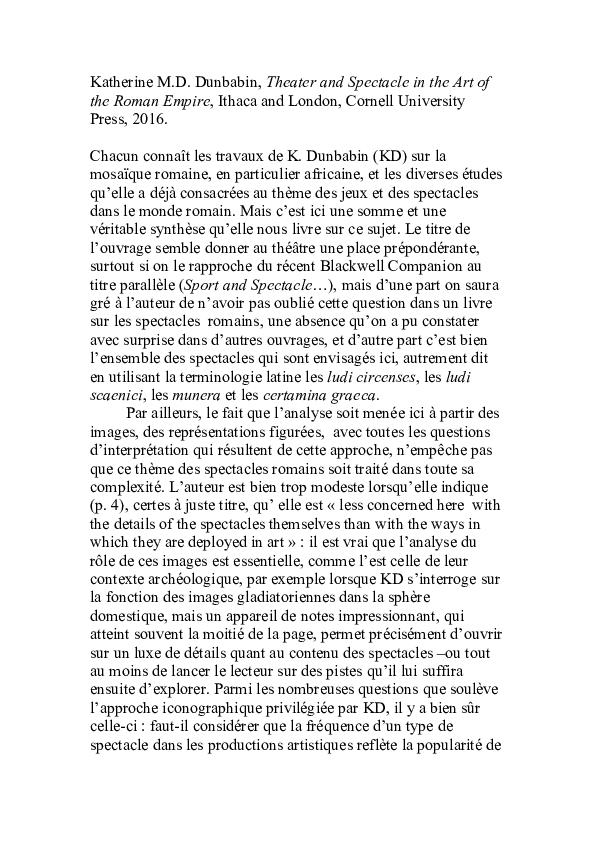
 Jean-Paul Thuillier
Jean-Paul Thuillier