La perception est-elle une interprétation ?
Hubert Wykretowicz
Le test de Rorschach pose au philosophe une question classique : quel genre d’accès au réel la
perception offre-t-elle ? Autrement dit, la perception me permet-elle de saisir le monde tel
qu’il est là devant nous ou bien est-ce que toute relation au monde est de l’ordre d’une
interprétation de celui-ci ?
À cette question, la phénoménologie de Husserl semble répondre de manière claire : la
perception est un accès direct au réel ; on se souvient de son souci de l’évidence, de la
présence « en chair et en os » ainsi que du célèbre mot d’ordre « droit aux choses-mêmes ».
Mais, à bien y regarder, ce mot d’ordre nomme un problème plus qu’il ne le résout : qu’est-ce
qui nous autorise ainsi à parler d’un accès « direct » aux choses-mêmes ? N’est-on pas au fait
que toute perception est médiatisée par un nombre considérable d’éléments, à commencer par
le langage lui-même, de sorte que parler d’accès « direct » au réel c’est simplement ignorer
les apports du tournant linguistique de la philosophie ? Et cette médiatisation nous contraintelle nécessairement à admettre que toute perception est une interprétation ?
1. Le piège cognitiviste et la phénoménologie
On connaît tous ces expériences d’enfants regardant les nuages pour y deviner des formes.
C’est à partir de ce genre d’exemples que le sens commun élabore une croyance selon
laquelle percevoir c’est interpréter. Nous ne voyons pas tous la même chose, parce que nous
interprétons tous le réel à notre manière. Une telle croyance trouve un relais d’importance
dans certaines explications cognitivistes :
« Voir, c’est découvrir, à partir des images que forme l’optique oculaire sur le fond de nos yeux,
les objets et les événements présents dans le monde ; (…) Le système visuel doit donc être capable
de créer des représentations internes qui ne retiennent des images rétiniennes que certains aspects
1
�utiles pour décider des actes déployés dans les trois dimensions de l’espace et des pensées qui
occupent la scène mentale » (Imbert, 2004, p. 69).
La perception est en effet ici présentée comme un mécanisme complexe de sélection
d’information (« ne retiennent … que … »), médiatisé par de nombreux « filtres » 1 et
producteur de « représentations internes ». Cette théorie cognitiviste prend appui sur
l’explication neurobiologique de la vision qui, en tant que telle, peut légitimer des
conceptions relativement contradictoires des rapports entre interprétation et perception. En
effet, selon une perspective en partie réaliste, l’on tend à dissocier les mécanismes perceptifs
et interprétatifs : percevoir c’est « enregistrer » des données sensorielles que le cerveau et la
cognition se chargent dans un second temps de « traduire » en « images mentales » : comme
l’écrit une psychologue de Princeton, « Nous devons non seulement enregistrer mais aussi
comprendre ce qui se passe autour de nous pour pouvoir réagir de façon efficace. »
(Treisman, 2004, p. 157). Il existe cependant aussi une perspective plus idéaliste, qui repose
paradoxalement sur ce même postulat réaliste, mais qui argue du caractère déterminant des
représentations mentales dans la sélection des stimuli visuels. On tendrait ici clairement à
identifier la perception et l’interprétation : percevoir c’est toujours percevoir à travers une
« grille de lecture », c’est-à-dire par le biais de représentations (conscientes ou inconscientes).
Si la phénoménologie n’a pas grand-chose à (re)dire à propos des explications scientifiques
des mécanismes de la vie, il reste qu’elle peut légitimement contester les conceptions
dominantes que de telles explications scientifiques engendrent et que des philosophies
cognitivistes accréditent. Car une telle explication scientifique donne en effet naissance à
certaines idées préconçues discutables à propos du regard ou de la perception : en suivant les
propos d’Imbert et de Treisman, on comprend que voir c’est en partie « assimiler »
(l’extérieur à l’intérieur), et qu’il existe entre moi, le monde et ma « scène mentale », un
intermédiaire « interne ».
1
Sur l’image oculaire de la citation ci-dessus, l’auteur ajoute : « De nombreux arguments, tant physiologiques
que tirés de la psychologie expérimentale, permettent d’assigner aux diverses classes de cellules ganglionnaires
des fonctions différentes dans le traitement des aspects spatiaux et temporels de l’environnement. L’idée
s’impose alors que l’image oculaire passe à travers un ensemble de filtres superposés, opérant et possédant des
résolutions spatiales différentes. Certains ne laisseront passer que les grandes « masses » d’une scène, alors que
d’autres, au contraire, les élimineront pour ne retenir que les fins détails spatiaux. (…) Des opérations, que nous
ne pouvons détailler davantage ici, permettent de détecter ces bords et réalisent ainsi une simplification de
l’image en une esquisse primaire, dont les caractéristiques serviront aux traitements subséquents par le cortex
visuel. » (Imbert, 2004, pp. 71-72) Il est bien au-dessus de nos compétences de pouvoir discuter la validité
scientifique de ces informations, mais nous nous étonnons quand même de la présence sur une page de pratiques
rhétoriques telles que « De nombreux arguments… » ou encore « Des opérations, que nous ne pouvons détailler
davantage ici… » et qui plus est sans renvois référentiels plus précis.
2
�Or, comme nous voudrions le montrer, cette conception de la perception, « digestive » (Sartre,
1990) et représentationaliste, est justement tout à fait discutable lorsqu’elle prétend rendre
compte de la perception dans le champ de l’expérience humaine. D’autre part,
méthodologiquement parlant, l’approche phénoménologique prend assez clairement ses
distances à l’égard de toute prise de position métaphysique initiale. Par cette abstention
(épochè), elle choisit de se laisser instruire par les phénomènes eux-mêmes, c’est pourquoi
elle est amenée à repousser dos-à-dos le réalisme et l’idéalisme, à la manière dont, jadis,
Merleau-Ponty (1945) avait fait jouer, l’un contre l’autre, l’empirisme et l’intellectualisme :
percevoir n’est ni un « enregistrement » passif de l’objet ni une « construction » active de la
part du sujet ; le réalisme repose sur la croyance naïve (l’attitude naturaliste) en l’existence
d’un monde objectif indépendant ; or, paradoxalement, c’est un présupposé identique que
partage l’idéalisme représentationaliste, qui apparaît dès lors comme un correctif tardif de ce
même réalisme2.
Pourtant, si la critique du réalisme et des représentations intermédiaires est un topos
phénoménologique relativement connu, le rôle exact de l’interprétation dans la perception
l’est moins. Ne serait-ce que parce que la tradition phénoménologique a connu suite à
Heidegger, Gadamer ou encore Ricœur, un « tournant herméneutique » (Grondin, 2003), qui
semble justement réintroduire l’interprétation au cœur même de notre accès au monde. Certes
on ne parle pas ici de « cartes mentales », mais on dénonce tous les présupposés
métaphysiques d’une philosophie de la conscience et de la perception chez Husserl.
Heidegger insiste sur le « als » herméneutique – selon lequel percevoir c’est toujours
percevoir quelque chose « comme » quelque chose –, et Gadamer sur la fonction médiatrice
du langage et le rôle des œuvres de la tradition ; et enfin, n’est-ce pas Ricœur qui rappelle,
dans son autoprésentation de 1983 (Ricœur, 1986, pp.32-36), le caractère indépassable de la
2
Frege avait lui-même déjà signalé le paradoxe d’un matérialisme réaliste qui se transforme en idéalisme du
cerveau : « Le plus remarquable est la façon dont la psychologie physiologique débouche sur l’idéalisme, parce
qu’il est tellement contradictoire avec son point de départ réaliste. On part de fibres nerveuses, de cellules
ganglionnaires, on fait des hypothèses sur des excitations et leur propagation, et on cherche par là à faire mieux
comprendre la représentation (…) On empiète sur la pensée et le jugement, et cela renverse tout à coup le
réalisme initial en idéalisme extrême, et, par là, cette théorie scie elle-même la branche sur laquelle elle est
assise. Dès lors, tout se résout en représentations, et, par là, les explications antérieures deviennent illusoires.
L’anatomie et la physiologie deviennent des fictions. Toute l’infrastructure anatomo-physiologique de fibres
nerveuses, cellules ganglionnaires, stimulations, excitations, propagation d’excitations, se dissout. Et que reste-til ? Des représentations de fibres nerveuses, des représentations de cellules ganglionnaires, des représentations
de stimulations, etc. Et qu’est-ce qu’on devait expliquer à l’origine ? La représentation. » Cité par J.-L. Petit
(1999).
3
�médiation par les signes, les symboles et les textes ? Par conséquent, là aussi notre accès au
réel semble être principalement interprétatif, quoique dans un sens évidemment bien différent
des cognitivistes. Regardons cela de plus près.
2. La perception est un accès direct au monde
C’est sur le terrain de l’expérience entendue dans un sens élargi que Husserl entend aborder la
perception et son rôle paradigmatique. La perception apparaît bien éloignée de toute forme
d’interprétation dans la mesure où elle constitue mon expérience originaire des choses ellesmêmes :
« Comme dans la vie quotidienne, de même dans la science (si elle ne se méprend pas,
embarrassée par une théorie « réalistique » de la connaissance, sur son action propre) l’expérience
est la conscience d’être près des choses mêmes et la conscience de les saisir et de les avoir tout à
fait directement. » (Husserl, 1957, p. 312).
« La perception est la conscience de voir et de posséder l’objet en chair et en os. Donc pour parler
par contraste, il n’est pas donné comme un simple signe ou image, il n’est pas médiatement
conscient comme un objet simplement signifié ou apparaissant dans l’image, etc. ; bien plutôt il se
tient là comme lui-même, comme tel qu’il est visé, et pour ainsi dire, en personne. » (Husserl,
1998, p. 173).
Husserl insiste ici, à la suite de l’empirisme, sur une expérience qui me donne un accès direct
au monde ; mais il ne l’entend absolument pas dans le sens d’un empirisme ordinaire :
« l’expérience n’est pas une brèche dans un espace de la conscience »3 ; en d’autres termes,
lorsque je dis que l’expérience est l’irruption d’un objet préexistant en soi dans la sphère du
sujet, je présuppose déjà comme perçu (ou expérimenté) d’une manière ou d’une autre cet
objet soi-disant en soi, dont je cherche pourtant à expliquer l’irruption. La perception ne doit
donc pas être pensée à partir de la dichotomie sujet/objet, mais à partir de l’intentionnalité
constituante de la conscience : la perception n’est pas la saisie d’une image (mentale) du réel,
mais elle me donne la chose elle-même « en chair et en os » ; c’est un acte à la faveur duquel
3
Husserl poursuit son propos en soulignant la contradiction interne à cet empirisme : « Mais l’expérience n’est
pas une brèche dans un espace de la conscience dans laquelle apparaît un monde existant avant toute expérience ;
elle n’est pas non plus une simple intrusion dans la conscience d’un élément étranger à la conscience. Car,
comment devrais-je, sans faire tort à la raison, pouvoir énoncer cet élément étranger à la conscience sans le voir
lui-même et sans voir alors, de la même façon que la conscience, ce qui est étranger à la conscience… donc sans
en faire l’expérience ? » (Husserl, 1957, p. 312)
4
�la chose est directement présente devant moi et en pleine lumière (Husserl, 1950, 4ème section,
chap.2). Il est contradictoire de dire que lorsque, par exemple, je regarde un arbre j’en vois
une image mentale ; car pour pouvoir dire qu’il se trouve entre moi et l’arbre une image de
l’arbre encore faut-il que j’aie perçu l’arbre lui-même, encore faut-il qu’il m’ait été donné en
propre. Voir n’est précisément pas imaginer ; qui plus est toute image (ou représentation)
présuppose l’accès direct à l’objet dont elle est l’image (ou représentation).
On peut volontiers souscrire à l’argumentation rationnelle évoquée ici par Husserl ;
néanmoins, il reste qu’on a du mal à s’expliquer pourquoi, si la perception me donne la chose
elle-même, nous ne percevons pas tous la même chose, de la même manière.
Or, après avoir insisté sur une présence aux choses pleine et totale, Husserl s’empresse
d’affirmer que cette présence est au fond incomplète, et que cette incomplétude tient à
l’essence même de la perception : « ce n’est pas une propriété fortuite de la chose ou le hasard
de « notre constitution humaine » que « notre » perception ne puisse atteindre les choses ellesmêmes que par l’intermédiaire de simples esquisses. Nous sommes au contraire sur le plan de
l’évidence : l’essence même de la chose spatiale (même prise au sens le plus large, qui inclut
les « choses visuelles ») enseigne que ce type ne peut par principe être donné à la perception
que par esquisses » (Husserl, 1950, p. 137) et Husserl d’ajouter plus loin : « or, ce qui s’offre
à la conscience de façon corporelle c’est non seulement ce qui « proprement » apparaît, mais
simplement cette chose même, le tout de la chose selon son sens global, bien que ce sens ne
soit intuitif que sous une face et de plus reste indéterminé à bien des égards. » (Ibid., p. 465).
Autrement dit, afin d’expliquer les différences de perception il n’est nullement besoin de faire
appel à des intermédiaires internes tels que des images ou des représentations ; l’idée
d’esquisse est largement suffisante : j’ai bel et bien un accès direct aux choses elles-mêmes,
mais cet accès se fait toujours de quelque part. Toutefois, il faut se garder de comprendre
cette théorie des esquisses de manière trop idéaliste, comme si elle signifiait que l’homme ne
voit les choses qu’en fonction de l’éclairage qu’il projette sur elles : si nous ne percevons pas
tous la même chose, c’est évidemment parce que nous n’avons pas tous le même point de vue
; mais ces différents points de vue ne flottent pas en l’air, ils sont « éveillés », comme dit
Husserl, par les choses mêmes qui s’esquissent devant nous (« ce qui s’offre à … »)4 : ainsi
lorsque j’entends une mélodie, je ne projette pas sur elle mon point de vue, mais c’est la
4
Sur cette « insistance » de l’objet, voir encore Husserl, 1970, p. 89, 1998, p. 97.
5
�mélodie elle-même, sa structure, qui éveille en moi une écoute attentive et préfigure son
exploration. Pour être exact, la théorie des esquisses doit être pensée à partir de ce « duo
constitutif » que Husserl décrit comme « une constitution de sens où l’initiative ne revient
unilatéralement ni au sujet ni au monde, mais aux deux à la fois » (Moinat, 2010, p. 47) : je ne
construis pas la mélodie de toute pièce à partir des notes entendues, mais en même temps,
selon la qualité de mon écoute j’y entendrai plus ou moins de choses.
Ce paradoxe d’une perception me donnant à la fois la chose pleinement et en même temps de
manière inadéquate, est pour Husserl une vérité d’essence5 : notre perception suggère par
définition de multiples faces, qui s’offrent à au moins autant d’explorations possibles et avec
plus ou moins de clarté – autrement ça ne serait plus une perception. Toute perception actuelle
se trouve être sollicitée par un avenir, affectée dit précisément Husserl (1970, p. 33), dans
lequel un autre aspect de la chose est déjà en train de s’éveiller à la conscience. Je regarde
dehors : mon attention se porte sur la neige qui tombe sur la route ; mais cette attention
déborde déjà au-delà d’elle-même, affectée en périphérie par les gens qui passent et qui, peu à
peu, constituent un nouveau centre d’attention. Percevoir ce n’est pas tellement saisir un objet
un et identique à lui-même à un instant précis et sous le « projecteur » de ma conscience, mais
se laisser attirer par l’horizon : horizon externe de la chose considérée, lorsque je passe de la
neige aux passants, horizon interne, lorsque j’explore la chose elle-même, la neige, les
flocons, puis leur structure fractale, etc. La perception se développe ainsi dans un système
dense et épais, fait de renvois, de parentés (synthèses de recouvrement), où les silhouettes se
répondent, formant un tableau concordant, un style propre :
« (…) le champ perceptif de choses tout entier, en tant que multiplicité constituée se composant de
choses qui apparaissent en perspective, est une unité harmonieuse de la perspectivité ; un style
perceptif règne, et continue de régner, dans la variation du champ perceptif qu’occasionne l’entrée
d’apparitions perceptives de choses qui à l’instant n’étaient pas dans le champ, ou bien la sortie de
certaines, qui y sont encore. » (Husserl, 1989, p. 69 et Husserl, 1998, p. 97)
5
Ce paradoxe, Romano (2010) l’évoque abondamment aussi, mais à la manière d’un reste cartésien qui
empêcherait Husserl de proposer une véritable phénoménologie de la perception. Pour notre part, nous sommes
ici un peu plus « généreux » avec Husserl : il nous semble qu’il y a ici une authentique conscience de la finitude
de la perception qui anticipe déjà les propos du tournant herméneutique de la phénoménologie – où l’on insistera
abondamment sur la finitude de l’expérience humaine. Husserl perçoit ici en effet très bien que la perception
n’est jamais un point de vue de nulle part selon l’expression de Nagel. Voir à ce propos Bernet, 1994, p. 121 et s.
6
�Husserl développera de plus en plus cette conception de la perception prise dans l’épaisseur
du monde, dans la finitude : on sait notamment le rôle que le corps et les kinesthèses
viendront jouer par la suite dans l’appréhension des choses ; si les choses s’esquissent devant
moi, c’est aussi essentiellement parce que je bouge (ou reste immobile) autour et auprès
d’elles – ne serait-ce qu’avec les yeux (Husserl, 1962, § 47, 1998, p. 104). Mais il reviendra
surtout à Merleau-Ponty (1945) de montrer comment, à la faveur de la perception, l’homme
vit dans un contact intime avec le monde, comment, dans la perception, l’homme et le monde
font corps, sont en « symbiose » (Romano, 2010, p. 566). La phénoménologie de la
perception élaborée par Merleau-Ponty est héritière de l’accès direct aux choses, mais un
accès qui n’est plus de l’ordre d’une saisie d’un objet là devant, préparant son objectivation
dans la science ; percevoir, à un niveau antéprédicatif, c’est pour Merleau-Ponty percevoir des
possibilités d’orientations pratiques offertes à mon corps, à l’instar du joueur de tennis
qui anticipe une amortie.
Si nous avons désormais des raisons de croire que la perception ménage bel et bien un accès
aux choses elles-mêmes, il reste que ce caractère contextuel et perspectiviste semble la
rapprocher cette fois-ci de l’interprétation. Comme le note Ricœur, « ce qui caractérise le
« style » de l’interprétation, c’est le caractère de travail infini qui s’attache au déploiement
des horizons des expériences actuelles. » (1986, p. 78). Certes la préoccupation de Ricœur
dans cet article est différente (la phénoménologie est-elle une discipline descriptive ou
interprétative ?) ; toutefois, elle rejoint en partie la nôtre lorsqu’il rappelle à quel point
l’expérience antéprédicative contient et prépare sa mise en mots (Ricœur, 1986, pp. 65-67).
En effet, dans cette donation de la chose par profils, dans cette ouverture pratique du monde,
c’est le « als » herméneutique qu’on retrouve : voir quelque chose c’est toujours le voir
comme quelque chose et à partir de quelque part. Le citron que je perçois en ce moment
possède un sens particulier en fonction du contexte qui est le sien (à côté de la tasse de thé) ;
mais n’est-il pas évident que lorsque ma fille l’attrape pour jouer, il n’a plus le même sens ?
Bref, toute perspective n’implique-t-elle pas logiquement une interprétation ?
Il y a dans la perception un travail infini autour du sens qui n’est pas sans rappeler la posture
du lecteur devant la chose du texte qui s’offre à la compréhension ; pourtant cette analogie
n’est pas, à notre avis, une raison suffisante pour affirmer que la perception est une
interprétation du réel. Lorsque nous percevons un citron, ma fille et moi, nous ne sommes
justement pas en train de l’interpréter ; lorsque le joueur de tennis fixe la balle des yeux avant
7
�de frapper, ce n’est pas non plus une interprétation. Mais encore faut-il le démontrer : pour ce
faire, nous proposons de revenir ci-dessous sur deux cas exemplaires, la perception d’une
chose et la perception d’autrui.
3. La différence entre perception et interprétation
Si l’on reprend le point de vue cognitiviste évoqué plus haut, lorsque nous identifions un
objet, la perception s’occupe d’offrir un matériel sensoriel à des intermédiaires neurocognitifs
qui se chargent de l’interpréter. Treisman, qui s’intéresse à la saisie des traits dans la
perception (par exemple lignes ou couleurs), affirme ainsi que « cette performance
perceptuelle que nous réalisons à chaque instant de notre vie consciente pourrait dépendre
d’analyses complexes auxquelles nous n’avons aucun accès conscient », comme cette
« analyse visuelle » qui rendrait possible « les transformations qui nous mènent des taches
lumineuses à une représentation interprétée du monde » (Treisman, 2004, p. 159). Le rôle de
la perception y est bien défini : « j’ai suggéré que la vision aux niveaux primitifs enregistre
simplement la présence dans la scène de tous les traits simples. Cet enregistrement se fait dans
un certain nombre de modules séparés et les traits ne sont reliés les uns aux autres qu’une fois
que l’attention est focalisée sur un élément particulier. » (Ibid., p. 175). Ajoutons que lorsqu’il
s’agit par exemple d’expliquer la continuité dans la modification perceptive (je crois voir un
avion, mais c’est un oiseau), l’auteure n’hésite pas à convoquer « une représentation
intermédiaire, dans laquelle les traits sont assemblés avant que l’objet soit identifié » (Ibid., p.
191), représentation temporaire elle-même stockée dans une sorte de « dossier mental » (Ibid.,
pp. 191-194) dernier garant de l’unité de la perception6.
6
L’auteure elle-même avoue cependant un certain embarras lorsqu’elle doit expliquer les associations de traits
ratées : « D’après mes expériences, il semble que l’attention focalisée est nécessaire pour assurer la conjonction
correcte des traits visuels. Mais cela pose un vrai problème quand nous tentons d’expliquer la perception de tous
les jours, dans l’univers familier hors du laboratoire, un monde riche et varié, rempli de conjonctions complexes
que nous voyons sans effort apparent. Certes, mes amis et mes collaborateurs viennent quelquefois me raconter
une anecdote pour me faire plaisir. Par exemple celle d’un ami qui, se retournant pour saluer un collègue dans la
rue, s’aperçoit que le crâne chauve et les lunettes appartiennent à un visage et la barbe noire à un autre. Mais
même moi, je dois admettre que ces événements sont rares. C’est peut-être que nous obligeons les conjonctions à
se conformer à nos connaissances sur les objets familiers. Nous ne nous autorisons pas à voir des œufs poilus et
des chiens verts. Nous les éliminons avant d’en prendre conscience, si d’aventure ils se forment. » (pp. 187-188).
On se rappellera à ce propos ce que jadis Merleau-Ponty (1942) disait des expériences de laboratoire de Pavlov :
qu’elles expliquent moins la vie en elle-même que sa forme dégradée et pathologique.
8
�Selon Sartre, ce genre d’explication repose sur une illusion intellectualiste : la perception
consisterait dans un premier temps à saisir diverses qualités isolées (couleur, forme, goût, …),
que l’intellect, dans un second temps, se chargerait de réunir sous l’étiquette citron par
exemple (« interpréter » comme étant un citron). En réalité, c’est l’inverse qui se passe, à
savoir l’objet « citron » se manifeste à moi comme une totalité d’emblée signifiante où les
divers côtés renvoient les uns aux autres :
« Le jaune du citron n’est pas un mode subjectif d’appréhension du citron : il est le citron. (…) En fait le citron
est étendu tout à travers ses qualités et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres.
C’est l’acidité du citron qui est jaune, c’est le jaune du citron qui est acide ; (…) il n’est pas vrai, comme le croit
Husserl, qu’une nécessité synthétique unisse inconditionnellement la couleur et la forme ; mais c’est la forme qui
est couleur et lumière ; si le peintre fait varier l’un quelconque de ces facteurs les autres varient aussi, non parce
qu’ils seraient liés par on ne sait quelle loi mais parce qu’ils ne sont au fond qu’un seul et même être. En ce sens,
toute qualité de l’être est tout l’être. » (Sartre, 1943, pp. 222-223)
Propos par lesquels Sartre se distancie de l’hylémorphisme de Husserl mais qui surtout nous
invitent à nous méfier d’une explication cognitiviste qui postule derrière la perception
quotidienne un mécanisme inconscient comme cette « analyse visuelle ». Le problème dans
cette explication, ce n’est pas tant la volonté de s’intéresser aux mécanismes neurobiologiques
qui sous-tendent notre vision ; c’est plutôt cette posture floue, quelque part entre cerveau et
conscience (états mentaux), qui risque de substituer à une juste compréhension de
l’expérience vécue un modèle raffiné selon lequel la perception est une interprétation du réel
construite sur la base de lignes et de taches perçues et traitées par des intermédiaires cognitifs.
Or, la phénoménologie n’a cessé de le répéter, percevoir n’est justement pas analyser,
interpréter ou construire un monde.
C’est d’ailleurs ce que montre bien la critique sartrienne de la « projection ». Sur un versant
cette fois-ci plus subjectiviste, on pourrait en effet soutenir que percevoir est interpréter, dans
la mesure où nous ne faisons que « projeter » sur le réel nos catégories subjectives. Prenons
cette fois-ci l’exemple de la viscosité développé par Sartre à la fin de L’être et le néant : on
sait que la viscosité sert à désigner une qualité sensible des choses ainsi que certains
comportements humains (allant de la simple poignée de main jusqu’aux pensées, précise
Sartre). Or, si nous percevons comme « visqueux » un comportement, ce serait
essentiellement à la suite d’une association subjective de l’expérience sensible de la qualité de
9
�la chose avec des traits humains (qui ne pourraient être désignés stricto sensu comme
visqueux selon cette théorie). Mais une telle explication repose selon Sartre sur un non-sens :
« J’aurais donc enrichi le visqueux en projetant sur lui mon savoir touchant cette catégorie
humaine de conduite. (…) si le visqueux n’est pas chargé originellement d’un sens affectif, s’il ne
se donne que comme une certaine qualité matérielle, on ne voit pas comment il pourrait être
jamais élu comme représentant symbolique de certaines unités psychiques. En un mot, pour établir
consciemment et clairement une relation symbolique entre la viscosité et la bassesse poisseuse de
certains individus, il faudrait que nous saisissions déjà la bassesse dans la viscosité et la viscosité
dans la bassesse. Il s’ensuit donc que l’explication par projection n’explique rien, puisqu’elle
suppose ce qu’il faudrait expliquer. » (1943, p. 651).
La perception n’est donc pas non plus une projection, quand bien même celle-ci présuppose
celle-là – soit dit en passant dans un mouvement d’appauvrissement de la richesse perceptive
qui la rapprocherait plutôt de l’imagination telle que Sartre la conçoit (Sartre, 1940).
Ce qu’il faut retenir de cet exemple comme de celui du citron, c’est que si nous tendons ainsi
à nous représenter la perception comme une interprétation (que ce soit au sens de
« décodage » de données sensibles ou « projection » de catégories subjectives), cela tient à
l’idée que le monde qui s’offre à nous dans la perception est composé de qualités sensibles
plus ou moins objectives et dépourvues de sens en elles-mêmes. Or, percevant, nous ne
sommes justement pas confrontés à des « taches lumineuses », mais à un visage, un abri ou un
nuage qui nous indiquent des possibilités d’être. Comme le rappelle Sartre, nous n’avons pas
affaire à de pures et simples qualités matérielles mais à un monde symbolique où la bassesse
se lit déjà dans la viscosité. De même, si nous pouvons par exemple dire d’un individu qu’il
est mielleux, c’est parce qu’il y a déjà dans le miel une certaine manière d’être (coulante et
collante). Merleau-Ponty ajoute à ce propos : « notre rapport avec les choses n’est pas un
rapport distant, chacune d’elle parle à notre corps et à notre vie, elles sont revêtues de
caractères humains (dociles, douces, hostiles, résistantes) et inversement elles vivent en nous
comme autant d’emblèmes des conduites que nous aimons ou détestons. L’homme est investi
dans les choses et les choses sont investies en lui. » (Merleau-Ponty, 2002, p. 29). Il n’est pas
question ici d’une donation de sens subjective à une réalité par ailleurs objective ; la
perception est une rencontre d’un sens se faisant à même les choses – selon le principe du
« duo constitutif » de Husserl évoqué plus haut : l’élève perçoit les leçons comme étant à
faire, la télévision comme devant être évitée, de la même manière qu’un joueur de tennis
10
�perçoit l’amortie à aller chercher ; en d’autres termes, ce sont autant de sollicitations
adressées au comportement mais qui ne sont et ne requièrent en aucun cas nécessairement un
acte d’interprétation : les choses se présentent ici dans une « évidence naturelle » (chère à
Blankenburg), pourrions-nous dire.
Mais alors que faut-il entendre au juste par interprétation ? Et surtout quelle place occupe-telle dans notre rapport au monde ? Elle semble signifier tantôt « traduction », ou
« organisation », tantôt « projection » ou « construction », voire « médiation ». Nous
n’ambitionnons pas ici de clarifier toutes ces significations ; rappelons seulement, à titre de fil
conducteur, que l’idée qu’il y a quelque chose à interpréter remonte à la tradition de l’exégèse
biblique : un sens est là, mais qui ne se donne pas immédiatement à la compréhension – ainsi
par exemple les paroles du Christ dont le sens est caché. À l’origine donc, l’idée
d’interprétation, à l’inverse de tout ce que nous avons dit de la perception, suppose que
quelque chose ne se montre pas (dans l’intuition), que nous ne sommes pas en présence de la
chose !
Chez Dilthey par exemple, cette absence prend la forme d’un accès problématique au
psychisme de l’autre, qui ne peut se faire alors que par la médiation de l’interprétation des
signes par lesquels il s’annonce. De même chez Heidegger (1985), l’herméneutique apparaît
comme le correctif nécessaire d’une phénoménologie de l’inapparent : au début de Être et
Temps, Heidegger (1985, §7) rappelle que la phénoménologie a pour objet ce qui ne se
montre pas – et on se souviendra de la stupeur de Husserl à la lecture de cette définition de sa
propre méthode (Husserl, 1993). C’est le sens de l’être, oublié et obscurci par la tradition
métaphysique, qui requiert un tournant herméneutique, une désobstruction afin d’y ménager
un accès. Chez Gadamer et Ricœur, cette absence du sens prend la forme de la distance que la
compréhension est appelée à franchir7 : en conséquence, l’interprétation n’intervient que dans
une situation problématique, où le sens ne se donne pas pleinement ; elle a alors pour fonction
de venir pallier à cette distance entre moi et la chose à comprendre : « interpréter, écrit
Ricœur, c’est rendre proche le lointain (temporel, géographique, culturel, spirituel). » (1986,
p. 57). Certes dans la situation dialogique cette interprétation se superpose assez
naturellement à la compréhension : ne comprenant pas où mon interlocuteur veut en venir, je
7
Chez Gadamer (1996, p. 317 et s.) les choses sont clairement plus compliquées, étant donné que pour ce
dernier l’herméneutique semble être la redécouverte de notre appartenance à l’histoire etc. Néanmoins, la
compréhension chez lui aussi est appelée à vaincre une « distance temporelle » pour produire une « fusion des
horizons » – qui présuppose évidemment une distance à franchir.
11
�pose des questions qui maintiennent ou restaurent la compréhension. Mais face aux paroles du
Christ, devant un poème hermétique, face à des mœurs étrangères (géographiquement comme
historiquement), ou confronté à un patient dont le vécu est incommunicable (maladie mentale
par exemple), le travail d’interprétation prend la place de la perception pour tenter de rétablir
une proximité avec la chose même : le médecin recourt à l’interprétation précisément parce
qu’il ne voit pas ce dont il s’agit, parce qu’il ne peut pas immédiatement saisir la réalité
pathologique de son patient.
Autrement dit, ce n’est que lorsque mon accès à la chose est empêché, par exemple lorsque
les signes sont devenus opaques, qu’ils ont perdu leur transparence intentionnelle, que la
perception requiert l’interprétation. Or, cela signifie que la condition langagière de l’homme
n’implique pas qu’on soit nécessairement toujours en mode interprétatif. Sartre rappelle à
juste titre que le langage n’est pas d’abord un prisme déformant, mais une proximité avec les
choses :
« Lorsqu’on est en danger ou en difficulté, on empoigne n’importe quel outil. Ce danger passé on
ne se rappelle plus si c’était un marteau ou une bûche. Et d’ailleurs on ne l’a jamais su ; il fallait
tout juste un prolongement de notre corps, un moyen d’étendre la main jusqu’à la plus haute
branche ; c’était un sixième doigt, une troisième jambe, bref une pure fonction que nous nous
sommes assimilée. Ainsi du langage : il est notre carapace et nos antennes, il nous protège contre
les autres et nous renseigne sur eux, c’est un prolongement de nos sens. Nous sommes dans le
langage comme dans notre corps ; nous le sentons spontanément en le dépassant vers d’autres fins,
comme nous sentons nos mains et nos pieds ; (…) La parole est un certain moment particulier de
l’action et ne se comprend pas en dehors d’elle. » (Sartre, 1948, p. 26).
Certes le langage offre toujours un certain point de vue sur les choses, mais, comme Husserl
l’a enseigné, c’est un point de vue sur la chose elle-même qui nous impose aussi sa loi :
contrairement à ce que Nietzsche a pu laisser penser, la perspective n’implique pas en soi une
interprétation du réel et un coup de force. C’est pourquoi Sartre peut dire que le langage,
avant de servir l’élaboration d’une interprétation du monde, est d’abord de la même nature
que mon corps, c’est-à-dire une manière d’entrer en contact avec les choses : « l’homme qui
parle est au-delà des mots, près de l’objet » (1948, p. 19). Lorsque, vers vingt heures, je me
trouve chez moi, à la table de la cuisine, et que ma femme me dit « passe-moi le sel ! », je n’ai
nullement besoin d’une interprétation : mon attention ne porte pas sur les mots ou la structure
grammaticale de la phrase, mais je me tourne, tends la main et saisis la salière. Mais lorsqu’un
12
�étudiant, lors d’un examen, prononce les mêmes mots, cette transparence intentionnelle de la
vie pratique se brouille : les signes font soudain écran et mon commerce spontané avec les
choses se trouve interrompu. Alors seulement un recours à l’interprétation s’avère nécessaire8.
Cette dualité de la perception et de l’interprétation est clairement identifiable dans notre
perception d’autrui. Considérons pour terminer les propos de Max Scheler. Se demandant
comment on peut avoir accès au psychisme de l’autre, ce dernier se trouve confronté à la
réponse intellectualiste, à savoir le raisonnement par analogie : nous percevrions chez l’autre
des mouvements corporels analogues aux nôtres, lorsque par exemple nous sommes en colère,
ce qui nous permettrait d’en inférer ensuite le même état d’âme (à savoir la colère). Cette
théorie, dont Husserl lui-même ne s’est pas complètement affranchi9, a été maintes fois
critiquée par les phénoménologues dont Scheler en premier lieu 10 : premièrement, ce
raisonnement par analogie ne me donne absolument pas un accès à un moi autre, mais à une
copie de mon propre moi en l’autre ; deuxièmement, il repose sur un présupposé contestable,
à savoir qu’il y aurait d’un côté un corps physique en mouvement et de l’autre, « derrière »
lui, une âme chargée de l’animer. Pour Scheler les données phénoménologiques nous invitent
à ne pas séparer ainsi l’âme du corps : le corps de l’autre qui se manifeste devant moi n’a pas
l’opacité du corps physico-chimique, mais c’est un corps expressif, c’est-à-dire animé de
sens, aussi étroitement lié avec ce sens qu’un signifiant et un signifié. Enfin, ce dualisme nous
pousse à recourir à une explication par projection assez discutable : certes nous projetons
souvent sur les autres beaucoup de choses (à commencer par nos propres défauts), mais c’est
un mécanisme psychique second qui présuppose la perception.
En conséquence, les données phénoménologiques tendent à montrer (il suffit de rappeler
l’exemple des nourrissons) que la pensée de l’autre est présente à même son corps : un orateur
devant son public, un joueur de tennis face à son adversaire, voient immédiatement ce qui se
8
Nous n’ambitionnons pas ici de développer plus avant la question de savoir si tout langage est par essence une
interprétation du monde. Nous nous permettons de renvoyer à Gallagher et Zahavi (2012, pp. 100-101) pour ce
qui est du caractère second du signe linguistique ainsi que du lien intime entre le signifié et le percevoir ; mais
aussi à Romano (2010) qui nous paraît avoir clairement démontré que l’enfermement de la philosophie
(analytique) dans le langage (le « tout ne serait que langage ») est au fond un avatar de l’idéalisme kantien (et
que par conséquent il existe une mise en forme prélinguistique). La veine herméneutique de la phénoménologie
a, quant à elle, rapidement pris ses distances à l’égard d’une telle totalisation de l’expérience en rappelant que le
langage, bien qu’essentiel, est toujours second, qu’il vient en réponse à une expérience du monde. Voir Grondin
(1993, p. 180 et s.).
9
Quand bien même il parle d’une apprésentation du vécu d’autrui et non d’un raisonnement par analogie
(Husserl, 1996, p. 177 et s.).
10
On retrouve un bon état de ces critiques dans Zahavi, 2005, chap.6. Pour le détail de l’argumentation de Max
Scheler (Scheler, 2003, IIIème partie, chap.3).
13
�passe « dans la tête » de leur vis-à-vis, sans passer par un quelconque raisonnement par
analogie ou une projection. Nous avons trop l’habitude de partir d’expériences limites telles
que le mensonge ou la simulation (attitudes dans lesquelles le sujet se retire dans son
intériorité) pour élaborer une théorie de l’intersubjectivité ; or, ces dernières ne sont pas la
règle, mais plutôt l’exception : « Ce que nous percevons « en premier lieu » des autres
hommes avec lesquels nous vivons, ce ne sont ni leur corps (pour autant qu’il ne s’agit pas
d’un examen médical, extérieur), ni leurs idées et leurs âmes, mais des ensembles indivis que
nous séparons aussitôt en deux tronçons, dont l’un serait destiné à la perception « interne »,
l’autre à la perception « externe » » (Scheler, 2003, p. 470). Comme le dit Scheler à propos de
l’expérience de l’amitié, je n’ai nullement besoin d’avoir conscience de stimuli physiques ou
chimiques du corps de mon ami pour en comprendre l’amitié ; celle-ci est un aspect de la
structure d’ensemble de l’homme : « quant aux phénomènes sensoriels, ils ne nous sont
« donnés » que pour autant qu’ils représentent la base sur laquelle reposent ces structures,
pour autant qu’ils sont capables de symboliser ces ensembles, qu’ils en sont, pour ainsi dire,
représentatifs. » (Ibid., p. 474).
Certes les propos de Scheler sont d’abord une critique de l’inférence et non de
l’interprétation. Toutefois, ils nous semblent valoir aussi, mutatis mutandis, pour le primat de
l’interprétation : autrui se manifeste immédiatement comme un comportement que je perçois
et nous ne nous mettons en situation d’interprétation que lorsque notre perception s’avère
soudain douteuse :
« C’est ainsi qu’à la suite d’un certain nombre d’actions accomplies par quelqu’un qui venait de
me parler et dont j’avais cru percevoir les sentiments et les intentions, je puis être forcé d’arriver à
la conclusion que je l’ai mal compris ou qu’il m’a trompé, ou qu’il fait preuve à mon égard de
simulation, etc. Ce faisant, je formule réellement des jugements se rapportant à ses expériences
psychiques. (…) ou encore toutes les fois qu’on est obligé d’admettre, soit pour des raisons
positives et précises, soit pour des raisons tenant en dernière instance à la perception elle-même,
une inadéquation entre le fait psychique et l’expression, c’est-à-dire une rupture (automatique ou
voulue) de cet ensemble symbolique, indépendant des faits psychiques et des expériences
particuliers de l’individualité. C’est alors, et alors seulement, que je commence à formuler des
jugements et des conclusions. Mais n’oublions pas, à cette occasion, que les prémisses matérielles
de ces jugements et conclusions reposent sur les données fournies par la perception pure et simple,
soit de l’homme auquel nous avons affaire, soit d’autres hommes ; elles supposent donc ces
perceptions directes et immédiates. (…) C’est ainsi, par exemple, que si je me rends compte de
son mensonge, ce n’est pas en me disant qu’il doit bien savoir que les choses ne sont pas telles
14
�qu’il les représente ou expose ou décrit : dans certaines circonstances, je suis capable de percevoir
directement son mensonge, de surprendre pour ainsi dire l’acte par lequel il ment. » (Ibid., pp.
468-469).
L’attitude interprétative ne survient que lorsque l’entente est menacée, rompue ou biaisée. Ce
n’est que quand le doute s’installe que s’immisce entre moi et le monde une distance propice
à la méfiance : « et s’il me cachait des choses ? ». Mais il y a encore plus. Comme le souligne
Scheler, l’interprétation ne vient pas suppléer ex nihilo à la perception, mais elle s’élabore à
même la perception : j’ai bien perçu quelque chose qui me fait dire qu’il me ment, il y a des
indices à voir qui motivent cette posture. Il y a un sens qui se donne, que je perçois et qui
éveille l’interprétation. C’est encore et toujours la proximité avec les choses mêmes qui
engendre l’interprétation.
En d’autres termes, l’interprétation ne vient pas se surajouter artificiellement à une perception
qu’elle remplacerait soudain – à la manière d’un circuit de secours ou d’une « greffe »
(Ricœur, 1986) ; mais comme Heidegger (1985, §32) l’a bien montré, l’interprétation s’élève
sur fond d’une compréhension primaire qu’elle développe et qu’elle contribue à restaurer en
retour. Nous voulons simplement dire par là qu’il n’y a pas entre la perception et
l’interprétation une différence de nature, comme entre la perception et le raisonnement par
inférence. L’inférence présuppose une objectivation de la chose en rupture avec la
participation perceptive : ainsi un corps perçu devient autre chose dans l’attitude scientifique
– par exemple un composé d’organes dont je peux étudier les relations pour en découvrir des
constantes. Or, si l’attitude interprétative génère un léger écart entre moi et la chose, cet écart
n’est pas de l’ordre de la distanciation objectivante du monde de la vie – une idéalisation qui
suspend la participation ; car la distance qui nous pousse à devoir interpréter n’est pas encore
le fruit d’une élaboration conceptuelle : c’est la finitude de la vie elle-même qui engendre
nécessairement un écart entre moi et la chose (que ce soit la chose perçue, le texte ou autrui et
que cet écart soit perceptif, langagier ou comportemental).
4. L’intrication de la perception et de l’interprétation
C’est finalement ce que Husserl, à sa manière, avait très bien vu. La perception n’est pas
simplement un flux paisible de multiples concordances s’enchaînant les unes après les autres.
15
�Cette unité du vécu, ce présent vivant (Husserl, 1989, p. 69), ne se constitue qu’à la faveur de
discordances, plus ou moins importantes, qui se trouvent perpétuellement surmontées :
« Tout remplissement dans la progression s’accomplit donc dans le cas normal comme
remplissement d’attentes. Ce sont des attentes systématisées, des faisceaux d’attentes, qui en se
remplissant s’enrichissent aussi, c’est-à-dire que le sens vide devient plus riche en sens et s’intègre
dans la préfiguration du sens. Mais chaque attente peut aussi se décevoir et la déception suppose
de façon essentielle un remplissement partiel : si un certain degré d’unité ne se maintenait pas dans
la progression des perceptions, l’unité du vécu intentionnel serait brisée. Mais malgré l’unité du
procès de perception comportant cette teneur de sens unitaire qui demeure, une rupture
s’accomplit et le vécu de l’"autrement" en résulte. » (Husserl, 1998, p.114).
La perception rencontre partout des obstacles, comme lorsque je crois voir le sel et que je
m’aperçois qu’il s’agissait du sucre. Toutefois, ce genre de « déceptions » comme dit Husserl,
ne menacent pas réellement l’unité de mon vécu, car elles reposent toujours sur un
« remplissement partiel ». Par conséquent, les corrections et les réorganisations du champ
perceptif sont d’abord et le plus souvent passives, ne nécessitant en aucun cas un acte ou un
effort de ma part ; ces ajustements perceptifs se font en quelque sorte d’eux-mêmes, comme
lorsque je m’attendais à ce qu’il fasse chaud alors qu’il fait plutôt froid. La perception se
corrige spontanément, sans que nous soyons appelés à interpréter quoi que ce soit, du moins
tant que « le cadre général de sens est conservé et se remplit » (Ibid., p. 114)11.
Cependant, il arrive qu’un conflit naisse à l’intérieur de ce même flux perceptif. Je visite une
exposition au musée d’art contemporain : la salle présente des installations avant-gardistes qui
m’interpellent et motivent mon intérêt ; or, mon regard croise une caisse de bois sur laquelle il
est écrit « fragile » : fait-elle partie de l’installation ou n’est-ce qu’une caisse de bois servant
au transport des œuvres ? Ai-je affaire à un simple coffre ou à une œuvre d’art ? Mon accès
au sens de la situation est devenu problématique et motive par conséquent une recherche de
justification12.
11
Husserl utilise déjà lui-même des dérivés de deuten pour désigner cette correction de la perception : « Leur
sens se change en sens de « vert », « surface bosselée ». Bien sûr pas en actes explicites, mais si nous revenions
en arrière activement, nous trouverions de façon nécessairement explicite et consciente l’interprétation
(Deutung) changée. (…) la détermination de sens rouge est, dans cette perspective biffée et simultanément
réinterprétée (umgedeutet) : c’est ″autrement″ ». (Ibid., p. 115)
12
Un autre exemple nous est fourni par la sociologie : selon Bourdieu (1979), l’habitus de classe est prédisposé à
fonctionner spontanément dans des milieux spécifiques ; lorsque je suis confronté à une nouvelle situation,
mettons l’exemple stéréotypé de la table d’un restaurant gastronomique sur laquelle il y a une assiette
comportant divers couverts, ma perception se trouve obscurcie et nécessite un travail interprétatif.
16
�L’interprétation s’inscrit précisément dans cet « empêchement » de la perception comme dit
Husserl, lorsque, pour une raison ou une autre, quelque chose fait écran aux choses mêmes.
Nous sommes alors contraints d’interpréter pour essayer de rétablir l’évidence, l’accès à la
chose. Le psychiatre est obligé de recourir à l’interprétation, car il ne peut directement
percevoir ce dont il est question dans le vécu de son patient : ici les choses ne se donnent plus
d’elles-mêmes, le monde de la maladie mentale est pauvre en évidences, partiellement voire
totalement voilé. C’est pourquoi Binswanger, confronté à une patiente qui souffre de fuite des
idées, doit interpréter le peu qui se montre (les mots, le comportement) s’il souhaite avoir une
meilleure perception de ce qui se joue devant lui : la « légèreté » avec laquelle sa patiente
traite le personnel hospitalier et ses soi-disant « sauts » de pensée prennent tout leur sens à
l’aune de l’expérience qu’elle fait d’un monde plus étroit que le nôtre, où les choses et les
hommes sont en quelque sorte à disposition (Binswanger, 2000, pp. 35-119).
Par conséquent, Husserl nous invite à ne pas faire jouer l’interprétation contre la
perception ; l’une et l’autre sont dans un rapport étroit de motivation, l’envers et l’endroit
d’une même attitude. La perception motive l’interprétation parce que, en tant qu’hommes,
notre accès au monde n’est jamais définitivement garanti, parce que nous ne sommes jamais
en complète « symbiose » avec notre environnement : il se peut fort bien que la situation me
soit défavorable, que les choses n’aillent plus de soi et que me déplacer ne suffise plus. Mais
alors pourquoi interprétons-nous sinon pour être au plus près de ces choses qui nous
échappent, pour l’assurance d’un sens qui nous fait défaut ? Il n’y a pas à choisir entre la
perception ou l’interprétation, comme s’il fallait choisir entre voir le monde tel qu’il est ou
l’inventer. Car, rappelons-le, le monde antéprédicatif de la perception n’est pas un univers
informe de données sensorielles chaotiques que nous pourrions organiser à notre guise : les
nuages que l’on scrute présentent différentes formes selon qu’on les regarde, par exemple, de
gauche à droite plutôt que de droite à gauche, mais toutes les formes ne se laissent pas voir –
même si elles se laissent imaginer. Toute interprétation est guidée, en dernier lieu, par une
évidence du monde qu’elle tend à restaurer, à savoir « le sol d’une certitude de croyance qui
se maintient par là même et qui est finalement le sol de la croyance universelle au monde »
(Husserl, 1970, p. 107) ; en effet, même le conflit entre des visions du monde radicalement
divergentes présuppose encore et toujours l’évidence du monde lui-même « (…) comme
monde de vie pour une communauté humaine capable d’intercompréhension, notre terre, qui
17
�contient en soi tous ces différents univers personnels avec leurs modifications (…). » (Ibid., p.
194).
***
Concluons. Si le test de Rorschach interroge la philosophie de la perception, cette dernière
demande en retour que l’on s’interroge sur le sens de tests dit « projectifs ». Qu’y examine-ton au juste ? Que croit-on pouvoir mesurer ? L’épreuve du Rorschach n’est pas « projective »
dans le sens où le sujet viendrait complètement librement construire un sens ex nihilo : les
taches qu’on lui présente sont et restent des formes, quand bien même ce sont des formes à
l’état naissant. Selon le point de vue que nous avons voulu défendre dans ce travail, le
Rorschach possède le mérite de mettre le patient en situation problématique, face à un monde
qui a perdu de son évidence naturelle, et le contraint à un effort interprétatif ou imaginatif qui
peut s’avérer révélateur. Pourtant, que peut-on espérer tirer d’une situation artificielle qui
extrait cet effort de son contexte pratique quotidien ? Des informations sur l’inconscient du
patient ? Sur sa personnalité ? Un diagnostic fiable ? Une expertise médico-légale ? L’école
phénoménologique a pris l’habitude de renvoyer dos-à-dos la psychologie positiviste et la
psychanalyse. La subjectivité ne nécessite pas d’être objectivée pour être rigoureusement
étudiée : quand on pense pouvoir expliquer les fléchissements de l’existence humaine à partir
d’expériences sur des rats, on court toujours le risque d’inventer des êtres hybrides tels que le
rat dépressif ou le singe hypomane. Mais ce n’est pas une raison non plus pour accorder à la
psychanalyse que le sens du vécu serait caché « derrière » le sujet. La psychiatrie
phénoménologique affirme qu’il y a, chez chaque sujet, quelque chose qui se montre et qui
peut se voir – à la différence près que le critère phénoménologique de l’évidence n’est pas la
preuve construite et contrôlée de l’Evidence-based Medicine mais appartient au registre de
l’intuition intellectuelle qui anime tout effort de compréhension. Or, ce qu’il y a à voir et à
comprendre, c’est le genre d’être-au-monde malade, avec sa forme et ses structures propres,
qui s’esquisse plus ou moins nettement à même le langage et le comportement. Aussi le
philosophe se demande-t-il finalement si l’épreuve du Rorschach, lorsqu’elle met le sujet dans
cette situation singulière d’incertitude perceptive, n’est pas d’abord et avant tout une occasion
d’entrevoir quelque chose de ces mondes souffrants.
Bibliographie :
18
�Bernet, R. (1994). La vie du sujet. Recherches sur l’interprétation de Husserl dans la
phénoménologie. Paris : PUF.
Binswanger, L. (2000). Sur la fuite des idées. Trad. Dupuis. Grenoble : Millon.
Bourdieu, P. (1979). La distinction. Paris : Minuit.
Gadamer, H.-G. (1996). Vérité et méthode. Trad. Fruchon, Grondin et Merlo. Paris : Seuil.
Gallagher, S & Zahavi, D. (2012). The phenomenological mind. New York : Routledge.
Grondin, J. (1993). L’universalité de l’herméneutique. Paris : PUF.
Grondin, J. (2003). Le tournant herméneutique de la phénoménologie. Paris : PUF.
Imbert, M. (2e éd. : 2004). Neurosciences et sciences cognitives. In D. Adler (dir.)
Introduction aux sciences cognitives. (pp. 53-80). Paris : Folio.
Heidegger, M. (1985). Être et temps. Trad. Martineau. Paris : Authentica.
Husserl, E. (1950). Idées directrices pour une phénoménologie. Trad. Ricœur. Paris :
Gallimard.
Husserl, E. (1957). Logique formelle et transcendantale. Trad. Bachelard. Paris : PUF.
Husserl, E. (1962). La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale.
Trad. Granel, Paris : Gallimard.
Husserl, E. (1970). Expérience et jugement. Trad. Souches-Dagues. Paris : PUF.
Husserl, E. (1989). La Terre ne se meut pas. Trad. Franck, Pradelle, Lavigne. Paris : Éditions
de Minuit.
Husserl, E. (1993). Notes sur Heidegger. Trad. Depraz. Paris : Éditions de Minuit.
Husserl, E. (1996). Méditations cartésiennes. Trad. Peiffer et Lévinas. Paris : Vrin.
Husserl, E. (1998). De la synthèse passive. Trad. Bégout et Kessler. Grenoble : Millon.
Merleau-Ponty, M. (1942). La structure du comportement. Paris : PUF.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard.
Merleau-Ponty, M. (2002). Causeries. Paris : Seuil.
Moinat, F. (2010). Phénoménologie de l’attention aliénée. Edmund Husserl, Bernhard
Waldenfels, Simone Weil. In Alter : revue de phénoménologie, Vol. 18, Paris.
Petit, J.-L. (1999). L’esprit-cerveau est-il idéaliste ? In J.-N. Missa (éd.) Matière pensante.
(pp. 151-169). Paris : Vrin.
Ricœur, P. (1986). Du texte à l’action. Paris : Seuil.
Romano, C. (2010). Au cœur de la raison, la phénoménologie. Paris : Folio.
Sartre, J.-P. (1943). L’être et le néant. Paris : Gallimard.
Sartre, J.-P. (1948). Qu’est-ce que la littérature ?. Paris : Folio.
19
�Sartre, J.-P. (1990). Situations philosophiques. Paris : Gallimard.
Scheler, M. (2003). Nature et forme de la sympathie. Trad. Lefebvre. Paris : Payot.
Treisman, A. (2004). L’attention, les traits et la perception des objets. In D. Adler (dir.)
Introduction aux sciences cognitives. (pp. 53-80). Paris : Folio.
Zahavi, D. (2005). Subjectivity and selfhood. London : MIT Press.
20
�
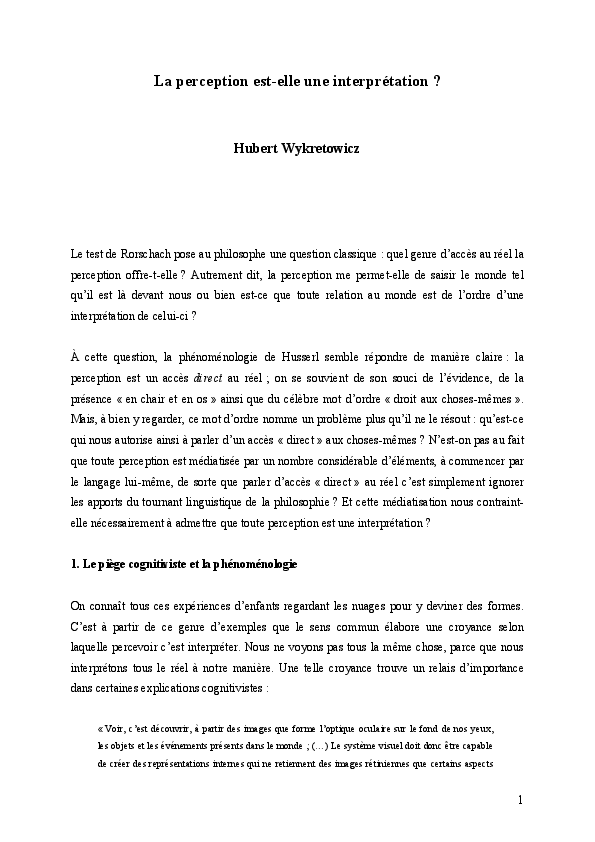
 hubert wykretowicz
hubert wykretowicz