�Jean Rouch
Maxime Scheinfeigel
DOI : 10.4000/books.editionscnrs.378
Éditeur : CNRS Éditions
Année d'édition : 2008
Date de mise en ligne : 22 mai 2013
Collection : Cinéma et audiovisuel
ISBN électronique : 9782271077905
http://books.openedition.org
Édition imprimée
ISBN : 9782271066435
Nombre de pages : 240
Référence électronique
SCHEINFEIGEL, Maxime. Jean Rouch. Nouvelle édition [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2008 (généré
le 02 mai 2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/editionscnrs/378>. ISBN :
9782271077905. DOI : 10.4000/books.editionscnrs.378.
Ce document a été généré automatiquement le 2 mai 2019. Il est issu d'une numérisation par
reconnaissance optique de caractères.
© CNRS Éditions, 2008
Conditions d’utilisation :
http://www.openedition.org/6540
�1
Inventeur du ciné-transe, cinéaste français inclassable, auteur d'environ 140 films dont les
indépassables Moi, un Noir et Cocorico ! - Monsieur Poulet, Jean Rouch s'impose comme l'un des
grands créateurs contemporains. Rouch « n'a jamais été vraiment identifié comme appartenant à
la communauté des cinéastes professionnels. C'était un franc-tireur. Un ethnologue cinéaste... Un
farceur sympathique », écrit Michel Marie dans sa Préface.
À quel genre appartiennent ses œuvres? Documentaire ou fiction? Quelle est la part
d'improvisation? Quels choix techniques sont privilégiés? Quelle parenté réelle ces films
entretiennent-ils avec la Nouvelle Vague? Quelle est sa postérité : Pasolini, Depardon?
Maxime Scheinleigel, familière de l'univers de ce cinéaste, nous offre ici une monographie
nourrie et sensible de Jean Rouch, un esprit universel au carrefour des cultures.
MAXIME SCHEINFEIGEL
Maxime Scheinfeigel enseigne à l'université de Montpellier, elle est historienne du
cinéma. Elle a publié Les Âges du cinéma (2002).
�2
SOMMAIRE
Préface
Michel Marie
Introduction
Chapitre premier. Genèse d’un cinéaste
ENFANCE ET JEUNESSE : UNE MYTHOGRAPHIE
LES MAÎTRES EN ANTHROPOLOGIE
LES MAÎTRES EN CINÉMA
Chapitre 2. Le contexte cinématographique
LE CINÉMA ETHNOGRAPHIQUE
LE NÉO-RÉALISME
MODERNITÉ DU CINÉMA
JEAN ROUCH ET LE CINÉMA DIRECT
JEAN ROUCH ET LA NOUVELLE VAGUE
Chapitre 3. Des itinéraires
LES « COPAINS »
DU DOCUMENTAIRE À LA FICTION
DU NIGER À LA SEINE
Chapitre 4. La fable documentaire
BATAILLE SUR LE GRAND FLEUVE
LA CHASSE AU LION À L’ARC
Chapitre 5. L’utopie identitaire
LA « CINÉ-TRANSE »
JAGUAR
PETIT À PETIT
Chapitre 6. Le montage
CHRONIQUE D’UN ÉTÉ
LES MAÎTRES FOUS
Chapitre 7. L’invention de la fiction. Moi, un noir
UNE EXPÉRIENCE
LE DOCUMENT DANS LE MIROIR DE LA FICTION
TROIS FOIS LE FILM INTÉRIEUR
UN RÊVE DE FILM
Chapitre 8. Le vertige du « temps réel »
GARE DU NORD
TOUROU ET BITTI, LES TAMBOURS D’AVANT
Chapitre 9. L’invention du mythe
D’UNE 2 CV À L’AUTRE
COCORICO ! MONSIEUR POULET
DIONYSOS
LE DÉSORDRE CRÉATEUR
L’AUTRE EN SOI
�3
Conclusion
Bibliographie
Filmographie sélective
Jean Rouch en films
Index des films cités
Index des noms
Remerciements
�4
Préface
Michel Marie
1
Maxime Scheinfeigel est une « rouchienne » de la première heure.
2
J’ai eu l’occasion de faire sa connaissance à son retour d’Afrique. Elle, elle y était vraiment
allée, contrairement aux personnages du film d’Alain Tanner, un peu oublié aujourd’hui.
3
Elle revenait de quelques années passées au Mali et s’apprêtait à inaugurer une carrière
de chercheuse en esthétique et histoire du cinéma. Le cinéma africain venait de
commencer. Son premier mémoire fut consacré à Borom Sarrett de Sembène Ousmane,
puis elle étudia Cabascabo d’Oumara Ganda.
4
Les collections de la Cinémathèque universitaire comprenaient une copie en 16 mm de
Moi un noir. L’objet de la thèse était tout trouvé. Elle fut soutenue quelques années plus
tard et le découpage du film publié, plan par plan et très détaillé, dans L’Avant Scène
cinéma.
5
Ce livre est à marquer d’une pierre blanche. En effet, c’est le premier livre entièrement
consacré à un immense cinéaste, célèbre et méconnu, Jean Rouch. Il existe plusieurs
numéros collectifs sur son œuvre, notamment deux CinémActions consécutifs, un volume
collectif italien, quelques ouvrages en anglais ; mais pour la bibliographie française,
aucun véritable livre. Maxime Scheinfeigel répare donc une anomalie de l’édition
française et il est heureux que ce livre soit publié par les éditions du CNRS, organisme
dont le cinéaste fut directeur de recherches pendant plusieurs décennies.
6
Les films de Rouch sont mondialement célèbres, étudiés dans toutes les universités qui
analysent le cinéma documentaire et son histoire. On travaille sur Moi un noir aux EtatsUnis, au Brésil, au Canada pour citer trois pays où j’ai eu l’occasion de le vérifier.
7
Certes, Rouch est loin d’être inconnu en France. Mais il n’a jamais été vraiment identifié
comme appartenant à la communauté des cinéastes professionnels. Il était un franctireur. Un ethnologue cinéaste. Il a toujours travaillé en format « substandard », le 16
mm. Il a fait des films avec deux ou trois personnes, parfois même seul. Il n’était pas un
« vrai professionnel » du « cinéma-cinéma ».
�5
8
En tant qu’ethnologue, il était assez souvent considéré avec une condescendance
ironique. Ses films étaient trop personnels, subjectifs, insuffisamment « scientifiques »,
parfois même complètement ratés, comme à certains égards et aux yeux de quelques
critiques, Les Veuves de quinze ans ou Dionysos, ce dernier naufrage. Bref, Rouch était un
farceur sympathique.
9
Il est vrai que son attitude institutionnelle pouvait apporter des arguments à ses
détracteurs, tant il manifestait une certaine désinvolture dans son magistère
universitaire, ses directions de thèse ou ses participations fort peu académiques à de
multiples jurys, et plus encore, dans certaines responsabilités un peu écrasantes comme
la présidence de la Cinémathèque française. Mais c’est précisément sa désinvolture, son
anarchisme intellectuel à la petite semaine qui font le prix de son cinéma. Car Jean Rouch
est un très grand cinéaste français, peut-être avec Robert Bresson, celui qui a le plus
marqué en profondeur toute l’histoire esthétique et formelle du cinéma français depuis
1945. C’est ce que ce livre démontre. Il y a un cinéma d’avant celui de Rouch et un cinéma
d’après lui. Deux titres ont tout fait basculer : en 1954, Les Maîtres fous et en 1958, Moi un
noir. Et je tiens Gare du nord comme le chef-d’œuvre des années 60.
10
Le livre de Maxime Scheinfeigel décrit bien la trajectoire professionnelle de l’ingénieur
des Ponts et Chaussées converti à l’anthropologie africaine en assistant pour la première
fois à un rituel de possession. C’est Jean Cocteau qui découvre le ton particulier de ses
premiers essais documentaires et introduit le jeune anthropologue dans les milieux du
cinéma d’avant-garde par le premier festival de Biarritz.
11
Maxime Scheinfeigel n’intègre pas directement Rouch dans l’école Nouvelle Vague. Rouch
est, en effet, un peu à l’extérieur et au-delà. Ses films précèdent ceux de l’école des Cahiers
du cinéma. Il n’a jamais vraiment cherché à construire une carrière de cinéaste
professionnel produit par des producteurs de cinéma, même si Pierre Braunberger l’a
soutenu tout au long de sa vie. Mais c’est justement cette extériorité institutionnelle qui a
marqué Rohmer, Rivette et Godard.
12
Rohmer dans son célèbre article Le Goût de la beauté prend La Pyramide humaine (avec
Exodus !) comme étalon de la modernité cinématographique en 1961. Ce n’est pas rien.
Plus tard, il sera fasciné par l’expérience de La Punition jusqu’à s’en inspirer lorsqu’il se
lance dans l’aventure du Rayon vert. Godard a été dithyrambique dans ses appréciations de
Moi un noir, où il évoque Rimbaud et Céline. Quant il entreprend Masculin féminin, c’est
pour faire les poches de Rouch et donner sa propre version des Veuves de quinze de quinze
ans. Car Rouch est d’abord un expérimentateur. Et les expériences auxquelles il se livre
sont aux sources même de la démarche esthétique de la Nouvelle Vague. Jacques Rivette
n’aurait jamais eu l’audace de se lancer dans la réalisation de ses longs feuilletons à
rebondissements, à partir de L’Amour fou, Céline et Julie, et bien entendu Out One, Spectre s’il
n’avait pas assisté à la Cinémathèque française et au Musée de l’homme aux projections
mouvementées des épisodes successifs des Sigui que tourne Rouch entre 1967 et 1973.
13
Rouch doit sa réputation internationale à Chronique d’un été, certes un film carrefour de
l’histoire du cinéma documentaire et du cinéma tout court, mais dont le projet appartient
d’abord à Edgar Morin. Il est assez atypique dans la filmographie rouchienne. Petit à Petit
est certainement plus proche du cinéma qu’il entendait promouvoir, un cinéma
d’anthropologie inversée, permettant aux Africains d’écrire leurs Lettres persanes en
observant ironiquement les mœurs parisiennes. Maxime Scheinfeigel insiste à juste titre
sur la bande de « copains », à la base même de la démarche créatrice du cinéaste. Il y a
�6
d’abord Rouch, mais son cinéma est autant celui d’Oumarou Ganda, de Damouré Zika, de
Lam Ibrahima Dia, d’Illo Gaoudel et de Safi Faye et ce n’est pas un hasard si deux d’entre
eux feront des films.
14
Maxime Scheinfeigel entre dans le foisonnement des films de Rouch en privilégiant
certains titres : La Chasse au lion à l’arc, Les Maîtres fous, Petit à petit, évidemment Moi un noir,
mais aussi Gare du Nord, Tourou et Bitti et Dionysos. Ce sont en effet les jalons essentiels de
l’œuvre. Mais il y a aussi une veine plus secrète, celle qui relie ces films à La Pyramide
humaine, et à la Punition pour culminer avec Gare du Nord, le chef-d’œuvre incontesté.
15
La connaissance de l’œuvre de ce cinéaste majeur n’en est qu’à ses premiers pas. Le
chemin sera aussi long et tortueux qu’un sentier de brousse. Avec ce livre, nous sommes
dans la bonne direction.
�7
Introduction
1
Jean Rouch est l’auteur d’environ cent quarante films. Son premier opus, Au Pays des
mages noirs (1947) et le dernier, Le Rêve plus fort que la mort (2002) se regardent aux deux
extrémités d’une œuvre désormais achevée et paraissent ainsi enclore son cinéma dans
un registre spécifique : l’anthropologie filmique. Les autres titres apportent deux
précisions capitales : la majorité des films a été tournée en Afrique de l’Ouest et a pour
objet l’observation ethnographique de faits rituels ou coutumiers. Le terrain
d’observation privilégié et presque exclusif de Rouch a été en effet une vaste région
subsaharienne dont il a conçu dès l’abord une approche spécialisée en s’intéressant aux
rituels de possession, fortement ancrés dans la tradition spirituelle des sociétés animistes.
Il a ainsi contribué de manière marquante à l’ethnographie africaine par le cinéma. Mais
la démarche de Rouch n’est pas si cadrée. Très tôt il déborde les limites de cette spécialité
scientifique du cinéma documentaire. En 1954 il réalise deux films s’inscrivant en effet
dans un autre registre que celui du cinéma ethnographique proprement dit. Il s’agit de
Jaguar, une première œuvre de fiction pourtant tournée selon des méthodes strictement
documentaires et Les Maîtres fous, un court-métrage notoire dont la dimension
sociologique et politique déplace les enjeux habituels de l’observation ethnographique. En
fait, dès ses débuts de réalisateur, Jean Rouch excelle à brouiller les cartes du jeu initial
qu’il a entre les mains. Il les déplace, les renverse, invente de nouvelles relations entre
elles. C’est ainsi notamment que le compte rendu ethnographique devient l’expression
d’une poétique personnelle d’approche des autres, les étrangers des lointaines contrées
exotiques que le cinéma ethnographique a l’habitude d’observer selon un protocole
d’approche scientifique bien établi, institutionnel. Or, à cet égard, Rouch bouleverse le
travail documentaire du cinéma ethnographique dans une intention précise : faire en
sorte que la voie soit toujours ouverte à la fiction. C’est dire que ce cinéaste atypique,
échappant à sa condition originaire, tout en ne cessant pourtant de la reconduire,
appartient autant à la communauté scientifique qu’à celle des artistes du cinéma. Dans ce
livre, il est surtout question de la seconde même si la première n’est pas ignorée. Y est en
effet évoqué l’auteur de cinéma que Rouch est devenu film après film, dans une période qui
voit la Nouvelle Vague justement promouvoir « la politique des auteurs ».
2
Tout commence donc avec l’ethnologie. Suivant la lancée de son premier tournage sur le
terrain en 1946, Jean Rouch continue à réaliser des films destinés à documenter le
discours ethnologique. Par exemple, Marcel Griaule, l’ethnologue « découvreur » du pays
�8
dogon est à l’initiative de Cimetière dans la falaise (1950), le premier film jamais réalisé sur
un rituel funéraire dogon. Rouch va même jusqu’à confirmer sa vocation scientifique en
rédigeant sous la direction de Marcel Griaule, une thèse consécutive à sa découverte de
l’altérité des sociétés africaines animistes, soutenue en 1953 et intitulée : Essai sur la
religion et la magie. Or, en même temps qu’il rend son tribut à la science, il contourne
d’emblée certaines contraintes du protocole d’observation scientifique. Toutefois, les
processus mis en place par lui, s’ils sont singuliers, « rouchiens » pour le dire autrement,
sont également liés à un contexte cinématographique encourageant particulièrement les
novations. Années quarante : essor et rayonnement du néo-réalisme ; années cinquante et
soixante : naissance et effervescence du cinéma direct et de la Nouvelle Vague. A propos de
Rouch, les faits sont établis : au tournant des années soixante, il devint un auteur
marquant du cinéma direct, notamment à travers une collaboration intense avec des
cinéastes d’Amérique du Nord, du Canada surtout, concernés comme lui par une refonte
radicale des bases du cinéma documentaire. Dans la même période, avec quelques autres
cinéastes français qui furent peu ou prou des « compagnons de route » de la Nouvelle
Vague, notamment Chris Marker, Alain Resnais, Jacques Rozier, Agnès Varda, Rouch
contribue activement à déplacer les frontières entre des genres que l’on croyait jusque-là
exclusifs l’un de l’autre. Il propose en effet de nouvelles figures filmiques d’expression du
réel. Tous ses films, fictions et documentaires pareillement, sont alors modernes, comme
d’autres le sont à la même époque, parce qu’ils portent la marque d’une profonde
déstabilisation : la vérité et la continuité spatio-temporelle des situations et de l’identité
des êtres à eux-mêmes ont perdu leur critère. Chez lui la modernité prend le caractère
affirmé d’une pensée hétérogène et hétérodoxe de la science et du discours
ethnographiques dont son travail de cinéaste est issu. Elle adopte aussi ce contour
hautement spécifique : au principe généralisé d’incertitude qui se met vite en place dans
ses films, répond peu à peu un autre principe, celui du mélange, de tous les mélanges.
3
C’est pourquoi le fil chronologique permettant l’entrée dans ses films n’est qu’une
commodité factuelle. Il ne permet pas d’appréhender le caractère profondément novateur
de l’œuvre, qui entend à la fois poursuivre le travail du cinéma ethnographique mais le
dépasser en récusant certaines de ses bases jusque-là largement admises. Dans le même
temps, par le même geste et selon la même pensée, Rouch veut inscrire son cinéma dans
un horizon d’invention filmique illimitée. Alors, pour peu que l’on prenne une certaine
distance et qu’on oublie notamment l’ordre chronologique des films et les frontières
entre des catégories bien visibles, déterminées selon des critères manifestes tels que la
variété des formats (court, moyen, long métrages), celle des genres (document
ethnographique, sociologique, fiction) et des lieux de réalisation (Afrique, France,
ailleurs), une question globale ressort. Elle aura occupé toute sa vie de cinéaste : c’est la
question de l’altérité. La co-présence de l’autre et le désir de récit qu’il suscite l’intéressent
plus que la seule approche ethnographique (l’ethnologie finit d’ailleurs par l’ennuyer) et
que le cinéma documentaire (il est fait pour être débordé). En corollaire, on voit ainsi que
ses méthodes de travail et les figures déployées par lui sont déterminées par son goût
inlassable de la fable appliqué à un fantasme, une utopie peut-être, d’identification à
l’autre selon une stratégie de fusion. Rouch, le filmant, l’observateur, l’ethnographe veut
être à la place où se tient l’autre, le filmé, place toute imaginaire où le cinéma moderne
excelle à mélanger les régimes d’images actuelles et mentales. Il y a plus : selon un
principe de réversibilité, il cherche à faire en sorte que le filmé devienne à son tour un
observateur, un pseudo-ethnologue (Jaguar et Petit à Petit) ou un pseudo-cinéaste (Moi, un
noir). C’est là le ressort essentiel de la double subversion, ethnologique et
�9
cinématographique, qu’il met en œuvre et qui le fait très vite remarquer (1954 : scandale
des Maîtres fous).
4
À cet égard, on observera ici quelques-uns des traits saillants qui singularisent l’œuvre de
Rouch. Ils participent d’une méthode de travail qui se met en place film après film, selon
les aléas du tournage de chacun d’entre eux. Il s’agit notamment de « l’effet feed-back »
amorcé dans Bataille sur le grand fleuve et poursuivi dans Moi, un noir, de la « ciné-transe »
qui court comme un fil rouge dans toute l’œuvre rouchienne depuis Bataille sur le grand
fleuve (1951) jusqu’à Dionysos (1984). Il s’agit aussi du tournage en temps réel, d’abord
expérimenté dans une fiction de 1964, Gare du Nord, puis repris dans un document
ethnographique de 1969, Tourou et Bitti. L’effet feed-back, la ciné-transe et le temps réel
apparaissent comme autant de pratiques innovantes permettant de repousser les limites
ordinaires du cinéma ethnographique de manière à parvenir à cette « anthropologie
partagée », que Rouch appelle de tous ses vœux. Dans la métropole coloniale qu’est alors
la France, la nouveauté de ses premiers films tournés en Afrique n’est pas mince. Elle
s’inscrit certes dans l’évolution globale du cinéma documentaire, qu’infléchissent de
manière décisive les méthodes du cinéma direct alors largement employées par de
nombreux documentaristes, tout en présentant une marque personnelle. C’est que le
cinéma de Jean Rouch est justement traversé par des tensions qui ne relèvent que de sa
seule poétique, et de l’expression artistique de soi. Ainsi dans ses films un observateur
attentif peut repérer un travail des formes liant inextricablement deux lignes de force : le
processus du cycle et la pensée du mythe. Ce que nous caractérisons ici comme « la fable
documentaire », « l’utopie identitaire », « le vertige du temps » ou encore, ce qui apparaît
comme l’utilisation parfois sauvage du montage, sont des passages obligés vers un
nouveau type d’actualisation de la pensée filmique issue du documentaire. Jean Rouch ne
cesse en effet de mettre en œuvre de vastes récits troués et interminablement adressés en
priorité à l’imagination du spectateur.
5
Son cinéma n’oublie pourtant pas le milieu scientifique où il est né et s’est développé, au
contraire, il y puise dès le départ les conditions mêmes de l’invention filmique qui
nourrira la plupart de ses films. Mais c’est seulement en fin de parcours, ou presque,
qu’émergera une vérité concernant le type d’auteur qu’il fut. Observateur de conduites
rituelles guidées par la toute-puissance de la pensée animiste, il se livra lui-même à l’idée
que la pensée suffit à mettre le monde, les choses et les êtres en mouvement. Dans une
fiction de 1984 au titre explicite, Dionysos, Rouch se confronte directement à une force
créatrice qu’il assume pour son propre compte de cinéaste libertaire. Ivresse revendiquée
d’un cinéma qui en vient enfin à cerner ce qui fut le désir essentiel et constant de son
auteur : « l’invention du mythe » que figure Dionysos. Le curieux film éponyme, peu
réussi, ou maladroit, bancal peut-être, comme on le dit de quelqu’un qui est ivre, est
pourtant une clé qui ouvre une porte laissant filtrer une lumière inattendue à la faveur de
laquelle tous les films antérieurs paraissent s’ordonner dans un paysage désormais
recomposé. Ce paysage est à la mesure de la construction d’une œuvre traversée de bout
en bout par des actions que détermine une volonté d’art, grand paradoxe d’un cinéaste
peu enclin à peaufiner les images et les sons de ses films, peu attaché à la belle forme, à la
forme parfaite.
6
C’est ainsi qu’en entrant dans l’univers filmique de Jean Rouch hybride et contrasté, à la
fois à la marge et au cœur de l’effervescence cinématographique des années cinquante et
soixante, on s’engage à revisiter le cinéma moderne, à le regarder du moins sous un angle
différent, inhabituel peut-être. A cet effet, il importe d’oublier le cinéaste encombrant de
�10
l’ethnographie africaine, celle du Niger et du Mali principalement, qu’il a annexée aux
yeux de certains collègues ethnologues, à la fois comme mandarin universitaire en France
et comme voyageur privilégié dans l’Afrique coloniale et post-coloniale. L’idée d’un
cinéaste pittoresque et inclassable, le « griot gaulois » dont il a lui-même activement
contribué à forger l’image est tout autant réductrice. Il serait plus juste de voir en lui un
des rares cinéastes qui élargit l’horizon français du cinéma moderne. Il va en Afrique et
passe une partie de sa vie de cinéma avec des Africains, une autre partie avec des
Européens ou des Américains du Nord. En outre, il renouvelle la notion même
d’« étrangeté » à travers des figures du couple observateur-observé tout à fait inédites
qu’il transpose sans difficulté, avec une élégance toute particulière même, dans des
fictions parfois sidérantes, parfois drolatiques ou amères, souvent heureuses et
désinvoltes.
7
Mais l’œuvre de Jean Rouch est l’objet d’un paradoxe étonnant. Elle est bien connue en
France et à l’étranger, particulièrement en Italie, au Canada ou aux Etats-Unis, au Brésil.
Or, elle n’a suscité jusqu’à présent que des articles soit isolés, soit réunis dans des revues
ou encore mis en ligne sur des sites thématiques de l’Internet, plus rarement des
chapitres de livres. Les textes sont d’autant plus nombreux qu’ils sont écrits par des
collaborateurs de Rouch, des critiques, des historiens du cinéma, des spécialistes du
cinéma documentaire, des ethnologues. En revanche, aucun auteur n’a isolément écrit un
livre qui soit une approche exclusive de son cinéma. C’est dire que l’on a sans doute trop
souvent jusqu’ici évalué l’importance de son œuvre seulement à l’aune de l’anthropologie
filmique, et que l’on a éventuellement négligé de voir en elle ce qui la désigne comme une
œuvre de cinéma, à part entière. Il convient maintenant de la poser à sa juste place dans
ce qu’il est convenu de considérer comme l’histoire du cinéma, de ses formes, de ses
idées, de ses pratiques, de ses enjeux. À cet égard, le cinéma de Jean Rouch est comme un
nœud ferroviaire : des grandes lignes en partent ou y aboutissent et des petites lignes
prolifèrent, vont se perdre dans des confins lointains, improbables, rares en un mot. Les
unes n’ont pas plus ou moins d’importance que les autres. Par exemple, savoir que Jean
Rouch n’a jamais tourné de films en vidéo est un détail, modeste comme peut l’être une
ligne secondaire de chemin de fer. Mais ce détail emmène le voyageur vers une ligne
principale, celle qui relie les films de Rouch au devenir télévisuel du cinéma 1.
NOTES
1. Pas d’ouvrages singuliers, venons-nous de dire. Il existe cependant de nombreux écrits dont
émergent quelques réflexions majeures sur le cinéma de Rouch. Trois parmi d’autres ont marqué
d’une empreinte incessante l’inspiration de ce livre. Les pages qu’André Labarthe a consacrées en
1960 à Moi, un noir dans son Essai sur le jeune cinéma français ; un article de Jean-André Fieschi
« Dérives de la fiction. Notes sur le cinéma de Jean Rouch », publié en 1973 dans Cinéma, Théorie,
Lectures ; le chapitre VI de Cinéma 2 -L’image-temps, dans lequel Gilles Deleuze réunit Orson Welles
et Jean Rouch sous la bannière des « puissances du faux ». D’autres écrits ont été des instruments
d’information très précieux, les deux suivants surtout : L’Aventure du cinéma direct publié en 1974
par Gilles Marsolais et la filmographie établie en 1996 par René Prédal dans Jean Rouch ou le ciné-
�11
plaisir. Un livre récent est venu apporter un éclairage singulier, imprenable sans doute, sur la
geste rouchienne. C’est Jean Rouch tel que je l’ai connu, un mémoire autobiographique que Jean
Sauvy a écrit après la mort du cinéaste, publié en février 2006. Autre source, au parfum
indéfinissable, celui-là : Jean Rouch lui-même. Il aimait raconter, pas tout raconter, mais plutôt
ce que l’on peut appeler des « anecdotes choisies » dont il se plaisait à répéter le récit, à le
peaufiner. De nombreux entretiens enregistrés (radio, télévision, colloques) ou publiés en
attestent. S’il arrive qu’une information soit transformée d’un entretien à l’autre, jamais on n’en
trouve qui soit contredite. Par-delà l’épreuve de vérité qu’appelle immanquablement son art de
la fable, Rouch est lui-même un « informateur » de premier ordre sur son œuvre. C’est sans doute
la moindre des choses que l’on peut attendre d’un ethnologue dont le travail consiste justement à
recueillir auprès de ses informateurs des faits qu’il lui revient de problématiser, ne fût-ce qu’en
vérifiant leur authenticité.
�12
Chapitre premier. Genèse d’un cinéaste
ENFANCE ET JEUNESSE : UNE MYTHOGRAPHIE
1
Jean Rouch a souvent évoqué des souvenirs que sa mémoire a organisés en un récit
d’aventures quasi picaresques. Son goût prononcé pour la transmission orale a fait de lui
le récitant et le commentateur hors pair de sa propre vie, dont il n’a cessé, en effet, de
mettre des épisodes saillants en relation avec son travail cinématographique. Il est parti
de loin puisque c’est dans sa propre enfance qu’il enracine sa prédestination au voyage,
en mentionnant dans de nombreux entretiens, publiés ou filmés1, une circonstance
favorable à cet égard : « le fait d’être le fils d’un officier de marine explique que j’ai eu la
chance de beaucoup voyager quand j’étais petit ». Cette précision biographique est
l’occasion pour Rouch de mentionner tout ce qui a contribué dans sa lointaine enfance à
la formation de son imaginaire. Du côté du père, un récit prestigieux : « il fait le tour du
monde sur la Jeanne d’Arc... part au pôle sud avec Charcot [sur le Pourquoi-Pas] comme
météorologue et océanographe ». Ce père, pour ainsi dire idéal, fut aussi son initiateur en
matière de cinéma documentaire :
Le premier film que j’ai vu de ma vie, c’est Nanook. Mon père avait été équipé par les
explorateurs, par Amundsen en particulier (...) et j’ai fait du ski moi-même avec des
skis qu’Amundsen avait donnés à mon père. Donc, fasciné, j’ai vu Nanook dans un
cinéma de la rue de Siam à Brest avec mon père. Je devais avoir six ans, six ou sept.
Ça m’a terriblement impressionné.
2
Du côté de la mère, l’introduction au cinéma est aussi déterminante, quoique à l’opposé
de celle du père :
Ma mère... était, comme toutes les femmes de cette époque, amoureuse de Douglas
Fairbanks. Et on passait dans ce même cinéma, quinze jours après, Robin des bois. On
va donc voir le film, et tout d’un coup je me mets à pleurer. Ma mère [m’interroge].
Je lui dis : « Les soldats que Robin des bois jette par-dessus les créneaux se tuent.
C’est triste ». Elle me dit : « Ce n’est pas vrai. Ce sont des mannequins. » Et elle
m’explique comment c’était fait. Alors moi, je lui dis : « Nanook, est-ce que c’était
vrai ? ». Elle me dit : « Tu demanderas à ton père ». Et mon père m’explique la
différence entre un film documentaire et un film de fiction. (...) Dès le départ, je
vois qu’il y avait ces deux catégories de film. Mais j’avais marché aux deux.
�13
3
Ce récit d’initiation présente au moins deux traits intéressants. D’abord les références
transforment le père en un héros significativement ambivalent : d’un côté, Charcot, le
pôle sud, le Pourquoi-Pas et Amundsen pour le vrai marin et le scientifique ; de l’autre, la
rue de Siam à Brest pour le marin imaginaire, de littérature ou de bande dessinée, à la
manière d’un Corto Maltese par exemple. Ensuite, le double parrainage de Nanook et
Robin des bois, deux créatures filmiques qui ont hanté Rouch tout au long de sa vie
puisque, âgé, il parvient encore à s’en émouvoir. Problème, cependant : si les
renseignements biographiques ne sont pas difficiles à trouver tant Rouch n’a jamais été
avare de confidences, ce dernier est paradoxalement susceptible de décourager n’importe
quelle entreprise biographique, un peu comme Eisenstein, ayant analysé de la manière
que l’on sait ses propres films, est susceptible d’intimider les exégètes de son œuvre. En
effet, Rouch opère de lui-même la clôture du récit biographique, il en délivre le sens et
l’orientation en faisant remonter toute son œuvre à une source déterminante, selon lui,
puisqu’elle est désignée comme l’origine même du monde qu’il va construire : c’est le
petit garçon, revenant de la rue de Siam et s’identifiant – se souvient-il – aux chiots de
Nanook au point de s’endormir dans la même position qu’eux. Par la suite, dans son
énumération minutieuse des étapes de sa trajectoire enfantine, Charcot, Amundsen,
Douglas Fairbanks paraissent autant de fétiches inaliénables, avec cette particularité pour
Charcot, que Rouch enfant l’a connu en chair et en os. Il se souvient notamment du
parfum de tabac qu’il exhalait et du piquant de sa barbe, taillée, remarque-t-il, comme
celle de Freud !2 L’exactitude du passé recomposé importe moins ici que l’inlassable
propension de Rouch à construire le récit de ses faits et gestes en les éclairant selon une
ligne de partage, jamais démentie, entre une sorte d’objectivité factuelle – oui, il y a une
rue de Siam à Brest, oui, son père, officier de marine, était un scientifique, et une
invention poétique due à des rapprochements inattendus mais pointus – oui, un petit
garçon peut bien s’endormir plutôt en « chien de Nanook » qu’en « chien de fusil », oui, la
barbe de Charcot vaut bien celle de Freud ! On a ici la formule hybride de son œuvre à
venir que sa formation, elle aussi unifiée par des contrastes, annonce pareillement.
4
En effet, Jean Rouch fait à l’école des Ponts et Chaussées des études scientifiques qui lui
confèrent le titre d’ingénieur des Travaux Publics, mais pendant ce temps il se promène
aussi dans l’effervescence artistique et culturelle du Paris des années trente. À savoir,
selon ce qu’il en dit lui-même, il suit les cours de Marcel Mauss, il est un ami de Pierre
Kast, il rencontre Henri Langlois, il connaît Michel Leiris, il lit les poètes surréalistes.
Même chose dans les années quarante, où le cercle de ses relations s’agrandit : Théodore
Monod, Marcel Griaule, André Leroy-Gourhan et aussi Jean Cocteau. Or, le contexte
historique intervient lourdement sur ces années de formation. Jean Rouch explique
longuement à Pierre-André Boutang pourquoi il s’est retrouvé en Afrique en 1942 à
diriger cinq mille hommes construisant des routes et des ponts, comme les Egyptiens
antiques construisaient les Pyramides. Et voilà qu’émerge dans son récit de jeunesse, la
localisation de la deuxième origine de son œuvre. C’est la découverte par lui, l’ingénieur
blanc, le parfait toubab3 ignorant des us et coutumes locales, d’une réalité étrangère
insoupçonnable pour lui : l’animisme africain qui, dit-il, va faire entrer l’ethnographie
dans sa vie « un peu par hasard ». Et quel hasard ! Rouch raconte :
Dans un village, un homme avait été tué pendant l’orage, personne ne savait si
c’était la foudre qui l’avait tué ou s’il était mort noyé (donc tué par le génie de
l’eau). Un copain nigérien nous a dit de faire appel à sa grand-mère, une
merveilleuse lady africaine. Elle arrive (...). J’ai ressorti mon Voïtlander 6 x 9, et suis
parti assister au premier rituel de possession d’esprit de ma vie. Je n’y comprenais
�14
rien, mais c’était formidable. (...). C’est à cette occasion que j’ai écrit mon premier
texte d’ethnographie. Je l’ai envoyé à Théodore Monod [et] à Marcel Griaule 4.
5
Faut-il y insister ? D’abord, pour Rouch, l’ethnographie s’improvise comme, peu de temps
après, le cinéma s’improvisera lui aussi. Or, l’improvisation repose sur un pacte d’amitié
et l’amitié conditionne le regard ethnographique : « C’est en devenant ami [avec des
Africains] que j’ai eu l’occasion d’assister à un rituel de possession. Je me suis passionné
pour l’ethnographie... »5. En la matière, une révolution douce est en train de germer
puisque d’une part, la distance que doit garder l’observateur scientifique par rapport à
l’observé est abolie et d’autre part, la méthode d’observation n’est pas étayée par un
savoir anthropologique magistral qui viendrait l’informer. En somme, après avoir appris à
dormir comme les chiots de Nanook, Jean Rouch déboule tel un chien fou dans l’institution
ethnographique. Dans Jean Rouch tel que je l’ai connu, Jean Sauvy, son condisciple à l’Ecole
des Ponts et Chaussées, fait un récit circonstancié de cette façon de procéder dans la
marge. C’est en auditeur libre en effet que Rouch assiste à des conférences de Marcel
Griaule. Au Niger, il est censé construire des ponts mais il écrit à Sauvy dans une lettre de
1943 : « Je travaille mal à faire un peu d’ethno et, quand même, je pourrai peut-être
publier un bouquin de deux cents pages, contribution à l’étude de la magie des Sonraï,
étude uniquement descriptive, le plus Griaule possible ». Un peu plus loin dans la même
lettre, il mentionne un travail qu’il souhaite « potable » sur « Harakoy (Dieu Sonraï du
Tonnerre) », il va même jusqu’à relever une erreur dans un livre sur le « plateau central
nigérien » écrit en 1907 par un militaire ; il parle à nouveau de Griaule : « Vive Griaule.
Mais qu’il est vache de rédiger quelque chose tout à la fois précis et flou »6. Cette
première expérience du terrain et de l’acquisition d’un savoir spécifique par une
observation rapprochée est placée sous l’autorité intellectuelle d’un ethnologue de
renom, d’un maître à penser. Jean Rouch est clairement son élève. Or, seulement trois
années plus tard, il est suffisamment autonome, ou émancipé, pour se lancer avec deux
amis dans une véritable expédition ethnographique dont il est le maître d’œuvre. Cet
épisode marque un tournant irréversible dans sa vie.
6
Le 16 juillet 1946, à l’aérodrome du Bourget, Jean Sauvy, Pierre Ponty et Jean Rouch
montent à bord d’un vieil avion militaire rafistolé. Quatre jours plus tard, ils débarquent à
Niamey, capitale de la colonie du Niger. Motif officiel de leur voyage : écrire des articles
pour l’Agence France-Presse avec laquelle ils ont signé un contrat d’exclusivité. Leur nom
de plume sera « Jean Pierjant ». Motif réel : mener une expédition qu’ils avaient projetée
en 1943, lors de leur séjour commun à Bamako, alors chef-lieu du Soudan français. Il s’agit
pour eux de descendre en pirogue le fleuve Niger et chemin faisant de faire des
observations ethnologiques et sociologiques. Ils ont trente ans, ils sont ingénieurs des
Ponts et Chaussées, les quelques cours d’ethnologie qu’ils ont suivis en Sorbonne sont
leur seul viatique en la matière, tous les trois ont servi l’administration coloniale en
Afrique entre 1941 et 1943, ils ont été mobilisés en 1943 dans l’armée française d’Afrique
et se sont retrouvés à Paris en 1945. Avant de partir, Rouch a insisté auprès de ses deux
camarades pour qu’ils embarquent dans leurs bagages, pourtant déjà bien encombrants,
une caméra 16mm achetée d’occasion. Pierre Ponty s’est chargé de faire des photos de
leur expédition dont Jean Sauvy est l’organisateur et l’intendant.
7
L’aventure a bien eu lieu telle qu’elle avait été conçue. Elle a duré plusieurs mois, à
travers plusieurs pays et sur plusieurs milliers de kilomètres. Les trois voyageurs ont le
plus souvent navigué sur le fleuve, parfois ils ont pris le train ou roulé en voiture, ou
encore, ils ont marché à pied. Flanqués de leurs guides, des « informateurs » selon le
�15
vocabulaire ethnologique, et des aides recrutés sur place, ils ont été confrontés, à leur
demande, à des événements coutumiers ou rituels. Deux de ces événements sont
particulièrement mémorables : une chasse à l’hippopotame et une chasse au lion. De la
première, Jean Rouch filme tout ce qu’il peut, comme il peut, depuis la préparation des
pirogues, des harpons et des pêcheurs eux-mêmes jusqu’à la capture finale d’un gros
hippopotame. Son premier film, le court-métrage Au pays des mages noirs, en atteste. Du
deuxième épisode, la chasse au lion, il y a des images, mais pas de film pour autant. Deux
raisons à cela. Le tournage s’est le plus souvent effectué au crépuscule ou pendant la nuit
et la pellicule n’était pas assez sensible pour être alors convenablement impressionnée. Et
surtout, cette chasse n’a pas vraiment eu lieu. Des chasseurs expérimentés ont bien
emmené les trois amis à la rencontre d’un lion mais il ne s’est rien passé car personne n’a
tiré. Le lion s’en est alors allé...
8
Ainsi, c’est dans le cadre d’une telle expédition semiimprovisée que débute la carrière de
Jean Rouch, cinéaste. Or, s’il a quelques lumières en ethnographie, en revanche il n’en a
aucune en matière de pratique cinématographique. Trait notable : il tire doublement
parti de son impréparation. D’abord, il va bien vite transformer les péripéties du filmage
d’Au pays des mages noirs en un récit qui rejoint les récits d’origine de son enfance. Mais
surtout, il va profiter des errements de cette première réalisation pour en tirer de
durables leçons de cinéma. Le film est tourné dans les circonstances particulières d’un
rapport direct à une réalité qui ne cesse de se transformer et qui est instable comme peut
l’être la course d’une pirogue poursuivant un hippopotame. Rouch s’adapte comme il peut
à ce mouvement perpétuel et il surenchérit même en ne cessant de braquer sa caméra
tantôt vers une rive du fleuve, tantôt vers la rive opposée. Deux savoirs lui font alors
défaut : la pratique du tournage en caméra portée7 et la conscience des nécessités du
montage filmique. C’est ainsi qu’il se rend compte, mais seulement après coup, que les
images tournées par lui sont trop instables et, circonstance aggravante, elles ne peuvent
pas être raccordées selon la logique spatio-temporelle d’un récit continu. Il en tire alors
une première leçon pratique de cinéma : il faut tourner les images en concevant leur
montage au moment même de leur réalisation. Tous ses films à venir vont obéir à cette
leçon inaugurale. Sa vision du film dans une salle de cinéma est l’occasion d’une
deuxième leçon, définitive elle aussi. Un producteur de cinéma avait acheté le film qu’il
avait projeté en première partie du Silence de la mer de Jean-Pierre Melville. Or, la
production avait sonorisé Au Pays des mages noirs avec une musique exotique et rythmée,
qui n’avait rien à voir avec les « mages » en question. Par ailleurs, une voix off
commentait les péripéties de la pêche à l’hippopotame comme un speaker de la radio (ou
de la future télévision) eût commenté celles d’une rencontre sportive. Ce commentaire
non pertinent fait d’emblée comprendre à Rouch qu’il faut aller chercher dans la réalité
filmée les sons qu’elle produit. Peu de temps après, il prend une autre décision
fondamentale qui va vite constituer une des spécificités essentielles de son cinéma : il
entre dans un territoire sonore que le réalisateur de films documentaires s’interdit en
principe puisqu’il s’empare de la voix off, décidant qu’elle serait désormais la sienne. Ces
leçons initiatiques, apprises au cœur même de l’action, les décisions qu’elles entraînent,
sont durables, elles confortent Jean Rouch dans un choix qui va conditionner toute sa
carrière de cinéaste et qui lui vient de sa formation mathématique : c’est la méthode « des
approximations successives » dont il a souvent parlé.
9
Le hasard des rencontres élevées au rang de coïncidences favorables unifie les deux récits
d’apprentissage de Rouch, le scientifique et le cinématographique. Sa rencontre avec
�16
Marcel Griaule qui procède à son adoubement dans le territoire réservé de l’ethnographie
en lui confiant la réalisation de Cimetière dans la falaise, précède de peu, en effet, une autre
rencontre majeure, dans le milieu du cinéma cette fois, avec Jean Cocteau. Celui-ci,
président du jury du « festival du film maudit » en 1949, inscrit dans la compétition
Initiation à la danse des possédés que Rouch a tourné en 1948. Ce court-métrage de 25
minutes remportera le Grand Prix. Des « possédés » du film au « maudit » du festival,
quelle rencontre, en effet ! Autre type de coïncidence, évoquée non sans raison, par
Rouch : en 1949, Jacques Becker tourne Les Rendez-vous de juillet dont le personnage
principal est un étudiant en ethnologie qui cherche à monter une expédition en Afrique
avec trois de ses camarades. Et Jean Rouch de constater que « les personnages du film,
c’est nous, Ponty, Sauvy et moi »8. À cet égard, Jean Sauvy apporte là aussi un élément
biographique intéressant à travers une anecdote de janvier 1943. Les trois amis se
retrouvent à Bamako, ils montent au « Point G », un lieu au bord d’une falaise qui
surplombe la ville (et qui a donné son nom par la suite au principal hôpital de Bamako
édifié sur son emplacement), « [ils] laissent courir [leur] imagination.
10
Et, inspirés par la vue du fleuve Niger majestueux et un brin mystérieux, [ils se voient] en
train de parcourir son ruban en pirogue, sur la totalité de son parcours, l’étudiant, le
scrutant, lui, ses usagers, ses riverains, le domestiquant en quelque sorte et, à travers lui,
[s’appropriant] un filament de cette Afrique, etc. ». Sauvy ajoute : « C’est ce que nous
appellerons plus tard “le serment de Bamako” »9, et qui sera honoré trois ans plus tard
sur les eaux du fleuve Niger.
11
Ainsi, la geste cinématographique, commencée avec Robin des bois et l’esquimau Nanook,
poursuivie avec la fréquentation d’Henri Langlois et le parrainage bienveillant de Jean
Cocteau, pourra naturellement se conforter avec la rencontre des jeunes critiques des
Cahiers du Cinéma, en même temps que la carrière scientifique de Rouch se dessine et
s’affermit. Il fait intensivement du terrain en Afrique, commençant à tracer et délimiter
son propre territoire d’ethnographe. Corrélativement, il rédige sa thèse dont la
soutenance en 1953 fait de lui le cinquième docteur d’état en ethnologie, dans une lignée
prestigieuse qu’il se plaît à énumérer avec exactitude. L’ont précédé Griaule en 1938,
Leroy-Gourhan en 1945, Lévi-Strauss en 1947, Dieterlen en 1951. Il n’est sans doute pas
très difficile pour lui de se concevoir comme le membre d’une confrérie universitaire
rare, dont il infléchit les productions caractéristiques en lui apportant une nouveauté
incontestable. C’est le cinéma, qu’il fait passer du statut de simple support à celui de
mode d’expression à part entière. Griaule et Lévi-Strauss, en choisissant une écriture
littéraire, avaient les premiers déplacé les enjeux et les problématiques de l’ethnographie
et s’étaient tournés vers un public non spécialiste mais cultivé. Avec la forme de récit
filmique qu’il invente, Rouch démultiplie les effets d’un tel déplacement. D’abord, il
autorise l’ethnographie à glisser insensiblement vers « l’ethno-fiction », phénomène déjà
perceptible dans les documents des débuts tels que Bataille sur le grand fleuve et un peu
plus tard Les Maîtres fous, et qui s’avère pleinement dans Moi, un Noir et La Pyramide
humaine. Ensuite, Rouch est un agent essentiel du recentrement de l’ethnographie,
processus qu’esquissait déjà La Pyramide humaine et qui se renforce lorsqu’il tourne à
Paris, en 1960, Chronique d’un été avec Edgar Morin. Sur ce film, qui est un des plus
commentés de son œuvre, il faut souligner ici un caractère essentiel : Chronique d’un été
est sans doute le maillon manquant entre le cinéma documentaire et la télévision, faisant
passer la « micro-ethnographie » encore confidentielle à ce moment-là, aux prémisses de
l’ère médiatique, dont le « micro-trottoir », genre proprement télévisuel est
�17
emblématique. Or, ce type de reportage est déjà bien esquissé dans Chronique d’un été. Mais
Rouch, qui n’aimait pas la caméra vidéo, n’est pas devenu pour autant un réalisateur de
télévision.
12
Coïncidence à relever : Rossellini, qui préférait le 16 mm au 35 mm, a pour sa part vite
compris que la télévision était « une évolution du cinéma » et qu’elle allait lui permettre
de faire en sorte que « la caméra n’ait qu’un droit : celui d’enregistrer uniquement ce qui
se passe »10. Dès 1964, il ne tourne plus que des films de télévision. Pendant ce temps,
Rouch, réalise presque exclusivement en 16mm des films extraordinairement variés et
pourtant toujours recommencés à partir d’un modèle fondateur identifiable à quelques
traits majeurs, dont ceux-ci : il regarde les Européens comme il regarde les Africains ; il se
promène sans difficulté entre le Musée de l’Homme et la Cinémathèque française, entre
l’anthropologie visuelle et le récit filmique, désormais étroitement corrélés par
l’ethnofiction ; il réalise même de pures fictions, tel en 1964 l’exceptionnel court-métrage
Gare du Nord qui trouve un écho saisissant en 1968 dans un bref film ethnographique
d’une dizaine de minutes, Tourou et Bitti11. Rouch, comme Rossellini, mais selon une
trajectoire inversée, parvient bien à renverser l’ordre dans lequel s’inscrivent son travail
et la démarche qui le sous-tend. Ce renversement s’apprécie, bien entendu, au grand
écart mesurable dans les œuvres elles-mêmes entre les modèles du passé dont elles sont
issues et l’avenir vers lequel elles entraînent tout un pan du cinéma. Entre les deux bords
se déploie un territoire qui tire sa configuration autant de la singularité des traits qui lui
sont propres que de ses connexions avec d’autres lieux du cinéma.
LES MAÎTRES EN ANTHROPOLOGIE
13
Jean Rouch est d’abord un ethnographe. Il l’est resté tout au long de sa carrière qui s’est
principalement exercée sur deux terrains d’observation, l’Afrique de l’Ouest et la France,
et dans trois secteurs d’activité : le cinéma, l’enseignement universitaire et la recherche.
Son premier film et les circonstances de sa réalisation sont suffisamment spécifiques à cet
égard. Au Pays des mages noirs est le fruit d’une démarche ethnographique qu’il avait déjà
spontanément adoptée en 1942, d’ailleurs moins en allant photographier la transe d’une
vieille femme, qu’en envoyant à Théodore Monod et Marcel Griaule ses réflexions
d’apprenti ethnographe confronté à un rituel exotique. Aussi, lorsqu’il revient au Niger
après la guerre, et après avoir suivi les cours de Marcel Mauss et Marcel Griaule à Paris, et
qu’il tourne Au pays des mages noirs, il ne fait que confirmer sa vocation d’ethnographe
cinéaste, en s’installant dans une pirogue pour accompagner sur le fleuve Niger des
pêcheurs Sorko lors d’une pêche à l’hippopotame. Un peu plus tard, en 1951, Griaule est
toujours très présent dans son travail. Celui-ci lui demande, en effet, d’assurer
l’enregistrement filmé d’une cérémonie rare, un enterrement dans la falaise de
Bandiagara, au pays dogon. Le film s’appelle Cimetière dans la falaise et il est le premier
document visuel jamais réalisé en une telle circonstance. Or, ce film confirme ce que tous
les documents réalisés auparavant par Rouch laissaient déjà voir. Avec son cinéma
ethnographique, on entre dans un domaine circonscrit au croisement de deux facteurs
opposés : d’une part, la recherche, qui suppose une méthode d’observation et de
déduction maîtrisée ; d’autre part, la force incontrôlée d’une posture qui s’affirme plutôt
dans la trouvaille, Rouch rejoignant par là Picasso quand ce dernier déclare : « je ne
cherche pas, je trouve ». Désormais, « il est clair que pour Rouch, science et cinéma vont
jouer comme alibi l’un de l’autre, ou plutôt comme générateur l’un de l’autre (...) entre
�18
science et fiction »12. Il en est allé ainsi, sans doute parce que Jean Rouch, ingénieur
expatrié, découvre dans le même temps et dans le même lieu sa vocation d’ethnographe
et son désir de faire du cinéma. La conjonction de tous ces facteurs aurait pu ne pas
produire l’étincelle qui transforme Rouch en cinéaste. Mais cela a eu lieu, dans
l’improvisation, un trait qui caractérise la personnalité de ce dernier et qui est un des
constituants essentiels de sa méthode de travail. Cet élément biographique est important
à noter puisqu’il permet de comprendre à quel point les rencontres de Rouch ont tout au
long de sa vie un retentissement sur son œuvre, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être
élevées par lui au rang d’événements13.
14
Ainsi la rencontre de Marcel Griaule sur son propre terrain de recherche est
particulièrement déterminante car Griaule est lui-même un découvreur et un initiateur.
Notamment, lorsqu’il dévoile les arcanes de la société dogon, sa vision est celle d’un
anthropologue mais elle a un retentissement public considérable, exceptionnel. Griaule
fait voir aux Français des années trente, encore largement colonialistes, des Africains
vivant au fin fond d’un pays complètement coupé du reste du monde, que l’on considère
pour cette raison comme primitifs ou arriérés, et qui ont pourtant reçu en héritage une
grande œuvre de la pensée humaine. Car, oui, veut affirmer Griaule, pour la première
fois : « on pense » sur la falaise de Bandiagara, des Africains pensent d’une manière
savante et sophistiquée. Et il explique clairement de quoi il retourne. Le processus
d’abord, insoupçonné, inaperçu : la transmission orale, depuis la nuit des temps, assure la
pérennité du savoir comme l’écriture le fait en Occident. Ensuite, il caractérise ce savoir.
C’est un récit des origines, une cosmogonie détaillée, raisonnée, féconde, à la fois
singulière et universelle. Chaque société, en effet, a ses propres explications sur le début
du monde, mais toutes les sociétés en gardent pareillement le récit qui se transmet au fil
des générations. C’est ainsi, par exemple, que les fables mythologiques grecques
constituent un fondement inaliénable de la culture européenne. Or, avoir pressenti en
1931 que les Dogons rencontrés par lui étaient les dépositaires d’un savoir ancestral leur
permettant de maintenir dans le présent la cohésion de leur société, est la vraie
découverte de Griaule. Ainsi, quand il retourne au pays dogon en 1946 pour aller recueillir
les propos d’un vieux chasseur aveugle, Ogotemmêli, il donne une forme littéraire à la
traduction des paroles de son témoin, de manière à les situer d’emblée dans le registre
prestigieux des récits mythiques. Mais cela ne suffît pas à caractériser la nouveauté de sa
démarche qui opère un renversement radical des idées reçues sur les sociétés sans
écriture14. Encore lui faut-il d’abord s’identifier à un Dogon au point de devenir un initié
selon les codes traditionnels de l’initiation. Comme il entre dans un pays de soumission
des jeunes aux vieux, des non-initiés aux initiés, il a beau être un homme d’âge mûr, il
prend la posture d’un humble jeune homme soumis au cérémonial de la transmission du
savoir par « le vieux chasseur aveugle ». Dieu d’eau est issu de cette rencontre singulière.
À cet égard, la leçon de Griaule n’est pas perdue pour Rouch, il se montre même aussi
griaulien qu’on peut l’être puisque, comme on l’a déjà dit, il va mettre au point une
méthode de filmage qui lui permet d’entrer à son tour dans un rapport d’identité avec les
protagonistes de ses films.
15
Qu’en est-il de Dieu d’eau, un des principaux textes initiant justement l’entreprise
identitaire de l’ethnographie occidentale ? Au début du livre, Griaule écrit qu’une fois
arrivé au seuil de la maison d’Ogotemmêli,
[Il] lança les formules de salut. Aussitôt une voix où les mots sonnaient
distinctement répondit (...). La voix s’approchait lentement. De l’ombre intérieure
venaient des frottements de mains aux murs et aux bois des chambranles. Un bâton
�19
tâtonnait les parois ; une poterie sonna creux ; des poussins minuscules sortirent un
à un de la chatière, poussés par une grande vie qui avançait. Enfin une tunique
brune apparut, tirée aux coutures, effrangée par l’usage comme un drapeau de
guerres d’autrefois ; puis une tête se courba sous l’architrave et l’homme se
redressa de toute sa taille, tournant sa face indescriptible vers l’étranger : « Salut à
ceux qui ont soif ! » dit-il. Les lèvres épaisses parlaient la plus pure langue de Sanga.
On ne voyait qu’elles. Elles seules vivaient15.
16
À lire ces lignes, ne croirait-on pas que leur auteur est traversé par deux tentations ?
L’une est bel et bien celle de la littérature16 tant la description fait appel à l’art de la
suggestion et du raccourci saisissant (« une grande vie avançait », « sa face
indescriptible », « Elles seules vivaient »). L’autre est tournée vers l’image tant le trait est
précis et exhaustif. Nul doute qu’un scénariste n’aurait aucune peine à transposer ce récit
en une séquence filmique et à la découper plan par plan. L’homme lui-même, sa posture,
ses gestes, son allure, sont remarquablement visualisés, non sans un paradoxe notable. Ce
qu’il offre au visible n’est pas un corps mais une voix qui « s’approchait lentement ». Et
c’est bien sa voix qui, à travers la parole qu’elle profère, est l’unique origine du livre de
Marcel Griaule. On trouve là un autre élément fondamental autorisant le rapprochement
entre Griaule et Rouch : une même relation entre parole et acte de création se trouve
dans les films de ce dernier. Un exemple parmi d’autres : la première image de La Chasse
au lion à l’arc (1965) montre « un cercle d’enfants attentifs, réunis à la veillée autour d’un
conteur invisible, la voix de Jean Rouch, qui s’apprête à leur révéler comment leurs
ancêtres chassaient le lion. Puis s’anime alors un livre d’images nous emmenant dans les
dédales d’un merveilleux document filmé en direct par Jean Rouch, suivant pas à pas un
groupe de chasseurs lancés sur la piste d’un grand lion introuvable qu’ils ont appelé
“l’Américain” »17. Ainsi, à la manière de Griaule recueillant la parole d’Ogotemmêli sur
« le système du monde » et « l’aurore des chose »18, Rouch situe dans un temps
immémorial les origines d’une pratique conservée intacte au fil des générations et
assurant le lien entre les vivants et leurs ancêtres, aussi éloignés dans le temps fussentils.
17
D’autres traits unissent d’ailleurs ce film de Rouch au livre de Griaule. Le premier
concerne la durée nécessaire pour que la rencontre ethnographique aboutisse à un livre
pour l’un, à un film pour l’autre. Quand Griaule entreprend d’écouter Ogotemmêli, il ne
sait pas combien de temps cela va prendre. Plus d’un mois, en réalité ! Les chapitres du
livre sont en effet numérotés de la « Première journée » à la « trente-troisième journée ».
Griaule savait-il qu’il faudrait tant de jours au vieil Ogotemmêli pour l’instruire ? Pas de
réponse. Même chose pour Rouch quand il s’embarque dans le filmage d’une chasse
traditionnelle censée durer des jours et des jours. Combien ? Nul ne le sait. Autre
similitude. Griaule avait fait un choix essentiel en allant voir un vieillard dont tout le
monde lui avait dit qu’il était le meilleur connaisseur de la tradition. A posteriori, il
s’exprime clairement à cet égard : « D’une intelligence exceptionnelle, [Ogotemmêli] avait
compris l’intérêt des travaux ethnologiques des blancs et il avait attendu pendant quinze
ans l’occasion de révéler son savoir. [Pour cela] en octobre 1946, il manda chez lui
l’auteur... »19. Ainsi, Griaule paraît bien se mettre à la disposition d’Ogotemmêli et c’est
pourquoi, sans doute, « sa science, de blanc, d’ethnologue, d’enquêteur, va être débordée
par l’extraordinaire capacité d’Ogotemmêli à restituer à voix haute le fleuve de mots qui
coule en lui et qui est intarissable parce que la source en est très lointaine et que de
génération en génération elle n’aura justement pas cessé d’alimenter le récit des mythes
originaires. »20. Jean Rouch expérimente le même mode de rencontre avec les gens dont il
�20
va filmer les faits et gestes et écouter les paroles. En 1954, le tournage de Jaguar, par
exemple, est bien une mise à disposition du cinéaste pour les fantaisies quotidiennement
inventées par les protagonistes de ce récit picaresque et hilarant dont le montage a été
achevé bien plus tard, en 1967. Un phénomène semblable se reproduit pour son film
suivant. Au projet initial d’une enquête sociologique sur le devenir déjeunes immigrés
nigériens à Abidjan, va se substituer le premier de ses grands films de fiction achevé, Moi,
un Noir, dont la trame est fournie par les propos du personnage principal qui emmène le
cinéaste, à la fois dans ses trajets multiples en ville et dans les méandres de son
imaginaire (nous y reviendrons). Ici surgit une question inévitable qui concerne autant
Griaule que Rouch : quelle est la part du document, quelle est celle de la fable ? Plutôt :
d’où s’origine la fable, s’il y en a une ? Le récit de Dieu d’eau est-il une forme
qu’Ogotemmêli aurait polie pour que son auditeur étranger l’écrive mieux, ou bien est-il
la traduction plus ou moins libre par Griaule d’une forme orale moins belle, moins
parfaite en tous cas, qu’il aurait reconstruite ? Ainsi, de la même manière que Rouch,
enfant, a connu un balancement significatif entre la vérité documentaire de Nanook et la
vérité fictive de Robin des bois, il se peut qu’il ait réussi à identifier dans le travail de
Griaule un tel balancement entre la vérité vraie et la vérité inventée. Tout son cinéma est
une volonté de nier l’opposition de ces deux pôles, de les unir, comme dans le beau livre
de Griaule, au point de les rendre irrécusables grâce à la justesse et à l’adéquation du
mélange.
18
Il convient d’ajouter que Jean Rouch a rencontré une autre personnalité importante de
l’ethnographie dogon, Germaine Dieterlen, qui a achevé et publié en 1965 Le Renard Pâle,
le livre que Griaule préparait et avait conçu comme une suite et un approfondissement de
Dieu d’eau21. Ce fameux « renard pâle », protagoniste essentiel du panthéon dogon, se
présente comme une figure peinte parmi d’autres dans une grande fresque qui tapisse la
paroi d’une des cavernes de la falaise de Bandiagara. À échéances régulières, les peintures
sont restaurées par les prêtres du culte selon un rituel immuable qui est l’occasion d’une
grande fête religieuse, le « sigui ». Fonction de la fresque : elle met en images la
cosmogonie dogon, celle dont Ogotemmêli a fait le récit à Griaule et qui laisse voir que les
Dogons avaient une science astronomique d’une richesse et d’une précision
incomparables. À ce titre, la caverne du Renard Pâle est non seulement à l’art pariétal
d’Afrique de l’Ouest ce que Lascaux est à l’art européen, un réservoir d’images archaïques
susceptibles d’éclairer le présent ; elle est aussi une sorte de planétarium puisque sur la
paroi tous les chemins du ciel et de la terre, les planètes du système solaire, la Voie lactée,
sont figurés. Les visites de Rouch et de Dieterlen au pays dogon les ont fait passer par
cette caverne à maintes reprises. C’est ainsi qu’ils ont mené pendant plusieurs décennies
une collaboration pour la réalisation d’un document de longue haleine : filmer chaque
sigui, un rituel annuel qui se déplace dans plusieurs villages et qui forme un cycle de
soixante années, au terme desquelles il prend le caractère d’une célébration totale,
exceptionnelle. De 1966 à 1973, la filmographie de Rouch compte ainsi un Sigui par année
et en 1981, un montage des sept films, Sigui Synthèse est réalisé par Rouch à la demande de
Dieterlen, qui, la même année cor-réalise avec lui Le Renard Pâle. À la fin de leur vie
respective, ils sont encore réunis dans un film de Philippe Constantini, tourné en 2004 :
Rouch et Dieterlen22.
19
Griaule, Rouch, Dieterlen : tous trois sont les initiateurs de l’ethnographie du pays dogon,
devenue par la suite l’objet de recherches nombreuses, et chacun a fait l’objet d’un rite
funéraire autochtone, pour deux raisons au moins. D’abord, comme Griaule le mentionne
�21
dans Dieu d’eau, ils ont fait connaître la société dogon aux Occidentaux. Ensuite, raison
encore plus déterminante sans doute, ils ont fait des séjours fréquents sur place, durant
une bonne partie de leur vie de chercheur, accompagnant ainsi l’évolution des Dogons qui
ont été amenés à s’ouvrir à toujours plus d’échanges avec les autres ethnies composant la
société malienne. En même temps que les trois ethnographes ont vu vieillir, et mourir
parfois, les personnes rencontrées par eux lors de leurs premiers contacts, ils en ont vu
naître d’autres auxquelles ils sont devenus familiers. Les enfants, comme dans toutes les
sociétés patriarcales, sont éduqués dans le respect des aînés et des traditions. Ainsi, le
moindre écolier dogon d’aujourd’hui est-il encore convié à cultiver une relation filiale,
respectueuse, avec ces « toubabs », vieux amis du pays dogon, grands frères et grande
sœur de leurs grands-parents. À ces diverses explications, il faut ajouter la persistance de
l’animisme malgré la christianisation et l’islamisation de l’Afrique de l’Ouest. Si dans la
transe les humains peuvent être chevauchés par des « génies », il arrive que certains
d’entre eux deviennent des génies à leur mort. C’est le cas de Rouch, par exemple, dont la
légende est née, à peine venait-il de mourir. Lors de son ultime séjour au Niger, quand il
est parti vers l’est, un génie guerrier touareg s’est emparé de lui. Il est alors devenu un
des gardiens du fleuve23.
20
Bien sûr, tant d’honneurs accordés à trois ethnographes français par ceux-là mêmes qui
ont fait l’objet de leur recherche ne produisent pas des effets univoques. Leur présence
incontournable dans les études dogons, celles concernant le Renard Pâle notamment, a
certainement de quoi en agacer plus d’un(e) qui veut faire entendre sa voix en actualisant
la recherche. Le modus vivendi qu’ils ont instauré avec les Dogons est lié, nolens volens, à
l’ère coloniale dont ils sont issus tous les trois. Quant à Rouch plus particulièrement,
cinéaste dont le travail s’est déroulé dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, il s’est
constitué un territoire et s’y est déplacé comme un prince voyageant sur ses terres. De ce
fait, son travail, ses méthodes, ses points de vue ont été critiqués, le sont encore, aussi
bien en France qu’en Afrique. Exemplaire, le scandale provoqué par Les Maîtres fous en
1954 est une péripétie saillante, mais celle-ci n’est pas la seule à marquer les réticences
qui ont parfois accueilli les films du cinéaste.
LES MAÎTRES EN CINÉMA
21
L’œuvre de Rouch est abondante. La filmographie établie en 1996 par René Prédal dans
Jean Rouch ou le ciné-plaisir24 compte cent trente-deux films. Le cinéaste en a réalisé quatre
autres entre 1996 et 199825. Beaucoup sont de courts, voire de très courts métrages.
Quelques-uns sont restés à l’état de rushes, non montés ou même inachevés. D’autres sont
la réunion de plusieurs courts-métrages, tournés à des années de distance. La plupart ont
été réalisés en Afrique de l’Ouest, quelques-uns et non des moindres, en France et plus
rarement dans d’autres pays (Japon, Canada, etc.). La majorité des films relève du cinéma
documentaire, beaucoup sont des fictions. Quelques producteurs notoires ont
accompagné le travail de Rouch, notamment Les Films de la Pléiade et/ou Pierre
Braunberger (Les Maîtres fous, Mamy Water, Moi, un Noir, La Pyramide humaine, La Punition,
Les Veuves de quinze ans, La Chasse au lion à l’arc, Jaguar, Petit à petit), Argos Films (Chronique
d’un été, Monsieur Albert Prophète), Les Films du Losange (Gare du Nord), Films du Jeudi
(Dionysos, où l’on retrouve Pierre Braunberger). Des organismes d’État, tels que l’Institut
français d’Afrique Noire (I.F.A.N.), l’Office national du cinéma canadien (O.N.F.), le Centre
national de la recherche (C.N.R.S), le Musée de l’Homme, l’Institut de recherches en
�22
sciences humaines de Niamey, le ministère des Affaires étrangères, l’Institut national de
l’audiovisuel (I.N.A.), la Fondation européenne des métiers de l’image et du son (F.E.M.I.S.)
ont été tour à tour producteurs ou co-producteurs de Rouch, parfois avec des chaînes de
télévision (Antenne 2, Arte). Cette énumération dit assez quel fut l’éclectisme du travail
de Rouch, sa pluralité. En même temps, de grands axes apparaissent, des unités se
dessinent, ses films peuvent alors entrer dans des catégories identifiables, avec des
ambivalences significatives.
22
L’émergence du cinéma de Jean Rouch est à relier au cinéma documentaire. La raison en
est tout simplement factuelle : jusqu’au tournage des images de Jaguar, en 1954/55,
l’ethnographe Jean Rouch ne réalise en effet que des films documentaires. Or, en tant que
tel, le cinéma documentaire a une histoire spécifique dont la périodisation ne recoupe pas
exactement celle du cinéma de fiction. En 1995, Guy Gauthier en proposait par exemple
un découpage en quatre grandes périodes : « la préhistoire » (années 1870-1900), « le
temps de l’image reine » (années 1900-1930), « à la recherche de la parole » (années
1930-1960) et « la parole en direct » (années 1960-1990)26 La ligne historique ici tracée se
déroule, on le voit bien, selon un axe qui privilégie un aspect fondamental du cinéma
documentaire : la parole. Un autre facteur essentiel détermine l’évolution des conceptions
documentaires du cinéma : le montage. Les deux s’inscrivent dans un horizon qui relève
typiquement de la posture documentaire : la relation au réel, sa captation ou sa
(re)construction. Ces trois éléments combinés entre eux (et à plusieurs autres) ne
permettent évidemment pas d’unifier le cinéma documentaire sous la bannière d’une
définition, mais ils laissent apparaître un phénomène pour le moins obsédant. D’une
génération à l’autre, les documentaristes retrouvent les mêmes questions : à quelle(s)
méthode(s) se vouer ? quelles techniques utiliser ? quels rapports instituer entre le
tournage et le montage ? à qui parler ? qui faire parler ? qui faire entendre ? comment
monter les images ?, etc. Il y a eu autant de réponses que d’écoles de cinéma
documentaire, de sujets abordés, de thèmes traités, si bien que la variété des formes
documentaires du cinéma est proprement interminable. Entre les œuvres dédiées au
grand public, tels que les films de voyage ou les films animaliers, et celles destinées à un
public plus spécialisé, tels les films médicaux par exemple, entre les films informatifs et
ceux de propagande, l’éventail est sans doute plus large que celui du cinéma de fiction. En
fait, les déterminations qui pèsent sur les films documentaires et qui sont aussi bien
intracinématographiques qu’extérieures au cinéma, sont si nombreuses qu’elles viennent
accuser la diversité et augmenter la prolifération des genres.
23
En tant que documentaliste, Jean Rouch situe lui-même son héritage au confluent de deux
œuvres opposées : celle de Robert Flaherty et celle de Dziga Vertov. Gilles Marsolais, le
premier auteur d’une étude exhaustive du cinéma direct, reprend ou corrobore cet
héritage revendiqué lorsqu’il écrit de Rouch qu’« il est un “amateur” au sens noble où
l’entendait Robert Flaherty, et [un] bricoleur génial, à l’exemple de Dziga Vertov » 27. Se
pourrait-il que ce binôme contradictoire reproduise la dualité originaire du cinéma, la
« tendance Lumière » et la « tendance Méliès », qui serait ainsi comme mise en abyme à
l’intérieur même du cinéma documentaire ? La réponse est oui pour une partie de la
production documentaire, celle qui s’intéresse en priorité à la condition humaine, à
travers l’observation d’individus ou de groupes humains. Dans la descendance des vues
Lumière, on trouve, en effet, tous les films issus d’un contact (qui se veut) immédiat avec
la réalité documentée. Robert Flaherty paraît s’inscrire dans cette descendance. Sur
l’autre bord documentaire, il y a les films qui en passent par le montage pour construire
�23
l’image d’une réalité médiatisée par la pensée du cinéma. Dziga Vertov en est la grande
figure. Ainsi, tout un continent du cinéma sépare les deux cinéastes tutélaires de l’œuvre
de Jean Rouch, aussi sûrement qu’entre leur pays d’origine respectif s’étend l’immensité
géographique de deux continents séparés par un océan.
24
Le cinéaste Robert Flaherty semble opposé en tout à Dziga Vertov, ne fût-ce que parce
qu’il est américain et qu’il s’est intéressé à des sujets jugés exotiques : les Inuit, les
Polynésiens, les pêcheurs de l’île d’Aran, les Français de Louisiane. Par ailleurs, il a
travaillé avec des auteurs du cinéma de fiction, notamment Woodbridge Van Dyke pour
Ombres blanches en 1928 et Friedrich Murnau pour Tabou, en 1931. Mais la différence entre
les deux cinéastes est plus profonde encore, elle est d’ordre pour ainsi dire ontologique.
L’horizon idéal du cinéma de Vertov c’est l’image. Les êtres sont filmés comme des
figurants, au sens propre : ils sont des modèles pour des formes cinématographiques à
inventer, qui, elles, sont les vrais personnages de ses films. À l’inverse, Flaherty utilise le
cinéma pour que des êtres humains deviennent les personnages d’histoires qui serviront
de support à l’incarnation filmique de leur propre vie. Marsolais commente cette
opposition entre les deux cinéastes en ces termes : « Fort différente de celle de Dziga
Vertov est la méthode de Robert Flaherty, fondée sur la collaboration effective des
hommes que le cinéaste veut filmer. Le film s’élabore à la prise de vue, et les vertus
expressives du montage sont reléguées à l’arrière-plan »28. Vue de près, la méthode de
Flaherty semble par le fait annoncer, plus sûrement que celle de Vertov, les travaux de
Rouch et des autres réalisateurs du cinéma direct. Dès le tournage de Nanook l’essentiel
est déjà là qui se résume à quelques grands traits. Flaherty s’immerge dans le milieu qu’il
va filmer en vue d’une longue observation préalable (deux ans !), il devient un familier de
quelques-unes des personnes rencontrées, il en choisit une plus particulièrement avec
laquelle il noue un dialogue et l’amène progressivement à entrer dans un mode de
participation tel au film qu’elle y incarnera son propre rôle. Il n’écrit pas de scénario tant
son observation de la vie quotidienne l’a préparé à ce qu’il allait pouvoir et devoir mettre
en images. Toutes les scènes filmées, qu’elles soient authentiques ou reconstituées, sont
enregistrées une fois pour toutes. Nanook, qui a connu un énorme succès public et
critique, est donné comme un des grands modèles du cinéma documentaire et c’est
d’ailleurs à son propos que le mot « documentaire » a été utilisé pour la première fois
comme un substantif. Or, ce document à vocation ethnographique a été violemment
critiqué par des ethnologues. L’un d’entre eux, Jean-Dominique Lajoux29, est
particulièrement radical : il dénonce tous les « trucages » dont Flaherty s’est rendu
coupable selon lui, notamment pour la célèbre scène de la chasse au phoque dont il va
jusqu’à dire qu’elle « n’est pas même une reconstitution mais une scène mimée jusqu’au
burlesque et jouée sans phoque »30. En fait, la critique de Lajoux est instructive. On peut
en effet en déduire cette première idée a contrario : le dispositif du cinéma documentaire
ne coïncide apparemment pas avec les principes et les méthodes de la stricte observation
ethnographique. Question ainsi provoquée par la critique rigoureuse, pour ne pas dire
rigoriste, de J-D Lajoux : fallait-il attendre l’avis d’un expert scientifique pour
comprendre que le cinéma documentaire n’est pas réductible au simple enregistrement
de faits réels ou supposés tels ?
25
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : si Nanook est réputé être un documentaire,
officiellement le premier de tous, et si l’auteur s’est permis de reconstituer des scènes, qui
ne sont donc pas authentiquement réelles, quelle est l’exacte nature documentaire du
cinéma ? Où se tient-elle dans les films ? A quoi se repère-t-elle ? De quelles pensées, de
�24
quels gestes et postures dépend-elle ? Dans un article célèbre, « Le montage interdit »,
André Bazin s’interroge sur le cinéma documentaire en une réflexion qui, malgré les
apparences, n’est pas complètement éloignée de celle de J.-D. Lajoux. « Il faut que l’unité
spatiale de l’événement soit respectée au moment où sa rupture transformerait la réalité
en sa simple représentation imaginaire. (...). Ceci est vrai de tous les films documentaires
dont l’objet est de rapporter des faits qui perdent tout intérêt si l’événement n’a pas eu
lieu réellement devant la caméra ». Et, au titre de sa fameuse « loi du montage interdit »,
Bazin mentionne deux épisodes pris dans deux films de Flaherty : « Si l’image de Nanook
guettant son gibier à l’orée du trou de glace est l’une des plus belles du cinéma, la pêche
du crocodile visiblement réalisée “au montage” dans Louisiana Story est une faiblesse » 31.
Ainsi, Bazin aime la scène que Lajoux n’apprécie justement pas. Quels spectateurs
différents sont-ils ? Un trait pour le moins les distingue : Bazin, spécialiste du cinéma, ne
connaît peut-être rien de la chasse au phoque alors qu’il sait tout des effets de montage.
Lajoux, spécialiste des Inuit, s’intéresse plus à la réalité de la chasse au phoque qu’à celle
recréée par le cinéma. Ainsi, ce qu’il a vu comme une tromperie délibérée est passé
inaperçu aux yeux de Bazin. Un trait important les rapproche pourtant : Lajoux s’insurge
contre la reconstitution truquée, il demande aux images d’être exactes alors que Bazin
croit que la caméra peut authentifier une réalité pour peu qu’elle se contente d’en filmer
sans « rupture » le continuum spatial et temporel. Question : aurait-il trouvé aussi belle la
scène de Nanook s’il avait eu une connaissance effective de la réalité reconstituée par
Flaherty ? Gageons que oui : Bazin aimait la réalité, mais il aimait tout autant le cinéma.
Dès lors que celui-ci a une exigence documentaire, plus difficile à satisfaire que la simple
prétention au réalisme, il aimait surtout qu’un écho profond s’instaure entre le monde du
cinéma et celui de la réalité, par la grâce – ou l’élégance32 de choix filmiques
ontologiquement adéquats. Quand Nanook produit sur Jean Rouch, enfant, un effet tel
qu’il s’identifie aux petits chiens du film, il affirme à sa manière la même pensée que
Bazin : l’adéquation entre le réel et son image est une affaire de vérité mais celle-ci n’est
pas un fait en soi, elle est déterminée par l’image qui la construit et qui la laisse
apparaître comme telle, la donnant ainsi en partage au spectateur. La réaction somatique
de Rouch, transformé dans son sommeil en jeune chien de traîneau, est une manifestation
de ce processus qui légitime la nature vraiment documentaire de certains films.
26
Au-delà, il est pour le moins troublant de constater des coïncidences entre le parcours et
l’œuvre respective de Flaherty et de Rouch. Flaherty a été lui aussi un cinéaste voyageur.
Ses pas l’ont mené des confins du Grand Nord canadien jusqu’à ceux des Mers du Sud,
pour filmer des documents tout autant que pour réaliser des fictions. Or, il était pour
ainsi dire né voyageur puisque, enfant, il avait suivi chez les Indiens son père qui était
prospecteur. Plus tard, il explore le Grand Nord, s’installe à demeure chez les Inuit. C’est
lors d’une expédition commerciale en 1916, qu’il tourne les images de ce qui aurait dû
être son premier film mais qui a disparu dans un incendie. Ainsi, sa manière d’entrer dans
le cinéma préfigure parfaitement celle de Rouch. Lui aussi était le fils d’un voyageur et a
tourné son premier film à l’étranger, lors de circonstances professionnelles qui n’avaient
a priori rien à voir ni avec l’ethnologie ni avec le cinéma.
27
Peut-on déduire quelque trait d’ordre général de ces coïncidences entre deux cinéastes
irrémédiablement associés au carrefour du cinéma documentaire et du cinéma de
fiction ? Oui. On peut légitimement envisager cette hypothèse : le cinéma dit
« d’observation » s’édifie sur le déploiement puis la mise en cause de problématiques
identitaires. Flaherty, peut-être, Rouch, assurément, et tous les cinéastes de la même
�25
famille qu’eux, s’intéressent à la place que les « filmants » et les « filmés » tiennent les
uns par rapport aux autres. En cela, ils rejoignent Vertov et les cinéastes du montage qui
se proposent d’évaluer et de faire évaluer les êtres selon la place d’où ils sont regardés ‐
par eux et selon l’ordre dans lequel le montage construit et organise leur incarnation
filmique. Documentaristes, tous mobilisent en effet la caméra pour ce qu’elle est, au fond,
et qui est tantôt caché ou insu, tantôt revendiqué ou montré : un miroir déformant. La
déformation, qui agit sur l’analogie, composante essentielle du mécanisme filmique
d’enregistrement des images, est inévitable car elle est inscrite au cœur même du
dispositif de l’image en miroir33. Ce phénomène est un des rares traits qui caractérise en
son entier le cinéma documentaire, quel que soit le type de film concerné, dans la
descendance de Vertov ou celle de Flaherty.
28
Le russe Dziga Vertov et son « ciné-œil » se chargeant d’une observation minutieuse,
récurrente mais diversifiée des phénomènes filmés, cherche moins à dévoiler les
apparences du monde qu’à en inventer la ciné-vérité (kinopravda). La réalité ultime qui
semble l’intéresser est en effet celle que permet de créer le cinéma. Par exemple, dans son
documentaire sur la ville d’Odessa, il célèbre plutôt une réalité urbaine telle qu’un
opérateur et un monteur de cinéma peuvent la construire. Le film en question c’est
L’Homme à la caméra dont le titre indique assez quel était le projet de Vertov : déployer
toutes les possibilités techniques de la prise de vue et du montage pour construire une
parfaite illusion documentaire. En somme, pour Vertov il s’agissait de documenter le
cinéma lui-même (voir à cet égard l’insistance métaphorique sur les automates et les
machines à coudre tout au long du film). Le cinéaste est allé jusqu’à « prêter » aux images
filmées le corps même de l’opérateur, son propre frère, en incarnation glorieuse de
l’homme du cinéma. Ainsi, il n’y a rien d’immédiat dans la pensée et dans le travail de
Vertov, surtout pas dans son « montage d’idée », notamment commenté par Jean Mitry en
termes restrictifs, peut-être parce qu’il voyait dans cette sorte de montage les
fondements du cinéma de propagande34. Il est alors étrange de constater que Vertov est
considéré, par Gilles Marsolais notamment, comme un des précurseurs du cinéma direct.
En fait, Marsolais précise que les documentaristes des années soixante ont surtout retenu
de Vertov ses recherches sur le matériau sonore. Marsolais rappelle des détails qui
paraissent d’autant plus significatifs qu’ils anticipent des épisodes importants du travail
de Jean Rouch. Ainsi, en 1930, pour Enthousiasme (ou La Symphonie du Donbass), Vertov
demande à un ingénieur de lui construire « un appareil d’enregistrement sonore, aussi
petit et maniable que les caméras dont se servaient alors les opérateurs d’actualités. (...) Il
a aussi innové en insérant dans son film Trois Chants sur Lénine, des conversations
authentiques, spontanées, enregistrées “en direct”, de façon synchrone avec l’image » 35.
29
L’influence de Dziga Vertov, qui est en fait le grand ancêtre du montage dit
« d’actualités », est marquée aussi bien sur le cinéma documentaire que sur le cinéma
expérimental. Elle n’est pourtant pas limitée à la mémoire et au culte de sa seule
virtuosité technique. Au tout début des années soixante, on assiste par exemple, à la
résurrection d’une des conceptions centrales de son travail de cinéaste : le kinopravda.
Cela ne va pas sans un paradoxe. En 1960, dans sa traduction mot à mot, l’expression est
accolée à Chronique d’un été et à partir de là, le « cinéma-vérité » français, conjointement
au « candid eye » canadien, s’éloigne considérablement de son origine vertovienne, dans
la mesure où la vérité y est une émanation des êtres filmés, elle est contingente et
aléatoire, alors que chez Vertov la vérité est une puissance du cinéma comme langage,
�26
celui-ci étant une arme politique au service de la lutte révolutionnaire. Dans les années
soixante-dix, où il créa le groupe « Dziga Vertov », Jean-Luc Godard, y revient :
Vertov, au début du cinéma bolchevique, avait [des] théories consistant simplement
à ouvrir les yeux et à montrer le monde au nom de la dictature du prolétariat. À
cette époque, le terme de « Kino-Pravda » n’avait rien à voir avec le reportage ou la
caméra « candide », ce avec quoi il est abusivement assimilé aujourd’hui sous le
concept de « cinéma-vérité » : cela voulait dire cinéma politique 36.
30
Oui, Jean-Luc Godard fait une synthèse parfaite de la sphère d’influence de Dziga Vertov
lorsqu’il parle de « cinéma politique ». On n’a, par exemple, aucune peine à reconnaître la
persistance de son héritage, pour le meilleur ou pour le pire, dans certains documentaires
politiques contemporains37. Ainsi, au titre du cinéma politique, tel qu’il se développe en
France dans les années 50/60, on verrait mieux l’influence de Vertov s’exercer auprès
d’auteurs plus ouvertement en prise sur la réalité et le discours politiques de l’époque,
Alain Resnais ou Chris Marker par exemple. Cependant Rouch a trouvé chez Vertov le
« ciné-œil », une méthode au service d’un effet, le « cinéma-vérité », susceptible de
déstabiliser l’adhérence attendue entre l’apparence des images et leur vérité. Pour s’en
convaincre, il suffit de demander à un spectateur voyant L’Homme à la caméra une
première fois, de raconter la fameuse séquence de l’opérateur posant son oreille sur des
rails pour écouter le bruit d’un train qui, depuis l’arrière-plan, fonce à toutes vitesses vers
lui. S’il veut s’en tenir à la précision des faits vus par lui, le spectateur en arrivera à dire
qu’après le passage du train, la jambe de l’opérateur est restée sur le ballast. Le tas de
terre fraîchement remuée bien en vue dans la dernière image de la séquence n’est pas
pour détromper cette interprétation mortifère et farfelue, bien au contraire ! Or, L’Homme
à la caméra est un film documentaire... à moins qu’il ne soit une fiction, peut alors
librement conjecturer le spectateur s’il ne croit pas un instant que Vertov a sacrifié le
corps de son propre frère à la locomotive du cinéma et s’il n’a pas la possibilité de
vérifier, image par image, que le train n’est pas passé sur la jambe de l’opérateur. C’est
pourquoi on peut faire remonter à Méliès tout le cinéma de montage, fût-il documentaire
ou non. En effet, en inventant les « trucs » de la surimpression ou du fondu-enchaîné dont
il avait besoin pour créer des situations spatio-temporelles merveilleuses, c’est-à-dire
dérogeant aux lois naturelles exactement comme dans les spectacles de magie, Méliès a
fait du montage la puissance expressive initiale du cinéma, celle-là même qui constitue la
matière première de la pensée du montage vertovien et qui – il n’y a sans doute pas de
hasard – est un des objets d’observation favoris de Rouch, cinéaste-ethnographe.
NOTES
1. Notamment, dans Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang, Paris, Edition Montparnasse, 2005
et un entretien de 1999, au cinéma Les 400 Coups, sur Internet : perso.wanadoo.fr/cine.beaujolais/
rouch.htm, p. 1. Les extraits suivants proviennent de cette source.
2. Cf. Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang, op. cit.
3. En Afrique de l’Ouest, de langue mandingue ou dioula, « toubab » veut dire « l’homme blanc ».
�27
4. Le monde selon... Jean Rouch, propos recueillis par Jean-Luc Bitton et Laurence Pinsard, mis en
ligne en 2001 sur le site routard.com/mag p. 2.
5. Jean Rouch raconte à P.-A. Boutang, op. cit.
6. Jean Sauvy, Jean Rouch tel que je l’ai connu, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 90-91.
7. Il est initié seulement à la fin des années cinquante par l’opérateur canadien, Michel Brault.
Voir infra, « Jean Rouch et le cinéma direct », pp. 52-63.
8. Jean Rouch raconte, op. cit.
9. Jean Rouch tel que je l’ai connu, op. cit., p. 78.
10. Roberto Rossellini, « Cinéma et télévision », entretien d’André Bazin avec Jean Renoir et
Roberto Rossellini », in Le Cinéma révélé, Paris, Flammarion, coll. « Champs Contre-champs »,
Préface d’Alain Bergala, 1988 réed., pp. 146-152.
11. Voir infra, chap. VIII, « Le vertige du temps réel ».
12. Jean-André Fieschi, « Dérives de la fiction. Notes sur le cinéma de Jean Rouch ». Cinéma,
Théorie, Lectures, dir. Dominique Noguez, Paris, Klincksieck, 1973 et 1978 (réed.), p. 258.
13. Parmi les rencontres nombreuses qui ont émaillé la carrière de Rouch comme autant de
coïncidences propices ou fécondes, en voici encore une : quand il tourne au Ghana les images de
Jaguar, Pierre Schaeffer, l’auteur du Traité des objets sonores, l’animateur du Groupe de recherche
musicale, s’y trouve également, en train d’enregistrer la campagne électorale de Wade
N’Krumah !
14. La démarche de Griaule préfigure celle de Resnais et Marker, quand ils réalisent ensemble Les
statues meurent aussi.
15. Marcel Griaule, Dieu d’eau, Entretiens avec Ogotemmêli, Paris, Fayard, 1948, réed. 1966, p. 11.
Sanga est le principal village de la falaise de Bandiagara.
16. Dans sa préface à Dieu d’eau, p. 5, Griaule écrit qu’il « souhaite (...) mettre sous les yeux d’un
public non spécialiste et sans l’appareil scientifique habituel un travail que l’usage réserve aux
seuls érudits ». L’avant-propos de Geneviève Calame-Griaule à l’édition de 1966, mentionne « la
présentation volontairement non-scientifique, le style volontairement littéraire » du livre.
17. Maxime Scheinfeigel, Les Âges du cinéma. Trois parcours dans l’évolution des représentations
filmiques, chap. I : « Les origines : Ogotemmêli », Paris, L’Harmattan, 2002, p. 32.
18. M. Griaule, Dieu d’eau, op. cit., p. 14.
19. M. Griaule, Préface à Dieu d’eau, p. 4.
20. M. Scheinfeigel, op. cit., p. 33.
21. En 1991, réédition du livre de Dieterlen et Griaule, Le Renard pâle, tome 1, Paris, Institut
d’ethnologie-Musée de l’Homme.
22. Le cinéaste devait participer aux funérailles dogon de Germaine Dieterlen. Il s’était d’abord
rendu à Niamey puis, au lieu d’aller vers l’ouest, vers le Mali, où l’attendait la cérémonie
funéraire consacrée à son amie, il est parti vers l’est, vers le pays des Touaregs. Sa voiture est
accidentée, il meurt dans l’accident. Cette mort accidentelle, pour cause de voyage dévié de sa
trajectoire prévue, opère « un montage fulgurant » (Pasolini) de la vie de Rouch.
23. Jean Rouch a une stèle funéraire dans l’île de Firgoun, sur le Niger, là même où il avait achevé
de tourner en 1946 son premier film, Au Pays des mages noirs.
24. René Prédal, op. cit., Cinémaction, n° 81, 1996.
25. Germaine Dieterlen : hommage à Marcel Mauss, Moi fatigué debout, moi couché, En une Poignée de
mains amies et pour finir, Cinq poèmes sur Paris.
26. Guy Gauthier, Le Documentaire – Un autre cinéma, Paris, Nathan, coll. « Nathan Université »,
1995, titres des chapitres 2, 3, 4 et 5 de la première partie.
27. Gilles Marsolais, L’Aventure du cinéma direct, Paris, Seghers, coll. « Cinémaclub », 1974, p. 177.
28. G. Marsolais, op. cit., p. 41.
�28
29. Dans un entretien avec René Prédal, intitulé « le ciné-plaisir », Jean Rouch mentionne qu’il a
envisagé de travailler avec Jean-Dominique Lajoux pour la série des Sigui. Jean Rouch ou le cinéplaisir, Cinémaction, n°81, 1996, p. 20.
30. Jean-Dominique Lajoux, « Film ethnographique et histoire », in Pour une anthropologie visuelle,
op. cit., p. 111.
31. André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Editions du Cerf, 1975, pp. 59-60.
32. Cette élégance dont parlent souvent les mathématiciens à propos de certaines équations qui
ont une plus grande réussite que les autres, au vu de leur beauté.
33. L’historien de l’art Ernst Gombrich propose à cet égard une petite expérience très simple,
amusante même : « sur un miroir légèrement embué de vapeur (...) tracer le contour de [notre]
visage, puis effacer la buée à l’intérieur du périmètre délimité par le contour. C’est alors
seulement que nous demeurons frappés de la petitesse de l’image qui nous donne l’illusion de
nous regarder “face à face”. Disons, dans un souci de précision, que la surface de notre visage
représente à peu près deux fois celle de son reflet ». Cette expérience tend à « nous convaincre de
la surprenante réalité de l’illusion de la représentation ». L’Art et l’illusion, Gallimard, Bibliothèque
des Sciences humaines, 1971 et 1987 (réed.), trad. Guy Durand, pp. 24-25.
34. « Il s’agit, en se servant de documents pris dans des films d’actualité, de juxtaposer des faits
ayant une authenticité évidente mais ne signifiant que ce dont ils témoignent. On exprime alors
une idée, qui, bien entendu, n’existe qu’en raison de ce rapport. (...) Tout en gardant une certaine
valeur, les faits authentiques ne pourront plus être considérés que comme des matériaux utilisés
dialectiquement, [la] dialectique ne prenant appui que sur une authenticité continuellement
transgressée », Jean Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma, tome 1, « Les structures », Paris,
Éditions universitaires, 1963, pp. 362-63.
35. G. Marsolais, op. cit., pp. 38-39.
36. Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Alain Bergala (dir.), Cahiers du Cinéma-Éditions de
l’Étoile, 1985, p. 343.
37. Par exemple, le film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, une grosse machine de guerre et de
propagande, a par endroits (seulement par endroits) le type de subtilité discursive dont le
montage d’idée a besoin pour atteindre son but.
�29
Chapitre 2. Le contexte
cinématographique
1
Quels sont les facteurs favorisant l’éclosion du cinéma de Jean Rouch ? Comment en
expliquer certains traits déterminants ? Il est d’autant plus utile d’aborder cette question
que Rouch ne s’était pas destiné à entrer dans le monde du cinéma mais plutôt dans celui
de l’exploration ethnographique d’un territoire géographique et humain, circonscrit par
des nécessités autres que celles de l’expression artistique. C’est ainsi qu’à ses débuts, le
cinéma est un moyen, pas une fin, au moins en apparence. En effet, si son premier film est
un brouillon mal ficelé, il se constitue pourtant comme un véritable opus
cinématographique. Un regard sur la suite de l’œuvre permet de s’en rendre compte
puisqu’on y retrouve des traits stylistiques qui caractérisaient déjà cet essai. Autant dire
que le premier document de pure observation filmé par Rouch déborde sa finalité
spécifique, celle indiquée par l’ethnologie, et est investi, éventuellement à l’insu du
cinéaste, par autre chose qui va vite se développer, qui s’appelle « le cinéma » et qui se
mêle organiquement aux visées scientifiques dont Rouch a toujours été porteur. C’est
pourquoi il est aussi légitime d’aborder ses films comme un corpus ethnographique que
comme une œuvre de cinéma.
2
Des faits précis apportent un éclairage convaincant à cet égard. Mais, ces faits, par
exemple la projection d’Au Pays des mages noirs au Festival du Film Maudit que préside Jean
Cocteau en 1949, ou encore, dès 1954, le financement des films de Rouch par des
producteurs dont on retrouve le nom au générique des films de la Nouvelle Vague, sont
relatifs à une époque, des lieux, une physionomie générale du cinéma. Un contexte
différent n’aurait peut-être pas permis à Rouch de trouver sa place dans le monde du
cinéma, alors même qu’il n’a jamais cessé d’appartenir à une institution scientifique. Quoi
qu’il en soit, l’époque est largement à prendre en compte, ne fût-ce que parce que, d’une
part, la carrière cinématographique de Jean Rouch s’inscrit dans le cadre institutionnel
d’une recherche scientifique liée à l’Afrique coloniale, elle est de plain-pied, donc, avec un
certain état historique de la société. D’autre part, en matière de cinéma, quand il met
pour la première fois son œil derrière le viseur d’une caméra, l’œuvre de Vertov est
achevée et Flaherty est en passe de réaliser son dernier film. C’est l’année de La Vie est
belle (Capra), La Poursuite infernale (Ford) et Le Criminel (Welles), de La Belle et la bête
(Cocteau) et de Farre-bique (Rouquier), de Sciuscia (De Sica) et de Paisa (Rossellini). Le
�30
cinéma n’est pas encore vraiment installé dans sa modernité mais le néo-réalisme, parmi
d’autres tendances du cinéma de l’après-guerre qui portent en elles tout ce qui annonce
et prépare un renouvellement radical de l’expression filmique, a un rayonnement si
intense qu’à travers lui s’opère la naissance d’une nouvelle galaxie du cinéma. Deux
écoles en attestent dans les années cinquante : le cinéma direct et la Nouvelle Vague. Ainsi,
du néo-réalisme au cinéma direct et à la Nouvelle Vague, on trouve trois mouvements à la
lumière desquels se lit l’inscription des films de Jean Rouch dans l’histoire du cinéma.
Mais cette inscription est elle-même conditionnée par un premier processus créatif : il
s’agit de la manière dont Rouch, héritier d’un cinéma ethnographique aux bases bien
établies, contribue à le moderniser en déplaçant certains enjeux et certaines procédures
qui le caractérisaient jusque-là et faisaient de lui surtout un serviteur zélé de l’ethnologie
écrite.
LE CINÉMA ETHNOGRAPHIQUE
3
En 1948, alors que Jean Rouch entreprend le tournage de Hombori, son quatrième courtmétrage ethnographique, André Leroi-Gourhan interrogeait les relations du cinéma et de
l’ethnologie dans un article notoire au titre retentissant : « Le film ethnographique
existe-t-il ? »1. Or, dès le début du XIXe siècle la planète était déjà sillonnée de reporters,
d’explorateurs et de scientifiques, dont des ethnologues, équipés d’une caméra. Mais
l’ethnologie peine à légitimer le cinéma. Elle résiste. Pourquoi ? Au cœur même de
l’ethnologie gît un conflit entre le verbal et le filmique, qui lui-même recoupe une
partition de cette dernière. Selon sa vocation première l’ethnologie est principalement
une science de synthèse qui vise à établir comment des groupes humains différenciés se
sont formés et ont traversé l’histoire. Or, le cinéma est entièrement dévolu à la capture
d’une réalité présente, actuelle, contingente et singulière. Ainsi, quand un ethnologue
emmène une caméra sur son terrain d’observation, le relevé filmique des faits observés
par lui est insuffisant à nourrir la problématique ethnologique. Perpétuant la tradition
des récits de voyage qui ont tissé jusque-là le discours de l’anthropologie, il lui faut
surtout recueillir des récits, ceux des anciens notamment qui, en racontant le passé,
permettent à l’observateur d’évaluer le degré d’évolution d’une société à travers sa
capacité à se transformer. Pour servir ce propos, entièrement déterminé par la parole,
l’ethnologie n’a pas besoin du cinéma, ou, pour le dire autrement, le cinéma ethnologique
n’existe pas. Et c’est bien du cinéma ethnographique dont s’inquiète André Leroi-Gourhan.
Pourtant, l’ethnologie évolue et elle finit même par reconnaître comme telle la valeur
signifiante intrinsèque du cinéma ethnographique. Deux raisons principales expliquent
cette évolution après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
4
D’abord, le contexte géopolitique est marqué par le déclin effectif de l’ère coloniale, les
fondements mêmes du colonialisme étant remis en cause aussi bien dans les métropoles
que dans les territoires colonisés. Ce phénomène tout à la fois politique, économique et
sociologique a une incidence évidente sur l’ethnologie. Fleuron cultivé du colonialisme,
elle accède en effet à une forme de mauvaise conscience qui l’incite à se retourner sur
elle-même. Que voit-elle dans le miroir qu’elle se tend ? L’idée qu’elle s’est peut-être
trompée d’objet. Le titre provocant d’un des premiers ouvrages de Claude Lévi-Strauss,
Tristes Tropiques, paru en 1955, est symptomatique d’un désenchantement qui va venir
troubler les certitudes qu’avaient procurées jusqu’ici l’observation scientifique des
habitants des contrées lointaines. Un peu plus tard, quand il publie en 1960 son
�31
Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss explicite sa pensée : « dans une
science où l’observateur est de même nature que son objet, l’observateur est lui-même
une partie de l’observation2. » On entre ici dans un relativisme déstabilisant qui fait de
l’observateur un mutant. Jusque-là, les sciences de l’observation reposaient surtout sur le
substrat de la pensée évolutionniste qui fut aux origines mêmes de l’anthropologie
moderne. Il s’agit d’un système occidentalo-centré qui, s’il a plus ou moins contesté, voire
même oublié ses fondements racistes, a installé durablement l’observateur dans la
prééminence sur l’observé que lui confère son extériorité. Or Lévi-Strauss opère un
déplacement radical de l’observateur en le vouant à une ambivalence qui le contraint à
entrer dans un processus d’identification à l’autre, l’observé. A cet égard, les aspirations
de Jean Rouch, alors débutant dans l’ethnographie filmique, coïncident parfaitement avec
ce schéma moderne de la pensée anthropologique. La coïncidence se révèlera pleinement
dans deux films de sa maturité : Chronique d’un été (1960) et Petit à petit. Dans le premier, il
fait de l’enquêteur-sociologue, Edgar Morin en personne, l’objet d’un questionnement.
Dans le second, il en vient à faire « ethnographier » des Parisiens par un Nigérien 3.
5
Ensuite, un changement de mentalité opère au sein même de l’institution ethnologique.
Elle commence à regarder d’un autre œil les images rapportées par les gens de terrain,
mais le processus est lent. Pour qu’une véritable méthodologie filmique appliquée à
l’observation anthropologique soit élaborée, il faut en effet attendre les années soixantedix. En France, ce projet passe notamment par la création en 1971, à l’université de Nanterre-Paris X, d’un diplôme de recherche en ethnologie dont Jean Rouch est le promoteur
et qui intègre une formation audiovisuelle spécifique. Dans la même perspective, Claudine
de France qui publie Pour une anthropologie visuelle4 en 1973 et Cinéma et anthropologie5 en
1982 approfondit cette réflexion et précise comment l’identité de point de vue entre
cinéma et ethnographie est envisageable. Le cinéaste est un observateur, l’ethnographe
aussi. Les savoir-faire de l’un, les objectifs et les méthodes de l’autre peuvent se réunir et
se conjoindre puisqu’une formation audiovisuelle adéquate est à même de transformer
l’ethnographe en cinéaste compétent. La fonction impartie à cet observateur scientifique
moderne, « l’ethnographe-cinéaste », est maintenant reconnue, légitimée. Son
intronisation officielle joue sur deux idées nouvellement adoptées. Premier changement :
l’ethnographie reconnaît enfin le pouvoir réflexif des images car elle devient sensible au
fait que les films, à travers le montage notamment, ont une valeur d’analyse des
processus observés et filmés. Second changement : l’ethnographie devient capable de
produire des films libérés de la tutelle de l’écrit, ne fût-ce qu’en cherchant à faire
entendre la parole des êtres filmés.
6
Toutes ces péripéties ne peuvent pas faire oublier néanmoins que la rencontre de
l’ethnologie et du cinéma était inévitable puisque à l’origine un même type de réalité aura
été susceptible de les mettre d’emblée dans un contact immédiat. C’est le voyage, auquel
les Lumière font d’abord servir le cinématographe en envoyant leurs opérateurs un peu
partout dans le monde. Or, le voyage qui est déplacement, migration ou errance à la
surface de la planète, est nécessairement un passage. Les voyageurs passent des
frontières, outrepassent des limites, connaissent des transgressions. Un genre filmique
finira même par unifier à la fois la forme et le fond de tous ces processus, le road-movie.
Mais s’il est courant d’ancrer la naissance du road-movie dans les films des années
cinquante/soixante, modernes à la manière de L’Avventura d’Antonioni par exemple, on
doit se rappeler que les films de voyage proprement dits relèvent d’une histoire plus
ancienne, celle qui a vu jour au début du xxe siècle. Jean Rouch s’inscrit bien dans une
�32
lignée de voyageurs, cinéastes au long cours plus ou moins illustres. Explorateurs à la
manière de Scott ou de Shackleton, ethnographes à la manière de Haddon ou Curtis,
documentaliste tel Flaherty, le premier cinéaste ainsi qualifié, ils forment un lignage dans
lequel Rouch vient prendre sa place. Pour lui en effet, comme pour eux avant lui,
parcourir des kilomètres dans des confins éloignés n’est pas une fin en soi, les explorer et
en faire le reportage non plus. Il s’agit aussi d’une aventure mentale où devant l’autre, on
devient étranger à soi-même, projeté en-dehors de soi, excentrique en un mot. Or,
l’excentricité est un trait de jeunesse, fortement inscrit dans la biographie même de Jean
Rouch. C’est à ce titre, notamment, qu’il infléchit le cours du cinéma ethnographique en
le faisant passer par d’autres voies que celles déterminées par le caractère impersonnel
des questionnements qui sont traditionnellement les siens.
LE NÉO-RÉALISME
7
Porosité des genres, réversibilité des postures, continuités hétérogènes, fusion des
contraires, mélange des niveaux de réalité représentée, dissemblance analogique, toutes
ces traits du cinéma moderne caractérisent le cinéma de l’après-guerre. Le néo-réalisme
illustre de manière exemplaire cette période. Parmi d’autres films de cette période,
Allemagne, année zéro laisse transparaître d’autant plus l’intensité historique de son propos
que s’y reflète M de Fritz Lang, tourné à Berlin en 1931, quand l’ordre nazi était sur le
point de refonder entièrement la société allemande, cette société dont Rossellini filme les
ruines en 1946. Même chose avec Paisa que le critique Jacques Lourcelles évoque en ces
termes : « description du présent immédiat -intense et frémissant – à l’aide des outils que
Rossellini a pour ainsi dire forgés et inventés sur le tas (improvisation, acteurs peu ou non
professionnels, style documentaire de la photo). (…). La pellicule doit être, plus encore
qu’un miroir, une sorte de buvard de la réalité »6. Les propos de Lourcelles sont ici
remarquables parce que, désignant la corrélation toute rossellinienne entre les moyens
(« improvisation… style documentaire… ») et les fins, le film comme « buvard de la
réalité », il décrit en fait des procédures filmiques et une posture de pensée qui
annoncent les principes du cinéma direct, dont celui-ci que Rossellini semble avoir
exactement anticipé : si le film boit la réalité c’est parce que celle-ci est en train de se
faire dans le moment où l’appareil du cinéma l’enregistre. Allant dans le même sens que
Rossellini, le critique et cinéaste Giuseppe De Santis s’adresse en ces termes à tous les
cinéastes italiens : « Nous voudrions qu’on perde à la fin chez nous l’habitude de
considérer le documentaire comme une chose distincte, séparée du cinéma. C’est
seulement de la fusion de ces deux éléments que, dans un pays comme le nôtre, il sera
possible de tirer la formule d’un authentique cinéma italien »7. Or, cette « formule » de la
fusion des genres documentaire et fictionnel, ses méthodes associées résultent de
contraintes économiques et politiques surtout, liées au contexte de l’Italie fasciste. Les
cinéastes que l’histoire a consacrés comme ceux du néo-réalisme, marqués par leur
opposition au régime en place, ont fréquemment tourné leurs films à l’extérieur des
studios de Cinecitta, en décors naturels.
8
Par manque de moyens financiers, ils ont souvent eu recours à des acteurs non
professionnels et, pour contourner le contrôle des autorités fascistes, ils ont parfois évité
d’écrire les découpages de leurs films. Autrement dit, ils ont eu l’occasion d’improviser à
la fois les modalités pratiques des tournages, qui s’effectuaient dans des conditions
parfois incertaines, et les scénarios, qui pouvaient se modifier au gré des circonstances.
�33
Ils ont ainsi ouvert la voie à ce qui deviendra quelques années plus tard de véritables
points de méthode dans les films du cinéma direct, et qui servira de source d’inspiration
esthétique à quelques cinéastes de la Nouvelle Vague.
9
Un autre trait du cinéma néo-réaliste révèle un nouveau regard qui déborde la réalité
simplement italienne. Une fois encore, c’est dans les films de Rossellini que la nouveauté
apparaît avec le plus d’acuité. Trois de ses films, Stromboli, Voyage en Italie et La Peur, ont
pour interprète principale Ingrid Bergman, une étrangère, aussi bien en termes d’origine
individuelle, que d’activité professionnelle. Or, à travers les trois films, Rossellini bâtit à
partir d’elle en tant qu’actrice étrangère et en tant que personnage décalé, l’image
saisissante d’une sorte nouvelle de voyageur : le touriste. Dans Stromboli, une séquence
exemplaire à cet égard, la montre aux prises avec un événement coutumier, une pêche
collective au thon. Or, elle offre aux pêcheurs le visage de son incompréhension de
l’événement qui se déploie devant elle, qui l’effraye et la dégoûte. Il faut rappeler ici un
détail bien connu des historiens du cinéma : les Stromboliens avaient renoncé depuis une
trentaine d’années à ce type de pêche et c’est à la demande de Rossellini – apparemment
intéressé, tel un ethnographe, par des coutumes en voie de disparition – qu’ils en ont
reconstitué une. Dans Voyage en Italie, la même actrice et son personnage, Katherine Joyce,
donnent également la mesure de la différence irrémédiable entre l’observateur étranger,
ici une riche bourgeoise anglaise, mariée mais solitaire, et un peuple anonyme, pauvre,
mais embarqué dans la liesse partagée d’une fête religieuse8. D’ailleurs, la plupart des
films néoréalistes, tournés par Rossellini et les autres cinéastes italiens dans les années
quarante et au début des années cinquante, notamment Les Gens du Po, Rome ville ouverte,
Paisa, Allemagne année zéro, Riz amer, Le Voleur de bicyclette, La Terre tremble, etc., partagent
des caractéristiques communes les rapprochant d’une anthropologie filmée,
l’anthropologie ici étant celle de l’étranger avec, en arrière-fond, la question de l’altérité
qui se fait de plus en plus obsédante à ce moment-là.
10
Bien sûr, tout le néo-réalisme ne saurait se réduire à la seule intention de produire une
vision documentée contemporaine de l’actualité italienne. De nombreux films néoréalistes, voire la majorité, construisent des situations dans lesquelles ils immergent des
héros, comme le moindre film d’action, fût-il européen et réaliste, ou bien américain, « de
genre », inspiré par un roman, « polar » ou drame criminel de préférence. Mais dans son
ensemble le néo-réalisme donne une nouvelle orientation à l’histoire du cinéma. En
premier lieu, son aspiration documentaire, organisée au sein de procédures fictionnelles
précises, fait de lui un passeur entre deux périodes du cinéma : la « classique », celle où la
fiction et le documentaire ne se confondent pas, et la « moderne », celle qui, au contraire,
fait se dissoudre les frontières entre les genres par l’invention de nouveaux types
d’images et de nouvelles procédures de montage. Le cinéma direct et la Nouvelle Vague
sont les parangons d’une modernité annoncée par le néo-réalisme, entre autres tendances
marquées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Cette modernité, devenue classique
aujourd’hui puisqu’elle est donnée en modèle aux interrogations métafilmiques des
cinéastes contemporains, se noue au cœur des années cinquante.
MODERNITÉ DU CINÉMA
11
Dans les années classiques, peu de cinéastes européens se sont fait connaître à travers des
œuvres documentaires marquantes. Les seuls qui ont effectivement rencontré une
notoriété internationale durable sont Luis Bunuel (Las Hurdes en 1932), Jean Vigo (À propos
�34
de Nice en 1930 et Taris ou la natation en 1931), le prolifique Joris Ivens qui s’est fait un nom
avec Bori-nage en 1933, John Grierson, d’ailleurs plus pour son rôle de fondateur de l’école
documentaire britannique que pour ses films (Drifters en 1929 et Fishing Banks of Skye en
1934). On peut ajouter Leni Riefenstahl, notamment passée à la postérité avec Les Dieux du
stade, pour des raisons qui ont directement à voir avec un contexte politique particulier.
Est-ce à dire que la production documentaire est pauvre ? Non, mais elle occupe une place
mineure dans l’institution cinématographique et comme la télévision n’est pas encore en
mesure de la financer et de lui assurer un mode de diffusion auprès du grand public, elle
est soit une spécialité choisie par des cinéastes qui ont, tels les Anglais du « GPO Film
Unit » ou les Américains de « Fronder Film »9, des intentions sociales et politiques
précises, soit un passage obligé pour des apprentis cinéastes, comme c’est souvent le cas
en France. Le premier film de Marcel Carné, Nogent, Eldorado du dimanche (1930) est un
court-métrage documentaire. Même chose pour René Clément (Au Seuil de l’Islam en 1936
et Arabie interdite en 1937), Jean Dréville (Autour de l’argent en 1928), Roger Leenhardt
(plusieurs courts-métrages), Jean Grémillon (filmographie documentaire abondante). La
tradition de l’apprentissage du cinéma par le documentaire s’est poursuivie au-delà des
années trente et quarante, en France notamment : Georges Franju (Le Sang des bêtes en
1948), Yannick Bellon (Gœmons en 1948), Pierre Kast (Les Charmes de l’existence en 1949 avec
Grémillon), Alain Resnais (Van Gogh, 1948), Jacques Demy (Le Sabotier du Val de Loire, 1956),
Jean-Luc Godard (Opération béton, 1954) ont tous connu ce passage obligé qui, tel un rite
d’initiation au cinéma, a joué un rôle plus ou moins important dans l’orientation de leur
œuvre de fiction à venir.
12
Or, cette époque est marquée par le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Le cinéma
européen connaît alors une mutation irréversible que l’on peut, d’ailleurs, mettre en
relation avec celle de toutes les autres formes d’expression artistiques : peinture,
littérature et musique10 notamment. Les expériences, les représentations et les idées sur
le monde, sur soi et sur l’autre, sur le réel et sur la réalité ont changé de façon si marquée
au sortir de la guerre que les images analogiques, indicielles et souvent référentielles du
cinéma, qu’elles soient réalistes ou non, révèlent tous ces changements à la manière d’une
plaque sensible. Les films néo-réalistes italiens, on vient de le voir, manifestent en
premier la mise en crise des grands modèles narratifs du cinéma. Dans la France des
années cinquante, quelques auteurs de films poursuivent le même travail de
déconstruction des modes de récit. Jean Rouch, bien sûr, mais encore, parmi les plus
connus : Chris Marker, Alain Resnais, Agnès Varda. Les films qu’ils ont respectivement
tournés entre 1950 et 1958, Bataille sur le grand fleuve, Les Maîtres fous, Moi, un noir, La
Pyramide humaine (Rouch), Dimanche à Pékin, Lettre de Sibérie (Marker), Les Statues meurent
aussi, Gauguin, Nuit et Brouillard, Toute la mémoire du monde, Le Chant du Styrène (Resnais),
L’Opéra-Mouffe, Du Côté de la côte, La Pointe courte (Varda) ont au moins une caractéristique
commune nettement marquée. Ils sont à la recherche d’un point de contact encore inédit
entre les deux pôles documentaires traditionnels, d’une part, l’observationenregistrement et d’autre part, le discours-reconstitution qui en passe par la classique
voix off du commentaire. Parfois, pour créer le contact entre les deux, lui-même censé
produire une tension filmique nouvelle, les auteurs de ces films utilisent un levier
inattendu : c’est la fiction, instrumentée comme puissance de discours, qui leur permet de
déranger tout à la fois les principes méthodologiques de l’observation scientifique et les
règles établies du cinéma, qu’il soit fictionnel ou documentaire. Les films de Rouch,
Marker et Varda sont ici particulièrement significatifs.
�35
13
Quelques critiques ont précisément relevé et analysé ce tournant. Un des premiers, André
Bazin en 1958 écrit à propos de Lettre de Sibérie que « cela ne ressemble absolument à rien
de ce qu’on a vu jusqu’ici en fait de film à base documentaire »11. En 1960, André Labarthe
creuse la réflexion d’André Bazin dans son Essai sur le jeune cinéma français 12, où il montre
le surgissement de quelques caractéristiques majeures du cinéma moderne telles que
« l’image synthétique », la « relativité du point de vue », la « dissolution des genres » qu’il
voit œuvrer dans les films de Rouch, Resnais, Franju, Chabrol, Marker. Deux décennies
plus tard, Gilles Deleuze apporte un prolongement éclairant aux considérations d’André
Labarthe à travers le lien qu’il établit entre le concept d’image-cristal et son analyse des
puissances du faux13. L’image-cristal, selon Deleuze, fait passer le cinéma de « la
description organique » à « la description cristalline ». Dans les facettes du cristal
s’engendrent toutes les ambiguïtés qui troublent le système de ressemblance et de
vraisemblance propre au cinéma fictionnel et documentaire classique. Un échange
permanent, sans solution de continuité apparente, s’établit en effet entre le réel et
l’imaginaire, le vrai et le faux, entre l’image du temps fondée sur le passé et celle fondée
sur le présent. Deleuze reprend ici la conception du temps qu’il avait développée dans
Logique du sens14 et, en la confrontant au travail d’Henri Bergson sur la mémoire, le rêve et
le souvenir, autrement dit sur les relations entre les images actuelles et les images
virtuelles, il désigne un phénomène qu’André Labarthe avait déjà nettement distingué
lorsqu’il écrivait que « le cinéma synthétique postule l’indissolubilité de l’apparence et de
sa vérité ». A elle seule, par exemple, la fameuse séquence du palais des glaces de La Dame
de Shangaï concentre toutes les vertus explosives de l’image-cristal quand elle sert,
comme ici avec une acuité particulière, à ruiner toute idée de continuité entre un modèle
et son image, quand elle vide en fait l’image du cinéma des rassurantes vertus identitaires
de l’analogie.
14
Dans son Essai sur le jeune cinéma français, notamment consacré à l’effritement des
frontières entre les différentes sortes de films, André Labarthe avait réuni Moi, un noir et
Hiroshima, mon amour, les premières œuvres à « surmonter », selon lui, « l’opposition
entre le documentaire et la fiction ». Ou encore, il voyait dans le cinéma « science-fictif »
de Chris Marker une « manière particulière de mêler la science (le documentaire) et la
fiction [faisant que] la valeur absolue de l’image se voit constamment contestée au profit
de sa valeur relative »15. Pour sa part, au titre des « puissances du faux », Gilles Deleuze
cite rapidement quelques films des années soixante : Le grand Escroc (Godard, 1964),
L’Année dernière à Marienbad (Resnais, 1961), Trans-Europ-Express (Robbe-Grillet, 1966). Puis
il analyse plus particulièrement le cinéma d’Orson Welles et celui de Jean Rouch, selon
une association qui peut sembler étonnante au premier abord. L’un est en effet désigné
par la figure du « faussaire » et l’autre est rattaché au « cinéma-vérité ». Mais c’est en
réalité la même chose. Welles, en faisant « passer l’image sous la puissance du faux (…) est
créateur de vérité » et Rouch « détruit tout modèle du vrai pour devenir créateur,
producteur [lui aussi] de vérité »16. Dans cet ordre d’idée, on peut constater que si Rouch,
issu du cinéma ethnographique, a réalisé des fictions, Welles, droit venu de la fiction
quant à lui, a réalisé des documentaires17.
JEAN ROUCH ET LE CINÉMA DIRECT
15
En terme de chronologie, le cinéma direct est le contemporain de la Nouvelle Vague.
Comme celle-ci, il est issu d’une posture critique vis-à-vis de l’institution du cinéma, plus
�36
particulièrement du cinéma documentaire. Les cinéastes du direct, à commencer par Jean
Rouch, veulent en effet récuser des canons légitimés par plusieurs décennies de
classicisme documentaire. Or, leur manière de travailler, leur conception du rapport
documentaire à la réalité ont pour effet – à moins que ce ne soit une cause – de leur faire
retrouver un esprit ancien, primitif même du cinéma, celui des vues Lumière. En effet
réalisées en une prise unique que l’on pourrait qualifier de « plan-séquence », les vues
sont déjà, enregistrement sonore en moins, des films directs ! Ainsi, le cinéma direct est-il
voué au plus grand écart possible entre d’une part, son retour aux origines mêmes de la
fonction documentaire du cinéma et d’autre part, sa vocation à créer du nouveau, dans un
contexte où de manière générale le cinéma est en pleine phase de renouvellement. Le
néo-réalisme est l’initiateur de cette tendance qu’il exemplifie. Le cinéma direct, qui vient
peu après, est une autre face de la modernité qui s’est sublimée dans la Nouvelle Vague.
16
Le lien entre cinéma direct et Nouvelle Vague, largement attesté, a fait l’objet
d’observations et de commentaires nombreux. Or, phénomène beaucoup moins
remarqué, le cinéma direct est, lui aussi, apparenté d’une certaine façon, au néoréalisme.
S’il se déploie au départ dans le seul territoire du documentaire, il partage avec la fiction
néo-réaliste une volonté déterminée de renouvellement des méthodes de création
filmique, mais dans une intention plutôt politique ou militante qu’esthétique. C’est ainsi
que pour parler du cinéma direct, l’italien Enrico Fulchignoni emploie des termes qui
pourraient convenir aussi bien au néo-réalisme : « Refus des formes traditionnelles et des
conventions, recours aux sources populaires, (…) en vue de la contestation politique » 18.
Autre aspect, et non des moindres, d’une possible comparaison entre les deux
cinématographies : leur rayonnement et leur influence durable dans l’histoire du cinéma.
De même que tout le réalisme moderne du cinéma de fiction européen est marqué par sa
source italienne, de même la décennie effervescente du cinéma direct, celle des années
soixante, laisse une marque profonde, irrémédiable sans doute sur la production
documentaire moderne et contemporaine. On peut même constater que si le néo-réalisme
est désormais éloigné dans la mémoire que le cinéma a de lui-même, en revanche, le
cinéma direct prolonge son existence dans de nombreuses formes filmiques actuelles,
notamment celles qu’a engendrées la télévision à travers des dispositifs variés de films et
d’émissions documentaires.
17
Sans doute, le cinéma direct tire-t-il cette longévité d’une caractéristique originelle et qui
fait de lui une des expressions les plus spécifiques de la modernité du cinéma dans son
moment d’émergence : sa capacité à radicaliser une forme nouvelle d’approche de la
réalité, grâce à des principes et des méthodes de tournage que l’on peut résumer en
quelques caractéristiques essentielles. L’équipe technique est réduite au strict minimum :
un opérateur et un preneur de son, le plus souvent. La caméra des films directs est
immergée – comme l’était déjà celle de Flaherty – dans un milieu réel. Le plus souvent,
elle est portée par l’opérateur. Elle filme les actes et les paroles de gens réels, sans
scénario préconçu écrit à l’avance. Une scène tournée, enregistrée comme telle, n’est pas
rejouée en principe. Par ailleurs, le son et toutes ses composantes constituent un des
enjeux majeurs du cinéma direct qui a le souci de le capter à sa source, là où il se produit
et quand il se produit : il s’agit de parvenir à enregistrer du son synchrone direct, une
aspiration fondamentale de la majorité des cinéastes concernés. Ils souhaitent en effet se
démarquer d’un héritage du documentaire classique : la hiérarchisation des sons qui
assure la primauté du commentaire en voix off et dispose des sons réels comme s’ils
étaient des « ambiances ». À cet égard, le cinéma direct répond aux attentes nouvelles de
�37
l’observation scientifique des êtres humains, en groupes ou individuellement. L’approche
ethnographique et sociologique, notamment, vise la vie quotidienne des personnes
observées dans son tissu ininterrompu d’actions et de paroles dont l’interrelation est
l’enjeu même de l’observation. De façon plus large, l’anthropologie, acquise aux méthodes
d’investigation de la psychanalyse et de la psycholinguistique, s’intéresse de plus en plus
spécifiquement à l’expression langagière des individus, chacun se définissant par un
idiome irréductiblement singulier où intervient une multitude de processus mêlés, les
mots n’étant qu’une composante de cet idiome : voix, intonation, accent, rythme
d’élocution, registre lexical, non-dit, silence, gestuelle, etc. Tout cela, qui fait là encore
l’objet de l’observation, ne saurait souffrir aucune traduction et doit donc être capté à sa
source et sonorisé comme tel.
18
À cet égard, quelques films marquent l’histoire du cinéma direct et illustrent ses liens
avec l’anthropologie moderne. Par exemple : O Dreamland (Lindsay Anderson, 1954), A
Happy Mother’s Day (Michel Brault, Gilles Groux, 1958), We Are The Lambeth Boys (Karel
Reisz, 1959), Primary (Richard Leacock, 1960), Moon Trap (Pour la suite du monde, Michel
Brault, Pierre Perrault, 1963), Jeunesse année zéro (Louis Portugais, 1964), Portrait of Jason
(Shirley Clarke, 1967) sont tous des films, parmi d’autres, qui rendent mémorable la
parole en acte, faisant d’elle l’événement majeur des récits filmés. Ils détournent en effet
la vocation figurative visuelle du cinéma documentaire au profit d’une forme nouvelle
dans laquelle les figures sonores se mettent à valoir pour elles-mêmes, le cas extrême
étant celui du film de Shirley Clarke. La cinéaste a filmé pendant douze heures un
prostitué noir américain en train de parler de lui-même puis elle a monté les moments les
plus significatifs en un long-métrage d’une centaine de minutes. Au début du film, Jason
est souriant, à la fin, il pleure, entre les deux il orchestre assez magistralement l’écart
entre lui en tant que tel, et lui, en représentation. Or, le seul acte essentiel qu’il accomplit
consiste en sa prise de parole. Il n’est pas difficile de constater que ce type de film est
tombé à point nommé pour esquisser la suite que le cinéma s’est donné à lui-même au
travers de la télévision. On peut remarquer aussi bien que la « logorrhée » jugée souvent
caractéristique de la Nouvelle Vague française, notamment haut portée par Antoine
Doinel/Jean-Pierre Léaud dans les films de François Truffaut, procède d’une même
conception moderne de la personne et de son adéquation aux images. En fait, le cinéma
direct, la Nouvelle Vague et, bien au-delà, toutes les formes du cinéma sont modernes
dans les années cinquante et soixante, car entre autres processus, elles opèrent un
renversement de certaines valeurs filmiques, la relation image/son par exemple. Un être
représenté se caractérise désormais autant par son image sonore que par son image
visuelle. En France, un film de 1973 met en scène ainsi ses personnages. C’est La Maman et
la putain de Jean Eustache, un cinéaste dont l’œuvre s’inscrit avec une intensité
particulière au croisement de la volonté d’art et de l’observation sociologique et
subjective de l’environnement immédiat, personnel, intime à la limite.
19
Un autre trait du cinéma direct est, ou a été, trop rarement évoqué : l’appellation désigne
aussi bien des films documentaires que des films de fiction. Gilles Marsolais en cite
quelques-uns, diversement mémorables, dans son « dictionnaire filmographique »19 :
Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1962), L’Amour à la ville (M-A Antonioni, 1953), L’Amour fou
(Jacques Rivette, 1968), Prologue (Robin Spry, 1969), La Punition et La Pyramide humaine
(Rouch, 1959-1960), La Rosière de Pessac (Eustache, 1969), Salvatore Giuliano (Rosi, 1962),
Shadows (Cassavetes, 1958), Viol d’une jeune fille douce (Gilles Carie, 1968), etc. Mais la
vocation sociologique, politique et souvent militante des films directs en passe par une
�38
immersion de leur réalisateur dans l’actualité du monde, dans la contingence des faits
constatés et les aléas des rencontres menées. Or, l’immersion dont il s’agit ici n’est pas
toujours et seulement effective ou authentique. Elle peut être simulée mais, à la
différence de la fiction du cinéma réaliste qui procède à des reconstitutions, les
techniques de tournage sont celles du cinéma direct à travers l’orchestration, souvent
subtile, de circonstances qui font se mêler étroitement des éléments offerts par la réalité
elle-même et les contraintes filmiques qui pèsent malgré tout sur celle-ci. Cette mise en
équation n’est pas neuve : le néo-réalisme l’avait déjà instaurée, d’une manière d’ailleurs
si souvent magistrale qu’elle pouvait apparaître comme définitive, dans les films de
Rossellini par exemple. Mais en France, Jean Renoir en expérimente le versant sonore
dans Toni, en 1934. On la retrouve chez Eric Rohmer quand, en 1959, il tourne Le Signe du
lion pour une bonne part dans les rues de Paris, ainsi que chez Jacques Rozier qui, en 1958,
installe une fiction d’une vingtaine de minutes dans les rues d’Antibes, avec deux jeunes
acteurs parfaitement amateurs, les héros de Blue Jeans. Jacques Rozier, notons-le, est de
tous les cinéastes de la Nouvelle Vague celui qui revendique le plus clairement l’héritage
du néo-réalisme20. L’énumération pourrait d’ailleurs s’étendre à de nombreux films de la
Nouvelle Vague, celle-ci étant souvent marquée par un projet de rencontre immédiate
entre le cinéma de fiction, art de studio, et le cinéma documentaire, art de la rue.
20
Tout ce que l’on vient de dire intéresse évidemment le cinéma de Jean Rouch. Plus
exactement, si l’on peut parler d’une école française du cinéma direct, elle passe
essentiellement par Rouch. Peu de cinéastes français, en effet, sont concernés par cette
forme de cinéma. Les plus connus – et reconnus – sont François Reichenbach, Mario
Ruspoli, Chris Marker et le précurseur Georges Rouquier. Parmi eux, Rouch fait figure de
chef de file incontestable car il « est l’un des rares réalisateurs français qui aient utilisé de
façon systématique le cinéma direct comme tel »21. Quoi qu’il en soit, son nom et son
œuvre sont étroitement liés à l’histoire du cinéma direct au travers de quelques
événements déterminants. On en relèvera deux ici, relatifs à Chronique d’un été, une
enquête sociologique d’Edgar Morin, filmée par Jean Rouch en 1960.
21
L’année précédente, lors du premier Festival International du Film ethnographique de
Florence en décembre 1959, le socio-anthropologue Edgar Morin, auteur d’un livre
marquant, Le Cinéma ou l’homme imaginaire22, est interviewé par un journaliste de FranceObservateur. Il a « eu l’impression qu’un nouveau cinéma-vérité était possible ». Passant en
revue « le cinéma soviétique de la grande époque puis des films néo-réalistes », il tente de
caractériser « le nouveau cinéma-vérité », celui que Rouch et lui vont justement réaliser
en 1960 dans leur entreprise commune de Chronique d’un été. L’idée – son expression du
moins, directement reprise du kino-pravda de Dziga Vertov – fait mouche et connaît un
sort ambivalent. Elle est utilisée à des fins publicitaires lorsque l’affiche du film, présenté
au festival de Cannes en 1961, porte cette inscription : « Pour un nouveau cinéma-vérité ».
Mais elle suscite aussi des réserves, des controverses et des débats parmi les critiques et
les historiens du cinéma23. C’est que la vérité pose problème, surtout représentée dans
une forme choisie, forme obtenue par la médiation d’une technologie qui ne donne pas à
voir la réalité mais l’image de cette réalité, son double (plus ou moins) ressemblant. Il faut
alors parler non pas de la vérité du monde mais de la vérité de l’image, équivoque elle
aussi. C’est à l’issue de ce débat qu’est née l’appellation « cinéma direct », proposée par
Mario Ruspoli lors d’une rencontre cinématographique à Lyon, en 1963. Elle finit par
fédérer des cinéastes de plusieurs pays qui tous se reconnaissent dans l’emploi spécifique
de techniques à des fins elles-mêmes particulières, qu’ils soient des auteurs du « Candid
�39
Eye » britannique, du « Free cinema » américain ou de « l’Office National du Film »
canadien. Cette péripétie, bien connue des historiens du cinéma, a le mérite de mettre en
lumière le travail filmique de Jean Rouch comme un des fondements du cinéma direct.
22
La deuxième contribution de Chronique d’un été au cinéma direct est plus technique. Il
s’agit du travail d’enregistrement sonore dont une des péripéties, elle aussi évoquée par
Edgar Morin, est notoire. L’équipe du film est à Paris, en extérieur, place de la Concorde.
Jean Rouch suit Marceline Loridan qui parle en marchant. Changement de lieu. Morin
rapporte : « C’est un autre décor. Carrefour de rue. Marceline avance en s’éloignant de
nous. On entend sa voix fredonner “Les grands prés marécageux”… Elle soupire ».
Marceline continue à parler : « Papa… quand je t’ai vu, tu m’as dit “et Maman ? et
Michel ?”. Tu m’as appelée “ta petite fille”, j’étais presque heureuse… ». Morin poursuit
ses annotations : « On reconnaît les voûtes des Halles. La caméra, qui la précède à
nouveau, s’éloigne d’elle très vite. Marceline n’est plus bientôt qu’une petite silhouette
solitaire dans les Halles vides, mornes et immenses, tandis qu’on entend encore sa voix ».
Suite du monologue de Marceline Loridan : « … d’être déportée avec toi, tellement je
t’aimais, etc. »24. Ce moment est hautement singulier dans la mesure où pour la première
fois un film documentaire parvient à réaliser une captation de son synchrone direct, grâce à
une procédure technique aussi simple qu’habile. D’une part, l’ingénieur du son André
Coutant, sollicité par Rouch, a eu l’idée de coupler la caméra à un magnétophone.
L’histoire du cinéma, du moins en France, a retenu – comme par antonomase – que la
caméra de Chronique d’un été était une « Eclair-Coutant ». D’autre part, rappelant quelque
peu le cinéaste fictif de Singing in the rain, acharné à trouver la meilleure technique
possible pour « sonoriser » Vera Lamont dans son premier film parlant, Coutant a confié
un micro à Marceline Loridan, relié par fil au magnétophone. La technique mettait ainsi
en synchronie parfaite tous les composants de la situation filmée : mouvement de la
caméra, déclenchement du magnétophone, mouvement du personnage filmé, son de sa
voix, articulation du moindre mot. Aujourd’hui, la séquence montre son imperfection,
voire sa rusticité qui renvoie à un autre moment sonore initiatique dans l’œuvre d’un
cinéaste important : c’est la bande-son de M, le premier film parlant de Fritz Lang, qui
offre une raréfaction excessive, irréalisante des sons d’ambiance, tonalité d’autant plus
frappante que le film joue sur le registre d’un réalisme méthodique et méticuleux. Même
phénomène dans cette séquence expérimentale de Chronique d’un été. Pourtant, si l’on
écoute bien ce qui se passe au-delà de la confidence difficile, timidement murmurée par
Marceline Loridan, rescapée d’un camp de concentration, on peut entendre le cinéma
d’observation prendre son envol vers un accomplissement auquel il aspire depuis
longtemps : tout de suite faire entendre sans médiation ce que les protagonistes disent,
faire voir leur image de gens qui parlent, de gens qui se savent à la fois filmés et écoutés
et surtout, peut-être, faire tomber dans les oreilles des spectateurs le grain inaliénable,
authentique de chaque voix enregistrée.
23
Mais pour Jean Rouch, le cinéma direct ne se joue pas seulement en France. À ses débuts,
antérieurs à l’éclosion du cinéma direct, il a rencontré à la fois les Africains de l’Ouest et
les ethnologues qui étudiaient leurs sociétés. Par la suite, dans les années cinquante,
Rouch tisse des liens particulièrement serrés avec des cinéastes outre-Atlantique, les
réalisateurs de l’O.N.F, ses homologues, ou ses pairs, en cinéma. Or, de même que
l’Afrique visitée par lui est majoritairement celle qu’a colonisée la France, de même, la
langue et la culture françaises ne sont pas pour rien dans cette rencontre canadienne.
Outre les techniques de tournage que Rouch a apprises auprès de certains des réalisateurs
�40
de l’O.N.F, Michel Brault en particulier, c’est toute une situation singulière qui s’est en
effet offert à lui, confortant sa posture de cinéaste à la fois important et à la marge. À ce
sujet, un article récent de Vincent Bouchard25 éclaire l’histoire de l’O.N.F. et donne des
aperçus intéressants sur la présence de Rouch au Canada. A grands traits, l’auteur parle
d’abord du contexte. Dans les années cinquante, le paysage institutionnel canadien du
cinéma est dominé par le National Film Board des anglophones, basé à Ottawa, et « les
cinéastes francophones subissent différentes formes de discrimination ». En 1956 un
Office du film est tout de même installé à Montréal et finit par être dirigé en 1957 par un
commissaire francophone. Enfin, et surtout, pour les Canadiens francophones, « la France
reste la référence culturelle ». Les intellectuels canadiens vont donc en France alors que
« par contre, les seuls français dont on retrouve la trace au Canada sont principalement
des immigrants, des aventuriers ou des exilés ». Dans la pauvreté des échanges entre les
deux cultures francophones, Vincent Bouchard note le « développement d’une forme de
cinéma légère et synchrone, de manière concomitante à Montréal et à Paris ». Il précise
que « la pierre angulaire de cette collaboration est le cinéaste français Jean Rouch ».
Vincent Bouchard fait porter son analyse de l’événement sur quelques points essentiels,
oscillant entre des appréciations flatteuses et des remarques critiques, des éléments
factuels et des analyses de fond.
24
Prenons d’abord les faits : le premier contact de Rouch avec le cinéma canadien
francophone remonte à 1949, au Festival du Film Maudit de Biarritz, où il fait la
connaissance de Norman Mac Laren. La deuxième circonstance, encore plus décisive, se
passe avec Claude Jutra qui, après avoir vu Moi, un noir à Paris en 1958 « précipite son
départ pour Abidjan » afin d’y rencontrer Rouch. C’est d’ailleurs dans sa lancée africaine
que Jutra va réaliser pour l’O.N.F. en 1961 Niger, jeune république. Jean Rouch collabore au
tournage de ce film. En 1959, lors d’un « séminaire Flaherty » en Californie, Michel Brault
et Claude Fournier présentent Les Raquetteurs à Jean Rouch qui est « impressionné par la
caméra en mouvement ». Rouch invite Brault à Paris pour le tournage de Chronique d’un
été. Brault est convaincu parce qu’il s’est aperçu que Rouch et lui « se ressemblaient un
peu comme cinéastes ». Brault « importe des pratiques utilisées à l’O.N.F. », notamment
pour la séquence parlée avec Marceline Loridan, dont il est l’opérateur. A Paris, Brault fait
la connaissance de Mario Ruspoli et, de même qu’il a aidé Rouch, il collabore au tournage
du troisième film de Ruspoli, Les Inconnus de la terre (1961). Il reprend ainsi en Europe une
habitude bien implantée chez les réalisateurs du cinéma direct nord-américain, et dans
une moindre mesure, parmi les cinéastes parisiens de la Nouvelle Vague : la participation
réciproque des uns au tournage des films des autres.
25
C’est par le biais de ce contact serré, avec Jutra et Brault surtout, que Rouch exerce une
influence « incontestable » sur le cinéma direct québécois. Vincent Bouchard mentionne
notamment Pour la suite du monde, un long-métrage en 16 mm, coréalisé en 1963 par
Michel Brault et Pierre Perrault à l’Ile-aux-coudres, une petite île située non loin de
Québec. Ce film, une des œuvres majeures du cinéma direct canadien francophone, peut
se comparer à Stromboli du fait d’une circonstance spécifique : le point de départ en est
une fiction par laquelle les insulaires remettent en vigueur une pêche ancienne au
marsouin, tombée en désuétude, exactement comme la pêche au thon fut ressuscitée pour
les besoins du film de Rossellini. Mais Moi, un noir vient aussi faire entendre sa présence
dans Pour la suite du monde, à deux égards au moins. D’abord, la fiction initiale est en prise
directe sur une double réalité : celle de la pêche inscrite dans l’histoire coutumière de l’île
et celle du film qui enregistre en direct des faits réellement vécus par les protagonistes
�41
lors du tournage. Or, le même rapport entre la fiction narrative et le récit documentaire
fonctionne dans Moi, un noir. Ensuite, comme Jean Rouch l’avait fait avec Oumarou Ganda,
jeune Nigérien immigré à Abidjan26, les cinéastes ont élevé un des protagonistes filmés,
Alexis Tremblay, au rang de personnage principal. Or, à la manière d’Oumarou Ganda,
Alexis Tremblay s’adonne au commentaire des événements, parlant aussi bien de son
propre mode de vie que de la pêche dont il est en train de vivre les péripéties collectives.
Un troisième trait offre une ressemblance entre ce film et le cinéma de Jean Rouch : il a
une suite en 1967, Le Règne du jour, dans lequel on voit Alexis Tremblay et sa femme venus
en France à la recherche de leurs origines. Plusieurs films de Rouch connaissent des suites
de ce genre. C’est, par exemple, La Chasse au lion à l’arc de 1965 que prolonge en 1969 Un
Lion nommé l’américain. C’est aussi Jaguar (1954-1967) et sa suite, Petit à Petit, tourné treize
ans plus tard, dans laquelle on voit les héros nigériens de Jaguar en voyage d’affaires à
Paris27.
26
Par-delà ces traits de ressemblance, il semble pourtant que la relation des Canadiens au
cinéma direct diffère sensiblement de ce qui se passe en France, pour le cinéma de Rouch
notamment, immergé dans la modernité ambiante. A Montréal, en revanche, « beaucoup
d’intellectuels [canadiens] regrettent que le cinéma prenne une voie aussi mineure. Ils
privilégient une conception classique du cinéma, telle qu’elle est pratiquée à Hollywood
ou dans les studios français. De manière générale, tous les maux sont attribués à Jean
Rouch. Si les Canadiens français et Michel Brault en particulier ne font pas de vrais films,
c’est en raison de l’influence de Rouch »28. Son œuvre attire des critiques variées, le plus
souvent motivées par des raisons d’ordre idéologique ayant peu à voir avec l’esthétique,
le style, le travail formel. Ici, le constat critique prétend associer les deux aspects.
L’idéologie : « Rouch ne s’exprime pas sur la situation de domination vécue par les
francophones à l’O.N.F ». La forme : la critique canadienne francophone de l’époque s’en
prend à Rouch sous prétexte qu’il encourage la réalisation de films médiocres. La critique
et le public les voient comme des « glossages prétentieux » , constatant « leur préparation
bâclée », leur réalisation « sans méthode et leur montage sans imagination. (…). Aucun ne
prend en compte la dimension de prise de parole. Au mieux le film est ressenti comme
bavard »29. Les deux observations sont pareillement intéressantes, mais pour des raisons
différentes. La première pointe un caractère constant du travail de Rouch qui, bien
qu’amené à réaliser des films à partir d’enquêtes de type sociologique, évite tout
positionnement qui apparaîtrait comme politique. Cela est d’autant plus criant que le
colonialisme dans ses épisodes violents et sa contestation sont connus de lui depuis le
début de sa carrière de cinéaste. La deuxième critique est comme une démonstration de
ce que n’est pas le cinéma de Rouch, quand bien même s’adonnerait-il, lui aussi, au
bâclage. « Imagination » et « dimension de prise de parole » en sont en effet deux des
moteurs essentiels. Mieux, les films de Rouch sont précisément ce que les critiques
québécois aimeraient que soient ceux des réalisateurs francophones de l’O.N.F, à savoir,
« marqués d’une personnalité et qui rejoignent l’universel »30.
27
À ce stade de notre étude, il convient de constater que l’enracinement de l’œuvre de
Rouch dans le cinéma direct ne suffit pas à en expliquer la substance. Cette forme de
cinéma direct joue un rôle important, mais il n’est qu’un élément, à la manière d’une
pièce d’un puzzle, qui aura permis à Rouch de trouver une adéquation entre les nécessités
d’une technique contrainte par la pauvreté des moyens matériels à sa disposition et la
part inappréciable de son génie propre où l’esprit du bricoleur se confond aisément avec
la patience organisée de celui qui, poursuivant un projet personnel, un rêve ou une
�42
utopie, n’a cure de rester dans les limites d’un territoire défini. C’est ainsi que Rouch
n’aura été un initiateur et un adepte du cinéma direct que pour mieux le déborder, ou,
autrement dit, que pour moins s’y laisser enfermer.
JEAN ROUCH ET LA NOUVELLE VAGUE
28
Jean Rouch n’est pas un cinéaste de la Nouvelle Vague. Il est un voisin, un ami, parfois un
complice. Et la Nouvelle Vague le lui rend bien. Leur relation mutuelle transparaît
notamment dans les souvenirs de Rouch. En voici un épisode, parmi tant d’autres à peu
près semblables, recueilli lors d’entretiens à la fin des années quatre-vingt avec plusieurs
auteurs du « cinéma du réel ». Lors de la projection d’une version encore provisoire de
Jaguar, organisée en 1957 à la Cinémathèque française par Henri Langlois. : « …
Je présente [le film], raconte Rouch. Il y avait là tous mes “copains du premier rang”
de la rue d’Ulm, Rivette, Truffaut, Rohmer, Godard… Le film casse mais le son
continue, on rallume, et ils découvrent que l’auteur, c’est moi, le type dont ils ne
savaient pas très bien ce qu’il faisait là… Cette liberté d’improvisation, cette liberté
avec les images, c’est vrai que cela a influencé la Nouvelle Vague française. Mais
entre eux et moi, il y avait deux différences. J’étais réalisateur-cameraman (…) et
puis ils refusaient le 16 mm31.
29
De telles évocations surgissent souvent dans les propos de Rouch qui se souvient à la fois
d’un environnement propice à l’amitié, sinon à la camaraderie entre initiés, et de la mise
en œuvre d’un fonds commun du cinéma, d’une pensée commune, plutôt, de la nécessité
de son évolution. Quand Truffaut vitupère en 1954 « une certaine tendance » du cinéma
de la « Qualité française », quand Godard salue Jacques Tati en 1957 parce qu’« avec lui, le
néo-réalisme français est né »32, ou que la même année, Louis Malle commande à Miles
Davis la musique d’Ascenseur pour l’échafaud et confie le rôle principal à Jeanne Moreau,
révélée en actrice moderniste dans ce film33, tous partagent une même aspiration : il faut
que quelque chose naisse. Qualité nouvelle de l’écriture, création de formes, état nouveau
de la relation du cinéma à la réalité, nouvelle incarnation d’acteur (d’actrice), etc.,
Truffaut, Godard, Malle ne visent pas autre chose que ce que Rouch veut atteindre lui
aussi : l’imprévu, le contingent, l’intempestif, tout ce qui, en somme, ne se manifeste que
pour décadrer les images bien faites, déborder les visées des scénarios bien écrits,
délocaliser l’histoire même du cinéma en tournant les films ailleurs, autrement. Pour les
« jeunes turcs » cet ailleurs est dans les rues de Paris ou les appartements des amis, des
lieux inconnus des studios de cinéma. C’est ainsi que la manière dont des corps étrangers
aux histoires filmées s’intègrent aux films, voire même les fécondent, est un trait typique
de la Nouvelle Vague. Le cinéma de Jacques Rozier en offre de très bons exemples, si
parfaits à cet égard qu’ils emmènent abruptement la fiction sur les rivages du plus pur
cinéma documentaire34.
30
Plus généralement, les techniques utilisées pour la réalisation des films de la Nouvelle
Vague recoupent souvent celles du cinéma direct, vont même parfois jusqu’à se
confondre avec ces dernières. En premier lieu, les cinéastes pratiquent souvent les
tournages en extérieur et les lieux investis par eux ne sont pas de simples décors naturels,
ils sont au contraire élevés au rang de protagonistes des histoires filmées, que ce soit à
Paris, tels Les 400 coups, Le Signe du lion, A bout de souffle, Paris nous appartient, Les bonnes
Femmes, ou ailleurs : La Pointe courte, Le beau Serge, Lola. Les protagonistes de ces films ne
vont pas simplement d’un lieu à un autre, leurs trajets ne sont pas seulement asservis aux
nécessités des scénarios tels qu’ils sont écrits, ils emmènent le spectateur dans une
�43
découverte vivante des lieux dont les images filmées prennent une incontestable valeur
documentaire. Chez Truffaut par exemple, il s’agit de laisser apparaître une géographie
du souvenir : le cinéaste a grandi dans quelques rues de Paris, singularisées par la
présence de salles de cinéma. Aussi, le jeune héros de son film erre-t-il presque
exclusivement à l’intérieur du territoire délimité par ces rues, celui de sa précoce
cinéphilie. Rohmer, quant à lui, fait de Paris l’espace même de l’étrangeté puisqu’il égare
son personnage dans des rues qu’il connaît bien, qu’il ne cesse de parcourir et qui
s’offrent à lui comme un labyrinthe parfaitement ordonné et interminable. Un des
derniers films de la Nouvelle Vague exemplifie ce rapport nouveau entre le cinéma et la
ville, déjà signifié dans le titre : Paris vu par… . Pour ce film collectif, Jean Rouch a réalisé le
court-métrage Gare du Nord qui marque sa rencontre avec le cinéma de la Nouvelle Vague
35
.
31
« Le son direct » est un autre trait qui instaure une relation entre le cinéma tel que le
pratique Jean Rouch et celui que les auteurs de la Nouvelle Vague ont envie de faire.
Michel Marie rappelle que pour ces derniers « le débat esthétique tourne essentiellement
autour de la question de la post-synchronisation ». Mais dans les années cinquante,
l’enregistrement du son direct synchrone tient encore de l’utopie pour au moins deux
raisons : la lourdeur du matériel d’enregistrement, qui le rend peu adapté aux tournages
des scènes de rue, et son coût trop élevé pour les petits budgets des films de la Nouvelle
Vague. A cet endroit pourtant, la place de Rouch dans le paysage du cinéma français
moderne apparaît on ne peut plus clairement. Elle est ménagée par Jean-Luc Godard qui
« s’inspire » du travail sonore de Moi, un noir, « en post-synchronisant d’abord Charlotte et
son Jules, où il a l’audace de doubler lui-même Jean-Paul Belmondo, puis À bout de souffle,
avec la même liberté et la même désinvolture apparente ». Autre détail, relevé par Michel
Marie : « La synchronisation de l’enregistrement image et son devient plus facile grâce à
de nouveaux magnétophones, comme le Nagra » qui va d’ailleurs être de plus en plus
utilisé aussi bien par « la télévision et par le cinéma de reportage »36. Chronique d’un été est
évidemment le modèle initiateur aussi bien à travers la technique d’enregistrement
sonore mise au point par André Coutant, la technique de prise de vue en caméra portée de
Michel Brault, jusqu’à la marque du magnétophone employé : un « Nagra » !
32
Le mode de production de leurs films respectifs signale également une connivence entre
Jean Rouch et les cinéastes de la Nouvelle Vague. L’esprit qui règne parmi ces derniers est
celui d’un défi au système dominant qui promeut notamment les superproductions
contemporaines, réalisées par des cinéastes alors prestigieux. Michel Marie rappelle qu’ils
sont ceux-là mêmes que Truffaut accable de son courroux : Clouzot, Clément et AutantLara. Ils sont selon Truffaut « pourris par l’argent » et « il énonce cet aphorisme
provocateur : “ce qui manque le plus au cinéma français, c’est l’esprit de pauvreté”37. »
Autrement dit, les cinéastes de la Nouvelle Vague se distinguent par leur volonté
d’assumer des réalisations au budget modeste. Mais la chose n’est possible, au fond, que
parce qu’ils ont des producteurs pour les aider, ou pour les suivre. C’est bien connu : à la
Nouvelle Vague sont attachés les noms de quelques producteurs. Le fait peut d’ailleurs
donner à sourire puisqu’il a un écho dans le système cinématographique apparemment le
plus éloigné qui soit de la Nouvelle Vague : celui d’Hollywood, marqué par la présence
notable, parfois écrasante, de grands producteurs (Selznic, Thalberg, Goldwin, Mayer,
etc.), qui sont à certains égards les véritables « auteurs » des films, alors que les
réalisateurs n’en sont que les « directors ».
�44
33
Parmi les producteurs de la Nouvelle Vague, trois se distinguent : Pierre Braunberger,
Anatole Dauman et Georges de Beauregard. Braunberger s’est fait une spécialité de la
promotion du court-métrage. Sa société, « Les Films de la Pléiade », produit notamment
les films d’art d’Alain Resnais (Van Gogh, Guernica et Gauguin), les premiers films de Godard
(Tous les garçons s’appellent Patrick, Charlotte et son Jules) et bien sûr, des films
ethnographiques de Rouch : Les Maîtres fous (1954), Mamy Water (1955), La Punition (1962),
Les Veuves de quinze ans (1964). Il produit aussi des longs-métrages très variés. Des
fictions : Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville, Tirez sur le pianiste de Truffaut, Vivre sa
vie de Godard. Il accompagne longtemps le travail de Rouch, puisque au fil des ans il
produit Jaguar (1954), Moi, un noir (1957) et, au-delà de la période de la Nouvelle Vague,
Petit à petit en 1970 et enfin, sous le couvert des « Films du Jeudi », Dionysos en 1984.
Braunberger s’intéresse aussi au cinéma documentaire. En 1958 il produit L’Amérique
insolite de François Reichenbach ; en 1952 Les Fils de l’eau de Rouch (une synthèse de cinq
courts-métrages tournés entre 1948 et 1951) et La Chasse au lion à l’arc en 1965. Les
productions d’« Argos Films », la société d’Anatole Dauman, présentent la même diversité
entre courts et longs-métrages, films d’art, fictions et documentaires. Dauman est en effet
le producteur des films « science-fictifs »38 de Chris Marker (Dimanche à Pékin et Lettres de
Sibérie), des documentaires et des fictions de Resnais (Nuit et brouillard, Hiroshima, mon
amour, L’Année dernière à Marienbad). De Rouch, il produit Chronique d’un été (1960) et
Monsieur Albert prophète (1962). Georges de Beauregard fut surtout le producteur de JeanLuc Godard et avec le succès phénoménal d’À bout de souffle qui apporte « un nouveau
triomphe à la Nouvelle Vague (…) il devient le principal producteur de la Nouvelle
Vague »39 (sauf de François Truffaut). Il ne produit pas de film de Rouch.
34
Dans ce contexte spécifique, Jean Rouch appartient à une petite constellation de cinéastes
français : celle d’Alain Resnais, Chris Marker, Agnès Varda aussi, que la Nouvelle Vague a
rencontrés mais pas complètement absorbés. Pour autant, leurs films ne présentent pas
nécessairement des ressemblances qui les rapprocheraient pareillement de la Nouvelle
Vague, tout en les maintenant dans une même extériorité qui serait leur marque. Il
convient plutôt de parler pour les uns et les autres d’une autonomie, territoriale
notamment. La Nouvelle Vague est ancrée à Paris comme un bateau sur la Seine, parfois
elle va à la campagne ou en province, mais pour mieux revenir à son ancrage d’origine. Le
partage entre la ville et la campagne ou encore, entre la capitale et la province se
rencontre aussi dans les films de Varda (Cléo de 5 à 7 est tourné à Paris, La Pointe courte à
Sète, Du côté de la côte le long de la Riviera), mais pas seulement : par exemple, elle réalise
Salut les Cubains avec des photos prises par elle lors d’un séjour à Cuba en 1963. Marker et
Resnais, comme cette dernière, comme Rouch, passent les frontières du pays, du
continent européen, voyagent au loin, si bien qu’ils font des films explicitement
déterminés par des villes, des contrées, des peuples étrangers. C’est ainsi que les Japonais
d’Hiroshima, mon amour et les Chinois de Dimanche à Pékin valent pour les Nigériens de
Bataille sur le grand fleuve ou de Jaguar, en ce sens, ici, que le regard les faisant naître au
cinéma dans des images documentaires ou fictionnelles est le même que celui qui crée,
dans les films de la Nouvelle Vague, une espèce nouvelle de Parisiens dont ils sont ainsi
pareillement dissemblables. On peut alors penser de ces cinéastes en marge qu’ils offrent
à la Nouvelle Vague un trésor inappréciable : un dehors, une différence, une ligne de
perspective supplémentaire, quelque chose en tous cas qui, en agrandissant le territoire
de cette dernière, a contribué à sa notoriété et à son rayonnement. Il est alors permis de
penser que la relation bénéfique fut réciproque : la Nouvelle Vague a beaucoup reçu de
�45
ces cinéastes atypiques, en retour, elle a facilité leur entreprise filmique, notamment par
le biais du système de production qui fut le sien.
35
La Nouvelle Vague n’offre pas simplement à Jean Rouch l’opportunité de produire ses
films. Elle élargit leur audience, les fait sortir du cercle scientifique auquel ils sont
initialement destinés, ce qui conduit Rouch à rencontrer un public différent, celui des
cinéphiles pour le dire vite. Or, si rien n’indique qu’il a modifié à leur intention sa
manière de faire des films, on peut constater tout de même que son contact avec les
réalisateurs de la Nouvelle Vague, sa fréquentation des hauts lieux de rassemblement de
celle-ci, telle la Cinémathèque française et Les Cahiers du Cinéma, ses discussions avec un
public spécialisé, non pas en science de l’homme, mais en science du cinéma, ont une
influence sur les modes de création de son œuvre, dont son statut d’« auteur » de cinéma.
Or, un des traits qui cimente la Nouvelle Vague en une « école » est, bien sûr, sa
promotion de « la politique des auteurs ». Ainsi, la réussite de la rencontre entre Jean
Rouch et la Nouvelle Vague tient probablement à un facteur qui, échappant à ce que
l’actualité a toujours d’infailliblement moderne, finit par s’inscrire durablement dans la
mémoire collective comme un modèle, autrement dit, comme un trait classique. Ce trait,
c’est l’auteur, son assomption dans et par la justement bien nommée « politique des
auteurs ». Elle est menée par les cinéastes de la Nouvelle Vague bien sûr, en tant que
réalisateur de films, mais en tant que critique et cinéphile par rapport à des cinéastes
dont certains sont très éloignés d’eux, ne fût-ce que parce qu’ils sont américains et
travaillent ainsi dans des conditions spécifiques, bien différentes du Paris des années
cinquante/soixante. En 1984, dans sa préface à La Politique des auteurs, Serge Daney
s’interroge :
Ce petit mot, « auteur ». Comment le définir ? Est-ce, tout simplement celui qui sign
[e] le film ? Ou celui qui, dans des conditions hostiles, [fait] en sorte que son désir –
son « désir de cinéma » – triomphe de tous les autres et se les assujettisse ? Ou celui
qui est devenu tout pour son film, instigateur, promoteur, scénariste, réalisateur,
acteur, attaché de presse ? (…) Ou le pionnier franc-tireur d’un pays sans cinéma –
comme en Afrique – « auteur » par définition d’un film qu’aucune industrie aurait
voulu – ou refusé de – faire à sa place ? Un peu de tout cela, sans doute. Mais un
peu, seulement40.
36
Daney visait les promoteurs de la « ligne hitchcocko-hawk-sienne », notamment Truffaut,
Godard, Rivette et en face d’eux, une poignée de cinéastes prestigieux avec lesquels les
rédacteurs des Cahiers du Cinéma se sont entretenus dans les années cinquante et
soixante : Renoir, Rossellini, Lang, Hawks, Hitchcock, Bunuel, Welles, Dreyer, Bresson,
Antonioni. D’autres cinéastes, souvent présents dans les colonnes de la revue, étaient
susceptibles d’entrer dans la cohorte de ces derniers : Bergman, Fellini, voire Cocteau.
Jean Rouch l’aurait-il pu ? La réponse est négative si l’on s’en tient à la notion historicocritique d’auteur promue par les Cahiers du Cinéma au cours des années cinquante. Mais
au-delà de ce contexte restreint, Cassavetes, Rozier, Pasolini, Malle, Marker, Resnais,
Varda, sont rétrospectivement également des « auteurs » auxquels les différentes
questions de Daney peuvent s’adresser de la même manière qu’aux cinéastes
précédemment cités.
37
Qu’en est-il de Rouch ? D’abord, sa manière de signer ses films n’est pas indifférente
puisqu’elle est voisine de celle d’Orson Welles, ce qui crée un lien supplémentaire de
parenté entre l’œuvre de deux cinéastes pourtant très dissemblables. Rouch, en effet, ne
se contente pas d’inscrire banalement son nom aux génériques, il fait entendre sa voix
dans tous ses films, moins pour les commenter que pour les raconter, pour les envelopper
�46
en tous cas de sa personne comme source réelle des images (Sacha Guitry n’est pas si
loin !). Le fait est d’autant plus notable qu’il concerne pareillement ses films
documentaires et ses films de fiction. Ensuite, s’il n’est pas toujours l’instigateur des
projets, il est présent et impliqué dans tous les stades de leur réalisation. Enfin, il entraîne
ses collaborateurs et les protagonistes des films dans son désir de cinéma. Surtout, il
travaille en dehors des normes de l’industrie du cinéma. Tout cela ne suffirait pourtant
pas à le caractériser comme un auteur si de surcroît, son œuvre ne manifestait pas une
cohérence ou, du moins, une permanence stylistique qui, assurant une adéquation
spécifique entre la pensée et les formes, les intentions et leur actualisation en fait une
sorte d’idiome artistique typique. C’est ainsi que ses films ont beau répondre à des visées
institutionnelles précises, ils sont l’expression d’une conception personnelle de l’art
cinématographique.
38
On peut alors se demander si l’auteur Rouch l’est au même titre que les cinéastes
marquants de la Nouvelle Vague, si pour lui être un auteur fut comme pour certains
d’entre eux un projet explicitement déterminé dans lequel le plan de carrière et le plan
de vie sont entremêlés au point de se confondre. Parmi eux, l’exemple de Jean-Luc Godard
est peut-être plus pertinent que d’autres puisque de tous, c’est lui qui marque le plus
d’intérêt pour le cinéma de Rouch, à un point tel que non seulement il écrit des articles
particulièrement louangeurs sur Moi, un noir mais encore, sur le même mode de citation
qui lui fait convoquer dans Le Mépris une scène d’un film de Minnelli 41, il transpose une
brève séquence de Moi, un noir dans À bout de souffle, consacrant par là même
l’« auteurité » de Rouch, cet état qui le concerne, lui, au plus haut point. Or, Jean-Pierre
Esquénazi, sociologue du cinéma, commente en ces termes l’évolution de Godard à partir
du Mépris :
Godard énonce une nouvelle quête : celle de devenir un artiste au même titre que
Proust et Malraux. (…) L’impératif d’« auteurité », principe conducteur de l’activité
créatrice de la Nouvelle Vague a donc maintenant changé pour Godard. (…) il est
compris comme un principe de différenciation. Dorénavant, le cinéaste voudra faire
voir qui il est personnellement…
39
Esquénazi poursuit son analyse en évoquant la « soudaine prédilection [de Godard] pour
un art filmique élevé, ambitieux, pour tout dire “classique” »42. Cette sorte d’ambition est
aussi à certains égards celle de François Truffaut, moins parce qu’il adapte, très tôt dans
son œuvre, des textes d’écrivains, des « auteurs » autrement dit (Tirez sur le pianiste, Jules
et Jim, Fahrenheit 451) que parce qu’il crée dès Les quatre cents coups, son premier longmétrage, une image probable de son alter ego en la personne d’un acteur fétiche, JeanPierre Léaud, et qu’il en fait l’objet d’un cycle filmique au parfum autobiographique à
peine déguisé.
40
Apparemment, le souci d’auteur de Godard et de Truffaut n’est pas celui de Rouch. Il ne se
pose pas dans les mêmes termes. Rouch n’est pas un cinéaste « tout court », il est un
cinéaste ethnographe. Qu’il réalise des documentaires ou des fictions ne change rien à
l’affaire : son cinéma est en principe dédié à la captation des faits et gestes, des paroles et
des postures des autres, les vrais autres, pas ceux que son imagination est susceptible
d’inventer comme des figures filmiques exclusives. Oui, mais ce n’est qu’un principe,
justement, bien vite dépassé puisque dès 1954, il tourne avec les méthodes du cinéma
direct une première fiction, Jaguar, un « grand film » sans « commune mesure avec les
petits reportages purement ethnologiques »43. Or, on le verra plus loin, Jaguar est un
dispositif complexe qui, entre autres processus, détourne les fins du cinéma d’observation
en en bouleversant de fond en comble les modalités référentielles et en remettant en
�47
cause la place de chacun dans la configuration traditionnelle de l’observateur et de
l’observé, typique du cinéma documentaire. C’est ainsi que dans Jaguar il y a un
protagoniste qui n’est pas très éloigné ni d’Antoine Doinel le personnage des films de
Truffaut, ni de Jean-Pierre Léaud, l’interprète de ce personnage : il s’appelle Damouré
Zika. À la différence de Léaud, il garde son nom propre mais, comme Léaud, il apparaît en
adolescent dans Bataille sur le grand fleuve en 1951, puis en jeune homme dans Jaguar et
enfin en homme mûr dans Petit à Petit en 1970. Or, dans ces deux derniers films, son
évolution personnelle semble s’infléchir de plus en plus nettement en une projection
identitaire entre lui et Jean Rouch44, et ce processus n’est pas sans rappeler celui mis en
œuvre par Truffaut dans le cycle d’Antoine Doinel.
41
Mais c’est Moi, un noir, tourné en 1957, qui révèle le premier que Rouch est un auteur au
sens de la Nouvelle Vague. Coïncidence sans surprise : c’est à Godard que revient
l’identification du phénomène impliqué. « En appelant son film Moi, un noir, Jean Rouch
qui est un Blanc tout comme Rimbaud, déclare lui aussi que Je est un autre » 45. Ce « je » qui
avance plus ou moins masqué dans la forêt de ses films, de tous ses films, est au lieu même
de l’auteur, l’αυτ des Grecs, l’ego des latins, celui par lequel Rouch est un confrère de
Godard, de Truffaut, de Rivette également. Il l’est aussi de Jean-Daniel Pollet par exemple,
auteur avec lui de Paris vu par… Comme eux tous, il fait entrer dans son projet
cinématographique la relation intime, nécessaire avec un lieu géographique. Et, comme
dans les films de ces derniers, le lieu d’attache, un village africain ou un quartier parisien,
a une qualité nouvelle, irrémédiablement moderne en fait : il est prosaïque et actuel,
documentaire si l’on veut ; il est poétique et mental, fantasmatique si l’on veut,
contradiction féconde que Gare du Nord laisse admirablement transparaître. Paris vu par…
décline six occurrences de cette cartographie ambivalente que chacun des réalisateurs
traite selon une singularité telle que l’on y reconnaît, éminemment contractées dans
l’espace du court-métrage, toutes les caractéristiques de leurs longs-métrages respectifs.
C’est à ce titre, notamment que Paris vu par… est « le deuxième manifeste de la Nouvelle
Vague ». Or, au-delà de quelques détails évidents, un seul des six films de Paris vu par… ne
paraît pas ressembler aux autres films de son auteur : c’est Gare du Nord. Il ne faut pas s’en
étonner. Rouch, comme on l’a dit plus haut, n’est décidément pas un cinéaste de la
Nouvelle Vague et quand il fait un film de la Nouvelle Vague il montre tout simplement
que sa science du cinéma, droit venue d’un ailleurs éloigné des boulevards parisiens de
cette dernière, sait de toutes façons élaborer une fiction parisienne en prise sur la
modernité la plus aiguë qui soit, à ce moment précis du cinéma, en 1964.
42
Convient-il de circonscrire l’investigation des principaux fondements de l’œuvre
cinématographique de Rouch à la seule coïncidence temporelle entre le cinéma direct et
la Nouvelle Vague, due à un processus à la fois culturel et sociologique dont Rouch
apparaît comme un agent essentiel ? Non, sans doute, et pour trois raisons au moins.
D’abord, du côté du cinéma direct Jean Rouch est l’arbre qui cache la forêt. Parmi ses
contemporains de la Nouvelle Vague, il y a par exemple François Reichenbach qui filme
New York et l’Amérique profonde selon certaines méthodes du cinéma direct. Citons aussi
Chris Marker dont le cinéma documentaire est si distinct du cinéma direct qu’il peut
justement lui servir admirablement d’envers critique, en faire mieux ressortir du coup la
spécificité. Par ailleurs, de même que le direct est essentiellement une internationale du
cinéma dans laquelle les cinéastes, les techniques de travail, les matériels circulent d’un
pays à l’autre malgré des spécificités nationales, de même la Nouvelle Vague dépasse
largement la sphère française du cinéma : John Cassavetes, Glauber Rocha, Milos Forman,
�48
Vera Chytilova parmi quelques cinéastes importants, sont là pour nous le rappeler. Et
enfin, un dernier élément permet de faire le départ entre le cinéma direct et la Nouvelle
Vague : leur délimitation dans le temps. La Nouvelle Vague se développe entre 1956 et
1963, selon l’option maximale de Michel Marie. Les films réalisés après cette période par
certains cinéastes de la Nouvelle Vague (François Truffaut et Claude Chabrol notamment)
ou par des épigones tels que Barbet Schrœder peuvent être appréhendés en fonction de
l’influence de la Nouvelle Vague. Quant au cinéma direct, on aura beaucoup plus de mal à
en décréter des limites temporelles tant il est à l’origine d’une multiplicité de productions
filmiques différenciées si bien qu’il est difficile de tracer une ligne de partage entre le
direct stricto sensu et sa survivance ou sa métamorphose dans des productions ultérieures.
Le cinéma militant des années soixante-dix est-il encore du cinéma direct ? La somme de
William Klein sur Mai 68 à Paris, Grands soirs, petits matins (1978) s’apparente-t-elle à un
film direct ? Les productions télévisuelles telles que les talk-shows ou les micro-trottoirs
ont-elles quelque chose à voir avec le cinéma direct dont elles paraissent terriblement
éloignées alors même qu’il les a fait naître, qu’il les a rendues possibles et que les images
et les sons sont bel et bien enregistrés en direct ? Qu’en est-il par ailleurs du cinéma
ethnographique aujourd’hui qui se prend à respirer un air différent de celui de ses aînés,
dans quelle mesure est-il concerné par l’héritage conjoint du cinéma direct et de la
Nouvelle Vague ? Dans son Essai sur le jeune cinéma français, André Labarthe disait de la
rencontre du documentaire et de la fiction – et il pensait alors à Moi, un Noir – que « l’un
[était] multiplié par l’autre ». Question : faut-il réécrire cette formule de la dissolution des
genres maintenant que la Nouvelle Vague est passée et que le cinéma direct est devenu de
plus en plus introuvable, indéfini ?
43
Autre question : de la constellation féconde qui a vu naître son cinéma, qu’ont retenu les
films postérieurs de Rouch ? Deux fictions, seulement deux ( !), sont notoires : Petit à petit
(1970) qui est une reprise allègre de l’ethno-fiction selon Jaguar et Cocorico ! Monsieur Poulet
(1974), un road-movie africain qui s’inscrit, là encore, dans le lignage de Jaguar. Une
troisième fiction, Dionysos (1984) est un échec. On a beau y retrouver la 2 CV de Cocorico !
Monsieur Poulet le moteur narratif fonctionne selon un régime qui s’est à la fois complique
et essoufflé46. Les autres films, qui présentent une variété presque extravagante de
formats, de durées, de modes de production, de lieux de tournage, de sujets bien sûr, sont
majoritairement des documentaires que le grand public aura peu eu l’occasion de voir.
Rouch est en somme rentré dans le rang d’où il était sorti pour faire autre chose,
autrement, au bon moment, semble-t-il, quand une force nouvellement apparue de son
côté (le cinéma direct d’un ethnographe libertaire) et du côté de jeunes critiques
ambitieux (les affirmations radicales de la Nouvelle Vague), a bousculé en son entier
l’institution du cinéma français. Cette convergence spécifique de deux courants est
limitée dans le temps. Les courants se sont séparés : la Nouvelle Vague n’est pas
retombée, elle s’est éloignée de son rivage parisien, elle a continué à alimenter à des
degrés divers l’œuvre de cinéastes qui tous se sont affirmés, ou confirmés du côté de la
fiction en radicalisant, en dépassant, en transformant, ou bien en oubliant les préceptes
« nouvelle vague » du cinéma. Chabrol, Godard, Rivette, Rohmer, Rozier, Truffaut, etc.,
pas un n’échappe à l’emprise du cinéma de fiction qui occupe une place éminente,
centrale dans l’institution et qui attire vers lui la majorité des spectateurs. Or, deux
cinéastes se distinguent à cet égard : Godard et Rozier, l’un parce qu’il se tourne vers la
vidéo dans les années soixante-dix, l’autre parce qu’il travaille surtout pour la télévision
dès 1964. Ces deux-là sont décidément différents, ce qui explique sans doute leur plus
grande proximité avec Jean Rouch dont le cinéma porte en lui si admirablement
�49
l’ambivalence de la fiction comme horizon et du documentaire comme méthode. Ainsi, s’il
faut prendre la mesure critique de l’œuvre de Jean Rouch postérieure aux années
Nouvelle Vague, celles d’une rencontre qu’avaient éclairée les aspirations du néoréalisme et servie les techniques du cinéma direct, il ne faut plus regarder le cinéma en
son centre mais plutôt dans ses marges.
NOTES
1. André Leroi-Gourhan, « Le film ethnographique existe-t-il ? », Revue de Géographie humaine, 3,
1948.
2. Cl. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, P.U.F. 1960.
3. Voir infra, chap. V, « L’utopie identitaire », pp. 129-133.
4. Claudine de France, Pour une anthropologie visuelle, recueil d’articles publiés sous sa direction,
Cahiers de l’Homme-Mouton éd. 1973 et 1979, réed.
5. Claudine de France, Cinéma et anthropologie, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1982 et
1989 (réed.).
6. Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma – Les films, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1992 pp.
1095-1096. L’auteur souligne.
7. Cité par Barthélémy Amengual in « D’une résistance l’autre. Notes sur la genèse du style néoréaliste italien », Études cinématographiques, n° 82-83, 1970.
8. À propos de Rossellini et de la perception qu’a Rouch de ses films, M-H Piault écrit : « Jean
Rouch ne s’y trompera pas, la réalité se perçoit, se ressent et se comprend à travers les personnes
qui la vivent et qui l’inventent », Anthropologie et cinéma, op. cit., p. 136.
9. Cf. G. Gauthier, op. cit., pp. 59-62.
10. Résurgence en peinture de l’expressionnisme figuratif des gestes et des corps (Giacometti,
Bacon, etc.), apparition de la musique électro-acoustique (Berio, etc.), naissance du « nouveau
roman » (Sarraute, Butor, etc.).
11. André Bazin, Le Cinéma français de la libération à la Nouvelle Vague (1945-1958), textes réunis et
préfacés par Jean Narboni, Édition de L’Étoile-Cahiers du Cinéma, p. 179.
12. André Labarthe, Essai sur le jeune cinéma français, Paris, Le Terrain Vague (Eric Losfeld), 1960.
Ce bref et percutant essai de 44 pages n’a jamais été republié.
13. Gilles Deleuze, Cinéma 2 – L’image-temps, Paris, Minuit, 1985, chap. VI, « Les puissances du
faux ».
14. Id., Logique du sens. Minuit, 1969.
15. A. Labarthe, Essai sur le jeune cinéma français, op. cit., respectivement p. 27 et 39-40.
16. G. Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, op. cit., pp. 179-197.
17. Quelques grandes fictions rouchiennes se déploient dans le cadre d’un voyage : Jaguar, Petit à
petit, Cocorico ! Monsieur Poulet. Les documentaires que Welles a tournés en Europe, L’Affaire
Dominici, Corrida à Madrid, Saint-Germain-des-Près, Le Pays basque sont, selon Welles lui-même,
autant « d’essais en cinéma sur le voyage ». Cf DVDY FILMS, coffret Orson Welles, Malpertuis, Le
Criminel, Dossier Secret, Around The World With Orson Welles.
18. Enrico Fulchignoni, préface à L’Aventure du cinéma direct, op. cit., p. 9.
19. G. Marsolais, op. cit., pp. 423-456.
�50
20. Jacques Rozier évoque ainsi le tournage de Blue Jeans : « J’avais placé la réalisation sous le
signe du néo-réalisme italien », puis celle d’Adieu Philippine : « J’avais alors un projet : appliquer la
méthode des moyens ultralégers à un long-métrage. (…). Toujours obsédé par le néo-réalisme, je
voulais le plus d’italianismes et d’italiens dans le film. » Jacques Rozier, le funambule, Cahiers du
Cinéma, coll. « Auteurs », 2001, pp. 28-32.
21. G. Marsolais, op. cit., p. 181.
22. Edgar Morin,
Le Cinéma ou l’homme imaginaire-Essai d’anthropologie, Gonthier, coll.
« Médiations », 1958.
23. Dans Chronique d’un été, une réflexion écrite qu’il a consacrée au film (avec Rouch), Edgar
Morin publie des « points de vue critiques » de, entre autres, Jean de Baroncelli, Henry Chapier,
Georges Charensol, Jean Dutourd, Fereydoun Hoveyda, André Labarthe, Samuel Lachize, Morvan
Lebesque, Pierre Marcabru, Claude Mauriac, Jean-François Revel, David Rousset, Georges Sadoul,
qui tous, élogieux ou non, discutent précisément la question du « cinéma-vérité ». Domaine
Cinéma 1, Inter Spectacles, 1962, pp. 167-183.
24. Ibidem, pp. 107-108.
25. Vincent Bouchard, « Jean Rouch et l’Office national du film », Revue Hors-Champs, 9,
novembre 2004.
26. Voir infra, chap. 7, pp. 145-168.
27. Voir infra, chap. 5, pp. 129-134.
28. V. Bouchard, op. cit., p. 6. L’auteur souligne.
29. Ibid., p. 6. L’auteur souligne.
30. Jean-Pierre Lefebvre et Jean-Claude Pilon, « L’équipe française souffre-t-elle de la
Roucheole ? », Objectif, n° 18, 1964, p. 53, cité par Vincent Bouchard, op. cit., p. 7.
31. Cinéma du réel, [entretien avec] Claire Devarrieux, Marie-Christine de Navacelle, éditions
Autrement, 1988, p. 18.
32. Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, « Dictionnaire des cinéastes français » de 1957, opus cité,
p. 100.
33. Voir Geneviève Sellier, La Nouvelle Vague-Un cinéma au masculin singulier, CNRS éditions, coll
« Cinéma & Audiovisuel », 2005, pp. 162-163.
34. Telle cette scène, relevée parmi tant d’autres du même type dans Adieu Philippine, filmée à une
terrasse de café. Le personnage principal discute avec des amis mais la caméra s’attarde
longuement sur une tablée de consommateurs inconnus, anonymes. Sont-ils des figurants ou des
passants que le film aurait rencontrés là par hasard ? Quoi qu’il en soit, la pellicule se constitue
en l’occurrence comme une archive documentaire. Voir M. Scheinfeigel, op. cit., « Les corps en
trop », p. 87.
35. On reviendra sur Gare du Nord, chap. 8, p. 170-179.
36. Michel Marie, op. cit., ainsi que les citations précédentes, pp. 83-84.
37. Ibid., pp. 50-51.
38. André Labarthe, Essai sur le jeune cinéma français, op. cit., p. 40.
39. M. Marie, ibid., p. 59.
40. Serge Daney, préface à La Politique des auteurs. Entretien avec dix cinéastes. Cahiers du CinémaÉditions de l’Étoile, 1984, pp. 8-9. Première édition : 1972.
41. Scène où Paul Javal/Michel Piccoli prend son bain avec un chapeau sur la tête, à l’instar – ditil à Camille – de « Dean Martin dans Some Came Running ».
42. Jean-Pierre Esquénazi, Godard et la société française des années 1960, Armand Colin, 2004, pp.
127-129. L’auteur souligne.
43. Jean-Luc Godard, « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens », Jean-Luc Godard par Jean-Luc
Godard, op. cit., p. 182.
44. Voir le chapitre VI, « L’utopie identitaire ».
�51
45. J.-L. Godard, « Etonnant-Jean Rouch-Moi, un noir », Arts, n°713, mars 1959, repris dans Jean-Luc
Godard par Jean-Luc op. cit., p.178.
46. Voir infra, chapitre X, « La 2 CV de Dionysos ».
�52
Chapitre 3. Des itinéraires
LES « COPAINS »
1
Les connaisseurs de l’œuvre filmée de Rouch peuvent faire un constat facile : d’un film à
l’autre, des noms, des visages, des voix sont les mêmes. Sans parler des lieux, villages,
villes, fleuves, brousses et déserts déployés sur un vaste territoire, principalement celui
que traverse le fleuve Niger, on assiste à la constitution par Rouch d’une tribu de cinéma :
la sienne certes, mais telle qu’elle s’est présentée à lui dans son essence irréductiblement
africaine, nigérienne et malienne surtout. Damouré Zika, Illo Gaoudel, Lam Ibrahima Dia,
Tallou Mouzourane, Idrissa Maiga, Moussa Hamidou, sont – selon un mot très fréquent
dans le vocabulaire de Rouch – les « copains » qui ont collaboré à ses films pendant
plusieurs décennies. Détail notable : certains d’entre eux ont eu plusieurs fonctions,
puisqu’on les trouve à la fois devant et derrière la caméra, par exemple comme preneur
de sons ou opérateur de prises de vue. Ces « copains »-là, tôt rencontrés par Rouch,
l’accompagneront pendant de nombreuses années. D’autres, plus circonscrits à l’intérieur
de telle ou telle période rouchienne, ont simplement figuré comme personnages dans
plusieurs films, tenant à peu près le même rôle, comme dans un feuilleton. Suivons
Nathalie, personnage secondaire de Moi, un Noir où elle incarne la jeune femme qui
remporte un concours de danse lors de la Goumbé, la fête de quartier du samedi soir à
Treichville. On la revoit dans le film suivant, La Pyramide Humaine où elle est toujours un
personnage secondaire, mais les traits de sa personnalité sont cette fois un peu plus
précis et son rôle plus étoffé au regard de l’histoire racontée : elle continue à participer
au concours de danse de la Goumbé, on apprend de surcroît qu’elle est coiffeuse et un des
jeunes lycéens blancs du film est amoureux d’elle. Même chose d’un des autres
protagonistes de La Pyramide humaine, Modeste Landry, que l’on retrouve en France dans
Chronique d’un été, La Punition, Rose et Landry. Nadine Ballot, une jeune Française,
rencontrée par Rouch à Abidjan, est actrice dans plusieurs films tournés en France et en
Afrique : La Pyramide humaine, Chronique d’un été, La Punition, Gare du Nord.
2
Est-ce du caractère nettement amical de sa fabrication que le cinéma de Jean Rouch tire
sa spécificité ? Et si oui, celle-ci est-elle rouchienne ? africaine ? L’un ne va pas sans
l’autre, en fait. L’environnement africain a déterminé le cinéma de Rouch et lui a donné
son identité, qu’il a importée dans ses films tournés en France. En retour, Rouch a façonné
�53
son entourage africain en produisant sur lui des effets parfois discrets, parfois plus
visibles et plus spectaculaires, tel celui qui va transformer Oumarou Ganda, acteur
principal de Moi, un Noir, en cinéaste 1. Lui-même parle de cette interrelation à propos de
plusieurs films, de La Pyramide humaine en particulier, dont il évoque le tournage en ces
termes révélateurs :
[C’est] un film dans lequel on [a traité] du problème des relations entre blancs et
noirs dans une classe de première (...). Nous jouions vraiment avec le feu parce que
nous sommes tombés très rapidement sur le fait que l’on ouvrait une brèche
indispensable car ces gens vivaient chez eux, sans jamais se voir. (...). On a brouillé
toutes ces cartes. J’ai demandé aux uns de jouer le rôle des racistes et aux autres le
rôle des non racistes. (...) Ce qui est extraordinaire, c’est qu’ils sont effectivement
devenus un groupe d’amis. (...) Le film joue un peu (...) comme le précédent [Moi, un
Noir] dans lequel on essayait de mettre en scène les positions rêvées des uns et des
autres. [Les acteurs] se sont révélés très curieusement dans ce film. Et pour moi cela
a été un élément très surprenant, où la fiction devenait réalité 2...
3
Coïncidence historique à relever : en 1960, les colonies africaines deviennent
indépendantes et c’est à cette date que naissent dans certains des pays nouvellement
constitués, un cinéma national3. L’équipe agrégée autour de Jean Rouch se situe alors dans
un entre-deux. Ni française, ni africaine, les deux à la fois cependant, elle participe
fondamentalement d’une identité hybride qui la caractérise. Cela ne va pas sans
problème, mais c’est par là qu’ensemble Rouch et ses « copains » africains produisent un
cinéma justement capable de problématiser la question de l’altérité traversant tout le
cinéma ethnographique moderne, et qui le déborde en se trouvant parfois posée et
explorée par le cinéma de fiction des années 1950-1970. À cet égard, il n’y a sans doute pas
de hasard si le cinéma de Rouch trouve un écho direct dans celui de John Cassavetes ou de
Pier Paolo Pasolini, voire même dans celui de Rainer Werner Fassbinder et d’Ingmar
Bergman. Comme Rouch, ces cinéastes ont formé autour d’eux une équipe de caractère
familial ou amical, voire amoureux, plutôt que professionnel. Et c’est de la permanence
des relations affectives établies au sein de l’équipe que découle en partie la permanence
de leurs choix filmiques. Au fil de leur sortie sur les écrans, leurs films se reconnaissent à
des situations similaires, font entendre les mêmes sons, les mêmes voix, les mêmes
musiques, montrent les mêmes visages et les mêmes corps, laissent advenir ou éclater les
mêmes affects et de ce fait, renvoient de la même manière à la présence du hors-cadre, le
monde réel dans lequel acteurs et techniciens font partie d’une bande dont le cinéaste est
le chef. Or, le caractère singulier de ces œuvres est marqué par un paradoxe initial : la
familiarité de certains éléments, si repérables à leur ressemblance film après film, et qui
confèrent une esthétique particulière à l’ensemble des films, est fondée sur de l’inconnu,
sur du nouveau plutôt. Par exemple, qui, avant Cassavetes, a montré dans le cinéma
américain des noirs à l’apparence de blancs (Shadows) ! Qui, avant Pasolini, a sanctifié le
visage et la pose d’un voyou de banlieue (Accatone) ? Qui, avant Rouch, a fait entendre la
voix intérieure d’un africain (Moi, un noir) ? En fait, le cinéma de Cassavetes, de Pasolini,
de Rouch, un peu plus tard, celui de Fassbinder aussi bien, distille pareillement des signes
quelque peu étrangers à la vocation – du cinéma occidental dominant. L’étrangeté vient
en partie des protagonistes, eux-mêmes en situation de rupture par rapport à leur
environnement ordinaire et tous concernés par une même tension qui les fait s’avancer
vers un miroir susceptible de mettre en cause leur ressemblance à eux-mêmes. Si on les
réduit à leur plus simple expression, telles sont en effet les structures signifiantes de
Shadows et à ? Accatone, mais aussi bien de quelques-uns des films suivants dans l’œuvre de
Cassavetes et celle de Pasolini. Par exemple, Too late Blues (1962), Faces (1968) et Husbands
�54
(1970) d’une part, Mamma Roma (1962), La Ricotta (1963), Comizi d’Amore (1963), Uccellacci et
Uccellini (1965) d’autre part, semblent pareillement issus d’une création collective, ou du
moins, rassemblée autour d’un centre à la fois univoque (le dispositif d’enregistrement
visuel et sonore des images qui laisse une part appréciable d’autonomie aux acteurs) et
équivoque (le cinéaste chef de bande à la fois au-dedans et en-dehors de ce dispositif). Il
s’agit là d’un « agencement collectif d’énonciation »4 qui ne se rencontre pas ou peu dans
les pratiques courantes de réalisation des films de fiction.
4
Ce processus anime le cinéma de Jean Rouch, avec deux particularités encore plus
marquées. Premièrement : les personnages de ses films sont parfois réellement invités à
traverser le miroir que le cinéma leur tend. On y reviendra. Deuxièmement : comme c’est
parfois le cas dans certains des Appunti de Pasolini, on entend, reprise ou non en voix off
par Rouch qui la traduit en français, la langue vernaculaire des protagonistes (bambara,
haoussa, dioula, poular, tamachek, etc.), mêlée au français ou à l’anglais créoles, les
langues véhiculaires des principaux pays où le cinéaste a tourné des films : Niger, Mali,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin. Tout ce parler, bruissant de mots le plus souvent
incompréhensibles, est comme l’incarnation sonore, vocale, d’un personnage collectif –
tel lieu de tel pays de l’Afrique de l’Ouest, tels habitants de ce lieu – qui impose sa
présence en débordant la sphère strictement profilmique, quel qu’ait été son mode de
détermination par le cinéaste et ses collaborateurs. On le verra plus loin, la plupart des
films africains de Rouch, fictionnels ou documentaires, sont conçus de telle manière que
chaque espace rendu visible est l’objet d’une superposition d’un autre lieu, configuré
comme une sphère sonore, en coïncidence plus ou moins parfaite avec l’espace visible.
Dans l’écart entre les deux lieux, c’est « renonciation collective » qui fait son œuvre, à
savoir la source africaine qui se déverse, incontrôlée, à l’intérieur de chaque film et dont
le cours incessant finit lui-même par former un fleuve comme le Niger ou le Sénégal. Des
mots et des voix, des bruits d’objets familiers, des sons d’instruments de musique variés,
des cris d’animaux domestiques et sauvages, le crépitement de la pluie, le grondement du
tonnerre, etc., en sont les principaux éléments qui composent ce fleuve, emportant avec
lui le pouvoir tout spécial de faire se lever dans l’imaginaire du spectateur une
cartographie sonore de l’Afrique. On peut supposer que Jean Rouch était particulièrement
disponible à la perception sonore de l’environnement en dépit de ce qu’il souhaitait que
l’image fût. Plusieurs de ses films témoignent, en effet, que son cinéma africain s’est
souvent fait « à l’oreille », mais l’oreille en question n’est pas celle d’un musicien ou d’un
spécialiste du son qui expérimenterait le montage des deux matières filmiques, la visuelle
et la sonore ou qui, même, ferait un reportage sonore sur l’Afrique. Rouch écoute et capte
une expression sonore qu’il transmet plus ou moins fidèlement comme une part de
spécificité inaliénable sur laquelle il n’a d’autre prise que d’être un récepteur passif. Car
ce langage collectif, rarement enregistré en son synchrone, mais toujours capté à sa
source réelle, est peut-être le meilleur véhicule d’une représentation de l’Afrique de
l’Ouest par elle-même.
5
Qu’est-ce à dire ? La tradition orale a régulé la mémoire des habitants de l’Afrique de
l’Ouest. La transmission écrite des savoirs a été amenée par les colonisateurs, les Arabes
d’abord puis les Européens et dans les deux cas, elle est longtemps restée le fait d’une
minorité d’« indigènes », quand ils étaient d’origine sociale élevée et donc amenés à être
partie prenante des pouvoirs en place. La plupart des gens, villageois ou citadins,
analphabètes, ont un rapport uniquement oral à toutes les formes de l’expression,
qu’elles soient familières ou savantes, accessibles à tous ou spécialisées, voire ésotériques.
�55
C’est là une composante intrinsèque d’un monde dont la réalité et l’imagination sont
tissés par une parole incessante. Marcel Griaule avait rendu perceptible cette texture
orale en faisant comprendre aux lecteurs de Dieu d’eau qu’Ogotemmêli créait le monde au
fur et à mesure qu’il le racontait. Mais aux oreilles occidentales du colonisateur, la parole
de ce monde (n’) était (que) du bruit mêlé aux autres bruits. Jean Rouch est le premier
cinéaste à écouter et à essayer de restituer ce monde sonore en version originale.
6
Question : avant Rouch, qu’en était-il de la représentation des Africains dans le cinéma
français ? Il y a beaucoup d’images, beaucoup de films. On les doit principalement soit à
des voyageurs scientifiques, ethnologues, géographes ou zoologues, soit à des aventuriers
qui « traversaient l’Afrique jusqu’en 1940, pour l’exploit, pour la chasse ou pour la
découverte »5. La suite de l’histoire est connue : quelques rares films secouent la
conscience coloniale encore vivace des années cinquante, c’est notamment Afrique 50
(René Vautier), Les Statues meurent aussi (Resnais et Marker) et Les Maîtres fous. Ces films
brisent chacun à leur manière le mur du silence qui entoure la relation du colonisateur au
colonisé. Or, les deux premiers ont été censurés et le troisième a fait l’objet d’une violente
polémique. La réaction produite par les trois a une même cause, essentielle : celui ou celle
dont on parlait jusque-là dans les films coloniaux ou exotiques est ici devenu quelqu’un
d’autre, l’image qu’il présente est ainsi étonnante, dérangeante, voire inacceptable. Dans
le film de Resnais et Marker par exemple, il est le descendant de civilisations qui ont
produit des œuvres d’art impérissables en façonnant des représentations liées à des
croyances et à des pratiques religieuses, exactement comme ce fut le cas dans les
civilisations réputées de la Méditerranée ou de l’Orient. Dans Les Maîtres fous, le colonisé
s’empare de la pensée, du comportement et des représentations du colonisateur, qu’à son
tour il plie à ses propres lois et fait servir à ses propres nécessités. Rouch creuse l’idée
dans ses films suivants, qui pourtant apparaissent presque tous comme singulièrement
dépolitisés.
7
En fait, la nouveauté apportée par Rouch est mesurable à l’aune de films qui sont proches
des siens. Tel est le cas notamment des documentaires réalisés par Jacques Dupont qui
s’est beaucoup intéressé, lui aussi, à l’Afrique noire. Son deuxième film, Pirogues sur
l’Ogoué, un court-métrage de 1947, présente de grandes similitudes avec le cinéma que
Rouch commence à faire. L’époque, le lieu, le sujet même du film, mais plus encore, la
méthode de réalisation autorisent la comparaison. Dupont, secondé par un opérateur
réputé, Edmond Séchan, introduit en effet quelques nouveautés remarquables en matière
de film de voyage. Certains passages clés sont tournés en caméra portée, l’action filmée,
un transport de marchandise avec des péripéties fluviales parfois difficiles, est regardée
au plus près de la réalité et n’est en rien magnifiée ou poétisée par le cinéma, et surtout,
une prise de son directe fait entendre, peut-être pour la première fois dans ce genre de
films, le son même de la voix des protagonistes du voyage. A ce titre, Pirogues sur l’Ogoué
est un film du cinéma documentaire direct, exactement comme le sont ceux de Rouch.
Mais le cinéaste Dupont n’est pas Rouch, du moins ne s’intéresse-t-il pas de la même
façon à la réalité qui s’offre à sa caméra. Toutes les images de son film obéissent à un
paramètre documentaire qui concerne la majorité des films de voyage : la distance.
Autrement dit, Dupont filme des ensembles. Paysages, fleuve, pirogues sont vus dans des
plans larges. Les piroguiers ont beau parler, crier, rire, chanter, ils restent anonymes,
lointains. Silhouettes s’agitant dans une altérité insaisissable, aucun d’eux n’est
susceptible de s’offrir à l’imaginaire du spectateur comme un personnage. C’est que, si
Dupont documente une Afrique authentique, contrairement à Rouch il ne s’implique pas
�56
dans le milieu observé, il ne s’engage pas sous l’angle d’une vision subjective. On peut dire
de son film qu’il est « politiquement correct » en ce sens qu’il paraît désinvesti des affects
coloniaux d’avant-guerre, on peut aussi le recevoir comme une carte postale comme il y
en a eu avant lui, comme il y en aura d’autres après lui. Son audace formelle est
intéressante, ne fût-ce que parce qu’elle permet de voir en quoi le travail de Rouch est
conforme à son époque, elle devient insignifiante dès lors que le film campe sur des
positions documentaires acquises depuis longtemps et qu’il ne remet pas en question. À
l’inverse, Rouch bouleverse les données de la situation que croise son cinéma parce qu’il
invente d’autres chemins pour aller ailleurs, pour y séjourner et pour en revenir.
DU DOCUMENTAIRE À LA FICTION
8
La première ligne à suivre pour entrer spécifiquement dans l’univers cinématographique
de Rouch est celle qui oppose en les reliant ses documentaires et ses fictions. Le débat
paraît bien vieux aujourd’hui. Il ne l’est pas quand Rouch commence sa carrière de
cinéaste et c’est même un trait d’époque, pour quelques cinéastes particulièrement
prospectifs, que d’inventer des formes neuves en les interrogeant l’une par l’autre, en
pensant différemment leur nature respective. Quant à Rouch, il est intéressant de voir
rétrospectivement par quel processus un réalisateur de films ethnographiques en arrive à
faire des films de fiction, là même, et avec ceux-là mêmes qui sont les témoins et les
protagonistes de son cinéma documentaire. Il y a glissement, « dérive » d’une forme vers
une autre comme l’écrit si justement Jean-André Fieschi6. De 1946 (Au Pays des mages noirs)
jusqu’à 1952 (Les Fils de l’eau), Rouch fait des courts et des moyens métrages
ethnographiques. Les Maîtres fous, tourné en 1954 au Ghana, alors appelé Gold Coast, est
encore un documentaire à strictement parler, mais ce film marque un tournant pour deux
raisons au moins. D’abord, Rouch introduit dans le montage final des images qui ne sont
pas strictement en rapport avec celles du rituel qu’il a enregistrées en direct. Ensuite,
l’horizon ethnographique est ici élargi à un questionnement sociologique : le rituel de
possession filmé est moins visé comme le fait d’une transe religieuse d’origine archaïque,
qu’il n’est relié à la situation actuelle d’un groupe d’émigrants nigériens, réunis en une
secte, les « haoukas », dans un pays qui est encore une colonie anglaise. L’ethnographie
bascule alors dans l’observation de la contemporanéité des pensées et des conduites
sociales que détermine un contexte précis. La même année, Rouch tourne les images de
Jaguar dont le montage sera seulement achevé en 1967. Ce film marque une rupture
importante avec les précédents puiqu’il s’agit cette fois d’une vraie fiction, quand bien
même les méthodes de tournage sont-elles celles du cinéma direct. Constat d’un détail
factuel significatif : Damouré Zika, vu une première fois dans Bataille sur le grand fleuve, est
le preneur de son des Maîtres fous, il est crédité des « commentaires et dialogues » et du
son de Jaguar dont il est, par ailleurs, un des personnages principaux. Le jeune homme de
1951, à qui ses aînés pêcheurs avaient confié la garde d’un bébé hippopotame alors
qu’eux-mêmes repartaient pour une pêche tourmentée, est ainsi transformé à peine trois
années plus tard en technicien et en acteur de cinéma, double fonction qu’il assumera
jusqu’au tournage de Cocorico ! Monsieur Poulet.
9
Voilà le glissement, la « dérive » qui advient entre une forme de cinéma et une autre, au
gré de circonstances favorables. Un jeune garçon nigérien, banal protagoniste d’un film
documentaire, entre dans la fiction du cinéma parce que le réalisateur est lui-même dans
l’attente de cette transformation que rendent possible plusieurs facteurs, caractéristiques
�57
de l’entreprise rouchienne. L’un de ces facteurs est sans doute plus déterminant que tous
les autres : c’est la correspondance s’instaurant entre les êtres filmés et le cinéma qui les
regarde, plus précisément, entre les gens dont Rouch est venu filmer les faits et gestes
ordinaires et le cinéaste en personne. Les uns et les autres partagent en effet une même
envie : que des histoires se racontent, que des récits s’inventent avec la matière première
constituée par la vie de ceux qui participent au tournage des films. Cette tension
inlassable vers la fiction de soi, dont Moi, un Noir reste à ce jour le manifeste le plus
bouleversant, fait s’ouvrir le cinéma documentaire de Rouch à un dehors, à un lieu
imaginaire où tout devient possible, notamment l’avènement d’une poésie filmique
intempestive dont on pourrait résumer l’essence sui generis à la formule du « mentirvrai ». Selon cette formule, Damouré Zika, l’apprenti de Bataille sur le grand fleuve, y est
peut-être, en son for intérieur, non pas l’acteur de son rôle propre mais l’incarnation,
déjà, d’un personnage de cinéma. Avec le tournage de Jaguar, la sensation s’accuse : Zika
est prié par Rouch, comme tous les autres protagonistes du film, d’inventer au fil des
jours la fiction d’un vrai/faux récit de voyage. En cette circonstance, Rouch trouve entre
les puissances du faux (Zika en scénariste d’événements fictifs) et les méthodes
d’observation documentaire (reportage sur Zika voyageant pour de vrai), l’identité de
tout son cinéma à venir. Les films documentaires y seront les récits inlassables d’une
réalité quasi fabuleuse, qui paraît même imaginaire, comme, exemplairement, dans La
Chasse au lion à l’arc (1965) ; les fictions, telles La Pyramide humaine, La Punition, Gare du
Nord, Petit à Petit, Cocorico, Monsieur Poulet ! Dionysos seront étroitement et profondément
documentaires.
10
Du fait de son montage différé et de sa sortie tardive en salle, Jaguar est répertorié dans la
filmographie officielle de Rouch, bien après Moi, un Noir. Or, ce film n’existe pas sans le
premier, plutôt, Jaguar est le prototype de Moi, un Noir. Si l’on ajoute que les deux films
sont eux-mêmes corrélés à certains des documents ethnographiques qui les précèdent,
notamment Bataille sur le grand fleuve et Les Maîtres fous, et qu’ils annoncent parmi les films
suivants, aussi bien Petit à petit et Cocorico ! Monsieur Poulet, que Chronique d’un été et
Dionysos, le rapport fiction-documentaire et le travail de l’un par l’autre dans l’œuvre de
Rouch apparaissent clairement. Le cinéaste fait « sauter (...) tout le jeu des oppositions
réglées, confortables, fausses, par lequel, depuis l’axe inaugural Lumière-Méliès, on
pensait les catégories du documentaire, de la fiction, de l’écriture, de l’improvisation, du
naturel, de l’artifice (...). À cheval entre les techniques, entre les cultures, Rouch va jouer
de plus en plus systématiquement cet entre-deux, dont il va faire le moteur d’une longue
geste fictionnelle »7. C’est pourquoi Rouch est un passeur. Il parvient à mettre en contact,
comme naturellement, des modes de pensée et des formes d’expression hétérogènes. Mais
d’abord et d’emblée, à l’origine exacte de son œuvre, la pensée scientifique dont relèvent
l’ethnologie et la sociologie, s’exprime dans ses films sous une forme essentiellement
poétique. C’est ainsi qu’il ouvre au cinéma documentaire la voie de la fiction et que, à
l’inverse, il élève la fiction au rang de documentaire, non pas par le réalisme mais plutôt
par une forme de surréalisme qui sublime le réalisme en mettant à l’envers ses rouages
éprouvés.
11
Sans parler de Flaherty, quelques rares cinéastes ont à certains égards ouvert la voie à
Rouch. Friedrich Murnau peut-être, lorsqu’il détourne la fiction de Nosferatu vers le
documentaire scientifique dans une mémorable séquence consacrée à l’observation
d’animaux suceurs de sang par un professeur de sciences naturelles. Jean Painlevé
également, dont les surréalistes n’ont justement pas manqué de célébrer son fameux
�58
Hippocampe (1934) et qui, lui aussi, d’ailleurs, s’est intéressé dans Vampire (1945) à un
animal suceur de sang8. Tod Browning est particulièrement prémonitoire de Jean Rouch
lorsque, dans Freaks, il fait jouer à des infirmes leur personnage de monstre de foire
d’après leur réelle expérience de vie. Ainsi, le critique Jacques Lourcelles peut-il noter à
propos de ce film que, « dépassant les catégories traditionnelles du réalisme et de la
fiction, du documentaire et de la fiction horrifique, Freaks appartient un peu à chacune
d’entre elles »9.
12
À son tour, le mélange rouchien du documentaire et de la fiction, de la science et de la
poésie, a-t-il une descendance ou, du moins, trouve-t-il un écho dans d’autres films que
les siens ? Si quelques auteurs notoires du cinéma documentaire, tel Raymond Depardon,
peuvent être considérés comme s’inscrivant en partie dans le sillage de Rouch, qui a
d’ailleurs réalisé un Portrait de Raymond Depardon en 1982, il faut là aussi chercher des
correspondances rouchiennes dans le cinéma de fiction. Chez Eric Rohmer par exemple,
quand il tourne Le Signe du lion à Paris en 1959. Il en va de même avec Place de l’Etoile, le
court-métrage que Rohmer réalise en 1964 pour Paris vu par. Mais Jacques Rozier,
répétons-le, est sans doute le cinéaste le plus proche de Rouch aussi bien par les
méthodes de tournage, l’esthétique visuelle et sonore et la corrélation immédiate entre la
réalité et l’imaginaire. Comme Rouch, il tourne des films purement documentaires tels
que la Rentrée des classes (1955), Dans le vent (1962), Paparazzi (1963). Il réalise aussi des
fictions selon les méthodes du cinéma direct, tel Blue Jeans (1959), si étonnamment
rouchien que l’on peut inverser la formule et dire du cinéma de Rouch qu’il est roziérien.
Par exemple, Adieu Philippine (1963) a l’exacte ambiguïté de n’importe quel film de Rouch.
La fiction du scénario est par le fait largement enracinée dans le terreau de la réalité du
début des années soixante qui fait de ce film le premier grand document anthropologique
sur la télévision française, en même temps qu’une étude socio-historique de la jeunesse
française confrontée à la guerre d’Algérie. Et comme chez Rouch, il n’y a nul volontarisme
de la part de Rozier : le choix des lieux et des acteurs, la manière de tourner, notamment
influencée par la méthode d’improvisation collective qui caractérise le jazz, s’allient dans
une poétique singulière où règne là aussi le « mentir-vrai », rendant indiscernables le réel
et l’imaginaire, l’actuel et le virtuel, au contraire même, les fondant l’un dans l’autre de
manière telle qu’une nouvelle catégorie du réel fait son entrée dans le cinéma.
DU NIGER À LA SEINE
13
Là encore, la filmographie de Rouch laisse apparaître un contraste unifiant. Son
quinzième film, Chronique d’un été, est le premier qu’il tourne en France, en 1960. Pour
cette raison, Chronique d’un été est un repère, il est le lieu d’un passage entre deux
périodes et deux espaces de l’œuvre filmique de Rouch. Or, ce film est porteur d’un
paradoxe initial. Au départ, il est une enquête de sociologie française décidée par Edgar
Morin, Rouch ne devant qu’en assurer la captation filmique. Le film est donc a priori un
document destiné à servir les sciences humaines. Or, celles-ci relèvent de la tradition
« logocentriste » occidentale qui « interdit [aux européens] de penser [leur] histoire et
[leur] identité depuis l’autre bord, c’est-à-dire toutes les formes d’altérité »10. Edgar
Morin, alors tenté par une forme nouvelle d’ethnosociologie appliquée à des Parisiens, a
fait appel à Rouch du fait de sa manière de regarder et d’écouter des Africains. Par
ailleurs, Morin connaissait d’autres films du cinéma direct, tournés en Angleterre, aux
États-Unis et au Canada, si bien qu’il avait pu faire le constat suivant : « Ce que Rouch a
�59
fait en Afrique, on l’a commencé dans notre civilisation même »11. Tel est le motif
véritable de sa rencontre avec Rouch autour du projet de Chronique d’un été, plutôt
ambitieux, puisqu’il ne s’agit rien moins que de réinventer l’approche de l’autre.
14
Ainsi, lors de la réalisation du film, deux lignes de force distinctes se confrontent. D’une
part, le discours socio-ethnographique à l’œuvre dans le projet de Morin qui fixe un cadre
au tournage à travers une même question posée à tous les protagonistes du film
(« comment vivez-vous ? »), d’autre part la place faite à l’imprévu, voire à l’impensé par le
cinéma direct de Rouch. À cet endroit, le tandem Morin-Rouch, tiraillé par des tensions
opposées dont Morin a d’ailleurs fait état12, a été de nature à produire un nouveau type de
film. Les deux auteurs sont entrés par le fait dans une procédure de déconstruction, au sens
derridien du terme, des effets ordinairement recherchés par le cinéma d’observation
documentaire. Selon la volonté universaliste des sciences humaines qui gouvernent
jusqu’alors ce cinéma, il s’agit de s’approprier la différence, de l’intérioriser « pour la
réduire à l’état de différence culturelle »13. Or, Chronique d’un été ne veut justement rien
savoir en la matière, alors même que les personnes interrogées proviennent d’horizons
très variés. Au contraire, le dispositif du tournage met curieusement tout le monde à
égalité face au discours et à la posture que l’on attend des uns et des autres. L’ouvrier, le
petit bourgeois, la jeune épouse, l’étudiant, le Parisien, l’Africain, l’ancienne déportée
d’un camp de concentration, les jeunes filles jouant les starlettes sur la Côte d’Azur, et
Edgar Morin, lui-même en sociologue enquêteur dont « Rouch avait songé à faire le
“héros” du film parti à la recherche d’un Graal qui lui échappe »14, tous sont mis à la
question selon un même projet que Morin résume en ces termes : « Le film est une
recherche. (...). Ce n’est pas un film romanesque. (...). Ce n’est pas un film documentaire.
(...). Ce n’est pas un film sociologique (...). C’est un film ethnologique au sens fort du
terme : il cherche l’homme »15.
15
Jean Rouch donne une forme aux négations sur lesquelles s’appuient les intentions
novatrices d’Edgar Morin. Sa méthode y pourvoit. Quelques allusions lapidaires de Morin
en décrivent d’ailleurs parfaitement bien les aspects essentiels. En premier lieu, Rouch
veut tirer l’enquête documentaire vers la fiction, exactement comme il vient de le faire
pour La Pyramide humaine dont il est en train de terminer le montage. De surcroît, « il en a
assez du tournage sur place, en chambre avec caméra sur pied » et comme pour la scène
« en son synchrone direct » évoquée plus haut16, il invente une méthode que Morin
qualifie plaisamment de « pédovision », qu’il oppose au dispositif voulu par lui, la
« commensalité », à savoir le tournage en intérieur, autour d’un repas. La méthode
rouchienne, poursuit Morin, finit par être « employée à plein : (...) microcravate et
magnétophone en bandoulière, [deux enquêtrices] marchent librement. Brault guidé à la
main par Rouch les suit ou les précède de très près au grand angle. Ainsi dans cette
marche où filmeurs et filmés font presque corps, les passants s’aperçoivent à peine qu’on
fait du cinéma ». Dernier point, et non des moindres, de la manière rouchienne : « c’est
l’idée de Landry “explorateur noir de la France en vacances” »17, une disposition
scénaristique d’importance qui sera reprise par Rouch et systématisée quelques années
plus tard dans Petit à Petit.
16
Or, ces trois axes fondamentaux, la « dérive de la fiction », la « pédovision » et l’inversion
identitaire de l’enquête ethnographique, sont au service d’un projet purement
documentaire dont Rouch est le servant, pas l’initiateur. Il se trouve ainsi dans la même
situation que lors de sa rencontre avec Marcel Griaule. Il fut son chargé de mission
filmique comme il est ici celui d’Edgar Morin. De là à penser qu’un fil court entre
�60
l’ethnologue de la falaise de Bandiagara et l’ethno-sociologue des quartiers parisiens, il
n’y a pas loin. Ce fil passe éventuellement par Rouch dont Jean-Luc Godard a pu écrire en
1959, après avoir vu Moi, un noir, qu’« il n’a pas volé son titre de carte de visite : chargé de
recherche par le Musée de l’Homme »18. Il n’y a en effet pas vraiment de hasard. Griaule
est le premier anthropologue qui s’intéresse à « l’ontologie dogon », qui la découvre et la
dévoile parce qu’elle « ouvrait des horizons aux ethnologues »19. Edgar Morin, le
défricheur de « l’homo cinematographicus (...) selon une méthode d’anthropologie
génétique »20, veut mener ici « une expérience [inédite] d’interrogation
cinématographique »21. Si un lien, un peu lâche certes, existe via l’anthropologie entre
Griaule et Morin, Jean Rouch, pour sa part, répond d’une manière adéquate, mais non
scientifique, à la demande de l’un et de l’autre puisqu’il postule que tourner un film peut
amener « un truc extraordinaire (...), c’est la découverte poétique des choses à travers le
film »22.
17
Quelle est cette découverte dont Chronique d’un été s’avère un jalon important ? Au départ,
il y a le frottement de deux mondes étrangers, enclos sur leur ignorance réciproque de
l’autre. L’anecdote exemplaire du premier contact de Rouch en 1942 avec un rituel
animiste entre bien dans ce cadre. Puis la familiarité s’installe et avec elle la
reconnaissance mutuelle de l’autre, à la fois comme individu et comme membre d’un
groupe, éventuellement engagé dans un projet commun. Or, ici, il s’agit du cinéma qui
exige de toutes façons un travail d’équipe, quand bien même se réduit-il au minimum
d’exigence technique. C’est ainsi que les Africains dont Rouch était initialement censé
faire l’objet d’une observation documentaire, entrent dans le processus de l’expression
cinématographique, non seulement parce qu’ils s’inventent comme personnages mais
encore parce qu’ils collaborent à la fabrication technique des films. La première
découverte de Rouch, qui vient irriguer tout son cinéma, c’est leur altérité, du moins telle
qu’elle émerge et apparaît de plus en plus comme une puissance poétique autonome.
Encore a-t-il fallu que le cinéaste soit à la hauteur pour percevoir celle-ci et la
transmettre d’une manière appropriée et efficace, pour le moins absolument nouvelle.
Avant lui, en effet, l’Occident a déjà fait son œuvre en Afrique, notamment à travers les
conquêtes coloniales, les récits de voyage23 et les rapports ethnographiques. Mais Rouch,
qui n’est ni un militaire, ni un aventurier, ni un ethnologue d’ailleurs quand il débarque
là-bas pour la première fois, cherche un contact direct avec une réalité en principe
improbable pour un Occidental bon teint, à peu près ignorant du terrain sur lequel il
s’engage. Il s’agit, au sens large du terme, de percevoir, sinon de comprendre le « génie »
africain, ancestral et moderne tout à la fois.
18
Un document de 1951, Les hommes qui font la pluie ou Yenendi, les faiseurs de pluie, indique
dans quelle voie Rouch s’est engagé à cet égard. Le film, un court-métrage de trente
minutes tourné dans un petit village Songhaï du Niger, montre un rituel par lequel il
s’agit d’appeler la pluie. Le rituel prend fin, il ne pleut toujours pas. Mais au tout dernier
plan du film, d’énormes nuages assombrissent le ciel, un grondement de tonnerre est
entendu au loin, une pluie violente s’abat sur la brousse. Un spectateur attentif peut se
poser cette question : qui a fait venir la pluie ? Les prêtres du rituel ou bien le cinéma et
son art du montage ? Un spectateur averti sait, par ailleurs, que la fin de la saison sèche
débouche sur « l’hivernage », autrement dit la saison des pluies annoncée par une période
d’orage. Ainsi, il semble bien que les célébrants du rituel et Rouch lui-même soient
tombés d’accord sur un point : il faut appeler la pluie au bon moment pour qu’elle tombe
à la fois dans la réalité à venir et dans le film à terminer. On est au là au cœur de ce que
�61
Rouch appelle « la découverte poétique des choses » et qui participe du génie africain
comme du sien. La caméra est l’outil et le médium irremplaçables du processus ici engagé,
au terme duquel le cinéma – même documentaire – aura engendré de la réalité. Selon
cette conception vraiment littérale de ce qui s’appellera plus tard « le cinéma du réel » 24,
Rouch explique à Edgar Morin que pour lui, la réalité en soi visée par Chronique d’un été est
moins importante que celle du tournage : « l’intérêt de cette histoire, c’est la chronologie
et l’évolution des gens en fonction du film. Le sujet, en soi, n’a pas grand intérêt » 25.
19
De La Pyramide humaine, son film précédent, Rouch aurait pu dire la même chose, comme
d’ailleurs de Moi, un Noir et de Jaguar. Mais La Pyramide humaine est plus proche de
Chronique d’un été pour une raison vraiment déterminante : les participants du film vivent
en Afrique, certes, mais pour la première fois, des Français mêlés aux Africains montent
sur la scène du cinéma de Rouch. Ainsi, se dessine dans son œuvre une généalogie du
métissage qui se superpose au mélange de la fiction et du documentaire. Le cinéaste est
parti de l’autre lointain, l’étranger absolu, par exemple le pêcheur Sorko, animiste, qui
pêche l’hippopotame au harpon (Au Pays des mages noirs) puis, suivant une pente sans
doute naturelle, celle qui fait de chaque tournage une recréation de la réalité, Rouch en
arrive à un nouvel autre qui peut être familier, proche. C’est l’ami, le voisin, le collègue, le
confrère, à savoir, le « copain » nigérien, le Français d’Afrique (les lycéens de La Pyramide
humaine), l’intellectuel parisien connu (Edgar Morin) ou inconnu (le jeune Régis Debray
parmi les protagonistes de Chronique d’un été). L’autre, tout en étant proche à certains
égards, peut être un inconnu à d’autres égards, tel l’ouvrier ou l’employé parisiens
(Angelo et le couple Gabillon de Chronique d’un été). Cette expérience rouchienne de
l’altérité fait étroitement écho à l’évolution de l’ethnologie et plus largement à celle des
sciences anthropologiques : il n’y a pas d’autre immuable en son lieu. Le spectateur du
cinéma de Rouch n’a qu’à aligner dans sa mémoire, parmi les personnages des films,
quelques figures de l’altérité pour s’en convaincre. « Madame Locomotive » (Les Maîtres
fous), Edgar Ray Sugar Robinson (Moi, un Noir), Nadine (La Pyramide humaine), Marceline (
Chronique d’un été), « l’inconnu » (Gare du Nord), Lam (Petit à Petit), Hughes Gray (Dionysos)
etc., sont chacun une incarnation de l’étrangeté. Or, celle-ci est variable, moins du fait de
la différenciation naturelle entre les êtres, que de la manière dont chaque film les détache
du schéma global susceptible de servir d’arrière-plan explicatif aux films. Plus ou moins
énigmatique, inachevée, non signifiante parfois, s’impose tout au contraire leur
singularité d’individu, dès lors qu’ils parviennent à s’actualiser en personnages de
cinéma.
20
Ainsi, le travail de Rouch s’oriente-t-il vers l’indifférenciation anthropologique dès lors
qu’il réalise en France des films de la même manière qu’il en a toujours réalisé en Afrique.
Après Chronique d’un été, en viennent d’autres, en effet, qui creusent les différentes voies
ouvertes par ce film. Par exemple La Punition (1962), Rose et Landry (1963) et surtout, Petit à
Petit continuent de déconstruire le système occidentalo-centré du discours des sciences
humaines, en inversant tous les paramètres de la relation de l’observateur à l’observé. Ou
encore, l’onirisme réaliste des situations, des personnages et des scènes de Dionysos, paraît
prolonger directement certaines péripéties d’ordre sociologique et culturel de Chronique
d’un été même si un quart de siècle sépare ces deux films. Un Lion nommé l’Américain, qui
fait suite en 1968 à La Chasse au lion à l’arc de 1965, s’ouvre à l’actualité historique, celle
des « événements » de mai 68, il n’est cependant pas engagé, du moins au sens politique
ordinaire du terme, tenant là une position qui était déjà celle Chronique d’un été par
rapport à la guerre d’Algérie.
�62
21
Ce n’est pas tout. Chronique d’un été marque dans l’œuvre de Rouch un véritable tournant
en matière de techniques de réalisation. La prise de son synchrone direct n’est pas sans
retentir sur la prise de vue. On voit en effet s’affirmer dans le cinéma de Rouch ce que
Bazin, dans son étude de Citizen Kane, avait appelé « la tentation du plan-séquence ». Alors
que les films précédents de Rouch sont en général hyper découpés, tel Moi, un Noir qui ne
comporte pas moins de sept cent vingt-cinq plans pour une durée de soixante-dix
minutes26, Chronique d’un été s’installe de préférence dans le tournage de plans longs qui
veulent maintenir chacun(e) dans l’image aussi longtemps qu’il (ou elle) prend la parole.
Quelques films ultérieurs peaufinent la technique du plan-séquence, avec
l’enregistrement en direct de l’image et du son synchrone. Cette procédure répond
idéalement aux attentes du cinéaste qu’est devenu Jean Rouch. Si la matière
documentaire est toujours visée aussi bien dans les documents que dans les fictions, elle a
changé de nature. Elle ne préexiste pas aux films, au contraire, chaque tournage crée une
réalité spécifique qui est la somme des effets produits sur les participants et sur
l’environnement concret. Parfois, les acteurs en sont conscients, voire même, ils
participent activement au dispositif, parfois, c’est à leur insu que le cinéma fait son œuvre
sur eux. Dans tous les cas, on assiste à une expérience nouvelle du temps au cinéma. Deux
courts-métrages, Gare du Nord dont il sera plus longuement question plus loin et Tourou et
Bitti (1971) résument bien la situation. Ils sont pareillement à la pointe de
l’expérimentation d’un vertige temporel spécifique, partagé entre l’instance de
réalisation et les protagonistes. Or le premier film est une fiction parisienne et le second
est un documentaire nigérien. Les deux sont concernés de la même manière par la
tension que fait régner « le temps réel » sur la réalisation filmique. L’intervalle des cinq
années et la distance de plusieurs milliers de kilomètres qui séparent les lieux de leur
tournage respectif fonctionnent comme un miroir où la montée en puissance d’une scène
de ménage entre deux jeunes gens à Paris en 1964 rejoint l’entrée dans la transe d’un
petit groupe de villageois à Simiri, en 1969.
22
Temps réel et son direct synchrone en Afrique, en France, ou ailleurs, dans les
documentaires, dans les fictions. Telle est la formule idéale, pas toujours appliquée, du
cinéma postulé par Rouch, son horizon technique, son programme esthétique. Mais
l’œuvre cinématographique de Rouch ne se réduit pas à cette formule qui est, tout au
plus, un fondement méthodologique. Par-delà, règne l’imaginaire, le plus souvent
incontrôlable, et officie l’imagination, une des premières ressources du cinéma de Jean
Rouch.
NOTES
1. Filmographie de Ganda, assistant technicien au Centre Culturel franco-nigérien puis cinéaste :
Cabascabo (1968), Le Wazzou polygame (1970), Saitane (1972), L’Exilé (1990).
2. Jean Rouch : « Comment le lecteur d’Eluard tourne La Pyramide humaine ». Internet.fr/
cine.beaujolais/Rouch.htm, pp. 7-8.
3. Voir Pierre Haffner, Essais sur les fondements du cinéma africain, Nouvelles Éditions africaines,
1978 et Pierre Haffner & André Gardies, Regards sur le cinéma négro-africain, Editions OCIC, 1987.
�63
4. « Les trois caractères d’une littérature mineure sont la déterritorialisation de la langue, le
branchement de l’individuel sur l’immédiat-politique, l’agencement collectif d’énonciation », Gilles
Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975, p. 33.
5. G. Gauthier, Un siècle de documentaires français, op. cit., p. 112.
6. J.-A. Fieschi, « Dérives de la fiction : notes sur le cinéma de Jean Rouch », op. cit.
7. Jean-André Fieschi, « Dérives de la fiction. Notes sur le cinéma de Jean Rouch », op. cit., pp.
255-258.
8. Dans son Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs, Jean Tulard considère Vampire comme « un
classique de l’épouvante », Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1999, p. 675.
9. Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma. Les films, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
1992, p. 618. Je souligne.
10. Sébastien Camus, « La Passion de l’excès », dans Foucault, Derrida, Deleuze – Pensées rebelles.
Revue Sciences Humaines, hors-série spécial n° 3, juin 2005, p. 84.
11. Edgar Morin, Chronique d’un été, op. cit., p. 7. Morin mentionne ici We Are The Lambeth Boys de
l’Anglais Karel Reisz (1959) et On The Bowery de l’Américain Lionel Rogosin (1955).
12. « Nous commençons à diverger Rouch et moi » commence-t-il par constater et un peu plus
loin, il reprend : « nous divergeons nettement Rouch et moi », ibid., p. 13 et p. 18.
13. Sébastien Camus à propos de « les Fins de l’homme », une conférence de Jacques Derrida en
1968, Foucault, Derrida, Deleuze – Pensées rebelles, op. cit., p. 85.
14. Edgar Morin, Chronique d’un été, « Chronique du film », op. cit., p. 33.
15. Ibid., pp. 8-9.
16. Voir supra, pp. 77-78.
17. Edgar Morin, ibid., pp. 13-20.
18. « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens », op. cit., p. 180.
19. Marcel Griaule, préface à Dieu d’eau, op. cit., p.4.
20. Edgar Morin, Le Cinéma ou l’homme imaginaire, Paris, Gonthier, 1958, avant-propos, p. 7.
21. Edgar Morin, Chronique d’un été, op.cit., p. 9.
22. Jean Rouch, ibid, p. 30.
23. Quel écolier français n’a pas entendu parler, entre autres exemples très connus, de
« Tombouctou la mystérieuse », celle qu’a visitée René Caillé au début du
XIXe
siècle et dont
l’expédition, mise en doute, a été authentifiée par la publication en 1830 de son Journal d’un
voyage à Tombouctou et à Djenné dans l’Afrique centrale ?
24. Sur le festival « cinéma du réel » à Paris, voir le livre d’entretiens de Claire Devarrieux et M-C
de Navacelle, publié sous le titre Cinéma du réel par les éditions Autrement en 1988.
25. Jean Rouch, Chroniques d’un été, op. cit., p. 28.
26. Voir mon découpage plan par plan du film dans L’Avant-Scène Cinéma, n° 265, avril 1981.
�64
Chapitre 4. La fable documentaire
1
L’auteur Jean Rouch se laisse approcher à travers l’observation des principes et des
pratiques mis en œuvre dans les tournages de ses films. Ces principes et pratiques
ressortissent aux méthodes du cinéma direct, ils sont mobilisés à des fins documentaires,
ils en passent par les chemins de la fiction, ils s’inscrivent, comme on l’a vu
précédemment, dans le contexte du cinéma moderne européen. C’est pour toutes ces
raisons, d’ailleurs, que Rouch ne se borne pas à n’être qu’un documentariste au service
d’une institution scientifique. Son premier principe, si c’en est un, consiste justement à
investir d’emblée un vaste territoire du cinéma, pas simplement celui du film
ethnographique, à faire jouer, en somme, son « désir de cinéma » par-delà les nécessités
scientifiques et les contraintes institutionnelles variées. Ainsi, tout en alimentant les
problématiques de l’anthropologie moderne, Rouch construit en toute conscience une
œuvre de cinéma, et cela seul contribue déjà à le singulariser comme ce fut le cas, avant
lui, pour Dziga Vertov ou Jean Vigo. Ses films sont traversés par une conception du
cinéma et des idées en cinéma qui s’exercent dans la plupart d’entre eux, même dans les
quelques films publicitaires qu’il a réalisés en Afrique1.
2
Or, dans la profusion des films, quelques-uns, éventuellement plus marquants que les
autres, apportent à l’appréciation de toute l’œuvre une moisson suffisante de traits
caractéristiques. Certains ont déjà été évoqués ou nommés : Les Maîtres fous, Moi, un noir,
Jaguar, La Pyramide humaine, Chronique d’un été, La Punition, Gare du Nord, La Chasse au lion à
l’arc, Petit à Petit, Cocorico ! Monsieur Poulet, Dionysos. Ils sont les « grands » films de Rouch,
en tous cas les plus connus du public cinéphile, celui de la Cinémathèque française
notamment. D’autres sont plutôt familiers aux habitués du Musée de l’Homme et de
l’université de Nanterre. Ce sont surtout les documentaires à vocation ethnographique et
plus particulièrement ceux qui forment des cycles, tels les quatorze Yenendi, ou les onze
Sigui réunis en fin de parcours en un Sigui Synthèse au sous-titre mémorable :
Commémoration de l’invention de la parole et de la mort.
3
En fait, il faut peu de temps à Rouch pour que l’art du cinéma s’affirme dans ses films
comme une puissance créatrice. Celle-ci se manifeste dès lors qu’il charge sa propre voix
de « dire » le monde que les images figurent et que, conjointement à ce processus oral, la
caméra est visiblement soumise aux aléas du corps qui la porte, celui du cinéaste en
personne. Les deux aspects du processus sont en place dès son deuxième film, Les
Magiciens du Wanzerbé (1947). Quelque chose d’autre mûrit au fil de la réalisation des
�65
courts-métrages ethnographiques suivants : Initiation à la danse des possédés et La
Circoncision en 1948, Cimetière dans la falaise en 1950 ont beau être des reportages
purement documentaires, ils ont déjà le parfum de la fable. Deux facteurs concourent à
cette sorte de transsubstantiation. Le premier provient de l’événement lui-même : c’est, à
chaque fois un rituel, autrement dit une circonstance organisée qui connaît son début et
sa fin comme dans un récit déjà écrit et qui, de surcroît, met en co-présence le passé et le
présent. Le second facteur, c’est Rouch en personne : il aime les récits narratifs et cette
disposition le fait passer, dès son deuxième film documentaire, du rang de commentateur
à celui de récitant. Ainsi, il est permis de penser que si sa prédilection quasiment
immédiate pour les rituels naît d’une curiosité anthropologique, elle est pour une bonne
part activée par ce goût inlassable de la fable qui, à son arrivée en Afrique en 1942, terre
d’oralité ancestrale, a trouvé un terrain favorable pour éclore et s’épanouir. A peine dix
ans plus tard, en 1951, Bataille sur le grand fleuve en porte les marques déjà irrécusables,
définitives.
BATAILLE SUR LE GRAND FLEUVE
4
1946-1951 : Rouch réalise au Niger et au Mali une dizaine de courts et moyens-métrages
ethnographiques. Ces films observent des rituels religieux ou des pratiques coutumières.
Ils sont tournés en 16 mm avec de la pellicule Kodachrome, le cinéaste est l’opérateur de
prise de vue même quand il a un assistant. Les sons, enregistrés indépendamment des
images sont utilisés comme des « ambiances ». Au montage, Jean Rouch post-synchronise
le commentaire en voix off. Il maintient là, semble-t-il, une tradition du cinéma
documentaire. Or, pour Rouch, il s’agit d’un commencement de monde, plutôt, la
réalisation enfin effective d’un « rêve » de 1946 : « repartir en Afrique pour descendre le
Niger » avec ses amis Jean Sauvy et Pierre Ponty. Circonstance toute particulière : Jacques
Becker – raconte Rouch – est dans le même avion1 et « lors d’une longue escale dans le
Sahara, l’équipe de Becker [lui enseigne] le maniement de la caméra » [achetée au Marché
aux Puces]. Ainsi, lorsqu’il tourne ses « trois premiers films, [Rouch] n’a aucune notion
des raccords. [Il tourne] par morceaux ce qui [1]’intéresse, sans souci du montage à venir
(…) ».2 Ce cinéma improvisé dont le cinéaste parle comme d’un bricolage, est perçu en ces
termes par le critique Jean-André Fieschi :
À ses commencements, la caméra enregistre, outil supplémentaire dans la panoplie
de l’ethnologue, (…) rites et coutumes (…). Ce cinéma (…) ne s’écrit pas, tributaire
de l’événement, de l’instant, du lieu. S’invente, surprenant, au fur de son
déroulement, dans le cadre d’un scénario fixé par avance mais extérieur au cinéaste
(…). Il est l’opérateur au sens mallarméen d’enclancheur, de distributeur de signes,
comme au sens strictement technique3.
5
Oui, au croisement du cinéma et de l’Afrique Noire, Rouch s’avance en même temps dans
deux territoires, tel un explorateur aventureux qui ferait ses premiers pas sur une terra
incognita presque sans bagages. Il n’invente pas l’Afrique, il n’invente pas le cinéma, mais
il s’invente, lui, en cinéaste de l’Afrique parce que avant lui, peut-il penser, personne
n’aura filmé cette contrée comme il va le faire : en roue libre. Ce n’est pas rien si l’on
songe d’une part au contexte colonial et à la somme de contraintes politiques et de clichés
racistes qu’il entraîne, d’autre part à la situation du cinéma ethnographique, lui-même
asservi, via le discours scientifique, à l’empire des mots et de l’écriture. La voie tracée par
Rouch évite précisément ces deux écueils majeurs parce qu’elle passe ailleurs, dans les
confins d’un cinéma qui déconstruit les bases sur lesquels il devrait en principe s’édifier.
�66
6
Parmi d’autres, Bataille sur le grand fleuve, le septième film de Rouch, illustre à merveille la
manière dont ce dernier laisse dériver son cinéma vers un lieu inattendu. Il s’agit de
suivre une pêche traditionnelle, depuis la fabrication des harpons, la réfection des
pirogues, leur mise à l’eau, la descente du fleuve, les péripéties mouvementées de chaque
harponnage, la traque particulièrement longue d’un hippopotame assez vieux pour être
plus rusé et plus dangereux que tous les autres, sans oublier la rituelle consultation
préalable chez un devin. Ainsi s’écrit le premier degré de ce film simplement
documentaire, conçu, en principe, pour éclairer le spectateur occidental sur des pratiques
coutumières lointaines. Le scénario se constitue réellement au fil du tournage,
« tributaire de l’instant, de l’événement, du lieu », en même temps qu’il trouve tout de
même son organisation et sa lisibilité dans le cadre d’un récit chronologique. À cet égard,
Bataille sur le grand fleuve pourrait être un documentaire comme il y en a tant, d’autant
plus que les images sont assorties d’un commentaire en voix off. Mais autre chose
advient, qui est clairement lisible à la surface des images. C’est l’interaction entre le
filmant et les filmés. Plutôt, le spectateur n’est pas simplement confronté aux péripéties
de la pêche, il voit (et il entend) le cinéma faire son travail et être ainsi partie prenante,
de façon manifeste, des actions engagées. Les images ont en effet cette caractéristique
marquante qui les singularise par rapport au classicisme documentaire : elles sont
approximatives, elles sont aussi proches de la réalité filmée qu’elles en sont éloignées,
celle-ci ne cessant en effet d’échapper à la prégnance de la caméra qui fonctionne dans le
calme ou dans la précipitation selon ce qui se passe devant elle. Il s’agit là d’une caméra
réactive, « participante » – dirait Gilles Marsolais – portée et non pas posée sur un
trépied, embarquée dans une des pirogues, disposant alors de peu d’espace devant elle.
Ainsi, le cadre est constamment instable du fait du tangage de la pirogue et il est serré, si
bien qu’il est le plus souvent menacé de laisser fuir par tous ses bords des pans de la
réalité observée qu’il faut souvent rattraper par des recadrages rapides et intempestifs.
Tel est le second degré du film auquel pourrait s’appliquer la formule bien connue de
Jacques Rivette selon laquelle « tout film est le documentaire de son tournage ».
Seulement, Bataille sur le grand fleuve précède de quelques années la modernité du cinéma
de la Nouvelle Vague et surtout, n’est a priori qu’un documentaire dans lequel
l’observation ethnographique devrait déployer son ordonnancement avant celui du
cinéma. Or, ici, le cinéma s’impose en tant que tel car « tous les accidents techniques par
lesquels la matière résiste (…) viennent au-devant de la scène, à égalité pourrait-on
presque dire, de la représentation elle-même »4.
7
La nouveauté essentielle que Jean Rouch introduit, en tournant en cinéma direct, est la
représentation de la relativité en matière de vérité documentaire. Comme l’image qui
tangue, la vérité bouge. La vérité ne préexiste pas à son image, au contraire, elle se
construit et se donne pour ce qu’elle est : une représentation liée aux déterminations du
moment, qui pourrait donc être différente à un autre moment. Elle n’est qu’une vérité de
cinéma. Et cette vérité-là, découvre le spectateur du film, est l’expression d’une relation
circonstancielle et unique entre les deux forces de vie, les deux pôles constitués par le
filmant et le filmé, au moment de leur rencontre. Quand, parlant du cinéma moderne des
années soixante, André Labarthe le définit notamment par « le passage au relatif » dont il
fait « le signe d’une conciliation entre la fiction pure et le documentaire pur [parce que
la] vérité sera à la fois exemplaire et unique »5, il désigne un processus que Jean Rouch avait
déjà installé dans son cinéma dès l’aube des années cinquante. Si en terme de typologie
des genres filmiques, Bataille sur le grand fleuve reste un film strictement documentaire,
�67
néanmoins, son mode d’approche de la réalité, doublement déterminé par les aléas de la
pêche et ceux du tournage du film, laisse s’installer et croître au cœur même de la
matière documentaire, les germes d’une fiction qui, en cette toute première période du
cinéma de Rouch, ne dit pas encore son nom. Tout se passe, en fait, dans l’écart entre les
deux réalités confrontées, dans « la constellation »6 fugitive formée par celles-ci au
moment du tournage et qui laisse son empreinte sur la pellicule. Voilà le document, mais
il n’est pas tout le film. Par-delà la vérité circonstancielle de l’image enregistrée et son
authenticité garantie par la technique même du tournage, l’art filmique de Rouch fait que
l’histoire du film en train de se faire coïncide infailliblement avec le mouvement de
l’histoire que les protagonistes, Rouch d’un côté, les pêcheurs de l’autre, sont pourtant en
train d’écrire ensemble, tel un scénario tendu vers sa finitude.
8
L’art filmique ? Bien sûr, « les accidents techniques » évoqués plus haut sont intégrés à
l’esthétique et à l’esprit même de la réalisation en cours. De surcroît, à la pointe, déjà, de
la spécificité rouchienne, « le désir de cinéma » pousse l’histoire filmée vers son
accomplissement de récit. C’est la matière sonore, notamment, qui manifeste une telle
poussée. D’une part, le commentaire en voix off déploie les fastes d’un récit qui donne aux
moindres péripéties une allure picaresque. Mais, d’autre part, une résonance insolite
s’instaure entre ce commentaire et les voix de tous les pêcheurs, mêlées au fond sonore
fait de bruits diégétiques et de musique additionnelle. Par là, le « mentir-vrai » fait
intrusion dans le film car la représentation sonore, déterminée elle aussi par la double
réalité de la vie vécue et du tournage en direct, parvient à mettre le spectateur en face
d’une situation teintée d’étrangeté. D’une part, la voix du commentaire est off sans
ambiguïté, d’autre part, les voix des pêcheurs, quoique recueillies parmi les ambiances
puis postsynchronisées, sont in sans ambiguïté, là non plus. Or, ces deux catégories de
voix que distinguent leur source réelle et leur fonction dans l’espace sonore de la
représentation, semblent être en contact direct dans le même espace-temps du récit. Voix
diégétiques réduites au rang d’ambiances, inaudibles parce que brouillées, paroles le plus
souvent incompréhensibles (les pêcheurs ne parlent pas français) ou bien voix claire et
isolée du commentaire, parole toujours compréhensible, peu importe, en fait, puisqu’elle
semblent vibrer sur un même fond sonore, l’effet de la post-synchronisation ne jouant
pas plus ou pas moins pour les voix des pêcheurs que pour celle de Rouch. Conséquence la
plus directement appréciable : sans qu’il y ait concurrence entre elles, les voix in sont
entendues à égalité avec la voix off. C’est à cet endroit que le film déroge à une tradition
documentaire tenace. Les documentaristes ont en effet l’habitude de hiérarchiser le
matériau sonore entre les ambiances issues de la réalité filmée, y compris les paroles
quand il y en a, et le commentaire qui donne son sens à l’image et qui, en instaurant son
primat sur toute la dimension sonore de la représentation maintient la différence entre
les plans de réalité sonore. Il n’y a (presque) rien de tel dans Bataille sur le grand fleuve. À
cet endroit, le spectateur est amené à se poser une question sur la nature même du
spectacle qui lui est ici prodigué : quelle logique ou quelle nécessité font converger dans
un même plan de réalité filmique le son de voix qui proviennent de deux lieux
spatiotemporels différents ? Ce document pris sur le vif, donc enchaîné à une réalité qu’il
n’a pas inventée, serait-il, en fait, la fiction d’un récit quelque peu fantastique dans lequel
on verrait, on entendrait, plutôt, une insolite collusion spatio-temporelle entre des êtres
qui évoluent pourtant dans des sphères différentes de l’espace-temps représenté ? Entre
autres traits saillants, voilà comment un effet-fiction vient inopinément interférer avec le
propos documentaire de Bataille sur le grand fleuve selon un processus qui se poursuit dans
tous les autres films de Rouch. A cet égard, il est sans doute un des cinéastes à avoir le
�68
plus sûrement contribué à ruiner la détermination des genres au cinéma, celle-ci passant
notamment par le partage traditionnel entre la fiction et le documentaire.
9
Une péripétie apparemment mineure renforce la modernité à l’œuvre dans ce film, en
voici le récit de Rouch lui-même, lors d’un hommage à la Cinémathèque française en 1999.
Le premier film que j’ai montré à Bamako, c’était La Chasse à l’hippopotame. Les gens
(…) m’ont dit deux choses : la première, c’est qu’on ne voyait pas assez
l’hippopotame ; la deuxième : Mais pourquoi tu as mis la musique ? » Je leur dis :
« Mais cette musique, vous l’avez reconnue ? C’est la musique qui donne du courage
aux chasseurs. » Alors eux : « Mais tu es con ! Là où tu l’as mise, l’hippopotame
attend sous l’eau, et c’est à lui qu’elle donne du courage. C’était pour moi le début
de quelque chose qui allait devenir essentiel : le « feedback », c’est-à-dire la
projection d’un film à ceux qui y ont participé7.
10
Moi, un noir, on le verra plus loin, est le grand opus partiellement inventé, créé par la grâce
toute spéciale du « feedback. ». En terme de cinéma ethnographique, la décision de Jean
Rouch déclenche une véritable révolution copernicienne car aucun cinéaste auparavant,
s’il avait songé à demander aux personnes observées ce qu’elles pensaient de leur image
ou reflet filmique, n’aurait intégré les réactions enregistrées dans le tissu du film luimême. En outre, le « feedback » ne se réduit pas à la simple consultation des protagonistes
de ses films. Rouch ne se contente pas, en effet, de leur demander un avis ou jugement, ni
même de lui délivrer un certificat d’authenticité. Plus imaginatif, ou plus provocateur que
l’art documentaire strict ne l’exige, il va ouvrir aux uns et aux autres un nouveau champ
d’expression, en faisant coïncider l’effet « feedback » avec le moment technique de la postsynchronisation. Geste capital – on y reviendra – qui élève les protagonistes au rang
d’acteurs de cinéma et les transforme ainsi en personnages de film.
11
Enfin, les pêcheurs de Bataille sur le grand fleuve, qui n’ont pourtant pas la parole directe et
qui, de ce fait, restent encore grandement du côté de ceux que le cinéma documentaire ne
fait qu’observer, profitent rétrospectivement des films à venir. En effet, s’ils
impressionnent la mémoire du spectateur des films de Rouch, c’est que leur image
emporte celle d’un futur dans lequel eux-mêmes ou leurs semblables seront des
personnages. L’effet fonctionne surtout avec l’un d’entre eux, Damouré Zika, « né » au
cinéma dans ce film. C’est notamment par lui que le futur s’engouffre dans Bataille sur le
grand fleuve, comme si chaque image, à l’instar de la sienne, celle d’un être en gestation,
était virtuellement féconde. La fécondation, qui a bien eu lieu pour lui, s’étend aussi aux
autres composants du film. C’est là encore un trait rouchien typique : l’horizon de tous les
films est illimité, la clôture du récit n’est qu’une nécessité ou une contrainte technique, le
principe du cycle fait son œuvre dans chaque film qui se trouve ainsi irrémédiablement
attaché à d’autres films. D’ailleurs, Bataille sur le grand fleuve est explicitement traité
comme un élément d’un cycle puisqu’il est repris dans un autre film, Les Fils de l’eau qui
réunit cinq documentaires tournés par le cinéaste entre 1949 et 1951. Le phénomène peut
paraître banal, du moins en matière d’expression artistique où règnent souvent la loi des
séries, l’ordre des répétitions, reprises et variations en tous genres. Mais à cet égard le
travail de Rouch manifeste là encore un double écart par rapport à une conception établie
du film documentaire. D’abord, l’horizon de chaque film devenant indéfini, la fin n’est
plus connue, autrement dit le sens des choses n’est pas simplement maîtrisable par le film
qui les documente. C’est ainsi que les fins dites « ouvertes » sont récurrentes dans son
cinéma. Ensuite, il attire le spectateur dans une autre sphère de perception que celle du
simple film documentaire. L’idée du cycle et son principe actif, qui entraîne le spectateur
de l’œuvre dans un ressassement productif des effets ressentis par lui, appartient à
�69
l’ordre de la fiction. Ce n’est rien, en effet, que de constater que des pêcheurs en 1951
perpétuent à l’identique des pêches traditionnelles, encore faut-il que la représentation
soit ordonnée de manière à indiquer qu’elles ne sont pas simplement anciennes, qu’elles
sont en fait immémoriales et du coup, toujours présentes, que la force du passé les fait
tenir dans le présent. Voilà le cycle, il ne peut se voir à l’œil nu que si l’image du présent
est (re)composée, à savoir reliée à une autre image, déjà faite ou à venir. La fiction, celle
dont chaque spectateur a le loisir de déployer les méandres dans son imaginaire s’installe
bien dans le lien qu’il pressent entre l’actualité de l’image telle qu’elle se montre à lui hic
et nunc et sa virtualité telle qu’elle est engendrée depuis un passé inappréciable et
susceptible de revenir dans un futur lui aussi inappréciable. On est là au cœur même de la
sorte spéciale d’image que Gilles Deleuze a appelée « l’image-cristal ».
12
À ce titre, Bataille sur le grand fleuve et les autres films du cycle des Fils de l’eau ont dépassé
l’horizon ethnologique que le cinéaste leur a fixé, de même qu’ils ont provoqué des
résistances chez des Africains. Le cinéaste sénégalais Sembene Ousmane, par exemple,
explique à Rouch qu’il n’aime pas les films de ce cycle parce que « on y campe une réalité
mais sans en voir l’évolution »8. Et pour cause : Rouch installe le récit d’une péripétie
présente dans l’intemporalité qui caractérise le mythe. C’est là un des moteurs essentiels
de ce qui apparaît comme une véritable geste rouchienne de l’Afrique qu’avère tout
particulièrement un film parmi d’autres, La Chasse au lion à l’arc, dont le tournage a duré
sept années.
LA CHASSE AU LION À L’ARC
13
Ce film est l’occasion d’un événement institutionnel notable puisqu’il reçoit le Lion d’Or à
la XXVIe Mostra de Venise en 1965. Or, La Chasse au lion à l’arc est un documentaire dont le
propos relève a priori du plus pur cinéma ethnographique. Il semble bien alors que Jean
Rouch ait accompli un exploit en faisant primer un film strictement défini par son origine
documentaire par le jury d’un festival dédié au cinéma de fiction. En réalité, il suffit
simplement de pénétrer dans l’univers proposé par le film, de regarder les images
initiales et d’entendre les premiers bruits pour prendre la mesure de ce qui s’y joue et a
sans doute séduit en son temps les premiers spectateurs du film. À la faveur d’un récit
filmé dans le sillage d’un fait coutumier, Jean Rouch se propose en effet de reconstruire
un monde immémorial. L’ambition est explicite et d’entrée, elle embarque le spectateur
du film dans un voyage dont l’ampleur spatio-temporelle déborde largement les limites
des péripéties filmées en cinéma direct. Les sept années de tournage et le commentaire
introduit après coup par Rouch dans la résonance de l’effet feedback, dont il est désormais
familier, n’y sont certes pas pour rien. Le temps passé par le cinéaste à accompagner les
chasseurs lors de plusieurs missions ethnographiques, leurs multiples déplacements dans
une aire géographique qui couvre un territoire indéfini sont impossibles à mesurer. D’une
mission à l’autre, des mois, voire des années ont pu s’écouler mais le commentaire
coordonne les séquences entre elles en un seul tissu ; même chose pour les kilomètres
parcourus lors d’allées et venues sur le terrain de la chasse, une péripétie qui est en fait
toujours recommencée. Jean Rouch ne se soucie pas de tenir un carnet de bord relevant
avec exactitude les coordonnées spatiotemporelles de chaque péripétie. Ainsi, de ce point
de vue, le film évite ou oublie de répondre aux attentes ordinaires des films
documentaires.
�70
14
L’écart est renforcé par un trait encore plus incisif qui permet à Rouch de mettre en
contact comme immédiat la matière documentaire des images et la puissance de
l’imagination. La procédure est d’autant plus frappante que les images sont entièrement
liées à une réalité filmée hic et nunc en cinéma direct. Le spectateur a alors en principe
peu de chance de pouvoir échapper au circuit référentiel ainsi instauré par le cinéma
documentaire en général, par le cinéma direct plus particulièrement. De l’image vue et
entendue, à la réalité dont on suppose qu’elle fut le modèle, ce circuit est a priori
univoque, balisé. Or, quelques éléments de mise en scène font éclater les repères qui
orientent la perception documentaire du récit par le spectateur. Le premier de ces
éléments est un détail sonore. Juste avant le plan d’ouverture du récit proprement dit, on
entend en effet rugir un lion ; sa voix grave paraît sourdre depuis l’arrière-plan
inaccessible d’une image sombre, à peu près indéchiffrable, qui représente peut-être la
couverture d’un livre ou d’un manuscrit. Agissant comme une force centrifuge, cet
acousmêtre attire vers lui toute une mise en œuvre de l’imagination, la faisant ainsi
travailler avant même le début du récit attendu. Ce début1 situe la narration filmique
dans le registre des contes. Les quelques plans suivants, qui constituent un prologue,
renforcent une telle impression. Dans la nuit, un musicien joue du violon mandingue puis,
des enfants groupés autour d’un feu écoutent à l’unisson ces paroles :
Les enfants, au nom de Dieu écoutez… écoutez l’histoire de Gaweye Gaweye…
Gaweye Gaweye, l’histoire de vos pères et de vos grands-pères, l’histoire des
chasseurs de lion à l’arc.
15
La voix, très suave, est bien sûr celle de Jean Rouch, le récitant, le griot, l’acousmêtre qui
ouvre ainsi le grand livre des images à venir.
16
Le fait de destiner le récit à des enfants qui vont bientôt aller dormir est bien sûr
programmatique : le récit de La Chasse au lion à l’arc est d’emblée un conte, une fable. Les
mots appellent des images, traversent le temps et l’espace sans contrainte, sans barrière
d’aucune sorte. Ainsi, de la nuit, on passe au jour. Une Land-Rover roule dans la brousse
sur une piste cahotante et la voix du récitant, que soutient en arrière-fond sonore le
violon mandingue, poursuit :
Le pays où se passe cette histoire s’appelle Gandji Gamourou Gamourou, la brousse
qui est plus loin que loin, le pays de nulle part.
17
Pour cause : les enfants ont disparu, la nuit qui les contenait également. Où sommesnous ? Quand sommes-nous ? Justement dans « le pays de nulle part », nous dit la voix qui
continue son récit tandis que le son d’un balafon s’élève maintenant comme une musique
off d’accompagnement. « Pour aller dans ce pays, il faut passer Issabéri, le grand fleuve, le
Niger ». Image de la Land-rover sur un bac. La voiture continue son périple dans la
brousse :
« Au début il y a des routes, il y a des villages et puis, après Bankiaré, après Tégué,
après Yatala, il n’y a plus de village (…) il n’y a plus de route, il n’y a plus que la
brousse. Mais si l’on peut dépasser la dune Guerjam on entre dans Gandji Gamourou
Gamourou, la brousse qui est plus loin que loin, le pays de nulle part. Ce pays-là,
c’est un pays de sable, un pays de poussière, un pays de brume. Ce sont des forêts
sans chemin, des montagnes dont les noms ont été oubliés et que nous appelons,
nous, les montagnes de la lune et les montagnes de cristal.
18
À l’image apparaissent des arbres clairsemés, bas sur le sol, et les faibles ondulations de
quelques collines. La mise en condition des spectateurs est surprenante. D’abord postulés
comme des enfants, ils sont maintenant priés d’entrer dans un lieu indécidable tant
l’écart entre ce que dit la voix et ce que montre l’image est déréalisant. Par là, Jean Rouch
�71
atteint déjà un premier effet visé par lui et qui va conditionner la suite : il s’agit
d’instaurer d’emblée l’idée que le voyage accompli en automobile, horizontal,
géographiquement orienté dans l’espace, chronologique, vaut pour un voyage immatériel
dans la profondeur du temps. Autrement dit, on est là au cœur d’une image-cristal
immédiate. Cette sorte d’image est ici assignée à une fonction précise : Rouch,
ethnographe d’une chasse coutumière, circonstancielle et contingente, filmée entre 1958
et 1965, la plonge d’emblée dans un temps proprement immémorial, un temps si vaste
que les noms des lieux ont justement été oubliés. Mais les lieux sont là, ils sont présents
depuis le passé qui remontent en eux, par eux. Or, le film veut rendre compte de cette
remontée spectaculaire du passé dans le présent.
19
Un deuxième élément de mise en scène intervient à cet effet. L’opérateur, peut-être
descendu de voiture, à l’arrêt quoi qu’il en soit, effectue un panoramique vers la droite,
faisant ainsi entrer dans le champ l’objet de son regard : un long rocher orné de gravures
diverses. Le récitant accompagne le mouvement du regard :
Ici, il n’y a rien. Pourtant, il y a longtemps, des hommes vivaient là. Ils ont laissé sur
les rochers un livre d’images qui montrent ce qu’ils étaient, un livre de chevalerie
avec des cavaliers à deux ou trois cornes tenant dans la main un bouclier, dans
l’autre une lance ou un arc (gravure stylisée d’un cavalier en armes). Qui étaient ces
hommes ? Personne ne le sait plus. Ce sont les hommes d’avant. Les hommes
d’avant ont aussi laissé sur les rochers des cercles autour d’une croix qui sont peutêtre des signes magiques, des “guendjiaou”, des “attachés de brousse”, mais qui
sont peut-être aussi des roues de char (image d’un cercle divisé par des rayons), les
premiers chars qui ont traversé le Sahara pour venir jusqu’ici, ou peut-être des
pièges avec lesquels les hommes d’avant attrapaient les animaux sauvages, les
crocodiles, les mouflons, les girafes, les buffles, les grandes antilopes [gravures
animales stylisées].
20
Puis, ayant décrit le rocher dans toute sa longueur, le mouvement de caméra reprend et
se poursuit vers la droite. On retrouve la brousse désertique et la voix : « Et si les hommes
d’avant ont disparu du pays de nulle part, les animaux sauvages, eux sont restés ». Ces
paroles font surgir des animaux bien vivants : un phacochère galope devant une voiture
invisible ; des autruches font de même, une girafe court derrière une voiture, la rattrape
et la dépasse ; peut-être a-t-elle rejoint, dans le dernier plan de la séquence, un troupeau
de girafes, rassemblées dans un bois : image de crépuscule, ciel rougeoyant en arrièreplan, silhouettes des girafes mêlées à celles des arbres, les unes et les autres baignées
dans la pénombre. Fin du prologue. L’image suivante, montrant en plongée le sol aride de
la brousse, est diurne. Ici débute le récit de la chasse proprement dite.
21
Le processus est net : à la faveur d’un mouvement de caméra glissant, ou paraissant
glisser, le long d’un rocher, le présent se déplace dans le temps. « Les hommes d’avant »
et ceux d’aujourd’hui se retrouvent parce que autour d’eux des animaux sont
éternellement présents. Gravures pariétales de l’époque néolithique où les guerriers et les
chasseurs côtoyaient les bêtes sauvages, les chassaient et les dessinaient aussi bien,
images filmiques du XXe siècle où les chasseurs de lions et les chasseurs d’images se
trouvent rassemblés dans un même « safari »2 qui les confronte eux aussi aux animaux
sauvages. Dans l’entre deux, dans le gouffre du temps immense qui se referme sur les uns
et les autres, rien de moins que l’histoire de la civilisation humaine, de sa conquête de
l’espace et du temps s’est déroulée. La magie animiste des gris-gris (« les attachés de
brousse ») ou la magie technologique du cercle (les « roues de char ») ont permis la
coïncidence entre les origines et les fins, autrement dit le cycle incessant dont le film de
�72
Rouch entend développer la fable. Le spectateur est prévenu : la chasse à laquelle il va
assister a lieu ici et maintenant, elle a lieu là-bas et autrefois.
22
Telle est la fable documentaire : c’est un tissu de vérités indécidables conférant à un
espace-temps indéterminé des données précises.
NOTES
1. Ces films sont V.W voyou (1973), Le Foot-girafe ou « l’Alternative » (1973), La 504 et les foudroyeurs
(1974). Par ailleurs, il est arrivé à Rouch, d’exécuter des commandes de circonstance et des films
à usage spécialisé ou restreint, peu vus par le grand public. Exemples : Les Ballets du Niger (1961),
Festival à Dakar (1962), Bateau-givre (1987), Liberté, égalité, fraternité et puis après… (1990).
1. Encore une des coïncidences merveilleuses qui jalonnent la vie de Rouch : Becker part faire des
repérages pour Rendez-vous de juillet, le film qui, d’après Rouch, raconte son expédition avec
Sauvy et Ponty.
1. Voir le chap. premier, p. 23.
2. Entretien avec Gilles Mouellic, sur le site internet, jazzmagazine.com/interviews/Dauj/rouch/
rouch
2. . En swahéli, le mot « safari » renvoie à l’idée du « voyage ».
3. Jean-André Fieschi, « Dérives de la fiction », op. cit., p. 256. L’auteur souligne.
4. J.-A. Fieschi, Dérives de la fiction, op. cit., p. 257.
5. A. Labarthe, Essai sur le jeune cinéma français, op. cit., p. 20. L’auteur souligne.
6. Walter Benjamin : « Une image est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un
éclair pour former une constellation », in « Réflexions théoriques sur la connaissance », Paris,
Capitale du XIXe siècle, le livre des passages, trad. Jean Lacoste, Paris, Le Cerf, 1993, p. 478.
7. « Jean Rouch, maître du désordre », L’Humanité, 14 avril 1999.
8. Extrait de « Tu nous regardes comme des insectes ». Confrontation entre Jean Rouch et
Sembene Ousmane réalisée par Albert Cervoni, France Nouvelle, n° 1033, 4-10 août 1965, in Jean
Rouch ou le ciné plaisir, op. cit., p. 106.
�73
Chapitre 5. L’utopie identitaire
« – Jean Rouch : Je te dis que c’est la seule façon
d’étudier ces gens-là. Il faut s’intégrer dans leur
univers merveilleux, sinon on n’y comprend rien ».
– Jean Sauvy : Peut-être, mais alors ne parle pas de
méthodes “scientifiques”. C’est de l’Art, c’est tout
ce que tu voudras, mais ce n’est en aucun cas
objectif, objectif ! »
Jean Sauvy, Jean Rouch tel que je l’ai connu.
LA « CINÉ-TRANSE »
1
Dans un texte notoire, « La Caméra et les hommes », Rouch a explicité sa méthode de
tournage :
Pour moi, la seule manière de filmer est de marcher avec la caméra, de la conduire
là où elle est le plus efficace, et d’improviser pour elle un autre type de ballet où la
caméra devient aussi vivante que les hommes qu’elle filme. C’est la première
synthèse entre les théories vertoviennes du « ciné-œil » et l’expérience de la
« caméra participante » de Flaherty. (…) au lieu d’utiliser le zoom, le caméraman
réalisateur pénètre réellement dans son sujet, précède ou suit le danseur, le prêtre
ou l’artisan, il n’est plus lui-même mais un « œil mécanique » accompagné d’une
« oreille électronique ». C’est cet état bizarre de transformation de la personne du
cinéaste que j’ai appelé, par analogie avec les phénomènes de possession, la « cinétranse »1.
2
À l’évidence, Rouch situe son cinéma du côté de l’événement, de la révélation, de la
communion. Quelques cinéastes l’ont précédé dans cette voie et s’il désigne lui-même
Vertov et Flaherty, son idée de la « ciné-transe », bien sûr inspirée par les rituels de
possession qu’il filme souvent, a une source cinématographique plus ancienne et plus
spécifique. On la trouve par exemple dans les images de deux films d’expédition
antarctique : celle du commandant Scott en 1911, dont Herbert Ponting a utilisé le
matériel filmé pour réaliser en 1925 The Great White Silence, et celle d’Ernest Shackleton en
1921, dont le film achevé en 1922 a pour titre L’Expédition du Quest.
3
Scott et son équipage, on le sait, ont péri et le capitaine a filmé leur fin. Dans un article de
1925, Belà Balàsz2 revient sur l’événement : « le capitaine Scott dresse une dernière fois sa
�74
tente et y pénètre avec ses compagnons comme s’ils allaient attendre la mort dans leur
tombe : on filme. (…) l’opérateur reste à son poste et tourne jusqu’à ce que sa main gèle
sur la poignée ». Même description pour Shackleton qui, avec ses hommes d’équipage, a
survécu au naufrage de son navire : « le navire est brisé par la pression de la glace : on
filme. Leur dernier chien crève : on filme. La voie du salut se ferme, tout espoir disparaît :
on filme. Ils s’en vont à la dérive sur un bloc de glace, le bloc fond sous leurs pieds : on
filme ». Belà Balàsz fait le constat que « la particularité et la nouveauté de ces films
viennent de ce que ces gens ont regardé la mort en face à travers l’objectif d’une
caméra », et il donne à ce phénomène l’explication suivante :
C’est là une nouvelle forme de connaissance de soi. En se filmant, ces hommes
réfléchissent. « Réfléchir » : d’interne qu’il était, le processus est devenu externe.
(…) Le film du contrôle sur soi, qu’autrefois la conscience faisait défiler à l’intérieur
du cerveau, se trouve entraîné sur la bobine d’un appareil et la conscience qui, en
une scission interne, ne pouvait jusqu’à présent se refléter que pour elle-même
donne cette fonction à une machine qui fixe l’image réfléchie, désormais visible
pour d’autres également. (…). La machine présente l’avantage d’être dépourvue de
nerfs, si bien qu’elle est plus difficile à troubler que la conscience. Et le processus
psychologique s’inverse : on ne tourne pas aussi longtemps que l’on reste conscient,
on reste conscient aussi longtemps qu’on tourne.
4
Balàsz ajoute un peu plus loin un aperçu intéressant sur la finalité de ces films extrêmes,
œuvres de voyageurs anglais : « Consciemment, ils ont le “sens de la terre” (…). Ils
n’habitent pas Vienne, ni Londres : ils habitent le globe terrestre, comme on habite sa
maison, et ils inspectent toutes les caves et tous les combles des biens héréditaires. Car on
reste étranger à un lieu aussi longtemps qu’on ne le connaît pas »3.
5
Les propos de Balàsz se retrouvent quelque peu dans la conception rouchienne de la
« ciné-transe ». Par exemple, l’« œil mécanique » et l’« oreille électronique » sont comme
un écho de « la machine dépourvue de nerfs » évoquée par ce dernier. Par ailleurs, sans
oublier que Rouch, enfant, a été au contact d’Amundsen et de Charcot et qu’il était fasciné
par la banquise au point qu’il l’a filmée en 1987 à bord d’un brise-glace suédois 4, on peut
constater que Scott, Shackleton et lui-même asservissent pareillement les images filmées
à une fin a priori scientifique : explorer les glaces de l’Antarctique dans un cas, les
coutumes africaines dans l’autre. Or, qu’elle soit géographique ou anthropologique, la
science, comme horizon filmique, offre pour certains l’occasion d’un dépassement de soi
allant jusqu’à l’oubli (Shackleton), la déperdition (Scott), la « transe » (Rouch). Qu’est-ce-à
dire ? La caméra, au contact de son opérateur, est impliquée dans des mouvement
humains, physiques et mentaux et, en retour, elle communique à l’opérateur son
fonctionnement mécanique. C’est « l’automate spirituel » dont parlait Antonin Artaud ou
encore, « l’homme à la caméra » tel qu’il est représenté dans la première image du film
homonyme de Dziga Vertov. On peut ainsi imaginer que Scott et Shackleton, menacés de
mourir, mais arrimés à une caméra qui fait corps avec eux, deviennent insensibles à la
réalité de leur corps, aux propriétés et au devenir de ce corps, celui-ci n’étant plus que
l’énergie capable d’actionner le mécanisme de la caméra. Ils n’adhèrent plus en
conscience à leur corps, ils ne l’habitent plus, si bien qu’il devient la possibilité d’une
image, une image quelconque de corps humain en perdition, comme le serait n’importe
quelle image d’un autre corps humain dans la même situation. Figure du détachement
suprême, image de soi devenu un autre, en l’occurrence, dans les deux cas, image filmique
de l’Autre. Pour se convaincre tout à fait de la réalité d’un tel processus, il aurait fallu
demander à Shackleton lui-même d’évoquer son expérience, d’en expliquer les ressorts
physiques et psychiques. La supposition qui en est faite ici sert surtout à cerner la
�75
formule de base du cinéma de Rouch. Il faut peu de temps à ce dernier, en effet, pour
réaliser des films présentant une particularité jusque-là inconnue dans leur domaine
d’expression : ils sont ethnographiques et identitaires, ces deux traits déterminés l’un par
l’autre étant fonction, bien sûr, de la méthode de la « ciné-transe ».
6
Rouch, à la différence de Scott et Shackleton, fait une œuvre de cinéma. L’ethnographie
qui a nourri ses débuts est pour lui trop limitée à la différence de l’anthropologie, qui
ouvre sur un horizon plus vaste. Là où les explorateurs de l’Antarctique s’intéressent à la
nature, Rouch est essentiellement motivé par la figure humaine, par la représentation de
l’être humain dans un cadre filmique. En ce sens, il est un cinéaste parmi d’autres,
ressemblant à la majeure partie d’entre eux, et réalisant des fictions ou des
documentaires. Seulement, mettre en avant comme processus créatif la « ciné-transe »
donne une indication sur la particularité de son projet. Derrière la caméra, il s’agit pour
Rouch de s’identifier à l’objet de la vision. À cet effet, lui, le filmant, et eux, les filmés
devront bel et bien être dans le même état : la transe de possession, « une expérience
intérieure intense » qui les mettra « dans un état de déconnexion avec le milieu propre » 5.
C’est là une forme de transport psychique connue dans toutes les civilisations animistes,
chez tous les sorciers, devins, magiciens, voyants. Tous sont des intermédiaires (médium),
tous participent, via le phénomène de possession, à la constitution « d’un champ
d’immanence du sacré »6, dans lequel l’humain se révèle étranger à lui-même. Or, voilà à
quoi Rouch commence par identifier son désir de faire des films. Comme on l’a vu
précédemment, c’est bien à partir de sa première expérience d’observation d’un rituel de
transe, vécue par lui comme une rencontre initiatique avec l’Afrique inconnue, qu’il pose
les fondements de tout son cinéma à venir. L’enjeu, c’est l’Autre : le possédé en offre la
meilleure incarnation qui soit et du coup, il fait l’objet du fantasme identitaire de Rouch.
Car il s’agit de cela : il ne faut plus seulement approcher et observer les autres en restant
à l’extérieur du cercle dans lequel ils évoluent, il faut entrer dans le cercle, mieux même,
il faut se placer au centre, là où les autres se tiennent, il faut se mettre à leur place, les
incorporer… devenir l’Autre. Rouch se fait un « génie » du cinéma en entrant, justement,
dans cet état de dépossession de soi-même et d’incorporation de l’autre qu’est la « cinétranse ». Les limites ordinaires du cinéma sont désormais caduques : la séparation
traditionnelle des espaces entre le filmant et le filmé n’est plus étanche, leur place peut
s’échanger. Rouch poursuit une utopie fusionnant deux espaces en un territoire unifié à la
fois par l’empathie et la connaissance intime que chacun, en son lieu, aurait de l’Autre. En
1980, le cinéaste nigérien Inoussa Ousséini formulait à cet égard l’hypothèse que chez
Rouch, « un bon anarchiste français (…) il y a cette espèce de fuite vers les autres en
espérant pouvoir trouver un modèle de ce qu’on aurait pu être soi-même »7. L’explication
politique et sociologique permet de comprendre comment « la “ciné-transe” découverte
et mise au point par Rouch est bien une méthode de travail destinée à mettre dans une
corrélation nouvelle la dimension générique de son travail d’ethnologue et l’envie toute
singulière d’une saisie filmique de l’autre, placée sous le signe de la ressemblance idéale,
de l’intimité inaccessible.
7
Par le fait, la « ciné-transe » n’est pas simplement une méthode de tournage qui permet à
la caméra d’adhérer en toutes circonstances à tous les aspects d’une situation ou d’une
péripétie filmées, de faire corps avec la réalité ambiante. Elle est, en outre, le véhicule
idéal des aspirations identitaires du cinéaste, même celles non explicitées par lui. Au
départ, méthode de réalisation peu à peu mise au point dans le cadre d’un travail
d’enquête documentaire filmée en direct, la « ciné-transe » devient vite l’enjeu d’une
�76
stratégie visant à mettre en place un dispositif de miroirs par lequel sera posée, pensée,
représentée la question de l’Autre. L’idée de Rouch est à la fois simple et vertigineuse. Elle
consiste en un déplacement de ses affects de cinéaste sur un ou plusieurs personnages de
ses films. Il bouscule ainsi les termes de la classique vision subjective qui identifie la
vision humaine d’un personnage à celle, plus qu’humaine, non humaine de la caméra. Ici,
c’est sa vision humaine et singulière, néanmoins filtrée par le viseur de la caméra, qu’il
délègue aux personnages filmés, selon un processus que Pasolini appellera un peu plus
tard « la subjective indirecte libre », une posture de la caméra et une tournure
d’énonciation permettant « l’immersion de l’auteur dans l’âme de son personnage »8.
Ainsi, quelles que soient ses activités, sa fonction sociale, ses aventures, le personnage
rouchien typique est ou doit être possédé par la transe qui possède Rouch lui-même. Or,
nonobstant celle effective des Haoukas dans Les Maîtres fous, ou bien celle des Dogons dans
la série des Sigui, il s’agit strictement d’une transe de cinéma et c’est Rouch qui la
transmet aux personnages de ses films, de sorte que l’Autre se projette en lui et qu’il se
projette en l’Autre. La caméra réelle, celle dans le viseur de laquelle il fait ses films et la
caméra imaginaire, celle qui se lève en chacun des personnages comme une puissance
nouvelle de la perception des choses, en sont l’outil ambivalent. On retrouve ici une idée
vertovienne de cinéma, quand, dans L’Homme à la caméra, Vertov identifie le
fonctionnement du diaphragme de l’objectif à la vision clignotante d’une jeune femme,
via un store à lames. L’équation est à trois termes qui font circuler une identité, une
projection identitaire plutôt, entre la vision photographique et la vision humaine. En
déléguant la « ciné-transe » à ses personnages, Rouch instaure un processus semblable.
Moi, un noir est le premier film où on le voit à l’œuvre. Le diptyque de Jaguar et Petit à Petit
en multiplie toutes les possibilités. Dans ces deux films, la « ciné-transe » connaît en effet
un saut qualitatif déterminant, sans doute parce que la germination du personnage
principal de Moi, un noir en cinéaste (imaginaire) est achevée. Les héros de Jaguar (du
moins quand ce film est post-synchronisé par eux en 1967) et Petit à Petit sont à cet égard
parvenus à maturité. Ils peuvent ainsi connaître l’ivresse du détachement de soi que
procure leur maîtrise du processus enclenché, et dépasser ainsi leur statut de double
profïlmique ou intradiégétique du cinéaste. À travers cet écart, que Jaguar rend
extraordinairement sensible pour la première fois dans le cinéma de Rouch et qu’accroît
irrémédiablement Petit à petit, l’anthropologie filmique connaît une mutation
significative. L’Autre, qu’elle approche depuis si longtemps est à son tour capable de
produire de l’Autre. Il élabore, à son tour, des images des êtres, des objets et des lieux, qui
rendront compte de son sens propre de l’altérité. C’est exactement en ces termes que
s’écrivent les scénarios des deux films. Un trio d’amis y circule. Ce sont trois « copains »
nigériens de Rouch, originaires d’un même village, Ayorou. Ils sont les agents d’une
mutation anthropologique pour le moins radicale car c’est à partir d’eux que désormais le
degré de civilisation des êtres est mesuré, littéralement, selon un protocole qui met à mal
l’héritage évolutionniste de l’ethnologie occidentale. D’un film à l’autre, leur trajectoire à
cet égard est exemplaire : dans Jaguar ils constatent que certains Africains sont très
différents d’eux, dans Petit à Petit, des Européens, habitants de Paris, sont devenus leurs
objets d’étude.
�77
JAGUAR
8
Jaguar, tourné en 1954, achevé en 1967, est un film de voyage. L’enjeu initial et la stratégie
du récit, en écho à ceux de Moi, un noir, tiennent en effet à cette idée de Rouch : il voulait
filmer la vie des jeunes Nigériens qui, selon une habitude installée depuis quelques
années, émigraient temporairement en Gold Coast pour gagner de l’argent et ramener des
richesses au village. Il a alors demandé à Lam, Illo, Damouré et à un quatrième comparse,
Tallou, d’entreprendre un vrai/faux voyage. Le périple a duré deux mois et Rouch a suivi
les quatre hommes qui, sur le conseil d’un devin consulté avant leur départ, s’étaient
séparés après leur entrée en Gold Coast. Jaguar condense ainsi en un long-métrage
d’environ une heure trente les péripéties nombreuses d’un voyage de plusieurs milliers
de kilomètres, fait le plus souvent à pied, du moins pour ce que l’on en voit, et qui, de
surcroît, se démultiplie dans le sillage de chacun des protagonistes. Autant dire que le
récit est un montage de moments filmés ici et là, et qu’il comporte des ellipses énormes
pas nécessairement suturées par des solutions de continuité. Le film ne manque pourtant
pas d’esprit de synthèse ni de continuité, obtenu grâce à son unité stylistique, étrange et
paradoxale conquête de la narration dans ce tissu de ruptures.
9
D’abord, les personnages sont les protagonistes d’une fiction qui ne dit pas son nom, plus
précisément, Jaguar est l’équivalent d’un essai romancé. Le modèle idéal de Rouch,
explicité dans Petit à Petit, c’est les Lettres persanes de Montesquieu. Lam, le berger peuhl,
Illo, le pêcheur bozo et Damouré, l’écrivain public songhaï sont, comme les créatures de
Montesquieu, des chargés de mission. Quelle mission ? Quitter leur village, s’éloigner de
leur lieu habituel, aller loin. Pour quoi faire ? Pour être quelqu’un d’autre. Lam devient
marchand de colifichets, Illo mineur et Damouré, chef d’équipe dans une scierie. Ils
traversent des régions où l’on parle des langues locales inconnues d’eux, ils séjournent en
Gold Coast où l’anglais, langue officielle, remplace le français, ils se baignent pour la
première fois dans la mer, ils parcourent des montagnes verdoyantes. Ils pourraient alors
être des touristes mais le film a choisi pour eux une autre destinée. Chacun est sorti de
chez soi pour s’adonner sous l’objectif de la caméra de Rouch, à la réinvention de son
territoire propre. Les trois amis traversent en effet le monde qui s’offre à eux pour le voir
et le faire voir dès lors qu’eux-mêmes ont endossé une identité nouvelle, placée sous le
signe de la complexité, voire de l’ambiguïté. En effet, au moment du tournage en 1954, ils
sont les co-auteurs (avec Rouch) d’un scénario d’émigration semi-improvisé dont ils sont
aussi les acteurs. Damouré pousse ce double jeu plus loin en se mettant imaginairement
dans la peau d’un explorateur. Au moment du doublage en 1967, il retrouve ce rôle mais il
y ajoute une autre composante : il se pose ici en ethnologue, entraînant d’ailleurs ses amis
dans ce sillage identitaire, à l’horizon duquel ne se laisse pas oublier la personne même de
Rouch. Cette insolite et intéressante sublimation des protagonistes du film passe
essentiellement par la parole. Postsynchronisée longtemps après le tournage, selon la
procédure du feed-back mise au point pour Moi, un noir1, elle vient après coup, comme un
plan de réalité qui se superpose à celui des images tournées en direct, treize années
auparavant. En effet, Damouré et ses compagnons, dans la coulisse du studio de
sonorisation, réinvestissent moins leur place de personnages qu’ils ne deviennent les
commentateurs du film. Le résultat est saisissant, du moins pour un spectateur européen.
Plusieurs épisodes prennent en effet un tour incongru, voire surréaliste, scandaleux peuton dire, essentiellement parce qu’ils font soudain émerger une nouveauté en mettant en
�78
désordre les données qui caractérisent habituellement les relations du couple filmant/
filmé, observateur/observé.
10
L’exemple le plus extrême, à une vingtaine minutes du début du film, est sans doute cet
épisode où les trois protagonistes, arrivés au nord du Dahomey, rencontrent les Sombas,
un peuple d’agriculteurs qui vivent nus. Les images paraissent ne montrer rien d’autre
que la confrontation de deux sortes contrastées d’Africains, ceux dont la colonisation a
occidentalisé l’apparence et le comportement, et ceux qu’elle a – semble-t-il – oubliés
dans leurs confins retirés. Les vêtus et les nus, comme paradigme de base de la scène
coloniale. Mais un tiers s’est glissé sur cette scène, est venu en compliquer le dispositif.
Damouré et Lam échangent des commentaires qui ne s’arrêtent pas à leur vision un peu
embarrassée des Sombas. De surcroît, Damouré cherche une explication à leur nudité. Il
entre alors de plain-pied à la fois dans le relevé ethnographique et dans le discours
anthropologique. Il donne la mesure du processus lorsque au tout début de l’épisode, sur
l’image en plan rapproché d’une jeune femme portant un plateau de nourriture, on
l’entend dire à Lam, invisible comme lui : « A l’école on m’a appris que les Sombas c’est
des gens du Dahomey mais qui n’aiment pas les vêtements ». L’autoportrait de Damouré
en homme lettré (il a choisi pour le film de jouer le rôle d’un écrivain public) est encore
plus significatif quand on le voit s’avancer au milieu des Sombas, vêtu de la veste de coton
et du chapeau de brousse qui lui confèrent l’allure typique du colon blanc. Le reste de la
séquence, qui dure un peu plus de trois minutes, est de la même eau, où se mélangent le
sérieux d’observateurs appliqués à bien faire et l’humour de voyageurs en goguette. Par
exemple, conversation de Damouré et Lam sur l’image un peu sous-exposée d’un jeune
Somba à l’étui pénien bien visible : Lam – « Tu vois quelque chose en bas, blanc ? ».
Damouré, mi goguenard, mi-pontifiant – « C’est sa machine, c’est son affaire, quoi ! ».
Damouré, poursuivant, peu après, sur l’image de femmes « complètement nues » : « Si tu
arrives dans un pays, c’est le pays qui te change et c’est pas toi qui changes le pays ». Un
peu plus tard, question de Lam à Damouré, sur l’image d’un vieil homme esseulé dans le
cadre : « Tu as vu le vieux, là ? ». Réponse de Damouré : « Oui. Il n’est pas du tout content
qu’on le regarde ! ». Et pour finir, Damouré fait la leçon à ses amis Lam et Illo : « Les
Sombas sont des gens vraiment gentils. Vous voyez, Lam et Illo, ce n’est pas parce qu’ils
sont nus qu’il faut se moquer d’eux. Le bon dieu a voulu qu’ils soient comme ça, comme
chez nous, le bon dieu a voulu que nous portions des vêtements. C’est des frères, comme
nous. ». Lam et Illo, en chœur : « Nous sommes d’accord ton parole ». Puis, les trois amis
disent un sonore « au revoir les Sombas » et partent poursuivre leurs aventures ailleurs…
On se croirait presque chez Hergé, en compagnie de « Tintin au Congo ». Mais Tintin est
africain !2
11
Le scandale, à la mesure peut-être de celui qui se rencontre dans Les Maîtres fous, est que
deux Nigériens observent des Africains depuis un lieu qui jusque-là était seulement
investi par l’homme occidental, l’Européen, aussi bien le colon dirigeant le pays que le
savant étudiant les mœurs locales ou le reporter en quête d’aventures exotiques. Bien sûr,
le spectateur de Jaguar sait que la conversation de Lam et Damouré, enregistrée à la fin
des années soixante, retentit dans une Afrique qui n’est plus coloniale. Mais elle n’est pas
si « indépendante » que les discours officiels le proclament et Damouré, qui a fréquenté
l’école française, paraît un modèle d’acculturation, comme le montre une scène du film.
Devenu chef d’équipe – son patron ayant vérifié qu’il sait compter des planches de bois –
Damouré recrée avec les ouvriers l’exacte relation du maître (colon et blanc) et du
serviteur (colonisé et noir) en molestant et en insultant les hommes de son équipe, sans
�79
autre motif que de faire une démonstration de force. Perplexe, le spectateur a peu
d’éléments pour discriminer entre deux interprétations de la scène : est-elle sérieuse ?
est-elle parodique ? Damouré se prend-il réellement pour un petit chef ? Ou bien, en bon
acteur d’une satire, bro-carde-t-il l’autorité coloniale encore en place lors du tournage du
film ? Damouré en Africain acculturé est en fait l’image qui se forme au contact de deux
mondes réfléchis l’un par l’autre : le monde imprenable, non figuré, d’où provient le
cinéma de Rouch et le monde rencontré par ce cinéma. Ou encore, Damouré, l’Autre de
Rouch, trouverait son reflet le plus exact, à la fois dans Lam qui, en lieu et place de
l’explorateur blanc d’autrefois, s’interroge sur le degré d’humanité des Sombas (Lam : « Je
suis arrivé ici. Je vois les Sombas mais je ne suis pas sûr que ce sont des hommes ») et à la
fois dans cette image, fugitive et pourtant inoubliable : un jeune Somba, vu en plan-taille,
a pour tout vêtement la monture en plastique blanc de lunettes sans verres, en forme de
cœur, élégamment posées sur son nez. Cet accessoire dérisoire et formidablement
incongru exerce une attraction irrésistible sur le regard du spectateur. Or, il semble bien
que l’attraction se soit d’abord exercée à la fois sur les protagonistes de Jaguar et le
cinéaste lui-même. De Rouch au Somba, via Damouré et Lam, quelque chose a circulé, un
bien commun dont les lunettes, détournées de leur fonction propre, sont le parfait
révélateur. Pas besoin de verres en effet pour qu’à travers elles se forme l’image de ce qui
est déplacé, à tous les sens du terme.
12
Pendant leur séjour en Gold Coast, les trois compères ont transformé le petit commerce
forain de Lam en une société dont ils calligraphient le nom sur un panneau de bois,
accroché en haut de l’échoppe. La société s’appelle : « Petit à petit l’oiseau fait son bonnet ».
Fin du film : on arrête le commerce, on plie bagages, on démonte le panneau…
PETIT À PETIT
13
Seize années plus tard, en 1970, les trois associés (imaginaires) sont devenus riches et plus
particulièrement, Damouré a pris l’embonpoint (réel) d’un homme d’affaire prospère.
Désirant construire un immeuble assez grand pour y loger leur société, ils repartent en
voyage, à Paris cette fois, en vue d’y étudier l’architecture des immeubles « à étages ».
Située comme dans Jaguar à environ vingt minutes du début du film, un épisode concentre
au plus haut point les vertus subversives de l’ethnographie revisitée par Rouch et ses
« copains », ses complices, en fait. Damouré est le personnage principal de la séquence. En
imperméable et en chapeau, ainsi vêtu à la semblance de n’importe quel passant parisien,
il sort de son hôtel, il marche, puis, coup sur coup, il arrête plusieurs personnes pour leur
adresser la même demande saugrenue : peut-il prendre leurs mesures ? La même question
est répétée dans des circonstances différentes. Il dit « mademoiselle » à la première
personne rencontrée, alors qu’il s’agit d’un homme à la tignasse bouclée. Immédiatement
après, il dit « monsieur » à une jeune femme dont les cheveux sont ramenés sous une
casquette. Avec les deux suivants, une jeune fille et un homme d’âge mûr, il ne se trompe
pas d’interlocuteur. Le spectateur sait que la méprise de Damouré est un gag, un procédé
comique pour critiquer les mœurs françaises, tout à fait à la mesure de la forme d’humour
qui caractérisait ses propos dans Jaguar et qui semble alors être entièrement de son cru.
Mais Damouré n’est pas qu’un humoriste, il est aussi le chargé de mission de Rouch, pour
le film où il se fait à son tour ethnographe. C’est ainsi qu’on le voit sortir un appareil avec
lequel il prend les mesures censées alimenter son enquête. Il mesure le tour de tête et la
largeur d’épaules du premier jeune homme, le tour de poitrine et le tour de taille d’une
�80
jeune fille. Il leur demande leur lieu de naissance, celui de leurs parents, leur âge. A leur
questionnement respectif sur sa démarche, il répond d’abord qu’il fait « de l’ethnographie
pour la télé », puis qu’il est « étudiant « et qu’il lui « manque une mesure pour obtenir
[s]on diplôme ». Il pousse la plaisanterie encore plus loin, lorsque, dans la deuxième
partie de la séquence, il demande à une jeune fille de lui montrer ses dents : « Je suis
ethnologue, j’ai besoin de voir les dents d’une demoiselle pour avoir mon diplôme ». Elle
accepte, il compte ses dents abîmées : « ah là là, dix dents foutues » et il rassure la jeune
fille inquiète, comme s’il était dentiste : « ce n’est pas grave, ce n’est rien ». À la dernière
personne interviewée par lui, un homme d’âge mûr, il demande même des explications
sur ses vêtements : nom, couleur, nature du tissu, etc. Il ne rencontre qu’un seul
récalcitrant, un jeune homme fâché qui lui demande brutalement : « vous avez votre
carte ? ». Tout est si simple et si excessif que le spectateur est à même de comprendre
d’emblée que chaque rencontre est une partie d’un scénario, préparé comme dans
n’importe quel film de fiction. D’ailleurs, s’il est cinéphile, il peut reconnaître dans les
figurants des personnes connues du milieu cinématographique ambiant. Par exemple,
deux d’entre eux sont des critiques liés aux Cahiers du Cinéma : Sylvie Pierre et Michel
Delahaye1. La séquence apparaît ainsi pour ce qu’elle est, comme tout le reste du film
d’ailleurs : une valise (non) diplomatique retournée à l’expéditeur, ou encore, en termes ô
combien cinématographiques, une histoire « d’arroseur arrosé ».
14
Pourtant, si le schéma de la subversion est clair, quelque chose ne l’est pas et porte sur ce
film apparemment lumineux une ombre, qui se retrouve d’ailleurs dans toutes les fictions
africaines de Rouch : qui est la cause véritable des situations créées, des propos
entendus ? Les protagonistes qui seraient alors en roue libre, ou Rouch qui les
téléguiderait à sa convenance ? Il n’y a pas de réponse qui fonderait une vérité définitive
à cet égard, on a plutôt affaire à une œuvre de cinéma dont les processus mêmes de
réalisation provoquent justement le doute. A y bien regarder, en effet, le spectateur voit
que la « ciné-transe » de la caméra portée est un leurre analogique, semblable par
exemple aux « appelants » utilisés par les chasseurs ; s’il écoute bien, il entend que
Damouré ou Lam redisent des paroles déjà dites, et pourquoi pas par Rouch lui-même qui
les leur aurait ainsi soufflées ? Cette ambiguïté dérange la ligne de partage entre le
documentaire et la fiction au cinéma et elle contrevient aux fondements mêmes de
l’observation ethnographique ou sociologique qui s’établit sur le constat de faits réels,
ceux-là même qui constituent, comme dans les autres films de Rouch, le fonds
authentique sur lequel s’enlève la fiction de Jaguar et celle de Petit à petit.
15
Ainsi, la subversion n’est pas seulement dans la caricature, somme toute simpliste, de
l’ethnologue blanc par l’ethnologue noir, d’autant plus qu’ici, rien n’est sûr quant à
l’identité même du caricaturiste si bien qu’aucune vérité n’est établie, de quelque point
de vue que ce soit. C’est que le dispositif intrafilmique est plus complexe, plus subtil en
tous cas qu’il n’y paraît et produit des effets variés à plusieurs niveaux du récit comme la
péripétie marquant une césure au beau milieu de la séquence. Damouré marque en effet
une pause dans son enquête. Il est sur l’esplanade du Champ-de-Mars, avec en fond, bien
visible, la tour Eiffel. Il consulte son carnet, énumère à voix haute les mesures qu’il y a
reportées : « 22 … 47 … 54 … 18 … 17 … 16 », et il (se/ nous) parle : « En réalité, les
Parisiens ils sont pas beaux. D’abord ils sont trop petits, ils sont pas tellement gros, ils
sont vilains, avec des grosses jambes. Ça ne vaut rien ! » Ainsi, son commentaire s’égare-til au-delà du jeu de correspondances instauré entre lui, ethnologue fictif et son modèle,
n’importe quel ethnologue occidental. L’ethnologie n’est pas censée en effet déprécier les
�81
sujets qu’elle observe et si elle procède bel et bien à leur estimation, c’est sous le couvert
du jugement scientifique.
16
Or, le discours de Damouré, d’une subjectivité si flagrante qu’elle en paraît outrancière,
est en réalité le pendant parfait d’un discours scientifique. Plus précisément, Damouré ne
parle pas ici seulement en tant que lui-même, sa singularité est celle – bien commune –
d’un Nigérien vivant dans un monde où la plupart des gens sont très minces, de même
que l’ethnologue lambda vit dans un monde en majorité blanc. Une autre péripétie de la
séquence amplifie le processus. En passant devant un café, Damouré s’en prend aux
jeunes femmes attablées derrière la vitre, il les trouve jolies mais habillées de manière
inconvenante. Qui s’exprime à travers lui ? Un authentique villageois africain, musulman
de surcroît, ou un non moins authentique acteur du film de Rouch ? Sa critique virulente
est-elle sincère, est-elle feinte ? Pas de réponse appropriée à ces questions mais en
revanche, un effet est obtenu à coup sûr : l’Autre ce n’est pas l’étranger, l’Africain venu de
loin, c’est notre concitoyen, le Parisien aux grosses jambes, la Parisienne aux mauvaises
dents ou à la jupe trop courte. La figure même de l’Autre ici construite et proposée par
Damouré est inédite parce qu’il est à Paris non seulement en tant qu’alter ego du cinéaste
enquêteur mais encore en tant que lui-même, choqué par la morphologie, la dentition ou
les vêtements des parisiens. S’il incarne une espèce nouvelle de personnage filmique c’est
bien parce que son regard est nouveau. Or, qui dit nouveau sujet du regard dit nouvel
objet regardé : c’est le Parisien de l’ethnographie africaine dont se prend à rêver le
cinéma de Jean Rouch, survivance ou prolongation de ceux déjà esquissés en tant que tel
par Edgar Morin et lui-même dans Chronique d’un été.
17
À Paris en 1970, Damouré est l’héritier de l’explorateur de l’Afrique qu’il était en 1954. Par
le fait, Petit à Petit, sorti du « bonnet » qu’avait tissé Jaguar, met en place les derniers
rouages d’un nouveau dispositif d’approche cinématographique de l’Autre. Le mécanisme
parachevé est fondé sur un jeu de comparaison dont les termes créent des identités
surprenantes. D’un côté, il y a Jaguar et l’observation des Sombas par un Africain. De
l’autre, il y a Petit à Petit et l’observation des Parisiens par ce même Africain. Le résultat de
l’équation est le suivant : via Damouré, leur plus petit commun dénominateur, un Somba
égale un Parisien et un Parisien égale un Somba. Mais tout n’est pas dans tout, l’identité
des Sombas et des Parisiens n’est pas quelconque, n’est pas généralisable, en tout cas, à
des catégories plus vastes d’êtres humains, pas plus qu’elle ne s’applique en tout à chaque
Somba et à chaque Parisien. Elle est une création du cinéma, non une réalité en soi, elle
est une vue du cinéma, exactement comme on dit d’une opinion qu’elle est « une vue de
l’esprit ». Phénomène banal, auquel le cinéma a habitué ses spectateurs depuis
longtemps, y compris le cinéma documentaire lorsque le montage lui sert à inventer à
partir d’éléments réels des objets dont la réalité n’est que filmique. Les remarques
pseudo-savantes sur les Sombas ou l’appareil à mesurer les Parisiens sont eux aussi des
opérateurs de fiction dans un milieu pourtant bien réel. Mais Jean Rouch fait des films
avec des Africains et chaque film, documentaire ou fictionnel, est censé contribuer à une
meilleure connaissance de ces derniers. Or, à cet égard, Rouch n’observe pas la réalité
telle qu’elle est, il lui applique la force identificatoire de son imagination si bien qu’il
parvient à la faire inventer par les protagonistes mêmes de ses films. C’est là une des
raisons essentielles de la défiance qu’il suscite tantôt chez des Africains qui ne se
reconnaissent pas dans l’image que ses films donnent de certains d’entre eux, tantôt chez
des ethnologues qui récusent les fantaisies de sa méthode d’approche, les uns et les autres
étant parfois amenés à le soupçonner d’être un manipulateur. Et sans doute la
�82
manipulation, peu acceptable au regard des exigences strictes des sciences humaines et
celles du cinéma documentaire ou encore des nécessités établies en matière de relations
politiques, est une des vérités de son art filmique. Pour commencer, d’ailleurs, on y
trouve la manipulation cinématographique par excellence, celle du montage.
NOTES
1. Jean Rouch, « La Caméra et les hommes », in Pour une anthropologie visuelle, op. cit., p. 63.
1. Voir infra, pp. 149.
1. Sylvie Pierre a été critique pour les Cahiers du Cinéma entre 1966 et 1971, alors qu’elle
séjournait au Brésil. Elle est actuellement membre du comité éditorial de la revue Trafic. Michel
Delahaye est entré aux Cahiers du Cinéma en 1959. Il a notamment rencontré Claude Lévi-Strauss,
Roland Barthes, Cari Dreyer. Puis il est devenu acteur, dans, entre autres films, L’Amour fou et La
Religieuse (Jacques Rivette), Femmes Femmes (Paul Vecchiali), Simone Barbes ou la vertu (M.-L.
Treilhou), La Révolution est un coup de dés (les Straub), Brigitte et Brigitte (Luc Moullet), Offre d’emploi
(Jean Eustache).
2. Article publié le 22 mars 1925 dans Der Tag, repris dans Le Génie documentaire, revue Admiranda
n° 10, op. cit., pp. 12-13. Toutes les citations suivantes sont extraites de ce texte (trad. Marielle
Carlier).
2. Déclaration de Rouch : « Dans Jaguar j’ai essayé, derrière l’idée même de voyage, disons de
dépasser le journal “Tintin” pour tomber quelque part du côté de Diderot… ». Les Cahiers du
Cinéma, n° 144.
3. Rouch pousse l’idée plus loin lorsqu’il explique que le tournage de Moi, un noir, sa première
fiction, alimentée par une connaissance intime des lieux et des gens, lui a fait découvrir que « le
cinéma a été pour [lui] la remise en question de ce qu’avait été l’ethnographie, c’est-à-dire
l’étude d’une population que l’on connaît bien, mais qui reste étrangère ». Site perso.wanadoo.fr/
cine.beaujolais/rouch.htm, p. 2-6 sur 8.
4. Son court-métrage, Bateau-givre, filmé en 35mm, est un des trois épisodes d’une production
franco-suédoise, Brise-Glace. Raoul Ruiz a signé le troisième épisode, Histoires de glace.
5. Jean-Marie Gibbal, Les Génies du fleuve. Voyages sur le Niger, Paris, Presses de la Renaissance,
1988, p. 127.
6. Ibid.
7. Entretien avec Pierre Haffner, repris dans Jean Rouch ou le ciné-plaisir, op. cit., p. 102.
8. P. P. Pasolini, L’Expérience hérétique, Paris, Ramsay, coll. « Cinéma », 1989 (réed.), p. 26.
�83
Chapitre 6. Le montage
1
On voit bien, à écouter Rouch et à regarder ses films, qu’il se soucie peu du montage en
soi. Dans la plupart de ses films, tournés selon les strictes méthodes du cinéma direct, le
montage intervient pour donner au bout à bout initial une forme maîtrisée qui rend
lisible la continuité d’événements filmés au fil de leur déroulement, avec des ruptures et
des sautes dues aux aléas des événements réels et à ceux des tournages. Les ellipses,
nombreuses, récurrentes, n’ont pas d’autre fonction que d’assurer la cohérence
temporelle en restaurant une continuité filmique imaginaire. Or, un premier phénomène
vient contredire ce qui semble ici un degré zéro de l’emploi du montage comme médium
spécifique de l’écriture filmique. La continuité temporelle n’est pas nécessairement
assurée par le montage plan à plan. La dimension visuelle (et sonore) des raccords ne fait
pas système dans le cinéma de Jean Rouch. Ou pour le dire autrement, ce dernier ne
craint ni le bon ni le mauvais raccord, en dépit de certaines déclarations contraires 1. En
fait, sa désinvolture en la matière met son cinéma en contact immédiat et intempestif
avec le faux-raccord, susceptible de rompre l’impression d’homogénéité du récit, d’en
fracturer la continuité. Ce phénomène est d’autant plus déroutant que tous les films
suivent le fil unifiant d’une narration chronologique. En ce domaine, Rouch attire une fois
encore la comparaison avec Rossellini. Ce dernier n’avait cure d’afficher sa modernité au
moyen d’une forme filmique. Notamment, le plan-séquence et le faux-raccord, deux
caractéristiques majeures de son cinéma, ne sont pas réductibles à des choix stylistiques
car il n’a pas plus de goût pour les plans longs que pour les plans courts, pour les raccords
modernes que pour les raccords traditionnels. Les formes rosselliniennes en rupture avec
des codes bien établis adviennent selon une nécessité spirituelle ou ontologique, elles
s’imposent, en fait, comme le seul parti pris possible pour assurer au mieux l’adéquation
entre la vérité des situations filmées et la justesse de l’art qui les transfigure 2. Chez
Rouch, l’adéquation entre les deux repose éventuellement sur d’autres bases mais le but
atteint, sinon recherché, est le même car les situations vécues lors des tournages
imposent et impriment leur marque expressive aux films. Le montage final, qui fait tenir
ensemble toutes les particules filmiques dont sont faits les récits, est une simple
opération technique destinée à assurer la viabilité des films dans le circuit des salles de
projection. Il ne procède pas d’une intention distincte par laquelle il imposerait son
primat sur la matière filmée. Il ne cherche pas à se faire reconnaître comme tel... Oui et
non cependant. Nombreux sont les films de Rouch qui font un usage minimaliste du
�84
montage. D’autres, en revanche, sont créatifs à cet égard. C’est notamment le cas de
Chronique d’un été.
CHRONIQUE D’UN ÉTÉ
2
Dans ce film, le montage réorganise en profondeur la continuité des images enregistrées
lors du tournage. Le rapport entre la longueur des rushes (vingt-cinq heures) et celle du
film achevé (une heure trente) dit assez à quel point le montage est intervenu dans
l’organisation de l’œuvre. Par ailleurs, le film est issu d’une confrontation entre ses deux
auteurs. Morin souhaitait un système d’oppositions réglées entre le général et le
particulier, élaborant ainsi une « structure » pour les différents thèmes abordés. Rouch,
lui, plaidait pour « un montage chronologique en fonction du tournage plutôt qu’en
fonction du sujet »3. Après intervention de la production , Jean Rouch finit par tirer cette
conclusion intéressante : « Le co-auteurisme (...) est un jeu violent où le désaccord est la
seule règle, et la solution dans la solution de ce désaccord. Encore faut-il que l’arbitre (ou
le producteur) ait l’esprit assez libre pour suivre la partie en sanctionnant les seules
fautes. Hélas, un producteur de film, coincé entre le mécénat d’artistes insupportables et
les impératifs financiers, ne peut pas être impartial »4. Que Chronique d’un été soit le
résultat hybride d’une double tension, l’une entre les auteurs, l’autre entre le producteur
et les auteurs, contribue ainsi à le distinguer car la chronologie décrétée par le tournage
n’impose plus sa loi au montage. Celui-ci est conçu selon d’autres nécessités qui, tout en
étant contraignantes, libèrent paradoxalement le film du réalisme documentaire. Les
vingt-cinq heures de rushes n’ont pas été simplement réduites à l’échelle ordinaire d’un
long-métrage, elles sont devenues une pâte d’espace-temps malléable qu’une opération à
la fois intellectuelle et artistique a transmuée en un récit dont l’apparence chronologique
est une illusion purement cinématographique. Cela ne serait que banal si Chronique d’un
été n’était pas un film d’observation documentaire, attaché, semble-t-il, à suivre au plus
près et au plus juste, les situations provoquées par l’enquête à laquelle sont soumis les
protagonistes dans la réalité.
LES MAÎTRES FOUS
3
Depuis le tournage de son premier film, Rouch est habitué à un protocole de tournage qui
allie l’art de l’instant, requis par l’improvisation, à la science de la durée, liée à
l’observation. Il prend ainsi le parti de filmer dans une continuité telle, que le montage de
ses films se fait déjà au tournage. Sa fonction d’opérateur de prise de vue lui permet
d’être « le premier spectateur » du film en train de se faire devant l’objectif. Il le construit
– dit-il – « à la caméra », après quoi, il a recours à « un deuxième spectateur », le monteur.
Celui-ci « doit être quelqu’un qui n’a pas assisté au tournage »5. Or, il lui arrive d’opter
pour un montage en conflit flagrant avec la continuité diégétique du récit. Cas exemplaire
d’une telle démarche : Les Maîtres fous. « Glossolalie », tel est le terme utilisé par Rouch
lui-même pour évoquer cette œuvre si marquante dans sa filmographie. La « glossolalie »
n’est pas seulement une langue inconnue que parleraient les protagonistes du film,
plongés dans une transe de possession6, elle désigne aussi le rapport du cinéaste en
personne à ce qu’il voit dans le viseur de sa caméra. En effet, s’il connaît en théorie le
culte voué aux divinités nouvelles que sont « les maîtres fous », il ne saisit pas tout ce
qu’il voit, il ne comprend aucune des paroles prononcées, si bien qu’il ne sait rien ou pas
�85
grand-chose du scénario en train de se jouer devant lui. Il tourne alors sans idée
préconçue de la suite, à laquelle il doit pourtant rester attentif, afin d’en accompagner au
plus près les péripéties probables mais quelque peu imprévisibles.
4
On connaît la trame du film, son argument à la fois anthropologique et sociologique.
Pendant le tournage de Bataille sur le grand fleuve, Rouch, qui étudiait les rituels de
possession, était entré en contact avec les Haoukas, officiants d’un culte dévolu à des
dieux nouveaux. Lors d’une projection du film à Accra, des prêtres haoukas l’ont convié à
filmer leur rituel annuel qui devait avoir lieu deux mois plus tard. C’est ainsi que le film
Les Maîtres fous est au départ une commande venue du terrain ethnographique lui-même !
Rouch a évoqué en détails, à plusieurs reprises, le tournage du film qui s’est fait en direct 7
. Sur place, il procède selon des habitudes désormais acquises. Chaque bobine de sa
caméra dure vingt-cinq secondes, il lui faut remonter celle-ci toutes les trois minutes, ce
qu’il fait « très doucement parce que [sa] théorie, c’est quand on remonte, on réfléchit ».
Il ne choisit pas la personne à filmer. « Tout d’un coup, elle rentrait dans le champ par la
droite ou par la gauche et [il] la suivai[t] » pendant le bref laps de temps permis par la
longueur de la pellicule. Par ailleurs, il fait procéder à un enregistrement sonore grâce à
« un micro accroché à un arbre », relié à un magnétophone dit « portatif », mais très
lourd en réalité (40 kg !) et qui « avait environ trente minutes d’autonomie ». Le tournage
dure une journée. Ainsi, dans le moment même où il est le spectateur de péripéties
« impressionnantes » auxquelles il lui arrive de ne rien comprendre, notamment celle du
sacrifice du chien, il les filme dans leur évolution chronologique et linéaire, avec les
ruptures et les hiatus imposés par les contraintes techniques. À Paris, la monteuse du
film, Suzanne Baron, organise le récit en suivant la chronologie originelle, celle que
Rouch lui demande de respecter. Or, la bande sonore pose un problème car le micro a
enregistré toutes les sources sonores, y compris la caméra qui fait « le bruit d’un moulin à
café ». C’est alors que le montage intervient comme un deus-ex-machina : « il fallait
supprimer [le bruit de la caméra] mais on pouvait prendre le son des plans qui s’étaient
passés disons vingt secondes avant ou vingt secondes après, puisque l’enregistrement
était continu. Et on a monté le film de cette manière ». Le décalage ainsi instauré entre
l’enregistrement des situations visuelles et leur accompagnement sonore installe
d’emblée dans ce pur document qu’est Les Maîtres fous, un type d’adéquation entre le réel
et son image qui ressortit à la fiction. Les « puissances du faux » font déjà leur œuvre de
vérité. Mais ce n’est pas tout. Rouch ajoute au document filmé en direct deux autres
déterminations non immédiates.
5
D’abord, le commentaire en voix off. Pendant la première projection au Musée de
l’homme, le cinéaste commente le film sur place, sans texte. Puis, en travaillant avec « un
ingénieur du son de la vieille école du cinéma optique », André Cotin, il s’initie à
l’enregistrement de sa propre voix dans un micro. Notamment, en mettant « une octave
en moins dans la voix », il adopte un « ton de confidence ». Enfin, contredisant
radicalement l’immédiateté du tournage en direct, il répète son texte jusqu’à le connaître
« par cœur », persuadé, selon la théorie du théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud, qu’à
force de répétition, « à un moment donné [on est] le personnage du rôle ». Oui, Rouch
s’avance déjà dans un territoire de l’expression de soi qu’il va de plus en plus investir, en
partie pour satisfaire son besoin d’identification à l’autre, l’Autre que représentent les
protagonistes de ses films à venir. Eux aussi, rappelons-le, se muent en acteurs et
deviennent des personnages de cinéma dès lors qu’ils prennent la parole pour dire dans
un micro ce qu’ils sont en train de faire, de penser, de ressentir.
�86
6
Ensuite, et surtout, intervient une autre détermination du film par le montage, plus
marquante – du moins en apparence – que la précédente : ce sont des ruptures
diégétiques. Cet aspect du film est très connu, peut-être parce qu’il a cristallisé des
réactions très négatives, violentes même, dès sa première projection, pour des raisons qui
n’ont pas grand-chose à voir avec le cinéma, mais qui sont d’ordre idéologique et
politique8. Rouch a en effet introduit dans le tissu narratif, qui se présente comme le
reportage en continu d’un rituel de transe, des images hétérogènes : la relève de la garde
devant le palais du gouvernement, la sortie de la messe, la reine Elizabeth d’Angleterre
dans son carrosse. Or, la Gold Coast, habitée par de nombreux Européens, est une colonie
britannique. Ainsi, les images insérées parmi celles de la transe des Haoukas proviennent
d’un monde totalement différent de celui des Haoukas et en même temps, tout à fait
proche. L’hétérogénéité des images qui le représentent apparaît alors comme doublement
pernicieuse. D’abord, la procédure de leur insertion dans le film, qui relève de la figure
classique du montage parallèle, crée une comparaison immédiate entre les Haoukas et les
Européens. Or, la comparaison a un impact d’autant plus fort, elle est d’autant plus
gênante qu’elle résonne sur la possible confusion que le titre même du film invite à voir –
sous la bannière unique du rite social – entre les faits vécus par les uns, les servants noirs
d’un culte animiste et les autres, les maîtres blancs et les serviteurs noirs de l’ordre
colonial. À cet endroit, le film dit très clairement, en effet, une sorte de vérité
proprement scandaleuse : entrer en transe, baver et se contorsionner comme un
épileptique, boire du sang et manger un chien ne sont pas des postures et des gestes
moins ordinaires ou plus extraordinaires que d’aller à la messe, de chevaucher dans un
défilé militaire ou encore d’acclamer une reine, un grand « chef coutumier » parmi
d’autres.
7
Mais le montage parallèle qui crée la collusion entre deux mondes hétérogènes, va plus
loin que cet effet, déjà à l’œuvre dans toute une tradition du cinéma idéologique, en
particulier celle de Vertov et d’Eisenstein. Il n’y a pas de métaphore dans le film de Rouch.
ÔAu contraire, les deux mondes d’images parallèles existent dans une proximité à la fois
littérale et béante, alors que leur réalité de fait et leur actualité dans la représentation
sont de même nature. Ils se déploient, en effet, dans un même espace-temps du récit, mais
à côté l’un de l’autre, irréductibles l’un par l’autre, sans une solution de continuité qui
rendrait leur représentation homogène. Leurs composants sont différents, comparables
mais distincts, ils ne sont pas apparentés par une isomorphie généralisée, comme par
exemple dans le montage organique d’Eisenstein. Le seul endroit du film où existe un
phénomène de réelle continuité concerne les Haoukas eux-mêmes. À la fin du rituel, et du
film, ils rentrent chez eux et le lendemain, ayant retrouvé leur apparence propre, ils
reprennent leurs activités quotidiennes, se rangent à nouveau parmi les humains
ordinaires. Ainsi les Haoukas sont doubles, comme tous ceux qui, à la faveur de la transe,
sont visités par un génie. Leur dédoublement est lui-même complexe puisqu’ils
s’incarnent en des figures empruntées à des êtres qui vivent en réalité près d’eux, comme
une troisième incarnation : le docteur, le général, le conducteur de la locomotive, etc. A
travers chaque Haouka possédé, tout un monde de représentations mentales, religieuses
et politiques prend corps et sous les yeux du spectateur, s’unifie dans l’espace-temps du
rituel qui les a rassemblés et qui, par la même occasion, a procuré au film sa propre unité
de temps et d’espace. Celle-ci est contenue dans une journée et un lieu, exactement
comme une pièce du théâtre classique. Mais il se trouve que le film, qui n’est pas borné à
la seule représentation du rituel haouka, n’a pas la clôture narrative et dramaturgique
�87
d’une pièce de théâtre. Un dehors vient se greffer sur le noyau central, sans se raccorder
pour autant dans la sphère même de la représentation. Ici règne la différence inaliénable
qui assemble entre elles les parties d’un monde inorganique. A cet égard, Les Maîtres fous
va bien dans le sens de l’histoire. La fin de l’ère coloniale est proche en effet, le couple
colonisateur/colonisé est au bord du divorce. Les administrateurs blancs n’ont plus en
face d’eux de simples administrés noirs, mais des êtres autonomes, les Haoukas qui, dans
un geste typique d’indépendance, sont désormais capables de tendre à leurs maîtres
colonisateurs un miroir dans lequel se reflète leur image déformée, révélant la vérité de
leur grimace. Chaque partie du couple brisé peut ainsi redevenir une singularité valant
pour elle-même.
8
Quatre années après Les Maîtres fous, Rouch réalise Moi, un noir où le montage est utilisé à
nouveau comme un levier expressif spécifique. La nature même du travail accompli par le
montage a changé, sans doute parce que le film est une fiction. Mais quoi qu’il en soit, les
puissances du montage expérimentées dans Les Maîtres fous viennent nourrir la
disposition stylistique si singulière de Moi, un noir. Ce qui était apprécié par Rouch luimême comme le bricolage d’un apprenti cinéaste est devenu la quintessence même de sa
conception du montage. Il offre à l’agencement du récit filmique la possibilité d’une
dérive inlassable vers ce qui finit par apparaître comme son centre de gravité, que les
éléments composant ce centre soient raccordés ou non à leur périphérie. On va le voir,
Moi, un noir est comme un poème en vers libres : sans rime et irrégulier, pourtant
incantatoire.
NOTES
1. Cf. supra à propos de son premier film, Au Pays des mages noirs, p. 15.
2. Un mince épisode de Stromboli suffit à s’en convaincre. Après que Karen (Ingrid Bergman) et
son mari ont débarqué dans l’île, arrivés à mi-pente du chemin qui les emmène vers leur maison,
le mari pointe son index vers le haut et dit à la jeune femme : « Regarde notre maison ». La
maison en question est hors-champ et on attend son apparition dans le plan suivant. Il n’en est
rien. Rossellini choisit de montrer en un plan plus serré le visage de Karen, qui se détourne tant
elle est décontenancée par ce qui l’environne, pas d’accord. Il y a donc là une défaite absolue du
raccord homogénéisant et suturant, au profit d’autre chose, une lacune ou une béance, une figure
d’expression nouvelle qui viendra marquer en profondeur le cinéma moderne.
3. Chronique d’un été, op. cit., pp. 27-28.
4. Ibid., p. 43.
5. Jean Rouch, « À propos du tournage de Petit à Petit », Le Monde, 16 septembre 1971, repris par
L’Avant-Scène Cinéma, n° 123, mars 1972 et cité par G. Marsolais, L’Aventure du cinéma direct, op. cit.,
p. 370.
6. « Les Haoukas parlaient une langue que j’avais essayé de transcrire, mais je n’arrivais pas à en
dresser le vocabulaire. (...) j’ai appris plus tard que c’était la langue de la Pentecôte, du Saintesprit ! C’est ce que les linguistes appellent une “glossolalie” », Jean Rouch parle des « Maîtres
fous », in Jean Rouch ou le ciné-plaisir, op. cit., p. 84.
�88
7. « Jean Rouch, cinéaste », entretien avec Laurent Devanne au Café de l’Observatoire. Tous les
propos et mots suivants entre guillemets en sont extraits. arkepix.com/kinok/Jean%20ROUCH/
rouch_interview.html, Paris, 12 mars 1998.
8. Deux réactions exemplaires : Marcel Griaule, le professeur de thèse de Rouch, lui demande de
détruire le film. Paulin Vieyra, étudiant à l’I.D.H.E.C. et sur le point de tourner son premier film,
Afrique-sur-Seine, réclame lui aussi la destruction du film.
�89
Chapitre 7. L’invention de la fiction.
Moi, un noir
UNE EXPÉRIENCE
1
Si Rouch renouvelle le cinéma documentaire, s’il contribue à moderniser l’ethnographie
filmique, c’est notamment parce qu’il laisse la fiction se développer et travailler au cœur
même de l’entreprise documentaire qui est la sienne. Le processus est si substantiel et
profond, qu’on peut même l’évoquer en en inversant les termes : l’entreprise de Rouch
serait fictionnelle, en fait, et il vouerait le travail documentaire à en être le médium. Moi,
un noir concentre à cet égard toutes les propriétés d’un tel dispositif de la réversibilité.
Avec Gare du Nord, il est une des plus belles machines de Rouch destinées à mener la
guerre contre toutes les formes univoques d’expression artistique en cinéma. Au cours
des sept années qui séparent la réalisation de ces deux films, Rouch tourne en France et
en Afrique des documentaires (Chronique d’un été, Monsieur Albert prophète, Festival à Dakar,
Abidjan port de pêche, Le Cocotier, etc.) et des fictions (La Punition, La Pyramide humaine, Rose
et Landry). Ces films ont une renommée inégale. A l’évidence, les spectateurs de cinéma
connaissent plutôt les fictions que les documentaires tant ces derniers sont attachés à des
sujets et à des territoires précis et susceptibles de n’intéresser qu’un public spécialisé.
Autrement dit, Rouch auteur de documentaires s’impose moins auprès des spectateurs
que Rouch auteur de fictions, alors même qu’il est réputé être un documentaliste. Le
cinéaste est peut-être lui-même engagé dans une stratégie de diffusion et de réception de
son œuvre favorisant les fictions. Par le fait, dès ses débuts de cinéaste, Rouch laisse
apparaître que pour lui les limites assignées au territoire documentaire sont destinées à
être débordées. De 1946, année de son premier film, à 1958, année de Moi, un noir, il trace
une route qui, en passant par une thèse d’ethnologie et une longue série de documents
filmés, l’emmène toujours plus au cœur d’un cinéma qui sublime le document
ethnographique ou sociologique en fable filmique : Bataille sur le grand Fleuve et Les Maîtres
fous sont les témoins notables, perturbants même, surtout le second, de cette
transformation décisive. La route, dont il est ici question, n’est d’ailleurs pas rectiligne.
D’une part, Jaguar constitue une bifurcation essentielle puisque, pour la première fois,
Rouch asservit les méthodes du cinéma direct à la mise en œuvre d’une fiction. D’autre
�90
part, le moindre de ses films documentaires accuse d’emblée une tension vers la fiction
par laquelle doit en passer l’expression d’une vérité qui n’est plus celle de la réalité en soi
mais celle de la réalité en cinéma. Alors, pourquoi, comment Moi, un noir parvient-il à
cristalliser le premier toutes les qualités d’un projet au départ marqué par la subversion
des genres ?
2
Ce film est un des plus connus et commentés de la filmographie rouchienne. Symptôme
manifeste d’une adhésion à la fois critique et cinéphile, Moi, un noir a reçu le prix Louis
Delluc en 1959. Or, le film réunit deux traits qui le distinguent d’emblée : il est le premier
long-métrage achevé par Rouch, distribué et projeté en salle en 1960 ; il est aussi sa
première fiction achevée. Les Maîtres fous lui avait conféré, fût-ce au prix du scandale, une
notoriété appréciable, qui dépassait en tout cas le cadre de l’institution ethnographique,
mais c’est Moi, un noir qui assoit la réputation de Rouch, cinéaste moderne. L’impact du
film est notamment mesurable à ce qu’en écrit Jean-Luc Godard dans les trois articles
qu’il lui a consacrés. Le premier, « Jean Rouch remporte le prix Louis Delluc » mesure la
nouveauté du film à celle de Rome, ville ouverte, en son temps. Le deuxième, « Étonnant
(Moi, un noir, Jean Rouch) » évoque cette fois une parenté avec Un Roi à New York. Le
troisième, « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens », situe le film dans un “immense
triptyque nigérien”, entre Les Fils de l’eau et Jaguar (non encore sorti), venant se constituer
en fait comme “une porte ouverte sur un cinéma nouveau” »1.
3
Ainsi, le premier fait à noter est que Moi, un noir inscrit le travail de Rouch dans la
mouvance moderne du cinéma français, à hauteur – pourrait-on dire – des films de la
Nouvelle Vague. Moi, un noir est contemporain de Mon Oncle (Tati), Les Amants (Malle), Les
Mistons (Truffaut), et précède d’une année À bout de souffle, dans lequel Jean-Luc Godard
lui rend un hommage explicite2. La nouveauté percutante du film tient en quelques
petites inventions typiquement rouchiennes, déjà présentes dans tous ses films
antérieurs, mais ressaisies ici dans l’aventure d’un projet plus vaste. En effet, quand
Rouch tourne en une journée la transe des Haoukas, sans toujours comprendre ce qu’il
voit et ce qu’il entend, ou au contraire, quand il navigue pendant des jours et des jours
sur le Niger, dans le sillage parfois imprévu, voire dangereux des pêcheurs sorkos, les
films alors en cours de réalisation ont comme un garde-fou : la réalité, seule la réalité,
viendra imprimer ses marques dans les images. Les Maîtres fous et Bataille sur le grand fleuve
sont bel et bien sous l’empire des images actuelles. Bien sûr, le montage et la postsynchronisation altèrent la réalité de référence en en reconstruisant l’image. Mais le
matériau des films se constitue dans une relation à la seule réalité : il ne provient que
d’elle, que de ce qui s’y est actualisé et a été capté par la caméra, mais pas créé
spécialement par et pour celle-ci. Moi, un noir, à l’inverse, est une plongée dans l’ailleurs,
une sorte de voyage transcontinental. Rouch abandonne en effet le rivage du continent
documentaire où se tenait son cinéma jusque-là, il dérive et vogue librement vers un
autre rivage, bordant un autre continent du cinéma. Et c’est sur son parcours, dans le
sillage du film en train de se faire, que se forment les empreintes d’une fiction au long
cours, exactement comme lors du tournage de Jaguar. Le montage vient parachever cette
construction qui, ainsi, tient tout entière dans un entre-deux. Cet aspect est décisif car
Moi, un noir, originellement conçu comme une enquête sociologique, n’était pas destiné à
l’errance dans la fiction qui le caractérise.
4
Lors d’une rencontre publique en 1999, Rouch évoque longuement la genèse et la
conception de Moi, un noir. Ses propos sont éclairants, à bien des égards. « J’ai rencontré
Oumarou Ganda à Treichville. Nous faisions une enquête sociologique sur l’immigration
�91
des gens du Nord de l’Afrique Occidentale qui venaient travailler à Abidjan ». À cet effet, il
avait montré Jaguar aux enquêteurs, raconte-t-il, et parmi eux, Ganda lui avait reproché
une part de falsification : « on voit bien que ton héros n’a pas vécu l’immigration, qu’il ne
sait pas ce que cela veut dire. Nous ici, nous savons ce que c’est ». Ganda est alors devenu
le personnage principal de Moi, un noir, par la force de son verbe, souligne Jean Rouch :
Il avait l’habitude d’écrire des contes. (...). Moi, un noir est son aventure. (...) On a
donc décidé de faire ce film qui était à peu près impossible à tourner. (...) C’était une
espèce de combat dans une jungle étrange pour voir quelqu’un que je suivais à la
trace. Nous l’avons suivi en Afrique, nous l’avons suivi sur les chemins
extraordinaires qui étaient les chemins de découverte du monde. Il était vraiment
« Moi, un noir ». (...) Cela a duré longtemps. On l’a suivi partout.
5
Puis Rouch en passe à l’évocation du montage et du traitement sonore :
On travaillait en ayant comme son, le son enregistré en direct (...) sur lequel j’avais
ajouté quelques airs de musique. (...) Quand on a monté le film, on l’a fait avec la
musique et le montage s’est fait automatiquement, sur l’action. (...) Le tout n’était
pas du son synchrone. Mais le film a été synchronisé après coup par des admirables
façonnières, fabricantes de vrais mensonges. Trois mois après (...) je suis retourné
en Côte d’Ivoire, et devant les images, Robinson [Oumarou Ganda] et Eddie
Constantine [Petit Touré] ont improvisé un texte, pour moi ébouriffant. La
première prise a toujours été la bonne. C’est-à-dire que le film d’une heure et demie
à peu près, a été sonorisé à la radio d’Abidjan en une heure et demie. Ils revivaient
complètement cette histoire, ils la réinventaient. (...) Pour moi, c’était la découverte
presque sacrée du cinéma. Ces gens vivaient leurs rêves (...). Quant au commentaire
off, c’est moi qui l’ai inventé pour boucher les trous. ».
6
Au final, Rouch fait ce constat : « le cinéma a été pour moi la remise en question de ce
qu’avait été l’ethnographie, c’est-à-dire l’étude d’une population que l’on connaît bien,
mais qui reste étrangère. Et là, tout d’un coup, j’avais l’impression de faire moi aussi de
l’improvisation, comme dans le jazz hot. Et avec un très grand avantage moral, car, qui
était l’auteur ? C’était moi et les copains. (...) Les gens de la Nouvelle Vague ont été épatés
par ce film qui avait coûté 2,5 francs et qui remettait un peu en en question le cinéma 3. »
7
Tout est dit : les limites de l’ethnographie qui sont repoussées, l’improvisation qui gagne
en puissance, le rêve qui impose sa nécessité au déroulement de la fable documentaire, le
dévoiement des conduites cinématographiques ordinaires, le voisinage avec la Nouvelle
Vague. On peut alors remarquer que le travail de Jean Rouch, effectué loin des grands
pôles d’attraction et d’effervescence de l’actualité cinématographique, est pourtant bien
ancré dans son époque. Plus précisément, à entrer dans le détail d’un film comme Moi, un
noir, on voit jouer des figures et se dessiner des traits communs, qui distinguent donc la
fin des années cinquante comme une période spécifique de l’histoire du cinéma moderne.
Moi, un noir présente à cet égard plusieurs caractéristiques marquantes.
LE DOCUMENT DANS LE MIROIR DE LA FICTION
8
La plus importante, qui vient comme un écho à la fois assourdi et démultiplié de ce que
Rouch avait déployé dans Les Maîtres fous grâce au montage, concerne la mise en place
d’un système de subversion de la vérité documentaire. À savoir : en caméra portée, Rouch
suit dans les rues d’Abidjan Oumarou Ganda, qui se surnomme « Robinson (Edward G.) »
et est « bozori », c’est-à-dire manœuvre journalier sur le port d’Abidjan. Sur son passage,
Robinson4 commente tout ce qu’il voit, nous invitant en somme à une visite guidée de la
ville, de son quartier, de son lieu de travail et de ses lieux de débauche nocturne. Le même
�92
principe est appliqué à trois autres protagonistes du film : Petit Touré, un colporteur
surnommé « Lemmy Caution, agent fédéral américain », Alassane Maïga, chauffeur de taxi
surnommé « Tarzan, Johnny Weismüller », et Seydou Guédé, manœuvre lui aussi,
surnommé « Facteur ». Tous ont choisi leur pseudonyme pour le film, tous sont les objets
de l’enquête sociologique menée par Rouch qui les filme en cinéma direct. Les différents
moments passés avec eux, dans leur réalité propre, constituent la trame narrative du
récit qui se construit jour après jour, au fil d’une improvisation quasi ininterrompue. Le
spectateur a ainsi le sentiment d’être confronté à un film documentaire, ce qui est le cas.
Mais cela est également tout à fait faux et Robinson est l’agent de cette situation qui n’est
pas sans rappeler Leibniz et sa fameuse théorie des mondes « incompossibles ».
9
Pour commencer, le film repose sur une tricherie initiale : Oumarou Ganda n’est pas un
manœuvre, plutôt, il n’est plus manœuvre quand Rouch le rencontre et le recrute comme
enquêteur-statisticien. Son personnage, Robinson, est alors une fiction, inventée pour les
nécessités du film à partir d’un épisode de sa vie passée. Cette fiction est elle-même
doublée par celle qui consiste à faire en sorte qu’en la personne d’Oumarou Ganda,
l’enquêteur se fasse acteur de cinéma. On entre là dans une figure de la prolifération et de
l’emboîtement des plans de réalité (Ganda enquêteur, Ganda acteur, Ganda personnage
fictif, Ganda personnage de son propre rôle) qui laisse comprendre pourquoi Gilles
Deleuze a pu réunir dans un même chapitre de L’image-temps dédié aux « puissances du
faux », Orson Welles « le faussaire », celui qui « dévoile quelque chose, l’existence
derrière lui d’un autre faussaire » et Rouch, le fabulateur du cinéma-vérité qui « détruit
tout modèle du vrai pour devenir créateur de vérité »5. Moi, un noir fait en effet revenir le
passé dans le présent, l’actualise de telle manière que tous les composants du film, même
quand ils sont authentiquement documentaires, sont contaminés par la fiction. Cela
concerne notamment les amis de Robinson, filmés dans leur vie de tous les jours. Mais la
vérité de ce quotidien, dont le déroulement est synchrone avec celui du tournage du film,
est d’emblée falsifiée puisque chacun, en son lieu, est aspiré dans la sphère d’une fiction
de cinéma dont Oumarou Ganda, devenu Robinson, est la source. A travers un tel
dispositif, Moi, un noir peut être comparé à quelques films antérieurs qui présentent des
situations similaires, que le film soit un documentaire, tel Nanook of the North, ou une
fiction, tel Stromboli. Les esquimaux de la baie de Baffin et les pêcheurs de Stromboli
avaient rejoué pour la caméra, dans un cas, la fameuse chasse au phoque de Nanook, dans
l’autre, la pêche au thon telle qu’on la pratiquait par le passé, et les deux ont été remises
au présent du cinéma. Or, les deux films ont au moins un trait commun : le style et la
manière de leur auteur respectif récusent le réalisme supposé de toute reconstitution
soucieuse de la ressemblance avec une réalité de référence. Flaherty et Rossellini
requalifient directement la réalité en déplaçant les coordonnées de l’espace-temps dans
lequel elle advient. Celui-ci n’a plus d’autre référence, en effet, que le moment et le lieu
du filmage. On peut alors parler d’un devenir-fiction irrémédiable du cinéma
documentaire car la réalité, purement cinématographique, est tout entière dans les
images documentées par la fiction qui les a fait naître. Paradoxe qui participe de la
refondation du réalisme, ce pourquoi on a justement pu l’appeler « néo-réalisme » à un
moment précis de l’histoire du cinéma, en Italie. Nanook, Stromboli, et Moi un noir
pareillement sont en prise directe sur la réalité parce que leur style - ou leur esthétique –
est tel qu’ils paraissent affranchis de la servitude de la référence6 qui conduit
traditionnellement le cinéma réaliste à la reconstitution. Or, celle-ci empêche, sinon rend
�93
difficile, l’émergence d’une vérité instantanée ou intempestive dont le cinéma, pour
Flaherty, Rossellini, Rouch et quelques autres, bien sûr, peut être, doit être le révélateur.
10
Une telle disposition explique pour une grande part comment Moi, un noir parvient avec
une aisance confondante à une « rénovation radicale de la fiction cinématographique » 7.
Car chez Rouch s’affirme par ailleurs « la fascination pure de la frontière, de la rupture,
l’espace même du basculement »8, tension dont Les Maîtres fous, le premier, témoigne, que
prolonge Jaguar et qui contribue à la singularité du récit dans Moi, un noir. En effet, outre
l’insoupçonnable fiction originaire du film, Rouch met en place un autre processus,
radical lui aussi, brouillant davantage les niveaux de la réalité supposée. Dans le cadre
strictement documentaire du tournage en direct de la fiction instituée au départ,
s’insèrent plusieurs scènes absolument hétérogènes à ce contexte. Elles sont pourtant
parfaitement intégrées dans le tissu narratif, grâce au montage qui les coud « bord à
bord » – peut-on dire – avec les images directes. Il y en a trois, réparties sur trois jours qui
se suivent dans « la semaine » dont le film fait le reportage9. Le samedi après-midi,
Robinson s’entraîne à la boxe, le dimanche soir, il s’enivre et finit par s’endormir dans la
rue. Le lundi matin, dégrisé, il doit retourner au port pour trouver du travail. Dans les
trois cas, survient une péripétie imaginaire, filmée pourtant comme toutes les autres
péripéties, au plus près de leur actualisation dans le temps et dans l’espace du tournage.
C’est ainsi, notamment qu’elles sont très découpées, le montage intervenant comme dans
un banal film de fiction pour assurer une continuité illusoire à des actions entrecoupées
en fait de nombreuses ellipses. Mais les trois sont vouées à un sort hautement particulier
puisqu’elles sont l’objet d’un passage stupéfiant à un au-delà de la réalité actuelle qui
constitue en principe la matière narrative et figurative du film.
TROIS FOIS LE FILM INTÉRIEUR
11
Le premier décrochement (plans 304-316)10 intervient après que Robinson a passé l’aprèsmidi au bord de la plage avec ses amis. Il est encore avec eux lorsqu’il s’isole et se
rembrunit : « tout le monde est gai et moi je suis triste » dit-il à une jeune femme dont il
est amoureux, Dorothy Lamour, assise sur le sable, à côté de lui. Il poursuit : « il faut que
je sois moi aussi un homme heureux, comme tous les autres ». C’est alors que tout
bascule : du bord de la lagune Ébrié, en plein soleil, le film est maintenant passé sans
transition visuelle d’aucune sorte à une salle de boxe, plongée dans la pénombre. La
phrase commencée par Robinson au plan précédent vient s’achever ici, dans un espacetemps violemment hétérogène. Rien ne permet, en effet, de mesurer l’écart entre un lieu
et l’autre, d’évaluer leur proximité ou leur éloignement spatio-temporels. Seul raccord
entre les deux : la voix de Robinson qui, dans la première image de la péripétie imaginaire
à venir, paraît à la fois surgir du hors-champ (voire même du hors-cadre), et résonner
comme la voix intérieure du personnage. Et c’est bien de cela dont il s’agit...
12
D’abord, la scène se donne clairement pour ce qu’elle est : une fiction. Robinson, boxeur
au nom composite de « Edward G. Ray Sugar Robinson », devient sous nos yeux champion
du monde de boxe ! Ensuite, le filmage « déréalise » subtilement cette franche fiction.
Depuis la coulisse où le film l’a rejeté, Robinson, spectateur de lui-même, commente de
plus en plus vite les images pour terminer sur un point d’orgue plaisant : tandis que,
endossant la fonction de l’arbitre, il compte lui-même les secondes où son adversaire est
au sol, il s’exclame : « là, je me colle au titre de champion du monde de poids plume ».
Ensuite, la fin de la péripétie est abrupte, comme la chute d’une nouvelle. Le film
�94
enchaîne immédiatement, en effet, sur un vrai match, dans la même salle, sur le même
ring, commenté par la voix hors-champ de Robinson, mêlé cette fois au public et
annonçant le match en ces termes : « moi, c’est ce que j’aimerais faire : le champion du
monde Ray Sugar Robinson. Je ne suis pas un boxeur, c’est seulement un rêve et voici le
vrai boxeur ». Enfin les images du match fictivement joué par Robinson, d’abord projetées
à une vitesse normale, finissent par être accélérées. A l’évidence, le film est entré de
plain-pied dans la représentation directe d’un espace mental : la rêverie éveillée de
Robinson. Elle fait le lien entre ici (la lagune) et là-bas (la salle de boxe), entre le présent
actuel (Robinson spectateur d’un match) et le présent virtuel (Robinson acteur d’un
match), tout en escamotant les personnages et les lieux (où donc a disparu Dorothy ?
Comment passe-t-on de la lagune à la salle de boxe ? Combien de temps s’est-il écoulé
entre les deux épisodes ? entre le match fictif et le match réel ?). Et si l’on s’interroge sur
Robinson lui-même, on voit bien que la question de son identité est inséparable de la
question du lieu. Dans le champ des images, il est le personnage d’une fiction, dans le
hors-champ des mêmes images, il est le spectateur et commentateur du récit, dans le
hors-cadre de la même séquence d’images, à Radio-Abidjan, il est l’acteur et le
commentateur du film en cours de post-synchronisation. La multiplicité des fonctions,
qui coïncide avec la prolifération des identités, découle en fait de la posture privilégiée,
aussi bien par Rouch que par Oumarou Ganda : le personnage n’est pas déterminé par ses
actions mais plutôt par le fait qu’il est capable de se « voir », au sens psychique du terme,
ailleurs que là où il est en réalité. Il faut souligner que la méthode du feed-back
transformée en post-synchronisation par Rouch est la cause efficiente de ce phénomène :
le personnage Robinson est effectivement vu sur un écran de cinéma par l’acteur Ganda.
La situation est banale pour un acteur professionnel amené à se post-synchroniser selon
des techniques éprouvées qui lui permettent de maintenir la distance entre lui-même et
« son » personnage. Ici, Ganda et Robinson sont deux faces d’une même personne. Le
premier est bel et bien en position de « voyant » du second, dans une parfaite situation
d’autoscopie. La parole de Ganda/Robinson, ou de Robinson/ Ganda aussi bien, charrie
cette double polarité : elle est en même temps hors de l’image et dans l’image, dans le
présent de la diégèse et dans celui du commentaire, dans la réalité du cinéma et celle de
la vraie vie. Au lieu même de cet écart entre les deux pôles, se laisse deviner un no man’s
land du récit et de l’image qui le supporte. C’est ici qu’il y a la place en creux pour le
rêveur ou le « voyant » dont parle Gilles Deleuze, celui dont les visions créent de l’espace
et du temps, se transformant ainsi littéralement en un voyageur spatio-temporel.
13
Le procédé et l’effet qu’il engendre rappellent quelque peu ce qu’Alain Resnais réalise
dans Hiroshima, mon amour lorsque l’héroïne, « elle » à Hiroshima en 1958 (Emmanuelle
Riva), revoit pour la première fois, en image mentale, son amant de Nevers, mort en 1943,
et qu’elle figure aussi dans l’image, jeune fille du passé, penchée sur le cadavre du jeune
homme (Bernard Fresson). Les deux films sont contemporains et le parfait faux raccord
employé dans les deux cas est, bien sûr, un trait d’époque, une procédure tout à fait
déterminante dans l’identité du cinéma moderne qui crée des entités discontinues. Mais
Resnais n’est pas venu au cinéma sur les mêmes bases que Rouch : il est d’abord un
monteur et s’il y a une essence du cinéma resnaisien elle passe notamment par une
science du montage, jamais démentie ou oubliée, même dans ses films les plus récents. On
peut ainsi percevoir dans le cinéma de Resnais une relation substantielle entre geste de
création et esprit ou trouvaille de montage11. Dans les films de Rouch, la modernité du
montage tient à un autre ressort, que Moi, un noir met admirablement en lumière. Le
match fictif, pour commencer, dit assez à quel point la rhétorique du désir et son
�95
corollaire, celle de la frustration, génèrent l’articulation des images entre elles et celle
des séquences. Mais, comme dans le film de Resnais, la force du dispositif ainsi mis en
place tient essentiellement au fait que Rouch évacue le récit psychologique vers lequel
son personnage est susceptible d’entraîner le film. Il mobilise – ou exploite – plutôt ses
états d’âme qu’il transforme en une pure énergie cinétique, produisant non pas des
paroles mais des images, permettant au film de faire des bonds formidables, improbables,
entre différents plans de réalité. Proche de Moi, un noir, un film de 1962 pousse cette idée
encore plus loin en en faisant le dispositif intégral de son récit. C’est La Jetée de Chris
Marker, dont le personnage principal est un pur « voyant ». Choisi comme cobaye d’une
expérience science-fictive de voyage dans le temps à cause de « sa fixation sur une image
du passé », « une image d’enfance » et physiquement privé de vue puisqu’il a des
bandeaux sur les yeux, il voit alors des images mentales qui lui permettent de se déplacer
effectivement dans le temps, surtout dans le passé où a vécu une femme dont il a été
amoureux et qu’il veut rejoindre. Les savants fous ont bel et bien spéculé sur la force
d’attraction du désir amoureux.
14
Ainsi, s’il y a une narration chronologique dans Moi, un noir, cette chronologie, quoique
linéaire pour l’ensemble du film, dont le récit est normalement orienté du début vers la
fin, n’est pas simplement soumise aux lois temporelles objectives, factuelles. Elle est un
processus actionné par un moteur qui programme une réalité plurielle, hétérogène,
discontinue comme l’est le monde de la pensée. Dans Allemagne, année zéro, Rossellini avait
déjà donné une image saisissante, très concrète de cette sorte de machinerie destinée à
rendre compte d’une réalité purement mentale. A la fin du film, lorsque Edmund s’enfuit
de chez son instituteur auquel il était venu faire la confidence de son parricide, il erre
longuement dans les rues de Berlin. Le spectateur peut bien avoir envie d’interpréter les
pensées et les émotions du personnage dont le visage plutôt lisse et les gestes tout
simples, enfantins, ne laissent rien deviner. À quoi pense-t-il d’ailleurs ? Que ressent-il ?
On ne le sait pas. En fait, c’est l’environnement sonore, complètement « irréalisant », qui
se substitue à la traditionnelle psychologie narrative. En effet, tous les sons d’ambiance
sont à peine audibles mais il suffit qu’Edmund passe devant une église pour qu’éclate
alors un chant religieux fervent qui, semble-t-il, a traversé les murs de l’église ! Ou
encore : une musique d’accompagnement, a priori off, intervient dans le plus grand
désordre. Discontinue, fragmentaire, arbitraire, elle passe d’un air à l’autre, d’une
mélodie à l’autre, sans que rien ne relie les brèves plages musicales entre elles. Cette
musique, littéralement déchirante, guère en accord avec les images unifiées par la
constance du mouvement en travelling de la caméra et par la rectitude quasi déserte des
rues en ruines, se déverse ainsi dans l’oreille du spectateur comme la voix non entendue
du personnage en plein désarroi, en pleine crise d’identité à soi-même, en rupture avec le
monde environnant. L’accélération des images du match de boxe dans Moi, un noir est un
processus semblable qui permet d’inscrire dans la matérialité même des objets
concrètement représentés leur qualité de choses mentales. Il va sans dire que ni
Rossellini, ni Rouch n’ont besoin de solution de continuité entre les deux univers, le
physique et le mental, car, justement, ils sont insécables, indistincts, valant d’emblée l’un
pour l’autre, autre marque par excellence du cinéma moderne.
15
Le deuxième décrochement qui advient dans Moi, un noir (plans 620-627) entérine les
dispositions du premier, les rend encore plus éclatantes. On est dans un moment clé, un
des plus « truqués » du film, le dimanche soir, qui constitue pour Robinson un
interminable épisode de désenchantement s’achevant par une errance nocturne solitaire.
�96
Temps fort de l’épisode : dans un bar, en compagnie de ses amis qui fêtent la victoire
d’Eddie Constantine et de sa cavalière Nathalie au concours de danse de la Goumbé, il fait
la cour à Dorothy Lamour (encore elle !). Arrive un italien qui courtise la jeune femme.
Elle se détourne complètement de Robinson. Double truquage, typiquement rouchien :
d’abord, la situation n’est en rien spontanée. Bien sûr engendrée par les circonstances
mêmes de la réalité, elle a pourtant été préparée et provoquée par Rouch qui veut voir
comment Robinson (ou Oumarou Ganda ?) va réagir. Ensuite, l’Italien qui vient perturber
la soirée, est en fait le preneur de son du film, André Lubin. Lors de la postsynchronisation, c’est le cinéaste Enrico Fulchignoni qui va prêter sa voix à ce vrai faux
italien de pacotille ! À cet égard, Moi, un noir fait écho au cinéma néo-réaliste qui
pratiquait souvent le doublage des personnages par d’autres acteurs. Moi, un noir regarde
aussi la Nouvelle Vague, est regardé/écouté par elle : Jean-Luc Godard reprend non sans
humour le trucage sonore de l’épisode rouchien lorsqu’il prête sa voix en 1959 à Jean-Paul
Belmondo dans Charlotte et son Jules.
16
Le royaume du faux exerce donc son influence, tantôt grave, tantôt malicieuse sur les
méandres du film en cours de tournage, alors même que celui-ci est en prise sur la réalité
immédiate. Ainsi, c’est bel et bien parce que Dorothy se détourne de lui à la faveur d’un
scénario préconçu par Rouch, que Robinson/Ganda se met à dériver « pour de vrai » dans
la nuit, de bar en bar. Ivre et complètement désargenté, il finit par être mis à la porte du
dernier endroit visité par lui, le bar « Mexico ». Son attention est attirée par une peinture
murale représentant un couple de danseurs élégamment vêtus (617) que la caméra
détaille par deux gros plans en vision subjective, d’abord sur la danseuse, puis sur le
danseur (618 et 619). Robinson ratiocine : « Vous êtes capables de me foutre à la porte,
mais vous ne m’empêcherez pas de rentrer au bar ! Ma Dorothy Lamour ! Bientôt je serai
le mari de Dorothy Lamour... ». Plan d’ensemble sur un mur orné d’affiches de films (620),
panoramique sur un premier titre (Des Femmes chassent à l’homme), puis sur un deuxième
titre inscrit en dessous du visage de Marlon Brando (Le Gang descend sur la ville). Robinson
poursuit son monologue : « ... et Dorothy Lamour sera ma femme et moi je serai un acteur
comme Marlon Brando... ». Plan suivant (621) : un panoramique ascendant dévoile
Dorothy Lamour, debout dans la nuit, appuyée au chambranle de la porte d’entrée d’une
maison. Souriante, elle arrange ses cheveux, se retourne et entre dans la maison.
17
Le basculement est déconcertant et le spectateur a besoin de remettre en place sa
perception du récit, exactement comme lorsqu’on accommode sa vision sur un objet dont
l’apparence est floue. Que vient faire ici Dorothy au milieu de la nuit ? D’où sort-elle ?
Plutôt : d’où sort son image ? Telle est la question que le spectateur est contraint de se
poser, mélangeant ainsi de lui-même différents niveaux de réalité, comme le film ne cesse
de le faire. En effet, Dorothy semble tout à fait réelle, physique, concrète et en même
temps elle apparaît immédiatement pour ce qu’elle est : une projection mentale de
Robinson, une incarnation onirique. Le reste de la séquence (623-628) confirme cette
sensation première. Dorothy ferme la porte (622) puis, sur le lit, cadrée de près, elle
sourit, se caresse les bras, ôte les bretelles de sa robe et, les seins nus, elle s’étire
voluptueusement puis s’allonge sur le lit. Robinson commente les gestes de Dorothy,
comme il commentait ses propres gestes lors du match de boxe fictif : « elle ferme la
porte. On ne veut pas du dérangement, on est tranquilles et dans notre maison en
personne, j’ai Dorothy Lamour, le poste radio. Elle cause avec moi des mots d’amour. Elle
sortira sa robe puisque j’aime voir ses nichons, elle a soif d’amour, là, sur notre lit, ce que
nous allons faire ne regarde que nous seuls ». Ainsi Dorothy, créature du fantasme
�97
amoureux de Robinson, agit au son de la voix de ce dernier, qui se manifeste ici en
montreur de marionnettes. Or, depuis son hors-champ d’amoureux transi dans le récit,
confondu avec le hors-cadre de l’acteur en post-synchronisation, il est devenu un
équivalent de la machine cinématographique elle-même, à la fois la caméra qui voit les
images et le projecteur qui les fait voir. Dans la nuit, il projette et sonorise un film aux
images muettes (pas un mot ne sort de la bouche de Dorothy) et la projection s’achève
comme dans une salle de cinéma : image nocturne très noire, à peine éclairée par la lueur
d’une flamme de bougie. Le dernier intertitre du film, « le lundi » en lettres minuscules
d’imprimerie blanches, apparaît pendant quelques secondes (629). Puis c’est le petit jour
et Robinson qui a dormi là, dans la rue, se réveille. Ainsi, alors que la nuit, tout entière
engloutie dans les ténèbres de l’intertitre, est achevée en quelques secondes, Robinson, à
la lumière de l’aube, émerge d’un rêve qui avait pris la forme d’un film. À cet égard, il ne
suffit pas de noter que les images du rêve de Robinson revisitent son désir amoureux
frustré. Elles font de lui une sorte de metteur en scène de cinéma et de son rêve
l’actualisation d’un film dans le film.
18
Lundi matin : le troisième décrochement par rapport à la réalité immédiate introduit une
donnée nouvelle qui achève le paradigme ainsi mis en place par Jean Rouch. Robinson,
dégrisé notamment par une bagarre avec « l’Italien » de la veille et l’annonce de
l’emprisonnement d’Eddie Constantine qui s’est battu avec un agent de police, marche en
compagnie de « Petit Jules », un de ses amis, manœuvre comme lui. Alors qu’ils sont
censés trouver à la fois de l’argent pour l’apporter au prisonnier et du travail pour euxmêmes, ils s’assoient, dos à la caméra, au bord de la lagune Ébrié qui s’étale placidement
sous leurs yeux. À ce moment, « Rouch, accroupi à côté d’eux, la caméra sur l’épaule, se
redresse lentement et s’élève à la Anthony Mann, les genoux en guise de grue, pour
cadrer Abidjan, ô Abidjan des lagunes »12, et faire voir le ciel, là-bas, de l’autre côté du
plan d’eau (690). A la faveur de ce travelling en caméra portée, Robinson et Petit Jules
sortent du champ. Image suivante (691) : à nouveau le spectateur doit faire un effort
spécifique pour remettre les choses à leur place car le paysage est encore dominé par la
présence de l’eau mais dans l’instant même où celle-ci se montre, elle n’est pas semblable
à l’eau de la lagune Ébrié. Plutôt, l’environnement visuel et sonore est différent, quand
bien même le cadre, de grand ensemble et frontal, raccorde-t-il parfaitement avec celui
du plan précédent. Le faux raccord exerce là encore son œuvre de continuité dans la
rupture. Maintenant, en effet, une rive boueuse entoure un plan d’eau très calme. Tout au
fond, un camion roule lentement dans un paysage nu, presque désertique. Changement
visuel, si doux qu’il en est presque imperceptible alors que les deux personnages sont tout
de même sortis de l’image : l’horizon d’Abidjan s’est évanoui ! Changement sonore,
nettement repérable, pour sa part : Jean Rouch, en voix off, se « mêle » à la scène qu’il
commente : « Robinson et Petit Jules, assis devant la lagune d’Abidjan, rêvent à leur
fleuve, le Niger, à leur pays natal... » (691) et tandis qu’il achève sa phrase par ces mots :
« Là-bas à deux mille kilomètres », apparaît un deuxième paysage (692) plus circonstancié
que celui du plan précédent. Ici, en effet, le spectateur reconnaît à coup sûr un fleuve
parsemé de bancs de sable et bordé de rochers. Un pêcheur jette son filet, des enfants
sont grimpés sur les rochers. On a bel et bien quitté la lagune Ébrié et sans doute, faut-il
croire la parole de Jean Rouch lorsqu’il nomme le fleuve Niger.
19
Jusque-là, le procédé peut sembler banal, inscrit même dans une tradition documentaire
connue : intervention du commentaire en voix off pour suppléer au laconisme du
montage eut et orienter le spectateur dans l’espace du récit. Nous avons même
�98
connaissance de la distance parcourue entre un lieu et l’autre ! Mais la séquence glisse
vers un tout autre horizon, novateur celui-là. A peine le dernier mot du commentaire estil entendu, que dans le même plan, Robinson reprend la parole, comme si le off, d’où
émane la voix de Jean Rouch et le hors-champ, d’où émane la voix du personnage, étaient
en communication directe, immédiate13. On atteint là un premier seuil de
« déréalisation » de la matière documentaire des images. Deuxième seuil : dans la
séquence qui s’ensuit (693-706), les images montrent des enfants qui s’amusent à plonger
dans le fleuve. Trois sont plus particulièrement désignés à l’attention du spectateur : une
petite fille, un petit garçon rayonnant d’un sourire édenté et un adolescent costaud qui
fait régner la loi du plus fort parmi les autres enfants. Robinson commente ces images en
s’adressant à Petit Jules : « ... Dorothy Lamour que tu vois n’était qu’une petite fille et moi
je n’étais qu’un petit garçon toujours souriant... Voilà Tarzan, déjà costaud, il est
beaucoup plus grand que nous tous ! Tarzan est fort depuis l’enfance... il faut qu’ils se
mettent à trois, quatre pour le lancer à l’eau... ». Ainsi, ce qui dans la séquence du rêve
n’était qu’une approximation de film dans le film a pris corps cette fois de la manière la
plus concrète. Les images commentées par Robinson sont bel et bien filmiques, sans doute
ont-elles été tournées par Rouch qui les utilise ici, non pas comme des documents
d’archives, mais plutôt comme la matière produite par une projection mentale, issue d’un
processus de la pensée : la mémoration. Robinson remonte effectivement le temps, « voit »
ou « visionne » son enfance, et le film Moi, un noir actualise cette remontée qui se
matérialise sous la forme d’un voyage non seulement spatial, mais surtout, temporel. Or,
Rouch complique la représentation, ou la métaphorise, en mettant en place une mise en
scène qui fait se confondre matériellement le processus psychique du travail de la
mémoire et celui de la projection d’un film. Rarement le cinéma aura été aussi près de
l’idée de Bergson qui voyait travailler la pensée comme un cinématographe intérieur !
Plus prosaïquement, Robinson est assigné par son passage dans le hors-champ, au rôle de
projectionniste et de commentateur d’un film muet dont Petit Jules est devenu le
spectateur.
20
À ce détournement irrécusable de la vocation a priori documentaire des images ici
projetées – doublement projetées à un personnage du film et aux spectateurs dans la salle
– s’ajoute un détournement, majeur lui aussi, de l’obligation d’authenticité du cinéma
documentaire : la source des images projetées n’est pas attestée. Sont-elles ou ne sontelles pas ce que Robinson dit qu’elles sont, à savoir les images de son passé ? La chose est
invérifiable. Autant dire qu’à cet endroit du film, les frontières entre les genres sautent :
le cinéma direct annexe le territoire entier du cinéma. L’image de Robinson et Petit Jules
au bord de la lagune, tournée en caméra directe, est documentaire, pourtant c’est une
fiction. L’image des enfants dans le fleuve est une fiction, pourtant la séquence a une
identité documentaire. La suggestion de Robinson assis dans le hors-champ, faisant
« voir » à Petit Jules les images de son souvenir, est une fiction. Pourtant, Oumarou Ganda
et Karidyo Daoudou (Petit Jules) sont bel et bien assis devant un écran de cinéma, en train
de visionner les images d’un film.
UN RÊVE DE FILM
21
Pour clore cette description des vertigineuses échappées oniriques et méta-filmiques
dont Rouch fait un des enjeux essentiels de la conquête du singulier, de l’intempestif et du
contingent qui qualifient le mentir/vrai dans Moi, un noir, il convient d’évoquer encore ces
�99
deux traits : l’extrême simplicité des moyens employés et la place toute spéciale que
Rouch s’est assignée dans le dispositif du récit.
22
Au titre des moyens figuratifs, quand Robinson/Ganda, celui par qui tout arrive au gré de
ses aspirations mentales, pense à quelque chose, Jean Rouch se contente de montrer
l’image filmique de cette chose, en l’insérant, quelle que soit sa source, dans le tissu de
l’histoire. La représentation de la chose mentale ne subit aucune distorsion, ni ne
s’enrichit ni ne s’appauvrit en quoi que ce soit par rapport à l’image de la chose physique.
On peut alors dire des deux qu’elles sont isomorphes, ce qui vaut à Moi, un noir de n’être
« ni un film de fiction, ni un documentaire, il est l’un et l’autre, mieux : l’un multiplié par
l’autre »14. Ce travail de subversion est très pauvre dans sa dépense matérielle comme
dans sa dépense d’imagination, le faux raccord faisant à lui seul office de levier et de clé
de voûte dans l’invention et l’architecture d’un nouveau type de récit filmique. Et
pourtant, Moi, un noir, comme Hiroshima mon amour, son contemporain, tout aussi
économe dans ses moyens figuratifs, s’offre le luxe de parcourir en toute liberté des
espaces très vastes, de relier entre elles des périodes de temps irrémédiablement
dissociées dans la chronologie ordinaire, d’unifier dans un même plan de représentation
des images actuelles et des images mentales. Peu après ces deux films initiatiques, les
premiers à « surmonter l’opposition entre la fiction et le documentaire »15, des films,
riches d’inventions figuratives et d’une science toute cinématographique des trucages,
proposent de tels voyages proprement sidérants : c’est, parmi d’autres, 2001, l’Odyssée de
l’espace en 1968 et Solaris en 1972. Le film de Kubrick s’achève bien par une plongée du
personnage principal dans sa genèse, dans l’incarnation de l’enfant ante-vitam qu’il n’avait
pas encore été car il n’en avait pas le souvenir et qui accède désormais, par la seule force
de la pensée, à la représentation. Le film de Tarkovski, pour le moins aussi ambitieux que
celui de Kubrick dont il semble d’ailleurs revisiter quelques propositions figuratives et
métaphysiques, ne fait rien d’autre en réalité que ce que fait Moi, un noir, mais à une
échelle plus vaste : le cinéma entre ici dans l’univers mental d’un être humain et
l’agrandit aux dimensions de tout l’univers de telle manière que le dedans, le monde de la
pensée, devient le dehors, l’univers physique subsumé par l’océan Solaris ;
corollairement, le dehors, le monde des choses physiques devient à son tour une
concrétion de la pensée. Image finale saisissante de la maison du père, noyée sous la pluie,
qu’un mouvement d’élévation dans l’espace fait s’engloutir, en fait, dans l’océan
purement mental de sa résurrection par le souvenir.
23
Quant à la place de Rouch dans le récit, elle peut s’apprécier à la lumière de Jaguar. On l’a
dit précédemment, le cinéaste y avait déjà expérimenté comment débrider le
documentaire par la fiction et gauchir la fiction par le documentaire. On trouve bien dans
Jaguar un emboîtement et une prolifération des plans de réalité et des identités de
chacun, semblables à ceux de Moi, un noir. On y trouve surtout le règne de l’imaginaire,
déjà assuré dans le cadre d’un film strictement tourné selon les méthodes du cinéma
direct. Il manquait encore à ce film une audace : celle de faire croire au spectateur qu’une
caméra était capable d’entrer dans la tête d’un personnage, de capter et d’enregistrer des
images en ce lieu imprenable, de les imprimer sur de la pellicule, de les sortir, en somme,
de leur camera obscura originaire pour les jeter sur un écran, offertes à la vue de chacun
comme autant d’objets traversés par la lumière du cinéma. Constat en liaison avec ce
« manque » : Jaguar est un film gai, souvent drôle, l’humour des trois protagonistes, que
l’on retrouve d’ailleurs intact dans Petit à Petit (et plus tard dans Cocorico ! Monsieur Poulet)
étant souvent mis par eux au service de leur imagination intarissable. Moi, un noir est au
�100
contraire un film triste, amer malgré des épisodes voués à la gaieté (la Goumbé), à
l’humour ou à la légèreté (séduction de Dorothy par Eddie Constantine). C’est qu’à la
différence de Jaguar, Moi, un noir est un film souvent nocturne, parfois onirique. Le récit se
déploie comme une descente dans un souterrain ou dans un no man’s land obscur dont il
extirpe des matériaux divers, les visions de Robinson. Mais lors de sa remontée,
manifestée par les images qui actualisent ces visions, le récit emporte avec lui la nuit dont
il provient, les particules ténébreuses dont il s’engendre. Ce phénomène est ici à mettre
entièrement au compte de l’imaginaire rouchien (pas des personnages/acteurs) et de la
manière dont il se déploie à travers un dispositif spécifique, déployé d’une manière
intentionnelle qui passe notamment par la posture de la caméra. S’il est vrai qu’à cet
égard, là encore, Jaguar et Moi, un noir se ressemblent, puisque Rouch tourne en caméra
portée dans le sillage inlassable des protagonistes du récit, un fait différencie absolument
les deux films. Dans Moi, un noir, le processus identitaire qui lie le cinéaste et les
protagonistes, joue ici surtout avec Robinson, un personnage dont l’activité mentale,
souvent marquée par la présence de la nuit, est le moteur même du récit. Du coup, Rouch
occupe ici une place spéciale où le mène sa relation au personnage : c’est celle d’un
rêveur.
24
On l’a déjà noté, le récit est divisé en quatre parties qu’annonce chacune un intertitre :
« la semaine » (80), « samedi » (235), « dimanche » (367) et « lundi » (629). Tous sont des
plans nocturnes, extérieurs, éclairés par la flamme d’une bougie (80 et 629), des phares de
voiture (235), des réverbères (367). Leur longueur est variable mais chacun accueille dans
sa continuité l’intégralité d’un commentaire en voix off de Jean Rouch. Ces quatre plans
apparemment banaux sont singuliers à plusieurs égards. D’abord, leur fonction n’est pas
simplement celle d’un intertitre puisque chacun d’eux est un morceau de nuit. Ainsi, les
quatre passages nocturnes sont ambigus : ils renvoient, dans le même temps et dans le
même lieu, aussi bien à l’absence des personnages du récit, dont, justement la caméra ne
filme jamais le sommeil, qu’à la présence du commentateur/récitant, Jean Rouch. Ce
dernier, conscience omnisciente, annonce en effet tout ce qui va se passer dès lors que la
nuit de l’intertitre se sera dissipée. Il est bien en position de « voyant » lui aussi, et sa voix
s’élève dans la nuit, parcourt avec la plus grande précision les méandres du récit à venir,
comme un somnambule louvoie dans un espace dont il épouse avec adresse la
configuration alors même qu’il a les yeux clos. Bien sûr, Rouch a simplement enregistré le
commentaire après coup, « pour boucher les trous », dit-il. Mais s’il a maintenu tous les
signes apparents qui qualifient la nature off du commentaire, notamment la distance
entre des faits tels qu’ils se déroulent et le récit maîtrisé de ces faits dès lors qu’ils sont
connus du récitant, il a pourtant fait un choix esthétique qui, là encore, entraîne le
spectateur vers un territoire non balisé. Le didactisme limpide et la précision
documentaire des paroles, qui annoncent en détail l’ordre même des péripéties bientôt
montrées16, résonne en effet dans un espace étrangement indéfini, celui de la nuit
équivoque qui sert d’écrin, volontaire semble-t-il, à la voix de Jean Rouch. Ce dernier
transgresse bel et bien une frontière, celle qui distingue le hors-cadre et le profilmique,
l’opérateur et les acteurs, l’auteur et les personnages. Il prend sa voix en effet et, depuis
le fond de la nuit où il se tient tel un rêveur, il la projette dans une autre nuit, celle des
personnages. A l’instar de Robinson animant une projection onirique de Dorothy, Rouch
assimile ainsi tous les acteurs/personnages de Moi, un noir aux créatures que son rêve
aurait inventées.
�101
25
Jean Rouch aurait pu donner cet autre titre à son film : Moi, un noir ou « Quatre nuits d’un
rêveur »17.
NOTES
1. Voir Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 1, op. cit, respectivement pp. 155, 177 et 180-182.
2. Voir supra, p. 73.
3. Site perso.wanadoo.fr/cine.beaujolais/rouch.htm, p. 2-6 sur 8.
4. Le nom, choisi en référence au boxeur Ray Sugar Robinson et à l’acteur Edward Robinson est
prononcé à l’américaine : [ρ ô β ι ν σ ô ν].
5. G. Deleuze, op. cit., pp. 175-197.
6. Comment ne pas s’apercevoir au passage que le cinéma est déjà en route vers son devenir où il
ne cessera de s’éloigner de l’analogie qui caractérise les modalités techniques du médium ?
7. Jean-André Fieschi, « Dérive de la fiction – Notes sur le cinéma de Jean Rouch », op. cit., p. 262.
8. Ibid., p. 263.
9. Des intertitres ponctuent ainsi le récit : « la semaine », « samedi », « dimanche », « le lundi ».
10. Ces numéros de plan et ceux indiqués dans les pages suivantes sont repris du découpage
intégral du film publié dans L’Avant-Scène Cinéma n° 265 (1981).
11. Ses derniers films ne me contrediront pas. Par exemple, la scénographie si particulière de Pas
sur la bouche est entièrement déterminée par un travail de montage qui consiste à déplacer non
plus les images mais les éléments qui les composent : c’est l’ameublement d’un même lieu qui
change et qui entraîne avec lui tous les changements temporels et dramaturgiques dont le récit
fait l’objet.
12. Jean-Luc Godard, J.-L. Godard par J.-L. Godard, « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens »,
op. cit., p. 182.
13. Tel est le cas d’ailleurs, la figure en est déployée dès la première séquence du film où
Robinson apparaît en personnage diégétique, au plan 31 : sur un travelling descendant le long
d’une façade d’un immeuble en construction, devant lequel se tient Robinson, Rouch dit en voix
off : « C’est dans les rues d’Abidjan que j’ai rencontré pour la première fois Edward G. Robinson ».
Dans le même plan, Robinson prend la parole : « Non, je m’appelle Edward G. Robinson... etc. ».
14. André Labarthe, Essai sur le jeune cinéma français, op. cit., p. 26.
15. Ibid.
16. Exemple du premier, plan 80 : « Chaque jour de la semaine, c’est la lutte de Robinson et de ses
amis pour le travail : “bagage” qui porte n’importe quoi à n’importe quel prix, “coxer”, racoleur
de passagers sur la gare routière, colporteur, marchand de tissu venant du Ghana, “mouilleur”,
docker de bois tropicaux ou, comme Robinson et Elite, “bozori”, manœuvre journalier à la merci
des besoins des employeurs. Qu’importe, le soir on partagera les gains de la journée en les jouant
aux cartes ».
17. Tel est le titre d’un film que Robert Bresson a réalisé en 1971.
�102
Chapitre 8. Le vertige du « temps réel »
1
On l’a vu précédemment, Jean Rouch a appris très vite, avec les réalisateurs de l’O.N.F. en
particulier, comment filmer une scène en caméra portée tout en gardant le contrôle du
filmage, quelles que soient les circonstances. Mais cet exercice initialement physique finit
par changer de nature, devient un élément essentiel du travail pratique de réalisation et
contribue à l’affirmation d’un style. Ces deux aspects conjugués, l’un technique, l’autre
expressif, inclinent parfois le cinéaste à la virtuosité. Ce n’est pas un mince paradoxe pour
Rouch qui a souvent affirmé son dédain de la forme soignée, préférant « une image ronde
et sale » à « une image propre et carrée ». Parmi d’autres, deux films laissent
admirablement transparaître à quel point Rouch était capable de se jeter dans l’aventure
des formes, d’inventer des situations filmiques extrêmes, exigeant une acuité particulière
dans la conduite du tournage, qui est élevé ipso facto au rang d’événement
scénographique. Gare du Nord et Tourou et Bitti, les tambours d’avant se tiennent aux deux
extrémités les plus opposés du cinéma de Rouch. Or, malgré ce très grand écart entre ces
œuvres, un détail crée entre elles une intense ressemblance : Rouch cède dans l’une
comme dans l’autre à l’attraction irrésistible du « temps réel ». De là vient la prouesse
technique que le cinéaste met au service d’une aspiration pour ainsi dire démiurgique.
Gare du Nord et Tourou et Bitti sont en effet deux expériences par lesquelles Rouch s’élève
selon une volonté manifeste au rang de créateur. Pour la première, il veut inventer une
fiction parfaite, absolue, vaste comme un monde et pourtant réduite à un espace-temps
terriblement exigu, enclos sur lui-même. Dans la seconde, il met en concurrence le travail
du temps filmique (neuf minutes de pellicule), le travail du temps psychique (un danseur
est sur le point d’entrer dans une transe de possession) et lui-même aux aguets, l’œil rivé
au viseur de la caméra, il attend que ces deux temporalités parfaitement hétérogènes
fusionnent en un instant idéal qui verrait coïncider la fin de la pellicule et l’éclatement de
la transe. Rarement, la contrainte et la nécessité du « temps réel » ne se seront inscrits
aussi profondément dans la matière vive d’un film.
GARE DU NORD
2
Gare du Nord est une œuvre singulière tant le projet esthétique s’y manifeste avec une
force et une évidence qu’il n’avait pas atteint jusqu’alors dans les films précédents de
Rouch. Plus précisément, ce dernier laisse apparaître pour une fois que le vrai sujet d’un
�103
de ses films pourrait bien être le cinéma, qu’il a le pas sur l’enjeu narratif et
dramaturgique, l’observation de la montée d’une scène de ménage chez un jeune couple
de la petite bourgeoisie parisienne. Autrement dit, les images de Gare du Nord laissent voir
quelque chose que les autres films de Rouch tendent à oublier ou à occulter : une
situation est exactement réglée pour venir coïncider avec les attentes d’un film à faire.
Apparemment, le spectateur est ici confronté à l’anti-cinéma direct. Or, raison
substantielle de la singularité de Gare du Nord, sa réalisation et sa facture l’apparentent, en
fait, à un film du cinéma direct. S’il est évident que le tournage a été préparé, tous les
repères pris et les rôles répétés, les prises de vue ne dérogent pourtant pas à la loi du
direct : elles sont uniques et l’enregistrement des paroles se fait directement, lui aussi, en
son synchrone. Le fait se remarque à des hésitations maladroites au cours de la dispute du
couple, les deux acteurs, Nadine Ballot et Barbet Schrœder, n’ayant qu’une expérience
d’amateur, la première chez Rouch, le second chez Rohmer, dans La Boulangère de
Monceau. Rouch a, semble-t-il, conçu une forme bizarre, virtuellement impossible, qui a
moins à voir, de toutes façons, avec la tradition du cinéma qu’avec la nouveauté
télévisuelle, alors en train de se mettre en place.
3
Dans son apparence, le film est simple à décrire1. Il dure dix-sept minutes et comporte six
plans dont le premier (un carton noir sur fond sonore de marteau piqueur) porte la
mention du titre et de l’auteur, et dont le dernier complète le générique (nom des acteurs,
de l’opérateur, du preneur de son). Entre ces deux bornes, quatre prises de vue sont
disposées en miroir.
4
Le deuxième plan, qui dure une vingtaine de secondes, part d’une vue aérienne d’un
quartier de Paris montrant à la fois le Sacré-Cœur et la gare du Nord, puis un zoom avant
suivi d’un panoramique vient cadrer le dernier étage d’un immeuble : une jeune femme
penchée à sa fenêtre, arrose des fleurs. Bruit insistant des marteaux piqueurs.
5
Le cinquième et avant-dernier plan, symétrique du deuxième, un peu plus long
néanmoins, montre d’abord la même jeune femme puis s’achève sur la vision des toits du
quartier et du Sacré-Cœur. Entre ces deux images du drame filmé, l’initiale (plan 2) et la
finale (plan 5), deux autres images (plans 3 et 4) de durée à peu près équivalente
(plusieurs minutes) déroulent l’histoire selon une dramaturgie que le tournage en temps
réel rend irrémédiable. Les deux se déplient elles aussi l’une par rapport à l’autre, comme
dans un miroir.
6
Plan 3 : petit déjeuner d’un jeune couple dans la cuisine. La conversation vire rapidement
à l’aigre. Exemple de ce que la jeune femme dit à son mari : « Ce que j’aimerais partir ! Pas
à Tahiti, ni même en Grèce. Je ne sais pas. Le Club Méditerranée. Pas de souci ! Partir
n’importe où ! Prendre une caravelle. Tu sais, la voix des hôtesses d’Orly, [elle imite la
voix d’une hôtesse] : “Les passagers pour Téhéran, vol Air France 342, embarquement
immédiat, porte n° 3”. Toi, t’as plus envie de partir ». Le couple passe dans la salle de bain
(elle se coiffe, il se rase) ; elle va dans la chambre à coucher (elle fait du rangement,
s’habille) ; elle revient dans la salle de bain (elle se maquille, achève de s’habiller, il se
coiffe) ; sur la lancée de la discussion qui dégénère, ils se disputent, elle le gifle. Ils sortent
de l’appartement, traversent le couloir du palier jusqu’à l’ascenseur, elle entre dans la
cabine. Lui, immobile devant la cage d’ascenseur appelle sa femme : « Odile ! Odile !
Écoute, Odile ! Écoute, Odile ! Arrête... Odile... », etc. Visage à peine visible de la jeune
femme dans la cabine. Lueurs intermittentes à chaque palier franchi. La voix du mari
s’estompe, disparaît. Rez-de-chaussée. Elle sort de l’ascenseur, traverse le palier et appuie
sur le bouton de l’ouvre-porte. Cut.
�104
7
Plan 4 : elle marche dans la rue, tourne à droite, s’apprête à traverser. Grand bruit de
frein. Une voiture blanche pile juste devant elle. Le chauffeur sort de la voiture, la rejoint
et l’accompagne, abandonnant là son véhicule. Ils suivent le trottoir de la chaussée
surplombant la voie ferrée de la gare du Nord. Discussion animée entre eux, dans les
termes qui reprennent presque mot pour mot ceux de la dispute de tout à l’heure, mais en
inversant les interlocuteurs. Exemple de ce que l’inconnu dit à la jeune femme : « Tenez.
Il fait beau ce matin. Prenons la voiture et allons n’importe où, dans un endroit où il n’y a
personne. Ou bien, allons à Orly. Vous connaissez la voix caressante des hôtesses de l’air ?
Nous prendrons le premier départ annoncé. Vous n’avez jamais eu l’envie de partir
comme ça, pour aller n’importe où, avec quelqu’un que vous n’avez jamais vu ou que vous
ne connaîtrez peut-être jamais ?... ». Les deux marcheurs s’arrêtent une dernière fois
devant la grille bordant le pont du chemin de fer. L’homme demande à la jeune femme de
partir avec lui, sinon, il a « décidé de mourir ». Elle refuse. Il compte jusqu’à dix. Un train
siffle. Il escalade la grille. Elle hurle : « Non ! Monsieur ! Monsieur ! Non ! Monsieur !
Monsieur !, etc. Il se jette dans le vide. Cut.
8
Plan 5 : elle, effarée, mains agrippées aux barreaux de la grille, regarde vers le bas. Un
panoramique descendant s’arrête brièvement sur le corps de l’homme, allongé sur la voie
ferrée, inerte. Recadrage ascendant vers les toits et le Sacré-Cœur dans le lointain.
9
Cette description sommaire laisse apercevoir à quel point Rouch s’est fixé deux règles,
deux lois devrait-on plutôt dire : la contrainte du tournage en temps réel et celle de la
symétrie inversée qui constitue une circonstance aggravante quant au poids de
prédétermination pesant sur le récit. À propos de la première loi, le spectateur songe
d’emblée à La Corde (Rope) qu’Hitchcock a réalisé en 19482. Le défi formel est le même,
mais ce n’est pas tout. Une première similitude troublante apparaît entre les deux films,
dès leur introduction : chez Hitchcock, on pénètre, comme dans le film de Rouch, dans
l’appartement du personnage principal par une voie aérienne. Après quoi, le récit installe,
comme le fait Gare du Nord, le primat du tournage en continuité dans un lieu clos, rendu
d’autant plus complexe que l’action se déplace dans plusieurs pièces. Hitchcock a donc
tout prévu pour éviter les raccords de plan, jusqu’à l’utilisation d’une porte battante,
marquant la séparation entre le salon et la cuisine, qui permet à la caméra de passer
d’une pièce à l’autre sans changer de prise de vue. Quant au montage proprement dit, il
est paradoxal car il se dissimule autant qu’il se voit, Hitchcock ayant choisi pour chaque
raccord de plans (il y en a une douzaine pour tout le film) le même système : il coud bord
à bord des images sombres, presque noires, qui sont le plus souvent le dos ou la manche
du vêtement d’un des protagonistes, serré au plus près par la caméra et éclairé à contrejour. En procédant de la sorte, il rend sensible ce que l’œil du spectateur n’est pas censé
voir, la barre de montage et le battement rythmé de la pellicule qui construit la
continuité imaginaire du ruban filmique, déportant ainsi le travail figuratif de l’image
vers la représentation d’une abstraction : l’idée même du montage, qui plus est, dans un
film paraissant récuser le binôme « découpage-montage » caractéristique du cinéma
narratif américain. Il est illusoire pourtant de penser que le cinéaste a congédié le
montage classique qui synthétise en une continuité homogène les éléments fractionnés
en amont par le découpage. Sa caméra, très mobile, prend le relais, effectue le montage
dans l’image. On retrouve cette procédure dans le film de Jean Rouch qui aligne environ
quatre-vingt déplacements de la caméra correspondant à autant de cadres différents à
l’intérieur des deux plans-séquences centraux.
�105
10
Ainsi, Jean Rouch soumet son film aux mêmes contraintes que son prédécesseur et les
rend d’autant plus perceptibles qu’il s’agit d’un court-métrage. Il ne fait pas de doute que
l’horizon esthétique est ici semblable à certains égards à celui de La Corde. Cette visée, du
moins telle qu’elle est manifeste ici, est hybride : elle est entièrement investie par
l’aventure du cinéma, violemment même, et pourtant elle trouve sa forme dans un récit
quasi théâtral. Or, l’appartement de La Corde est, avant celui de Gare du Nord, une scène de
théâtre dont les protagonistes occupent surtout le centre, la pièce principale de
l’appartement bien sûr, un espace à la fois centrifuge et centripète parce qu’il est le lieu
du crime, le lieu où l’on a caché le cadavre, le lieu où l’on mange sur le coffre renfermant
le cadavre et le lieu où se déroule l’enquête. L’architecture de la pièce, largement éclairée
par la lumière qu’est censée diffuser une vaste baie vitrée, placée au fond comme un
accessoire permettant de faire entrer dans le décor de la scène les immeubles du quartier,
renforce son caractère théâtral. La similitude à cet égard entre les deux films n’est pas
surprenante car le tournage en continu est susceptible de conférer un caractère théâtral à
n’importe quelle séquence filmée, la spatio-temporalité propre à la scène de théâtre étant
effectivement transposée dans un studio de cinéma (ou ce qui en tient lieu). Cette
similitude est peut-être à mettre au compte d’une volonté particulière qu’aurait eu Rouch
de reprendre une expérience stylistique pratiquée avant lui par l’illustre Hitchcock, peutêtre pas3. Quoi qu’il en soit, Rouch paraît spécialement intéressé ici par la transfusion
quasi organique susceptible de s’opérer entre le cinéma et le théâtre.
11
À la contrainte technique du tournage en temps réel, le cinéaste ajoute en effet une
disposition significative qui accentue l’aspect théâtral du récit : c’est un artifice narratif,
la symétrie des situations. Elle fait du récit une dramaturgie exactement calibrée pour
tenir dans un espace-temps enclos sur sa propre finitude, ce qui constitue là une rareté,
pour ne pas dire une exception, dans le cinéma de Rouch. A cet endroit, Gare du Nord
quitte délibérément le sol réaliste sur lequel il a établi ses bases. La première partie du
film, qui correspond à la scène dans l’appartement, est la fiction sociologique d’un couple
moderne. Elle décline toutes les données matérielles, vestimentaires, comportementales,
verbales, etc., propres à deux personnes prises comme des « échantillons » dont on
pourrait déduire le portrait psychologique d’une classe sociale, celle des employés du
secteur dit « tertiaire », à Paris, dans les années soixante. En ce sens, Gare du Nord n’est
pas loin de Chronique d’un été dans lequel chaque protagoniste avait été choisi par Edgar
Morin selon une représentativité sociologiquement établie. Mais là s’arrête la
ressemblance, très précisément à la porte de l’ascenseur que va bientôt prendre la jeune
femme, sans doute parce que à la faveur d’une rapide translation, la caméra est entrée
avec elle dans la cabine, quittant ainsi définitivement, et l’appartement et la pseudoétude de cas qui s’y déployait. Le film bascule maintenant dans un tout autre registre.
L’ascenseur s’engage en effet dans un puits de ténèbres qu’éclairent sporadiquement et
avec parcimonie des rais de lumière. Le spectateur, qui entr’aperçoit furtivement le
visage de la jeune femme, compte les étages descendus. Au cinquième, l’obscurité est
totale. Peu après, toujours dans le noir, la jeune femme sort de l’ascenseur pour aller
retrouver la rue, la lumière diurne. Jusque-là, pas un instant la caméra ne s’est éloignée
d’elle, pas un instant la prise de vue n’a cessé. Un premier constat s’impose alors : la
descente dans le noir apporte un trouble fondamental dans l’ordre du récit.
12
C’est qu’il n’est pas très difficile d’interpréter la représentation ici mise en place comme
une métaphore dont le passage dans l’ascenseur serait l’agent. Première partie du film :
une jeune femme exprime des frustrations et des déceptions : voyager, partir à l’aventure,
�106
vivre une autre vie, toutes choses que son mari, d’abord séduisant, attractif et
virtuellement aventureux, n’est en réalité pas capable de lui offrir. Restent la routine et la
perspective, insuffisante pour elle, d’une dérisoire promotion professionnelle et
financière que le mari évoque avec une naïveté désarmante : « quand je serai chef de
bureau on aura une autre maison, on aura une bagnole et on pourra aller en vacances où
on voudra ». L’entrée de la jeune femme dans l’ascenseur et la chute progressive de celuici dans les ténèbres seraient l’équivalent d’une entrée dans le sommeil. Puis arriverait le
rêve, plutôt, les images de rêve. C’est la deuxième partie du film où un aventurier offre à
la rêveuse l’opportunité d’assouvir ses désirs. Or, contrairement aux apparences,
l’aventurier n’est pas un inconnu : il est la figure exactement inversée du mari. Par
exemple, ce dernier disait tout à l’heure : « Moi, je préfère être couillonneur que
couillonné ». L’inconnu dit maintenant : « J’ai choisi d’être celui qui dévore plutôt que
celui qui est dévoré ». De là vient peut-être le fait qu’il meurt, répondant ainsi au vrai
désir de l’épouse déçue, celui de se débarrasser de son mari. Le tuer en rêve, par la figure
interposée de son double onirique prenant la décision de se suicider, voilà « le crime
parfait » ! Décidément, Hitchcock ne se laisse pas oublier, du moins pour qui veut bien
s’adonner au jeu de l’exégèse. Ce jeu est suscité par le film tant il est vrai que Rouch
accentue le côté factice de l’histoire racontée en faisant appel à un système de
coïncidences invraisemblables qui la structurent en deux parties rigoureusement
opposables terme à terme. L’aspect réaliste des images, tournées dans un vrai
appartement, puis dans les vraies rues d’un vrai quartier de Paris n’en offrent qu’un
contraste plus saisissant avec le principe d’« irréalisation » auquel elles sont soumises. On
est ici dans une fable proprement surréaliste dont l’imaginaire qui la baigne, telle une
quatrième dimension, paraît susceptible d’inciter le spectateur à se faire à son tour aussi
imaginatif qu’on peut l’être.
13
Il convient de rappeler ici deux faits. Premièrement, Gare du Nord est un film de la
Nouvelle Vague, le seul que Jean Rouch ait jamais réalisé à l’intérieur de celle-ci. A cet
égard, « l’œuvre parisienne de Rouch (...) est traversée par des questions du cinéma de
l’époque : éloge et invention du cinéma direct mais aussi fantasme du plan-séquence. Gare
du Nord (...) rejoint les démarches de Jacques Rivette ou Jean-Luc Godard à la fois comme
rupture avec le cinéma de montage “manipulateur” et comme “exploit”, acte
funambulique dans lequel celui qui filme s’expose au risque de l’imprévu dans une sorte
d’Action filming »4. Deuxièmement, avec cinq autres courts-métrages, Gare du Nord
participe à la construction d’un ensemble prédéterminé. Le titre du film et les titres
respectifs de chaque court-métrage donnent une idée très claire de la contrainte
narrative majeure : il fallait que chaque histoire filmée s’enracinât dans un quartier de
Paris. Des six auteurs, seul Godard, suivant une inclination personnelle sans doute
irrépressible, a dérogé puisque deux lieux, indiqués par le titre « Montparnasse et
Levallois », sont concernés5. La Nouvelle Vague étant une « école », Gare du Nord est, si l’on
peut dire, un film d’école. Qu’il soit une expérience n’est alors pas pour surprendre car il
est la première incursion de Rouch dans un territoire du cinéma qui n’a pas été tracé par
lui. Certes, il a déjà filmé une fiction à Paris en 1962 : La Punition, un moyen-métrage de
soixante minutes environ dont Nadine Ballot était déjà l’actrice principale. Mais ce film
reste dans la lancée de La Pyramide humaine, tourné à Abidjan en 1961, avec la même
actrice, dans un rôle de lycéenne, proche de sa propre vie car elle est effectivement élève
dans un lycée de la ville. Par ailleurs, la présence de Michel Brault, opérateur des prises
de vues, fait de La Punition un film typique du cinéma direct. Ce trait est renforcé par sa
place dans l’institution : certes il est produit par les Films de la Pléiade, très impliqués
�107
dans la Nouvelle Vague, mais il est diffusé à sa sortie sur une chaîne de télévision. Enfin,
La Punition et La Pyramide humaine ont un sujet à peu près semblable, les relations
amoureuses. Dans les deux cas, la fiction est l’occasion d’une enquête, sur les rapports
interraciaux pour le premier, sur les fantasmes amoureux de la jeunesse urbaine pour le
second. Rouch se situe là dans un registre qui est ordinairement le sien et qui allie à
l’observation des mœurs, des paroles, des pensées et des postures, la construction d’une
réalité filmique circonstancielle. On peut parler à ce titre d’un cinéma anthropologique,
au sens où les sciences humaines peuvent admettre d’une observation filmique qu’elle
soit à la fois une enquête (documentaire) et une proposition (fictionnelle). Gare du Nord est
d’une tout autre nature, plutôt, il répond à une autre inspiration à laquelle son
environnement « Nouvelle Vague » n’est sans doute pas étranger.
14
Quelle est cette inspiration ? L’espace du cinéma transformé en scène de théâtre en est le
véhicule. Jean Rouch se tourne entièrement vers une topographie nouvelle (pour lui) de la
création filmique qui lui permettra de produire une fable en temps réel, de vivre pour la
première fois dans son cinéma, l’expérience d’une synchronie entre lui, le filmant et les
autres, les filmés. En somme, la fonction de metteur en scène, telle qu’elle est ici endossée
par le réalisateur Rouch, vaut aussi bien pour un rôle, comme on le dit du travail d’un
acteur. Cette élaboration, qui n’est pas sans rappeler la complexité des jeux
identificatoires de Jaguar via la « ciné-transe », prend corps dans un cadre aussi mouvant
que le sont, d’une part la pensée et les gestes du cinéaste, d’autre part, la réalité
profilmique en cours. Ainsi, le choix du tournage en temps réel n’est pas réductible à la
prouesse technique qu’il occasionne. Il est aussi ce par quoi Rouch a décidé qu’en
passerait l’expression de cette peu habituelle synchronie. Relève-t-elle de la conception
que les cinéastes de la Nouvelle Vague se font du cinéma ? Pas vraiment, pas souvent en
tous cas. Cependant, le fait de produire une posture nouvelle répond bien à une attente
typique de la Nouvelle Vague, que chacun des six films de Paris vu par décline à sa
manière. Celle de Rouch lui fait trouver un agencement inédit fusionnant la modernité
contemporaine du cinéma et l’ancienneté archaïque du théâtre dans un récit dont les
événements principaux se déroulent selon une double spirale. Spirale de l’univers profïlmique de la diégèse bouclé sur la fatalité mortelle d’une rencontre vouée à l’échec ;
spirale qui implique l’instance filmante dans un processus qu’elle doit, selon un paradoxe
productif, parfaitement organiser et subir, ou encore, exactement prévoir et laisser filer.
15
Ainsi, le tournage en temps réel d’une fiction à la fois préparée dans son agencement
scénaristique et imprévue dans ses aléas humains, aussi bien du côté des acteurs que du
côté du fïlmeur, est une expérience sans doute extrême : Gare du Nord fait se rencontrer et
se condenser ce qui tiraillait jusqu’à présent le cinéma de Rouch dans des directions
différentes, voire opposées, selon des variations dont le couple ethnologie/fiction est sans
doute la plus emblématique. Il a réussi à lier dans une même structure en boucle une
fiction totale et le document de son filmage. Ainsi Gare du Nord est non seulement un film
rouchien, il est de surcroît un film aussi moderne que peut l’être un film de la Nouvelle
Vague en 1964. Néanmoins, si l’on s’en tient au seul cinéma de Rouch, Gare du Nord est
sans doute le premier film qui lui offre l’opportunité de maîtriser un certain protocole de
tournage auquel il aspire depuis longtemps. Lequel ? On peut hasarder cette réponse : la
cristallisation d’éléments hétérogènes dans de beaux paradoxes filmiques. Tourou et Bitti, tourné
sept ans après Gare du Nord est une réponse parfaite à cette attente.
�108
TOUROU ET BITTI, LES TAMBOURS D’AVANT
« – Ce film que Rouch a projeté, Tourou et Bitti, est-il vraiment fait d’un seul planséquence ?
C’est ce qui lui donne ce caractère exceptionnel dont je parlais tout à l’heure. Il
s’agit d’un unique plan séquence de dix minutes – la durée d’une bobine – au cours
duquel une cérémonie de possession qui « échoue » depuis trois jours, dans la
mesure où aucun génie, aucun holey, ne s’est incarné, « fonctionne » tout à coup
sur intervention de l’ethnocinéaste ! La présence subite de la caméra semble avoir
déclenché pour deux des danseurs la transe longuement attendue, ouvrant alors les
négociations rituelles et les sacrifices correspondants...
– Le sait-on autrement que par le commentaire qu ’en fait Rouch ?
Il faut certes une grande habitude de la culture Songhay pour reconnaître la transe
du premier des danseurs, mais la terrible possession du second d’entre eux – c’est
une femme – quelques minutes plus tard ne fait aucun doute, même pour le
spectateur néophyte. Peut-être n’est-ce pas le document le plus impressionnant de
Rouch, les cérémonies les plus esthétiques, celles où la danse se déploie le plus
librement, étant souvent celles dans lesquelles les dieux ne s’incarnent pas. Mais ici
le but du rite a été atteint ; on a quitté le plan purement esthétique pour celui de
l’efficacité religieuse et c’est l’entrée en scène de l’ethnocinéaste qui a été décisive.
C’est ce moment de crise même qui est frappant et le fait que nous y assistons en
temps continu, sans aucune coupure6. »
16
Le sujet, le lieu, les protagonistes, le mode opératoire relèvent dans Tourou et Bitti de
l’ordinaire du cinéma ethnographique de Jean Rouch. Cependant, le choix du tournage en
temps réel en fait un « essai de tournage en un plan séquence du “moment fort” d’un
rituel de possession... »7. Oui, Tourou et Bitti est un bien « essai », au double sens du terme
d’ailleurs. Premier sens : Rouch réitère l’expérience de Gare du Nord qui lui avait permis de
synchroniser sans délai l’aventure de la fiction et celle de sa mise en scène, lui, le cinéaste
se trouvant au lieu exact où se forme la rencontre des deux. Avec Tourou et Bitti, il teste à
nouveau la possibilité de ce type de rencontre. Deuxième sens, découlant étroitement du
premier : Tourou et Bitti est, quant à son fond, un essai car ce qu’il donne à voir et à
entendre au fil d’une narration chronologiquement déterminée vaut d’emblée pour une
réflexion qui problématise certains enjeux de l’observation ethnographique.
17
Un premier plan d’environ une minute montre en une vue large et frontale, un coin de
brousse avec, au fond, quelques maisons d’un village. Un travelling en caméra portée
s’avance vers le village. Son de la musique des tambours. Voix off de Jean Rouch : « Le 11
mars 1971, après trois années de disette, les habitants de Simiri au Zermaganda du Niger,
organisaient une danse de possession pour demander aux génies de la brousse la
protection des récoltes futures contre les sauterelles. Le 15 mars, Daouda Sorko, fils d’un
prêtre (...) nous demandait d’assister au quatrième jour de cette cérémonie pour laquelle
on avait fait appel aux tambours archaïques, Tourou et Bitti. Vers la fin de l’après-midi,
aucun danseur n’ayant été possédé, nous décidons, le preneur de son Moussa Hamidou et
moi-même à la caméra, de réaliser malgré tout un plan-séquence d’une dizaine de
minutes afin de conserver un document filmé dans le temps réel sur ces tambours d’avant
qui très bientôt se tairaient à jamais. Ainsi a été entrepris cet été-là, le cinéma
ethnographique à la première personne ».
18
Deuxième plan très bref (trois secondes) : sur un fond noir, la mention « un film de JEAN
ROUCH » en bas de l’image.
�109
19
Troisième plan qui dure un peu plus de huit minutes. Rouch capte en continu tout ce qui
se passe sur la place du village où le rituel a lieu. À plusieurs reprises il filme l’orchestre,
deux joueurs de tambour et un violoniste, assis devant la palissade d’une concession. Il
filme plus particulièrement un homme, « Samou Abeïdou, le cultivateur de Simiri » qui
attend d’être possédé par la « hyène Kouré, le génie des Haoussa », il filme le dialogue de
celui-ci avec le maître de cérémonie Daouda Sorko lui répétant plusieurs fois : « le départ
n’est pas pour toi ». Il filme une femme qui entre en transe, c’est « Wazzi... elle n’est plus
la ménagère de Simiri mais Hadjo, la captive peule ». Il filme les spectateurs, surtout « les
petits garçons et les petites filles des écoles venus voir comment dansent leurs mères,
leurs pères, leurs grands-mères et leurs grands-pères ». Pendant ce temps dont la coulée
est ininterrompue, dans cet espace que la caméra portée parcourt inlassablement en tous
sens, au plus près des protagonistes, la musique entêtante des tambours et du violon en
arrière-fond se mêle à la voix peu audible des protagonistes (in) et à la voix de Rouch (off)
qui tantôt traduit les propos des uns et des autres, tantôt rend compte du déroulement de
l’événement. La fin de la prise de vue (à presque neuf minutes) est remarquable tant elle
est dans le droit fil de tout ce qui précède en même temps qu’elle lui apporte une
contradiction flagrante. Alors que « Daouda asperge l’orchestre de parfums Haoussa » et
que, selon la traduction des propos de ce dernier par Rouch, « les dieux maintenant
attendent ( ?)... », Rouch se recule, s’éloigne de l’orchestre et commente ce qu’il est en
train de faire : « ... et moi, j’aurais du continuer à filmer mais j’ai voulu faire un film,
retomber sur le début de mon histoire et je me suis éloigné lentement pour voir ce que
voyaient les enfants des écoles, cette petite place du village aux derniers rayons de soleil
où, au cours d’une cérémonie furtive, les hommes et les dieux parlaient des récoltes à
venir ». Sur ces derniers mots, l’image s’assombrit, enveloppant toutes choses dans
l’ombre d’un rapide crépuscule.
20
Quatrième et dernier plan d’une dizaine de secondes : sur un fond noir, mentions du
générique technique : « Assistant réalisateur Laurent Lam Dia-Hama – Prise de son
Moussa’Hamidou – Montage son Philippe Luzuy ». Silence total. La durée totale du film est
inférieure à dix minutes.
21
La contradiction, dont on vient de parler, s’établit entre deux ordres de fait hétérogènes
que le principe du tournage en temps réel et en caméra portée veut rendre coalescents.
D’une part la réalité va son cours, suit sa pente naturelle en toute autonomie ; d’autre
part, le cinéma qui, ici, n’intervient apparemment pas sur cette réalité, en est pourtant
l’ordonnateur décisif. Plusieurs détails sont saisissants à cet égard. Par exemple, vouloir
regarder l’ensemble comme le voient les enfants et en déclarer l’intention dans le
commentaire en voix off, revient à proclamer la transformation immédiate de la scène
réelle en une scène de cinéma. En effet, l’identification explicite du point de vue de la
caméra à celui des enfants constitue une figure filmique connue : la mise en abyme du
spectateur. Ou bien cet autre détail, à la fois infime et éminent : quand Rouch dit qu’il a
« voulu faire un film, retomber sur le début de [son] histoire », il fait la démonstration
irrécusable du pouvoir exercé par le cinéma sur la réalité adaptée et transformée à ses
propres fins. Par ailleurs, à cet endroit, la parole de Rouch entre pour la première fois
dans le registre du commentaire alors que jusqu’ici elle était une parole de récit. Or, que
dit ce commentaire ? Il développe l’introduction par Rouch, au début du film, d’un
nouveau concept : « le cinéma ethnographique à la première personne ». Il est difficile d’être
plus clair dans l’affichage de ses intentions. En se mettant à la source et au centre d’un
documentaire dont le protocole d’observation est déterminé par une corrélation étroite
�110
des parties en présence, l’observateur et l’observé, l’un étant asservi à l’autre – comme on
le dit de deux appareils d’enregistrement (tels la caméra et le magnétophone de Chronique
d’un été !) – Rouch est tout simplement en train de construire un nouveau lieu de
l’imaginaire ethnographique du cinéma. Il y faut une certaine audace provocante. Parler
en effet d’une « première personne » dans un tel contexte de dévoilement documentaire
d’une réalité que la caméra met à nu en la serrant d’aussi près et en la suivant avec
l’insistance propre au tournage en continu, mène tout droit à une question de fond : qui
est cette première personne ? L’auteur du film, auquel cas Tourou et Bitti serait le portrait
de l’ethnographe en cinéaste en quête d’une aventure filmique ? Les gens filmés ? Une
personne parmi ces gens, qui serait intronisée en personnage principal ? Ce
questionnement, qui fait écho à l’ambiguïté que le titre « Les Maîtres fous » faisait déjà
valoir en 1954, n’attire bien sûr pas une réponse univoque. Le cinéaste, opérateur du film,
ethnographe autorisé du rituel qu’il est en train de filmer, connaisseur du pays et des
gens avec lesquels il est par ailleurs en terrain ami, est subjectif, revendique sa
subjectivité engagée dans la manière même de filmer. Les participants, surtout ceux dont
il décline le nom et la situation, « Daouda Sorko, fils de prêtre », « Samou Abeïdou, le
cultivateur de Simiri », « Wazzi... la ménagère de Simiri » sont chacun un individu
singulier à partir et autour duquel se cristallise la captation filmique des événements.
Ainsi, tous sont concernés par le projet d’« ethnographie à la première personne »,
puisque tous sont entraînés dans la même sphère d’une réalité enclose sur son filmage
immédiat. Or, on voit bien ici que le temps, cette dimension impalpable censée
envelopper les trois dimensions visuelles de la représentation cinématographique, en est
la cause. C’est que, comme on dit qu’un même sang coule dans le corps des gens d’une
même famille, tous sont traversés par un même flux temporel. Le principe du tournage en
temps réel parvient à instaurer, semble-t-il, cette espèce de distribution égalitaire des
paramètres filmiques. Ici, Tourou et Bitti apparaît bien comme un accomplissement des
recherches de Rouch en matière de film ethnographique. Par la « ciné-transe », le pilier
essentiel de sa méthode de travail, expérimentée depuis ses tout premiers films, parvenir
à une « anthropologie partagée », son ambition humaniste, tôt affirmée elle aussi dans sa
carrière de cinéaste en Afrique.
22
Peut-on affirmer pour autant que Jean Rouch a trouvé le « sésame, ouvre-toi » du cinéma
ethnographique moderne grâce à une technique de tournage qui lui permet de
transformer le couple traditionnel de l’observateur et de l’observé en remodelant
l’interrelation entre les deux pôles ? Une réflexion de l’ethnologue Gaetano Garcia menée
à la fois sur Dieu d’eau de Marcel Griaule et Sigui Synthèse de Jean Rouch8, donne des
éléments de réponse qui peuvent concerner tels quels Tourou et Bitti.
La production de Rouch, écrit-il, s’inscrit dans une perspective mythopoïétique. (...)
Du mythe on passe à la mythographie filmique puisque sans ce désir de bouclage
ethnographique et dramatique le rite n’aurait pas lieu à [Simiri] 9 (...). Rouch a saisi,
avec sagacité, le moment où le film devait coller à la réalité à travers l’usage du son
direct et des longs plans-séquences. Son cinéma n’enregistre pas la réalité mais la
soumet au moins, à un point de vue, à un rythme, à un montage [pour Tourou et Bitti,
comme pour Gare du Nord, montage dans le plan] et, préalablement, à une mise en
scène. Il lui est donc loisible d’assumer ce que l’ethnographie textuelle n’ose pas faire,
c’est-à-dire le caractère délibérément construit de sa documentation filmée.
23
Oui, semble dire, un ethnologue contemporain : le passage du rapport verbal
(« l’ethnologie textuelle ») au document filmé a débridé la discipline et le passage du
document filmé au film mis en scène est autorisé puisqu’il est « producteur d’une
réalité ». Cette liberté d’action et de pensée est bien un trait moderne de l’ethnologie. Or,
�111
Garcia fixe l’origine d’une telle modernité dans le travail de Griaule. Celui-ci « conçoit
Dieu d’eau comme une œuvre révolutionnaire, destinée à transformer l’approche par
l’ethnologie des civilisations “noires”. (...) Le mythe est désormais défini comme la plus
haute activité spéculative dont le chercheur occidental doit prendre connaissance de
façon lente et non linéaire. (...) Dieu d’eau est une œuvre mixte, entre littérature et
ethnographie ». La rencontre entre Griaule et Rouch a notablement contribué à renforcer
cette tendance. Et Rouch, par la suite, n’a pas cessé de vouloir faire évoluer dans un même
mouvement créatif son travail d’ethnographe et son œuvre de cinéaste. Le plan-séquence
en temps réel de Tourou et Bitti est un endroit singulier de cette évolution, sans doute
extrême, parce que la fusion entre deux traits modernes spécifiques à l’ethnologie d’une
part, au cinéma d’autre part, est atteinte. Ou encore, « l’anthropologie partagée » et la
« ciné-transe » font naître un hybride, le film « ethnofictif », sur un paradoxe plutôt
vertigineux. Tourou et Bitti, en effet, est de tous les documents filmés par Rouch le seul
dont l’écriture par le montage se fait à vif, faisant écho sur ce point à la plus
cinématographique des fictions de Rouch, Gare du Nord.
24
Au bout du plan-séquence, l’assombrissement du ciel, indiquant la limite à venir d’un
événement où coïncideront à la fois la fin de la journée, l’aboutissement espéré d’un
rituel et, de surcroît, la fin de la pellicule utilisable, vient renforcer le processus de
l’ethnofiction. Car ce rapide passage à la pénombre, lors d’un film tourné en temps réel
qui commence en pleine lumière du jour et s’achève à peine dix minutes plus tard, paraît
vraiment surnaturel, baigné de la magie propre au rituel animiste filmé. On se souvient
du dernier plan de Yenendi, les faiseurs de pluie10 où le montage filmique coïncidait
parfaitement avec le rituel appelant la pluie, ce qui conférait, en somme, au cinéma la
fonction d’un génie de la pluie. Ici, sans montage à proprement parler, Rouch est parvenu
au même résultat, instillant un maximum de fiction dans un film qui reste pourtant
intégralement documentaire.
NOTES
1. Voir mon découpage intégral dans Visions de nuit, Cinergon, n° 8/9, op. cit., pp. 33-44.
2. Le cinéaste pensait de ce film qu’il était « complètement idiot » et qu’il constituait tout au plus
« une expérience pardonnable ». Voir François Truffaut, Le Cinéma selon Hitchcock, Paris, Seghers,
1975 (réed.), pp. 202-207.
3. Jean-André Fieschi parle à ce sujet d’« une gageure, renouant avec celle de Rope ». « Dérives de
la fiction », op. cit., p. 263.
4. Frédéric Sabouraud, « Paris vu par Jean Rouch », Forum des Images, février 2005 (site Internet :
forumdesimages.net).
5. Gilles Deleuze : « Ce qui compte [chez Godard], ce n’est pas 2 ou 3, ou n’importe combien, c’est
ET, la conjonction ET. L’usage du ET chez Godard, c’est l’essentiel », in « Trois questions sur six
fois deux (Godard) », n° 271, novembre 1976, repris dans Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 64.
6. Philippe Despoix, « L’invention barbare. Dialogue en marge d’un congrès d’ethnographie (à
propos de Tourou et bitti) », Hommage à Jean Rouch (1917-2004), novembre 2004. Site
Internet.horschamp.qc.ca.
�112
7. René Prédal, Jean Rouch ou le ciné-plaisir, « filmographie », op. cit., p. 219.
8. Gaetano Garcia, « L’ethnofiction à l’œuvre-Prisme et images de l’entité dogon », in Passés
Recomposés, n° 5, automne 2002. Publication en ligne du CERCE. Je souligne.
9. L’auteur écrit : « à Songo », je transpose.
10. Voir supra, p. 96.
�113
Chapitre 9. L’invention du mythe
D’UNE 2 CV À L’AUTRE
« – Jean Rouch : « On racontait le mythe et tout le
monde y croyait C’est après qu’est venue
l’écriture »
– Jean Sauvy : « Ce qui m’a plu, c’est de constater
que le véritable Dionysos présent dans le film, ce
n’était pas le personnage grec transfiguré, mais
Jean Rouch lui-même, et qu’Ariane, la compagne
de Dionysos, n’était pas une jeune femme, mais la
caméra de Rouch. »
1
À l’évidence, Dionysos, un film de 1984, est une somme. Les mélanges constitutifs jusque-là
d’une œuvre composite, bariolée, hétérogène cherchent à s’harmoniser dans un récit qui
les subsumerait. Drôle d’harmonie en fait, puisqu’elle se réalise au moyen de la
mémoration d’un dieu qui apportait le désordre partout sur son passage ! Or, selon un
paradoxe spécifique, dans l’œuvre de Jean Rouch il n’y pas de désordre qui ne serve à
l’entêtante et inlassable construction de cycles. A cet égard, Dionysos, film entièrement
français puisque tourné en France, à Paris et en forêt de Meudon, avec une équipe
technique française, est à mettre en regard de plusieurs films documentaires que Rouch a
tournés en Afrique : Au Pays des mages noirs et Bataille sur le grand fleuve, dans lesquels on
voyait des pêcheurs Sorko chasser des hippopotames sur le Niger, et La Chasse au lion à
l’arc, un long périple avec des chasseurs Haoussa qui actualisaient une pratique
ancestrale. Quels rapports peut-on établir entre ces films d’Afrique et Dionysos, alors que
leur statut, leur fonction, leur ancrage culturel et institutionnel, et même le schéma
narratif les différencient, puisque dans un cas il s’agit d’éliminer des créatures, dans
l’autre, il s’agit, au contraire, d’inventer une créature nouvelle ? Trait encore plus
discriminant : Dionysos est une pure fiction alors que les trois films d’Afrique sont des
reportages au long cours. Ces différences ne doivent pas cacher certaines similitudes. Les
pêcheurs d’Au Pays des mages noirs et de Bataille sur le grand fleuve, transformés en
protagonistes d’un récit picaresque, appartiennent à un monde animiste qui les met en
communication directe avec les esprits. Ceux de La Chasse au lion à l’arc chassent moins les
�114
lions qu’ils ne tentent de dialoguer avec l’esprit de l’un d’entre eux. Ainsi placés sous les
auspices d’une coutume immémoriale liée à une conception religieuse, ces trois récits
filmiques mettent en œuvre avec une intensité particulière la « fable documentaire ».
COCORICO ! MONSIEUR POULET
2
Cependant l’idée d’un processus cyclique incessant dans l’œuvre de Rouch, se révèle
comme une évidence à travers un lien on ne peut plus concret avec une de ses fictions
africaines, Cocorico ! Monsieur Poulet. Ce film de 1974 est lui-même déjà inséré dans le tissu
d’un cycle puisqu’il est une reprise de Jaguar, qu’à son tour viendra prolonger Petit à Petit
quelques années plus tard. On a là quatre films dont Dionysos est le dernier avatar, le point
d’arrivée si l’on veut, d’une idée, d’une figure, dont Cocorico ! Monsieur Poulet ancre en
premier la représentation dans l’image d’un vulgaire objet transcendé par un mythe.
Dans ce film, le territoire parcouru est de modestes dimensions, comparativement à celui
de Jaguar, mais la sorte de voyage qui s’y accomplit en fait un road-movie, ce qu’était déjà
Jaguar. Les protagonistes du voyage sont les mêmes que ceux de Jaguar et de Petit à petit, à
savoir Damouré, Lam et Tallou.
3
Enfin, les trois compères sont associés dans une entreprise commerciale là encore : le
commerce du poulet dans la brousse environnant Niamey. Mais rapprocher Cocorico !
Monsieur Poulet de Jaguar et de Petit à Petit permet aussi de constater que le rapport de Jean
Rouch à la fiction a subi une inflexion décisive. Les aspects pratiques, réels, du commerce
constituant l’action essentielle du film ont si peu d’importance que celui-ci apparaît tout
au plus comme un prétexte. Prétexte à quoi ? Le voyage des trois compères est rythmé
par la rencontre récurrente d’un personnage étrange : une femme chasseur, tantôt
d’éléphants, tantôt d’hippopotames, qui est sans doute un « diable », en tous cas un génie,
exerçant son pouvoir maléfique sur Damouré en le rendant à chaque rencontre
passagèrement fou. Sa présence fait entrer de plain-pied le spectateur dans le monde de
la magie animiste.
4
Parallèlement, Cocorico ! Monsieur Poulet offre la vision d’une autre créature elle aussi très
étrange : c’est une voiture, une vieille camionnette 2 CV Citroën. La manière dont elle est
représentée laisse deviner le projet de Dionysos à savoir, la sublimation d’un objet
prosaïque en fétiche iconographique. Le véhicule conduit par Lam est en effet si
ahurissant qu’il sort de l’ordinaire, cet ordinaire fût-il africain et le plus souvent peuplé
de voitures rafistolées, comme c’est bien sûr le cas ici. La 2 CV a été transformée,
transfigurée même. Les ailes avant du capot ayant été retirées, elle prend en effet l’allure
d’un animal. Tout y est : le mufle figuré par le dessus restant du capot posé de guingois
sur la calandre, les pattes avant formées par les deux roues exagérément écartées, le
pelage correspondant au jaune beige plutôt sale de la carrosserie, l’allure clopinante
comme celle d’un être vivant ralenti par la vieillesse. Tout au long du film, le moteur de la
voiture qui ne cesse bien sûr de tomber en panne est démonté et remonté et chacune de
ces opérations, exécutées avec bonhomie soit par Lam, soit par Tallou censé être son
apprenti, prend le caractère indéniable d’une consultation médicale. La relation entre les
humains et la voiture est à proprement parler extravagante puisque chaque situation
banale de la conduite automobile donne lieu à l’invention d’un geste inédit qui marque
une symbiose essentielle entre les deux. Ce geste par exemple : la voiture n’a pas de
rétroviseur, alors Lam, main gauche sur le volant, sort de l’habitacle sa main droite,
armée d’un miroir. Ainsi, il est le rétroviseur de la voiture comme elle est sa monture.
�115
Autrement dit, l’un et l’autre sont appariés en fonction d’un trait commun : l’homme a un
double, la voiture aussi, de même la femme chasseur est le double incarné d’un génie. Le
pays Djerma environnant Niamey est animiste et la fiction mise en œuvre par Rouch et
ses amis nigériens ne fait rien d’autre, après tout, que donner une forme à la nature toute
spirituelle d’un réel partagé par tous mais a priori intransmissible par des images
figuratives, analogiques, comme celles du cinéma. D’où le grimage de la voiture qui
aboutit à sa transformation effective. On n’est pas ici dans le domaine de la comparaison –
la 2 CV n’est pas comme un animal, elle est un être animé – mais plutôt dans celui de la fable
mythologique. Elle se démarque de la « fable documentaire » (qui s’enlève notablement
sur la parole), en ceci qu’elle donne au cinéma la possibilité de créer avec ses seuls
moyens visuels une sur-réalité se substituant sans aucun intermédiaire d’aucune sorte à
la simple réalité dont les êtres humains ont ordinairement la perception.
DIONYSOS
5
Or, le récit de Dionysos, lui aussi dédié à une 2 CV Citroën, fait l’objet d’une digression
également fabuleuse, à partir d’un matériau de référence tangible. Ainsi ce film,
étrangement mais typiquement rouchien, coud ensemble des péripéties disparates et
tisse dans les profondeurs de la trame du récit des matériaux hétérogènes. On y voit en
effet, un universitaire américain, Hugh Gray, éventuelle réincarnation de Dionysos,
soutenir en Sorbonne une thèse d’anthropologie sur « la nécessité du culte de la nature
dans les sociétés industrielles ». Devenu chef d’atelier dans une firme automobile, assisté
des Ménades et d’ouvriers français et étrangers, il invente à partir d’une vieille 2 CV une
voiture qui est d’abord démembrée, tel un taureau offert à un sacrifice, puis reconstruite
et repeinte à l’image, cette fois, d’une « panthère parfumée ». Le film s’achève sur la
célébration d’une fête dionysiaque dont la voiture est l’héroïne. Hugh Gray quitte l’usine,
ses amis et se prépare à rentrer en Amérique... Ce scénario obéit manifestement à la loi
d’un syncrétisme affirmé qui met en contact des cultures, des pratiques et des gens très
différents, très éloignés même les uns des autres. Par exemple, les acteurs offrent une
particularité remarquable. Si, comme dans toutes les fictions de Rouch, ils sont des
amateurs et jouent des personnages en relation avec leur personne propre, certains
d’entre eux sont de surcroît des alter ego de Rouch quant à leur appartenance
socioprofessionnelle. Hugh Gray est interprété par l’anthropologue, cinéaste et poète Jean
Monod ; dans le jury de sa thèse, on voit siéger Jean Sauvy, Germaine Dieterlen et Enrico
Fulchignoni ; à ses côtés, on trouve l’ethnologue Hélène Puiseux dans le rôle d’Ariane ! A
ces personnages, ici liés à la Sorbonne, un haut lieu de la culture savante, Rouch
confronte d’une part, un chef d’entreprise (interprété par un vrai directeur d’usine) et un
agent de maîtrise ouverts aux innovations, d’autre part, des ouvriers et ouvrières qui
rappellent certes ceux de Jean-Luc Godard dans La Chinoise mais surtout, donnent à leur
travail d’usine un tour artistique : leur équipe fonctionne en fait comme un orchestre de
musique d’inspiration variée. Rouch précise d’ailleurs que les pseudo-ouvriers de son film
sont « des musiciens venus de tous les coins du monde, à qui nous avons demandé de faire
une musique composée (...) que l’on n’avait jamais entendue auparavant »1. Le contraste
le plus accusé est bien sûr celui qui met en regard un mythe grec souvent commenté mais
peu ou mal connu des non-spécialistes, à savoir la majorité des gens, et une automobile,
symbolisant toutes les aspirations matérielles du petit peuple français des temps
�116
modernes, Rouch compris, lui dont la voiture d’élection pour se déplacer en France (du
moins dans Paris et Nanterre) était la 2 CV Citroën.
LE DÉSORDRE CRÉATEUR
6
Le résultat de cette entreprise extravagante est déroutant. On doit à Jean Rouch lui-même
d’avoir indiqué la mesure du phénomène :
Un film doit être avant tout un objet inquiétant que l’on met en circulation. Si les
spectateurs sont inquiets quand ils voient la transformation d’une 2 CV, d’abord en
taureau qui saigne, c’est qu’ils auront retrouvé en eux les anciens mythes, les vieux
rituels du sacrifice ; s’ils admettent que cette voiture est devenue à la fin une
véritable panthère parfumée, ils se demanderont : pourquoi parfumée ? Il faut
relire Hésiode et vous découvrirez que la panthère est le seul animal qui a une
haleine tellement bonne qu’elle n’a qu’à ouvrir la bouche pour que les lapins y
viennent. Il vaut mieux que la voiture soit devenue une panthère que mettre un
tigre dans son moteur1.
7
Rouch est un naïf, oui, mais un naïf lettré et sans doute, un peu rusé. Le malaise que
d’aucuns ont pu ressentir à la vision de Dionysos vient en partie de là. Car en effet, le
spectateur qui n’a pas lu Hésiode mais qui connaît éventuellement le cinéma
ethnographique de Rouch, ou bien le cinéphile qui a vu ses grandes fictions africaines, se
trouvent devant un film peu compréhensible, déconcertant même. Le film lui-même
suggère son inaccomplissement, avec cette fin évasive, comme si les scénaristes n’avaient
pas clairement voulu indiquer au spectateur quel horizon atteindre. Et parmi eux, Rouch
est le plus engagé à cet égard. Ayant abandonné la caméra, avec laquelle il est apparu à
l’image à plusieurs reprises, il quitte le bois de Meudon sur une bicyclette, posée là
comme par hasard – ou par magie – et, semblable au personnage de la dernière vignette
d’une bande dessinée un peu bâclée, il crie à Hugh Gray (ou à Jean Monod ?), en
s’éloignant : « Moi, comme toi, je continue à chasser l’imaginaire à travers l’espace et les
saisons ». C’est là une façon de renvoyer le spectateur à une fin dont les enjeux sont
esquivés avec une désinvolture affichée. Le critique René Prédal va même jusqu’à écrire
que « la fête est cinématographiquement pitoyable » et il se demande si Rouch n’a pas
« complètement échoué dans ce final ou s’est plutôt laissé guider par l’échec même du
concept, montrant seulement, en bon documentariste, qu’en 1984, entre la Sorbonne et
Citroën, les conditions ne sont pas réunies pour le retour de Dionysos »2. Certes, la naïveté
parfois ampoulée de Dionysos prête à sourire, le récit paraît s’embarrasser d’un savoir
livresque, abstrait, qui sied mal aux films d’action en général et qui, ici, ne permet pas
toujours d’assurer une adéquation suffisamment pertinente entre le prosaïsme des
actions telles qu’elles sont mises en scène et figurées, et leur valeur mythologique ajoutée
3
. La maladresse de l’ensemble n’est pas sans rappeler, en l’aggravant d’ailleurs, celle de
Petit à Petit, lui aussi chargé de références culturelles (Les Lettres persanes de Montesquieu
notamment) et lourd de préoccupations anthropologiques.
8
Pourtant, Dionysos, est un aboutissement, plutôt, dans ce film on voit se déployer à l’air
libre d’un récit quelque peu débridé les multiples facettes du mythe rouchien du cinéma.
Ce mythe est dionysiaque à n’en pas douter car Dionysos est le nom que Rouch donne enfin à
ce qui est ancien dans son cinéma, fondateur même, à savoir la « ciné-transe ». Le mythe
est en effet approprié : Dionysos, dieu du désordre, de la marge et de la transgression,
était l’étranger par excellence. La violence physique et les excès de toutes sortes attachés
à son culte étaient aussi bien un facteur de destruction et de renouveau que le symptôme
�117
justement désordonné, anarchique d’une ouverture à l’autre. A tous les sens du terme
puisque Dionysos ne prenait pas une figure simplement humaine, il pouvait s’incarner en
animal, âne, panthère ou léopard (comme dans le film où la carrosserie de la 2 CV
repeinte, même si celle-ci est une « panthère parfumée », rappelle les ocelles du pelage
d’un léopard). Dans la descendance du panthéisme des Grecs anciens, Dionysos s’était
réincarné en un taureau dont les célébrants des mystères orphiques se partageaient la
chair, de même que les ouvriers de l’atelier brandissent les « entrailles » de la 2 CV
déconstruite. Le mystère chrétien : « Buvez car ceci est mon sang, mangez car ceci est ma
chair », n’est pas si loin ! Dernier aperçu, ici essentiel sur le culte de ce dieu atypique : les
fêtes dionysiaques, musique et danse conjuguées, menaient les Ménades vers la transe de
possession. Comment, avec un tel décalque par le film du mythe et de ses prolongements
orphiques, ne pas voir la charge allégorique que Jean Rouch y a mise ? Dionysos/Hugh
Gray/Jean Monod sont les trois faces d’une même figure, celle que Jean Rouch assigne au
créateur, pourquoi pas lui-même ? Significativement, Dionysos apparaît d’abord comme
le contraire d’un démiurge puisqu’il met le monde en désordre, mais en fait, c’est un geste
(re)fondateur : il ne détruit pas le monde, il permet son renouvellement. A la permanence
et à la stabilité de la cité grecque, à son architecture policée, Dionysos oppose le dehors,
l’infini, l’ouvert, il rend vaine ou dérisoire la clôture des territoires, la protection des
frontières, le partage ordonné entre la lumière et les ténèbres.
9
Dionysos a au moins deux raisons de figurer comme forme terminale dans un film de
Rouch : il est le dieu de la transe, et la transe est le processus par lequel les doubles
s’incarnent, phénomène tôt recherché, sinon intériorisé par Rouch dans sa méthode de la
« ciné-transe » ; il est le dieu de l’altérité, la figure idéale du mouvement centrifuge à
l’origine même de son cinéma. En langage politique, il se pourrait que Dionysos soit le
modèle inspirant l’anarchie. En langage artistique, Rouch semble proclamer que la
création n’est pas une pure invention, elle est une intention, qu’elle s’appelle « volonté de
puissance » (Nietzsche), qu’elle soit un acte de « déconstruction » (Derrida), ou qu’elle
jaillisse comme une « ligne de fuite » (Deleuze). Tout le vouloir faire cinématographique
de Rouch tient dans ces termes auxquels renvoie particulièrement bien le paradoxe de la
fin inachevée et surtout, indéterminée de Dionysos. Rappelons-nous ici que déjà, en 1957,
le dernier plan de Moi, un noir, profitant d’un panneau indicateur fiché dans le sol d’un
terrain de construction, indiquait « fin de chantier » et suspendait là un récit qui n’était
pas enclos sur une vraie fin.
L’AUTRE EN SOI
10
Avant Rouch, un cinéaste avait déjà tenté de rapprocher bord à bord les rives de deux
civilisations que la Méditerranée n’était pas seule à séparer. C’est Pasolini qui en 1969,
dans ses Notes pour une Orestie africaine (Appunti per un’Orestiade Africana), met en contact
direct plusieurs états ou faits de civilisation selon un scénario complexe. L’Orestie
d’Eschyle dont il commence par présenter à un auditoire d’étudiants africains à Rome des
passages qu’il a lui-même traduits, fournit en effet la trame d’un film qu’il veut tourner
en Afrique, avec des acteurs africains que l’on voit à plusieurs reprises dans des bouts
d’essai : un jeune homme marche dans la brousse, c’est Oreste ; une jeune fille se recueille
sur une tombe, c’est Electre, comme, dans le film de Rouch, Hughes Gray est Dionysos. Par
ailleurs, le saxophoniste Gato Barbieri joue la musique du film, accompagné par deux
chanteurs de jazz, Yvonne Murray et Archie Savage. A Rome, on assiste même à un
�118
concert de free jazz qu’ils donnent avec deux autres musiciens. Pasolini fait plusieurs
apparitions dans le film. Or, la première d’entre elles montre son reflet dans la vitrine
d’un magasin d’une ville d’Afrique sur laquelle il a braqué sa caméra. Ici, la
correspondance avec la posture autoscopique de Rouch est parfaite ! Ce n’est pas la
première fois que le cinéma de Pasolini et celui de Rouch se croisent. Par exemple, la
réalisation d’Enquête sur la sexualité (Comizi d’Amore, 1964) rappelle explicitement celle de
Chronique d’un été. Pasolini fait le film avec l’écrivain Alberto Moravia et le psychanalyste
Cesare Musatti, comme Rouch avait travaillé avec Morin. Le jeu des questions/réponses
de l’enquête relève d’un schéma sociologique éprouvé. Les coauteurs interviennent avec
des commentaires de leur cru et dans des discussions. Le modèle de cette enquête sur les
mœurs sexuelles dans l’Italie urbaine des années soixante est bien celui qui associe la
sociologie de Morin au cinéma direct de Rouch pour Chronique d’un été1.
11
Ce détour par Pasolini, auquel conduit immanquablement un regard sur Dionysos, laisse
apparaître la veine mythographique qui n’a jamais cessé de parcourir l’œuvre de Rouch.
D’un côté, Œdipe roi (1967), Médée (1970), L’Évangile selon Saint Matthieu (1964) : chez
Pasolini, l’inspiration vient de la Grèce et du Moyen-Orient antiques, eux aussi
pourvoyeurs de rites animistes et elle vient également des premiers temps du monde
chrétien, moment de genèse à proprement parler cosmogonique. De l’autre côté, Les
Magiciens du Wanzerbé (1947), Cimetière dans la falaise (1950), Daouda Sorko (1967), Sigui
Synthèse (1995), etc. : chez Rouch, les rites magiques, à la fois liés au panthéisme animiste
des gens du fleuve (les pêcheurs Sorko par exemple) et à la cosmogonie de ceux de la
falaise (les Dogons) sont les chemins documentaires qui ont fini par indiquer au cinéaste
la voie vers la fiction de Dionysos. Dans ce film, tout être ou toute chose a un double, est
susceptible de se dédoubler à l’infini, la figure la plus convaincante à cet égard étant bien
sûr celle que Rouch en personne forme avec Jean Monod, doublé par Hugh Gray, luimême doublé par Dionysos ! Ces dédoublements inlassables sont un moyen de se perdre
en tant que tel pour se retrouver en tant qu’un autre. Chez Pasolini, l’autre est le poète,
lui seul plongé dans la « Réalité » qui est « aussi faite d’Irréalité (l’horrible irréalité des
petits-bourgeois) » et qui « se révèle quand bon lui semble »2. Dans un même esprit, la
renaissance – ou la résurgence – rouchienne de Dionysos vient fermer la boucle immense
de la Réalité dans laquelle Rouch a élu domicile dès son premier film. Les suivants
apportaient tous des éclairages différenciés sur cette Réalité dont Rouch paraît savoir
qu’elle ne peut pas se saisir, mais qu’il peut l’approcher et la percevoir en se glissant, à la
manière d’un génie, tel « l’invité divin » de Théorème, dans d’autres corps que le sien, qui,
en retour, reçoivent en partie ses sensations (de cinéaste et/ou d’ethnographe). Dans
Dionysos, le détournement des personnes n’est plus nécessaire. Hugh Gray, même attaché
à Rouch, est autonome parce que de son côté, ce dernier est clairement identifié et c’est
une série d’images enchâssées qui répond de lui. Image en abyme de l’homme à la caméra,
comme continuation éventuelle d’autres images avant celle-ci (Narcisse, Gorgone, Le
Caravage, Velasquez, Rembrandt, Vertov, Pasolini) ; image du cycliste, comme résurgence
d’un être composite, la « chimère » peut-être des temps mythologiques, qui part « chasser
l’imaginaire à travers l’espace et les saisons » ; image, enfin, d’un être introuvable en son
lieu, ce qui est d’ailleurs le cas des autres protagonistes, notamment ceux que l’on
évoquait tout à l’heure comme ses alter ego : Jean Monod, Hélène Puiseux, Enrico
Fulchignoni, Jean Sauvy. Sont-ils eux-mêmes ? Sont-ils leurs personnages ? Marque
rouchienne spécifique : il n’y a pas de réponse, du moins n’y-a-t-il pas d’intérêt
�119
particulier à répondre et c’est bien en cela que le film répond, lui, à l’exigence
dionysiaque du désordre.
12
Cette fois Rouch n’a plus eu besoin d’être ailleurs, dans la savane, sur les fleuves, dans les
villes d’Afrique. Il est chez lui, en Sorbonne, à Meudon, avec ses pareils et dans ce cadre
homogène, avec un peuple endogène serait-on tenté de dire, il trouve l’ouverture
indéfinie, il trouve Tailleurs indéterminé. Bien sûr, les ouvriers musiciens venus d’un peu
partout, diversement colorés, et les Ménades, elles aussi nuées entre elles selon des
origines continentales diverses (une Africaine, une Asiatique et une Européenne)
maintiennent le courant exotique qui traverse tout le cinéma de Rouch, plus
particulièrement celui qui transforme des Africains en personnages de films français (La
Punition ou Petit à Petit). Mais ici Tétrangeté enjeu, c’est celle de Rouch lui-même, avec sa
culture mélangée et hétérogène. Nanook et Robin des bois, poésie surréaliste,
mathématiques et physique des matériaux, ethnologie griaulienne, etc., sont autant
d’éléments qui, sur un mode aléatoire, tantôt raccordent, tantôt se différencient. Rouch
n’a que faire d’élaborer des continuités, de proposer des cohérences car, pris dans leur
ensemble, tous ses films forment un réseau et ce réseau, ou ce tissu, ce « texte » aurait pu
dire Roland Barthes, est comme un palimpseste. Les approximations, les discontinuités,
les paradoxes, les exagérations ou les négligences qui affectent les récits rouchiens sont
autant de trouées qui laissent transparaître une trame de fond. Seulement, personne ne
peut vraiment prendre pied sur cet univers du dessous, sur ce monde à demi-caché par la
luxuriance un peu flagorneuse des images mal faites, mais d’une élégance sans pareille. Il
y a une raison éventuelle à ce phénomène : les films de Rouch seraient porteurs d’un
conflit, ou d’une contradiction, qu’eux-mêmes méconnaîtraient, qui les traverserait tous
et qui en viendrait à constituer le sujet véritable de Dionysos, comme on dit d’un
symptôme qu’il manifeste enfin une maladie. Serait-ce que la contradiction entre les
racines de Rouch, bourgeoises, européennes, universitaires et son immersion immédiate
et durable dans des univers africains complètement différents, étrangers, n’ait jamais été
surmontée par lui et que tout son cinéma, qui est une grande affaire de dédoublement et
de projection identitaire en porte la trace jusqu’à ce que, enfin, Dionysos, le dieu de la
possession, autrement dit du dessaisissement de soi, vienne justement apaiser ce conflit
en le laissant se propager dans la lumière des images filmiques ?
13
Et quand bien même l’interprétation psychologique ne serait-elle pas décisive, il resterait
la lumière, justement la lumière qu’un dieu du panthéon grec inspire à une œuvre
principalement dédiée aux génies de la terre, de l’air et de l’eau qui jusque-là hantaient
abondamment les films africains de Jean Rouch.
NOTES
1. « Jean
Rouch
parle
de
Dionysos :
“Une
expérience
ethnographiques” », in Jean Rouch ou le ciné-plaisir, op. cit., p. 202.
inséparable
de
mes
films
�120
1. Ibid. Je souligne : ici, Rouch fait allusion à une publicité bien connue des années 80, où
l’expression « mettre un tigre dans son moteur » avait largement débordé son usage commercial
pour devenir une sorte de cliché, ou de stéréotype culturel.
1. Dans son Pasolini, portrait du poète en cinéaste, Hervé Joubert-Laurencin mentionne le lien entre
les deux films, Paris, Éd. Cahiers du Cinéma, 1995, pp. 49-51.
2. Ibid.,p. 201.
2. P. P. Pasolini, La divine Mimesis, trad. Danièle Sallenave, Paris, Flammarion, 1980, p. 57.
3. Jean Sauvy parle de ce film comme d’un « “Super-Rouch”, délicieusement farfelu et
terriblement prétentieux », Jean Rouch tel que je l’ai connu, op. cit., p. 193.
�121
Conclusion
1
Une histoire de double : voilà l’œuvre de Jean Rouch, lui-même voué à un partage
fondamental entre deux fonctions. Ethnologue, il lui revient d’observer le monde.
Cinéaste, il lui est loisible de l’inventer. Les deux faces n’en forment qu’une grâce à un
choix initial qui va orienter et conditionner toute sa carrière : c’est l’observation de la
mentalité magique et son incarnation essentielle dans la transe de possession. À parcourir
la filmographie rouchienne, abondante et diverse, un thème ressort nettement : les
rituels où l’on attend les génies. Ils viennent ou ne viennent pas, mais dans tous les cas,
« l’anthropologie partagée » selon Rouch met en série, ou en miroir, la loi du
dédoublement qui gouverne aussi bien les filmés que le filmeur. Avoir choisi en tant
qu’ethnologue de s’intéresser aux rituels de possession et en tant qu’artiste d’en passer
par un mode d’expression fondé sur les techniques du cinéma direct constitue la clé d’un
dispositif qui aura permis à Rouch de transformer à la fois les enjeux de la recherche
ethnologique et ceux du cinéma qui prend celle-ci en charge.
2
Le résultat des changements opérés dans un domaine a priori réservé aux sciences
humaines est spectaculaire. D’abord, au sens littéral du terme : avant Rouch, bien des
voyageurs ont tenu une caméra de cinéma sous des cieux lointains pour capter des images
de rituels ou de coutumes étrangères. Mais l’on parle ici seulement d’« opérateurs » car
telle était leur simple fonction que l’on trouve d’ailleurs à l’origine du cinéma, celui des
vues Lumière et de leurs fameux « opérateurs ». Ainsi, dans la plupart des documents
ethnographiques antérieurs à ceux de Rouch, abordant ou non les mêmes questions, on
constate l’absence d’une recherche spécifique : celle de l’identité des filmés à eux-mêmes,
individu par individu. En effet, dans le droit fil de l’anthropologie occidentale, toute la
recherche ethnologique commence par s’intéresser, comme son nom l’indique, aux
ethnies et non pas aux individus. Rouch pour sa part innove dans le cinéma
ethnographique, puisqu’il trouve justement une voie d’accès à l’inaliénable singularité
des êtres. Cette voie correspond peut-être à une forme détournée de l’autoscopie, le
cinéaste se regardant en toute hypothèse dans le miroir de l’autre. Peu importe car ce
faisant, il utilise les possibilités qu’offre la dimension narcissique peut-être inévitable de
son travail, de telle manière qu’il transforme le domaine de la représentation de soi
ordinairement réservé à ceux et celles que le cinéma anthropologique observe. On a vu
par exemple Damouré Zika grandir à la fois en tant que lui-même et en tant que
protagoniste du cinéma de Rouch. Il n’est pas le seul, loin s’en faut, à venir et surtout à re-
�122
venir dans les images qu’il laisse ou sème derrière lui comme autant d’empreintes d’un
périple filmique, existentiel et incessant. On le suit à la trace mais cette trace est, film
après film, une constellation d’images. Chacune et toutes à la fois font reculer dans un
lointain improbable les images anthropologiques, générales, donc réductrices, que Rouch
ne voulait sans doute plus faire : Zika ne représente pas simplement une ethnie, il est en
son nom propre, Damouré Zika. De ce dernier, on retient l’image particulière d’un
personnage un peu hâbleur et goguenard, doté d’une forte personnalité. Le reste, le
substrat ethnographique, renversé sur ses bases, arrive de surcroît, comme la beauté. On
peut en faire l’épreuve à un autre titre : dans l’œuvre de Rouch, il semble que Zika a
plutôt des frères en cinéma que des concitoyens d’un même village ou des semblables
d’une même ethnie. En effet, en dehors de sa propre filmographie, des protagonistes
d’autres films de Rouch sont ses reflets ou ses doubles en tant que personnages tel,
notamment, Petit Touré alias Eddie Constantine, l’« agent fédéral américain » de Moi, un
noir, le colporteur qui fait une cour langoureuse à Dorothy Lamour. On le voit bien : pour
Zika, pour Touré et pour tous ceux que le cinéma rouchien met dans un rapport de
ressemblance avec ces derniers, l’être et l’image se confondent dans le personnage et
cette fusion unique et circonstancielle fait oublier la réalité en principe visée par
l’observation documentaire au profit de celle créée par le cinéma.
3
Un tel phénomène permet de dire du cinéma de Rouch qu’il est moderne parce qu’il met à
mal la traditionnelle dichotomie entre le documentaire et la fiction. Or, au-delà de ce
constat doublement banal – il a souvent été fait, il concerne bien d’autres cinéastes –
apparaît un autre couple : c’est celui du cinéma et de la télévision. Roberto Rossellini et
Jacques Rozier, deux cinéastes majeurs, de la même constellation à certains égards que
celle de Rouch, ont travaillé dès le début des années soixante pour la télévision, Rossellini
de manière intentionnelle et exclusive selon le « projet pédagogique » qu’on lui connaît 1,
Rozier commençant par réaliser un Jean Vigo en 1964 pour la très cinéphile collection de
Janine Bazin et André Labarthe, Cinéastes de notre temps. Un peu plus tard, Jean-Luc
Godard, qui fut, lui aussi, un proche de Rouch, a fait travailler le cinéma à la lumière de la
vidéo. Aujourd’hui, il n’est même plus possible de parler du cinéma hors du contexte
télévisuel dominant. Mais dans les années cinquante, rien de tel n’est encore advenu. Jean
Rouch fait des films de cinéma et même si au fil des ans la télévision est parfois devenue
un de ses producteurs ou coproducteurs, même s’il fréquente les plateaux pour
s’entretenir avec des critiques spécialisés ou présenter ses films, il n’abandonne jamais le
cinéma, plus particulièrement le format 16 mm. Pourtant, son influence se mesure mieux
du côté de la télévision que de celui du cinéma. En particulier, la « télé-réalité » qui
gouverne aujourd’hui les dispositifs télévisuels vient bien sûr du cinéma direct dans son
ensemble, du sien en particulier, notamment de la révolution documentaire que ce
cinéma a accomplie en se donnant les moyens de mettre au cœur des récits filmiques des
gens ordinaires, vus et entendus en synchronie dans leur vie quotidienne. On sait
comment ce dispositif s’est progressivement dévoyé en devenant ce contre quoi il s’était
constitué à son origine : l’image des uns jetée en pâture à des fins seulement
commerciales aux autres, les usagers modernes du spectacle de masse, les
téléspectateurs. Jean Rouch n’a pas fait de film de télévision2 et surtout, il n’a jamais
travaillé avec une caméra vidéo. D’un monde à l’autre, du cinéma à la télévision, du studio
de tournage au plateau d’émission télévisée, il n’y aura pas eu, pour lui, de passage. On
peut faire l’hypothèse que sa résistance à l’égard de la télévision et de la vidéo n’est pas
que le symptôme d’une cinéphilie prolongée. Quoi qu’il en soit, le fait est d’autant plus
intéressant que peu d’œuvres sont plus proches du devenir télévisuel du cinéma que celle
�123
de Rouch. Les réalisateurs de télévision le savent-ils ? Reconnaissent-ils Chronique d’un été
d’une part, La Punition d’autre part comme des prototypes de ce que seront bientôt les
enquêtes thématiques et les fictions documentaires télévisuelles ? La question reste
ouverte.
4
Quant au domaine plus restreint du cinéma anthropologique, Rouch laisse d’abord un
héritage, sinon des héritiers, parmi les cinéastes ethnographes à la formation desquels il a
contribué, soit sur le terrain, soit à l’université, soit à la Cinémathèque. Selon ce qui
devint très vite un rituel hebdomadaire notoire, il venait en effet au-devant de ses élèves
du Département d’Anthropologie filmique de l’Université de Nanterre, autant pour leur
montrer ses propres films que pour regarder les leurs, les critiquer ou les louer. Parmi
eux, il en est qui résistent à son œuvre, critiquent ses méthodes par trop personnalisées,
sa neutralité politique trop systématique, ses recours fréquents à des inventions de toutes
sortes. Faut-il s’en étonner ? Non, car Rouch, élève d’un célèbre ethnologue, est à son tour
devenu un maître de renom et destiné, à ce titre, à cristalliser des discussions. Ses films,
contestables ou non, sont inévitables pour qui entre en ethnologie aujourd’hui et
s’intéresse notamment aux rites animistes, à leur transformation dans des sociétés qui
elles-mêmes ont terriblement changé depuis la fin de l’ère coloniale. Les unes ont su ou
ont pu maintenir le passé dans le présent, parfois au prix d’accommodations de toutes
sortes (le tourisme en est une parmi d’autres), les autres non. Le matériau rassemblé par
Jean Rouch, essentiellement en Afrique de l’Ouest, même transformé par son art filmique
infatigable, est une mine d’informations pour l’ethnologie d’aujord’hui. A ce titre, Rouch
reste un des principaux cinéastes ethnographes du XXe siècle.
5
Hormis cette spécialité, peu de cinéastes s’inscrivent dans l’héritage de Rouch. Raymond
Depardon par certains aspects pourrait compter parmi ses héritiers, même si par leurs
sujets ses films documentaires se rapprochent davantage de ceux de Fred Wiseman – tous
deux regardent fonctionner les institutions en essayant de rendre manifestes leurs
aberrations et leurs effets sur les individus. Depardon a néanmoins fini par trouver des
formes filmiques qui sont une réaction à celles du cinéma de Rouch. Sa préférence pour le
cadre fixe, sa volonté de respecter une distance constante entre lui et les personnes
filmées, son goût de plus en plus affirmé pour des tournages en vidéo avec une caméra
toujours plus petite, sont des éléments que le photographe qu’il a toujours été a fini par
imposer à son cinéma contre ce qu’il faisait à ses débuts de cinéaste et qui lui était
nettement inspiré de Rouch. Il est dans la résistance, oui, mais de ce fait même, il
présente des ressemblances avec ce dernier : documentariste, comme Rouch l’a toujours
été, il subit lui aussi l’attraction de la fiction jusqu’à en faire un des moteurs essentiels de
son cinéma. Comme Rouch, il mène sa vie entre l’Europe et l’Afrique et pour signifier, ou
animer, ou interroger l’entredeux, il fait des films qui tissent des contrepoints volontaires
entre un continent et l’autre. Mais le rapprochement de ces deux cinéastes vaut moins
pour le style et le contenu des films que par la place d’exception occupée par eux dans
l’institution du cinéma. Rouch a (presque) été célèbre en son temps, celui de la Nouvelle
Vague, et sa notoriété est établie, alors même qu’il vient du cinéma documentaire. Même
chose pour Raymond Depardon dont la notoriété constitue une exception encore plus
flagrante que celle de Rouch. Aujourd’hui, il est (presque) un cinéaste grand public, tous
publics même.
6
Il faudrait, enfin, mesurer l’empreinte de Jean Rouch du côté du cinéma de fiction. Parmi
les auteurs de films évoqués au fil des pages, on trouve notamment Browning, Eustache,
Godard, Hitchcock, Kubrick, Lang, Méliès, Pasolini, Tarkovski, Truffaut, Welles. Cette
�124
confrontation montre bien la connivence de l’œuvre de Rouch avec une mémoire et une
culture qui doivent beaucoup à la grande forme fictionnelle du cinéma. On a vu qu’il fut
un compagnon de route de la Nouvelle Vague. Par la suite, il s’écarte des routes
principales du cinéma et retrouve plutôt son terrain d’origine, la recherche, notamment
celle qu’il poursuit au sein du C.N.R.S. Hormis Dionysos, aucun de ses films postérieurs à
Cocorico ! Monsieur Poulet ne connaît une diffusion en salle destinée au grand public. Ce
retrait explique peut-être pourquoi les films de Rouch exercent sur les cinéastes des
générations qui ont succédé à celle de la Nouvelle Vague une influence modeste, limitée
en tout cas à un cercle restreint. On serait en peine de distinguer tel(le) ou tel(le) cinéaste
qui aurait fait des films en les situant par rapport aux siens. Désaffection ?
Méconnaissance ? Un peu des deux sans doute. Le caractère africain du cinéma de Rouch,
son ésotérisme occasionnel, sa désinvolture formelle contribuent, parmi d’autres traits, à
entretenir la solitude cinématographique qui est la sienne. Solitude renforcée par son
rapport à la réalité, complètement dépris du réalisme qu’affectionne tant et depuis si
longtemps le cinéma français.
7
Alors il faut finir par se dire que si Rouch a fait des films comme personne avant lui, après
lui on ne fait pas de films comme les siens. Du moins, il n’est pas sûr de rencontrer des
spectateurs, d’être soi-même l’un d’entre eux qui, un jour, en voyant un film de voyage,
une aventure picaresque proche ou lointaine, une errance dialoguée dans les méandres de
l’imaginaire, une conversation avec les génies, ou encore une enquête ethno-sociologique
tournée ici ou là-bas, se prendra à songer que les images vues par lui aujourd’hui sont
inspirées par des images antérieures qu’aurait inventées le cinéma de Jean Rouch.
8
Un film thaïlandais contemporain éveille toutefois un écho rouchien, mais il est ténu :
c’est Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul. Il y est question de l’envoûtement
d’un homme par un tigre, à moins que ce ne soit l’inverse, l’un et l’autre se confrontant
dans un miroir dont le spectateur n’est pas à même de savoir lequel des deux le traverse.
Cette histoire indécise et pleinement merveilleuse existe déjà dans les films de Jean
Rouch.
NOTES
1. Voir Roberto Rossellini, La Télévision comme utopie. Textes choisis et présentés par Adriano Apra,
Paris, Auditorium du Louvre-Cahiers du Cinéma, coll. « Essais », 2001.
2. À l’exception, peut-être de Couleur du temps, Berlin août 1945 dont la filmographie de René Prédal
signale qu’il est produit par Télé Image en 1988.
�125
Bibliographie
ANTHROPOLOGIE/ETHNOLOGIE
GRIAULE Geneviève, Ethnologie et langage, la parole chez les Dogons, Paris, Gallimard, 1965.
DE FRANCE Claudine (dir.), Pour une Anthropologie visuelle, Paris-La Haye-New York, Mouton, 1979.
DE FRANCE
Claudine, Cinéma et anthropologie, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1982 et 1989
(réed.).
GARCIA Gaetano,
« L’Ethnofiction à l’œuvre. Prisme et image de l’entité dogon », Passés Recomposés,
n° 5, 2002.
GIBBAL
Jean-Marie, Citadins et villageois dans la ville africaine, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 1974.
GIBBAL Jean-Marie, Les Génies du fleuve. Voyage sur le Niger, Paris, Presses de la Renaissance, 1988.
GRIAULE Marcel, Masques dogons, Paris, Institut d’Ethnologie, 1938.
GRIAULE Marcel, Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Paris, Fayard, 1966 (réed., l re éd., 1948).
GRIAULE Marcel et DIETERLEN Geneviève, Le Renard pâle, Paris, Institut d’ethnologie, 1965.
LAJOUX
Jean-Dominique, « Film ethnographique et histoire », in Claudine de
FRANCE,
Pour une
anthropologie visuelle, 1979.
LAPLANTINE François, L’Anthropologie, Paris, Seghers, coll. « Clefs », 1987.
LATOUR Eliane (de), Les Temps du pouvoir, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1970.
LEIRIS Michel, L’Afrique fantôme, Paris, Gallimard, 1934.
LEROI-GOURHAN
André, « Le Film ethnographique existe-t-il ? », Revue de Géographie Humaine et
d’ethnologie, n° 3, Paris, 1948, pp. 42-51.
LÉVI-STRAUSS Claude, Tristes Tropiques, Paris, Pion, 1955.
LÉVI-STRAUSS Claude, Anthropologie structurale, Paris, Pion, 1973 (réed., l re éd., 1958).
LÉVI-STRAUSS Claude, Introduction à Marcel Mauss, Paris, PUF, 1960.
MAUSS
Marcel, Sociologie et anthropologie, PUF, coll. « Quadrige » (avec la préface de Cl. Lévi-
Strauss), 2002, Paris, 2002 (réed., lre éd. 1950).
MONOD Jean, Un riche Cannibale, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. 10/18, 1972.
�126
Edgar, Le Cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie, Paris, Gonthier, coll.
MORIN
« Médiations », 1958.
DIVERS
CAMUS
Sébastien, « La Passion de l’excès », Foucault, Derrida, Deleuze- Pensées rebelles. Sciences
Humaines, hors-série spécial n°3, juin 2005.
DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975.
GOMBRICH
Ernst, L’Art et l’illusion, trad. Guy Durand, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Sciences
Humaines, 1971 et 1987 (réed.).
MERLEAU-PONTY Maurice, Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1993 (réed.).
NADAR, Quand j’étais photographe, Paris, Le Seuil, coll. « L’École des Lettres », 1994.
SORLIN Pierre,
Les Fils de Nadar. Le « siècle » de l’image analogique, Paris, Nathan, coll. « Fac Cinéma »,
1997.
VERNANT
Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique, Paris, La
Découverte, 1996.
CINÉMA
AMENGUAL Barthélémy, Du Réalisme au cinéma, Paris, Nathan, 1997.
AUMONT Jacques, L’Œil interminable. Cinéma et peinture, Paris, Librairie Séguier, 1989.
AUMONT
Jacques, Ingmar Bergman. « Mes films sont l’explication de ma vie », Paris, Cahiers du Cinéma,
coll. « Auteurs », 2003.
BALÀZS Belà, Le cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau, Paris, Payot, 1979 (réed.).
BALÀZS
Belà « Conscience filmante », in Der Tag, 22 mars 1925, repris dans Le Génie documentaire,
Admiranda n° 10, Mireille Carlier, trad., Aix-en-Provence, 1995.
BAZIN André, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Le Cerf, 1975.
BAZIN
André (NARBONI Jean dir.), Le Cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague (1945-1958),
Paris, Cahiers du Cinéma-L’Étoile, 1983.
BURDEAU Emmanuel
(dir.), Jacques Rozier. Le funambule, Paris, Centre Pompidou-Cahiers du Cinéma,
coll. « Auteurs », 2001.
COLLEYN Jean-Paul, Le Regard documentaire, Paris, Centre Georges Pompidou, 1993
DELEUZE Gilles, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969.
DELEUZE Gilles, Cinéma 2 – L’image-temps, Paris, Minuit, 1985.
DEVARRIEUX Claire & DE NAVACELLE Marie-Christine, dir., Cinéma du Réel, Paris, Autrement, 1988.
DUBOIS Philippe, L’Acte photographique, Paris, Nathan, 1991.
EPSTEIN Jean, Écrits sur le cinéma, Paris, Seghers, Cinémaclub, 1974 (réed.).
ESQUÉNAZI Jean-Pierre, Godard et la société française des années 1960, Paris, Armand Colin, 2004.
FULCHIGNONI Enrico, La Civilisation de l’image, Paris, Payot, 1969.
GAUTHIER Guy, Le Documentaire. Un autre cinéma, Paris, Nathan Université, 1995.
GAUTHIER Guy, Un Siècle de documentaires français, Paris, Armand Colin, 2004.
GIRAUD Thérèse, Cinéma et technologie, Paris, PUF, coll. « Science, Histoire, Société », 2001.
�127
GODARD
Jean-Luc (BERGALA Alain dir.), Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Paris, Cahiers du
Cinéma-L’Étoile, 1985.
HAFFNER
Pierre, Essais sur les fondements du cinéma africain, Paris-Dakar, Nouvelles Éditions
Africaines, 1978.
HAFFNER Pierre & GARDIES André, Regards sur le cinéma négro-africain, Paris, OCIC, 1987.
JOUBERT-LAURENCIN Hervé, Portrait du poète en cinéaste, Paris, Cahiers du Cinéma, 1995.
LABARTHE André, Essai sur le jeune cinéma français, Paris, Le Terrain Vague, 1960.
LOURCELLES Jacques, Dictionnaire du cinéma. Les films. Paris, Robert Laffont, 1992.
MARCORELLES
Louis (avec
ROUZET-ALBAGLI
Nicole), Clefs pour un nouveau cinéma, Paris, U.N.E.S.C.O.,
1970.
MARIE Michel, La Nouvelle Vague. Une école artistique, Paris, Nathan Université, 1997.
MARSOLAIS Gilles, L’Aventure du cinéma direct, Paris, Seghers, Cinmaclub, 1974.
METZ Christian, « Le Cinéma : langue ou langage ? », Cahiers du Cinéma, n° 94, avril 1959.
MITRY Jean, Esthétique et psychologie du cinéma, 2 tomes, Paris,
PUF, 1963.
NINEY François, L’Épreuve du réel à l’écran, Bruxelles, De Bœck Université, 2000.
PASOLINI
Pier Paolo, L’Expérience hérétique, trad. Anna Rocchi Pull-berg, Paris, Ramsay, coll.
« Cinéma », 1989 (réed.).
PASOLINI Pier Paolo, La divine Mimesis, trad. Danièle Sallenave, Paris, Flammarion, 1980 (réed.).
PIAULT Marc-Henri, Anthropologie et cinéma, Paris, Nathan, coll. « Cinéma », 2000.
PRIEUR Jérôme, Le Spectateur nocturne, Paris, Cahiers du Cinéma, 1993.
ROSSELLINI Roberto, Le Cinéma révélé, Paris, Flammarion, coll. « Champs Contre-Champs », 1988.
SELLIER Geneviève, La Nouvelle Vague. Un cinéma au masculin singulier, Paris, CNRS Éditions, 2005.
TRUFFAUT François, Le Cinéma selon Hitchcock, Paris, Seghers, 1975 (réed.).
SUR JEAN ROUCH (LIVRES)
GALLET Emmanuel (dir.), Jean Rouch une rétrospective, Paris, ministère des Affaires étrangères, 1981.
PRÉDAL René (dir.), Jean Rouch, un griot gaulois, Cinémaction, n° 17, Paris, L’Harmattan, 1982.
PRÉDAL René (dir.), Jean Rouch ou le ciné-plaisir, Cinémaction, n° 81, Paris, Corlet-Télérama, 1996.
SAUVY Jean, Jean Rouch tel que je l’ai connu, Paris, L’Harmattan, 2006.
SCHEINFEIGEL
Maxime, Les Âges du cinéma. Trois parcours dans l’évolution des représentations filmiques,
chapitre 1 : « Un auteur nouveau : Jean Rouch », Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 23-101.
TOFFETTI
Sergio, dir., Jean Rouch et le renard pâle, Centre Culturel Français de Turin/Cinémathèque
de Turin, 1992.
Collectif : Jean Rouch. Catalogue de la rétrospective, Galerie nationale du Jeu de Paume, Éditions du
Jeu de Paume, 1992.
SUR JEAN ROUCH (SÉLECTION D’ARTICLES)
BÉGHIN Cyril, « Jean Rouch, esprit de cinéma », Cahiers du Cinéma, n° 589, avril 2004, pp. 43-44.
�128
BORY
Jean-Louis, « Vessies et lanternes », Le Cinéma et la vérité (ciné-œil, Candid Eye, Free Cinema,
cinéma-vérité), Artsept, n° 2, 1963.
BOUCHARD
Vincent, « Jean Rouch et l’Office National du Film », Montréal, Hors-Champs, 9
novembre 2004.
BURCH Noël, « Fonctions de l’aléa », Cahiers du Cinéma, n° 197, 1967, p. 53.
DELAHAYE Michel, « La règle de Rouch », Cahiers du Cinéma, n° 120, 1961.
DESPOIX
Philippe, « L’invention barbare. Dialogue en marge d’un congrès d’ethnographie (à propos
de Tourou et bitti), Hors-Champs, n° 9, Montréal, 2004.
FIESCHI
Jean-André, « Dérives de la fiction : notes sur le cinéma de Jean Rouch », in Dominique
Noguez, Cinéma : Théorie, Lectures, Paris, Klincksieck, 1973 et 1978 (réed.), pp. 255-264.
GODARD Jean-Luc, in Alain Bergala, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Cahiers du Cinéma, 1985 :
• « Jean Rouch remporte le prix Louis Delluc », p 155.
• « Étonnant (Moi, un Noir, Jean Rouch) », pp. 177-178.
• « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens (Jean Rouch) », pp. 180-183.
GOLDMAN Lucien,
« Cinéma et sociologie. Réflexions à propos de Chronique d’un été », Le Cinéma et
la vérité, Artsept, n° 2, 1963.
LABARTHE André, « Jean Rouch et les films de vérité », Radio-Cinéma-Télévision, n° 447, 1959.
ID., « Chronique d’un été », France-Observateur, n° 576, 1961, p. 27.
LARDEAU Yann, « Le Partisan du désordre créatif », Cahiers du Cinéma, n° 589, pp. 45-46.
LEFEBVRE Jean
& PILON Jean-Claude, « L’équipe française souffre-t-elle de la Roucheole », Montréal,
Objectif, n° 18, 1964.
SABOURAUD
Frédéric, « Paris vu par Jean Rouch », site Internet : forumdesimages.net/fr/alacarte/
htm/LEPARISDE/ROUCH/content.htm.
SCHEINFEIGEL
Maxime, « Jean Rouch ou la magie du direct » et découpage de Moi, un Noir, L’Avant-
Scène, n° 265, 1981.
ID, « Directement la fiction », Cinémas et Réalités, C.I.E.R.E.C., 1984, pp. 97-106.
ID.,
« Éclats de voix (Robinson ne dit pas son vrai nom) », Le Génie documentaire, Admiranda, n° 10,
1995, pp. 110-118.
ID.,
« De la nuit et des formes » et découpage de Gare du Nord, Visions de nuit, Cinergon, n° 8/9, 2000,
pp. 23-44.
WEYERGANS François, « La Pyramide humaine », Cahiers du Cinéma, n° 121, 1961, pp. 25-26.
WHITE Bob, « Hommage à Jean Rouch : caméra intouchable », Montréal, Hors-Champs, n° 9, 2004.
LIVRES ET ARTICLES DE JEAN ROUCH (SÉLECTION)
« Aperçu sur l’animisme Songhay », Notes Africaines, Dakar, 1943, pp. 4-8.
« Culte des génies chez les Songhay », Journal de la Société des Africanistes, Paris, vol.
XV,
1945, pp.
15-32.
« Banghawi, chasse à l’hippopotame au harpon par les pêcheurs Sorko du Moyen Niger », Bulletin
de l’IFAN, Dakar, 1948, pp. 361-367.
« Cinéma d’exploration et ethnographie », Les Beaux Arts, Bruxelles, 1952, pp. 17.
« Renaissance du film ethnographique », Le Cinéma éducatif et culturel, n° 5, Rome, 1953, pp. 23-25.
« À propos des films ethnographiques », Positif, Paris, 1955, pp. 144-149.
�129
« La Pyramide humaine (scénario) », Cahiers du Cinéma, n° 112, 1960, pp. 15-27.
« L’Africain devant le film ethnographique », Le Cinéma et l’Afrique au sud du Sahara, Bruxelles,
1958, pp. 92-94.
« Treichville : extraits », Cahiers du Cinéma, n° 90, 1958, pp. 50-52. La Religion et la magie Songhay,
Paris, PUF, 1960. Chronique d’un été, avec Edgar Morin, Inter-Spectacles, Domaine Cinéma, 1962 .
« Cinéma-vérité », Contre Champ, n° 3, Paris, 1962.
« Gare du Nord » (propos dans « Petit Journal »), Cahiers du Cinéma, n° 171, 1965, p. 11.
« Jaguar : extraits », Cahiers du Cinéma, n° 200-201, 1968.
« Le film ethnographique », in Jean Poirier, Ethnologie générale, Gallimard, 1968, pp. 429-471.
« Je suis mon premier spectateur », Le Monde, 16 septembre 1971 (repris dans L’Avant-Scène
Cinéma, n° 123).
« Aventures d’un nègre blanc », Image et Son, n° 249, 1971, pp. 55-83.
« Anthropologie et impérialisme », Les Temps modernes, n° 293-294, 1971.
« L’ethnologie au service du rêve poétique », Le Devoir, Montréal, 18 septembre 1971.
« Essai sur les avatars de la personne du possédé, du magicien, du sorcier, du cinéaste et de
l’ethnographe », in La Notion de personne en Afrique noire, Paris, C.N.R.S., 1971, pp. 529-544.
« Cinq regards sur Dziga Vertov », préface à Georges Sadoul, Dziga Vertov, Paris,Champ Libre,
1972.
« La Chasse au lion à l’arc », Image et Son, n° 259, (spécial programmation UFOLEIS), 1972.
« La caméra et les hommes », in Claudine de France, Pour une Anthropologie visuelle, La Haye,
Mouton, 1973, pp. 53-71.
« Le Renard fou et le maître pâle », Systèmes de signes, hommage à Germaine Dieterlen, Paris,
Hermann, 1978, pp. 3-24.
« Pour une anthropologie enthousiaste (Titre d’honneur pour Marcel Griaule) », in
ZAHAN
Dominique (dir.), Ethnologiques. Hommages à Marcel Griaule, Paris, Hermann, 1987, pp. 307-312.
ENTRETIENS (SÉLECTION)
« Propos et questions à l’auteur par Marcel Martin », Cinéma 60, n°51, 1960, pp. 14-20.
« Jean Rouch. Jaguar ». Propos recueillis au magnétophone par Jean-André Fieschi et André
Téchiné, Cahiers du Cinéma, n° 114, pp. 17-20.
« Entretien avec Jean Rouch » par Eric Rohmer et Louis Marcorelles, Cahiers du Cinéma, n° 144,
juin 1963.
« Jean Rouch cinéaste », propos recueillis par Laurent Devanne, site Internet : arkepix.com/
kinok/Jean%20ROUCH/rouch_interview.
Html., 1998.
« Jean Rouch, maître du désordre », entretien réalisé par Emile Breton, L’Humanité, 14 avril 1999.
« Jean Rouch », Entretiens et interventions, cinéma Les 400 Coups, octobre 1999, site Internet :
cine.beaujolais/Rouch.
« Le Monde selon Rouch », propos recueillis par Jean-Luc Bitton et Laurence Pinsard, site
internet : routard.com/mag_invite.asp%20?id_inv=18,%202001.
�130
DÉCOUPAGES DE FILMS
« La Chasse au lion à l’arc », découpage complet, L’Avant-Scène Cinéma, n° 107, 1970.
« Petit à petit », découpage complet, L’Avant-Scène Cinéma, n° 123, 1972.
« Moi, un noir », découpage complet, L’Avant-Scène Cinéma, n° 265, 1981.
« Gare du Nord », découpage complet, Visions de nuit, Cinergon, n° 8/9, 2000.
�131
Filmographie sélective
1
1946 – Au Pays des mages noirs
2
16 mm, distribué par Les Actualités Françaises (gonflé en 35), 13 mn.
3
Coréalisateurs : Jean Sauvy et Pierre Ponty.
4
Sur le fleuve Niger : chasse à l’hippopotame au harpon.
5
1947 – Les Magiciens du Wanzerbé
6
Collaboration : Marcel Griaule.
7
Noir et blanc, 34 mn.
8
Rituels de magiciens au Wanzerbé (Niger).
9
1951 – Bataille sur le grand fleuve
10
Kodachrome, 33 mn.
11
Production : J. Rouch, R. Rosfelder, I.F.A.N.
12
Distribution : C.N.R.S. Audiovisuel.
13
Préparatifs et déroulement d’une chasse coutumière à l’hippotame sur le Niger.
14
1951 – Les Hommes qui font la pluie (ou, Yenendi, les faiseurs de pluie)
15
Kodachrome, 30 mn.
16
Assistant opérateur : R. Rosfelder.
17
À Simiri au Niger : rituel Songhaï consacré à la pluie (danses, transes de possession).
18
1954 – Les Maîtres fous
19
Couleurs, 36 mn.
20
Production : Films de la Pléiade.
21
Son : Damouré Zika. Montage : Suzanne Baron. Commentaire : Jean Rouch.
22
Prix de la Section Ethnographique du Festival de Venise 1957.
23
Secte des Haoukas (formée d’émigrés nigériens) : rituel religieux dédié aux dieux
nouveaux dans la banlieue d’Accra, Ghana (ex Gold Coast).
24
1958 – Moi, un noir
25
Eastmancolor, 70 mn.
�132
26
Production : Films de la Pléiade (Pierre Braunberger). Direction de production : Roger
Fleytoux.
27
Son : André Lubin, Radio Abidjan. Chants : Myriam Touré, Amadou Demba, N’Diaye Yero.
Montage : Marie-Josephe Yoyotte, Catherine Dourgnon.
28
Interprètes principaux : Oumarou Ganda (Edouard G. Robinson), Petit Touré (Eddie
Constantine), Mademoiselle Gambi (Dorothy Lamour), Seydou Guédé (Facteur), Karidyo
Daoudou (Petit Jules), Alassane Maiga (Tarzan, Johnny Weismüller), Amadou Demba
(Elite).
29
Paroles et commentaires postsynchronisés : Oumarou Ganda, Petit Touré, Seydou Guédé.
30
Commentaire en voix off : Jean Rouch.
31
Prix Louis Delluc 1958.
32
En Côte-d’Ivoire, une semaine de la vie d’un petit groupe d’émigrés nigériens à
Treichville, quartier populaire d’Abidjan.
33
1959 – La Pyramide humaine
34
Eastmancolor. 90 mn.
35
Production : Films de la Pléiade. Images : Louis Miaille. Son : Michel Fano. Montage :
Marie-Josephe Yoyotte, Geneviève Bastide. Principaux interprètes : Nadine Ballot, Denise
Alain, Jean-Claude, Landry.
36
Tensions amoureuses et confrontations entre Noirs et Blancs, dans une classe d’un lycée
d’Abidjan.
37
1960 – Chronique d’un été
38
Eastmancolor. 90 mn. Premier usage de la caméra Coutant-Mathot-KMT 16 mm pilotée
par fil avec un magnétophone Nagra Neopilot Perfectone.
39
Production : Argos Films (Anatole Dauman). Scénario : Edgar Morin et Jean Rouch.
Images : Roger Morillère, Raoul Coutard, Jean-Jacques Tarbès, Michel Brault. Montage :
Jean Ravel, Nina Baratier, Françoise Colin.
40
Protagonistes principaux : Marceline Loridan, Mary-Lou Parolini, Angelo Borgien, JeanPierre Gabillon, Régis Debray, Nadine Ballot, Landry.
41
Été 60 à Paris (et incursion sur la Côte d’Azur) : Edgar Morin pose à un échantillon
d’employés, d’ouvriers, d’artistes et d’étudiants la même question : « comment vivezvous ? ». Jean Rouch organise le filmage.
42
1962 – La Punition
43
Couleurs. 58 mn. Sortie le 10 mars 1962 sur la lre chaine de l’O.R.T.F. Production : Films de
la Pléïade. Images : Michel Brault, Roger Morillère, Georges Dufault. Son : Roger Morillère.
Musique : Bach. Montage : Annie Tresgot.
44
Interprètes : Nadine Ballot (Nadine), Jean-Claude Darnal (l’étudiant), Jean-Marie Simon
(l’ingénieur), Modeste Landry (Modeste). Nadine, lycéenne à Paris, est mise à la porte de
son lycée. Elle fait plusieurs rencontres.
45
1964 – Gare du Nord
46
Sketch de Paris vu par... . Noir et blanc. 17 mn. Production : Films du Losange.
47
Scénario : Jean Rouch. Images : Etienne Becker. Assistant : Patrice Wyers. Son : Bernard
Ortion.
�133
48
Interprètes : Nadine Ballot (Odile), Barbet Schrœder (le mari), Gilles Quéant (l’inconnu).
49
A Paris, un jeune couple prend son petit déjeuner. Discussion. Scène de ménage. Départ
précipité de la jeune femme. Rencontre avec un inconnu dans la rue. Discussion.
L’inconnu se jette sur la voie de chemin de fer.
50
1965 – La Chasse au lion à l’arc
51
Couleurs. 88 mn.
52
Production : Films de la Pléiade (Pierre Braunberger).
53
Tournage entre 1958 et 1965 au Niger et au Mali (missions de l’I.F.A.N. et du C.N.R.S.).
54
Lion d’Or à la XXVIe Mostra internationale de Venise, 1965.
55
Son : Idrissa Maiga, Moussa Alidou. Assistants : Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia, Tallou
Mouzourane. Montage : Josée Matarasso, Dov Hœnig.
56
Niger : les troupeaux sont décimés par des lions. Les paysans font appel à des chasseurs
coutumiers. Préparatifs et déroulement de la chasse.
57
1954-1967 – Jaguar
58
Couleurs, 90 mn.
59
Production : Films de la Pléiade. Son : Damouré Zika. Montage : Josée Matarasso, Liliane
Korb, Jean-Pierre Lacam. Musique : Enos Amelodon (guitare), Tallou Mouzourane (piano),
Amisata Gaou-delize (chant), Yankori (violon), Ama (flûte), Djenné Molo Kari (harpe).
60
Dialogues post-synchronisés en 1957 et en 1967 : Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia, Illo
Gaoudel, Amadou Koffo.
61
Voix off : Jean Rouch.
62
Principaux interprètes : Damouré Zika (Damouré), Lam Ibrahima Dia (Lam), Illo Gaoudel
(Illo).
63
Partis d’Ayorou au Niger, Damouré, Lam et Illo, émigrent au Ghana puis, enrichis, ils
retournent au pays.
64
1969 – Un Lion nommé l’Américain
65
Couleurs, 40 mn.
66
Réunis pour regarder La Chasse au lion à l’arc, les mêmes chasseurs décident de repartir
traquer « l’américain », un lion qui était parvenu à s’enfuir. Ils retrouvent sa piste mais ils
se trompent de cible : ils tuent sa femelle. Annonce de la révolte des étudiants en mai 68 à
la radio. Jean Rouch rentre en France. Quelques semaines plus tard, « l’Américain » est
abattu au fusil.
67
1970 – Petit à petit
68
Eastmancolor. 96 mn (version 35 mm) et 250 mn (version 16 mm).
69
Production : Films de la Pléiade. Scénario improvisé par les acteurs. Assistant réalisation
et image : Philippe Luzuy Son : Moussa Hamidou. Montage : Josée Matarasso, Dominique
Villain. Photos : Daphné.
70
Interprètes : Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia, Illo Gaoudel, Safi Faye, Mustafa Alassane,
Marie Idrissa, Alborah Maiga, Tallou Mouzourane, Ariane Bruneton, Jacques Chaboud,
Michel Delahaye, Sylvie Pierre, Patricia Finaly, Philippe Luzuy.
71
A la manière d’Usbek et Rica, dans les Lettres persanes de Montesquieu, Damouré, Lam et
Illo, en voyage d’affaires, observent la vie parisienne.
�134
72
1971 – Tourou et Bitti, les tambours d’avant
73
Couleurs, 9 mn 20. Assistant réalisateur : Laurant Lam Dia-Hama. Son : Moussa Hamidou.
Montage son : Philippe Luzuy.
74
Simiri au Niger : Jean Rouch filme en un plan-séquence, un temps fort d’un rituel destiné
à faire venir la pluie.
75
1984 – Dionysos
76
Couleurs (16 mm et 35 mm), 104 mn.
77
Production : Films du Jeudi (Pierre Braunberger), Antenne 2, C.N.R.S. Scénario : Jean
Rouch, Pierre-Yves Prieur, Hughes Aubin, Jacques Duval, Laura Condominas. Son : Gérard
Delas-sus. Montage : Marie-Josèphe Yoyotte. Photo : Antoine Georgeakis.
78
Interprètes : Jean Monod (Hughes Gray), Hélène Puiseux (Ariane), Enrico Fulchignoni
(président du jury), Germaine Dieterlen, Roger Foucher, Jean Sauvy (membres du jury),
Fifi Raliatou Niane, Kagumi Onodera, Cookie Chialapone (les ménades), Bruno Ehrman (le
musicien).
79
À la Sorbonne, soutenance de thèse de Hugh Gray. Embauché dans une usine, il dirige la
fabrication d’une nouvelle voiture. Quand celle-ci est prête, célébration d’une fête
dionysiaque.
�135
Jean Rouch en films
1
Le Premier Film, 1947-1991, Dominique Dubosc, 25 mn, France, 1991.
2
Jean Rouch à Paris, Manthia Diawara, 50 mn, Grande-Bretagne, 1995.
3
Paroles données, entretien avec Marc-Antoine BOUSSAT, Paris, Festival Image et Science, 15
mn, 1997.
�136
Index des films cités
2001, l’Odyssée de l’espace (2001 : a Space Odyssey) 164
Abidjan, port de pêche, 145
À bout de souffle, 66, 67, 69, 73, 147
A Happy Mother’Day, 54
À propos de Nice, 48
Accatone, 82
Adieu Philippine, 56, 91
Afrique 50, 85
Allemagne anné zéro (Germania,anno zero) 44, 47, 156
Arabie interdite, 48
Ascenseur pour l’échafaud, 65
Au Pays des mages noirs, 1, 15, 19, 39, 87, 187, 188
Au Seuil de l’Islam, 48
Bataille sur le grand fleuve, 4, 17,49,70,74, 87, 88, 89,103-110,138, 146, 147, 187, 188
Blue Jeans, 56, 90
Borinage, 48
Chantons sous la pluie (Singing In The Rain), 59
Charlotte et son Jules, 67,68
Chronique d’un été, 18,28, 36, 42, 57, 58, 59, 61, 67, 69, 80, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 102, 132,
136-137, 145, 175, 183, 196, 204
Cimetière dans la falaise, 2, 19, 102, 196
Citizen Kane, 98 Cléo de 5 à 7, 69
Cocorico ! Monsieur Poulet, 11, 88, 89, 102, 165, 188-190, 189, 206
Dans le vent, 90
Daouada Sorko, 196
Dimanche à Pékin, 49, 69, 70
Dionysos, 5, 68, 77, 89, 98, 102, 187, 188, 189, 190-199, 206
�137
Drifters, 48
Du Côté de la côte, 49, 69
Enquête sur la sexualité (Comizi d’Amore) 82, 196
Enthousiasme, 36
Faces, 82
Fahrenheit 451, 73
Fahrenheit 9/11, 37
Farrebique, 40
Festival à Dakar, 145
Fishing Banks of Skye, 48
Freaks, 45
Gare du Nord, 4, 18, 28, 66, 75, 80, 88, 97, 99, 102, 145, 169, 170-179, 181, 185, 186
Gauguin, 49,68
Grands soirs, petits matins, 76
Goëmons, 48
Guernica, 68
Hippocampe, 90
Hiroshima, mon amour, 51, 69, 155, 164
Hombori, 40
Husbands, 82
Initiation à la danse des possédés, 102
Jaguar, 4, 24, 28, 62, 64, 74, 77, 87, 89, 102, 123,124-128, 129, 131, 132, 148, 152, 164, 165,
188, 189
Jean Vigo, 203
Jules et Jim, 73
L’Amour fou, 56
L’Année dernière à Marienbad, 51, 69
L’Avventura, 44
L’Evangile selon saint Matthieu (Il Vangelo secondo Matteo), 196
L’Expédition du Quest, 118
L’Homme à la caméra, 35, 37, 38, 123
L’Opéra-Mouffe, 49
La Belle et la bête, 40
La Boulangère de Monceau, 170
La Chasse au lion à l’arc, 23, 28, 62, 69, 88, 98, 102, 111-113, 187, 188
La Chinoise, 199
La Circoncision, 102
La Corde (Rope) 173, 174
La Dame de Shangaï (The Lady from Shangaï) 51 La Jetée, 156
La Point courte, 49, 66, 69
�138
La Poursuite infernale, 40
La Punition, 28, 56, 68, 80, 88, 97, 102, 145, 177, 178, 198, 204
La Pyramide humaine, 17, 18, 28, 49, 56, 80, 88, 93, 96, 97, 102, 145, 177,178
La Rentrée des classes, 90
La Ricotta, 82
La Rosière de Pessac, 56
La Terre tremble (La Terra Trema), 47
La Vie est belle, 40
Las Hurdes, 48
Le beau Serge, 66
Le Chant du Styrène, 49
Le Cocotier, 145
Le Criminel (The Stranger), 40
Le grand escroc, 51
Le Mépris, 73
Le Règne du jour, 62
Le Sabotier du Val de Loire, 48
Le Sang des bêtes, 48
Le Signe du lion, 56, 66, 90
Le Silence de la mer, 15, 68
Le Voleur de bicyclette (Ladri di Biciclette), Al
Les Amants, 147
Les bonnes femmes, 66
Les Charmes de l’existence, 48
Les Dieux du stade (Triumph des Willems) 48
Les Fils de l’eau, 68, 110
Les gens du Pô (Gente del Po), 41
Les Hommes qui font la pluie (ou Yenendi, les faiseurs de pluie), 95,186
Les Inconnus de la terre, 61
Les Magiciens du Wanzerbé, 102, 196
Les Maîtres fous, 1, 4, 17, 27, 28, 49, 68, 85, 89, 97, 102, 123, 127, 138-143, 146, 152, 184
Les Mistons, 147
Les quatre cents coups, 66, 73
Les Raquetteurs, 61
Les Statues meurent aussi, 85
Les Veuves de quinze ans, 28, 68,
Lettre de Sibérie, 49, 50, 69 Lola, 66
Louisiana Story, 33
M, 45
Mamma Roma, 82
�139
Mamy Water, 28, 68
Médée (Medea), 196
Moi, un noir, 4, 17, 24, 28, 49, 51, 62, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 94, 96, 97,
102, 109, 123, 124, 125,143-167, 195, 202
Mon Oncle, 147
Monsieur Albert prophète, 28, 69, 145
Montparnasse et Levallois, 177
Moon Trap, 54
Nanook (Nanook of the North), 25, 32, 33, 151, 152
Niger, jeune république, 61
Nogent, Eldorado du dimanche, 48
Nosferatu, 89
Notes pour une Orestie africaine (Appunti per un ’Orestiade Africana), 195
Nuit et brouillard, 49, 69
O Dreamland, 54
Œdipe roi (Edipo Re), 196
Ombres blanches, 30
Opération béton, 48
Paisa, 40, 45, 47
Paparazzi, 90
Paris vu par 66, 75, 90
Petit à petit, 4, 28, 42, 62, 68, 74, 88, 89, 94, 97, 102, 123, 124, 125, 129-132, 165, 188, 189,
198
Pirogues sur l’Ogoué, 85
Place de l’Etoile, 90
Portrait de Raymond Depardon, 90
Portrait of Jason, 54
Pour la suite du monde, 61, 62
Primary, 54
Prologue, 56
Riz amer, 47
Robin des bois, 10, 25
Rome, ville ouverte (Roma Città aperta), 47, 146
Rose et Landry, 80, 97, 145
Rouch et Dieterlen, 26
Salut les Cubains, 69
Salvatore Giuliano, 56
Sciuscia, 40
Shadows, 56, 82
Sigui, 26
�140
Sigui Synthèse, 26, 185, 196
Solaris, 164
Stromboli, 46, 62, 151, 152
Tabou, 30
Taris ou la natation, 48
The Great White Silence, 118
Théorème (Teorema), 197
Tirez sur le pianiste, 68, 73
Toni, 56
Too Late Blues, 82
Tourou et Bitti, les tambours d’avant, 4, 18, 99, 169, 180, 181-186
Tous les garçons s’appellent Patrick,68
Toute la mémoire du monde, 49
Trans-Euwp-Express, 51
Trois Chant sur Lénine, 36
Tropical Malady, 207
Un Lion nommé « l’Américain », 62, 98
Vampire, 45, 90
Van Gogh, 48, 68
Viol d’une jeune fille douce, 56
Vivre sa vie, 68
Voyage en Italie (Viaggio in Italia), 46
We Are The Lambeth Boys, 54
�141
Index des noms
Amundsen, 10, 11, 119
Anderson Lindsay, 54
Antonioni Michelangelo, 44, 56, 71
Artaud Antonin, 129, 140
Autant-Lara Claude, 68
Balàsz Belà, 118, 119
Ballot Nadine, 80, 170, 177
Baron Suzanne, 139
Barthes Roland, 198
Bazin André, 32, 33, 50, 98
Beauregard Georges (de), 69
Becker Jacques, 16, 103
Bellon Yannick, 48
Belmondo Jean-Paul, 67, 158
Bergman Ingar, 71, 81
Bergman Ingrid, 46
Bergson Henri, 51, 162
Bouchard Vincent, 60, 61
Boutang Pierre-André, 12
Brault Michel, 54, 60, 61, 63, 67, 178
Braunberger Pierre, 28, 68
Bresson Robert, 71, 167
Browning Tod, 90, 206
Bunuel Luis, 48, 71
Capra Frank, 40
Carie Gilles, 56
Camé Marcel, 48
�142
Cassavetes John, 71, 76, 81, 82
Chabrol Claude, 50, 76, 77
Charcot Jean-Baptiste, 9, 10, 11, 119
Chytilova Vera, 76
Clarke Shirley, 54, 55
Clément René, 48, 68
Clouzot Georges, 68
Cocteau Jean, 12, 16, 17, 39, 40, 71
Constantini Philippe, 26
Cotin André, 140
Coutant André, 59, 67
Daney Serge, 71, 72
Dauman Anatole, 68, 69
Davis Miles, 65
De Sica Vittorio, 40
Debray Régis, 97
Delahaye Michel, 130
Deleuze Gilles, 50, 51, 110, 151, 155
Delluc Louis, 146
Demy Jacques, 48
Depardon Raymond, 90, 205
De Santis Giuseppe, 45
Despoix Philippe, 180
Dia Lam Ibrahima, 79, 97, 124-128, 131, 188, 188-190
Dia-Hama Laurent, 182
Dieterlen Germaine, 17, 25, 26, 191
Dionysos, 5, 190, 194, 195, 199
Dréville Jean, 48
Dreyer Carl Theodor, 71
Dupont Jacques, 85, 86
Eisentein Serguéï Mikhaïlovich, 10, 141, 142
Eschyle, 195
Esquénazi Jean-Pierre, 73
Eustache Jean, 55, 56, 206
Fairbanks Douglas, 10, 11
Fassbinder Werner Rainer,
81 Fellini Federico, 71
Fieschi Jean-André, 87, 103, 152
Flaherty John, 30,31,32, 34, 35,40,44, 89, 118, 151, 152
Ford John, 40
�143
Forman Milos, 76
France Claudine (de), 43
Franju Georges, 48, 50
Freud Sigmund, 11
Fulchignoni Enrico, 53, 158, 191, 197
Ganda Oumarou, 62, 80, 148-151, 155, 158, 163
Gaoudel Illo, 79,124, 125, 127
Garcia Gaetano, 184, 185
Gauthier Guy, 29
Godard Jean-Luc, 37, 49, 51, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 146, 147, 158, 177, 191, 203,
206
Grémillon Jean, 48
Griaule Marcel, 2, 11, 12, 13, 16, 17, 19-26, 84, 94, 140, 185
Grierson John, 48
Groulx Gilles, 54
Guitry Sacha, 72
Hamidou Moussa, 79, 181, 182
Hawks Howard, 71
Hergé, 127
Hésiode, 192
Hitchcock Alfred, 71, 173, 174, 176, 206
Ivens Joris, 48
Jean Pierjeant, 13
Jutra Claude, 61
Kast Pierre, 11,48
Klein William, 76
Kubrick Stanley, 164, 206
Labarthe André S., 50, 51, 76, 106, 163, 203
Lajoux Jean-Dominique, 31-33
Landry Modeste, 80, 93
Lang Fritz, 45, 59,71,206
Langlois Henri, 11, 17, 64
Leacock Richard, 54
Léaud Jean-Pierre, 55, 74
Leenhardt Roger, 48
Leiris Michel, 11
Leroi-Gourhan André, 12, 17,41
Lévi-Strauss Claude, 17,41
Loridan Marceline, 58, 59, 61, 97
Lourcelles Jacques, 45, 90
�144
Lubin André, 158
Lumière (frères), 43
Luzuy Philippe, 182
Maïga Idrissa, 79
Malle Louis, 65,71, 147
Mann Anthony, 160
Marie Michel, 67, 76
Marker Chris, 3, 37, 49, 50, 51, 57, 69, 71, 75, 85, 156
Marsolais Gilles, 7, 30, 36, 53, 105
Mauss Marcel, 11, 19
Méliès Georges, 38, 206
Melville Jean-Pierre, 15, 68
Minnelli Vincente, 73
Mitry Jean, 35
Monod Jean, 191, 193, 194, 197
Monod Théodore, 11, 12, 19
Montesquieu, 125, 193
Moore Michael, 37
Moravia Alberto, 196
Moreau Jeanne, 65
Morin Edgar, 18, 41, 57, 58, 91-94, 96, 97, 132, 137, 175, 196
Mourouzane Tallou, 79, 124, 188, 189
Murnau Friedrich Wilhelm, 30, 89
Ogotemmêli, 21-25, 84
Ousséïni Inoussa, 120
Painlevé Jean, 90
Pasolini Pier Paolo, 71, 81, 82, 83, 122, 195, 196, 197, 206
Perrault Pierre, 61
Pierre Sylvie, 130
Pollet Jean-Daniel, 75
Ponting Herbert, 118
Ponty Pierre, 16, 103
Portugais Louis, 54
Prédal René, 7, 27, 193
Puiseux Hélène, 191, 197
Reichenbach François, 57, 68, 75
Reisz Karel, 54
Renoir Jean, 56, 71
Resnais Alain, 3, 37,48-51, 68, 69, 71, 85, 155, 156
Riefenstahl Leni, 48
�145
Rivette Jacques, 64, 71, 75, 77, 105, 177
Robbe-Grillet Alain, 51
Rocha Glauber, 76
Rohmer Eric, 56, 64, 66, 77, 90, 170
Rosi Francesco, 56
Rossellini Roberto, 18, 40, 45, 46, 47, 62, 71, 135, 151, 152, 157, 203
Rouquier Georges, 40, 57
Rozier Jacques, 3, 56, 65, 71, 77, 90, 203
Ruspoli Mario, 57, 58, 61
Sauvy Jean, 13, 16, 17, 103, 117, 187, 191, 197
Schrœder Barbet, 76, 170
Scott (commandant), 44, 118, 119, 120
Séchan Edmond, 85
Sembene Ousmane, 110
Shackleton Ernest, 44, 118, 119, 120
Sorko Daouda, 181, 182, 184
Tarkovski Andréï, 164, 206
Tati Jacques, 65, 147
Tremblay Alexis, 62
Truffaut François, 55, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73-77, 147, 206
Varda Agnès, 3, 49, 50, 69, 71
Vautier René, 85
Vertov Dziga, 30, 31, 35-38, 40, 57, 101, 118, 120, 123, 141, 197
Vieyra Paulin, 140
Vigo Jean, 48, 101
Weerasethakul Apichatpong, 207
Welles Orson, 40, 51, 52, 71, 72, 151, 206
Wiseman Fred, 205
Zika Damouré, 74, 79, 87, 88, 109, 124-129, 131, 132, 188, 189, 202
�146
Remerciements
1
Je remercie Michel Marie, le premier rouchien que j’ai rencontré à Paris et qui m’a fait
voir Moi, un noir ; Jules Dumotier, mon plus jeune lecteur à Montréal ; Laurent Creton et
Janie Castan ; Jocelyne Rouch, Laurence Braunberger et Jérôme Cantié.
2
Je salue la mémoire de Christian Metz, dont l’intérêt et la courtoisie indéfectible
contibuèrent à encourager mes débuts dans les études rouchiennes.
�
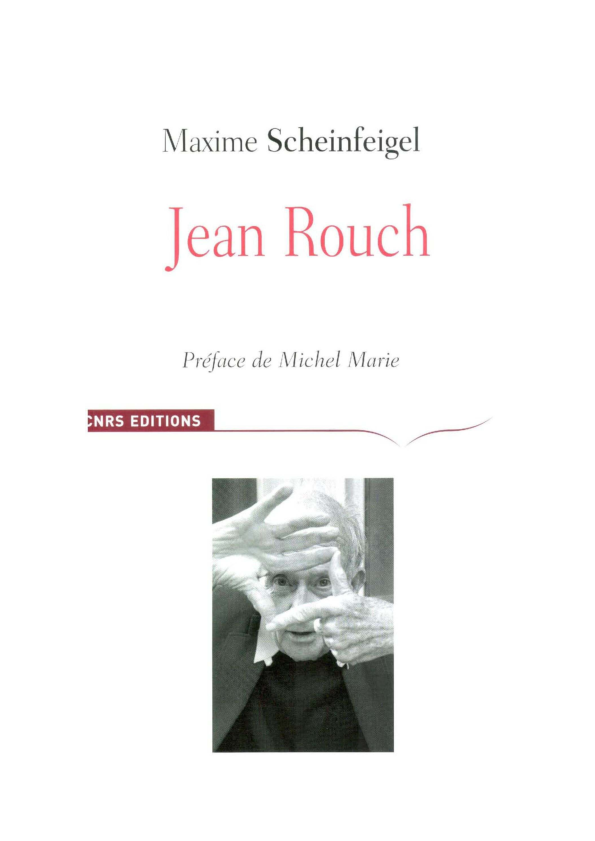
 Véronique Campan
Véronique Campan