Books by C. Gauvry
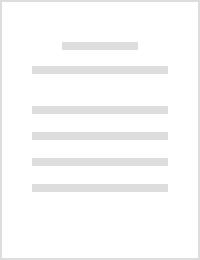
Dewalque A., Gauvry Ch. et Richard S. (éds.), Philosophy of Language in the Brentano School. Reassessing the Brentanian Legacy, Palgrave, Basingstoke, 2020
This collection of fourteen original essays addresses the seminal contribution of Franz Brentano ... more This collection of fourteen original essays addresses the seminal contribution of Franz Brentano and his heirs to philosophy of language. Despite the great interest provoked by the Brentanian tradition and its multiple connections with early analytic philosophy, precious little is known about the Brentanian contribution to philosophy of language. The aim of this new collection is to fill this gap by providing the reader with a more thorough understanding of the legacy of Brentano and his school, in their pursuit of a unique research programme according to which the analysis of meaning is inseparable from philosophical inquiries into what goes on in the mind and what there is in the world.
In three parts, the volume first reconstructs Brentano’s pathbreaking thoughts on meaning and grammatical illusions, exploring their strong connections with the Austro-German tradition and analytic philosophy. It then addresses the multifaceted debates on the objectivity of meaning in the Brentano School and its aftermath (Meinong, Husserl, Ingarden, Twardowski and the Lvov-Warsaw School). Finally, part three explores Brentano’s wider legacy, namely: Husserl’s theory of modification and typicality, Bühler’s theory of linguistic and non-linguistic expressions, and Wittgenstein’s thoughts on guidance and rule-following.
The result is a unique collection of essays which shows the significance, originality and timely character of the Brentanian philosophy of language.

L’ouvrage entend d’une part proposer une analyse critique des traditions de comparaison déjà exis... more L’ouvrage entend d’une part proposer une analyse critique des traditions de comparaison déjà existantes entre les œuvres de Martin Heidegger et de Ludwig Wittgenstein (depuis le commentaire inaugural de Hubert Dreyfus de 1990) et d’autre part clarifier à nouveaux frais les enjeux de l’herméneutique de la facticité heideggérienne et du contextualisme wittgensteinien. Il opère par une comparaison inédite entre la notion de « monde ambiant » [Umwelt] des cours fribourgeois du jeune Heidegger et les notions wittgensteiniennes de « contexte ».
Pour éviter tout rapprochement hâtif et remédier à certaines lacunes historiques des tentatives de comparaison déjà existantes, l’ouvrage commence (partie I) par une analyse historique des développements des deux auteurs consacrés respectivement au « monde ambiant » et au « contexte ». Il clarifie ensuite (partie II) les apparentes similitudes entre les deux démarches. Il examine en particulier les ressemblances et différences de leurs conceptions des phénomènes sémantiques (sensibilité à l’usage, indexicalité), de la conscience (intentionnalité) et de la méthode philosophique (compréhension, description, interprétation). Dans un dernier temps (partie III), l’ouvrage introduit un troisième terme dans la comparaison, à savoir le concept d’arrière-plan/background mobilisé par des auteurs normativistes comme Ch. Taylor, R. Brandom et S. Cavell. Ce geste lui permet de préciser, par contraste, le statut des normes déterminant le sens et la compréhension chez les deux auteurs.
Le principal résultat de l’ouvrage est de préciser la spécificité des régimes de détermination en jeu dans les premiers cours de Fribourg de Heidegger puis dans le contextualisme de Wittgenstein. Son ultime enjeu est de montrer in fine comment l’herméneutique heideggérienne et le contextualisme wittgensteinien se distinguent résolument du relativisme.
Edited Books by C. Gauvry
Le tournant du XXe siècle est marqué par un retour de la problématique catégoriale sur le devant ... more Le tournant du XXe siècle est marqué par un retour de la problématique catégoriale sur le devant de la scène philosophique, que ce soit chez Franz Brentano et ses élèves, chez Wilhelm Dilthey, chez les Néokantiens de l’école de Bade, ou chez les premiers pionniers de la phénoménologie. Tant et si bien qu’une certaine philosophie (celle d’Emil Lask par excellence) a pu se présenter comme une doctrine des catégories à part entière. L’enjeu de ce numéro est d’interroger la place historique et le rôle conceptuel qu’ont joué ces questions formelles dans l’émergence de la phénoménologie.
Doté d’une introduction substantielle, ce volume rassemble huit textes fondateurs qui plongent le... more Doté d’une introduction substantielle, ce volume rassemble huit textes fondateurs qui plongent le lecteur au cœur des riches controverses liées aux théories représentationnelles.
Avec des textes de B. Brewer, P. Carruthers, F. Dretske, G. Graham, T. Horgan et J.Tienson, U. Kriegel, D. Rosenthal, Ch.Travis, M.Tye.
Par une sélection de six textes emblématiques traduits en français, l'enjeu du présent volume est... more Par une sélection de six textes emblématiques traduits en français, l'enjeu du présent volume est d'introduire le lecteur francophone à l'histoire de la controverse sur le contenu conceptuel de la perception et d'interroger la pertinence des débats qu'elle a suscités.
Avec des textes de Tim Crane, Fred Dretske, Gareth Evans, John McDowell, Christopher Peacocke et Charles Travis
Bulletin d'Analyse Phénoménologique, 2016
Direction du numéro de la revue Les études philosophiques de juillet 2010 sur Heidegger et WIttge... more Direction du numéro de la revue Les études philosophiques de juillet 2010 sur Heidegger et WIttgenstein
Draft Philosophy of Mind by C. Gauvry

This paper investigates one of the central concepts of the contemporary intentionalist philosophy... more This paper investigates one of the central concepts of the contemporary intentionalist philosophy of mind: “intentional content”. It asks whether intentional content eo ipso means propositional content. After having shown that it makes sense to characterize the representational theories of consciousness as “content theories” (or “content views”), it seeks to prove that those contemporary theories lay on a semantic conception of the mental acts analysis that denies them access to the fine-grained sensible. As a consequence, this paper examines Tim Crane’s alternative view which postulates that it is possible to keep the intentionalist paradigm without falling into some semantics traps. This solution requires carefully distinguishing between two meanings of the “content” concept: the phenomenal content of experience and the propositional content that is supposed to describe it. As a conclusion, it questions the possibility of such a distinction.
Draft Austro-German Philosophy by C. Gauvry

Analecta Hermeneutica, 2020
Ludwig Landgrebe was prolific and his work dealt with various fundamental phenomenological issues... more Ludwig Landgrebe was prolific and his work dealt with various fundamental phenomenological issues. However, my paper will only focus on one specific aspect of his analysis. I will pay attention to his thoughtful intuitions regarding the philosophy of language, as developed in his 1934 habilitation thesis called Nennfunktion und Wortbedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie.
I will suggest that Landgrebe’s 1934, and somehow forgotten, dissertation is worth considering for at least two reasons:
1/ From an exegetic point of view, the first part of Landgrebe’s dissertation presents one of the clearest overviews on Marty’s complex 1908 work. In that respect, it provides a useful introduction to Marty’s main ideas, which are not so easy to pinpoint, especially because of the length and the density of his Untersuchungen. Additionally, Landgrebe’s dissertation clears up some misunderstandings on Marty’s position, in particular regarding his psychologist position. As a consequence, one can first use Landgrebe’s dissertation as an exegetical commentary and as a clear introduction to Marty’s somehow “Brentanian” conception of language.
2/ From a conceptual point of view, the two last parts of Landgrebe’s dissertation endorse a more critical point of view. Besides, they formulate some general criticisms regarding common and proper names and raise fundamental and still contemporaries questions regarding referential and contextual considerations.

Emil Lask. An der Grenze des Kantianismus, 2019
If Emil Lask’s position can be considered as taking part in the Southwest Neokantian School, it n... more If Emil Lask’s position can be considered as taking part in the Southwest Neokantian School, it nevertheless presents some original characteristic within this very influential Baden School. He indeed introduces the very idea that the realm of sense, far from being solely formal, is an interpenetration of form and matter (Materie, Material). Moreover, he interestingly claims in his Logik der Philosophie und Kategorienlehre (1911) that this matter is impenetrable (undurchdringlich). As a consequence, one could be tempted to consider Lask as the “materialist” of the Baden School or at least as the one who makes room for what the contemporary debates have analysed in terms of “given”. Lask notably thematizes himself the concept of “Gegebenheit”.
In order to develop this hypothesis, my paper will first pay attention to the lexicon developed by Lask in order to describe the matter given to the cognitive subject. In particular, I will try to carefully distinguish between his uses of the German notions of “das Alogische” and “das logische Nackt”, in order to show that the second notion is purely functional. According to this theory, even a non-sensitive or a supra-sensible form can be considered as a “logical Nakedness” (of a constitutive category) and consequently as a matter. Second, from a more critical point of view, I will ask whether those non-sensitive or supra-sensitive “materials” can indeed be considered as given.
In line with a rich and long tradition revived by Suárez, Brentano considers that all non-determi... more In line with a rich and long tradition revived by Suárez, Brentano considers that all non-determined entities have to be considered as non-beings. In this respect, he makes use of the concept of “entia rationis.” Interestingly, he suggests, at least since his 1901 letter to Marty, that those entities have to be considered as no things or no beings at all but as “fictions” and more precisely as “linguistic fictions.” The purpose of my text is twofold. First, I intend to clarify the status of “linguistic fictions” in Brentano. In particular, I will enquire the extent to which they are connected or disconnected from the medieval considerations on “entia irrealia” and “entia rationis” (Suárez). Secondly, I will emphasize the linguistic nature of those fictions and, consequently, sketch some remarks on Brentano’s view on language and concepts.

Cet article examine la doctrine des catégories développée par Emil Lask (1875-1915) au début du x... more Cet article examine la doctrine des catégories développée par Emil Lask (1875-1915) au début du xxe siècle (1911). Son objectif est double. 1) Nous entendons proposer une étude historique précise de cette doctrine relativement méconnue qui présente une synthèse inédite entre l’objectivisme sémantique de Bolzano, la théorie des valeurs de l’école de Bade et le formalisme husserlien, dans le contexte de l’héritage de la révolution copernicienne kantienne. Nous montrons que cette doctrine présente un caractère radical en ceci qu’elle considère que la philosophie est eo ipso une doctrine des catégories. 2) Le deuxième objectif de cette étude, plus critique, est d’évaluer la pertinence de la lecture herméneutique, d’inspiration heideggérienne, qui en est souvent proposée. S’il est indéniable que la doctrine de Lask exerça une réelle influence sur la phénoménologie herméneutique du jeune Heidegger, nous examinons jusqu’à quel point les intuitions originales de Lask sur l’extension du catégoriel et la donation de la forme préfigurent l’orientation herméneutique de la phénoménologie heideggérienne.
Dans cet article, je m'intéresse à l’usage du concept peu travaillé de « Vorgriff » (anticipatio... more Dans cet article, je m'intéresse à l’usage du concept peu travaillé de « Vorgriff » (anticipation) dans les premiers écrits de Heidegger. Cet examen technique me permet tout à la fois de souligner la dimension d’abord formelle des concepts phénoménologiques chez Heidegger et de préciser les enjeux de la méthode d’analyse fondamentale de la phénoménologie herméneutique : l’indication formelle.
Draft Philosophy of Ordinary Language-Wittgenstein by C. Gauvry
On appelle « indexical » un terme dont on ne peut déterminer la référence qu’en considérant le co... more On appelle « indexical » un terme dont on ne peut déterminer la référence qu’en considérant le contexte d’usage dans lequel il est employé. Ce concept d’ « indexicalité » a gagné un regain d’intérêt à la fin des années 1970, plus exactement après la conférence de David Kaplan de 1977 : « Les démonstratifs. Un essai sur la sémantique, la logique, la métaphysique et l’épistémologie des démonstratifs et autres indexicaux », qui fixe la plupart des distinctions conceptuelles qui sont encore aujourd’hui débattues.
C’est la pertinence de cette stratégie référentielle d’analyse des phénomènes de dépendance contextuelle que nous souhaitons ici interroger, à l’aune des réflexions « contextualistes » menées par Charles Travis depuis la fin des années 1980.

Contrary to traditional behaviourist (Ryle 1949), logical behaviourist (Fodor and Chihara 1965), ... more Contrary to traditional behaviourist (Ryle 1949), logical behaviourist (Fodor and Chihara 1965), more recent psychologist (Hacking 1982) or expressivist (see e.g. Taylor 1980, Rosenthal 1993, Wright 1998, Moran 2001) readings of Wittgenstein, I intend to show that there is a room both for expression of inner perception and for observation of oneself in Wittgenstein’s last writings. In his last grammatical remarks, Wittgenstein (1980, 1982, 1992, 1998) indeed introduces a crucial distinction between two kinds of psychological utterances: expression and description. The purpose of this paper is to show that the grammar of “expressions” manifests, against behaviourist readings, a certain form of first person authority and of infallibility of self linguistic analysis; and that the grammar of first person descriptions reveals, against psychologist or expressivist readings, a Wittgensteinian use of the notion of self observation, based on reports and inference of my own psychic language games.

Notre article explore les analyses de Wittgenstein développées dans ses Remarques sur la philosop... more Notre article explore les analyses de Wittgenstein développées dans ses Remarques sur la philosophie de la psychologie II de 1948 qui examinent la corrélation entre la représentation et l’imagination. Ces remarques ont une portée essentiellement grammaticale en ceci qu’elles ont pour finalité de clarifier la manière dont les concepts de « représentation », d’ « image » et d’ « impression sensorielle » sont effectivement mobilisés dans nos jeux de langage ordinaires.
Le premier objectif de l’article est de souligner la dimension critique de l’analyse de Wittgenstein en manifestant sa portée polémique à l’encontre de la conception de Hume qui associe l’imagination à une « idée » ou « image interne » et qui postule la thèse selon laquelle l’image interne et l’impression sensorielle diffèrent par leur degré de vivacité. L’un des enjeux de l’analyse wittgensteinienne est en effet de montrer qu’une telle conception repose sur un « mythe de l’image interne ». La preuve en est qu’il est possible de dissocier le concept d’imagination (entendue comme représentation), de ceux d’image et d’impression, même si ces concepts sont souvent corrélés.
Plus positivement, le deuxième objectif de l’article est de souligner quelques spécificités grammaticales de la représentation par image. L’analyse conceptuelle manifeste en effet le fait que seule l’imagination, entendue comme activité de représentation, à la différence de l’impression, 1/ est soumise à la volonté, 2/ est une pratique normée, 3/ présente une dimension créatrice. En raison de ces spécificités, il s’avère que seule l’imagination est susceptible d’inventer de nouveaux jeux de langage.
En conséquence, l’article insiste pour conclure sur le fait que l’imagination se présente comme un outil méthodologique privilégié de l’analyse wittgensteinienne dont l’une des aspirations ultimes est d’obtenir une visée synoptique de nos différents jeux de langage.

Ce texte pose la question de savoir si la sémantique est elle-même gouvernée par des règles gramm... more Ce texte pose la question de savoir si la sémantique est elle-même gouvernée par des règles grammaticales. La spécificité du travail de Ludwig Wittgenstein après le Tractatus logico-philosophicus a en effet consisté à étendre l’idée du grammatical (régi par des règles) à une organisation du domaine des significations qui n’est plus uniquement formelle mais concerne aussi les contenus sémantiques. La grammaire des termes de couleurs constitue à cet égard un exemple paradigmatique. Or, cette conception étendue de la grammaire philosophique bouscule doublement la caractérisation husserlienne. D’une part, dans une tendance propre à la philosophie analytique qu’assumera explicitement Moritz Schlick, elle tend à considérer comme conceptuelles les lois que la phénoménologie envisageait comme essentielles, c’est-à-dire reposant sur des essences (externes au langage). D’autre part, en vertu d’une orientation pragmatiste propre à la pensée du second Wittgenstein, elle tend à concevoir la grammaire comme « livre des comptes » des usages effectifs plutôt que comme code des usages possibles a priori. Ce faisant, comme le souligne à juste titre Charles Travis, elle prend en compte la sensibilité des règles aux « occasions », c’est-à-dire à leurs contextes d’application. En découle une conception de règles grammaticales très différente de celle qui prévalait dans les Recherches logiques.
Dans l'héritage des travaux inauguraux de Gottlob Frege et du fameux « principe de contexte » de... more Dans l'héritage des travaux inauguraux de Gottlob Frege et du fameux « principe de contexte » de la préface aux Fondements de l'arithmétique, la notion de « contexte » a gagné un surcroît d'intérêt dans la philosophie du langage de la seconde moitié du XX e siècle, au prix de grandes confusions. Nombreux courants d'analyse d'obédience fort disparate se revendiquent en effet de l'appellation « contextualiste », en partant du principe qu'ils souscrivent au principe de contexte frégéen. Nous entendons ici montrer que derrière ce concept générique de « contexte » se dissimulent une forte polysémie et une hétérogénéité d'usage. Nous tenterons de lever ces confusions en opérant une distinction entre ce que nous appelons « contextualisme », dans un héritage wittgensteinien et austinien, et « sémantique pragmatique ».

La découverte de Frege a eu une influence décisive sur les travaux de Wittgenstein. Pour prendre ... more La découverte de Frege a eu une influence décisive sur les travaux de Wittgenstein. Pour prendre la mesure de cet héritage, l’article examine un principe dont Wittgenstein hérite explicitement de Frege : « le principe de contexte ». C’est le deuxième principe de la Préface aux Fondements de l’arithmétique : « on doit rechercher ce que les mots veulent dire non pas isolément mais pris dans leur contexte [im Satzsusammenhange] ». De fait, il est clair que ce « principe de contexte » présenté comme un principe propositionnel influencera profondément la rédaction du Tractatus logico-philosophicus. Son influence est encore manifeste dans les Recherches philosophiques, ce que confirme leur paragraphe 49. L’objectif de l’article est alors double. Il entend mesurer l’importance de l’inflexion que l’auteur des Recherches fait subir au concept de « contexte » propositionnel frégéen. Car le « contexte » des Recherches n’est plus seulement celui de la proposition ou même de la phrase (Satz) ; il désigne bien plutôt les contraintes extra-sémantiques d’une situation d’énonciation. Qui plus est, l’article examine si Frege n’avait pas lui-même déjà saisi l’importance du « contexte pragmatique » de l’énonciation, notamment dans ses écrits tardifs.


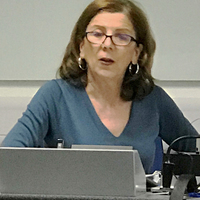



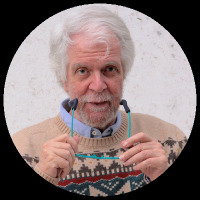




Uploads
Books by C. Gauvry
In three parts, the volume first reconstructs Brentano’s pathbreaking thoughts on meaning and grammatical illusions, exploring their strong connections with the Austro-German tradition and analytic philosophy. It then addresses the multifaceted debates on the objectivity of meaning in the Brentano School and its aftermath (Meinong, Husserl, Ingarden, Twardowski and the Lvov-Warsaw School). Finally, part three explores Brentano’s wider legacy, namely: Husserl’s theory of modification and typicality, Bühler’s theory of linguistic and non-linguistic expressions, and Wittgenstein’s thoughts on guidance and rule-following.
The result is a unique collection of essays which shows the significance, originality and timely character of the Brentanian philosophy of language.
Pour éviter tout rapprochement hâtif et remédier à certaines lacunes historiques des tentatives de comparaison déjà existantes, l’ouvrage commence (partie I) par une analyse historique des développements des deux auteurs consacrés respectivement au « monde ambiant » et au « contexte ». Il clarifie ensuite (partie II) les apparentes similitudes entre les deux démarches. Il examine en particulier les ressemblances et différences de leurs conceptions des phénomènes sémantiques (sensibilité à l’usage, indexicalité), de la conscience (intentionnalité) et de la méthode philosophique (compréhension, description, interprétation). Dans un dernier temps (partie III), l’ouvrage introduit un troisième terme dans la comparaison, à savoir le concept d’arrière-plan/background mobilisé par des auteurs normativistes comme Ch. Taylor, R. Brandom et S. Cavell. Ce geste lui permet de préciser, par contraste, le statut des normes déterminant le sens et la compréhension chez les deux auteurs.
Le principal résultat de l’ouvrage est de préciser la spécificité des régimes de détermination en jeu dans les premiers cours de Fribourg de Heidegger puis dans le contextualisme de Wittgenstein. Son ultime enjeu est de montrer in fine comment l’herméneutique heideggérienne et le contextualisme wittgensteinien se distinguent résolument du relativisme.
Edited Books by C. Gauvry
Avec des textes de B. Brewer, P. Carruthers, F. Dretske, G. Graham, T. Horgan et J.Tienson, U. Kriegel, D. Rosenthal, Ch.Travis, M.Tye.
Avec des textes de Tim Crane, Fred Dretske, Gareth Evans, John McDowell, Christopher Peacocke et Charles Travis
Draft Philosophy of Mind by C. Gauvry
Draft Austro-German Philosophy by C. Gauvry
I will suggest that Landgrebe’s 1934, and somehow forgotten, dissertation is worth considering for at least two reasons:
1/ From an exegetic point of view, the first part of Landgrebe’s dissertation presents one of the clearest overviews on Marty’s complex 1908 work. In that respect, it provides a useful introduction to Marty’s main ideas, which are not so easy to pinpoint, especially because of the length and the density of his Untersuchungen. Additionally, Landgrebe’s dissertation clears up some misunderstandings on Marty’s position, in particular regarding his psychologist position. As a consequence, one can first use Landgrebe’s dissertation as an exegetical commentary and as a clear introduction to Marty’s somehow “Brentanian” conception of language.
2/ From a conceptual point of view, the two last parts of Landgrebe’s dissertation endorse a more critical point of view. Besides, they formulate some general criticisms regarding common and proper names and raise fundamental and still contemporaries questions regarding referential and contextual considerations.
In order to develop this hypothesis, my paper will first pay attention to the lexicon developed by Lask in order to describe the matter given to the cognitive subject. In particular, I will try to carefully distinguish between his uses of the German notions of “das Alogische” and “das logische Nackt”, in order to show that the second notion is purely functional. According to this theory, even a non-sensitive or a supra-sensible form can be considered as a “logical Nakedness” (of a constitutive category) and consequently as a matter. Second, from a more critical point of view, I will ask whether those non-sensitive or supra-sensitive “materials” can indeed be considered as given.
Draft Philosophy of Ordinary Language-Wittgenstein by C. Gauvry
C’est la pertinence de cette stratégie référentielle d’analyse des phénomènes de dépendance contextuelle que nous souhaitons ici interroger, à l’aune des réflexions « contextualistes » menées par Charles Travis depuis la fin des années 1980.
Le premier objectif de l’article est de souligner la dimension critique de l’analyse de Wittgenstein en manifestant sa portée polémique à l’encontre de la conception de Hume qui associe l’imagination à une « idée » ou « image interne » et qui postule la thèse selon laquelle l’image interne et l’impression sensorielle diffèrent par leur degré de vivacité. L’un des enjeux de l’analyse wittgensteinienne est en effet de montrer qu’une telle conception repose sur un « mythe de l’image interne ». La preuve en est qu’il est possible de dissocier le concept d’imagination (entendue comme représentation), de ceux d’image et d’impression, même si ces concepts sont souvent corrélés.
Plus positivement, le deuxième objectif de l’article est de souligner quelques spécificités grammaticales de la représentation par image. L’analyse conceptuelle manifeste en effet le fait que seule l’imagination, entendue comme activité de représentation, à la différence de l’impression, 1/ est soumise à la volonté, 2/ est une pratique normée, 3/ présente une dimension créatrice. En raison de ces spécificités, il s’avère que seule l’imagination est susceptible d’inventer de nouveaux jeux de langage.
En conséquence, l’article insiste pour conclure sur le fait que l’imagination se présente comme un outil méthodologique privilégié de l’analyse wittgensteinienne dont l’une des aspirations ultimes est d’obtenir une visée synoptique de nos différents jeux de langage.
In three parts, the volume first reconstructs Brentano’s pathbreaking thoughts on meaning and grammatical illusions, exploring their strong connections with the Austro-German tradition and analytic philosophy. It then addresses the multifaceted debates on the objectivity of meaning in the Brentano School and its aftermath (Meinong, Husserl, Ingarden, Twardowski and the Lvov-Warsaw School). Finally, part three explores Brentano’s wider legacy, namely: Husserl’s theory of modification and typicality, Bühler’s theory of linguistic and non-linguistic expressions, and Wittgenstein’s thoughts on guidance and rule-following.
The result is a unique collection of essays which shows the significance, originality and timely character of the Brentanian philosophy of language.
Pour éviter tout rapprochement hâtif et remédier à certaines lacunes historiques des tentatives de comparaison déjà existantes, l’ouvrage commence (partie I) par une analyse historique des développements des deux auteurs consacrés respectivement au « monde ambiant » et au « contexte ». Il clarifie ensuite (partie II) les apparentes similitudes entre les deux démarches. Il examine en particulier les ressemblances et différences de leurs conceptions des phénomènes sémantiques (sensibilité à l’usage, indexicalité), de la conscience (intentionnalité) et de la méthode philosophique (compréhension, description, interprétation). Dans un dernier temps (partie III), l’ouvrage introduit un troisième terme dans la comparaison, à savoir le concept d’arrière-plan/background mobilisé par des auteurs normativistes comme Ch. Taylor, R. Brandom et S. Cavell. Ce geste lui permet de préciser, par contraste, le statut des normes déterminant le sens et la compréhension chez les deux auteurs.
Le principal résultat de l’ouvrage est de préciser la spécificité des régimes de détermination en jeu dans les premiers cours de Fribourg de Heidegger puis dans le contextualisme de Wittgenstein. Son ultime enjeu est de montrer in fine comment l’herméneutique heideggérienne et le contextualisme wittgensteinien se distinguent résolument du relativisme.
Avec des textes de B. Brewer, P. Carruthers, F. Dretske, G. Graham, T. Horgan et J.Tienson, U. Kriegel, D. Rosenthal, Ch.Travis, M.Tye.
Avec des textes de Tim Crane, Fred Dretske, Gareth Evans, John McDowell, Christopher Peacocke et Charles Travis
I will suggest that Landgrebe’s 1934, and somehow forgotten, dissertation is worth considering for at least two reasons:
1/ From an exegetic point of view, the first part of Landgrebe’s dissertation presents one of the clearest overviews on Marty’s complex 1908 work. In that respect, it provides a useful introduction to Marty’s main ideas, which are not so easy to pinpoint, especially because of the length and the density of his Untersuchungen. Additionally, Landgrebe’s dissertation clears up some misunderstandings on Marty’s position, in particular regarding his psychologist position. As a consequence, one can first use Landgrebe’s dissertation as an exegetical commentary and as a clear introduction to Marty’s somehow “Brentanian” conception of language.
2/ From a conceptual point of view, the two last parts of Landgrebe’s dissertation endorse a more critical point of view. Besides, they formulate some general criticisms regarding common and proper names and raise fundamental and still contemporaries questions regarding referential and contextual considerations.
In order to develop this hypothesis, my paper will first pay attention to the lexicon developed by Lask in order to describe the matter given to the cognitive subject. In particular, I will try to carefully distinguish between his uses of the German notions of “das Alogische” and “das logische Nackt”, in order to show that the second notion is purely functional. According to this theory, even a non-sensitive or a supra-sensible form can be considered as a “logical Nakedness” (of a constitutive category) and consequently as a matter. Second, from a more critical point of view, I will ask whether those non-sensitive or supra-sensitive “materials” can indeed be considered as given.
C’est la pertinence de cette stratégie référentielle d’analyse des phénomènes de dépendance contextuelle que nous souhaitons ici interroger, à l’aune des réflexions « contextualistes » menées par Charles Travis depuis la fin des années 1980.
Le premier objectif de l’article est de souligner la dimension critique de l’analyse de Wittgenstein en manifestant sa portée polémique à l’encontre de la conception de Hume qui associe l’imagination à une « idée » ou « image interne » et qui postule la thèse selon laquelle l’image interne et l’impression sensorielle diffèrent par leur degré de vivacité. L’un des enjeux de l’analyse wittgensteinienne est en effet de montrer qu’une telle conception repose sur un « mythe de l’image interne ». La preuve en est qu’il est possible de dissocier le concept d’imagination (entendue comme représentation), de ceux d’image et d’impression, même si ces concepts sont souvent corrélés.
Plus positivement, le deuxième objectif de l’article est de souligner quelques spécificités grammaticales de la représentation par image. L’analyse conceptuelle manifeste en effet le fait que seule l’imagination, entendue comme activité de représentation, à la différence de l’impression, 1/ est soumise à la volonté, 2/ est une pratique normée, 3/ présente une dimension créatrice. En raison de ces spécificités, il s’avère que seule l’imagination est susceptible d’inventer de nouveaux jeux de langage.
En conséquence, l’article insiste pour conclure sur le fait que l’imagination se présente comme un outil méthodologique privilégié de l’analyse wittgensteinienne dont l’une des aspirations ultimes est d’obtenir une visée synoptique de nos différents jeux de langage.
A crucial issue for both psychology and the philosophy of mind is how the subject can have access to her own mental life and acquire knowledge of it. Since the early 19th century this issue has given rise to numerous controversies which are still ongoing in the current literature and to which a wide range of phenomenologically-oriented philosophers have largely contributed. The aim of the seminar is to explore and discuss these debates, with a special focus on contributions from phenomenologically-oriented philosophers.
Systematic and historical contributions (e.g., on James, Wundt, the Brentano School, the Würzburg School, Husserl, Sartre, Wittgenstein, etc.) are welcome.
It is common knowledge that these schools critically contributed to the rise of descriptive and phenomenological psychology, and gave rise to significant works in the fields of ontology and value theory. By contrast, comparatively little is known about the contribution of Brentanian philosophers to the philosophy of language. Important exceptions include Anton Marty’s – Brentano’s so-called “Minister for Linguistic Affairs” – and Husserl’s considerations on language. However, other representatives of the Brentanian tradition are deeply concerned with language in itself or as a mean to solve philosophical problems.
Interestingly, both the Brentanian and analytic traditions consider that linguistic analysis cannot be exhausted by a grammatical analysis of linguistic utterances. According to both traditions, linguistic analysis has to investigate the “deep structures” of linguistic utterances. Only such a “deep” analysis can help solve philosophical problems, even when they do not manifest themselves immediately as linguistic problems. However, the status and characteristics these traditions confer to this “deep structure” differ in a significant way. Whereas the Brentanian tradition considers it as mental, the analytic tradition considers it as logical. On the Brentanian approach, indeed, linguistic analysis mainly consists in relating linguistic utterances to the mental acts – sometimes understood as an “inner form” – that are expressed by them. This psychological dimension explains why the Brentanian tradition was never involved in the “linguistic turn” which was endorsed by Wittgenstein or by the Oxonian philosophers of ordinary language.
This conference proposes to assess to what extent the Brentanian tradition involves an original research program in the field of the philosophy of language. Proposals on the following subjects in the Brentanian school will be welcome:
1) Meaning theory
1.1 Subjective meaning and objective meaning (psychologism and anti-psychologism regarding meaning);
1.2 Communicational and contextual dimensions of meaning;
2) Inner form of language;
3) Linguistic functions;
4) The connexion between linguistic expressions and mental acts, in particular mind/language parallelism;
5) Categorematic and syncategorematic expressions, pure grammar;
6) Linguistic analysis as a mean to solve philosophical puzzles;
7) Nominalism;
8) Indexical expressions;
9) Common names and proper nouns;
10) Utterances analysis;
11) Linguistic fictions and paraphrases.
More generally, we are interested in all proposals regarding the question of language in the Brentanian tradition. The conference will focus on the entire tradition but proposals on only one or several specific authors will also be accepted.
Moreover, we will also consider proposals which regard not only the heirs of Brentano but also its philosophical predecessors (as, for instance, Bolzano) and the ones who discussed some Brentanian theses regarding language, as Bühler or Landgrebe did.
Transversal contributions, non-investigated questions and work on less-researched philosophers within the Brentanian tradition are encouraged.
In the context of the recent translation into French of some of Heidegger early lessons (GA 60 in 2011, GA 63 in 2012, GA 59 in 2014, GA 56/57 forthcoming), the Catholic University of Louvain (CEP), the Free University of Brussels (LPH) and the University of Liège (URPh) jointly organise a research conference on “The Fundamental Concepts of Heidegger’s Hermeneutics of Facticity”, September 22-23, 2016.