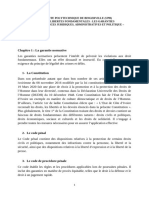Revdh 891
Revdh 891
Transféré par
Abdelhamid KarrakyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Revdh 891
Revdh 891
Transféré par
Abdelhamid KarrakyTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Revdh 891
Revdh 891
Transféré par
Abdelhamid KarrakyDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Revue des droits de l’homme
Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits
fondamentaux
6 | 2014
Revue des droits de l'homme - N° 5
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/revdh/891
DOI : 10.4000/revdh.891
ISSN : 2264-119X
Éditeur
Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux
Référence électronique
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014, « Revue des droits de l'homme - N° 5 » [En ligne], mis en ligne
le 01 décembre 2014, consulté le 11 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/891 ;
DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.891
Ce document a été généré automatiquement le 11 juillet 2020.
Tous droits réservés
1
SOMMAIRE
Edito
Le nouvel article 11 de la Constitution, quand dire ce n'est pas faire.
Charlotte Girard
Entretien
Entretien avec Mme Christine Lazerges, Présidente de la Commission Nationale Consultative
des droits de l’homme (CNCDH) et M. Hervé Henrion-Stoffel, magistrat, conseiller juridique à
la CNCDH
A propos de l’Avis de la CNCDH sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
(Assemblée plénière – 25 septembre 2014)
Jacqueline Domenach
Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques
: le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
Présentation
Véronique Champeil-Desplats et Malik Boumédiene
I. Approches thématiques et transversales
Révolutions arabes et renouveau constitutionnel : une démocratisation inachevée
Malik Boumédiene
Pouvoir politique, droits fondamentaux et droit à la révolte : la doctrine religieuse face aux
processus révolutionnaires dans le monde arabe
Fouad Nohra
Droits des femmes et révolutions arabes
Juliette Gaté
« Jus post-révolution » : quelle place pour les droits de l’homme?
Mamadou Meité
II. Monographie et comparaisons
Les droits de l’homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains
droits et libertés
Omar Bendourou
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
2
La gouvernance des Droits de l’homme en Tunisie postrévolutionnaire : état des lieux,
difficultés et opportunités
Souheil Kaddour
De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle : réflexion sur la
constitutionnalisation de l’opposition parlementaire à partir des cas tunisien et marocain
Antonin Gelblat
La Constitution égyptienne de 2014 est-elle révolutionnaire ?
Nathalie Bernard-Maugiron
Quelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions
tunisienne et égyptienne
Rahim Kherad
La protection ambivalente de l’égalité formelle dans la Constitution iranienne : après la
Révolution de 1979
Hiva Khedri
Analyses et libres propos
Le système interaméricain de protection des droits de l’homme: particularités, percées et
défis
Éric Tardif
Des idéaux à la réalité.Réflexions comparées sur les processus de sélection et de nomination
des membres des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme
Laurence Burgorgue-Larsen
La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
(Arrêt du 14 juin 2013 sur les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c.
Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie)
Alain Didier Olinga
Contribution à la clarification du régime juridique de la responsabilité de l’Etat résultant
d’un placement en cellule de dégrisement
Thierry Edouard
Les fichiers d’empreintes génétiques : les systèmes français et espagnol à l’égard de la
Convention européenne des Droits de l’Homme
Francisco Ramírez Peinado
Appréhender la cyberguerre en droit international. Quelques réflexions et mises au point
Clémentines Bories
Los refugiados, umbral ético de un nuevo derecho y una nueva política
Castor Bartolomé Ruiz
Les réfugiés, seuil éthique d’un nouveau droit et d’une nouvelle politique (version française)
Castor Bartolomé Ruiz
Mémoires
L’impact sur le procès pénal de l’absence des accusés dotés d’une qualité officielle
Les nouvelles règles 134bis, ter et quater du RPP de la CPI et les « personnes en charge de fonctions publiques
extraordinaires »
Rebecca Mignot-Mahdavi
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
3
Les lanceurs d’alerte
Etude comparée France-Etats-Unis
Jean-Philippe Foegle
Conférence
Le droit au patrimoine culturel face aux révolutions
Zeynep Turhalli
Bibliographie
Bibliographie
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
4
Edito
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
5
Le nouvel article 11 de la
Constitution, quand dire ce n'est pas
faire.
Charlotte Girard
1 En 2007, le Comité Balladur pour la réforme des institutions avait brandi le futur nouvel
article 11de la Constitution comme un étendard des droits fondamentaux que le peuple
allait conquérir du même élan que la nouvelle voie d’accès au contrôle de
constitutionnalité. Droit d’initiative populaire et recours direct au Conseil
constitutionnel, les deux mamelles de la nouvelle démocratie française. Une démocratie
nouvelle rééquilibrant les pouvoirs et faisant la part belle aux droits fondamentaux,
bref une république moderne !
2 Voici pour le discours. La réalité juridique, elle, éclaire les « droits » conquis d’une
autre lumière. Moins brillante. On ne reviendra pas sur la question prioritaire de
constitutionnalité et les coups de rabot portés à sa traduction dans le texte
constitutionnel lui-même où d’ailleurs il n’est pas question de droits fondamentaux
mais de « droits et libertés que la Constitution garantit » et où en fait de recours
indirect, il s’agit d’un recours filtré par les juridictions suprêmes.
3 Quant au référendum législatif de l’article 11, il faut chercher loin pour y voir
l’expression d’un droit nouveau au bénéfice des citoyens. Ne cédons toutefois pas à la
mauvaise foi en reconnaissant qu’indéniablement l’alinéa 3 de l’article 11 ouvre une
nouvelle possibilité pour le peuple français de s’exprimer directement : il s’agit bien
d'inaugurer un nouveau référendum. Pourtant, plusieurs indices témoignent d’une
sorte de pusillanimité - pour ne pas dire plus - à octroyer effectivement ce droit
d’expression politique directe.
4 D’abord, le délai de mise en œuvre du droit promis. Il aura fallu attendre 7 ans pour que
les textes de mise en application entrent en vigueur. La loi organique et la loi du 6
décembre 2013 qui précisent l’article 11 ne le rendront effectif qu’au 1 er janvier 2015.
5 Ensuite, l’étendue du droit espéré. Présenté dans un premier temps comme un « droit
d’initiative populaire », le Comité Balladur a tout aussi rapidement conçu comme
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
6
« indispensable d’[y]associer les parlementaires » (Rapport du Comité de réflexion et de
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, Une Ve République
plus démocratique, La Documentation française, 2007, p.74). De sorte qu'on a plutôt
affaire à un droit d'initiative parlementaire - une minorité d'1/5 du Parlement soit 185
parlementaires - soutenue par un nombre significatif d'électeurs - 1/10 des inscrits soit
plus de 4 millions de personnes.
6 Enfin, la garantie du droit rêvé. Ici la modernité pourrait bien porter une atteinte
irréversible au droit nouveau et à la république censée en découler. Là, le contrôle du
Conseil constitutionnel pourrait enterrer définitivement ces deux biens publics. En
premier lieu, les soutiens populaires seront en effet exclusivement recueillis par voie
électronique (art. 5 de la loi organique) et ce uniquement à l'aide de "points d'accès à
un service de communication au public en ligne" (voir pour une définition l'art. 1er II.
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique),
autrement dit des bornes d'accès au vote mises à disposition "au moins dans la
commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription
administrative équivalente et dans les consulats", sachant que "tout électeur peut, à sa
demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du
consulat son soutien présenté sur papier" (art. 6 de la loi organique). Autant dire que
l'expression du soutien est compliquée par une procédure largement dépendante de
circonstances locales, techniques entre autres. En second lieu, on ne peut que constater
la discrétion offerte au Conseil par le nouvel article 45-2 3° de l'ordonnance de 1958
portant sur le Conseil constitutionnel. Ce dernier a maintenant pour mission expresse
de vérifier la compatibilité de la proposition de loi à la constitution. On espère ainsi se
prémunir contre les révisions "à la De Gaulle façon 1962". Mais on donne aussi au
Conseil un moyen supplémentaire de faire obstacle à l'initiative parlementaire,
quoiqu'elle fût soutenue cette fois pas un nombre significatif d'électeurs. Et comme
deux précautions valent mieux qu'une, on peut également voir dans l'alinéa 5 de
l'article 11, le pouvoir d'un Président de reprendre le fil d'une relation exclusive avec le
peuple, temporairement interceptée par le Parlement. Le Président "soumet" la
proposition de loi au référendum si les parlementaires ne l'ont pas examinée à temps.
L'ambiguïté de l'indicatif présent du verbe soumettre laisse penser qu'en dernière
analyse, c'est bien au Chef de l'Etat que revient le pouvoir de manier l'outil
référendaire dont on sait que, sous la Ve République, il n'appartient qu'à lui.
7 On voit donc comment par une révision vibrant de bonnes intentions à l'égard du
peuple et de ses représentants, on perpétue une longue tradition exécutive toujours
méfiante à l'égard de ceux-là même qu'elle est censée servir et protéger.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
7
AUTHOR
CHARLOTTE GIRARD
Maître de conférences de droit public Habilitée à diriger des recherches, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, Centre de Recherche et d'Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF - EA
3933)
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
8
Entretien
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
9
Entretien avec Mme Christine
Lazerges, Présidente de la
Commission Nationale Consultative
des droits de l’homme (CNCDH) et
M. Hervé Henrion-Stoffel, magistrat,
conseiller juridique à la CNCDH
A propos de l’Avis de la CNCDH sur le projet de loi renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (Assemblée plénière
– 25 septembre 2014)
Jacqueline Domenach
AUTHOR'S NOTE
Dans l’avis très argumenté, rendu par la CNCDH sur le projet de loi renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme1, la commission a émis un certain
nombre de réserves et de critiques sur le projet. Cette analyse vise à la fois les
conditions de la procédure législative, les nouveaux pouvoirs du ministre de l’intérieur,
le contrôle des sites internet et la qualification de nouvelles infractions, ainsi que la
procédure pénale applicable.
1. Vous précisez dans l’avis rendu, votre « ferme opposition » à la mise en œuvre par le
gouvernement de la procédure accélérée
La CNCDH est systématiquement réservée sur l’utilisation de cette procédure et sur
l’accélération de la fabrication de la loi, en particulier dans les matières sensibles
pour les droits et libertés et notamment dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme2. L’élaboration de la loi dans de bonnes conditions nécessite une étude
d’impact qui en soit véritablement une. S’agissant du projet de loi renforçant les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
10
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la procédure a été si rapide que
les rédacteurs de l’étude d’impact n’ont pas donné de justifications suffisantes sur la
nécessité d’adopter de nouvelles mesures en matière de terrorisme. La procédure
accélérée elle-même ne peut être justifiée que si l’étude d’impact a été longuement
réfléchie. A cet égard, il convient de rappeler que la loi nouvelle est adoptée à peine
deux ans après la loi précédente renforçant la lutte contre le terrorisme 3. On doit
considérer que si le Parlement et le Gouvernement se donnaient le temps nécessaire
pour faire un bilan des textes existants, il ne serait souvent pas nécessaire d’adopter
une loi nouvelle. L’accélération du temps nécessaire à l’adoption de dispositions
législatives nouvelles ne peut être que préjudiciable à la garantie des droits et libertés
fondamentaux et ne donne que peu de temps à la CNCDH pour exercer sa mission
consultative.
2. Les conditions des décisions administratives en matière d’interdiction du territoire et
d’interdiction du territoire et atteintes aux libertés d’aller et de venir et de quitter le territoire
En vertu des nouvelles dispositions, tout français peut faire l’objet d’une interdiction
de sortie du territoire « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette… ».
Une telle décision pose la question de la solidité des informations qui permettent de
prendre une décision éclairée pour prononcer l’interdiction de quitter le territoire.
En pratique, la nouvelle mesure sera très probablement ordonnée à partir de notes
des services de renseignement émanant de la Direction générale de la Sécurité
intérieure (DGSI). Une atteinte aussi grave à la liberté d’aller et de venir ne peut
reposer sur les appréciations d’un seul service, et sans être soumises au principe du
contradictoire avant la prise de décision. Il doit néanmoins être relevé, et c’est un
point positif, que la décision peut être contestée dans le cadre d’un recours pour
excès de pouvoir, accompagné le cas échéant d’un référé suspension, ou par la voie
du référé-liberté fondamentale. Il sera évidemment intéressant de connaître la
position du juge administratif en matière de contrôle de telles mesures. Par ailleurs,
on pourrait imaginer la mise en œuvre d’une question prioritaire de
constitutionnalité sur l’une ou l’autre des dispositions de la loi. Le recours à la QPC
est possible en l’espèce, la loi n’ayant pas fait l’objet d’une saisine a priori du Conseil
constitutionnel.
Le problème est aussi celui des conséquences de telles mesures qui emportent le
retrait et l’invalidation du passeport contre la remise d’un récépissé permettant de
prouver son identité. A cet égard, il est « cocasse » d’observer qu’au moment où sont
institués une privation du passeport et de la carte d’identité pour les majeurs est
supprimée l’autorisation parentale de quitter le territoire pour les mineurs !
Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit la mise en place d’une mesure administrative
visant à interdire l’entrée sur le territoire français tout citoyen européen non
résidant en France ne se trouvant pas déjà sur le territoire et dont la présence en
France « constituerait (…) du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». L’absence
de mention du caractère terroriste de cette menace ainsi que l’interprétation
extensive de la menace à la sécurité publique donnent de bonnes raisons de craindre
que cette mesure ne soit utilisée abusivement par l’administration pour interdire
l’entrée sur le territoire des citoyens européens qui ne représentent en aucun cas une
menace terroriste. En effet, dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a considéré le 1 er
octobre 2014 que pratiquer la mendicité en prétendant récolter des dons pour une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
11
association caritative représentait une menace grave à la sécurité publique qui
constitue un « intérêt fondamental de la société française »4.
3. Les dispositions de la loi et la liberté d’expression
Dans un avis très récent sur la réforme de la protection du secret des sources, la
CNCDH a utilement rappelé, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme 5,
que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, constitue « l’un
des fondements essentiels d’une société démocratique »6. Pour la CNCDH, une réflexion
générale portant sur l’internet et les droits fondamentaux7, ainsi que sur l’éventuelle
définition d’un « ordre public numérique » doit être engagée8.
La nouvelle loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’ordonner aux
fournisseurs d’accès à internet le blocage de l’accès aux sites incitant à commettre
des actes terroristes ou en faisant l'apologie. Toutefois, le blocage administratif de
l’accès aux sites internet incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant
l’apologie est, pour la CNCDH, de nature à brouiller la distinction classique entre
police administrative et police judiciaire. Le nouveau texte habilite l’autorité
administrative à décider du blocage, alors même qu’une ou plusieurs infractions ont
déjà été commises9. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit d’une mesure de police
purement administrative destinée à prévenir la provocation à des actes de terrorisme
ou l’apologie de ceux-ci. Les nouvelles dispositions relèvent indéniablement du
domaine de la police judiciaire dont la direction et le contrôle sont dévolus à
l’autorité judiciaire, seule compétente pour la poursuite et la répression des
infractions. Il est donc porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
(article 16 de la Déclaration de 1789)10.
Le texte adopté pose également question au regard des exigences de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Même si la jurisprudence de la Cour
de Strasbourg ne semble pas fixée en la matière11, la CNCDH estime néanmoins
l’intervention d’un juge nécessaire pour ordonner et contrôler le blocage d’un site
internet12, dès lors que cette mesure constitue une ingérence grave dans la liberté
d’expression et de communication13. En effet, toute restriction préalable à
l’expression sur internet entraîne une présomption lourde d’incompatibilité avec
l’article 1014. Pour la CNCDH, le pouvoir de bloquer l’accès à un site internet devrait
être dévolu au juge des libertés et de la détention, qui statuerait dans un délai bref de
48 ou 72 heures, sur saisine du parquet compétent, notamment à la suite d’un
signalement auprès de la plateforme PHAROS.
La provocation publique aux actes de terrorisme et l'apologie publique de tels actes
étaient, avant la réforme, réprimées par la loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté
d’expression. La nouvelle loi a inscrit ces infractions à l’article 421-2-5 du code pénal,
au motif qu’il ne s’agit pas d’abus de la liberté d’expression, mais de faits qui sont
directement à l’origine d’actes terroristes. Par ce biais, il s’agit une nouvelle fois
d’écarter l’application de la procédure pénale protectrice spécifique aux délits de
presse, afin d’accroître les pouvoirs des enquêteurs, qui sont désormais habilités à
réaliser certains actes d’investigation dans le cadre du régime dérogatoire relatif aux
infractions terroristes. Les nouvelles dispositions sont de « véritables sorties du droit
pénal de la presse pour contrarier le principe de mesure dont il s’inspire au nom des libertés de
pensée, d’expression et d’opinion »15.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
12
La CNCDH est en principe opposée à l’introduction dans le code pénal d’infractions
relatives à la liberté d’expression, celles-ci ne pouvant être poursuivies qu’en
application des règles procédurales spécifiques définies par la loi du 29 juillet 1881.
En revanche, lorsque le législateur veut incriminer spécifiquement certains
comportements en rapport plus ou moins lointain avec la communication, et les
réprimer fermement, il est préférable qu’il le fasse dans le cadre du code pénal et non
dans celui de la loi de 1881, qui y perd son âme…
4. Les nouvelles qualifications de l’infraction de terrorisme et le respect de la procédure
pénale
La définition de l’infraction d’entreprise individuelle terroriste, (nouveau délit prévu
à l’art 421-2-6 du code pénal) constitue indéniablement une atteinte aux principes
fondamentaux du droit pénal. Le nouveau texte évoque en effet « l’acte préparé »,
« la préparation » ou le « fait de préparer » la commission d’une infraction. Cela
revient à incriminer de façon autonome des actes préparatoires. En référence au
principe pénal selon lequel la poursuite ne s’applique que dès lors qu’il y a
commencement d’exécution et non pas seulement actes préparatoires, il y a atteinte
au principe de légalité des incriminations et à la présomption d’innocence. A ce
propos, il convient de préciser que les nouvelles dispositions énumèrent des actes
délictueux qui sont antérieurs au commencement d’exécution et même aux actes
préparatoires ! A titre d’exemple on peut citer que le simple fait de rechercher des
objets ou substances dangereux, combiné à la consultation habituelle de sites
internet véhiculant une idéologie terroriste suffira pour qualifier la nouvelle
infraction. Dans un tel cas de figure, l’intégralité des actes réprimés est située au
stade de la simple « préparation de la préparation » de l’infraction. Dans son avis, la
CNCDH a retenu à cet endroit une violation du principe de légalité, en raison du
manque de clarté et donc de prévisibilité des conduites ainsi réprimées. Plus
fondamentalement, elle voit dans la pénalisation accrue d’actes antérieurs au
commencement d’exécution, une résurgence inquiétante de la doctrine du « droit
pénal de l'ennemi » : ce serait une « victoire de la peur », la victoire d'un droit pénal
sécuritaire sur un droit pénal classique strictement encadré par le principe de
légalité.
Enfin, la CNCDH est très réservée sur le principe même de la/ou des dérogations à la
procédure pénale de droit commun16. Or, on assiste à une extension systématique de
la procédure dérogatoire et à la multiplication des types de procédures dérogatoires.
Une telle évolution de la mise en œuvre du dérogatoire en matière pénale conduit à
rendre illisible les conditions d’intervention du Parquet et des juges d’instruction. La
réécriture des moyens d’investigation autorisés ou non s’impose. Pour l’instant, on
peut estimer que la Cour de Strasbourg a une vision laxiste de la procédure
dérogatoire. Alors que la procédure de droit commun est conforme aux garanties des
libertés et droits fondamentaux, les dispositifs d’exception qui se banalisent ne
peuvent qu’être déplorés. La conséquence n’est plus seulement un « dédoublement de
la procédure pénale » mais plus largement la multiplicité des types de procédure
selon les qualifications retenues par le Parquet et plus précisément en fonction de la
qualification retenue en tout début de procédure par le Parquet. Le risque est celui du
choix d’une qualification initiale autorisant dès le début de la procédure un régime
procédural dérogatoire moins garantiste des droits fondamentaux.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
13
NOTES
2. CNCDH 15 avril 2010, Avis sur l’élaboration des lois : www.cncdh.fr ; CNCDH 20 décembre 2012,
Avis sur la loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme : www.cncdh.fr.
3. Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme.
4. CE 1er octobre 2014, Mme A…, n° 365054.
5. Voir notamment Cour EDH, 28 juin 2012, Ressiot & autres c. France, req. n° 15054/07 et 15066/07.
6. CNCDH 25 avril 2013, Avis sur la réforme de la protection du secret des sources, JORF n° 0134 du
12 juin 2013, texte n° 90.
7. Voir Conseil d’Etat, Etude annuelle 2014. Le numérique et les droits fondamentaux, La documentation
française 2014.
8. Un groupe de travail portant sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
sur internet a été constitué à la CNCDH. Un avis sera rendu dans les prochains mois.
9. En effet, le nouvel article 6 I. 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 fonde le blocage
administratif sur des « actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ».
10. Cons. const. 19 janvier 2006, n° 2005-532 DC.
11. Voir Cour EDH 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, req. 3111/10.
12. Dans ce sens voir Assemblée nationale, Commission ad hoc de réflexion et de propositions sur
le droit et les libertés à l’âge du numérique, Recommandation sur l’article 9 du projet de loi renforçant
les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (http://www2.assemblee-nationale.fr/14/
commissions/numerique/a-la-une/recommandation-sur-l-article-9-du-projet-de-loi-contre-le
terrorisme).
13. Voir dans ce sens Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC.
14. Dans ce sens voir l’opinion concordante du juge Paulo Pinto de Albuquerque (sous Cour EDH
18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, op. cit.) qui se réfère à l’affaire Banatan Books, Inc. v.
Sullivan (372 U.S. 58 (1963) : « Any system of prior restraints of expression comes to this Court bearing a
heavy presumption against its constitutional validity »).
15. Cf. Y. Mayaud , La politique d’incrimination du terrorisme à la lumière de la législation
récente, AJ Pénal 2013, p. 446. Voir également J. Alix, Terrorisme et droit pénal. Pour une étude critique
des infractions terroristes, Dalloz 2010.
16. Voir CNCDH 29 avril 2014, Avis sur la refondation de l’enquête pénale, JORF n° 0108 du 10 mai
2014, texte n° 84.
1. CNCDH 25 septembre 2014, Avis sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la
lutte contre le terrorisme, JORF n° 0231 du 5 octobre 2014, texte n° 45.
AUTHOR
JACQUELINE DOMENACH
Professeure de droit public, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, CRDP
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
14
Dossier thématique : Révolutions et
droits de l’Homme (II). Aspects
politiques : le cas des révolutions
arabes et moyen-orientales
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
15
Présentation
Véronique Champeil-Desplats and Malik Boumédiene
1 Ce dossier est le second volet d’une vaste étude initiée par les doctorants du CREDOF
sur les rapports entre les concepts de Révolution et de droit de l’homme. Après une
première étude consacrée aux aspects épistémologiques et conceptuels (Revdh n° 5, juin
2014), la réflexion s’est concentrée sur la dimension politique de ces rapports en
privilégiant un terrain d’actualité : celui des Etats arabes et moyen-orientaux.
2 Les contributions présentées dans ce dossier sont issues, d’une part, de la journée
d’études organisée le 6 février 2014 par les doctorants du Centre de recherches et
d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF) de l’Université de Paris Ouest-Nanterre
la Défense, intitulée Droits de l’homme et Révolution (contributions d’Antonin Gelblat,
Mamadou Meité et Hiva Khedri doctorants au CREDOF).
3 Elles proviennent, d’autre part, de la publication de deux demi-journées d’études sur
les « révolutions arabes » organisées par Malik Boumediene, maitre de conférences à
l’Université de Toulouse Le Mirail et membre du CREDOF, dans le cadre d’une réflexion
sur les nouveaux constitutionnalismes et les droits de l’homme. La première demi-
journée, qui s’est tenue le 10 octobre 2013, portait sur « Les printemps arabes et les
droits de l’homme » et la seconde, organisée le 19 juin 2014, s’est interrogée sur « Les
apports du nouveau constitutionnalisme égyptien ».
4 Ces deux demi-journées partent du constat que le monde arabe fait l’objet depuis voilà
quelques années de toutes les attentions, et que cette actualité est toute proche de
nous. On rappellera à ce titre qu’il vient de se dérouler, il y a quelques semaines, en
Tunisie, les premières élections libres sur la base de la nouvelle constitution du pays.
Plus généralement, depuis 2011, on assiste, dans plusieurs pays, à une transition
démocratique plus ou moins lente. On parle ainsi de « printemps arabe », de « révolution
arabe », de « soulèvements populaires ». Des citoyens, au sein de pays autoritaires,
n’hésitent plus à braver le pouvoir, à manifester. Le peuple réclamant, le plus souvent,
davantage de liberté, plus de justice sociale, une meilleure répartition des richesses et
la fin de l’accaparation, par une minorité, de l’économie nationale.
5 Tout cela a débuté en Tunisie. En effet, des manifestations ont commencé le 17
décembre 2010 suite l’immolation d’un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes à
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
16
Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, dont la marchandise avait été confisquée par les
pouvoirs publics. Cela aura pour conséquence le départ du chef de l’Etat, Zine el-
Abidine Ben Ali au pouvoir depuis 1987. Ces manifestations vont se propager et toucher
d’autres pays arabes avec des conséquences diverses : l’Egypte, la Libye, le Maroc, le
Bahreïn, la Syrie, Jordanie. Ces évènements vont entrainer plusieurs conséquences dont
un renouveau constitutionnel de certains pays.
6 Les deux tables rondes qui se sont déroulées dans la cadre du CREDOF tentent de mettre
en évidence les mutations constitutionnelles qui ont pu voir le jour. Il s’agit tender
d’apporter un éclairage à plusieurs interrogations : quel est le contenu et la portée de
ces réformes constitutionnelles ? Assiste-t-on à un renouveau des droits
fondamentaux ? Peut-on parler de transition démocratique aboutie ? Quelle place pour
la religion ? Biens d’autres questions restent en suspens dont seul le futur pourra
apporter éventuellement une réponse : cette démocratisation constitutionnelle ne va-t-
elle pas se heurter à la pratique du pouvoir ? Quelle sera la place du pouvoir judiciaire
ou de la justice constitutionnelle dans la protection des libertés fondamentales ? Le
principe de séparation des pouvoir sera-t-il effectif ? Ne doit-on pas aller vers de
nouvelles réformes constitutionnelles ? Quelle sera la place de la société civile dans ces
pays post-révolutionnaires ?
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
17
Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects
politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
I. Approches thématiques et
transversales
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
18
Révolutions arabes et renouveau
constitutionnel : une
démocratisation inachevée
Malik Boumédiene
1 Le renouveau constitutionnel dans une partie du monde arabe trouve ses origines dans
la conception et la pratique du pouvoir ainsi que dans la place restreinte jusqu’alors
donnée aux droits fondamentaux. La question des droits de l’homme et de la
démocratie dans le monde arabe « pré-révolutionnaire » faisait (et fait encore
aujourd’hui) régulièrement l’objet d’une actualité.
2 Il n’y a qu’à prendre l’exemple de la Tunisie sous la présidence du président Ben Ali
pour s’en convaincre. Ben Ali était au pouvoir depuis 1989. La démocratie politique
était étouffée. Par ailleurs, sous sa présidence, les partis religieux étaient réduits au
silence. Le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique- RCD) était le parti
unique du Président Ben Ali créé par ses soins en 1988. Ce parti contrôlait, depuis sa
création, la grande majorité des sièges du Parlement. L’Etat tunisien faisait l’objet de
multiples critique du point de vue du respect des droits de l’homme. C’est ainsi que
l’Etat s’est vu reconnaitre coupable par diverses ONG d’actes de torture ou de mauvais
traitements dont certains magistrats avaient refusés d’enregistrer les plaintes.
L’indépendance de l’autorité judiciaire demeurait fragile puisque le poids du pouvoir
exécutif était important au sein du Conseil supérieur de la magistrature. La liberté
d’association, et ainsi la place de la société civile, restait à conquérir. En effet, un
nombre très limité d’associations indépendantes n’a été officiellement enregistré par
les autorités et, en pratique, plusieurs associations de défense des droits de l’homme
ont rencontré des obstacles dans l’obtention d’un tel enregistrement. On a également
pu constater une certaine mise sous contrôle des citoyens à travers la décision du
Président de la République le 10 mai 1991 de créer des comités de quartier. En janvier
1992, on comptait 2 825 comités de quartier. En créant de tels comités, le pouvoir avait
mis en place un dispositif nouveau visant à sa consolidation. Ils étaient contrôlés par
des personnalités politiques (ministres, membres du RCD, Etat,…).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
19
3 Outre les aspects politiques, la question sociale est une question, également,
omniprésente dans le monde arabe « pré révolutionnaire » (comme aujourd’hui
encore). Au Maroc par exemple, le nombre de chômeurs tend à augmenter. Avec près
de 1 130 000 de personnes sans emploi, le taux de chômage national a atteint, au
premier trimestre de 2012, les 9,9%, soit une hausse de 0,8 par rapport à 2011 (Haut-
Commissariat au plan). Plus de 28,9 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
(rapport du PNUD, 2010). Enfin, près de 53% des marocaines ne savent ni lire, ni écrire,
révèle un rapport du Haut-commissariat au plan marocain (2014).
4 La situation politique, économique et sociale d’une partie du monde arabe ne pouvait
alors que constituer les bases à des « révolutions » futures. Ce qui fut le cas en 2011
avec la Tunisie à travers le départ du président Ben Ali. S’en suit un effet domino
puisque avec le Maroc, l’Egypte, le Bahreïn, la Syrie ou encore la Libye. Ces
« révolutions » ou « printemps arabes » vont se traduire par la mise en place de
nouvelles constitutions. Ces dernières témoignent d’une volonté de démocratisation (I)
même si cette dernière reste limitée, non aboutie, voire précaire (II).
I. Le renouveau constitutionnel comme fondement à la
démocratisation
5 Il est incontestable que le monde arabe se voit traversé par un mouvement
démocratique qui touche les fondements même des régimes politiques en place. Ce
mouvement se manifeste par une volonté de consolider les droits fondamentaux (A)
tout en recherchant un plus grand équilibre des pouvoirs (B).
A. La consolidation des droits fondamentaux
6 La place des droits fondamentaux, tout comme leur protection, au sein des
constitutions devient aujourd’hui un indice pour se prononcer sur la densité
démocratique d’un régime politique. A ce titre, le renouveau constitutionnel suite au
« printemps arabe » est traversé par la volonté de donner une nouvelle portée aux
droits de l’homme et, de manière générale, au droits fondamentaux tels que reconnus
par le droit international. Prenons quelques exemples significatifs : le Maroc, la
Mauritanie, la Syrie et l’Egypte.
1. Le Maroc
7 La consolidation des droits fondamentaux se matérialise à travers la nouvelle
constitution marocaine en date du 1er juillet 2011. C’est ainsi qu’au sein du préambule il
est dorénavant noté que le Maroc a pour objectif de construire un « Etat de droit
démocratique ». Le préambule souligne aussi, explicitement, l’attachement du Royaume
aux droits de l’homme « tels que universellement reconnus ». En outre, l’article 9 fait
bénéficier les partis politiques d’une certaine protection puisque ces derniers 1,
notamment, ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu
d’une décision de justice.
8 L’égalité entre les hommes et les femmes fait l’objet d’une attention particulière
puisque l’article 19 de la constitution dispose que l’homme et la femme jouissent à
égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social culturel ou
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
20
environnemental. La loi fondamentale va même jusqu’à poser le principe de la
nécessité d’une action positive de l’Etat afin de garantir ce principe d’égalité et, plus
précisément, de parité entre homme et femme. Dans ce sens, il est créé au sein de la
Constitution d’une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de
discrimination. Ce principe d’égalité concerne aussi les fonctions électives où le
législateur est invité à intervenir. Cette volonté de promouvoir les droits des femmes
s’intègre dans le droit fil du droit international et plus précisément la convention des
Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes en date du 18 décembre 1979.
9 Le droit à la vie est reconnu comme le premier des droits humain. L’article 23 de la
Constitution de 2011 concerne la sureté de l’individu. C’est ainsi que la détention
arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont considérés comme des crimes. Des
garanties sont consacrées également en ce qui concerne la procédure pénale puisque
toute personne détenue doit être informée immédiatement d’une façon qui lui soit
compréhensible des motifs de sa détention et de ses droits dont celui de garder le
silence. Elle doit bénéficier au plus tôt d’une assistance juridique. L’article 23 reconnait
également la présomption d’innocence.
10 Enfin, l’article 28 concernera lui la liberté de la presse qui ne peut être limitée par
aucune forme de censure préalable.
2. La Mauritanie
11 Un mouvement comparable touche également la Mauritanie, comme en témoigne la
réforme constitutionnelle du 20 mars 2012 qui va dans le sens d’une consolidation des
droits fondamentaux. On a peu parlé de la Mauritanie lorsque l’on aborde la question
du printemps arabe. Pourtant, en janvier 2011, une personne de 43 ans se disant
« mécontent de la situation politique du pays et en colère contre le régime en place », s’est
immolée par le feu devant le palais présidentiel. Cet acte est intervenu quelques jours
après des actes similaires survenus en Tunisie, en Egypte et en Algérie. Il s’agissait pour
cette personne de protester contre le régime du général Mohamed Ould Abdel Aziz
arrivé au pouvoir par un coup d'Etat militaire mené en août 2008, puis ensuite élu à la
présidence de la République en juillet 2009.
12 La contestation qui débute vers le 17 janvier 2011 est décrite comme la plus grande
depuis l’indépendance du pays. Les manifestations demandent des réformes sociales et
économiques ainsi que le départ du président Mohamed Ould Abdel Aziz.
13 Face à cette situation, le gouvernement a adopté différentes mesures : le 23 juin, la
pénalisation des délits de presse est levée et des terres sont distribuées à une centaine
de jeunes diplômés pour qu’ils les cultivent. Le 20 mars 2012, la Constitution est
modifiée. Elle reconnait l’égalité entre homme et femme en ce qui concerne les
mandats électoraux et les fonctions électives. L’esclavage est condamné : nul ne peut
être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis
à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette condamnation
de la torture s’inscrit dans le sillage de la convention des Nations-Unies contre la
torture en date du 10 décembre 1984. Ces pratiques constituent des crimes contre
l’humanité et sont punis comme tels par la loi. En outre, une Commission Nationale des
Droits de l’Homme est créée. Il s’agit d’une institution consultative indépendante de
promotion et de protection des droits fondamentaux.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
21
3. La Syrie
14 La Constitution syrienne du 26 février 2012 va également dans le sens d’un
renforcement des droits fondamentaux. Il est souligné en ce sens l’égalité des citoyens
devant la loi sans discrimination en fonction du sexe, de la race, de la langue, de la
religion ou des croyances. Il est précisé également que la vie privée est inviolable et
protégée par la loi.
15 Des dispositions concernent aussi la liberté d’association. En effet, il est indiqué que la
liberté de former des associations et des syndicats à des fins légitimes et par des
moyens pacifiques est garantie.
16 D’autres dispositions renforcent les droits de la défense. La loi fondamentale reconnaît
ainsi le droit pour toute personne de bénéficier d’un procès régulier comme le droit de
faire appel et de plaider devant un jury. En outre, pèse dorénavant sur l’Etat
l’obligation de fournir une assistance juridique à ceux qui ne possèdent pas de moyens
financiers suffisant afin d’assurer leur défense. D’autres dispositions, encore, sont
relatives à la procédure pénale. Il est reconnu dans ce sens dorénavant que lors de son
arrestation la personne arrêtée doit être informé de ses droits et des motifs de son
arrestation. Il est fait interdiction de garder une personne sous le contrôle de l’autorité
administrative si ce n’est en vertu d’un ordre de l’autorité judiciaire compétente. Il
s’agit ici de condamner les détentions arbitraires contraires à l’article 9 du Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Enfin, les
personnes se voient reconnaître un droit à indemnisation si le verdict est erroné et la
peine appliquée.
4. L’Egypte
17 Pour sa part, la Constitution égyptienne de 2014 reconnait un certain nombre de droits
fondamentaux nouveaux, vient en préciser d’autres ou encore en renforcer certains
déjà existants.
18 A ce titre, on constate que le préambule de la constitution fait référence à la
déclaration universelle des droits de l’homme, les universités doivent enseigner les
droits de l’homme (article 24) et l’article 93 dispose nouvellement que « L’Etat s’engage à
respecter les traités, accords et conventions internationales relatifs aux droits de l’homme
ratifiés par l’Egypte ».
19 On relèvera tout d’abord que le droit de propriété bénéficie d’une attention particulière
puisqu’il est non seulement garantie mais également « protégé » et que la liberté de culte
devient « absolue ».
20 A la lecture de plusieurs dispositions, le droit à la sûreté semble également consolidé.
Par exemple, il est mentionné que toute personne arrêtée ou détenue doit être
informée « immédiatement » des motifs par écrit (on voit là l’application de l’article
9§2 du Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques). Elle ne peut, en outre, être
interrogée qu’en présence d’un avocat qui doit être désigné en cas de besoin (article
54). De plus, toute personne arrêtée ou détenue a le droit de s’en plaindre devant le
tribunal qui devra alors trancher au bout d’une semaine. Dans le cas contraire, elle doit
être remise immédiatement en liberté. Le nouveau texte reprend l’idée de l’inviolabilité
du domicile mais vient encadrer les atteintes éventuelles à ce principe. C’est ainsi que
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
22
s’il est permis d’entrer au domicile d’une personne, de le perquisitionner, ou de le
surveiller ce n’est que dans les conditions déterminées par la loi et sur ordonnance
judiciaire motivée, précisant le lieu, la date et l’objectif de la perquisition. En outre, les
habitants de la maison doivent être prévenus avant toute perquisition.
21 En ce qui concerne la liberté de la presse, la nouvelle Constitution met l’accent sur le
fait que les journaux. En outre, le texte fondamental mentionne qu’il est interdit de
censurer, confisquer suspendre ou fermer de quelques manière que ce soit les journaux
et médias égyptiens. Les journaux peuvent être publiés dès leur déclaration. La liberté
de réunion est davantage protégée par rapport au texte de 1971 puisqu’il est indiqué
qu’il est, non seulement, interdit aux agents de sécurité de participer à ses réunion
mais, également, il est fait interdiction de mettre sur écoute celles-ci.
22 L’interdiction de la mise sur écoute (« espionner ») apparaît comme le nouvel apport du
nouveau texte fondamental. Les syndicats bénéficient d’une protection renforcée dans
la mesure où leur dissolution ne peut intervenir, dans l’avenir, que sur la base d’une
décision judiciaire allant dans le sens de la philosophe de la Convention n°87 de l’OIT en
date de 1948 qui est relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical.
Par ailleurs, le droit de grève est reconnu.
23 Les droits sociaux bénéficient d’une certaine attention de la part du texte fondamental
puisque l’Etat doit assurer les services de l’assurance sociale. Il est indiqué que tout
citoyen a le droit à la solidarité sociale, s’il est incapable de prendre en charge sa
propre personne, ni sa famille, ou en cas d’incapacité, de chômage, de vieillesse, afin de
leur assurer un minimum de moyen d’existence. De nouvelles dispositions viennent
également mettre à la charge de l’Etat l’obligation d’assurer une pension convenable
aux petits paysans, aux ouvriers agricoles, à la main d’œuvre saisonnière et à tous ceux
qui ne sont pas couvert par le système de l’assurance sociale. La référence au droit au
logement apparait aussi comme une nouveauté. Dans ce sens le droit à une habitation
convenable est reconnu. A cette fin l’Etat doit adopter un plan national pour le
logement basé sur la justice sociale, et qui encourage les initiatives individuelles et les
coopératives de l’habitat. Ces dispositions sociales s’intègrent dans le sillage des
dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme en date de 1948.
24 On remarquera enfin que la protection de l’enfance fait l’objet d’une attention
particulière, contrairement au texte constitutionnel de 1971. Il est fait ainsi
interdiction d’embaucher un enfant avant l’âge de la fin de l’enseignement primaire ou
dans des activités inappropriées à son âge. En matière judiciaire, l’enfant ne peut être
détenu ou déclaré responsable que dans les conditions très strictes de la loi. Une
assistance juridique doit lui être assurée. Le lieu de détention doit être convenable
mettant en place une séparation entre les sexes, l’âge, la nature du crime et
l’éloignement des lieux de détention des adultes. Enfin, de manière générale, l’article 71
de la loi fondamental souligne que l’Etat doit prendre soin des enfants et des jeunes,
assurer leur éducation, leur développement spirituel, moral, culturel, scientifique,
physique, psychologique, social et économique tout en œuvrant pour leur participation
politique. On le voit, ces nouveaux droits à destination des enfants trouvent un
fondement dans la Convention des droits de l’enfant en date de 1989.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
23
B. La recherche de l’équilibre des pouvoirs
25 Une deuxième caractéristique semble commune à l’ensemble de constitutions arabes
postrévolutionnaires. Il s’agit de la volonté du constituant de rechercher un certain
équilibre des pouvoirs. L’équilibre des pouvoirs doit permettre un contrôle réciproque
d’un pouvoir sur un autre et de constituer une garantie à la concentration du pouvoir
au sein de l’exécutif ou du pouvoir législatif. Comme le précisait Montesquieu « Pour
qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le
pouvoir »2. Les réformes constitutionnelles3 égyptienne, mauritanienne, marocaine ou
encore syrienne témoignent de ce mouvement constitutionnel.
1. L’Egypte
26 En Egypte, nous assistons, avec la réforme de 2014, à un affaiblissement du pouvoir
présidentiel. On observe une réduction et un encadrement des prérogatives
présidentielles qui se matérialise de différentes façons.
27 Encadrement : en témoignent les dispositions relatives au droit de dissolution. C’est
ainsi que, dorénavant, le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des
députés qu’après un référendum et sur la base d’un décret motivé. En outre, on
remarque que le mandat du chef de l’Etat se voit réduit passant de 6 à 4 ans et celui-ci
ne peut se représenter dorénavant qu’une seule fois. La déclaration de l’Etat d’urgence
par le chef de l’Etat est également davantage encadrée puisque sous, le régime de la
Constitution de 1971, la déclaration de l’état d’urgence devait être soumise dans les 15
jours à l’assemblée législative, ce délai est ramené à 7 jours.
28 Cet affaiblissement de la fonction présidentielle se manifeste non seulement par un
plus grand encadrement des prérogatives du chef de l’Etat mais aussi par la suppression
de certaines prérogatives. En ce sens, la Constitution de 2014 supprime les dispositions
telles que celles contenues au sein de l’article 74 de la Constitution de 1971 et qui
concernaient les pouvoirs exceptionnels du chef de l’Etat. Cet article disposait que : « En
cas de danger imminent et grave menaçant l’unité national, ou la sécurité de la patrie, ou
empêchant les institutions de l’Etat de remplir leur rôle constitutionnel, il appartient au
président de la République de prendre les mesures urgentes pour parer à ce danger après
consultation du Premier ministre et des présidents de l’assemblée du Peuple et de ‘Assemblée
consultative. Il adresse un message au peuple et fait procéder à un référendum sur les mesures
prises dans les 60 jours qui suivent. La dissolution de l’Assemblée du peuple et de l’Assemblée
consultative est interdite lors de l’exercice de ces pouvoirs ».
29 La réduction des prérogatives présidentielles se matérialise enfin par le fait que la
nouvelle Constitution semble imposer au Président de la République de choisir le
Premier ministre au sein du parti détenant la majorité des sièges à la Chambre des
députés. Il s’agit là de donner une pleine possibilité pour le gouvernement de pouvoir
prendre les grandes décisions en s’appuyant sur une majorité parlementaire. Il s’agit
aussi d’encadrer le pouvoir de nomination du Chef de l’Etat et d’assoir un véritable
régime parlementaire.
30 A côté de cette volonté de mieux encadrer les prérogatives présidentielles, il existe
aussi celle de renforcer la place du pouvoir législatif afin de tendre vers un meilleur
équilibre des pouvoirs. La structuration même de la constitution permet d’avancer une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
24
telle idée puisque la section relative au pouvoir législatif précède celle qui concerne le
chef de l’Etat contrairement à la constitution de 1971.
31 C’est ainsi que la chambre des représentant voit le nombre de ses élus composé d’un
minium d’élu qui est de 450 contre 350 sous la constitution de 1971. La convocation de
la Chambre des représentants en sessions extraordinaire est facilitée puisque
dorénavant elle peut être convoquée par au moins un dixième des membres (article
116) alors que sous le régime de la constitution de 1971 une motion devait être adoptée
par la « majorité » de l’assemblée. En outre, on peut observer que le Premier ministre,
comme ses ministres, doit répondre « obligatoirement » aux questions posées par un
membre de la chambre des représentants et cela dans « la même session ». Les membres
de la chambre peuvent aussi interpeller le Premier ministre, les ministres et leurs
adjoints et le débat sur l’interpellation doit intervenir dans les 60 jours de son dépôt.
L’article 134 permet à chaque membre de la chambre de demander une réunion
d’urgence ou une déclaration du Premier ministre, à l’un de ses adjoints, à un des
ministres ou de leurs adjoints, sur des questions urgentes touchant à l’intérêt public. En
outre la constitution nouvellement rédigée impose au Premier ministre comme aux
ministres d’être obligatoirement présents à la Chambre si celle-ci le demande.
2. Le Maroc
32 Tout comme la nouvelle Constitution Egyptienne il semble que la réforme
constitutionnelle marocaine de 2011 est fondée aussi sur la volonté de tendre vers
davantage d’équilibre des pouvoir. Un tel fondement est inscrit dans la Constitution et
plus précisément au sein de l’article 1er.
33 Cet équilibre des pouvoirs va se manifester, dans un premier temps, par un
encadrement du pouvoir royal. Le Roi à obligation dorénavant de nommer le chef du
gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la
chambre des représentants.
34 La recherche de l’équilibre des pouvoir se matérialise aussi à travers la nouvelle
Constitution à travers la volonté de renforcer le rôle du parlement. Le nouveau texte
précis ainsi que le parlement contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques
publiques. L’article 71 élargit le domaine de la loi qui pourra intervenir dorénavant, par
exemple, dans le domaine des libertés et des droits fondamentaux.
35 Le contrôle du pouvoir législatif sur l’exécutif se manifeste aussi à travers l’article 102
qui permet aux commissions compétentes dans chacune des deux chambres de
demander à auditionner les responsables des administrations. Cet équilibre des
pouvoirs se manifeste enfin à travers le droit qui est donné dorénavant au chef du
gouvernement de dissoudre la chambre des représentants sur la base d’un décret pris
en conseil des ministres.
3. La Syrie
36 Un dernier exemple constitutionnel tend à appuyer l’idée de la volonté de donner une
certaine réalité au principe d’équilibre des pouvoirs dans ce mouvement de renouveau
constitutionnel touchant le monde arabe. Il s’agit de la révision constitutionnelle
syrienne du 26 février 2012.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
25
37 Le pouvoir législatif se voit renforcé à plusieurs égards. La durée minimale des sessions
de l’Assemblée du peuple est précisée au sein même de la Constitution ce qui n’était pas
le cas auparavant. Cette durée minimale est de six mois. Dorénavant le chef de l’Etat qui
peut exercer, comme en 1973, le pouvoir législatif en dehors des sessions du parlement
doit soumettre cette législation à l’Assemblée populaire du peuple dans les 15 jours de
sa première séance. Un tel délai ne figurait pas dans la Constitution de 1973. L’article
121 de la Constitution vient, quant à lui, souligner que le premier ministre comme les
ministres sont responsables devant l’Assemblée nationale du peuple. Enfin, en cas de
dissolution de l’Assemblée, les nouvelles élections doivent avoir lieu non plus dans les
90 jours à la date de la dissolution mais dans les soixante jours.
38 Parallèlement, le président voit, quant à lui, ses prérogatives réduites dans un premier
temps. C’est ainsi que la disposition suivante a été abrogée par la Constitution du 26
février 2012 : « Le président de la République exerce le pouvoir législatif durant les sessions de
l’Assemblée, lorsque c’est absolument nécessaire pour la sauvegarde des intérêts nationaux du
pays ou en raison de l’exigence de la sécurité nationale ».
39 En outre, sous la constitution de 1973, la loi fondamentale soulignait uniquement que le
chef de l’Etat pouvait exercer le pouvoir législatif en dehors des sessions de
l’Assemblée. La constitution de 2012 vient préciser qu’il exerce un tel pouvoir en cas de
dissolution de l’Assemblée du peuple uniquement. Ensuite si les prérogatives du chef de
l’Etat ont été réduites celles-ci font l’objet dorénavant d’un encadrement plus poussé.
En effet, la constitution du 26 février 2012 vient indiquer explicitement, dans son
article 96, que le chef de l’Etat doit respecter la constitution. Il ne peut effectuer
également que deux mandat successifs. L’élection présidentielle n’est plus au-dessus de
la loi puisqu’une disposition dispose qu’une Haute Cour constitutionnelle est
compétente pour examiner les recours concernant l’élection présidentielle. Enfin, le
déclenchement de l’état d’urgence fait l’objet d’un encadrement contrairement au
régime constitutionnel qui dominait sous la constitution de 1973 puisque dans l’avenir
s’il revient au chef de l’Etat de décréter l’état d’urgence c’est seulement à la suite d’une
décision du conseil des ministres adoptée à la majorité des 2/3. En outre, ces décisions
doivent être soumises à l’Assemblée du peuple dès sa première séance.
II. La démocratisation à l’épreuve du renouveau
constitutionnel
40 Ce renouveau constitutionnel ne peut faire l’économie de certaines critiques. Il semble
que l’on peut avancer d’une part, que la protection des droits fondamentaux restent
lacunaire (A) et, d’autre part, que la place de l’exécutif et, plus précisément des chefs de
l’Etat, reste prépondérante (B).
A. Une protection fragile des droits fondamentaux
41 La protection des droits fondamentaux, si elle fait l’objet d’une attention particulière
au sein des constitutions postrévolutionnaires, mérite néanmoins d’être relativisée
dans la mesure où plusieurs limites textuelles (1) et pratiques (2) apparaissent.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
26
1. Arguments de texte
a) Le cas de l’Egypte
42 A propos de l’Egypte, tout d’abord, on peut s’étonner que le texte fondamental précise
que les principes de la Charia Islamique sont la source principale de la législation. Quid
alors de la mise en place de droits fondamentaux en direction des femmes par
exemple ? Par ailleurs, en ce qui concerne la protection de la liberté religieuse, il est
reconnu la construction de lieu de cultes uniquement pour les relions « révélées ». Quid
des autres religions ou mouvements philosophiques ? De même, l’article 72 indique que
l’Etat doit garantir la neutralité des médias dont il est propriétaire. Mais quelle est
l’effectivité de telles dispositions ? On peut en douter lorsque l’on regarde le traitement
médiatique dont bénéficie le Président EL SISI. Ou encore, la constitution interdit la
constitution de partis politiques sur une base religieuse. Il s’agit là d’une atteinte aux
libertés politiques. La liberté syndicale se voit réduite puisque il est mentionné
qu’aucune profession ne peut créer plus d’un syndicat et ces derniers ne peuvent
exister dans les institutions étatiques. En outre, le droit de pétition est interdit puisque
l’article 85 dispose « Aucune requête ne peut être faite au nom d’un groupe ». S’il existe
des dispositions concernant le droit de l’environnement celles-ci ne font aucune
référence, par exemple, aux principes de précaution, de participation ou encore de
responsabilité environnementale. Concernant le procès pénal certains grands principes
sont reconnus comme la présomption d’innocence ou le double degré de juridiction.
Néanmoins on peut regretter l’absence de référence à la notion de droit à réparation ou
encore du droit de voir sa cause entendu dans un délai raisonnable comme le souligne
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre
1966). Egalement, est reconnue la liberté de croyance. Il aurait été toutefois opportun
de mentionner que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses à l’instar de
l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
43 Plus généralement, il est fait référence à la notion de liberté mais aucune définition
n’est proposée, pas même comme à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen, que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Surtout,
les droits et libertés reconnus par la loi fondamentale reste conditionnés par leur mise
en œuvre par le législateur et donc de l’existence d’une volonté politique. D’autre part,
la mise en œuvre de droits tels que le droit au logement, le droit à la santé ou le droit à
l’éducation sont des droits qui ont un coût financier important. Or, quid de la capacité
financière de l’Egypte qui apparait comme un pays pauvre dont le PIB est de seulement
225,9 milliards de dollars (2011) ?
44 Enfin, concernant la protection des droits fondamentaux le texte constitutionnel met
en place un contrôle a priori de la loi. Néanmoins il aurait été, là également, opportun
d’aller plus loin en mettant en place la possibilité pour le justiciable de saisir la Cour
constitutionnelle au cours d’un procès, c’est-à-dire la reconnaissance d’un contrôle a
posteriori de la loi. Un tel contrôle existe, notamment, au sein de la Constitution du
Tchad, en date du 14 avril 1996, qui dispose, dans son article 166, que « Tout citoyen peut
soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui la
concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel qui doit
prendre une décision dans un délai de quarante-cinq jours ».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
27
b) Autres exemples
45 Dans plusieurs autres Etats, les textes constitutionnels font apparaitre des limites aux
droits et libertés. Prenons quelques exemples.
46 En Jordanie, l’article 6 interdit les discriminations entre jordaniens mais ne fait pas
référence aux discriminations entre hommes et femmes. En outre, la liberté de religion
garantie par l’article 14 trouve sa portée limitée puisque l’Etat ne protégera pas une
religion si celle-ci est contraire à l’ordre public ou encore aux bonnes mœurs.
Qu’entend-on alors par ordre public et bonnes mœurs ?! Il s’agit là de deux expressions
qui laissent une certaine marge de manœuvre aux pouvoirs publics. On remarque
également qu’il n’est pas fait référence à la question des droits de l’homme ou à un
texte international sur ce sujet. Par ailleurs, le droit à la protection sociale, à la retraite
ou encore à la santé fait défaut alors que ces droits sont reconnus par les différentes
conventions élaborer dans le cadre de l’O.I.T. Aucune disposition ne concerne la
procédure judiciaire : présomption d’innocence, droit à un avocat ; droit d’accéder à un
tribunal indépendant ; droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; droit de faire appel ;
droit à réparation en cas d’erreur judiciaire. Pourtant la Jordanie a ratifié le 28 mai
1975 le pacte du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques qui reconnait
dans son article 14 un certain nombre de droits à la défense au cours du procès pénal.
47 En Mauritanie, les droits sociaux sont exclus de la Constitution. Or, dans la grande
majorité des constitutions on retrouve le droit à la sécurité sociale, le droit au
logement, le droit à la retraite, la protection de la santé. Aucune disposition ne
concerne le droit d’asile. Le principe de la démocratie ne figure pas au sein du
préambule. Il n’est pas fait référence à la liberté de religion. Il n’est fait mention à la
notion de droits de l’homme ou encore à une convention internationale à ce sujet que
dans le préambule et non au sein des articles mêmes de la Constitution.
48 En Syrie, s’il est fait référence à la notion de droits de l’homme, aucun lien n’est fait
avec le droit international des droits de l’homme. En outre, alors que, dans une
démocratie, l’opposition joue un rôle fondamental – en ce sens que la Constitution
marocaine consacre à l’opposition un statut particulier et protecteur -, rien de tout cela
n’est prévu par la Constitution Syrienne. Enfin, le droit à la sécurité sociale est reconnu
vis-à-vis des travailleurs, mais quid des autres catégories de la population ?
49 Au Maroc pour finir, la Constitution vient limiter l’action des partis politiques et plus
précisément la liberté d’expression. Ces derniers ont interdiction de porter atteinte à la
religion musulmane ou encore à la forme monarchique du régime politique (article 7 de
la Constitution). On observe également que la religion musulmane bénéficie d’une place
particulière au sein de la Constitution puisque on peut lire, au sein du préambule que «
La prééminence » est accordée à la religion musulmane. Quid alors de la place et de la
protection accordée aux autres religions ?!
2. La persistance de pratiques contraires aux droits et libertés
50 Les limites juridiques à la protection des droits fondamentaux au sein des constitutions
postrévolutionnaires ne sont pas les seules. La pratique du pouvoir, comme la
législation en vigueur, peuvent aussi venir contredire les principes reconnus par les
textes fondamentaux. Nous prendrons les exemples du Maroc et de la Syrie
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
28
a) Le Maroc
51 On a pu constater, en 2012, qu’un tribunal marocain de la ville de Taza a condamné
Abdelsamad Haydour, un étudiant de 24 ans, à 3 ans de prison et 1200 USD (environ 900
euros) d'amende pour avoir critiqué le roi du Maroc dans une vidéo publiée sur
YouTube. M. Haydour a alors été accusé « d'avoir attenté aux valeurs sacrées de la nation ».
Or, celui-ci n'a bénéficié d'aucune assistance juridique lors de l’audition et le tribunal
n’a pas désigné d'avocat pour le défendre comme le requiert pourtant la législation du
pays. Pourtant l’article 25 de la constitution reconnait la liberté de pensée, d’opinion, et
d’expression sous toutes ses formes.
52 La liberté d’association dans la pratique reste également un droit à conquérir comme
en témoignent les évènements d’aout 2011. Le samedi 20 août 2011, une centaine de
juges s’était déplacé de différentes régions du Maroc pour participer à l’Assemblée
générale constitutive du « Club des juges du Maroc », à l’Ecole nationale de l’industrie
minérale (ENIM) de Rabat. Cette organisation « veut œuvrer pour garantir les libertés des
citoyens à travers l’indépendance de la justice ». Cependant, l’adjoint du directeur de
l’ENIM, interdit aux magistrats l’accès à l’école. Celui-ci avait reçu des instructions
orales du ministère de l’Intérieur interdisant l’accès aux locaux qui pourtant ont été
loués. Les magistrats se sont alors réunis dans la rue. Cette décision est contraire à
l’article 111 de la Constitution marocaine qui garantit le droit pour les magistrats
d’adhérer et de créer une association professionnelle.
53 A côté de la liberté d’association, la liberté de manifestation est aussi quelques fois
bafouée. C’est ainsi qu’au mois d’aout 2013 les forces de l’ordre ont réprimé des
manifestations Alors même que l’article 29 de la constitution dispose que « Chacun a le
droit d'organiser des réunions et des manifestations pacifiques et non armées sans autorisation
préalable mais avec déclaration préalable pour les manifestations dans un lieu public ».
b) La Syrie
54 Des pratiques très problématiques peuvent également être observées en Syrie. Dans un
rapport de septembre 2012 une commission internationale d’enquête fait état de
meurtres, d'exécutions sommaires, d'actes de torture, d'arrestations arbitraires, de
violences sexuelles, de violations des droits de l'enfant de la part des forces
gouvernementales. Se pratique également en Syrie de la part du gouvernement à des
arrestations arbitraires. Par exemple Amnesty international a pu préciser que le
militant politique Ali Sayed al Shihabi, réfugié palestinien vivant en Syrie, a été arrêté
par les autorités syriennes le 19 ou le 20 décembre 2012 et soumis à une disparition
forcée. Il faut noter que la Syrie est depuis 1963 sous le régime de l’état d’urgence
permettant de réduire les libertés publiques.
55 Par ailleurs, l’égalité des sexes est reconnue par la Constitution syrienne. Pourtant les
lois relatives au statut personnel et le code pénal contiennent des dispositions
discriminatoires à l'égard des femmes et des filles, notamment en matière de mariage,
de divorce, de garde des enfants et d'héritage. En outre, on note que si le code pénal
n'exonère plus totalement les auteurs de prétendus crimes d'honneur, il laisse encore
aux juges une certaine latitude pour infliger des peines réduites si un crime a été
commis avec une intention « honorable ». Enfin, la loi sur la nationalité de 1969 interdit
aux femmes syriennes ayant épousé un étranger la possibilité de transmettre leur
nationalité à leurs enfants ou à leur conjoint.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
29
B. La prédominance des chefs de l’Etat
56 Lorsque l’on observe les constitutions arabes postrévolutionnaires, la prédominance du
pouvoir exécutif et, plus particulièrement, du chef de l’Etat semble perdurer. Cette
tendance pourrait trouver un fondement dans la survivance d’un schéma
constitutionnel antérieur où la loi fondamentale consacrait de véritables régimes
autoritaires. Prenons l’exemple de la Syrie, du Maroc, de l’Egypte, de la Jordanie et de la
Mauritanie.
1. La Syrie
57 Il ressort de la lecture de la Constitution syrienne que le président de la République
conserve de larges prérogatives. Il lui revient ainsi de nommer le premier ministre, les
ministres et leurs adjoints et de les décharger éventuellement de leurs fonctions. C’est à
lui qu’il appartient de déterminer la politique de l’Etat en accord avec le conseil des
ministres qu’il lui revient de présider. Il peut demander des rapports tant au Premier
ministre qu’aux divers ministres.
58 Il possède un rôle au niveau international puisqu’il accrédite les chefs des missions
diplomatiques auprès des gouvernements étrangers et il reçoit les accréditations des
chefs de missions étrangères en Syrie. Il ratifie les traités et accord internationaux. Au
niveau militaire, il est le chef suprême de l'Armée et de toutes les forces armées. Il
prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice de cette autorité.
59 Son influence est réelle sur l’Assemblée nationale dans la mesure où il peut s'adresser à
celle-ci par des messages écrits et, en personne, faire des déclarations devant elle. Il a la
possibilité également de dissoudre une telle assemblée. Il peut préparer des projets de
loi et les transmettre au pouvoir législatif pour délibération. L’article 113 lui permet
même d’exercer le pouvoir législatif, le cas échéant, en dehors des sessions de
l'Assemblée populaire, en cas de dissolution de l'Assemblée du peuple.
60 On constate, à côté de ses prérogatives à l’égard du pouvoir législatif, que le président
de la République possède des pouvoirs exceptionnels dans certains cas. Par exemple, si
un grand danger menace l'unité nationale, la sécurité ou l'indépendance de la patrie ou
empêche les institutions de l'État de remplir leurs obligations constitutionnelles, il peut
prendre les mesures d'urgence exigées par les circonstances, en vue de faire disparaitre
ce danger. Il a la possibilité de s’affranchir de la représentation nationale en faisant
appel directement au peuple à travers le referendum sur les questions importantes
relatives aux intérêts supérieurs du pays.
61 Il nomme par décret les membres de la Haute Cour constitutionnelle ce qui conduit à
s’interroger sur l’indépendance et l’impartialité de cet organe. Enfin, il dispose de
l’initiative de la révision, pouvoir partagé avec l’Assemblée du Peuple.
2. Le Maroc
62 Au Maroc, le Roi conserve de larges prérogatives malgré la réforme du 1 er juillet 2011. Il
a, par exemple, la possibilité de mettre fin aux fonctions d’un ou plusieurs membres du
gouvernement. Il peut également dissoudre les deux chambres du parlement. Il peut
s’adresser des messages à la nation ainsi qu’au parlement. Il est le chef suprême des
forces armées et nomme à ce titre aux emplois militaires. Il dispose d’un pouvoir
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
30
exceptionnel consacré par l’article 59 : lorsque, par exemple, l’intégrité du territoire est
menacée (mais également lorsque des évènements entravent le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics), il peut proclamer l’état d’exception. Il est alors habilité à
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour défendre l’intégrité territoriale ou
permettre que les institutions de la République puissent fonctionner normalement.
63 Cette prépondérance de l’autorité royale peut être regrettable : la réforme de 2011
aurait dû consacrer l’autonomie du gouvernement en précisant que ce dernier serait
dans l’avenir nommé par un vote de la chambre des représentants.
3. L’Egypte
64 En Egypte, quelques remarques allant dans le même sens peuvent être également
formulées. Le Président de la République reste omniprésent au sein de la Constitution
de 2014. Plusieurs dispositions tendent à appuyer une telle idée. Il lui revient ainsi de
convoquer les deux chambres en session annuelle comme de clore cette session. Le
Président de la République possède une pleine place dans la procédure législative
puisqu’il a la possibilité de proposer des lois. En outre, il a le droit d’opposer son veto à
la promulgation d’une loi et demander, à ce titre, à la Chambre des députés d’en
débattre une nouvelle fois. Il possède un pouvoir de nomination étendu. C’est ainsi que
si la constitution lui fait obligation de nommer le Premier ministre au sein de la
majorité arrivée en tête des élections de la chambre c’est à condition que le
gouvernement qu’il a nommé de manière discrétionnaire auparavant n’a pas obtenu la
confiance de la Chambre. Il peut nommer également un certain nombre de personnes à
la chambre des représentants sans que leur nombre soit supérieur à 5%.
65 Le texte fondamental donne également un rôle important au chef de l’Etat dans la
détermination de la politique nationale puisqu’il lui revient d’élaborer la politique
générale avec la « collaboration» du Gouvernement. Il a la possibilité de convoquer le
Gouvernement à chaque fois qu’il le juge utile. En effet, l’article 148 dispose que « Le
président de la République peut convoquer le Gouvernement pour débattre de questions
importantes, et préside les réunions auxquelles il participe».
66 Un article semble permettre au chef de l’Etat d’écarter le gouvernent pour exercer lui-
même certains pouvoirs. En effet, l’article 147 dispose que « Le Président de la
République peut dispenser le gouvernement de mener à bien ses tâches s’il obtient
l’approbation de la majorité de la chambre des représentants ».
67 Le chef de l’Etat apparait en outre comme le chef des armées (cela est d’autant vrai
actuellement que le Président EL SISI est un ancien militaire qui a déposé l’ancien
président MORSI). A ce titre, c’est à lui qu’il revient de déclarer la guerre comme l’état
d’urgence sous certaines réserves. Le chef de l’Etat peut aussi consulter directement le
peuple par voie de referendum sur toute question concernant les intérêts supérieurs de
l’Etat.
68 Le président semble par ailleurs pouvoir exercer une influence sur le pouvoir judiciaire
ce qui interroge sur la question de la séparation des pouvoirs et sur l’indépendance du
pouvoir judiciaire. La Constitution précise en effet que le parquet est dirigé par un
procureur général nommé par décret du présidentiel sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature. L’indépendance de la justice porte à discussion si l’on a à
l’esprit le véritable jugement de groupe organisé à l’encontre des frères musulmans lors
de l’arrivée au pouvoir du général EL SISI.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
31
69 On peut aussi s’interroger sur la place prépondérante de l’armée au sein des
institutions puisque le ministre de la défense doit être directement choisi au sein des
officiers de l’armée.
70 Enfin, on constate que les rédacteurs du nouveau texte constitutionnel ont voulu
bloquer toute possibilité de révision concernant certains sujets. Il en est ainsi des
modalités de réélection du chef de l’Etat qui ne peuvent faire l’objet d’une révision.
4. La Jordanie
71 En Jordanie, le Roi est également à même de concentrer de nombreux pouvoirs. Il
incarne et exerce le pouvoir exécutif, précise la Constitution. Cette idée marque
l’effacement du Gouvernement. C’est lui qui promulgue, notamment, les règlements
nécessaires à l’application de la loi. Il possède un rôle militaire puisqu’il est le
commandant suprême des forces de terre, de mer et de l'air. Il déclare la guerre,
conclut la paix et ratifie les traités et les accords. Il a une emprise sur le Premier
ministre qu’il peut révoquer à tout moment d’autant que ce dernier comme les
ministres doivent prêter serment de fidélité auprès de lui.
72 En outre, l’article 48 dispose que si le Premier ministre et les ministres signent les
décisions prises en Conseil des ministres, celles-ci doivent être soumises au Roi pour
ratification. Son influence sur le pouvoir législatif est également une réalité puisqu’il
nomme les membres du Sénat ainsi que le président de celui-ci. Les sénateurs et
députés doivent, comme les ministres, faire le serment d’être fidèles au Roi ce qui
remet en question le principe de séparation des pouvoirs.
5. La Mauritanie
73 En Mauritanie enfin, la prépondérance de l’exécutif et plus précisément du Chef de
l’Etat est également flagrante lorsque l’on lit le texte constitutionnel. Le Président de la
République exerce le pouvoir exécutif et préside le Conseil des ministres, et est
finalement le véritable chef de l’exécutif. La Constitution précise en ce sens que le
Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'État
conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République.
En outre, si le gouvernement peut prendre des décisions par ordonnance dans les
matières qui sont normalement du domaine de la loi, c’est après accord du Président de
la République.
74 S’agissant de la politique étrangère, il revient au Président d’en déterminer le contenu
et c’est lui qui signe et ratifie les traités. Il peut mettre fin, quand bon lui semble, aux
fonctions du Premier ministre qu’il lui revient également de nommer. La Constitution
dispose explicitement que le Premier ministre et les ministres sont responsables devant
le Président de la République.
75 Le Président possède également un pouvoir d’influence sur le parlement dans la mesure
où il a la possibilité de communiquer avec celui-ci par des messages. Il peut en outre en
prononcer la dissolution. Il peut aussi saisir le peuple par referendum.
76 Au niveau militaire, le Président est compétent pour nommer aux emplois dans ce
domaine. Il est le chef suprême des forces armées et préside à ce titre les conseils et
comités supérieurs de la défense nationale. A l’instar d’autres constitutions issues des
mouvements révolutionnaires dans la zone géographique, il possède des pouvoirs
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
32
exceptionnels dans certaines situations. Lorsqu’un péril imminent menace les
institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité
de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est
entravé, le Président de la République adopte les « mesures exigées par ces
circonstances » après consultation officielle du premier ministre, des présidents des
assemblées et du Conseil constitutionnel. Enfin, il possède l’initiative de la révision
constitutionnelle.
Conclusion
77 Les constitutions postrévolutionnaires, dans le monde arabe, tendent indéniablement
vers la modernisation. Elles traduisent la volonté de renforcer les droits fondamentaux
tout en allant vers un meilleur équilibre des pouvoirs. Néanmoins, il semble que ce
nouvel élan ne soit pas abouti. Des limites persistent nécessitant de futures réformes et,
la pratique du pouvoir contribue aussi à définir les caractéristiques de ces nouveaux
régimes politiques. La question du renouveau constitutionnel dans le monde arabe
reste ainsi ouverte et risque bien de continuer à faire l’objet d’une actualité régulière.
NOTES
1. Il en est de même pour les organisations syndicales.
2. Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, chap. VI.
3. D’autres Etats sont concernés par cette tendance.
En Mauritanie, avec la réforme du 20 mars 2012, on assiste à un renforcement de la
responsabilité gouvernementale devant le pouvoir législatif. En effet, des dispositions
précisaient déjà que le premier ministre est, solidairement avec les ministres,
responsable devant l'Assemblée nationale ; la mise en jeu de la responsabilité politique
résulte de la question de confiance ou de la motion de censure. La réforme
constitutionnelle vient rajouter qu’au plus tard un mois après la nomination du
Gouvernement, le Premier ministre présente son programme devant l’Assemblée
nationale et engage la responsabilité du Gouvernement sur ce programme. Le statut du
parlement est aussi renforcé. Les sessions parlementaires peuvent aller aujourd’hui
jusqu’à 4 mois, contre 2 mois antérieurement. En outre, l’Assemblée nationale possède
un délai de 45 jours afin de se prononcer en première lecture sur le projet de loi de
finances contre 30 jours auparavant. De plus la mission du parlement sur le budget de
l’Etat est précisée dans la mesure où il est mentionné que celui-ci contrôle l'exécution
du budget de l'Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses doit lui être fourni à la
fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice
sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une
loi.
L’exemple jordanien est révélateur également de cette recherche d’équilibre. C’est ainsi
que la réforme constitutionnelle jordanienne de 2011 réduit les prérogatives du
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
33
gouvernement au bénéfice du Parlement dans le sens d’un plus grand équilibre des
pouvoirs. Par exemple, la capacité de décréter des lois provisoires pendant les vacances
parlementaires a été réduite. La possibilité pour le gouvernement de dissoudre le
Parlement sans démissionner a également été limitée.
ABSTRACTS
Since 2011, the Arab world is confronted to a social and legal - especially constitutional-
mutation. In Morocco, Jordan, Egypt or Tunisia, deep constitutional reforms are emerging. These
changes are reaction against previous regimes characterized by their authorities, concentration
of powers and violation of human rights. Several questions will be then explored: what are the
positive contributions of these constitutional movements? Can they be analyzed as revival of
human rights? Do they exit in building a balance of powers? What about the scope of the new
constitutional reforms?
Le monde arabe, depuis 2011, vit une mutation tant sociale que juridique et, plus précisément,
constitutionnelle. En effet, que ce soit au Maroc, en Jordanie, en Egypte ou encore en Tunisie, des
réformes constitutionnelles de grandes ampleurs ont pu voir le jour. Ces mutations profondes se
veulent une réponse aux régimes qui prévalaient par le passé : des régimes autoritaires, à forte
concentration du pouvoir, une séparation des pouvoirs relative et de nombreuses atteintes aux
droits de l’homme. Il convient alors de se poser plusieurs questions : quels ont été les apports de
ces mouvements constitutionnels ? Peut-on parler de renouveau des droits de l’homme ? Assiste-
t-on à une tentative de mise en place des conditions d’un équilibre des pouvoirs ? Quid de la
portée de ces nouvelles réformes constitutionnelles ? On envisagera les réponses apportées les
principales nouvelles constitutions.
INDEX
Mots-clés: Constitution – Droits de l’homme – Séparation des pouvoirs – Mutations
constitutionnelles – Démocratie
Keywords: Constitution – Human rights – Separation of power – Constitutional transition -
Democracy
AUTHOR
MALIK BOUMÉDIENE
Malik Boumediene est Maître de conférences, Habilité à Diriger les Recherches à l’université de
Toulouse Jean Jaurès. Il est membre du Centre de Recherche et d’Etude sur les droits
fondamentaux (Université Paris 10). Il travaille sur la question de la démocratie, des droits de
l’homme, des transitions constitutionnelles.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
34
Pouvoir politique, droits
fondamentaux et droit à la révolte :
la doctrine religieuse face aux
processus révolutionnaires dans le
monde arabe
Fouad Nohra
1 Le processus révolutionnaire déclenché en décembre 2010 est souvent perçu
indépendamment de la dimension religieuse, au motif que les organisations se
réclamant de l’Islam politique n’y auraient participé que marginalement. Ce raccourci
occulte la forte présence du religieux dans la société politique arabe que l’on peut
identifier selon quatre types distincts
2 Certes, un premier type de présence minimal permet d’écarter cette influence. Il s’agit
de celui que l’on retrouve dans les mouvements adeptes d’une sécularisation radicale
qui relèguerait le religieux à la sphère privée. Mais ces mouvements demeurent peu
nombreux et faiblement enracinés dans les sociétés politiques arabes, et l’on ne peut
même pas y ajouter les libéraux qui reconnaissent la place du religieux au sein de
l’organisation sociale.
3 D’où le type suivant où le religieux est présent dans l’organisation de la vie sociale,
mais se tient à l’écart du jeu politique. A ce titre, la question demeure de savoir si les
dispositions constitutionnelles (en Algérie depuis 1996, en Egypte depuis 2007 etc.)
interdisant la constitution de partis politiques sur une base religieuse relève de
l’intention de laisser le religieux au niveau infra-politique ou au contraire de faire du
religieux un lieu de consensus inter-partisan plutôt qu’un lieu de confrontation
politique.
4 Selon un troisième type, le religieux est l’une des sources de légitimation de la pratique
politique, car elle légitime ce recours à toutes les autres sources compatibles. C’est à ce
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
35
titre que la référence aux idéologies nationalistes, socialistes ou libérales est rendue
possible par une relation non-exclusive entre religion et politique.
5 C’est au niveau du quatrième et dernier type que l’on peut considérer la doctrine
religieuse comme la principale source de légitimation qui croit subordonner les autres
références.
6 En un mot, l’influence de la pensée religieuse n’est pas simplement le fait des
mouvements politiques relevant de ce quatrième type. Elle est également l’œuvre des
organisations qui, nombreuses, ont recours, même en partie, à la légitimation
religieuse. Mais elle est la conséquence d’une forte présence des institutions religieuses
au sein des sociétés arabes.
7 La question générale qui se pose est celle de savoir en quoi a consisté cette influence
sur le « printemps arabe » ? A-t-elle été un accélérateur du processus révolutionnaire
ou un frein à celle-ci ? Le présupposé de nombre de sociologues ou politologues qui se
sont intéressés au monde musulman était celui selon lequel Islam et révolution
démocratique sont incompatible au motif que l’on était en face d’une religion à la fois
holiste privilégiant la collectivité au détriment de l’individu 1, conformiste prônant
l’obéissance inconditionnelle aux détenteurs du pouvoir2 et générant une culture située
à l’antipode de la culture démocratique3.
8 A ce titre, l’on est face à une diversité des interprétations religieuses et à une
multiplicité des niveaux d’interférence dans le champ politique. La doctrine religieuse
est à la fois le reflet des sources originales, notamment du texte coranique, et des
différentes méthodes d’interprétation. Ces différences ne sont pas uniquement celles
répertoriées entre les quatre grandes écoles historiques4. Elles s’étendent au-delà, et
mobilisent des écoles de pensées plus récentes.
9 A ce titre, le pouvoir politique a la capacité de recourir à la légitimation religieuse tout
en l’instrumentalisant et en la dénaturant. Il suffit de mentionner la critique que fait
Hasan Hanafi de l’ « application de la Shari’a » par nombre de gouvernements, en
affirmant que l’erreur consiste à croire qu’il s’agit essentiellement d’un catalogue
d’interdits et de sanctions, tandis que le principe premier de ladite Shari’a qui est loin
d’être réduite à un système de lois consiste avant tout à établir la justice (distributive)
et à restituer aux opprimés leurs droits fondamentaux5. Cette remarque permet
d’annoncer l’étendue de l’instrumentalisation du religieux par le politique. Dans quelle
mesure est-il possible de reconnaître l’impact de la pensée religieuse au-delà de son
instrumentalisation politique ? Comment savoir dans quelle mesure cette pensée a
influencé l’orientation en faveur du processus de démocratisation dans les sociétés
arabes ?
10 Le champ de cette question est bien entendu assez vaste, aussi vaste que le domaine des
droits fondamentaux de l’individu. A titre d’exemple, l’encyclopédie des droits de
l’homme en Islam de Khadîja al-Nabrâwi comprend plus de 17 chapitres distincts,
chacun englobant plus d’une dizaine de droits fondamentaux de la personne humaine 6.
C’est pourquoi, nous nous contentons d’aborder trois thèmes tels que développés par la
doctrine religieuse : la nature du pouvoir politique, les limites du pouvoir politique face
au droit et le droit de contester le pouvoir politique, sans entrer dans un débat plus
vaste et en évitant d’entrer dans les détails de l’interférence de ce discours sur la scène
politique.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
36
I. Le système délibératif face aux exigences de la
démocratie représentative
11 L'interprétation dominante du texte coranique fonde le pouvoir islamique sur la notion
de Shûra qui signifie littéralement consultation, et dans un sens plus précis ( Shûra
baynahum) concertation. Deux versets du Coran servent de référence, dont
essentiellement le verset 38 de la sourate 42. Ce dernier exhorte les croyants à la
concertation pour ce qui concerne les affaires de leur société. Le verset 59 de la sourate
3 vient renforcer l'appel à la concertation/délibération entre les membres de la
communauté sur leurs propres affaires (politiques, économiques ou sociales), car elle
appelle le Prophète à la concertation.
12 La Shûra que l’on peut définir comme système délibératif est présentée par l’ensemble
des savants religieux7 comme étant l’antidote au despotisme (Istibdâd), donc au pouvoir
absolu du « gouvernant » (Hâkim) ou du « prince » (si l’on utilise le vocabulaire de
Machiavel). Mais est-elle l’équivalent de la démocratie représentative ?
13 Au moment de la renaissance arabe du 19ème siècle, des philosophes tels Abdul Rahmân
al-Kawâkibi et Khayr al-Dîn al-Tûnisi cherchent à établir l’équivalence entre le système
originel de l’Etat islamique et le système politique de démocratie représentative. A ce
titre, al-Kawâkibi affirme que « l’Islam est une doctrine démocratique et socialiste » 8,
tandis qu’al-Tûnisi est l’ingénieur des premières réformes démocratiques à Tunis, en
légitimant celle-ci par l’équation (système délibératif islamique = démocratie
représentative)9. Le système délibératif s’appuie sur le principe selon lequel les
détenteurs du pouvoir sont choisis et investis par les membres de la société.
14 Toutefois, les versets cités ne restreignent pas la Shûra à l’investiture des détenteurs du
pouvoir. La question est ouverte lorsqu’il s’agit, de manière générale, des affaires de la
communauté des croyants. En se référant à la pratique de l’Etat de Médine, puis des
premiers Califes, l’on peut en déduire que le recours à la délibération au sein de la
communauté est requis, lorsqu’il s’agit d’établir de nouvelles normes au sujet
desquelles les sources originales demeurent silencieuses.
15 Reste une autre question : qui a le droit de participer à la Shûra ? Les sources initiales
demeurent silencieuses, et la pratique des premiers califats s’appuie sur les sages et les
représentants des différentes familles constituant la société de l’époque, mais
également et surtout sur le cercle des compagnons à la fois caractérisés par leur savoir
et leur vertu. La doctrine aurait élaboré dans l’histoire la notion de Ahl al-Hall wa al-‘Aqd
(ceux qui sont investis du pouvoir d’engager et de désengager), au nom de l’ensemble
de la société. C’est la pensée philosophique de la Renaissance arabe qui en déduit que,
fondamentalement le pouvoir de délibérer était implicitement et devait explicitement
être attribué à l’ensemble de la société.
16 Ce pouvoir est-il accordé à la société ou à la communauté des croyants 10 ? La doctrine
et la pratique originelle de l’Etat de Médine permettent de définir une citoyenneté
distincte de l’appartenance à la communauté des croyants. Même si le terme n’est pas
utilisé, une appartenance commune à la cité de Médine est définie entre tous ceux qui y
participent. Elle est définie par le premier pacte liant les musulmans aux tribus juives
de la ville11.
17 C’est l’autonomisation des communautés monothéistes désignées comme Gens du Livre
(Ahl al-Kitâb) qui a produit historiquement le système des Communautés (Milla), dont
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
37
chacune était assujettie à ses propres règles et à ses propres dignitaires religieux qui a
produit la distinction entre la Oumma des croyants et les Milla des différentes
communautés. Cette autonomisation est issue de la pleine reconnaissance des religions
du Livre par le texte coranique (Sourate 5, verset 69), y compris du droit à la
récompense divine, mais elle est construite par la pratique des premiers Etats et portée
à son apogée par le système ottoman des Millet12.
18 Le concept de citoyenneté distinct de l’appartenance religieuse est restauré avec la
Renaissance arabe. Rifa’at al-Tahtawi entend substituer à la Communauté des croyants,
une société politique constituée de citoyens, indépendamment de leur appartenance de
type communautaire13. Ce principe de citoyenneté détachée de l’appartenance
religieuse et consacrant une égalité formelle entre musulmans et adeptes des autres
religions a été mis en œuvre, dans un premier temps, sous le règne de Mehemet Ali (qui
était toutefois loin du paradigme délibératif). Les Tanzimat ottomans des années
1850-1870 s’orientaient dans ce sens, et l’instauration d’une citoyenneté ottomane
unique s’est heurtée à l’hostilité des dignitaires religieux chrétiens soucieux de
conserver leurs privilèges, et dotés de l’argument selon lequel les adeptes de leurs
communautés souhaitaient éviter la conscription14.
19 Transposé à la période actuelle, le principe d’une citoyenneté indépendante de
l’appartenance religieuse comme génératrice du droit à la décision politique est non
seulement instauré par la plupart des Etats arabes modernes quelle que soit leur
référence à l’Islam, mais aussi reconnu par tout un spectre des partis à référence
islamique, dont les Frères musulmans, et à l’exception des mouvements extrémistes.
20 Pourtant, cette similitude voulue entre système délibératif et démocratie
représentative est soumise à la critique des courants qui cherchent à prôner un modèle
d’organisation politique distinct de la société « occidentale » 15. Les arguments mobilisés
se résument ainsi :
- Le principe consensuel sur lequel se fonde le contrat politique de la plupart des
systèmes représentatifs pluralistes est le principe de la souveraineté nationale qui
détermine les limites du pluralisme et de la liberté politique. Dans le système fondé sur
la Shûra, le principe consensuel est celui de la souveraineté divine. Cette souveraineté
divine n'exclut pas celle de l'homme mais la rend relative et lui donne une autre forme.
Certains vont jusqu'à affirmer que le système de la choura évite la dérive nationaliste
que connaît la démocratie représentative et insiste sur l’universalité à l’encontre de la
nationalité16.
- La limite est plus restrictive sur un autre plan, dans la mesure où les formes
idéologiques sous-jacentes à la Shûra ne sont pas l'idée nationale située au-dessus de
l'éthique individuelle et sociale. Cette dernière devient une affaire politique, en ce sens
que l'appel à l'immoralité n'est pas toléré. C'est la question du rapport entre morale et
politique qui se pose à nouveau.
- Le principe de la Shûra est affecté l'exigence du consensus (al-ijma') et semble, à
première vue, contredire le principe majorité qui aurait pour conséquence la
frustration des minorités. Or, il n'est rien de plus dangereux que l'illusion d'un
consensus monolithique. C'est pourquoi deux nuances sont apportées à ce dernier
principe. Tout d'abord, le consensus se fait selon deux critères : la recherche des
fondements (notamment dans le Coran) et la recherche du juste milieu. Consensus et
conciliation retrouvent à ce niveau.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
38
21 Un débat a pris place au sujet de la place du pluralisme partisan, qui, actuellement, a
perdu sa raison d’être. A l’origine, certains mouvements la remettaient en cause, en
réplique aux mouvements d’inspiration socialiste prônaient le gouvernement par le
parti d’avant-garde. Il reste que l’interprétation dominante aujourd’hui est celle d’un
système qui reconnaît fondamentalement la pluralité des courants et forces politiques
au sein d'un système politique basé sur la Shûra17.
22 Ce débat au sujet de la similitude Shûra/démocratie demeure ouvert, et l’on peut aller
jusqu’à inverser le sens de la comparaison en faisant de la Shûra un principe de
participation continue à la décision à l’ensemble des niveaux, de la cellule familiale à
l’Etat en passant par l’entreprise, les institutions locales et les niveaux intermédiaires.
En ce sens, l’on peut aller jusqu’à faire du principe délibératif le fondement d’un
mécanisme démocratique allant bien au-delà du principe de démocratie représentative
et impliquant ce que certains désignent par « démocratie participative » 18.
23 C’est, comme nous le verrons, le concept même de Shûra qui laisse le débat ouvert à
l’évolution du contexte historique et des débats politiques. L’équivalence avec la
démocratie représentative est établie au moment où la Renaissance arabe emprunte
beaucoup à la modernité et, récemment, au moment où l’essentiel des acteurs
politiques re-découvrent le caractère fondamental, matriciel du jeu démocratique, au
moins deux décennies avant les révolutions de 2011. Elle est rejetée quelques décennie
plus tôt à une ère où, au cours des années 60-70, c’est le discours philosophique post-
moderne qui domine en Europe, et où l’alternative est recherchée du côté du
dépassement de la démocratie représentative, soit au nom d’un rapprochement Islam-
socialisme, soit au nom d’un différentialisme plus radical, soit les deux à la fois 19.
II. Les droits fondamentaux face au pouvoir politique
24 Une fois le pouvoir investi en vertu du principe délibératif quelles en sont les limites ?
Le concept d’Etat de droit a-t-il un équivalent dans la doctrine islamique ? La doctrine
instaure une « sacralisation » du droit et un assujettissement, voire une limitation, du
pouvoir par ce droit. Nombreux sont les versets coraniques et les sources issues de la
tradition prophétique qui font référence à cette hiérarchie droit/ pouvoir politique.
Nous nous contentons à ce sujet du discours d’investiture du premier Calife Abu Bakr
al-Siddîq :
25 « J'ai été désigné pour vous guider, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous ; aidez-
moi dans mes bienfaits et corrigez mes méfaits : la sincérité est un gage et le mensonge
une trahison. Les petits (faibles) parmi vous seront grands (forts) à mes yeux jusqu’à ce
que leurs droits leur soient acquis, et les grands parmi vous seront petits jusqu'à qu'ils
s'acquittent de leurs obligations… Obéissez-moi tant que j'obéis à Dieu et au Prophète;
si je me rebelle contre Dieu et son Prophète, vous ne me devrez aucune obéissance… » 20
26 Sans entrer dans une analyse détaillée des sources, trois interprétations globales sont
développées en ce qui concerne le statut des droits humains fondamentaux dans le
texte coranique :
27 La première porte sur l’étendue et l’intangibilité de ces droits. A ce sujet, leur source
divine rend impossible leur révocation par le pouvoir politique. De même, elle explique
leur universalité et le fait qu’ils ne peuvent être restreints à une catégorie d’humain à
l’exclusion des autres, notamment eu égard au principe d’égalité énoncé dans le texte
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
39
coranique et dans les Hadith21. Enfin, ces droits s’étendent à l’ensemble des champs de
la pratique sociale et comprennent les droits dits « économiques et sociaux » 22.
28 La deuxième porte sur le principe de leur incessibilité. Si aucun pouvoir ne peut ôter ou
révoquer les droits fondamentaux de la personne humaine, cette dernière ne peut à son
tour céder ces droits ou s’en désister, car elle a obligation de préserver les attributs de
sa dignité humaine ainsi que l’équilibre de la société 23.
29 Le troisième principe est celui issu de l’interprétation du verset 87, sourate 5 en vertu
duquel l’on n’a pas le droit de rendre illicite ce que Dieu autorise. Ce principe qui
définit un large champ de ce qui est autorisé soit explicitement, soit implicitement par
le silence du texte et l’absence de rapport de similitude avec ce qui est explicitement
interdit, définit de ce fait le champ de l’action libre de l’individu que le pouvoir
politique ne peut de son propre chef limiter sans se référer à son tour à d’autres droits
fondamentaux24.
30 Ces propositions soulèvent dès lors la question de savoir quelle est l’étendue des
libertés et droits fondamentaux que l’Etat a l’obligation de protéger. La liste est longue
et le débat déborderait le champ de la présente contribution. La doctrine entre dans les
détails de chacun des droits afin d’établir l’étendue et les contours des principes de
liberté de croyance et d’expression, d’égalité, de la présomption d’innocence etc…
31 Chaque domaine d’application permet d’ouvrir un débat spécifique. La question de la
liberté de croyance et d’expression permet de confronter les versets coraniques
fondateurs, notamment le principe « pas de contrainte en matière de religion » (La
Ikrâha fi al-Dîn), afin de légitimer le principe fondamental du respect de la liberté
individuelle. Ce principe a été assorti des limites que l’histoire de l’interprétation
doctrinale a construites, mais qui sont constamment débattues et controversées.
32 Certaines limites sont liées à la pratique de délimitation des frontières entre les
communautés religieuses (les règles sur l’affiliation liées au droit de la famille, la
condamnation de l’apostasie etc..). Du point de vue de la doctrine religieuse, mais aussi
de la pratique, ces limites sont contestées ou remises en cause 25.
33 D’autres limites sont dues à la confusion, faite essentiellement par les pouvoirs
politiques les plus rigoristes entre le domaine de l’éthique et le domaine du droit. Cette
confusion consiste à transposer les obligations de la personne humaine vis-à-vis de
Dieu en obligations de nature juridique dont le pouvoir politique contrôlerait
l’application. Cette confusion proviendrait d’une interprétation extensive du principe
de l’exhortation à la vertu et de la proscription du vice (Amr bi al-Ma’rûf wa Nahi ‘an al-
Munkar). Ce principe, issu du verset 110 de la Sourate 3, définit l’exhortation à l’action
vertueuse comme un corollaire de la vertu. Mais, si l’on confronte ce principe avec
d’autres principes de même niveau, cette exhortation est graduelle et ne peut atteindre
le stade de la contrainte, lorsque l’action n’a pas d’effet sur la société et n’affecte pas les
droits des autres individus26.
34 L’approche des acteurs politiques rigoristes consiste à imposer la contrainte juridique
dans les domaines qui relèvent simplement de l’exhortation morale, au nom de ce
dernier principe, ce qui a pour conséquence de restreindre le champ de l’action libre.
35 Or plusieurs versets du Coran contredisent explicitement cette tendance rigoriste. Il
s’agit notamment des versets 20-21 de la Sourate 88 qui n’autorisent pas le Prophète à
contraindre les individus en matière de croyance et d’action vertueuse, mais
simplement à rappeler le message. A fortiori, le détenteur du pouvoir politique ne
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
40
détient pas non plus le droit de contraindre à l’action vertueuse, lorsque son absence
ne nuit pas à autrui. C’est en ce sens que l’élaboration doctrinale contemporaine tend à
déconstruire le schéma rigoriste qui fait le raccourci entre ce qui relève de l’obligation
morale et ce qui relève de la norme juridique contraignante.
36 Enfin, la doctrine religieuse aborde la question des limites du pouvoir politique d’un
point de vue normatif, mais certes pas du point de vue de ce que l’on appellerait
l’ingénierie institutionnelle. Or cette dernière approche répond à la question suivante :
qu’est ce qui garantit qu’effectivement le pouvoir politique respectera les droits
fondamentaux définis par les textes normatifs ?
37 C’est en posant cette question que l’on peut aller jusqu’à affirmer avec Ali Abdul Râziq
que le texte coranique n’a pas développé une doctrine du pouvoir politique et que les
deux versets sur la Shûra ne suffisent pas à cela. La conclusion est qu’il existe des
domaines de la pratique sociale confiés par Dieu à l’action et l’intelligence humaines
édificatrices (al-‘Umrân al-Bashari)27.
38 C’est ce qui permet à la raison humaine d’élaborer des modèles de gouvernement.
Certes, la raison doit reconnaître ses limites avec l’obligation de « croire en ce qui n’est
pas perceptible» (Imân bi al-Ghayb), mais c’est elle qui accompagne l’intelligence du
texte sacré, celle des principes fondamentaux, celle de la connaissance des sources
dérivées etc… De même, elle confirme par d’autres procédés les principes apportés par
la révélation. A ce titre, Abu Hâmid al-Ghazâli met en évidence la superposition entre la
lumière de la raison et la lumière de la foi, tandis que pour Ibn Rushd, la première est
capable de reconstruire les principes édictés par la dernière.
39 Or, c’est cette liberté laissée à l’action humaine édificatrice qui permet d’édifier les
contraires en matière de régimes politiques : elle a permis de produire le despotisme
tout autant que la démocratie représentative dotée du système de séparation et
d’équilibre des pouvoirs. C’est en ce sens qu’un nouveau type s’est développé au cours
de la seconde moitié du vingtième siècle : le système autoritaire doublé de la
démocratie de façade. Cette dernière peut être inspirée, soit des schémas empruntés
aux démocraties libérales, soit à ceux empruntés aux démocraties populaires, soit à une
combinaison savante entre ces deux modèles. Rares sont les modèles à légitimation
ouvertement autocratiques.
40 Ce phénomène amène à plusieurs interrogations qui sortent du cadre du présent
travail, dont celle sur la nature du régime dit « démocratique », celle sur l’existence des
échelles de démocratisation et celle sur la pratique de gouvernement.
41 La seule question que nous pouvons poser est la suivante : étant donné la capacité du
pouvoir politique à produire du despotisme, comment la doctrine religieuse définit-elle
le droit de contester ce dernier ?
III. La doctrine religieuse et le droit à la désobéissance
42 L’historiographie religieuse s’accorde sur l’existence d’un point de non-retour dans
l’histoire des modes de gouvernement au sein de la cité islamique et qui marquerait la
revanche de l’histoire, celle qui aurait consolidé les pouvoirs autocratiques/
héréditaires, sur la doctrine religieuse fondée sur le principe délibératif.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
41
43 L’on suppose que dès les débuts de l’ère omeyyade, nombre de savants religieux
auraient consolidé une doctrine conformiste de l’action politique, en mettant en avant
le principe d’obéissance au « gouvernant» (Hâkim).
44 Le verset coranique servant d’appui à cette allégeance est le verset 59 de la sourate 4
qui enjoint les croyants d’obéir à Dieu, au Prophète et à ceux qui seront investis pour
les guider (Awliyâ° al-Amr). C’est ce verset qui est constamment cité en référence, par
les pouvoirs établis, y compris dans l’histoire contemporaine, pour les régimes
politiques adossés à une légitimité religieuse.
45 Ce principe d’obéissance est appuyé par un Hadith considéré par certains comme étant
de certitude moyenne ou faible selon lequel le Prophète aurait d’abord annoncé
l’avènement futur de gouverneurs injustes, pour ensuite recommander aux croyants la
patience, même s’ils en venaient à être les victimes.
46 Il est également développé par la doctrine conformiste au motif que l’ordre injuste est
un moindre mal par rapport à la Fitna qui signifie à la fois la mise à l’épreuve par le mal
et la discorde. D’autres Hadith vont jusqu’à réprouver l’action de celui qui affronte la
communauté en s’opposant au pouvoir en place, soit qu’il agisse sous l’emprise de la
colère ou en vue de défendre les intérêts d’un groupe contre les autres.
47 Selon une interprétation prolongeant la première, il y aurait une limite lointaine
autorisant le droit à la désobéissance ou au retrait d’allégeance (Khurûj ‘ala al-Hâkim)
défini par un autre Hadith, il faut un reniement (Kufr) manifeste (de l’Islam), dépourvu
d’ambiguïté (Bawwâh) observé (chez le « prince ») directement par les membres de la
communauté (et non pas simplement rapporté).
48 Or, depuis la Renaissance arabe, une autre interprétation semble s’imposer dans les
moments de crise : celle capable de justifier la désobéissance au pouvoir injuste. Le
verset 97 de la Sourate 4 insiste sur l’obligation de résister à l’injustice. Il s’adresse,
dans la circonstance spatio-temporelle, à ceux qui, n’ayant pas choisi de partir pour
Médine ont accepté de subir l’injustice des polythéistes de le Mecque. Au-delà, il
considère comme coupable envers Dieu toute personne qui a accepté de subir l’injustice
du pouvoir envers et contre ses propres droits.
49 Ce verset qui fait obligation non seulement de respecter les droits d’autrui, mais de
défendre les siens propres mène au principe déjà évoqué de l’incessibilité et de la non-
négociabilité des droits humains.
50 Ce verset est la référence institutive du droit à la révolte contre le « prince » injuste.
Selon un Hadith, « viendront des dirigeants injustes qui approuveront ce qui est
réprouvé et réprouveront ce qui est louable. Que celui qui en est conscient n’obéisse
plus à qui désobéit ainsi à Dieu ». D’autres Hadith similaires viennent ainsi contredire le
premier cité par les savants hostiles au droit à la désobéissance (Khurûj).
51 Ces préceptes s’opposent-t-ils au verset de l’obéissance ? Une autre interprétation de ce
dernier verset permet de remettre en cause l’interprétation traditionnelle qui en a été
faite. L’obéissance à ceux qui ont été investi du pouvoir (Awliya al Amr) comprend trois
conditions28 :
- la première est la subordination des « Awliya al-Amr » à Dieu et à son Prophète, donc
leur respect des principes fondamentaux qui commandent au respect des gouvernés
- la seconde est la collégialité du pouvoir. La conjugaison du terme au pluriel
signifierait ainsi le rejet d’un pouvoir autocratique individuel et l’instauration du
pouvoir collégial, lui même issu du pouvoir de délibération de la collectivité
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
42
- à cela s’ajoute la condition générale : que l’investiture des « Awliya al-Amr » ait été
légitime et faite par la communauté/ ou la société.
52 L’essentiel des interprétations doctrinales favorables au droit à la désobéissance
privilégient les moyens pacifiques. Dans l’équation, deux maux doivent être évités,
l’injustice et la discorde ou (Fitna). C’est ce qui a mené Ahmad ‘Umar Hachim, d’al Azhar
à développer de manière plus précise la thèse du droit à la désobéissance civile (non-
violente) et de l’exclusion du droit à la réponse violente29.
53 Ce droit s’appuie sur une combinaison des sources coraniques appelant à la conciliation
et au rejet de la Fitna, d’une part, et ceux appelant à s’opposer à l’injustice, d’autre part.
A ce titre, c’est le droit aux manifestations de masse qui est débattu : tandis que les
traditionnalistes nient ce droit en arguant les risques de nuisance aux biens et aux
personnes, ainsi que les risques de discorde, d’autres, dont Muhammad Mukhtâr al-
Mahdi, invoquent ce droit, dans la mesure où il est exercé de manière pacifique. Ces
derniers se fondent sur une situation où le Prophète avait exhorté un individu victime
des nuisances de son voisin à se manifester sur la voie publique en y étalant ses effets,
afin de mieux faire connaître publiquement cette injustice qu’il subit et d’amener le
voisin coupable d’injustice à changer de comportement.
54 C’est cette évolution doctrinale qui explique et accompagne la prise de position d’al-
Azhar en janvier 2011, que l’on peut résumer en ces six points.
- Le pouvoir légitime est celui qui est investi et légitimé par le choix du peuple : la
démocratie moderne est l’équivalent contemporain des principes traditionnels de
gouvernement islamique : les mécanismes de contre-pouvoir sont inséparables du
pouvoir politique légitime ;
- Lorsque l’opposition pacifique et légitime s’exprime et obtient le soutien populaire,
elle ne peut être considérée comme source de discorde : c’est le pouvoir qui devient
illégitime s’il ne répond pas à l’appel du peuple ;
- Lorsque le pouvoir en place répond aux manifestations pacifiques de son peuple par la
violence et le sang, il rompt le contrat qui le lie au peuple et devient un pouvoir
agresseur et illégitime ;
- L’appel au maintien des manifestations pacifiques de l’opposition et de l’action non-
violente ;
- Al Azhar soutient sans ambiguïté l’opposition pacifique ;
Al Azhar appelle les dirigeants à entreprendre les réformes politiques nécessaires à la
transition vers un système démocratique.
55 Reste à savoir quelles sont les limites du droit à la désobéissance au pouvoir injuste. A
ce titre, le débat est demeuré ouvert, bien que guidé par le débat éthique fondateur.
Dans un ouvrage plus ancien, Muhammad ‘Ammara conclut en faveur du droit à la
révolte et de l’inéluctabilité des processus révolutionnaires dans la doctrine religieuse
elle-même, en vue d’accomplir la justice sociale et de défendre la liberté humaine tout
en reconnaissant que le courant hostile à ce droit, pour « étrange et étranger à la
doctrine originelle » a prédominé dans l’histoire et a lui-même généré le despotisme 30.
56 Là aussi, le droit à la révolte est lui-même conditionné par les principes éthiques qui
guident la conduite de l’action politique. A ce titre, le risque de l’action violente est la
transgression des interdits moraux de l’action, et notamment ceux concernant la
protection des biens et des personnes. C’est en ce sens qu’une doctrine islamique de la
désobéissance, voire de la révolte se doit d’être à l’antipode du précepte machiavélien
selon lequel la fin justifie les moyens, car la finalité de l’action politique n’est pas tant
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
43
la prise du pouvoir que la réalisation des principes éthiques, à travers l’action, puis la
prise de pouvoir.
57 C’est en ce sens que le concept de désobéissance civile, développé au sein des
mouvements politiques des dix dernières années au sein des oppositions politiques
arabes, est réapproprié par la doctrine islamique de l’action politique. Or il s’agit là
d’une évolution qui permet de résoudre les dilemmes de l’action politique au sein
même de la société politique. Si la doctrine a été moins ambiguë sur les questions liées
à la guerre contrainte et à la paix voulue, en revanche, les divergences se sont
maintenues en ce qui concerne l’attitude à adopter vis à vis du «prince » injuste.
58 Le principe de la désobéissance civile permet de sortir du dilemme entre révolution
violente et obéissance inconditionnelle. Certes, les doctrines philosophiques se sont
développées indépendamment de la doctrine religieuse, à l’occasion de la guerre de
sécession américaine, mais aussi à l’occasion des diverses luttes contre la colonisation
(Inde), la ségrégation raciale (Etats-Unis) etc. La désobéissance civile est même
considérée par certaines théories du jugement moral comme le stade ultime de sa
maturité, car elle implique la contestation des lois positives et du « contrat social »
consenti par les citoyens mêmes, au nom de principes universels. Ici, les principes
religieux occupent la place de ces principes universels. Encore faut-il que le travail de
la raison accompagne l’interprétation de ces principes31.
Pour conclure : que peut faire la doctrine religieuse
dans un processus dominé par la raison politique ?
59 S’il est vrai que le corpus doctrinal islamique, tel que révisé depuis la Renaissance
arabe, privilégie la proximité avec le modèle de démocratie représentative, et
davantage avec le modèle de démocratie participative, cela ne garantit pas encore
l’individu contre le pouvoir politique. Et pour cause, la doctrine religieuse reconnaît
comme une obligation, pour le détenteur du pouvoir, la protection d’une longue série
de droits fondamentaux dont le contenu recoupe les déclarations de droit
contemporaines sans coïncider avec ces dernières. Mais elle le fait sous le mode
d’injonctions normatives. La réponse à la question de savoir qu’est-ce qui garantit ces
droits face au pouvoir politique se trouve du côté de l’ingénierie institutionnelle. Or,
comme l’établit ‘Ali ‘Abdul Râziq, le texte coranique ne comprend pas de préceptes
dans ce domaine qui est laissé à l’intelligence humaine édificatrice. C’est donc à partir
des théories scientifiques et des pratiques politiques antérieures accumulées par
l’expérience mondiale de l’exercice du pouvoir politique que la solution doit être
trouvée. En revanche, le rôle clé de la doctrine religieuse, qui se situe sur le terrain du
normatif, consiste à légitimer le droit à la désobéissance au pouvoir injuste (al-Khrûj ‘ala
al-Hâkim al-Zâlim). Dans ce domaine, la restitution du droit à la désobéissance, contre
les doctrines conformistes qui ont prédominé au nom du devoir d’obéissance à ceux qui
sont investis d’autorité (Awliya° al-Amr), a permis de donner toute leur légitimité, aux
yeux des croyants, aux processus révolutionnaires. Toutefois, sur le terrain de l’action
politique, les deux doctrines se côtoient et s’opposent, à chaque circonstance, et la
capacité du pouvoir établi à mobiliser les ressources doctrinales explique la persistance
du premier courant.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
44
60 Il reste qu’en établissant le droit à la désobéissance, le problème n’est pas résolu : les
avis (Fatwa) des savants religieux continuent à concilier deux impératifs : l’opposition à
l’injustice, d’une part, et la prévention de la Fitna, ainsi que celle de l’atteinte aux droits
des personnes, d’autre part. La question de savoir si, dans le champ politique interne, la
révolution violente est légitime, a été débattue. La maturation politique qui a englobé
l’essentiel des acteurs oppositionnels, ainsi que de nombreux mouvements relevant du
quatrième type de référence religieuse (dont les Frères musulmans), a permis de faire
triompher le principe de la désobéissance civile. Ce principe peut-il subsister au-delà
d’un certain seuil de violence du champ politique ? Le glissement de la révolution
syrienne de la protestation pacifique, au recours aux armes défensives au-delà d’un
certain seuil de violence éradicatrice, puis au militaire offensif pour mieux défendre ce
qui est acquis pacifiquement, puis au militaire offensif pour obtenir des gains
politiques, permet de reposer la question32. Est-ce une légitimation du recours à la
violence armée ? En aucun, cas, mais un argument en faveur de la raison politique
élaboratrice de nouvelles techniques de gestion de crises et de nouvelles solutions, là
où la raison normative religieuse affiche à bon droit les limites de sont ingérence.
61 Enfin, l’interférence du discours religieux se doit de définir les limites de son
interférence dans le champ du politique qui sont celle des principes éthiques
structurant l’action. Le piège dans lequel sont tombés nombre de savants religieux, tant
dans l’Egypte post-révolutionnaire, que dans nombre de pays arabes en crise est celui
de leur instrumentalisation par le jeu politique, à travers la légitimation/
délégitimation des acteurs politique et le positionnement en faveur des acteurs
protagoniste, ce qui, en alimentant les campagnes de délégitimation religieuse de
l’adversaire, entraînent une confusion entre des batailles politiques circonstanciées et
les enjeux doctrinaux éthiques à portée universelle.
NOTES
1. Cf. Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remake of the World Order, New York,
Simon and Schuster, 1996.
2. Bernard Lewis, Islam and the West, Oxford, Oxford University Press, 1993.
3. John Waterbury : « Une démocratie sans démocrates ? », in Ghassan Salamé (dir.) : Démocraties
sans démocrates, Politiques d’ouverture dans les mondes arabe et musulman, Paris, Fayard, 1994.
4. Il s’agit des quatre écoles celles d’Abu Hanîfa, de Mâlik ibn Anâs, d’Abû ‘Abdullah al-Shâfi’i et
d’Ibn Hanbal A titre d’exemple, Abû Hanîfa privilégie le raisonnement ou syllogisme (Qiyâs) sur le
Hadith (Da’îf) dont le degré de certitude est faible, tandis que l’ordre est inversé pour Ibn Hanbal.
5. Hasan Hanafi : al-Dîn wa al-Thawra fi Misr (La religion et la révolution en Egypte), Librairie
d’Alexandrie, 1981.
6. Khadîja al-Nabrâwi : Huqûq al-Insân fi al-Islâm (Les droits de l’homme en islam), Le Caire, Dar al-
Salâm, 2006.
7. Dans la doctrine religieuse, l’autorité revient au plus savant, à celui dont la connaissance des
textes, des sources et de leur interprétation est la meilleure, d’où le terme de ‘Alim (savant) ou
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
45
Faqîh (docteur) lorsqu’il interprète la doctrine. Il n’existe pas de clergé doté d’une autorité
sacralisée. L’autorité demeure relative et dépend du degré de savoir.
8. Abd al-Rahmân al-Kawâkibi: Tabâ°i’ al-°istibdâd, (La nature du despotisme), édition Moufim,
1988, Alger
9. Khair al-Dîn al-Tûnisi : Aqwam Al-Masâlik Fi Ma’rifati Ahwâl Al-Mamâlik, (la plus juste des voies dans
la connaissance de l’état des royaumes) , Le Congrès Tunisien des Sciences, des Lettres et des Arts,
Tunis.
10. La distinction entre les deux concepts est développée par la sociologie moderne. Si l’on se
réfère à la distinction de Tönnies, la communauté est avant tout définie par des systèmes de
valeurs, de pratiques et de représentations communes, tandis que la société est le lieu de
rencontre des intérêts communs. Il est moins aisé de la transposer à la société islamique des
débuts. Cf. Ferdinand Tönnies, Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure,
Paris, Presses universitaires de France, 1977.
11. Le Pacte de Médine considère que les musulmans et alliés juifs font partie d’une même
société, qu’ils y ont les mêmes droits, que la protection doit être accordée aux victimes d’injustice
parmi l’ensemble de ceux qui sont liés par le Pacte, qu’ils doivent tous être défendus de la même
manière.
12. Georges Corm, Contribution à l’étude des sociétés multiconfessionnelles : Effets socio-juridiques et
politiques du pluralisme religieux, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1971.
13. Cf. Rifâ'at Al-Tahtâwi : Takhlîs al-Ibrîz fi Takhlîs Bâriz (L'or de Paris), ed www.arabook.com
14. Cf. Qays Jawâd al-‘Azzâwi : al-Dawla al-‘Uthmâniya : Qirâ°a Jadîda li ‘awâmil al-Inhitât (L’Etat
ottoman, une nouvelle lecture des facteurs du déclin), al-Dâr al-‘Arabiya li al-‘Ulûm, 2003.
15. Cf. Hassan al-Turâbi, Al-shura wa al-dimucratiyya wa akhbar al-khulafa (La Shûra, la démocratie
et le récit des pratiques de Califes), Al Dar al-Sa’ûdiyya, Riyad, 1987.
16. Ibid.
17. Cf. Fahmi Huwaydi : al-Qur°ân wa al-Sultân (Le Coran et le pouvoir politique), Le Caire, Dar al-
Shurûq, 1969.
18. Cf. Jurgen Habermas : Droit et démocratie, entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997.
19. Cf. Ali Shariati : L’Oumma et l’Imamat, Beyrouth, Al Bouraq, 2007.
20. Abi Cf. Hatim al-Tammîmi : Al-Sîra al-Nabawiyya wa Akhbar al-Khulafâ° (la vie et œuvre du
Prophète et le récit des califes), réédité par Aziz Beik, Dar El Fikr, Beyrouth, 1991.
21. Selon un Hadith classé comme authentique (Sahîh) « les humains sont égaux comme les dents
d’un peigne ».
22. Cf. Khadîja al-Nablâwi, op. cit.
23. Cf. Izzat Qarni : al-Islâm wa Huqûq al-Insân (L’Islam et les droits de l’homme), Le Caire, ‘Âlam
al-Ma’rifa, 1985 (Préface de Muhammad ‘Ammâra)
24. Cf. Jamâl al-Dîn ‘Atiyyah : Huqûq al-Insân fi al-Islâm, al-Nazariyya al-‘âmma (Les droits de l’homme
en Islam, la théorie générale), Le Caire, 1989.
25. Cf. Leila Babes, Tarek Oubrou : Loi d’Allah, loi des hommes, Paris, Albin Michel, 2002.
26. Selon une interprétation plus courante, l’on ne peut pas exercer d’action contraignante pour
exhorter au bien, mais seulement pour empêcher un mal.
27. ‘Ali Abdul Râziq, Al-Islam wa Usül Al-Hukm, (L’Islam et les Fondements du Pouvoir Politique)
Alger, ed Mufim, 1988.
28. Cf. Izzat Qarni : op. cit.
29. Une partie substantielle des avis d’Al Azhar sont disponibles sur http://media.alazhar.eg/
30. Muhammad ‘Ammâra, al-Islâm wa al-Thawra (L’Islam et la révolution), Le Caire, Dar al-Shurûq,
1988
31. Cf., Lawrence Kohlberg, Essay on moral development : the philosophy of moral
development, San Francisco, Harper and Row, 1982. Et, pour la discussion de cette
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
46
doctrine, Cf. Fouad Nohra , L’éducation morale, au-delà de la Citoyenneté, Paris,
L’Harmattan, 2004.
32. Cf. Fouad Nohra, « Radicalisation politique et escalade militaire dans le conflit syrien », in
Pascal Chaigneau (Dir.) : Enjeux Diplomatiques et Stratégiques, Paris, Economica, 2013, pp 225-249.
ABSTRACTS
The revolutionary process in the Arab world is explained by a combination of heterogeneous
factors, but religious thought and culture seems to have provided a crucial contribution to this
political radical change. Of course the religious dimension is involved at different levels in the
Arab political landscape encompassing secular parties as well as the so called « Islamist »
movements. The manipulation of the religious doctrine by the political actor and/or power is a
common phenomenon and therefore it is necessary to get through the religious doctrinal matrix.
The latters’ principle are crucial as they provide the resources for a ethical debate on four main
issues: the political regime (whether democratic or not), the individual rights defined and
defended by the religious doctrine and their limits, the right to rebel against the unjust ruler and
how far a revolutionary initiative can be undertaken without hurting other values (as the
protection of human being and properties).
Le processus révolutionnaire qu’a connu le monde arabe est l’effet d’une combinaison de facteurs
multiples, mais la pensée et la culture religieuse semblent compter au titre des facteurs décisifs.
Cette dimension est présente, non seulement dans les forces politiques dites “islamistes”, mais
également au sein même des partis d’orientation séculariste dites “laïque“. Au-delà de la manière
dont le religieux est instrumentalisé par le politique, il est nécessaire de remonter aux sources
doctrinales matricielles, afin de répondre à quatre questions essentielles : quel est le régime
politique légitime ? Qu’en est-il des droits individuels et de leurs limites ? La doctrine religieuse
reconnaît-elle le droit à la désobéissance au “prince” injuste ? Quelles sont les limites de ce droit
?
INDEX
Mots-clés: Religion - Pouvoir politique – Démocratie – Révolution - Droits de l’homme -
Légitimité
Keywords: Religion - Political power – Democracy – Revolution - Human rights - Legitimacy
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
47
Droits des femmes et révolutions
arabes
Juliette Gaté
« Ce n’est pas une affaire d’épaules, ni de biceps
que le fardeau du monde
Ceux qui viennent à le porter sont souvent les
plus frêles »Abdelatif Laâbi
1 Toutes les images des « printemps arabes » montrent des femmes défilant dans les rues,
fréquemment en première ligne, au mépris souvent de législations qui interdisaient à
toutes et tous le droit de manifester1. « Dégage! » crient-elles avec les hommes aux
dirigeants en place pour réclamer le respect de leurs droits fondamentaux 2; la
démocratie bien sûr, la liberté politique avant tout, mais pour les femmes aussi, tout
spécialement, l’égalité en droit avec les hommes.
2 L’usage de ce droit de résistance à l’oppression a souvent été cher payé. Les femmes
ayant participé à ces manifestations ont fréquemment été les cibles premières de la
répression des mouvements révolutionnaires dans les pays arabes. En Egypte ainsi, par
exemple, les agressions contre les femmes ont été nombreuses. Sur la place Tahrir,
certaines ont été frappées, arrêtées, puis, trop souvent, soumises à des violences
sexuelles, sous prétexte notamment de tests de virginité3. Cela n’a pourtant arrêté leur
mouvement ni fait taire leurs revendications.
3 Sont-elles pour autant parvenues à leurs fins, ont-elles réussi à transformer cette
appropriation de la liberté de manifester en droits qui permettraient de faire
progresser durablement leur situation ?
4 Sans conteste, ces printemps ont engendré un vaste processus de réforme
constitutionnelle et législative dans plusieurs pays de la rive sud de la Méditerranée.
Sans conteste aussi ces réformes étaient une opportunité unique pour le renforcement
de l'égalité entre les femmes et les hommes. Unanimement, malheureusement, tous ces
efforts n’ont pourtant pas à ce jour permis les progrès escomptés. Si l'égalité devant la
loi est présente aujourd’hui dans tous les textes, en bonne place, il faut toutefois
s’attarder, pour en mesurer l’exacte portée, sur la formulation précise de ce principe
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
48
égalitaire qui varie d’un pays à l’autre et promet donc une protection plus ou moins
étendue des droits des femmes. Depuis les printemps arabes, la vie des femmes n'a sans
doute connu aucune amélioration majeure4. A bien y regarder, certains disent même
que les droits des femmes ont en certains points accusé un recul depuis ces
mouvements5. Il faut donc pour parler des droits des femmes suite aux révolutions
arabes s’attacher à étudier la manière dont les femmes ont été invitées à participer à la
réflexion sur l’évolution de leurs droits (I), l’évolution même des droits des femmes
depuis lors (II) et enfin les mesures prises afin d’assurer l’effectivité des droits
éventuellement consacrés (III).
I) Faible participation des femmes à la réflexion sur
l’évolution des droits
5 Pendant les soulèvements, la présence des femmes dans les manifestations est
spectaculaire : de tous âges, de tous horizons idéologiques, de toutes ethnies et de tous
statuts sociaux, elles défilent sans relâche. Pourtant, paradoxe tout aussi spectaculaire,
en Egypte, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie ou au Koweït, les femmes ne sont que
rarement associées aux réflexions sur l’évolution des droits qui suit et la place des
femmes en politique n’est que peu considérée ou promue.
A) De nouvelles constitutions rédigées sans les femmes
6 Sous la pression de la rue, plusieurs des pays agités par ces mouvements ont réagi en
changeant tout ou partie du texte constitutionnel. L’ampleur de ces changements,
réalisés ou en cours, est variable. En Tunisie et en Egypte, en Lybie ou au Yemen ce sont
ainsi de nouvelles constitutions qui ont été rédigées, tandis qu’au Maroc ou en Jordanie,
de simples modifications ont été apportées aux textes organisant ces monarchies
constitutionnelles.
7 Dans chacun de ces pays, très peu, trop peu de femmes ont été associées à la rédaction
de ces nouvelles constitutions alors même qu’elles avaient été aux côtés des hommes
dans les manifestations.
8 En Egypte, plusieurs mouvements constitutionnels ont déjà eu lieu mais aucun n’a
laissé grande place aux femmes.
9 A la suite des manifestations déclenchées le 25 janvier 2011 au Caire, le président
Moubarak doit se retirer et céder le pouvoir, le 11 février, au Conseil suprême des
forces armées, composé de 20 hommes, généraux. La Constitution est alors suspendue
puis amendée, et une nouvelle déclaration constitutionnelle organise la période de
transition avant le retour à un régime constitutionnel normal. C’est alors un comité de
7 juristes hommes qui est chargé de préparer les premiers amendements à la
Constitution concernant notamment la fonction présidentielle, la levée de l'état
d'urgence et la mise sur pied d'une assemblée constituante. Plusieurs articles hérités de
l'ancienne constitution alimentent les polémiques, à l'instar de l'article 2 qui consacre
l'islam comme source de toute législation en Egypte.
10 Les élections parlementaires, organisées fin janvier 2012, sont remportées par les
islamistes. Concernant les femmes seules neuf d'entre elles, sur les 987 candidates, sont
élues. Ce sont ces parlementaires qui mettent en place un comité constituant composé
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
49
de 100 membres chargés de la rédaction d’une nouvelle Constitution, dont une moitié
de parlementaires et une moitié de représentants de la société civile. Cette première
commission ne compte que six femmes.
11 Les partis laïcs, soutenus par un certain nombre d’autres factions politiques, rejettent
toutefois la composition du comité, et 20 des membres désignés démissionnent en
réclamant que soient mieux représentées les minorités. Des libéraux déposent même
une demande d'annulation du vote devant un tribunal administratif et fin avril 2012, un
tribunal rend une décision condamnant la composition du comité constituant et
ordonnant la suspension de ses travaux.
12 Le Parlement égyptien désigne donc de nouveau, en juin 2012, les cent membres de
l'assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution: 39 députés du parlement, 15
représentants de l’appareil judiciaire et des juristes, 9 représentants des institutions
religieuses dont Al-Azhar, et les églises évangélique, orthodoxe et catholique, 7
représentants des syndicats, 2 représentants de l’Armée, le ministre de la Justice, 11
personnalités éminentes du pays, 10 représentants des femmes et des jeunes dont 7
femmes. De nouveau, la contestation enfle. Les membres des partis politiques
d’opposition, tout comme des Églises chrétiennes, se retirent de cette Assemblée en
guise de protestation contre sa composition jugeant que les femmes, les intellectuels et
les chrétiens étaient sous-représentés dans la liste proposée.
13 Le 17 juin 2012, Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans, est élu à la
présidence de la République. Il prend bientôt un décret interdisant que le comité
constituant puisse être dissous. Un projet de Constitution est rédigé par cette
assemblée, approuvé par référendum et signé par le Président Morsi en décembre 2012.
Mais après des manifestations massives, le président Morsi est destitué par les forces
armées le 3 juillet 2013 et la Constitution est suspendue. Une nouvelle période de
transition est ouverte et le nouveau gouvernement décide de faire amender la
Constitution de 2012.
14 Le gouvernement intérimaire désigne donc à son tour une nouvelle Assemblée
constituante, où ne siège presqu'aucun islamiste, qui disposera d'un délai de 60 jours
pour réviser la Loi fondamentale. Dans ce « Comité des 50 », 10% des sièges seulement
sont réservés aux jeunes et aux femmes. De nouveau, 5 femmes sur 50 seulement font
partie de la Constituante.
15 Le texte de la nouvelle Constitution est approuvé par référendum les 14 et 15 janvier
2014 à 98,1 % avec un taux d’abstention record. Cette genèse constitutionnelle
complexe a été menée pratiquement sans femme.
16 En Lybie, beaucoup de femmes s’investissent dans la révolution pour sortir d’une
dictature. «Le début du soulèvement contre M. Kadhafi, a été une manifestation des
avocats à Tripoli et Benghazi, dans lesquelles il y avait beaucoup de femmes », rapporte
ainsi à RFI Ibtisan Al-Kilani, avocate libyenne en France 6. A l’issue de ces mouvements,
une déclaration constitutionnelle adoptée en août 2011 par le Conseil national de
transition prévoyait une période au cours de laquelle une assemblée serait élue, le
Congrès général national, ainsi que les membres d’une assemblée constituante. Le
processus se conclurait par l’adoption par référendum de la constitution et la tenue
d’élections législatives et présidentielles. Le Congrès général national fut donc la
première assemblée élue, le 7 juillet 2012 à l’issue de la première élection libre depuis
plusieurs décennies. Composée de 200 membres, elle voit 120 de ses sièges réservés aux
candidats individuels. Pour ceux là il y a eu 2500 candidats, parmi lesquels seulement 85
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
50
femmes. Les 80 sièges restants réservés aux partis politiques ont été brigués par 1202
candidats, parmi lesquels 540 femmes et 662 hommes. A l’issue du scrutin, 16,5 % des
sièges ont été attribuées à des femmes, soit 33 femmes et 167 hommes. Ce sont les
libéraux qui ont eu la majorité des sièges au Parlement en juillet, tandis que les Frères
musulmans étaient minoritaires. 7.
17 Ce Congrès général national (CGN), assemblée nationale libyenne, a d’ailleurs ensuite
débouté, le 4 octobre 2012, le gouvernement proposé par le Premier ministre
Moustapha Abou Chagour. La liste de 29 ministres, dont une seule femme, comprenait
plusieurs membres du gouvernement de transition sortant et ne comptait aucun
représentant de la principale coalition libérale8.
18 Compte-tenu de l’instabilité du pays, ce n’est que le 20 février 2014 que le peuple a été
appelé aux urnes pour désigner une Assemblée constituante. Les soixante élus, divisés
en trois groupes de poids égal représentant les trois grandes régions de la Libye,
disposent de 120 jours pour rédiger une nouvelle loi fondamentale, qui sera ensuite
soumise à référendum9.
19 Parmi ces 60 sièges, six sièges sont réservés aux minorités (toubou, amazigh et
touareg), et six autres aux femmes. Officiellement, les partis politiques n'y participent
pas et seules les candidatures individuelles ont été acceptées. Au total, 692 candidats se
sont inscrits pour ces élections, dont 73 femmes, volontaires précise la commission
électorale libyenne10.
20 En Tunisie, la Constitution tunisienne de 1959 est suspendue peu de temps après la
chute de M. Ben Ali. Une nouvelle Constitution doit être rédigée et adoptée par une
assemblée constituante. C’est la Commission pour la réalisation des objectifs de la
révolution, la réforme politique et la transition démocratique, composée de
représentants de la société civile et des principaux partis politiques qui se voit confier
la mission de d’adopter les textes juridiques nécessaires à l’organisation de l’élection
des membres de l’assemblée constituante et de la transition démocratique en général.
Cette élection est alors organisée par le biais d’un scrutin de liste devant être construite
à parité, avec alternance hommes femmes. Malheureusement, selon un procédé bien
connu, rien n’impose de faire figurer des femmes en tête de liste. Elles ne seront donc
que 49 sur 217, soit 24 % à réfléchir à la nouvelle constitution et 42 d’entre elles
appartiennent à Ennahda, parti islamiste modéré arrivé largement en tête, qui assure
ainsi, paradoxe, sur 90 élus, un taux de 47% de représentation féminine. La rédaction
sera longue et houleuse et les Frères musulmans d'Ennahda doivent abandonner le
pouvoir au terme d'une interminable crise politique, qui a paralysé le pays d'août 2013
à janvier 2014. La Constitution, la plus libérale jamais vue dans le monde arabe, est
cependant adoptée avec moins d’un quart de femmes.
21 Au Maroc, la commission consultative pour la réforme de la constitution (CCRC), avec
avis purement consultatif, est composée de dix-neuf membres nommés par le roi dont
seulement 5 femmes. Les propositions du comité marocain ont été soumises et
approuvées par référendum le 1er juillet 2011.
22 La révolution yéménite de 2011, qui a elle aussi mobilisé un grand nombre de
manifestantes, a conduit à une réflexion sur une nouvelle constitution rédigée sur la
base de travaux nés d’une « conférence sur le dialogue national » 11 . Depuis mai 2014, la
commission, composée de 17 membres, dont seulement quatre femmes, soit un peu
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
51
moins que les 30% promis, est appelée à traduire dans le nouveau texte fondamental les
conclusions du dialogue national,
23 Le bilan des femmes associées aux travaux constitutionnels post-printemps est donc
généralement bien faible. La présence de femmes dans les assemblées constituantes
aurait pourtant peut-être pu faciliter l'inscription de mesures de discrimination
positive en leur faveur, nécessaires à permettre la présence en nombre de femmes dans
les assemblées législatives, lieu de fabrique et de réforme des lois. Les chiffres montrent
en effet que sans l’instauration de cette inégalité de droit pour promouvoir l’égalité, les
femmes ne sont pas élues ni promues aux postes influents.
B) Une nouvelle politique menée sans femme ou sans féministe
24 L’expérience montre que la proclamation de l’égalité entre femmes et hommes ne suffit
pas à produire des résultats significatifs et rapides. Seules des mesures de
discrimination positive garantissent à ce jour la présence des femmes au pouvoir en
nombre notable.
25 La région arabe en général fait partie des régions où les femmes sont les moins
présentes dans les assemblées législatives avec une moyenne, en progression toutefois,
de 15,9% de femmes dans les parlements12. A ce sujet, le rapport de l’Union
interparlementaire (UIP) sur «les femmes au Parlement en 2011» souligne que «malgré
un début d’année prometteur, la région arabe reste la seule au monde dont aucun
Parlement ne comporte un minimum de 30% de femmes». Au Yémen par exemple, alors
que la constitution dit que les citoyens sont égaux en droits et devoirs, on compte 1
femme sur 301 au parlement en 2014.
26 Dans plusieurs pays aussi, les plus hautes fonctions de l'état sont réservées aux
hommes, plus ou moins explicitement. Aujourd'hui, la nouvelle constitution syrienne
mentionne, entre autres conditions, que l'aspirant chef d'état doit être marié à une
syrienne ; on est Roi au Maroc de père en fils et les tunisiens ont finalement rejeté
l'idée d'introduire le féminin dans l'article relatif au chef d'état dans la constitution
provisoire.
27 Le printemps n’a guère permis de faire avancer les choses : les mesures visant à
permettre ou favoriser la participation de femmes à la vie politique demeurent rares.
De plus, même lorsque l’idée de discrimination positive au bénéfice des femmes est
présente dans les textes de certains pays après les révolutions, sa portée est faible.
28 Au Maroc ainsi, l’égalité des citoyens développée et réaffirmée dans la constitution
révisée s’est accompagnée du vote, en octobre 2011, de deux lois organique de quotas,
décevantes dans leur ampleur. Certes, il est demandé aux partis politiques d’appliquer
le principe des quotas et de présenter au moins un tiers de femmes en leur sein, mais
rien n’est garanti, puisque le texte «encourage » et n’oblige à rien. Quant à la loi
organique de la Chambre des représentants, elle maintient le principe d’une liste
nationale de 90 sièges, dont 60 sont réservés aux femmes –au lieu de 30 dans la liste
nationale préexistante mais cette disposition ne permet de garantir qu’un pourcentage
de 15% de femmes –contre 10,8% dans la Chambre précédente- insuffisant pour oser
prétendre à une politique de parité. En outre, cette liste exclusive empêche les femmes
d’aller chercher à mener des listes au sein des partis13. Le chemin est encore long avant
l’égalité. A l’heure actuelle, aucun des huit chefs des groupes parlementaires des partis
politiques n’est une femme. Sur les 13 membres du Bureau du Parlement, 3 seulement
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
52
sont des femmes. Une seule femme préside une des huit commissions parlementaires.
Par conséquent, quatre femmes seulement occupent des postes leur permettant
d’influer sur le fonctionnement du Parlement.
29 Hors le parlement, d’autres changements sont notables dans le texte constitutionnel
30 Selon l’article 115 de la Constitution, une représentation des femmes juges doit être
assurée parmi les 10 membres élus du Conseil suprême de la magistrature, en fonction
de leur nombre dans le corps de la magistrature. L’article 12 de la Constitution
reconnaît aussi le rôle et la place des organisations de la société civile, dont font partie
les associations féministes, dans les affaires publiques. Il leur donne la possibilité de
faire des propositions et de surveiller et d’évaluer les politiques de l’Etat 14. Mais le
progrès se fait à tous petits pas.
31 En Egypte, les constitutions garantissent depuis longtemps l’égalité des droits entre les
hommes et les femmes. La Constitution de 1956 a été jugée moderne dans la région en
accordant aux femmes le droit de voter et de se présenter aux élections. Celle de 1971
leur garantissait l’égalité dans la vie politique, sociale et économique, sous réserve que
celle-ci n’enfreigne pas la charia. En pratique, le niveau de participation des femmes
aux affaires politiques était extrêmement faible. Seuls 9 des 454 sièges parlementaires
étaient détenus par des femmes après les élections de 2005, dont cinq avaient été
désignés par le président Moubarak. Lors des élections de 2010, leur nombre a
augmenté grâce à l’instauration de quotas. Une nouvelle législation avait ainsi permis
de réserver 64 sièges supplémentaires aux femmes, ce qui amenait leur représentation
à 12 % mais l’ensemble des sièges avait finalement été remporté par des représentantes
du Parti national démocrate (PND) au pouvoir, aujourd’hui dissous.
32 En 2012, le projet de Constitution approuvé par l’Assemblée constituante d’Égypte
restreint encore les droits des femmes. Le corps de la Constitution ne comportait ainsi
plus aucun article garantissant explicitement l’égalité entre les hommes et les femmes.
Seul le préambule de la Constitution consacrait l’égalité devant la loi et l’égalité des
chances entre « les citoyens et les citoyennes », mais le statut normatif de ce préambule
n’était pas défini, et il y était précisé par ailleurs que les femmes devaient être
honorées, en tant que « sœurs des hommes et les gardiennes de la maternité, la moitié
de la société ». De même, le quota de 64 femmes au Parlement, avait été abrogé par le
Conseil suprême des forces armées et en conséquence, seules dix femmes avaient été
élues au sein de l’Assemblée du peuple, aujourd’hui dissoute. La seule discrimination
positive destinée à promouvoir la représentation politique des femmes était
l’obligation d’inscrire au moins une femme sur toutes les listes électorales 15. A ce
moment, seulement 2,2 % des sièges du nouveau parlement étaient occupés par des
femmes. La représentation des femmes se dégrade donc après la révolution 16.
33
34 Dans la nouvelle constitution approuvée par référendum en janvier 2014, l’article 11
traite de la place des femmes. Il garantit une égalité hommes-femmes en matière civile,
politique, économique sociale et culturelle, il établit que les femmes doivent être
représentées de « manière adéquate » au parlement, sans toutefois établir de quotas, et
précise qu’elles peuvent occuper des fonctions officielles sans être discriminées. L’Etat
s’engage enfin à les protéger contre toute violence et les soutenir dans leur vie
familiale et professionnelle17. Le progrès est apparemment présent mais bien trop peu
contraignant.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
53
35 En Tunisie, la nouvelle constitution18 introduit pour la première fois dans le monde
arabe un objectif de parité hommes-femmes dans les assemblées élues. Deux articles de
la constitution tunisienne retiennent spécialement l’attention :
36 a) l’article 20 qui énonce que "Les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et
devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune." ;
37 b) l’article 45 ainsi rédigé :"L'Etat garantit la protection des droits de la femme et
soutient ses acquis. L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme
pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L'Etat œuvre
pour réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. L’Etat prend les
mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme."
38 Là encore toutefois, les quelques semaines écoulées depuis l’entrée en vigueur de cette
constitution suffisent à montrer que l’inscription de ces principes constitutionnels
n’est pas suffisante pour garantir une égalité de fait entre femmes et hommes, ne
serait-ce que dans la sphère publique.
39 Ainsi, le nouveau gouvernement de 2013 ne comptait qu'une ministre, en charge bien
sûr des affaires de la femme (Sihem Badi, qui occupait le même poste dans le
gouvernement sortant), et deux secrétaires d'Etat, Leila Bahrya aux Affaires étrangères
et Chahida Frej Bouraoui, à l'Habitat19. Mais le premier gouvernement choisi sous l’ère
de la nouvelle constitution ne fait guère mieux : 3 femmes seulement ont été nommées
sur les 35 ministres présents (commerce et artisanat, tourisme, affaires de la femme de
l’enfance et de la famille)20.
40 Enfin, le vote de la loi organique électorale en mai 2014 par l’assemblée nationale
constituante a également déçu. Si l’un des derniers articles adoptés instaure
l'obligation pour les partis de présenter des listes paritaires homme-femme aux
législatives, une proposition d'imposer un quota de femmes têtes de liste a cependant
été rejetée21.
41 Quoi qu’il en soit, il faut aussi ici rappeler que les instruments paritaires ne sont pas
toujours la panacée et ne suffisent pas à eux seuls à faire progresser les droits des
femmes.
42 D’abord parce que le concept de parité fait lui aussi l’objet de récupération politique,
des grands partis notamment. Ainsi, on l’a évoqué, en Egypte, le droit contingentaire de
2010, instauré officiellement pour augmenter la représentation des femmes au
parlement, était en réalité conçu pour bénéficier au seul Parti national égyptien (NPD).
Le quota a été respecté, mais ce uniquement pour rendre le parti national plus fort, et
non pas pour permettre aux femmes d’être plus représentatives.
43 Ensuite parce qu’on sait aussi que les femmes ne votent pas forcément pour les femmes
et que femmes ne veut pas dire féministe : en Egypte encore par exemple, 6 des 7
femmes de la constituante étaient des islamistes. En Tunisie, le seul groupe
parlementaire de l’assemblée constituante qui soit presque à parité (39 femmes sur 89
élus) est le groupe du parti islamo- conservateur Ennhada. Ce paradoxe s’explique par
le fait que la loi électorale avait imposé l'alternance, sur les listes candidates, entre les
hommes et les femmes. Comme les têtes de liste étaient, à 93 %, des hommes seul le
parti à avoir obtenu deux sièges ou davantage a été concerné par la parité. Or il s’agit
d’Ennahda.
44 De même le Magazine Forbes a récemment examiné et publié tous les postes importants
occupés par des femmes arabes, pour en distinguer 30, dans onze pays. Fait étonnant,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
54
17 femmes sont ministres dans des pays plutôt conservateurs : quatre aux Émirats
arabes unis, deux au Sultanat d’Oman, en Algérie, à Bahreïn, au Koweït, une en Jordanie
mais aussi en Tunisie, et au Maroc.
45 La présence ou l’absence des femmes dans les sphères du pouvoir n’est donc pas le seul
signe à prendre en considération pour mesurer le progrès du droit. Il faut bien sûr
s’attacher à sa lettre.
46 Là encore, depuis les printemps, l’évolution paraît bien faible.
II) Faible évolution des droits des femmes
47 Les droits en vigueur depuis les mouvements du printemps offrent encore pour la
plupart encore une trop faible protection aux femmes. Ces lacunes sont sensibles tant
au niveau constitutionnel où l’égalité cohabite souvent avec le respect des préceptes
religieux (A), qu’aux niveaux juridiques inférieurs où persistent de nombreuses règles
maintenant les femmes dans des situations clairement inégalitaires (B).
A) Droits constitutionnels : égalité et religion
48 Dans la plupart des pays dans lesquels les printemps arabes ont eu des répercussions
constitutionnelles, il est d’abord remarquable qu’une place toute particulière soit
désormais consacrée à l'égalité. Il faut toutefois, pour cerner la portée de cette
inscription, bien sûr comparer avec les textes constitutionnels pré-révolutionnaires,
mais encore s’attarder sur la formulation de ce principe qui varie d’un pays à l’autre et
promet donc une protection plus ou moins étendue des droits des femmes. A bien y
regarder en effet, on découvre que cette égalité ne vise pas toujours expressément les
femmes et surtout qu’elle ne leur garantit bien souvent pas l’égalité en tous domaines.
49 Avant les révolutions, certaines constitutions comme celles du Yémen, de l’Egypte ou
de la Tunisie consacraient déjà un principe général d’égalité des citoyens, devant la loi
ou en droits et devoirs, sans mention de sexe. D’autres mentionnaient en revanche
expressément l’égalité hommes-femmes ou l’interdiction des discriminations fondées
sur le sexe comme au Maroc, en Algérie ou au Bahreïn. Il était toutefois frappant de
constater que cette égalité n’était garantie que dans le champ des droits politiques ou,
au plus, dans d’autres champs relevant de la sphère publique.
50 Depuis les révolutions, à la lecture, certains progrès sont manifestement notables.
51 Au Maroc ainsi, les notions de « citoyenne » et « citoyen » se multiplient dans le texte
constitutionnel pour préciser les droits politiques. La même Constitution ne limite
d’ailleurs plus l’égalité aux droits politiques mais proclame dans son article 19 22 que
« les hommes et les femmes jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil,
politique, économique, social, culturel et environnemental... ». Au-delà de la
consécration constitutionnelle de la parité, le même article prévoit aussi
l’institutionnalisation de la protection de la parité par la création d’une Haute Autorité
de la parité. En outre, son préambule affirme également que « Le Royaume du Maroc
s’engage à combattre et bannir toute discrimination à l’égard de quiconque en raison
du sexe ».
52 En Tunisie, la Constitution garantit l'égalité des citoyens et citoyennes en droits et
devoirs «égaux devant la loi sans discrimination » dans son article 21. L’article 34 de la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
55
Constitution oblige l'Etat à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées
élues. L'article 40 affirme que « tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail
dans des conditions décentes et à salaire équitable ». On notera toutefois que cette
référence à la citoyenneté peut être une manière de circonscrire l’égalité à la sphère
publique. L'article 46, consacré plus particulièrement aux droits des femmes, inscrit
dans la Constitution la protection des acquis de la femme, le principe de parité et la
lutte contre les violences faites aux femmes23.
53 Dans la Constitution égyptienne, l’article 11, précité, évoque aussi la question de
l’égalité hommes-femmes. D’après cet article, les femmes peuvent occuper des
fonctions officielles sans être discriminées. Elles doivent, en outre, être représentées de
manière équitable au parlement, sans établir de quotas.
54 Cette égalité de principe doit toutefois être tempérée par plusieurs facteurs, parmi
lesquels la place importante de la religion et spécialement de la Charia dans les mêmes
textes constitutionnels. Les effets de ces références religieuses sont très sensibles
lorsque l’on s’intéresse aux droits des femmes dans la sphère privée. Or on sait que c’est
à ce jour principalement ici que se situent les enjeux politiques car pour les féministes
le privé est politique. C’est en ces matières que la nécessité de réforme est encore plus
grande. La question est posée dans tous les pays qui ont été secoués par les
mouvements du printemps arabe.
55 Ainsi, la place de la religion, à côté de la reconnaissance d'un Etat civil, a suscité de très
longs débats dans la « nouvelle Tunisie ».
56 La liberté de conscience était reconnue dans tous les projets constitutionnels, mais
l'ajout d'un article stipulant qu'aucune révision ne pourrait remettre en cause l'islam
comme « religion d'Etat », l’évocation de la loi islamique comme source de droit ainsi
que les termes du deuxième paragraphe du préambule, où les droits de l'homme sont
conditionnés en amont par « les principes immuables de l'islam » et en aval par « les
spécificités culturelles du peuple tunisien » ont fait craindre la dissimulation d’une
place importante laissée à la Charia.
57 Dans la constitution définitive, le préambule reconnaît « l'attachement [du] peuple aux
enseignements de l'islam et à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la
modération, des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l'homme
universels ». L'article 1 reconnaît la place de l'islam comme religion de la Tunisie mais
la charia n'est pas mentionnée comme source de droit. L'article 2 réaffirme en outre la
nature civile de l'Etat. La « liberté de croyance [et] de conscience » est reconnue (article
6), ce qui limite la possibilité d'engager des poursuites pour apostasie. On remarquera
toutefois que seuls les électeurs de confession musulmane peuvent se présenter à
l'élection présidentielle (art. 74). Les islamistes n'ont en revanche pas obtenu que soit
inscrite dans la Constitution la criminalisation des atteintes au sacré, mais l'Etat a pour
obligation de « protéger les sacrés ».
58 Au Maroc, l’article 3 de la constitution énonce que l’Islam est la religion de l’état et
l’article 41 rappelle que le Roi veille au respect de l’Islam.
59 D’autres états, comme le Bahreïn, la Syrie ou l’Egypte, avant et après la révolution, font
cette fois clairement de la charria ou de la jurisprudence islamique, la source de toute
loi ou la source principale de la loi
60 En Egypte ainsi, dans la constitution adoptée par référendum en 2012 comme dans celle
de 2014, les « principes de la charia » sont, comme dans l'ancienne constitution, la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
56
« source principale de la législation » et non pas la source unique du droit comme
certains le craignaient24. Le premier texte prévoyait en outre que c'est l'université al-
Azhar qui déterminera ce que sont les "principes de la charia" 25, ce qui n'était pas le cas
auparavant. Or Al-Azhar est une instance religieuse et non élue. Dans la version de
2014, il est encore précisé qu’Al Azhar est la principale autorité en matière de sciences
religieuses et d’affaires islamiques (article 7) mais aussi que l’interprétation de la
Charia islamique « découle de la jurisprudence de la Haute cour constitutionnelle »
(préambule). Dans la version de 2012, on trouvait aussi précisé que l'Etat égyptien est
garant des "traditions égyptiennes". Or, on sait quel danger peut recéler ces références
aux traditions pour les femmes26. Cette référence aux traditions disparaît dans le texte
de 2014.
61 Dans la version votée en 2014, l’Islam reste reconnu comme la religion d’Etat et les
principes de la Charia aux origines de la législation mais la liberté de culte est tout de
même consacrée comme absolue, et il est interdit aux partis politiques de se former sur
« la base de la religion, du genre, de la race ou de la géographie ». L’Etat garantit
l’égalité entre tous les citoyens et assure la protection des femmes face à toutes sortes
de violence. De manière plus inquiétante, il est toutefois aussi rappelé que l’état
« assure à la femme les moyens de concilier ses obligations familiales et les exigences
de son travail »27
62 En dehors même de la lettre des textes constitutionnels, l’influence de la religion est
forte pour le statut des femmes, dans les lois ou dans les esprits. La source n’est
pourtant pas tant l’Islam que le patriarcat. Les femmes émancipées luttent ainsi
souvent simplement contre l’interprétation historiquement patriarcale du Coran et des
pratiques sociales28. Il faut, selon elles, déconstruire cette structure politisée et la
reconstruire, en revenant à l’esprit du texte coranique qui offre toutes les latitudes
pour contextualiser l’égalité entre la femme et l’homme. Les femmes devraient donc se
réapproprier ce qui leur a été usurpé pendant des siècles.
63 A ce jour, le résultat de ce patriarcat fondé dans les textes constitutionnels sur la
coexistence de l’égalité et de la référence religieuse est évidemment perceptible dans
les textes de sources inférieures organisant les droits civil ou pénal.
B) Droits de sources inférieures
64 En cette matière, malheureusement, les exemples abondent.
65 Au Maroc ainsi, malgré la réforme de la Mudawana en 2004 et les avancées
précédemment évoquées de très nombreuses failles subsistent...Un programme a
pourtant été lancé par le royaume pour l’égalité sur la période 2011- 2015, visant des
domaines aussi divers que la lutte contre les violences et la discrimination contre les
femmes, la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des femmes, la légalisation de
l’avortement dans les cas de viol et d’inceste, mais les progrès sont lents.
66 Si les députés marocains ont voté un amendement au code pénal supprimant la
possibilité pour un violeur d'épouser sa victime afin d'échapper à la prison 29, le combat
pour les droits des femmes marocaines est loin d'être terminé. Fin 2012, la ministre de
la famille, Bassima Hakkaoui, avait indiqué que six millions de femmes - sur une
population totale de 34 millions d'habitants - étaient victimes de violences au Maroc,
dont plus de la moitié dans le cadre conjugal. Parmi les combats qui sont menés pour
les droits des femmes figure aussi l'interdiction du mariage des mineures, permis au
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
57
Maroc par le même code de la famille par dérogations des juges. Le nombre de mariages
conclus sur ce fondement ne cesse d’augmenter : 30 000 en 2008, 35 000 en 2010,
environ 40 000 en 2013 selon des chiffres d’Amnesty International 30.
67 Beaucoup d’associations féministes réclament la disparition de nombreux autres
articles du code pénal : l’article 488 qui définit le viol, l’article 487 qui ne reconnaît pas
le viol entre époux, l’article 488 qui distingue parmi les victimes de viol celles qui sont
vierges et celles qui ne le sont pas au moment de l’agression, l’article 490 qui prévoit
des peines d’emprisonnement d’un mois à un an contre toute relation sexuelle
consentie en dehors du cadre du mariage ou encore l’article 496 qui précise que
quiconque cache une femme mariée « qui se dérobe à l’autorité à laquelle est
légalement soumise » est passible d’une peine d’une à cinq années d’emprisonnement
et d’une amende.
68 Les problèmes sont identiques ailleurs.
69 L’Egypte a été classée à la 126e place sur 135 pays, dans le Gender Gap Index de 2012, en
ce qui concerne les inégalités entre les hommes et les femmes. Le code pénal égyptien
ne protège ainsi pas les femmes contre la violence domestique, notamment le viol
conjugal. Il autorise également l’indulgence à l’égard des hommes ayant commis des «
crimes d’honneur». Les articles 260 à 263 du code pénal répriment l’avortement en
toutes circonstances, même en cas de viol et d’inceste ou lorsque la santé d’une femme
est menacée par sa grossesse. Malgré la réforme du statut personnel, qui a permis la
pratique du « Kuhl », divorce par consentement mutuel, et interdit le mariage avant 18
ans, les lois relatives à la famille restent discriminatoires à l’égard des femmes. Ainsi,
une femme qui demande le divorce sans faute doit renoncer à ses droits financiers et
perd la garde des enfants en cas de remariage de son ancien époux ; le témoignage de
deux femmes équivaut en outre à celui d’un homme devant les tribunaux de la famille 31.
Les femmes ont l’obligation légale d’obéir à leur époux32.
70 Cette infériorité juridique contribue à alimenter les attitudes violentes à l’égard des
femmes et les mouvements du printemps arabe n’ont pas, à ce jour, amélioré la
situation33.
71 « Depuis la chute du président Moubarak, les Egyptiennes souhaitant prendre part aux
diverses manifestations politiques n'ont cessé d'encourir des violences sexuelles
exercées publiquement, et en toute impunité », affirme ainsi la Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) dans un long rapport rendu
public au Caire en avril 201434.
72 Ces violences visent à dissuader toute velléité de participation des femmes à la vie
publique. « Le lien entre cette violence envahissante et la discrimination structurelle
contre les femmes inscrite dans le droit égyptien ne peut plus être ignoré », estime la
FIDH. Selon un rapport des Nations Unies réalisé en avril 2014, 99,3 % des femmes et
jeunes filles égyptiennes ont été victimes de harcèlement sexuel. « Cela ne devrait pas
changer car il est considéré comme socialement acceptable et n'est pas pris au sérieux,
ni par les autorités, ni par la société », a commenté une journaliste égyptienne à la
Fondation Thomson Reuters35.
73 Une même enquête révèle qu’au Yémen, malgré les apparents progrès concernant la
place des femmes dans la vie publique suite aux mouvements du printemps 36, le
harcèlement sexuel constitue également un problème majeur. 98,9 % des femmes et
jeunes filles en ont été victimes dans la rue, selon un rapport du département d'Etat
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
58
américain de 2012. Les mariages d’enfants sont légion, aucun âge minimum n'étant fixé
pour le mariage.
74 En Lybie, la « grande Charte verte des droits de l’homme » de 1988 consacrait le
principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout en interdisant les mariages
forcés et le divorce sans consentement ou jugement. La polygamie, très peu pratiquée,
était également condamnée. La révolution de 2011 a révélé la réalité de la société. La
faible représentation politique des femmes – 33 femmes élues en 2012 sur les 200
membres de l'Assemblée nationale – n'a pas encore eu pour conséquence d'inscrire les
droits des femmes dans la loi. Les relations entre les hommes et les femmes sont restées
sous l’emprise de la religion et de la tradition patriarcale. Le port du voile est
quasiment généralisé. Les violences domestiques restent notamment un problème
majeur dans le pays. « Les femmes se sentent en insécurité du fait du manque de
protection sociale contre les maris abusifs », avance une militante libyenne. « Près de
99 % des femmes qui ont porté plainte contre des cas d'abus domestiques l'ont retirée,
note un responsable judiciaire libyen »37. Les femmes sont toutefois très actives et
nombreuses d’entre elles sont hautement qualifiées. Un projet de loi sur le viol a été
déposé au Congrès mais dans ce pays instable les acquis sont extrêmement fragiles. Le
grand mufti Ghariani a ainsi déclaré qu’il n’était plus besoin d’avoir l’autorisation de sa
première femme pour en épouser une deuxième et que le mariage d’une Libyenne avec
un étranger devait désormais être considéré comme interdit38.
75 Les exactions commises pendant la révolution devraient en revanche pouvoir être
punies. Le gouvernement libyen, dirigé par Ali Zeidan, a adopté, mercredi 19 février
2014, un décret qui protège et indemnise les victimes de viols ou de violences sexuelles
commises pendant les mouvements contre M. Khadafi 2011. Le texte a la particularité
de créer le statut de victime de guerre pour les victimes de viols. Il permet de leur
redonner une place dans la société en leur fournissant un soutien social, juridique,
économique et médical. Face aux réticences du Congrès national général libyen (CGN)
pour voter cette loi, le Ministre de la Justice Libyen a décidé hier d'adopter un décret.
Le décret est entré en vigueur dès son adoption par le gouvernement. Il est prévu que le
Parlement adopte, par la suite, le texte sous forme de loi.
76 En Jordanie, la protection des droits de l’homme a certes été renforcée depuis les
mouvements des printemps, notamment par la criminalisation de toute infraction aux
droits et aux libertés publiques, mais de nombreux progrès restent à faire en droit.
Ainsi, par exemple, les militants associatifs notent que, malgré leurs demandes,
l’interdiction de la discrimination ne s’étend toujours pas au sexe, à la race, à la langue
et à la religion.
77 Les femmes subissent aussi de graves discriminations au Yémen, selon Human Rights
Watch. Les femmes ne sont pas autorisées à se marier sans la permission de leur tuteur,
habituellement un père ou un frère. Elles se voient refuser l'égalité des droits au
divorce, à l'héritage et à la garde des enfants, et le manque de protection juridique les
laisse exposées à la violence domestique et sexuelle. Le mariage des enfants reste très
répandu. Au cours de 2013, des médecins et les médias ont rapporté la mort de filles
mariées dès l'âge de huit ans suite à des rapports sexuels ou à l'accouchement. Le
Yémen n'a pas légiféré sur l’âge minimum du mariage, bien que le Groupe de travail sur
les droits et les libertés du Dialogue national ait recommandé en novembre de fixer
l'âge minimum à 18 ans39.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
59
78 Si le droit progresse, il compte encore surtout de nombreuses failles. En outre, les
progrès réels des droits des femmes ne doivent être mesurés à la seule aune de la lettre
des textes mais aussi bien sûr sur à la manière dont le droit garantit ou non leur
effectivité. Là plus encore peut-être, les progrès réalisés depuis les révolutions sont
trop faibles.
79 Au Maroc par exemple, malgré la difficulté de données statistiques précises, nombre
d’observateurs s’accordent à dire que la règle du relèvement de l’âge minimum pour le
mariage des filles de 15 à 18 ans paraît bien largement contournée : les exceptions sont
très nombreuses et facilement obtenues souvent après un simple examen médical 40.
Autre exemple : alors que l’article 49 de la nouvelle Mudawana a établi un dispositif
équitable dans les rapports patrimoniaux des époux41, cet acte protecteur des intérêts
de l’épouse est souvent présenté par les ‘adul-s’, pour dissuader d’en user, comme un
obstacle à la conclusion d’une union matrimoniale et une gêne dans la conduite des
affaires privées du ménage42.
80 En Egypte, alors que l’excision est condamnée par les autorités religieuses musulmanes
et coptes et interdite par la loi, des études montrent qu’elle est subie par 91 % des
femmes, la loi continuant d’autoriser ces pratiques pour « raisons médicales » 43.
81 Enoncer les droits n’est donc pas suffisant, encore faut-il que le droit garantisse leur
effectivité. Les révolutions ont permis d’accomplir certaines avancées mais bien
d’autres doivent encore l’être.
III) Faible effectivité des droits consacrés
82 Consacrer les droits n’est pas suffisant, encore faut-il garantir aux femmes qu’elles
peuvent les faire valoir en justice et que ceux qui les enfreignent seront condamnés.
L’hypothèse est encore trop rare, rendant les réformes évoquées trop souvent
cosmétiques.
83 Moushira Kattab, ancienne ministre de la famille et de la population en Egypte, attire
ainsi récemment l’attention sur le fait que certes, certains termes de la nouvelle
constitution égyptienne accorde plus d’importance à la condition des femmes, mais
sans leur permettre de leur rendre justice ni leur garantir ces droits de façon
inconditionnelle44. On remarquera en effet que les termes ne sont souvent pas
prescriptifs mais indicatifs. L’article énonce par exemple que « la constitution veille à
garantir les droits des femmes ». Simple obligation de moyen…
84 Outre ces importantes subtilités sémantiques, la portée effective des dispositions
constitutionnelles peut varier en fonction de quatre facteurs dont on évoquera
brièvement l’importance dans les nouvelles constitutions : la place de la constitution
dans la hiérarchie des normes et la place des normes internationales prônant l’égalité
hommes femmes dans la hiérarchie des normes, d’une part (A), l’effectivité du contrôle
constitutionnel du respect de ces divers principes et la connaissance du droit par les
femmes, d’autre part (B).
A) Incertitudes liées à la hiérarchie des normes
85 Pour être respectée, la constitution doit clairement apparaître comme le sommet de la
hiérarchie des normes. Or, dans certains pays des printemps arabes, la place occupée
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
60
par la constitution est incertaine. Si elle se situe bien vers le haut de la pyramide, elle se
dispute souvent le sommet avec la loi coranique. En Libye, par exemple, la constitution
provisoire adoptée par le conseil national transitoire en août 2011 énonçait que « toute
loi contredisant la loi coranique sera nulle et non avenue ».
86 En Tunisie, cette place a longtemps été discutée. Dans le projet de juin 2013, il était
ainsi fait référence dans le préambule aux «principes universels élevés des droits de
l'Homme», qui pouvait impliquer une hiérarchie des droits humains universels, dont
certains seraient plus importants que d'autres. Aujourd’hui, dans la version entrée en
vigueur en février, l’article 49 permet d'assurer le respect des droits et des libertés
énoncés dans la Constitution. Aucune restriction à ces libertés ne peut toucher à leur
essence et les éventuelles restrictions doivent respecter le principe de proportionnalité
et de nécessité. Toutefois la prudence reste de mise. Il ne faut ainsi pas que des
dispositions comme celle de l'interdiction de l'atteinte au sacré soient utilisées pour
limiter la liberté d'expression ou de pensée.
87 En Egypte, l'Islam reste « la religion de l'État» et les «principes de la charia
« demeurent » la source principale de la législation ». Mais la compétence pour décider
si la législation est conforme aux principes de la charia est transférée à la Cour suprême
constitutionnelle.
88 La place du droit international est aussi capitale car on sait qu’il s’agit là d’une source
de protection précieuse pour les droits des femmes. La CEDAW, convention des Nations
Unies pour l’élimination de toutes discriminations à l’égard des femmes 45, proscrit ainsi
clairement toute discrimination fondée sur le sexe. Si tous les pays du printemps arabe
en sont signataires, sa portée est très souvent tempérée par l’émission d’une série de
réserves à son application46 mais aussi par la place incertaine qu’occupe le droit
international dans les ordres internes. Les révolutions et les nouvelles constitutions qui
en sont nées étaient l’occasion de nécessaires clarifications. Elles ont souvent été
saisies, mais là encore, à ce jour, des doutes plus ou moins forts subsistent.
89 En Libye, la constitution provisoire d’août 2011, mentionnait dans son article 7 que
« Etat s'efforce d'adhérer aux déclarations internationales et régionales et aux chartes
qui protègent les libertés ». La dimension contraignante était plus qu’incertaine.
90 En Egypte, la suprématie du droit international sur le droit national n’est nulle part
évoquée.
91 En Tunisie, les traités internationaux approuvés par l’assemblée représentative et
ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel 47 et, depuis le 23
avril 2014, toutes les réserves à la CEDAW ont été levées. Reste toutefois la déclaration
générale émise par la Tunisie selon laquelle le gouvernement tunisien n'adoptera en
vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative contraire aux
dispositions du chapitre premier de la Constitution tunisienne qui contient les
principes généraux. Or ce chapitre contient des dispositions qui peuvent neutraliser les
effets de la CEDAW comme celle rappelant que l’Islam est la religion d’état (article 1) ou
que la famille est la cellule essentielle de la société (article 7).
92 Au Maroc, la constitution a été largement saluée comme clarifiant la place hiérarchique
des normes internationales. Le préambule énonce ainsi d’une manière générale que
« les conventions internationales priment sur le droit interne du pays dans le cadre de
la constitution», et l’article 19 s’engage au respect des conventions et pactes
internationaux dans le cadre de la quête de l’égalité femmes-hommes. A la suite des
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
61
révolutions, le Maroc a en outre levé les réserves qu’il avait posées en adhérant à la
CEDAW en 1993.
93 Malgré ces incontestables progrès, la vigilance reste de mise car certaines formulations
mériteraient d’être précisées. L’article 19 sur l’égalité hommes femmes précise ainsi
que ce respect s’organise aussi dans le cadre « des constantes et des lois du royaume »,
ce qui pourrait bien être une autre manière de dire la tradition… religieuse peut-être
même… De même, dans le préambule, la suprématie des normes internationales est
organisé « dans le respect de l'identité nationale immuable ». Seules les réponses à
d’éventuelles futures exceptions d’inconstitutionnalité soulevées pourront éclairer ces
formules dont on ne peut aujourd’hui prédire de façon certaine le sens ni la portée 48.
B) Incertitudes liées à l’usage des normes
94 L’interprétation qui sera faite des notions pré-évoquées par le juge constitutionnel est
primordiale et l’on voit poindre, pour finir, l’importance de l’existence et du statut
réservé aux cours suprêmes dans les nouvelles constitutions.
95 Là encore certains progrès sont notables en quelques pays.
96 En Jordanie, dans le sillage du printemps arabe, le roi Abdallah II, crée en octobre 2012
une cour constitutionnelle, première dans le royaume, afin, selon le monarque d'offrir
« une garantie importante pour la séparation des pouvoirs et pour le respect des droits
et des libertés des citoyens ».
97 Au Maroc, la cour constitutionnelle existait déjà mais sa saisine est sensiblement
élargie : le nombre de signatures de parlementaires nécessaires à sa saisine a été
abaissé et la nouvelle constitution instaure l’exception d’inconstitutionnalité 49 . Il s’agit
là d’un outil précieux pour les femmes et les associations féministes qui pourront
l'utiliser pour faire disparaître certaines lois inégalitaires comme celle qui s'applique
en matière d'héritage. Un soin particulier doit aussi évidemment être accordé à la
garantie de l’indépendance des membres des juridictions et aux modalités d’exercice du
contrôle constitutionnel. Le gouvernement marocain a en outre adopté un projet de loi
sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la CEDAW qui permet d’enregistrer les
plaintes des femmes qui ont épuisé tous les recours nationaux pour faire prévaloir leurs
droits. Il reconnaît la compétence du « Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes » en ce qui concerne la réception et l’examen de ces plaintes. La loi
doit maintenant être adoptée par le parlement. A un degré moindre, la mise en place de
l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toute formes de discrimination (APALD), telle
que stipulé dans la Constitution de 2011, mécanisme indépendant de proposition, de
reddition de comptes et de suivi de la politique nationale est également attendue.
98 En Tunisie, la création d'une Cour constitutionnelle (articles 118 à 121) est une avancée
fondamentale. Le contrôle de constitutionnalité des lois s'exerce à la demande des
autorités publiques (gouvernement, président) ou peut être requis par les parties lors
d'un procès (article 120). Toute proposition de révision de la Constitution lui est
soumise (article 144).
99 En Egypte, en revanche aucun réel progrès n’est notable. Les juges le sont de père en
fils. Etat dans l'Etat, les magistrats comme les militaires ont vu leurs pouvoirs confortés
par la nouvelle Constitution. La Haute Cour constitutionnelle pourra choisir elle-même
ses membres et son président. « Rien n'a changé. Le juge est comme un soldat dans une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
62
bataille politique. Il n'assure pas l'égalité des citoyens devant la justice. En Egypte, cela
fait des siècles que ce système existe», relève ainsi Mokhtar Mounir, avocat d'une ONG
de défense de la liberté d'expression.50 Trois ans après le Printemps arabe, l'Egypte s'est
hissée au premier rang des mauvais élèves du monde arabe en matière de droits des
femmes, selon un classement établi par la Fondation Thomson Reuters à partir des
évaluations réalisées par 336 experts en droits des femmes au regard de la CEDAW et
publié le 12 novembre 2013. Le pays arrive en dernière position parmi les 22 pays
étudiés (21 pays de la Ligue arabe et la Syrie, qui en a été suspendue en 2011), précédé
par l'Irak, l'Arabie saoudite, la Syrie et le Yémen.
100 Enfin, le droit le meilleur sera inutile s’il n’est pas connu de ceux et celles qui peuvent
s’en prévaloir. Or, beaucoup d’ONG relèvent la faible connaissance de leurs droits par
les femmes des pays des printemps arabes et les difficultés à accéder aux « hommes de
loi ». Ce constat rend inutiles les progrès juridiques.
101 Un taux d’analphabétisme relativement élevé et une mauvaise connaissance des
processus juridiques empêchent souvent les femmes de faire valoir leurs droits Les
idées reçues sur la capacité ou le droit des femmes sont aussi largement répandues, en
particulier dans les zones rurales. Plusieurs ONG féminines animent ainsi
régulièrement des ateliers visant à informer les femmes sur leurs droits.
102 Comme le note le rapport parlementaire rédigé en 2013 sur les révolutions arabes, les
révolutions de 2011 ont donc aussi révélé au grand jour « l’écart grandissant entre la
façade juridique des régimes et la réalité sociétale, non seulement moins avancée que
l’état du droit mais connaissant aussi en parallèle diverses formes de recul.
103 Dans le même temps toutefois, comme l’a rappelé Mme Claude Guibal, ancienne
correspondante de Radio France en Egypte, lors d’une audition de la Commission des
affaires étrangères, si la situation des femmes connaît une régression dans leur vie
quotidienne, on peut penser que leur cause progresse au contraire, car « un nombre
considérable de femmes lutte au premier plan, jouant un rôle moteur dans le débat
politique, dans l’action sociale et dans l’activité économique » 51.
104 Souhaitons que les effets de leurs actions parviennent bientôt aux principales
intéressées.
NOTES
1. Lire à ce propos, Juliette Gaté, « Les libertés révélées par la révolution : du fait au droit? Sur la
reconnaissance des libertés d’expression et de manifestation », in Droits des femmes & révolutions
arabes, Julietté Gaté (dir.), Revue méditerranéenne de droit public n° 2, ed Lextenso, 2013, p. 41 et
s.
2. Comme le rappellent Stéphane Hessel et Aung San Suu Kyi dans leur préface du
rapport 2011 de l’observatoire pour la protection des défenseurs des droits de
l’Homme« le respect des droits fondamentaux a été placé au coeur des revendications des
populations ». http://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2011_fr-de_but.pdf
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
63
3. Lire par exemple à ce propos, Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty
International, « L’Égypte et ses généraux : entre déni et répression », Livewire, 12
février 2012, http://livewire.amnesty.org/fr/2012/02/12/legypte-et-ses-generaux-
entre-deni-et-repression/
4. Lire à ce propos le rapport de la commission européenne rédigé par Fatiha Saïdi,
« Egalité entre les femmes et les hommes: une condition du succès du Printemps
arabe », 5 avril 2012, Doc. 12893.
5. Constat dressé par le Forum international des femmes méditerranéennes, co-
organisé par le centre marocain Isis et par la fondation allemande Konrad Adenauer,
Fès, Maroc, 2013.
6. http://www.rfi.fr/afrique/20110901-avenir-incertain-femmes-libyennes/
7. « En Libye, une place limitée aux femmes au sein de la future Assemblée », Le Monde,
2 janvier 2012.
8. Lire « L’assemblée nationale rejette la composition du gouvernement », Jeune Afrique, 20
octobre 2012.
9. « Les Libyens élisent une Assemblée constituante sur fond de chaos sécuritaire », Le
Monde, 20 février 2014.
10. « Libye : faible participation pour élire l'Assemblée constituante », Le Monde, 21
février 2014.
11. Lire « Le Yémen engage les chantiers de la Constitution et de l'Etat fédéral », Le
Monde, 25 janvier 2014.
12. http://www.ipu.org/wmn-f/world.htm
13. Khadija Errebah, « 15% de femmes, ce n'est pas la parité », Terra femina, 25
novembre 2011.
14. Rapport Additif du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes dans la législation et dans la pratique, Mission au Maroc, Additif, conseil
des droits de l’homme, 20 juin 2012, A/HRC/20/28/Add.1.
15. Rapport parlementaire français n° 1566 sur les révolutions arabes, novembre 2013.
16. Fatiha Saïdi, rapport de la Commission européenne sur l'égalité et la non-
discrimination, « Egalité entre les femmes et les hommes: une condition du succès du
Printemps arabe », Doc. 12893, 5 avril 2012.
17. « L’État s’engage à réaliser, entre l’homme et la femme, l’égalité de tous les droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la Constitution.
L’État œuvre à prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation adéquate de la
femme aux assemblées parlementaires, conformément à la loi. Il assure le droit de la femme à
occuper les fonctions publiques et les postes de direction de l’État et à être nommée aux corps et
aux organismes de juridiction judiciaires sans discrimination. L’État s’engage à protéger la
femme contre toutes formes de violence et à lui permettre de concilier les tâches familiales et les
exigences du travail. L’État s’engage à prendre soin de la maternité, de l’enfance, la femme
chargée de famille, ainsi que de la femme âgée et des femmes les plus nécessiteuses et à les
protéger ».
18. Constitution votée le 26 janvier 2014, à une majorité écrasante (200 voix pour, 12 contre et 4
abstentions) au sein de l'Assemblée nationale constituante (ANC). Elle remplace la Constitution
de 1959, suspendue depuis mars 2011. Elle comprend un préambule et 146 articles, organisés en
dix chapitres.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
64
19. « Tunisie : Nouveau gouvernement, cherchez la femme », Courrier international, 8
mars 2013.
20. « Tunisie, Mehdi Jomâa a annoncé la formation de son gouvernement tunisien. » , Jeune
Afrique, 26 janvier 2014.
21. « L'Assemblée nationale tunisienne adopte la loi électorale », Le Monde, 1 mai 2014.
22. Cet article dispose que « l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et
libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental,
énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution ainsi que
dans les conventions et pactes internationaux dument ratifiés par le Royaume, et ce,
dans le respect des dispositions de la constitution, des constantes et des lois du
Royaume. L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les
femmes. Il est créé à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toute forme
de discrimination ». L’article 34 énonce que « les pouvoirs publics élaborent et mettent
en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins
spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à : traiter et prévenir la vulnérabilité de
certaines catégories de femmes et de mères ».
23. Article 46. « L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et
œuvre à les améliorer. L’Etat garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme
pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L'Etat œuvre à
réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. L’Etat prend les
mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme ».
24. Article 2 de la nouvelle constitution adoptée en 2014.
25. Article 219 : « Les principes de la charia islamique comprennent ses preuves globales, ses
bases fondamentales, les règles de la jurisprudence, ainsi que ses sources significatives, acceptées
par les écoles juridiques de la tradition du prophète et l'ensemble de la communauté ».
26. Lire « Droits des femmes et traditions », Juliette Gaté, Revue de recherche juridique, 2012, p.
1141.
27. Alinéa 3 de l’article 11 de la constitution égyptienne du 15 janvier 2014. L’article 5
alinéa 2 de la constitution du Bahreïn du 14 février 2002 est aussi ainsi rédigé : « L'Etat
s'efforce de concilier les devoirs des femmes à l'égard de la famille avec leur travail au
sein de la société, et leur égalité avec les hommes dans les sphères politique, sociale,
culturelle et économique, sans enfreindre les dispositions de la charia islamique. ». Lire
« Une perspective féminine de la Violence et de l’oppression exercées par le régime de Bahreïn »,
Dre. Ala'a Shehabi, AWID, 31 mai 2013, http://www.awid.org/fre/Actualites-et-
Analyses/Dossier-du-Vendredi/Une-perspective-feminine-de-la-violence-et-de-l-
oppression-exercees-par-le-regime-de-Bahrein
28. Lire « Féminismes islamiques », Zarah Ali, ed. La Fabrique, 2012.
29. Amendement voté le 22 janvier 2014.
30. Lire à ce sujet « Droits des femmes : Maroc, un violeur ne pourra plus épouser sa victime pour
échapper à la prison », Jeune Afrique, 23 janvier 2014.
31. Rapport parlementaire sur les révolutions arabes, n°1566, 20 novembre 2013, p. 63.
32. Lire Amnesty international « Les femmes veulent l’égalité dans la construction de la nouvelle
Egypte », Octobre 2011.
33. Lire « La FIDH publie un rapport sur les violences sexuelles en Egypte », Le Monde, 16
avril 2014.
34. « Egypt : keeping women out- sexual violence in the public sphere », FIDH, avril 2014.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
65
35. « L'Egypte, pire pays pour les femmes dans le monde arabe », Le Monde, 12 novembre 2013.
36. Voir supra.
37. « L'Egypte, pire pays pour les femmes dans le monde arabe », Le Monde, 12
novembre 2013.
38. Rapport parlementaire ° 1566, novembre 203, précité.
39. « Yémen : deux ans après la prise de fonction du nouveau gouvernement, aucune obligation
de rendre des comptes. », HRW, 27 janvier 2014.
40. Colloque « Droits des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », Fès,
juin 2013 http://www.kas.de/wf/doc/kas_35491-1522-3-30.pdf?13092412003. « Le statut
de la femme marocaine dans la « réforme constitutionnelle globale » », Florence Jean,
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/temoin/florence-jean_tem_1.pdf
41. « Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux
peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des
biens qu’ils auront acquis pendant le mariage. Cet accord fait l’objet d’un document
distinct de l’acte de mariage ».
42. Lire à ce propos, S WILLMAN, « Difficultés pratiques d’accès des femmes à la Justice », in Droits
des femmes & révolutions arabes, Julietté Gaté (dir.), Revue méditerranéenne de droit public n° 2, ed
Lextenso, 2013, p. 133 et s.
43. Chiffres 2013 de l’UNICEF, « Mutilations génitales féminines / excision: aperçu
statistique et étude de la dynamique des changements », http://www.unicef.org/
french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf
44. Colloque « Droits des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », Fès, juin 2013
http://www.kas.de/wf/doc/kas_35491-1522-3-30.pdf?13092412003
45. Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, elle est entrée en
vigueur le 3 septembre 1981. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/
fconvention.htm
46. Lire « Droits des femmes et traditions », Juliette Gaté, RRJ, 2012- 3 p. 1139.
47. Article 20.
48. Lire ainsi pour une explication très claire par l’exemple « L’égalité dans l’héritage,
entre l’Islam et la Constitution: Le cercle carré ? » , Pr. Mustapha Sehimi, L’économiste,
édition n° 4205 du 4 février 2014.
49. Article 133.
50. « La magistrature égyptienne, un système népotique rétif aux réformes », Le Monde, 25 mars
2014.
51. Rapport parlementaire français n° 1566 sur les révolutions arabes, novembre 2013, p. 61.
ABSTRACTS
Women have largely participated in the Arab Spring by protesting at the front line to claim
democracy and fundamental rights, we propose to reflect on the effects on their rights that these
protests could have produced.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
66
It appears at first, that they have not been closely associated with the reflections which have
been conducted to reforms caused by these revolutions and there has been little consideration
given to saving them a place in tomorrow’s political life.
However, the legal reforms that have been undertaken have generally devoted constitutional
equality to men and women, even though its significance remains variable and uncertain.
The reforms’ effectiveness is doubtless improved by the modifications often brought to the norm
hierarchy organisation and to controls of constitutionality, however, significant improvements
in terms of women’s access to rights remain to be realised.
Alors que les femmes ont très largement participé aux printemps arabes, manifestant en
première ligne pour réclamer démocratie et respect des droits fondamentaux, il est proposé de
réfléchir aux effets qu’ont pu produire ces mouvements sur leurs droits. Il apparaît alors qu’elles
n’ont, en premier lieu, que peu été associées aux réflexions qui ont été menées sur les réformes
qui ont été engendrées par ces révolutions et qu’il n’a que peu été songé à leur réserver une place
dans la vie politique de demain. Les réformes juridiques entreprises voient toutefois
généralement consacrée une égalité constitutionnelle entre femmes et hommes dont la portée
précise reste variable et incertaine. L’effectivité de ces réformes est aussi sans doute améliorée
par les modifications souvent apportées à l’organisation hiérarchique des normes et aux
contrôles de constitutionnalité mais des progrès notables doivent encore être réalisés en matière
d’accès au(x) droit(s) par les femmes.
INDEX
Mots-clés: Egalité - Parité - Discrimination positive - Traditions - Religion - Accès au droit -
Effectivité - CEDAW
Keywords: Equality - Positive action - Traditions - Religion - Due process of law - Efficacity -
CEDAW
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
67
« Jus post-révolution » : quelle place
pour les droits de l’homme?
Mamadou Meité
Nous aimerions remercier les Professeurs Véronique CHAMPEIL-DESPLATS et Marina EUDES qui ont
bien voulu relire cet article en suggérant les corrections nécessaires. Également, notre
reconnaissance va à l’endroit de M. Emmanuel GUEMATCHA et Mme Amélie ROBITAILLE qui, par
leurs remarques, ont permis l’amélioration de cet article. Évidemment, les lacunes qui demeurent
nous sont imputables.
« Comme dans les révolutions européennes,
l’anarchie amène la dictature ; et celle-ci
provoque d’immédiates contre-révolutions. […] Et
les révolutions succèdent aux révolutions jusqu’à
l’arrivée du tyran attendu, qui domine, durant
vingt ou trente ans, la vie nationale».
CALDERON Francisco Garcia, Les démocraties latines
de l’Amérique, Paris, Ernest Flammarion, 1912, p.
72.
1 Apportons, au préalable, quelques éléments de définition sur notre titre « Jus post-
révolution : quelle place pour les droits de l’homme ? ». Au premier abord, en ce qu’elle
emploie à la fois le latin et le français dans une même expression, la formule semble
incorrecte ou du moins mal exprimée. Généralement, il est fait usage des termes
comme « jus ad bellum » (droit à la guerre), « jus in bello » (droit de la guerre) ou
encore « jus post bellum » (droit après la guerre) pour désigner un certain type de droit
applicable en fonction du cadre rationae contextus de formation et d’application de ce
droit. Il aurait été plus juste d’employer l’expression « novae res » que les Romains
mobilisaient pour désigner la révolution1. Toutefois, cet usage aurait paru assez
rébarbatif compte-tenu du caractère inusité de cette expression latine. C’est pourquoi,
il nous a semblé approprié de former une expression néologisante, « jus post-
révolution », pour décrire une certaine réalité. Dès lors, il incombe de se focaliser sur
cette expression pour en comprendre le sens et la dynamique.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
68
2 Mobilisant une approche analogique définie comme la faculté de rapprocher deux
termes voire deux idées connexes2, l’expression « jus post-révolution » a été employée à
l’image de l’expression « jus post bellum ». Par jus post bellum, il incombe de comprendre
le droit positif (jus positum) applicable après une période de conflit armé 3. Ainsi, au
regard de cette définition, le « jus post-révolution » pourrait s’entendre, également,
comme le droit applicable après une révolution. Toutefois, nonobstant la précision
apportée à l’expression « jus post-révolution », la compréhension globale du titre de
l’article demeure toujours lacunaire, motifs pris de l’indéfinition du terme spécifique
qu’est la « révolution ». Afin de pallier cette lacune, il revient de définir la révolution
dont l’usage originel remonterait à Dante, Copernic et Galilée 4.
3 La révolution paraît difficile à définir. Dès lors, bien que cela peut paraître un brin
fastidieux, il incombe de mobiliser diverses conceptions doctrinales à l’effet d’en tirer
une définition qui nous satisferait.
4 Bien souvent, il est fait un emploi pluriel de ce terme : révolution industrielle,
révolution sexuelle, révolution verte en Inde, révolution culturelle voire révolution des
techniques d’information avec la bulle de l’Internet. Au sein de ces multiples emplois
du terme, il semble ardu de bien comprendre quelle réalité recouvre le terme
révolution. S’agit-il, à l’instar du monstre du Loch Ness, d’une idée à laquelle on fait
référence sempiternellement et qu’on a peine à appréhender, à « voir » ? Pour
répondre à cette question, il convient de faire appel à des éléments de définition.
5 Suivant le Professeur Patrick Van Inwegen, la révolution, du latin revolvere qui signifie
rouler en arrière, est un « changement par la force, irrégulier et populaire» 5d’un
gouvernement ou d’un régime politique dictatorial, patrimonial voire colonialiste 6 qui
perpétue un ordre jugé injuste. Cette définition concise mérite des éclaircissements. Au
regard de cette acception, un changement de gouvernement ou de régime politique,
pour être réputé révolutionnaire, doit remplir trois conditions cumulatives. En premier
lieu, il doit être contraint. Bien que non impérativement violente, cette contrainte est
« destinée principalement à assurer un changement des structures politiques de la
société impossible à réaliser par les voies constitutionnelles » 7. En deuxième lieu, il doit
s’opérer par voie de mécanismes extra-constitutionnels ou non constitutionnels. En
troisième lieu, le changement doit être soutenu par une majorité de la population.
Conforme à l’idée de l’auteur précité, la définition du Professeur Wilbert Moore
indique : « “La revolution”, qui est violente, implique une considérable partie du peuple 8, et
aboutit à un changement de la structure du gouvernement (…) » 9. Dans la même logique,
le Professeur Al Cohan conçoit la révolution comme « un changement violent et illégal 10
». Se focalisant sur les révolutions sociales, le Professeur Theda Skocpol estime, de son
côté, que les révolutions constituent des mécanismes « rapides 11 de transformation
basique des structures étatiques et sociales»12. Elle poursuit en précisant que ces
transformations sont portées par des révoltes de classes. En partant de l’hypothèse que
la violence est consubstantielle à la révolte étant donné que celle–ci est un bref
soulèvement armé13, il est permis de soutenir que cet essai de définition du Professeur
Skocpol trouve un appui confirmatif chez le Professeur Samuel Huntington. Ce dernier,
en effet, affirme expressis verbis: « La révolution est un changement interne rapide,
important et violent des valeurs dominantes d’une société, de ses mythes, de ses
institutions politiques, de ses structures sociales, de son leadership, de son
gouvernement et de sa politique »14. Par ailleurs, le Professeur Peter Calvert écrit que
: « Le mot “révolution” signifie spécialement un changement majeur 15 de la structure
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
69
politique et socio-économique d’un Etat du fait des efforts spontanés de ses
citoyens(…)». Il poursuit en résumant : « En un mot, il y a révolution lorsque l’usage de la
force aboutit à un changement politique fondamental »16. Pour conclure, il ajoute en
précisant dans un autre ouvrage: « l’idée de la violence est inséparable de la révolution »
17
.
6 De ces définitions diverses, il est possible d’inférer trois expressions clés qui paraissent
s’associer au terme « révolution » : « changement fondamental », « violence » et
« citoyen ou populaire ». On peut en retenir l’idée que la révolution constitue un
mécanisme populaire violent qui vise à rompre avec un ordre ancien pour instaurer un ordre
nouveau. L’instauration de ce nouvel ordre peut concerner théoriquement maints
domaines (économique, social, juridique, politique). Le domaine d’application du fait
révolutionnaire qui nous importe ici est le domaine juridique.
7 L’instauration d’un nouveau droit semble être la visée légitimatrice des mouvements
révolutionnaires. Selon le Dictionnaire Cornu, la révolution constitue « une rupture avec
l’ordonnancement juridique antérieur »18. Cette idée est confirmée par trois19 grands
évènements historiques qui, qualifiés objectivement de révolutions, ont abouti, au-delà
des changements sociaux, politiques et économiques20, à un changement de paradigme
juridique. D’abord, la révolution américaine de 1776. Cette révolution a scellé la
séparation de la Confédération américaine et du Royaume–Uni par l’adoption de la
Déclaration d’indépendance des anciennes colonies britanniques. Par le même biais,
elle a marqué l’instauration d’un droit nouveau influencé par l’idée du « droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes » dans les rapports entre les métropoles et les
colonies. Cette idée va, par la suite, se cristalliser dans les mouvements d’indépendance
des nations de l’Amérique du sud dans les années 1800 voire, également, dans la
Doctrine Monroe. Ensuite, la révolution française de 1789. Ce fait historique, marqué
par l’abrogation du droit de l’Ancien régime fondé sur les inégalités de jure et les
privilèges, a conduit à la consécration des droits de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen autour de la formule trinitaire « liberté, égalité, fraternité ».
Enfin, la révolution russe d’octobre 1917. Influencée par le marxisme, la révolution des
Bolcheviques a conduit à la création d’une nouvelle société expurgée du servage et à la
naissance d’un certain idéalisme social et humaniste : « à chacun selon ses besoins ».
Cet élan s’est s’affermi juridiquement dans l’adoption d’une nouvelle constitution qui a
reconnu les droits des ouvriers et des paysans considérés membres du prolétariat et du
lumpenprolétariat21.
8 Le Droit a ainsi constitué l’impetus de plusieurs révolutions. De façon plus précise, au-
delà du Droit, en tant que système objectif, il s’est agi, pour les révolutionnaires, de
vouloir établir un ordre juridique plus humain soucieux du bien-être des individus par
la reconnaissance et la sauvegarde des libertés donc des droits de l’homme. Au soutien
de cette idée, qu’il suffise de rappeler les mots célèbres du Marquis de Condorcet
prononcés dans un contexte révolutionnaire : « Le mot “révolutionnaire” ne peut
s’appliquer qu’aux révolutions dont la liberté est le but »22. Aujourd’hui, le slogan, «
justice, dignité et liberté ! » des révolutionnaires en Tunisie y fait écho. Par conséquent,
vouloir s’interroger sur la place des droits de l’homme dans un contexte post-
révolutionnaire pourrait sembler sans intérêt tant cette place va de soi.
9 On peut toutefois dépasser cette première impression en s’interrogeant plus précisément
sur le fait de savoir comment la post-révolution aménage la place réservée aux droits. Pour ce
faire, on s’appuiera sur une analyse générale de la doctrine ainsi que sur des exemples
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
70
concrets contemporains de : révolutions récentes que sont les révolutions arabes. Il ne
sera pas question de réfléchir sur ces révolutions in se qui, tout bien considéré, sont fort
disparates et différentes. Il importera, tout simplement, de s’y référer pour illustrer
certaines idées.
10 En premier lieu, il s’agira de montrer que la volonté de faire table rase de « l’ancien
régime » peut, à la faveur de certains mécanismes, aboutir, paradoxalement, à des
violations des droits de l’homme(I). En considération de cette menace attentatoire à
l’idéal de la « libération de l’homme »23, il incombera, en second lieu, de mettre en relief
les procédures propices à la sauvegarde des droits de l’homme, et partant du succès de
l’idéal révolutionnaire (II).
I. LA POST-RÉVOLUTION ET LES RISQUES DE
VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME
11 Suivant le Professeur Crane Brinton, « la révolution marque une nouvelle ère » et « met
fin pour toujours aux abus de l’ancien régime »24. Cette affirmation de principe semble
ne guère se confirmer dans tous les cas d’espèce. En effet, deux risques fondamentaux
paraissent constituer des menaces à l’instauration d’une période post-révolutionnaire
favorable au respect des droits de l’homme. Ces risques sont d’une part les excès de la
lustration (A), et d’autre part la justice défaillante(B).
A. Le cas de la lustration
12 Le mot « lustration » a des origines romaines. Selon The Oxford Classical Dictionary, son
étymologie dérive du latin lustrare et lustrum. Il désignait, dans la Rome antique, une
cérémonie sacrificielle de purification qui, accompagnée de musiques et de danses,
avait pour objectif d’éloigner les démons25. Nonobstant son caractère antique,
l’expression regagne en intérêt avec l’adoption, par la Tchécoslovaquie, de la première
loi de lustration en date du 4 octobre 199126. A la lumière de l’économie des dispositions
de cette loi, le Professeur Romain David estime qu’il incombe d’avoir une définition
plus formelle et procédurale de la lustration. Ainsi, cet auteur la conçoit comme « un
mécanisme de recherche et d’examen visant à trouver des informations sur la vie
passée de certaines personnes »27. Sous cet angle, la lustration « consiste à jeter la
lumière sur le passé totalitaire des personnes qui occupent ou doivent occuper des
postes importants dans (un) nouvel État démocratique »28. Ce processus d’investigation,
stricto sensu, est qualifié de « vetting ». Étant donné que la finalité de ces recherches
était l’impossibilité, pour les individus concernés, de prétendre à l’exercice des charges
publiques, il revient d’avoir à l’esprit cette exclusion et de considérer la lustration et le
vetting, finalement, comme une même et unique réalité dont le but est la purification
voire la purge29 des administrations. Cette volonté purificatrice assignée à la lustration
semble être partagée par la Professeure roumaine Lavinia Stan qui affirme en ces
termes : « Durant les années 1990, la lustration a été réglementée en Allemagne et en
Tchécoslovaquie comme une procédure accusatoire visant à purger l’administration
publique postcommuniste des anciennes personnalités du régime communiste » 30.
13 Outre la Tchécoslovaquie, maints États de l’Europe centrale et orientale voire de
l’Amérique latine se sont appropriés la lustration par l’adoption des lois ad hoc. Pour ces
pays, la lustration a pour principal objectif d’empêcher des collaborateurs d’un défunt
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
71
régime, soupçonnés de violation des droits de l’homme, de participer à la vie des
nouvelles institutions31. Cette vision de la lustration semble être partagée par le
Professeur Monica Nalepa qui estime qu’elle participe de la création d’un « contrat de
confiance » entre les élites politiques et le peuple32, car, par sa transparence, en
éclairant le passé des acteurs politiques, elle jauge leur niveau d’engagement respectif
en faveur de la démocratie et des droits de l’homme. Dans la même logique, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa résolution 1096 du 27 juin 1996, indique
que « les lois de lustration (…) sont conformes aux principes d’un État de droit(…) » 33.
Somme toute, en théorie, la lustration semble constituer un mécanisme qui facilite la
transition démocratique des États post-révolutionnaires. Pourtant, dans les faits, ce
mécanisme a donné lieu à une véritable dérive attentatoire à la protection des droits de
l’homme. Dans sa parution en date du 24 février 1992, The New York Times, parlant du
cas de la mise en accusation de l’ancien secrétaire du Parti communiste tchèque,
Zdenek Mlynar, par le Ministère de l’intérieur pour trahison en lien avec l’invasion
soviétique de 1968, estimait que « son cas symbolise une sorte de vengeance plaçant la
Tchécoslovaquie en tête des pays de l’Europe de l’Est dans la purge anti-communiste ».
14 Toujours pour le même pays et pour des raisons similaires, Mme Jeri Haber, co-
fondatrice de Human Rights Watch, exprimait son indignation à travers un article au
titre évocateur paru dans The New York Review of Books dans sa publication du 23 avril
1992 : « Witch Hunt in Prague »34.Ces critiques ont conduit à une désapprobation de la
Communauté internationale qui estimait que la loi tchèque précitée créait une
discrimination à l’embauche, et par conséquent violait les droits de l’homme 35.
15 Par ailleurs, d’une manière générale, la Cour européenne, saisie par plusieurs
requérants au motif que les procédures relatives à l’application des lois de lustration
violaient leurs droits, à travers une jurisprudence constante, a averti timidement les
États mis en cause en ces termes : « (…) Si un État adopte des mesures de lustration, il
doit s’assurer que les personnes affectées par ces mesures bénéficient des garanties
procédurales reconnues par la Convention (…) »36.
16 Nonobstant cette position des juges de la Convention européenne des droits de
l’homme (CEDH), la lustration a donné lieu, à plusieurs reprises, à des violations des
articles 837, 638 et 1439 du texte européen. Fort de ces mises en garde répétées de la Cour
européenne, le juge constitutionnel polonais, tout particulièrement, a indiqué les
conditions que devait respecter une loi de lustration pour être conforme aux exigences
d’un État de droit : « La loi de lustration conforme aux principes du fonctionnement
d’un État démocratique est supposé satisfaire (…) aux conditions suivantes : a) la
lustration ne sert qu’à éliminer ou à diminuer notablement les dangers pour une
démocratie stable et libre (...) b) la lustration ne peut jamais servir à punir, ni à faire payer
les fautes, ni à la vengeance40(…) c) la lustration ne peut pas être appliquée par rapport
aux postes dans les organisations privées ou semi-privées(…) d) la défense d’exercer (d)es
fonctions suite à la lustration devrait s’appliquer pendant une période raisonnable de temps (…)
g) la lustration doit respecter certaines) garanties procédurales.(…)» 41.
17 Cependant, ces conditions ne semblent pas être respectées par toutes les lois de
lustration. L’illustre tout particulièrement le cas contemporain de la Tunisie. Cet État,
après la Révolution du Jasmin, a adopté une série de lois à l’effet de rendre inéligibles,
pour une période de dix ans, les anciens membres de l’ancien parti au pouvoir, en
l’occurrence le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (ci-après RCD). En effet,
le décret-loi n°2011-35, en date du 10 mai 2011, portant « élection d’une Assemblée
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
72
nationale constituante » dispose, en son article 15, qu’ : «(…) Ont le droit de se porter
candidat à l’assemblée nationale constituante tout : électeur âgé au moins de 23 ans(…)
Ne peut être candidat toute personne ayant assumé une responsabilité au sein du
gouvernement à l’ère du président déchu exceptés les membres qui n’ont pas
appartenu au RCD et toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des
structures du RCD à l’ère du président déchu; toute personne ayant appelé le président
déchu à être candidat pour un nouveau mandat en 2014 ».
18 Un autre Décret n°2011-1089, en date du 3 août 2011, portant « détermination des
responsabilités au sein des structures du RCD (…)» confirme l’économie de l’article 15
du décret n°2011-35 lorsqu’en son article premier, il précise : « Est inéligible aux
élections de l’Assemblée nationale constituante, toute personne ayant assumé une
responsabilité au sein des structures du RCD (…) ».
19 Outre la Tunisie, il est également pertinent d’invoquer le cas lybien. Dans son élan
révolutionnaire, le Parlement de cet État a adopté une loi sur l’exclusion politique des
anciens collaborateurs de l’ancien régime. En date du 5 mai 2013, cette loi, votée par le
Parlement lybien, sous la menace des milices armées, exclut, pour une période de dix
ans, les personnes ayant occupé des postes de responsabilités sous l’ancien régime
depuis sa prise de pouvoir en 1969 jusqu’à sa chute en 2011 42.
20 A l’évidence, au vu de leur généralité et de leur caractère rationae personae collectif, ces
deux lois de lustration sont loin des recommandations qu’a pu formuler, de son côté, le
Tribunal constitutionnel polonais. Quoi qu’il en soit, elles aboutissent à une violation
des dispositions fondamentales de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples43et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 44. En
conséquence de toutes ces défectuosités, ces lois ont emporté les critiques de Human
Rights Watch. Concernant la Tunisie, cette organisation a pu affirmer au sujet des lois de
lustration : « (elles) prépar(ent) le terrain pour l’exclusion politique quasi-totale de
milliers de personnes sur la base de leur affiliation politique » 45. Cette critique rejoint
celle du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (ci-après HCDH)
qui, dans une étude sur le sujet, indiquait verbatim: « le vetting (donc la lustration) doit
être basée sur l’évaluation d’une conduite individuelle. Les purges et autres limogeages
massifs sur le seul fondement d’une affiliation à un groupe risquent d’avoir une portée
trop large, et porter préjudice à des personnes qui n’ont aucune responsabilité
individuelle dans les abus du passé (…). Un tel mécanisme de purge collective viole les
règles les plus fondamentales du procès équitable. Qui plus est, il risque de fragiliser les
réformes recherchées »46.
21 En parlant de la lustration, les mots métaphoriques d’un parlementaire roumain
semblent symptomatiques des dérives qui paraissent pouvoir affecter ce mécanisme : «
l’hygiène en politique est aussi utile qu’elle l’est dans notre vie personnelle » 47.
Pourtant, pour reprendre l’opinion du juge Spielmann qui mettait en exergue la vacuité
des mécanismes d’exclusions politiques, « l’Histoire nous a démontré (…) que la
République de Weimar ne s’est pas effondrée à cause de quelques fonctionnaires » 48. En
un mot, les fourvoiements de la lustration ne facilitent guère la réconciliation et la paix
sociale. Ces aspirations ultimes, essentielles au développement des communautés
nationales, risquent de rester des vœux pieux que la justice post-révolutionnaire
généralement lacunaire, donc défaillante, peinera à cristalliser.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
73
B. Les défaillances de la justice post-révolutionnaire
22 Tout État révolutionnaire doit faire face à son passé. En effet, il doit solder le passif de
l’ancien régime caractérisé par des abus multiples. Certainement, cette exigence
d’assainissement doit se faire sans un esprit vindicatif. Par conséquent, il importe de
retoquer la lustration au vu de ses excès. Afin de construire un nouvel ordre le juste
milieu est une voie à privilégier. Voie de la sagesse selon la doctrine platonicienne, le
juste milieu permet de ne point épouser le radicalisme et l’extrémisme. Il permet de
contenir les effets les plus dommageables de la révolution si l’on en croit l’historien
Patrice Gueniffey qui, parlant de la « Terreur », indique : « Elle est le produit de la
dynamique révolutionnaire (de 1789) et, peut-être, de toute dynamique
révolutionnaire. En cela, elle tient à la nature même de la Révolution (de 1789), de toute
révolution »49.
23 Le juste milieu faciliterait, dès lors, la construction d’une société qui se débarrasse de
sa mauvaise conscience en privilégiant la justice. Laquelle justice, en vertu de l’adage
latin « jus est ars boni et aequi », doit respecter les principes de la transparence, de
l’indépendance et du juste. La justice post-révolutionnaire ne doit point être
vengeresse. Elle doit répondre aux principes de la justice équitable. Au-dessus de la
mêlée, il lui importe d’être conforme à ces principes.
24 Pourtant, en dépit de ces exigences évidentes, l’Histoire révolutionnaire semble se
répéter. Du 10 mars 1793 au 28 juillet 1794, la Révolution française a connu sa « part
maudite »50 avec la « Terreur » et le « Tribunal révolutionnaire » qui, selon les termes
de Jean-François Fayard, n’était autre chose qu’ « une “chambre d’enregistrement” de
ce qui avait été décidé, soit par la Convention (…), soit par les meneurs de la Révolution
(…) »51.
25 De même, la Révolution d’octobre a connu sa « Grande terreur » 52 des années 1930
accompagnée des « procès de Moscou ». Vraisemblablement, les révolutions
contemporaines ne sont guère caractérisées par des déviances judiciaires à grande
échelle. Toutefois, elles ne sont pas indemnes de critiques. Aux fins d’illustration, la
Révolution tunisienne servira d’échantillon.
26 « La révolution tunisienne est inaugurale ». Pour reprendre l’idée du Professeur Jamil
Sayah : « Elle a ouvert (dans le monde arabe) une séquence historique en laissant
indécis le contenu de sa propre évolution »53.
27 Ainsi donc, la révolution tunisienne ne constitue pas en soi un Deus ex machina qui
viendrait résoudre toutes les problématiques propres à l’ancien ordre renversé. Tout
dépend de ce que les révolutionnaires en feront. Cette révolution sera-t-elle conçue
comme un instrument de vengeance ou d’instauration d’un nouveau paradigme
juridique ? A ce stade, en dépit de l’adoption récente d’une Constitution moderne 54, il
est impossible d’articuler une réponse définitive satisfaisante. Toutefois, à la lumière de
la réalité judiciaire post-révolutionnaire qui méconnait plusieurs principes du procès
équitable, il est permis de soutenir, pour le moment et provisoirement, que la
dimension vindicative de cette révolution semble avoir une préséance sur celle relative
à l’instauration d’un Etat de droit. La méconnaissance du droit à un délai raisonnable de
procédure en est un des signes les plus symptomatiques.
28 Le délai raisonnable est en effet un laps de temps qui s’écoule entre deux faits
instantanés : d’une part, l’arrestation, l’inculpation et l’ouverture des enquêtes
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
74
préliminaires55 contre une personne (dies a quo), et d’autre part le jugement définitif de
condamnation ou de relaxe (dies ad quem)56. « Gage d’une bonne justice, voire d’une
bonne administration de la justice »57, le délai raisonnable a pour visée la célérité du
procès. Autrefois, la lenteur procédurale était considérée comme un gage qui « donne le
temps de déjouer les calculs d’un adversaire trop habile et rassure la conscience du
juge »58.
29 Cependant, aujourd’hui, cette conception est devenue caduque. Pour emprunter les
mots du Professeur René Chapus, « juger bien, c’est d’abord (…) juger vite » 59. La
célérité du procès participe de l’équité du procès, car pour reprendre l’économie de cet
adage anglais « justice delayed, justice denied ». Une justice équitable et saine doit solder
dans un temps décent les instances qui lui sont soumises. Ceci permet, suivant l’opinion
des juges de Strasbourg, aux accusés de ne point demeurer « pendant un temps trop
long sous le coup d’une accusation et qu’il soit décidé sur son bien-fondé » 60.
30 Le droit au délai raisonnable de procédure vise tout particulièrement à éviter les cas de
privations arbitraires de liberté. Ces privations peuvent être multiformes : détention,
restriction à la liberté d’aller et de venir… En plus de la Convention de Strasbourg, son
caractère de droit fondamental est confirmé par sa reconnaissance dans divers
instruments conventionnels : la Convention américaine des droits de l’homme (ci-après
CADH) en son article 7§5 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-
après Charte ADHP) en son article 7. §1.d. Son appréciation, de l’avis des juges africains,
américains et européens, dépend des circonstances de chaque espèce. Ainsi, le juge
européen, en l’affaire X c. France, précise : « Le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (…) » 61.
31 Dans la même logique, le juge américain, en l’affaire Genie Lacayo c. Nicaragua, estime
qu’il apprécie la durée d’un procès en prenant en compte : « (…) trois points (…) a) la
complexité de l’affaire ; b) l’activité judiciaire du requérant ; et c) le comportement des
autorités judiciaires de l’Etat mis en cause »62.
32 La position de l’organe africain de sauvegarde de la Charte ADHP n’est pas différente 63.
Ainsi, le délai raisonnable permet au juge de statuer avec rapidité « tout en se laissant
le temps nécessaire pour la réflexion »64.
33 Ces considérations indiquées, il incombe maintenant de préciser que la Tunisie est
partie à la Charte ADHP depuis le 22 avril 1983. Partant, les dispositions de cet
instrument international ont une portée juridique contraignante au sein de l’ordre
juridique tunisien. Ainsi, le droit au respect d’un délai raisonnable de procès s’impose
aux organes judiciaires de l’Etat tunisien. Toute méconnaissance pourrait engager sa
responsabilité. En dépit de ces évidences, la justice de ce pays semble n’accorder qu’un
intérêt relatif au délai raisonnable dans les procédures intentées contre les anciens
fonctionnaires du régime bénaliste. La justice post-révolutionnaire tunisienne paraît
enrhumée du fait de son caractère parfois expéditif65. Au soutien de cet argument, il
suffit de mentionner le cas le plus révélateur parmi plusieurs 66.
34 Mohamed Ghariani, ancien secrétaire général du RCD, fut arrêté en 2011. Il lui est fait
grief d’avoir commis diverses infractions économiques dans le cadre de ses activités
politiques : détournement et extorsion de fonds, spoliations de biens… En juillet 2013, il
bénéficie d’une mesure de liberté provisoire assortie d’une interdiction de voyager et
de s’afficher dans les lieux publics. Ainsi donc, cette mesure ne met pas fin à la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
75
procédure. En effet, aux termes de l’article 88 du Code de procédure pénal tunisien, il
est précisé que : « L’ordonnance de mise en liberté provisoire de l’inculpé n’empêche
pas le juge d’instruction ou la juridiction saisie de décerner un nouveau mandat de
dépôt si cette mesure est rendue nécessaire par le fait que l’inculpé, convoqué, ne
comparaît pas ou par suite de circonstances nouvelles et graves ».
35 Au regard de sa date d’arrestation et des griefs reprochés, il est possible de soutenir
que Mohamed Ghariani voit son droit à un délai raisonnable méconnu. Cette
méconnaissance emporte une violation de sa liberté de circulation. Partant, cette
situation ne parait guère se conformer au dictum de la Commission de Banjul qui, en
l’espèce Constitutionnal Rights Project c. Nigeria, estimait : « (...) Le procès doit se faire le
plus rapidement possible, afin de minimiser les effets néfastes sur la vie d’une personne
qui, en fin de compte, peut être innocente »67.
36 En somme, le traitement des abus de l’ancien régime pré-révolutionnaire est complexe.
Entre amnésie et justice pénale, le choix est, bien souvent, cornélien. L’amnésie n’est
guère pédagogique. Elle oublie les victimes et sanctifie les bourreaux. Par conséquent,
la justice pénale semble s’imposer. Toutefois, elle ne doit point être un instrument de
vengeance au profit des révolutionnaires. Il devient dès lors capital de maintenir un
équilibre propice au respect des droits des damnés de la révolution, même si cet
équilibre paraît difficile à tenir. Certains faits révolutionnaires qui ont pu être observés
en Tunisie voire en Lybie témoignent de ce que cet équilibre ne semble pas être
respecté. Dans ces deux États, on constate une justice défaillante et une justice de
vainqueurs discriminatoire. Pourtant, pour reprendre les mots de Mme Marina Eudes,
dans ce genre de contexte révolutionnaire donc transitionnel, « c’est tout le droit des
droits de l’homme, notamment l’important principe de non discrimination, qui doit
être pris en compte par les promoteurs de la justice transitionnelle s’ils veulent
assumer la légitimité de celle-ci auprès des populations précisément privées de ces
garanties pendant plusieurs années »68.
37 La justice pénale, au vu de son application défectueuse dans un contexte post-
révolutionnaire, ne paraît donc pas constituer la voie idéale pour la construction d’un
État de droit post-révolutionnaire. La lustration, mécanisme non pénal, compte tenu
des dévoiements auxquels donne lieu son application, doit également être écartée.
Alors, comme s’interrogeait Lénine, « Que faire ? »69.
II. Les mécanismes de transition post-révolutionnaire
propices au respect des droits de l’homme
38 La poursuite pénale, après un passé caractérisé par une violation des droits de
l’homme, ne constitue pas un impératif. Partant, la post-révolution ne doit pas
constituer une grande messe d’instances inquisitoriales aux fins de punir certaines
personnes identifiées. Le cas échéant, la construction d’un État de droit se fragiliserait
et rendrait difficile la réconciliation de la communauté nationale. Comme le soutenait
le Professeur argentin Carlos Nino, après la disparition d’un régime peu respectueux
des valeurs humaines, la volonté de poursuivre pénalement certains individus pour
violation des droits de l’homme dépend de ce que veulent les nouvelles autorités. Nino
soutient, qu’au fond, tout est question de contexte70. Cette idée est également partagée
par Richard Goldstone. Le juge sud-africain écrit : « La poursuite pénale est la forme la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
76
plus commune de la justice. Cependant, ce type de poursuite n’est ni la seule forme de
justice ni forcément la mieux appropriée dans toutes les situations » 71.
39 En considération du fait que la société post-révolutionnaire est généralement polarisée
entre les révolutionnaires victorieux et les contrerévolutionnaires, il importe donc de
privilégier la justice restauratrice (restorative justice) qui vise à favoriser la
réconciliation, le respect des droits de l’homme de tous les protagonistes et la paix.
Cette forme de justice prend sa source originellement dans les réflexions concernant
l’amélioration de la justice punitive des États72. Elle prolonge la justice pénale73, favorise
le pardon entre les auteurs des violations des droits de l’homme, les victimes et la
communauté nationale74. Pour les Professeurs Stephanos Bibas et Richard Bierschbach,
elle atténue le caractère « dogmatique » et figé de la justice traditionnelle qui n’offre
pas l’opportunité aux auteurs des violations d’exprimer leurs regrets, leur contrition et
leurs excuses75. Par conséquent, elle donne une plus grande satisfaction aux victimes
que la justice punitive pénale76. Transposée dans le domaine de la justice transitionnelle
post-révolutionnaire, elle peut « emprunter deux voies »77: celle des commissions
vérité (A) et celle relative aux mécanismes de réparation(B).
A. La voie des commissions vérité78
40 Les commissions vérité font référence à des organes autonomes d’investigation qui ont
pour fonction d’enquêter sur des violations passées des droits de l’homme dans un État
donné79. Ce type d’organe a été mis en place dans plusieurs États lors de leur phase de
transition vers un régime démocratique. Ce fut le cas de l’Afrique du Sud, de
l’Allemagne, de l’Argentine, du Guatemala, de El Salvador voire du Rwanda 80. Il s’agit,
en l’espèce, d’organes de transition post-révolutionnaire. N’étant pas des organes
juridictionnels81, ils n’ont guère pour vocation de poursuivre pénalement des personnes
en prononçant des sanctions pénales sur le fondement des infractions qui leur sont
reprochées82. Le but précis des commissions vérité est double83.
41 D’une part, elles ont pour mission d’établir la vérité objective relative aux anciens abus.
Ceci permet à une nation de s’immuniser contre l’éventuelle répétition des mêmes abus
dans le futur84. Pour le juge Charles Goldstone : « Ce qui est fondamental à toutes les
formes de justice est la connaissance de ce qui s’est passé que soit par le biais d’une
procédure criminelle ou par celle d’une “Commission-Vérité”» 85.
42 D’autre part, contribuant à la promotion de la réconciliation 86 des peuples, les
commissions-vérités visent à faciliter la réintégration, dans les communautés
nationales, des personnes ostracisées parce que soupçonnées de collaboration avec
l’ancien régime déchu. Car, tout bien considéré, la période post-révolutionnaire
transitionnelle doit chercher l’apaisement et la réinsertion des collaborateurs de
l’ancien régime. Le choix contraire comporte des risques étant entendu qu’il conduit à
l’exclusion absolue de certaines personnes. Un tel choix peut conduire à une forte
réaction contrerévolutionnaire voire à la naissance d’un conflit armé 87.
43 Convaincue de ces avantages, l’Assemblée nationale constituante tunisienne, pour
reprendre le cas de cet État, a adopté, en date du 12 décembre 2013, la quasi-totalité des
dispositions du projet de loi portant création d’une commission vérité baptisée
« Instance de la vérité et de la dignité » (ci-après Instance). En vertu de l’article 18 dudit
projet de loi, cette Instance, qui jouit « d’une autonomie financière et administrative »,
dispose d’une compétence rationae temporis comprise entre le 1 er janvier 1955 et la date
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
77
de parution officielle de la loi au Journal officiel de la République Tunisienne (ci-après
JORT)88. Le législateur tunisien a délimité, en l’article 19 du projet de loi, à quatre ans le
mandat de l’Instance. Toutefois, ce mandat peut être reconduit pour une année
supplémentaire sur le fondement d’une décision justifiée de l’Instance qui sera soumise
au Parlement89. En outre, aux termes de l’article 41 du projet de loi, est portée à charge
de l’Instance l’obligation d’accomplir les missions suivantes : « Accéder aux archives
publiques et privées ; enquêter au sujet de toutes les infractions tombant sous le coup
de la présente loi, et cela par tous les moyens et mécanismes qu’elle juge nécessaires
tout en garantissant les droits de la défense ; auditionner les victimes d’infractions et
réceptionner leurs plaintes ; enquêter sur les cas de disparition forcée restés sans suite,
sur le foi des communiqués et des plaintes qui lui seront présentés ; et déterminer le
cas des victimes ; délimiter les responsabilités90 des organes de l’État ou de toutes
autres parties, dans les infractions tombant sous le coup (…) de la loi ; en clarifier les
causes et proposer des remèdes propres à prévenir la réédition de ces infractions, dans
l’avenir, collecter des données, repérer, recenser, confirmer et archiver les infractions,
en vue de constituer une base de données ».
44 Dans le but d’accorder une réparation aux victimes, il est mis en place un « Fonds de
dignité et de réhabilitation des victimes de l’oppression ». A la fin de sa mission,
l’Instance, suivant l’économie de l’article 45 du projet de loi adopté, émettra : « Les
recommandations et suggestions qu’elle juge appropriées en matière de réformes
politiques, administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, médiatiques,
éducationnelles et de dépoussiérage administratif et autre, en vue de prévenir toute
réédition de la répression, de la tyrannie, de la violation des droits de l’homme et de la
gestion malsaine des fonds publics ; les mesures qui peuvent être prises à l’effet de
favoriser la réconciliation nationale et de protéger les droits des individus et tout
particulièrement les droits de la femme et de l’enfant ; les recommandations,
suggestions et mesures destinées à consolider l’édification démocratique et à concourir
à la construction de l’État de droit ».
45 Certes, souvent, la mise en place des commissions vérité répond à un souci de
légitimation d’un nouveau régime. Dans ces cas, elles sont appréhendées par les
nouveaux acteurs non pas comme une fin en soi, mais comme un simple moyen en vue
d’atteindre des objectifs politiques bien définis. Toutefois, en l’espèce, par la mise en
place de l’Instance, la Tunisie se donne une chance de réussir sa révolution. L’Instance
doit, en effet, avoir une préséance sur les procédures inquisitoriales dont le relent
vindicatif ne peut être considéré comme optimal pour la construction d’un État de droit
post-révolutionnaire respectueux des droits de l’homme. Il est d’ailleurs ici possible de
s’appuyer sur le cas lybien. Cet État, nonobstant sa révolution, vit une situation
défavorable au respect des droits de l’homme91. Ayant voué aux gémonies les anciens
collaborateurs du régime déchu, la post-révolution lybienne a accordé une place
exorbitante aux acteurs de la révolution en faisant d’eux les seules forces de la vie de la
nation. Or, ce déséquilibre est préjudiciable à la mise en place de ce que Montesquieu
appelait un régime vertueux, et risque de favoriser l’échec de la révolution lybienne. Il
importerait donc que la Lybie minimise la place de la justice punitive dans le traitement
des abus du régime de Kadhafi par la mise en place d’une justice restauratrice. Cette
dernière doit être privilégiée d’autant plus qu’elle facilite le dialogue entre les
bourreaux et les victimes. Qui plus est, elle accorde une plus grande importance aux
victimes par la reconnaissance, dans leur chef, de divers mécanismes de réparations.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
78
B. La voie des mécanismes de réparation
46 Reconnue par plusieurs instruments conventionnels 92, « la réparation a pour but de
rendre justice aux victimes »93. Il s’agit d’ « un droit revenant aux victimes des violations
flagrantes des droits de l’homme et des violations graves du droit international
humanitaire »94. Suivant le Professeur Catherine Kessedjian, la réparation « fait partie
intégrante d’une certaine conception de la justice reconstructive, symbolisation de la
paix en ce qu’elle permet à l’auteur du crime d’exprimer une volonté de réparer et à la
victime une acceptation de la réparation »95.
47 Il s’agit d’un mécanisme au bénéfice des victimes reconnu par les droits positifs de la
quasi-totalité des États à travers le régime de la responsabilité civile 96. En droit
international, il trouve son fondement justificatif dans le régime de la responsabilité
des États. Ainsi, réaffirmant ce que le Professeur Paul Reuter nommait « l’unité de la
théorie de la responsabilité (acte illicite- imputation à un sujet de droit international-
dommage- réparation) »97, les juges de l’ancienne Cour Permanente de Justice
Internationale (ci-après CPJI), en l’affaire Usine de Chorzów, précisent : « C’est un
principe de droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation
de réparer dans une forme adéquate. La réparation est donc le complément
indispensable à l’application d’une convention, sans qu’il soit nécessaire que cela soit
inscrit dans la convention elle-même »98.
48 A la lumière de ce dictum, il est rappelé que toute violation du droit international
emporte à la charge de l’État présumé responsable le devoir de réparer 99. Plus
précisément, à la faveur du mécanisme d’imputabilité, « l’obligation de l’État
responsable de réparer intégralement concerne le “préjudice causé par [un] fait
internationalement illicite” »100. Ce préjudice peut avoir une dimension à la fois
matérielle et morale. La CPJI, se prononçant sur le fond de l’espèce Usine de Chorzów, a
eu à donner de plus amples détails : « Le principe essentiel, qui découle de la notion
même d’acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale (…) est que la
réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et
rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis.
Restitution en nature, ou si elle n’est pas possible, paiement d’une somme
correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, des
dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la
restitution en nature ou le paiement qui en prend place (…) » 101.
49 Somme toute, la réparation a pour objet de « mettre la victime du fait illicite dans la
situation qui serait la sienne si ce fait n’avait pas eu lieu » 102. Quant à sa mise en œuvre,
elle peut prendre différentes formes. Le Professeur James Crawford, rapporteur spécial
de la Commission du droit international (ci-après CDI) sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, dans son rapport finalisé en 2001, estime, en
prenant en compte l’opinion de la CPJI en l’affaire Usine de Chorzów, que la réparation
peut être mise en œuvre à travers la restituo in integrum (la restitution), l’indemnisation,
la satisfaction103.
50 Au-delà des relations interétatiques, ces formes de réparation ont été adoptées par le
droit international des droits de l’homme. Aux fins d’octroi des réparations dans cette
branche de droit, il importe, au préalable, de déterminer la « victime » voire « la
potentielle victime »104. Pour le Professeur Cherif Bassiouni : « “La victime” est une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
79
personne qui, par suite d’actes ou d’omissions constituant une violation des normes du
droit international humanitaire ou des droits de l’homme, a subi, individuellement ou
collectivement, un préjudice, notamment une atteinte à ses droits fondamentaux. “Une
victime” peut être également une personne à la charge ou un membre de la famille
proche ou du ménage de la victime directe ou une personne qui, en intervenant pour
venir en aide à une victime ou empêcher que se produisent d’autres violations, a subi
un préjudice physique, mental ou matériel »105.
51 Par conséquent, les réparations prennent en compte les victimes directes et indirectes.
Elles ont pour objet de faire disparaître les effets que la violation des droits emporte au
détriment de l’individu106. Aux formes de réparation établies par la CDI, le corpus des
droits de l’homme en rajoute d’autres. Les juges de San José de la Convention
américaine des droits de l’homme estiment: « La réparation est un terme générique qui
comprend différentes formes par lesquelles un État peut faire à sa responsabilité
internationale. Ces formes incluent : la restitutio in integrum, l’indemnisation, la
satisfaction, les garanties de non répétition »107 voire la réhabilitation.
52 Dans une période post-révolutionnaire, le mécanisme des réparations doit répondre
aux besoins et aux souhaits des victimes108. Ce faisant, il permet de placer les victimes
au centre du processus de construction d’un État de droit, car la peine classique ne
satisfait pas la victime en raison son caractère inadapté 109. Au regard de ce fait, la
justice restauratrice, grâce aux processus de réparation (restitution, indemnisation),
contribue à l’apaisement de la communauté nationale, et favorise, ainsi, la mise en
place d’une société réconciliée avec elle-même.
53 En définitive, il importe de retenir deux idées essentielles de cette brève analyse. En
premier lieu, la réponse judiciaire voire pénale ne constitue pas la meilleure réponse
dans le traitement des abus des anciens régimes prérévolutionnaires. Bien souvent,
quoique animés par de bons sentiments, les acteurs de l’ère post-révolutionnaire
commettent des abus qui menacent l’intégrité des droits de l’homme. Ce faisant, la
construction d’un État de droit devient plus difficile. En deuxième lieu, bien que
conscient de son caractère iconoclaste, la voie de la justice restauratrice a été suggérée
en vue de pallier les défectuosités de la voie pénale. Cette forme de justice, à travers les
mécanismes des commissions vérité et des réparations, est plus susceptible de faciliter
la construction d’un État de droit respectueux des droits de l’homme après une
révolution.
NOTES
1. HATTO Arthur, « ”Revolution”: An Enquiry into the Usefulness of an Historical Term », Mind,
1949, vol. 58, n°232, pp. 495-517, p. 500.
2. PERELMAN Chaïm, Logique juridique, Paris, Dalloz, 1999, pp. 55-56 ; CHAMPEIL-DESPLATS Véronique,
Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, pp. 363-365.
3. STAHN Castern, « Just Post Bellum: Mapping The Disciplines », American University International
Law Review, 2008, vol. 23, n° 2, pp. 311-347, p. 312 ; OSTERDAHL Inger, VAN ZADEL Esther, « What Will
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
80
Jus Post Bellum Mean? Of New Line and Old Bottles », Journal of Conflict and Security Law, 2009, vol.
14, n° 2, pp. 175-207, p. 176.
4. NEUMANN Sigmund, « The International Civil War », World politics, 1949, vol. 1, n° 3, pp. 333-350,
pp. 335 et 336.
5. VAN INWEGEN Patrick, Understanding Revolution , Londres, Lynne Rienner, 2011, p. 4; STONE
Lawrence, « Theories of revolution », World Politics, 1966, vol. 18, n° 2, p. 159, pp. 159-176, p. 159.
Nous soulignons.
6. SANDERSON Stephen K., Revolutions. A Worldwide Introduction to Social and Political Contention, 2 e
édition, Londres, Paradigm Publishers, 2010, p. 201.
7. MOMTAZ Djamchid, « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non
internationaux », RCADI 2001, t. 292, pp. 21-139, p. 21.
8. Nous soulignons.
9. MOORE Wilbert E., Social Change, New Jersey, Prentice-Hall, 1963, p. 82.
10. COHAN Al S., Theories of Revolution. An Introduction, Londres, Nelson, 1975, p.13.
11. Nous soulignons.
12. THEDA Skocpol, States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China,
Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 4.
13. GARNER Bryan, Garner’s Dictionary of Legal Use, 3e édition, Oxford, Oxford University Press, 2011.
14. HUNGTINGTON Samuel, Political Order in Changes Societies, New Haven, Yale University Press,
1968, p. 264.
15. .Nous soulignons. Le même auteur soutient, à bon droit, que le changement, le transfert de
pouvoir constitue la caractéristique majeure qui différencie la violence révolutionnaire des
autres formes de violence. Voy. CALVERT Peter, A Study of Revolution, Oxford, Clarendon Press, 1970,
p. 29.
16. Nous soulignons.
17. CALVERT Peter, Terrorism, Civil War and Revolution. Revolution and International Politics, New York,
Continuum, 2010, pp.12-13; Voy.également MUESEL Alfred « Revolution and Counter-Revolution »,
Encyclopedia of the Social Science, 1934, vol. 13, pp.367-376, p.367. Cet auteur estime à la page citée
que: « (…) The ideas of revolution and violence appeared to be so closely connected ».
Voy.CHALMERS Johnson, Revolution and the Social System, San Francisco, Hoover Institution Studies,
1964, p. 6.; Voy. YODER Dale, « Current Definition of Revolutions », American Journal of Sociology,
1926, vol. 32, n° 3, pp. 433-441, p. 437.
18. CORNU Gérard, dir., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2007, p. 833.
19. La révolution mexicaine a été écartée, car une partie de la doctrine conteste le caractère
révolutionnaire des évènements de 1910 et 1911. Voy. GOLDSTONE Jack A., « Theories of Revolution:
The Third Generation », World Politics, 1980, vol. 32, n° 3, pp. 425-453, p. 450. Pour une opinion
contraire, voy.DUNN John, Modern Revolutions. An Introduction to the Analysis of a Political
Phenomenon, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, pp. 48-69.
20. TANTER Raymond, MIDLARSKY Manus, «A Theory of Revolution », Journal of Conflict Resolution,
1967, vol. 11, n° 3, pp. 264-280, p. 265.
21. Terme marxiste désignant le sous-prolétariat, classe plus pauvre inférieure à la classe des
prolétaires.
22. Condorcet cité par ARENDT Hannah, Essai sur la révolution, Paris, Gallimard, 1967, p. 37.
23. BERNARD Brest, Libération de l’homme : essai sur le renouveau des valeurs monastiques, Paris, Desclée
de Brouwer, 1969.
24. BRINTON Crane, The Anatomy of Revolution, 3e édition, New York, Vintage Books, 1965, p. 237.
25. HORNBLOWER Simon, SPAWFORTH Anthony, EIDINOW Esther (dir.), The Oxford Classical Dictionary, 4e
édition, 2012.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
81
26. ROMAIN David, « Lustration Laws in Action: The Motives and Evaluation of Lustration Policy in
the Czech Republic and Poland (1989-2001) », Law and Social Inquiry, 2003, vol. 28, n° 2, pp.
387-431, p. 390.
27. ROMAIN David, Lustration and Transitional Justice, Philadelphie, University of Pennsylvania Press,
2011, p. 66. Il faut préciser que c’est en privilégiant cette dimension de la « lustration »que
certains auteurs utilisent le terme « vetting » dont la traduction française donne « vérification ».
Dans le cadre de cet article, le terme « lustration » sera privilégié.
28. MALENOVSKY Jiri, « Les lois de “lustration” en Europe centrale et orientale : une mission
impossible ?», Revue Québécoise de Droit International, 2000, vol. 13, n° 1, pp.187-218, p.189.
29. GASH Timothy Garton, History of the Present. Essays, Sketches and Despacthes from Europe in the
1990’s, Londres, Penguin Press, 1999, pp. 304- 314.
30. STAN Lavinia, Transitional Justice in Post-Communist Romania, Cambridge, Cambridge University
Press, 2013, p. 85.
31. ELSTER John, Closing the books. Transitional Justice in Historical Perspective, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004, p. 69.
32. NALEPA Monika, « Lustration as Trust-Building Mechanism? Transitional Justice in Poland », in
POPOVSKI Vesselin, SERRANO Monica, dir., After Oppression. Transitional Justice in Latin America and
Eastern Europe, New York, United Nations University Press, 2012, pp. 333-360, pp. 337 et 338.
33. Conseil de l’Europe, Rés.1096, 27 juin 1996, §12. Texte relatif aux mesures de démantèlement
de l'héritage des anciens régimes totalitaires communistes.
34. LABER Jeri, « Witch Hunt in Prague », in The New York Review of Books, vol. 39, n° 8, 23 avril 1992.
35. ELLIS Mark S., « Purging the Past: The Current State of Lustration Laws in the Former
Communist Bloc », Law and Contemporary Problems, 1996, vol. 59, n° 4, pp. 181-196, p. 182; voy.
également US Department of States, The Czech Republic Country Report on Human Rights Practices for
1996, 30 janvier 1997, §22.
36. CEDH, Zablocki c. Pologne, n° 10104/08, 31 mai 2011, §33; CEDH, Rasmussen c. Pologne, n° 38886/05,
28 avril 2009, §50, CEDH, Matyjek c.Pologne, n°38184/03, 24 avril 2007, §62; CEDH, Turek c. Slovaquie, n°
57986/00, 14 février 2006, §115.
37. CEDH, Sidabras et Dziautas c. Lituanie, n° 55480/00 et 59330/00, 27 juillet 2004.
38. CEDH, Rasmussen c. Pologne, n° 38886/05, 28 avril 2009 ; CEDH, Zablocki c. Pologne, n° 10104/08, 31
mai 2011 ; CEDH, Matyjek c.Pologne, n° 38184/03, 24 avril 2007; CEDH, Turek c. Slovaquie, n° 57986/00,
14 février 2006.
39. CEDH, Sidabras et Dziautas c. Lituanie, n° 55480/00 et 59330/00, 27 juillet 2004.
40. Nous soulignons.
41. Tribunal constitutionnel de la Pologne, Lustration, n° K2/07, 11 mai 2007.
42. Faute d’accès à la loi elle-même, voy. le compte rendu de la Documentation Française. http://
www.ladocumentationfrancaise.fr/chronologies/libye-le-parlement-adopte-une-loi-sur-l-exclusion-
politique-des-anciens-collaborateurs-du-regime (dernière consultation en date du 16 janvier 2014).
43. Art.2 : droit à la non discrimination ; Art.3 : égalité devant la loi, Art.13 : droit à la
participation à la vie publique.
44. Art.16 : droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, Art.25 : droit de voter et d’être
élu au suffrage universel, Art.26 : droit à l’égalité devant la loi.
45. Voy .http://www.hrw.org/fr/news/2012/10/13/tunisie-le-projet-de-loi-d-exclusion-politique-ouvre-la-
porte-aux-abus (dernière consultation en date du 16 janvier 2014).
46. HCDH, Rule of Law for Post-Conflict States. Vetting: An Operational Framework, Genève, 2006, p. 4.
47. STAN Lavinia, « Witch-Hunt or Moral Rebirth? Romanian Parliamentary Debates on
Lustration », East European Politics and Societies, 2011, vol. 20, n° 10, pp.1-18, p.10.
48. CEDH, Glasenapp c. Allemagne, n°9228/80, 28 août 1986, opinion partiellement dissidente du juge
M. SPIELMANN, §35.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
82
49. GUENIFFEY Patrice, La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794, Paris,
Fayard, 2000, p. 14,
50. JEAN-CLÉMENT Martin, La terreur. Part maudite de la Révolution, Paris, Gallimard, 2010.
51. FAYARD Jean-François, La justice révolutionnaire. Chronique de la Terreur, Paris, Robert Laffont,
1987, p .47; Voy. également CASTELNAU Jacques, Le Tribunal révolutionnaire (1792-1795), Paris, Sfelt,
1950.
52. LAUCHLAN Iain, « Checkist Mentalité and the Origins of the Great Terror », in HARRIS James
(dir.),The Anatomy of Terror. Political Violence under Stalin, Oxford, Oxford University Press, 2013,
pp. 13-28.
53. SAYAH Jamil, La révolution tunisienne : la part du droit, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 34-35.
54. Le Monde, « Le long chemin de la Tunisie pour sa Constitution », 70 e année, n° 21469, 27
janvier 2014, p. 2
55. CEDH, Eckle c.Allemagne, n° 8130/78, 15 juillet 1982, §73.
56. VAN DIJK Pieter, VAN HOOF Fried, VAN RIJN Arjen, ZWAAK Leo, Theory and Practice of the European
Convention on Human Rights, 4e édition, Oxford, Intersentia, 2006, pp.603-605.
57. ABIKHZER Franck, « Le délai raisonnable dans le contentieux administratif : un fruit parvenu à
maturité ? », AJDA, n° 18, 2005, pp. 983-992., p. 984.
58. GUINCHARD Serge, dir., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, 4 e
édition, Paris, Dalloz, 2007, p.1064.
59. CHAPUS René, Rapport de synthèse, in Trentième anniversaire des tribunaux administratifs, Paris,
CNRS, 1986, p. 341.
60. CEDH, Wemhoff c.Allemagne, n° 2122/64, 27 juin 1968, §18.
61. CEDH , X. c.France, n° 18020/91, 31 mars 1992, §32.
62. Cour IDH , Fond, Genie Lacayo c.Nicaragua, 29 janvier 1997, Série C n° 30, §77.
63. SOLANGE Ngono, « Commentaire de l’article 7§1 », in KAMTO Maurice, dir., La Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de
l’homme. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp.178-191, p.189.
64. MOZOL Patrick, « Le contentieux administratif français face aux exigences du droit à être jugé
dans un délai raisonnable », RRJ, 2004, n° 2, pp. 1015-1038, p. 1016.
65. DOT-POUILLARD Nicolas, Tunisie : la révolution et ses passés, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 54-55.
66. Voy. le cas de Abderrahim Zouari, ancien secrétaire général du RCD (1999-2000), mis en
liberté provisoire ; Voy. le cas de Abdelaziz Ben Diah, ancien ministre sous Ben Ali, en détention
depuis le 12 mars 2013 ; Voy. le cas de l’ancien diplomate Kamel Morjane mis en liberté
provisoire.
67. Commission ADHP, Constitutionnal Rights Project c. Nigeria (II), n° 153/96, 1999, §19.
68. EUDES Marina, « La justice transitionnelle », in ASCENCIO Hervé, DECAUX Emmanuel, PELLET Alain,
Droit international pénal, 2e édition, Paris, Pedone, 2012, pp. 593-601, p. 596.
69. LENINE, Que faire ?, Paris, Librairie de l’Humanité, 1925, 206p.
70. NINO Carlos S., « The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of
Argentina », Yale Law Journal, 1991, vol. 100, n° 8, pp. 2619-2640, pp. 2619 et 2620.
71. GOLDSTONE Richard, « Justice as a Tool for Peace-Making: Truth Commissions and International
Criminal Tribunals », New York University Journal of International Law and Politics, vol. 28, n° 3, pp.
485-503, p. 491.
72. Voy. CARIO Robert, La justice restaurative: principes et promesses, Paris, L’Harmattan, 2010.
73. MEIR Bernd-Dieter, « Restorative Justice- A New Paradigm in Criminal Law? », European Journal
of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, vol. 6, n° 2, pp. 125-139, p. 130.
74. AUKERMAN Miriam J. , « Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Framework for Understanding
Transitional Justice », Harvard Human Rights Journal, 2002, vol. 15, pp. 39-97, p. 77.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
83
75. BIBAS Stephanos, BIERSCHBACH Richard A., « Integrating Remorse and Apology into Criminal
Procedure », Yale Law Journal, 2004, vol. 114, n° 1, pp. 85-148, p. 90.
76. SANDERS Lucy Clark, « Restorative Justice: The Attempt to Rehabilitate Criminal Offenders and
Victims », Charleston Law Review, 2008, vol .2, n° 4, pp.923-940, p.929.
77. EUDES Marina, « La justice transitionnelle », in ASCENCIO Hervé, DECAUX Emmanuel, PELLET Alain,
op.cit., p. 598.
78. Nous nous inspirons de l’ouvrage de M. GUEMATCHA Emmanuel, Les commissions vérité et les
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, Paris, Pedone, 2014.
79. BAKER Judity, « Truth Commissions », University of Toronto Law Journal, 2001, vol.51, pp. 309-326,
p. 309.
80. HAYNER Priscilla B., « Fifteen Truth Commissions 1974 to 1994: A Comparative Study », Human
Rights Quarterly, 1994, vol. 16, n° 4, pp. 597-655.
81. HENDY Daniel J., « Is a Truth Commission the Solution to Restoring Peace in Post-Conflict
Iraq?», Ohio State Journal on Dispute Resolution, 2005, vol. 20, n° 2, pp. 527-562, p. 535.
82. ENSALACO Mark, « Truth Commissions for Chile and El Salvador: A Report and Assessment »,
Human Rights Quarterly, 1994, vol. 16, n° 4, pp. 656-675, p. 658.
83. STAHN Carsten, « Accommodating Individual Criminal Responsibility and National
Reconciliation: The UN Truth Commission for East Timor », American Journal of International Law,
2001, vol. 95, n° 4, pp. 952-966, p. 953.
84. TOMUSCHAT Christian, « Clarification Commission in Guatemala », Human Rights Quarterly, 2001,
vol.23, n°2, pp. 233-258, p. 23.; HAYNER Priscilla B, « Fifteen truth Commissions 1974 to 1994: A
Comparative Study », Human Rights Quarterly, 1994, vol. 16, n° 4, pp. 597-655, p. 607 ; WESTON Rose,
« Facing the Past, Facing the Future: Applying the Truth Commission Model to the Historic
Treatment of Native Americans in the United States », Arizona Journal of International and
Comparative Law, 2001, vol. 18, n° 3, pp. 1017-1058, p. 1019.
85. Charles GOLDSTONE cité par KAMALI Maryam, « Accountability for Human Rights Violations: A
Comparison of Transitional Justice in East Germany and South Africa », Columbia Journal of
Transnational Law, 2001, vol. 40, pp. 89-141, p. 126.
86. BUERGENTHAL Thomas, « The United Nations Truth Commission for El Salvador », Vanderbilt
Journal of Transnational Law, 1994, vol. 27, n°3, pp. 498-544, p. 500.
87. VILLA-VICENCIO Charles, « Why Perpetrators should not always be prosecuted: Where the
International Criminal Court and Truth Commissions meet », Emory Law Review, 2000, vol. 40, pp.
205-222, p. 209.
88. En dépit de nos recherches, nous n’avons pas pu vérifier la date exacte de parution de la loi
au JORT.
89. Sur ce point, force est de constater qu’une confusion existe. Le Parlement aura-t-il,
quant au pouvoir de reconduction du mandat de l’Instance qui lui a été confié, une
compétence liée subordonnée à l’avis favorable de ladite Instance ?
90. Il est évident qu’il ne s’agit pas de responsabilité pénale, puisque l’Instance ne constitue pas
une juridiction au sens de juris dictio.
91. Voy. la déclaration de Human Rights Watch à la suite de sa visite fin janvier en Lybie. Cette
ONG affirme, en parlant des procédures judiciaires pendantes concernant plusieurs piliers de
l’ancien régime, « Leur procès n’aura plus de crédibilité qu’un tribunal de pacotille si les
autorités ne leur accordent pas le droit fondamental à des procédures régulières ». Jeune
Afrique,n° 2771, 11-16 février 2014, p. 16.
92. Voy. notamment art.8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; art.2 du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques; art.6 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; art.11 de la Convention contre la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
84
torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants; art.5 de la CEDH ; art.63
de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
93. DE GRIEFF Pablo, « Justice and Reparations », in DE GRIEFF P ablo, dir. The Handbook of Reparations,
Oxford, Oxford University Press, 2006,p. 454.
94. D’ARGENT Pierre, « Le droit de la responsabilité internationale complété? Examen des Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes des
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaires », AFDI, 2005, vol. 51, pp. 27-55, p. 40.
95. KESSEDJIAN Catherine, « La réparation des crimes de l’Histoire vue sous l’angle du droit
international privé », in BOISSON DE CHARZOURNES Laurence, QUEGUINIER Jean-François, VILLALPANDO
Santiago, Crimes de l’Histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice, Bruxelles, Bruylant,
2004, pp. 85-96, pp. 85 et 86.
96. Voy. par exemple l’article 1382 du Code civil français qui dispose : « Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer.
97. REUTER Paul, « Principes de droit international public », RCADI 1961, t. 103, pp. 431-652, p. 585.
98. CPJI, Affaire relative à l’usine de Chorzów(Compétence), Série A, n° 9, 26 juillet 1927, p.21.
99. SHELTON Dinah, « Righting Wrongs: Reparations in the Articles on State Responsibility »,
American Journal of International Law, 2002, vol. 96, n° 4, pp. 833-856, p. 835.
100. CRAWFORD James, Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l’État. Introduction, texte et
commentaires, Paris, Pedone, 2003, p. 243.
101. CPJI, Fond, Affaire relative à l’usine de Chorzów (Fond), Série A, n°17, 13 septembre 1928, p. 47.
102. D’ ARGENT Pierre, Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité
internationale des États à l’épreuve de la guerre, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 666.
103. Voy. Rapport de la CDI, 23 avril-1 er juin et 2 juillet -10 août 2001, Rés.A/56/10, p. 253. La CIJ le
rappelle avec force dans son avis consultatif Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé en date du 9 juillet 2004. Après avoir conclu que la construction du mur
en Palestine était illicite, et emportait une série de violation du droit international des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, se prononçant sur l’obligation de réparation
conséquence sur le chef d’Israël, la Cour affirme: « Israël aurait(..) l’obligation juridique de
réparer les dommages occasionnés par son comportement illicite. Cette réparation devrait tout
d’abord prendre la forme d’une restitution, à savoir la démolition des portions du mur
construites dans le territoire palestinien occupé et l’annulation des actes juridiques liés à
l’édification du mur, ainsi que la restitution des bien réquisitionnés ou expropriés aux fins de
celle-ci ; la réparation devrait également consister en une indemnisation appropriée des
personnes dont les habitations ou exploitations agricoles ont été détruites » p. 64.
104. Voy.TRINDADE CANÇADO A. A., The Access of Individual to International Justice, Oxford, Oxford
University Press, 2011, pp. 127-131. Voy. la définition de la notion de « potentielle victime »
donnée par un passage de l’arrêt Klass et autres c.Allemagne en date du 6 septembre 1978 : «(…) En
principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu’une loi viole par sa simple
existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention; elle doit avoir été appliquée à son
détriment. Néanmoins, ainsi que l’ont souligné Gouvernement et Commission, elle peut violer par
elle-même les droits d’un individu s’il en subit directement les effets, en l’absence de mesure
spécifique d’exécution », §33.
105. Rapport final du Rapporteur spécial, M. Cherif Bassiouni, sur le droit à la restitution et
réadaptation des victimes de violation flagrantes des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 18 janvier 2000, E/CN.4/2000/62., 13p., p.8. Voy. aussi la Rés.A/RES/60/147 de l’AG
des Nations Unies en date du 16 décembre 2005. Ce texte définit les « victimes » comme « les
personnes qui individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
85
atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, ou une perte matérielle ou
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant les
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du
droit international humanitaire ».§8.
106. Cour IDH, Réparations, Blake c. Guatemala, 22 janvier 1999, Série C n° 48, §34.
107. Cour IDH, Réparations, Suarez Rosero c.Equateur, 20 janvier 1999, Série C n° 44, §41.
108. Netherlands Quarterly of Human Rights, « Reparations for Victims of Gross Violations of Human
Rights », 1994, vol. 12, n° 1, pp. 93-98, p. 96.
109. KESSEDJIAN Catherine, « La réparation des crimes de l’Histoire vue sous l’angle du droit
international privé », in BOISSON DE CHARZOURNES Laurence, QUEGUINIER Jean-François, VILLALPANDO
Santiago, op.cit., p .86.
ABSTRACTS
Revolution leads to systemic social, economic and political changes as well as the emersion of a
new paradigm in the field of Law. Indeed, through the revolutionary fact, actors aim at building a
new Rule of Law in order to respect human rights. In order to achieve that goal, rounding off the
past abuses, they can use two mechanisms: the lustration and the criminal justice. In se, these
mechanisms are not questioned. Nevertheless, in a revolutionary context, their implementation
can lead to a situation of human rights violation. Consequently, it is important to adopt an
alternative method: restorative justice. This kind of justice, thanks to the truth commission and
mechanisms of reparations, is supposed to facilitate the reconstruction of a peaceful
postrevolutionary state in which human rights are respected.
La révolution conduit à un changement systémique dans le domaine social, économique,
politique. Ce changement concerne, également, le Droit. En effet, les acteurs de la révolution
veulent, par le truchement du fait révolutionnaire, construire une nouvelle société respectueuse
de l’État de droit et des droits de l’homme. A l’effet d’y parvenir, en soldant les abus du passé,
deux voies sont, bien souvent, privilégiées : la lustration et la justice punitive. In se, ces deux
méthodes n’emportent aucune contestation. Toutefois, confrontées à la pratique, elles
conduisent à la violation des droits de l’homme. Aux fins d’y remédier, une voie alternative est
suggérée : la justice restauratrice. Cette forme de justice, à la faveur des commissions vérité et
des mécanismes de réparations, tend à faciliter la construction d’un État post-révolutionnaire
pacifique et respectueux des droits de l’homme.
INDEX
Mots-clés: Révolution - État de droit- Droits de l’homme- Justice punitive- Lustration- Procès
équitable, Délai raisonnable-Justice restauratrice- commissions Vérité- Réparations
Keywords: Revolution- Rule of Law- Human rights- Criminal justice- Lustration- Fair trial-
Reasonable period of time in the trial- Restorative justice-Truth commission- Reparations
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
86
AUTHOR
MAMADOU MEITÉ
Mamadou Meité est ATER en Droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
87
Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects
politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
II. Monographie et comparaisons
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
88
Les droits de l’homme dans la
constitution marocaine de 2011:
débats autour de certains droits et
libertés
Omar Bendourou
1 L’avènement de la constitution du 29 juillet 2011 qui se situe dans le sillage du
printemps arabe peut paraître révolutionnaire si l’on se limite à une lecture partielle
du texte. On constate d’une part la proclamation d’une longue liste des droits et les
libertés et d’autre part l’engagement de l’Etat à les garantir. La Constitution paraît en
outre répondre aux revendications du Mouvement du 20 février et des associations de
défense des droits de l’homme, qui demandaient le renforcement et la protection des
droits humains, l’établissement de la monarchie parlementaire, la fin de l’impunité, la
reddition des comptes, etc. La constitution semble en somme faire la synthèse de
différentes revendications de la société civile et des partis politiques. Mais, ce qui est
frappant dans le domaine des libertés, c’est la contradiction entre la proclamation des
droits et les restrictions qui les accompagnent à tel point que leur exercice paraît
entièrement compromis.
2 Dans cette étude, nous estimons plus judicieux de dresser, dans un premier temps, un
bref état des lieux des droits de l’homme au Maroc avant l’adoption de la constitution
de 2011 (I), pour analyser, dans un deuxième temps les innovations de la constitution
de 2011 (II) et, enfin, leur traduction sur le terrain (III).
I. Les droits de l’homme avant l’adoption de la
constitution de 2011
3 Le respect des droits de l’homme s’est toujours posé avec acuité dans le régime
politique marocain. Les associations de défense des droits de l’homme aussi bien
nationales qu’internationales ont toujours soulevé les questions relatives à la torture, à
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
89
la détention arbitraire, à la disparition des opposants politiques… Grace à Amnesty
international et aux militants nationaux des droits de l’homme, l’opinion
internationale apprenait vers la fin des années 1980 l’existence d’un camp secret de
détention arbitraire sous le nom de « Tazmamart » dans lequel étaient détenus les
militaires ayant participé aux deux tentatives de coup d’état contre le roi Hassan II en
1971 et 1972.
4 Dès la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’union soviétique, le roi Hassan II
prenait des initiatives pour attester de sa volonté de respecter les droits de l’homme en
faisant adopter en 1992 un nouveau texte constitutionnel qui reconnaissait
l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement
reconnus1. Il s’agit en fait d’un message adressé à la communauté internationale. Le roi
Hassan II a affirmé lors de la préparation du texte de 1992 que "Le Maroc ne pouvait
demeurer indifférent aux profondes mutations qui surviennent partout dans le
monde"2. La nouvelle réforme devrait, selon le Roi, conférer, au Maroc "le passeport
pour faire (son) entrée sur la scène mondiale". Plusieurs initiatives du roi ont précédé
ou accompagné la nouvelle constitution dont notamment l’installation du Conseil
consultatif des droits de l’homme et la Commission d’indemnisation des victimes des
violations des droits de l’homme, l’objectif étant de tourner la page du passé et de
donner un signal fort à la communauté internationale.
5 Le roi Mohammed VI, dès son accession au trône, va suivre les pas de son père. Les deux
premières années de son règne ont été caractérisées par un certain nombre d’actes
encourageants. Ainsi, le nouveau roi reconnaît l’existence de la détention arbitraire
ainsi que des disparitions forcées et ordonne la création d’une commission chargée de
statuer sur l’indemnisation des victimes3 Il présente un nouveau concept d’autorité,
fondé entre autres, sur la protection des libertés individuelles et collectives 4 et sur
l’État de droit. Il rétabli M. Abraham Serfaty (ancien détenu politique et l’un des
fondateurs de l’organisation marxiste-léniniste « Ila Al Amam », partisane de
l’autodétermination de la population du Sahara), dans ses droits en tant que citoyen
marocain à part entière, après avoir été déchu de sa nationalité par l’ancien régime et
expulsé à l’étranger. M. Serfaty a même été nommé conseiller auprès de l’Office
national de recherches et d’exploitation pétrolière (ONAREP). Il crée les conditions
favorables au retour de la famille du disparu Mehdi Ben Barka et de plusieurs exilés
politiques etc. Par ailleurs, il insiste, à plusieurs reprises, sur son attachement à la
monarchie constitutionnelle, à la démocratie, aux droits de l’Homme et à l’État de droit,
etc5. Or, ce libéralisme sera de courte durée et un retour à des pratiques anciennes a été
enregistré après les attentats de New York du 11 septembre 2001 et surtout après ceux
de Casablanca du 16 mai 2003.
6 L’acte toutefois le plus important, qui a suscité toutefois un débat controversé, est la
création de l’Instance Equité et réconciliation (IER) en janvier 2004 qui avait pour tâche
d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme de l’indépendance du Maroc
en 1956 à la mort du roi Hassan II en 1999, de dresser un inventaire sur ces violations et
de procéder à l’indemnisation des victimes.
7 Si cette instance a accompli un travail non négligeable, adopté un rapport sur ses
activités et adressé des recommandations, sa mission était néanmoins restée limitée. Il
s’agit en effet d’une institution royale dont les activités étaient contrôlées par le roi. Il
en est de même de son rapport qui a été soumis à l’approbation royale avant sa
publication. Il en résulte que sa mission n’a pas entièrement répondu aux attentes de
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
90
l’opinion publique. C’est la raison pour laquelle tous les problèmes liés à la monarchie
n’ont pas été élucidés comme les enlèvements de Mehdi Ben Barka en 1965 à Paris et
Houcine El Manouzi en Tunisie en 1972 ainsi que les révoltes du Rif marocain
(1958-1959) réprimées dans le sang par le prince héritier Moulay Hassan (devenu roi
Hassan II en 1961). Autrement-dit, les cas non élucidés ont été en relation directe avec
le roi Hassan II. Parallèlement à l’installation de l’IER, les violations des droits de
l’homme ont persisté comme l’indiquent les associations marocaines de défenses des
droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle l’IER paraissait plutôt comme une
opération de marketing politique que comme une démarche consistant à tourner la
page du passé et à renforcer les droits de l’homme.
8 Il en résulte qu’à la veille du printemps arabe, la question des droits de l’homme
demeurait poser comme d’ailleurs le problème lié à la nature du régime politique
marocain qui restait foncièrement autoritaire. Des voix s’élevaient ainsi pour demander
l’établissement de la monarchie parlementaire ainsi que le respect et le renforcement
des droits de l’homme, comme le Mouvement du 20 février, certaines associations de
défense des droits humains et les partis de gauche non gouvernementaux.
II. Les droits de l’homme dans la nouvelle Constitution
du 29 juillet 2011
9 Avant la nouvelle constitution du 29 juillet 2011, le statut juridique des libertés trouvait
son fondement dans la constitution de 1996 qui proclamait un certain nombre de
libertés dont la liste restait pour l’essentiel limitée. En outre, le préambule de la
constitution qui affirmait l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont
universellement reconnus ne s’est jamais traduit dans les faits par des mesures
concrètes, ce qui laissait cette affirmation à l’état de déclaration. La nouvelle
constitution marque-t-elle une rupture avec les anciens textes constitutionnels ? La
nouvelle constitution énonce une longue liste des droits et libertés dont la portée
recèle toutefois des ambigüités quant à leur effectivité.
A. La nature des droits et libertés proclamés
10 Dans ses dispositions, la Constitution du 29 juillet 2011 réserve une place importante
aux droits et libertés des citoyens à tel point qu’elle paraîtrait comme étant une
constitution des droits de l’homme, si l’on se réfère aux commentateurs proches du
pouvoir 6. On distingue les droits politiques et civils, des droits économiques et sociaux.
1. La Gouvernance, les droits et libertés politiques
11 La constitution affirme dans plusieurs de ses dispositions l’attachement du Maroc au
principe de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Elle précise que le
Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.
Elle souligne en outre que le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la
séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie
citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation
entre la responsabilité et la reddition des comptes (art. 1er). La constitution prévoit
même un titre particulier consacré à la bonne gouvernance (Titre XII) dans lequel est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
91
précisé que les services publics sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de
reddition des comptes et de responsabilité. Elle envisage l’adoption d’une charte des
services publics qui « fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au
fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités
territoriales et des organismes publics » (art. 157). Par ailleurs, le Titre II prévoit la
création de plusieurs institutions de bonne gouvernance qui devraient être dotées de
statut leur accordant l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de leurs missions 7.
12 Au niveau régional, l’article 1er de la Constitution annonce que « l’organisation
territoriale du Royaume est décentralisée. El1e est fondée sur une régionalisation
avancée ». Si les collectivités territoriales sont les régions, les préfectures, les provinces
et les communes, seuls toutefois les Conseils des régions et des communes sont élus au
suffrage universel direct (art. 135). L’article 139 prévoit l’adoption de mécanismes
participatifs de dialogue et de concertation que doivent favoriser les collectivités
territoriales pour l’implication des citoyens et des associations dans l’élaboration et le
suivi des programmes de développement. Il accorde aux citoyens et aux associations le
droit de pétition en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du Conseil d’une
question relevant de sa compétence (art. 139).
13 Au niveau des libertés et particulièrement politiques, le Titre premier consacre
plusieurs articles relatifs aux droits et libertés politiques. Ainsi l’article 2 proclame que
« La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de
référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants. La Nation
choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres,
sincères et réguliers ». L’article 6 précise que « Les pouvoirs publics œuvrent à la
création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de
l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique,
économique, culturelle et sociale ». En outre, l’article 11 souligne que « Les élections
libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la
représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte
neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux ». Les articles 14 et
15 accordent aux citoyens le droit de présenter des motions en matière législative et
des pétitions aux pouvoirs publics.
14 La constitution énonce aussi plusieurs libertés collectives comme les libertés de
réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et
d'appartenance syndicale et politique. Le droit d’accéder à l'information détenue par
l'administration publique est également proclamé. La liberté de la presse est affirmée
en interdisant toute forme de censure préalable. Il en est de même du droit d'exprimer
et de diffuser les informations, les idées et les opinions
15 Le statut de l’opposition parlementaire est protégé. L’article 10 lui garantit des droits
lui permettant de s’acquitter convenablement de sa tâche dans le travail parlementaire
et dans la vie politique. Il lui assure particulièrement la liberté d’opinion et
d’expression, le droit d’accès aux médias audiovisuels publics, un financement public et
la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des
Représentants.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
92
2. Les principaux droits individuels
16 Parallèlement aux droits politiques, les libertés fondamentales sont également
proclamées par la Constitution. Ces libertés trouvent leur origine tout d’abord dans le
préambule de la Constitution qui affirme, d’une part, l’attachement du Maroc aux
droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus et, d’autre part,
l’engagement du Maroc à « protéger et promouvoir les dispositifs des droits de
l’Homme, de bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque ». Le
préambule incombe à l’Etat le devoir d’ «accorder aux conventions internationales
dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du
Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de
ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en
conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».
17 Si le préambule inscrit les droits de l’homme dans le sillage du droit international des
droits de l’homme, le titre II de la constitution énumère les différents droits et libertés
individuels, qui sont du reste prévus par les conventions internationales relatives aux
droits de l’homme, ratifiées par le Maroc, comme le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. C’est le cas du droit à la sûreté, de la légalité des peines et des
infractions, du droit au procès équitable, de l’inviolabilité du domicile, de l’interdiction
de la torture et des traitements inhumains et dégradants, de la liberté d’aller et de
venir, de la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, du droit à la santé, au travail,
au logement, à l’éducation, etc. L’égalité entre hommes et femmes est également
affirmée dans les différents domaines économiques, sociaux, civils et politiques.
B. L’effectivité des droits et des libertés
18 Si la constitution reconnaît les droits politiques, leur effectivité paraît limitée. La
proclamation de la monarchie parlementaire est purement déclarative et ne se traduit
pas dans le texte constitutionnel dans la mesure où le roi demeure le principal pouvoir
dans l’Etat et la clef de voute du régime8. Le gouvernement issu de la majorité
parlementaire ne dispose pas de la plénitude de ses compétences et ne peut rendre
compte de ses actes que partiellement devant le peuple. A cela s’ajoute la
problématique de la transparence et de la sincérité des élections.
19 Le problème de l’effectivité se pose également pour l’ensemble de la longue liste des
autres droits et libertés proclamés. Déjà dans les constitutions de 1992 et 1996, le
préambule qui affirmait « l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils
sont universellement reconnu » est resté à l’état de déclaration9. En effet, non
seulement aucune mesure n’a été prise en vue d’adapter la législation nationale au
droit international des droits de l’homme, mais le gouvernement a même fait adopter
des lois plus restrictives des libertés comme la loi relative à la constitution des partis
politiques10 et la loi dite anti-terroriste 11. Ces deux lois sont considérées comme
contraires aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme, tel que le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Maroc en 1979. La
même formulation, comme on l’a vu, a été maintenue dans le Préambule du texte
actuel, qui affirme en outre, et de manière explicite, la primauté des conventions
internationales ratifiées sur le droit interne en la conditionnant cependant par le
respect de la loi et de l’identité nationale, ce qui la vide de sa substance. Ainsi, les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
93
conventions internationales qui sont en contradiction avec l’Islam, qui constitue l’une
de ses composantes essentielles, n’ont pas leur place dans le droit interne comme c’est
le cas, par exemple, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979 et ratifiée par le Maroc avec des
réserves liées au droit musulman. Il ne s’agit pas de la seule contradiction. Le texte
constitutionnel est dominé par des dispositions qui le rendent incompréhensibles. Il
soumet l’effectivité des libertés au respect des spécificités nationales. C’est le cas par
exemple de l’article 19 qui proclame l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice
des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturel et environnementaux, en les
conditionnant par le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du
Royaume et de ses lois12. Cette restriction justifie en elle-même l’inégalité prévue par la
loi marocaine relative aux statuts personnels qui discrimine la femme par rapport à
l’homme au niveau notamment de l’héritage. Dans ce sillage, il faut également relever
les discriminations à caractère religieux du fait qu’il est interdit aux non musulmans
d’hériter des musulmans et vice versa. D’autres dispositions contradictoires coexistent
comme celles relatives aux partis politiques, comme on le verra ultérieurement.
20 Par ailleurs, le conseil constitutionnel, qui assure les fonctions de la nouvelle cour
constitutionnelle, a contribué aux restrictions à l’exercice des libertés. C’est le cas de la
loi relative aux partis politiques (infra), mais également de la loi organique relative à la
chambre des représentants promulguée par le dahir du 14 octobre 2011 13. Cette
dernière prévoit dans son article 72 que le droit de vote accordé aux marocains résidant
à l’étranger ne peut s’exercer que par délégation. Cette disposition paraît contraire à
l’article 17 de la constitution qui dispose que : « Les Marocains résidant à l’étranger
jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et
éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des
circonscriptions électorales locales, régionales et nationales … ». Si la délégation est en
principe appliquée dans plusieurs démocraties, c’est le vote personnel et direct qui
constitue toutefois la règle. Or, au Maroc, les marocains résidants à l’étranger n’ont
d’autres choix que de déléguer ce droit. Il est difficile de comprendre comment cette
catégorie de marocains vote directement auprès des consulats et ambassades du Maroc
lorsqu’il s’agit d’un référendum, alors qu’ils ne peuvent en jouir pour les élections
législatives. Cette loi organique paraît étrange et pose la question de savoir si l’objectif
recherché est de faciliter l’orientation des élections par délégation interposée ou de
conduire les marocains à l’abstention. C’est la raison pour laquelle peu de marocain
concernés ont utilisé la procédure de délégations au cours des élections législatives
anticipées du 25 novembre 2011. Au lieu de faire prévaloir le droit de citoyenneté
pleine et entière comme l’affirme l’article 17, le Conseil constitutionnel estime, au
contraire, dans sa décision du 13 octobre 2011, que cette dérogation est conforme à la
constitution : « Considérant que, bien que le vote soit un droit personnel de par l’article
30 de la Constitution, la Constitution elle-même a renvoyé à la loi, dans son article 17, la
détermination des conditions et des modalités de l’exercice effectif des droits de vote et
de candidature pour les marocains résidant à l’étranger à partir du pays de résidence,
faisant ainsi que la mesure édictée -dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire- par le
législateur, de pouvoir voter par procuration n’est pas- en tant que dérogation par
rapport au principe de la personnalité de l’élection concernant en particulier la
catégorie en question et liée aux mesures explicitées dans les paragraphes suivants du
même article- contraire à la Constitution ».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
94
21 Si la nouvelle constitution cultive la confusion quant à la portée réelle des libertés
proclamées, certaines libertés publiques continuent de susciter des débats controversés
quant à leur exercice.
III. Débats autour de certaines libertés
22 Les libertés publiques qui ont suscité des controverses sont notamment celles relatives
aux libertés d’association, de rassemblements publics, de presse et de constitution des
partis politiques.
A. La liberté d’association
23 Depuis 1962, les différentes Constitutions qu’a connues le Maroc ont reconnu la liberté
d’association14. L’actuelle Constitution, celle du 29 juillet 2011, renforce encore le statut
des associations. Elle souligne dans son article 12 que les associations se constituent
librement et exercent également en toute liberté leurs activités dans le respect de la
constitution et de la loi. Ledit article précise par ailleurs qu’elles ne peuvent être
dissoutes ou suspendues qu’en vertu d’une décision de justice 15. En outre, l’article 29
réaffirme de nouveau la garantie de cette liberté16. Plus encore, la constitution confie
aux associations un rôle important en soulignant que « Les associations intéressées à la
chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre
de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des
décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et
pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et
modalités fixées par la loi » (art. 12)17.
24 Si la nouvelle constitution consacre la liberté d’association, l’application de la loi du 15
novembre 1958 relative à cette liberté est entravée par l’administration qui ne respecte
pas les dispositions légales.
25 Les principaux problèmes portent sur la procédure de constitution des associations et
sur les causes de leur interdiction.
1. Les modalités de constitution des associations
26 La loi du 15 novembre 1958, qui a connu plusieurs modifications (notamment en 1973 et
2002), prévoit que la constitution d’une association est soumise au dépôt d’une
déclaration préalable auprès des autorités locales en contrepartie d’un récépissé
délivré aux responsables de ladite association. La loi exige des autorités la délivrance
immédiate d’un récépissé provisoire dans l’attente d’un récépissé définitif qui doit être
remis aux intéressés au plus tard soixante jours (60) après la déclaration. Passé ce délai,
l’association acquière sa légalité et se voit habilitée à exercer ses activités prévues par
ses statuts. En outre, elle a autorisé les responsables de l’association à confier à
l’huissier de justice la mission de déposer, à leurs places, la déclaration de constitution
de l’association.
27 Le problème qui se pose au Maroc est que l’administration refuse parfois de remettre le
récépissé de déclaration aux responsables de l’association ou même de réceptionner la
déclaration. Parfois, l’administration impose des conditions non prévues par la loi pour
dissuader les responsables de la créer ou du moins retarder sa constitution.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
95
28 Les autorités agissent ainsi lorsqu’il s’agit d’associations islamistes ou de gauche ou
d’association dont les responsables sont considérés par les autorités comme des
personnes politiquement suspectes. Il faut préciser que le récépissé de dépôt de
déclaration constitue le seul moyen justifiant la légalité de l’association.
29 Ce comportement des autorités est, à l’évidence, contraire aux anciennes constitutions
marocaines ainsi qu’encore plus, à la nouvelle constitution de 2011 et à l’article 22 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Maroc a ratifié, et qui
proclame la liberté d’association18.
2. Les modalités de suspension et d’interdiction des associations
30 La loi prévoit des modalités de suspension et d’interdiction des associations fondées sur
des notions vagues et imprécises accordant ainsi aux autorités un large pouvoir
d’appréciation. Ainsi, il est précisé dans l’article 3 de la loi que « l’association ne doit
pas poursuivre des objectifs illicites, contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou qui ont
pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national,
au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination ». La question qui se pose
est de savoir ce que l’on entend par « atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du
territoire national, au régime monarchique »?
31 Les interprétations sont multiples et peuvent conduire à interdire des associations qui
débattent des pouvoirs étendus du roi ou qui discutent de la place de l’Islam dans l’Etat
et de son rôle dans la légitimation du pouvoir monarchique ou de la structure de l’Etat.
Ces notions ambiguës constituent de véritables obstacles aux activités des associations
dans la mesure où la justice au Maroc ne dispose pas encore de sa pleine indépendance
et souffre, comme l’a reconnu l’ancien ministre de la Justice M. Omar Azziman le 5 avril
1999, de plusieurs maux, dont la corruption, les malversations etc. 19. Ledit ministre a en
outre affirmé que les magistrats agissaient sur instruction 20. M. Abbas El Fassi, l’ancien
secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ancien premier ministre, avait affirmé, au
cours d’une conférence de presse tenue le 11 avril 2005, que la justice n’était pas
entièrement indépendante et intègre21. Par ailleurs, les différentes enquêtes menées
par Transprency-Maroc font ressortir la justice parmi les secteurs les plus corrompu du
pays22.
32
33 Ces restrictions comme d’ailleurs les modalités appliquées dans le processus de
constitution des associations apparaissent également comme contraires à l’article 22 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui détermine la nature des
restrictions en soulignant que « L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique…. ».
B. La liberté de constitution des partis politiques
34 Jusqu’en 2006, la constitution et l’organisation des partis politiques étaient régies par la
loi sur les associations de 1958. En 2006, le gouvernement a fait adopter une loi
spécifique aux partis politiques23 qui soumettait leur constitution à une autorisation
préalable du ministère de l’Intérieur. Cette loi accordait au premier ministre la
compétence de les interdire lorsque les partis « provoquent (sic !) …à des
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
96
manifestations armées dans la rue, ou présente, par sa forme et son organisation
militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou a
pour but de s'emparer du pouvoir par la violence, de porter atteinte à la religion
islamique, à l'intégrité du territoire national ou à la forme monarchique de l'Etat »
(art. 57). Sur la base de ces dispositions, un parti politique de tendance islamiste « Al
badil al hadari » (Alternative civilisationnelle) a été interdit le 28 février 2008 pour
implication dans le réseau terroriste Belliraj24 et son secrétaire général M. Mustafa Al
Moatassim a été condamné à 25 ans de prison25.
35 Après la promulgation de la constitution de juillet 2011, les défenseurs des droits de
l’homme, qui contestaient la loi de 2006, espéraient que le parlement adopterait une loi
plus libérale. La constitution a en effet prévu plusieurs dispositions relatives aux partis
politiques. L’article 7 affirme que leur constitution et l’exercice de leurs activités sont
libres26 et ne peuvent être interdits que par la justice (art. 9) 27. Elle leur accorde en
outre la mission d’encadrement et de formation politique des citoyens ainsi que de
concourir à l’expression de la volonté des électeurs et de participer à l’exercice du
pouvoir.
36 Comment la nouvelle loi a organisé alors les modalités de constitution des partis
politiques et celles de leur interdiction ?
1. La constitution des partis politiques
37 La loi organique du 22 octobre 201128 adoptée après la promulgation de la nouvelle
constitution du 29 juillet 2011, n’a fait que reprendre l’essentiel des dispositions
restrictives de la loi de 2006. La procédure de constitution des partis prévoit toujours le
dépôt d’une demande par trois membres-fondateurs auprès du ministère de l’Intérieur.
Cette demande doit comporter les déclarations individuelles de trois cents membres-
fondateurs accompagnées de plusieurs documents (copie de leur carte d’identité
nationale, attestation d’inscription sur la liste électorale) et d’informations (nom,
prénom, lieu et date de naissance, nationalité, profession et adresse). Les signataires
doivent être répartis dans au moins les deux tiers des seize régions du pays, être âgés
de 18 ans et inscrits sur les listes électorales. Si le ministre de l’Intérieur considère la
déclaration de constitution du parti comme conforme à la loi, il informe par lettre
recommandée les trois fondateurs ayant déposé la demande dans un délai de trente
jours. S’il estime que le projet de création du parti est contraire à la loi, il saisit le
tribunal, dans un délai de soixante jours, pour qu’il statue sur son illégalité (dans un
délai de quinze jours). La décision du tribunal est susceptible d’appel.
38 L’acceptation du ministre ou la décision favorable du tribunal relative à la création du
parti permet aux fondateurs d’organiser le congrès constitutif de leur parti dans un
délai d’un an, sinon la déclaration est considérée comme caduque. L’organisation du
congrès constitutif implique la participation d’au moins 1000 personnes, dont les trois
quarts des signataires de la déclaration, représentant au moins les deux tiers des
régions du pays. Chaque région doit être représentée par un minimum de 5% de
l’ensemble des participants. L’organisation du congrès requiert également le dépôt
d’une déclaration auprès de l’autorité locale compétente soixante-douze heures au
moins avant sa tenue et signée par deux des trois signataires de la première
déclaration. C’est le congrès qui doit approuver le statut ainsi que le programme du
parti et qui doit élire ses instances dirigeantes. Un procès-verbal du congrès doit être
établi pour être confié à un mandataire choisi par les congressistes qui le déposera
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
97
auprès du ministère de l’Intérieur. Il doit être accompagné de la liste de 1000
participants au moins avec leurs signatures ainsi que le numéro de leur carte d’identité
nationale et de la liste des membres des instances dirigeantes du parti. Le parti est
considéré comme légal dans un délai de trente jours après le dépôt de la déclaration.
Pendant ce délai, le ministre de l’Intérieur peut saisir le tribunal administratif de Rabat
qui doit décider de sa nullité si le ministre concerné estime que les conditions de la
tenue du congrès ou son programme ne sont pas conformes à la loi. Il est à préciser que
le parti n’acquiert sa légalité qu’après la validation par le ministre de l’Intérieur du
congrès constitutif. Durant cette période transitoire, les activités du parti ne peuvent
que se limiter à celles qui sont nécessaires à la préparation de son congrès constitutif.
39 Ce nouveau texte étant une loi organique, le conseil constitutionnel était appelé à se
prononcer sur sa constitutionnalité comme l’exige la Constitution.
40 En dépit des conditions restrictives de la constitution des partis politiques, le Conseil
constitutionnel a déclaré cette loi comme étant conforme à la Constitution. Pourtant, la
loi paraît contraire à l’article 7 de la constitution qui affirme que la constitution et les
activités des partis sont libres. Elle est également contraire à l’article 22 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques que nous avons mentionné
précédemment.
41 Sur la base de la nouvelle loi, un parti politique de tendance islamiste mais proche de la
gauche, en l’occurrence le Parti Al Ouma, n’a pas été autorisé par le ministère de
l’intérieur. Cette interdiction a été confirmée par la Cour de cassation en décembre
2012.
2. Les modalités d’interdiction des partis politiques : maintien des notions vagues
pour l’interdiction ou la suspension des partis
42 La nouvelle loi a supprimé la compétence du chef du gouvernement d’interdire les
partis politiques en confiant uniquement à la justice la mission de statuer sur les
activités des partis politiques. Ainsi cette loi s’est conformée à la nouvelle constitution
qui précise dans son article 9 que les partis politiques ne peuvent être dissous ou
suspendus qu’en vertu d’une décision de justice. Toutefois, la loi, se fondant sur la
constitution, a maintenu des notions vagues et imprécises pour les interdire le cas
échant.
43 En effet, la constitution (art. 7) avait prévu que les partis « ne peuvent avoir pour but
de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes
constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité
territoriale du Royaume ». On a déjà expliqué la portée de ces notions et les
incertitudes qu’elles font peser sur les activités des partis.
44 Si c’est la justice qui est chargée de statuer sur la légalité des activités des partis, son
statut et son fonctionnement posent le problème de l’indépendance de la justice vis-à-
vis de l’exécutif et de l’intégrité des juges, comme nous l’avons souligné précédemment.
A ces restrictions s’y ajoutent d’autres prévues dans l’article 7 qui précise « Les partis
politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou
régionale, ou, d’une manière générale, sur toute autre base discriminatoire ou
contraire aux droits de l’Homme ».
45 Ces restrictions sont des armes entre les mains du pouvoir pour sanctionner le cas
échéant les partis qui ne se conforment pas aux règles que celui-ci a établies.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
98
C. La Liberté de rassemblement publics
46 Les rassemblements publics englobent, dans la loi marocaine, les réunions publiques,
les manifestations sur la voie publique et les attroupements. La nouvelle constitution,
comme ses devancières, reconnait ces différentes libertés. Ainsi l’article 29 énonce :
«Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique,
d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions
d’exercice de ces libertés ».
47 C’est le dahir du 15 novembre 195829 modifié, essentiellement, par le dahir du 23 juillet
200230 qui régit ces libertés. Les amendements intervenus en 2002 ont restreint dans
une certaine mesure ces libertés.
1. Les réunions publiques
48 La loi exige pour la tenue des réunions publiques le dépôt d’une déclaration préalable,
signée par trois personnes domiciliées dans la préfecture ou province où la réunion
devra avoir lieu, auprès de l’autorité locale, en contrepartie d’un récépissé. Au cas où
les intéressés ne parviendraient pas à obtenir ce document, ils peuvent adresser la
déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion ne peut avoir
lieu dans ce dernier cas qu’après expiration d’un délai de 48 heures, sinon 24 heures
suffissent si le récépissé est obtenu. La réunion publique n’est donc pas entièrement
libre dans la mesure où deux conditions sont exigées. D’une part, la déclaration
préalable qui doit être effectuée soit par dépôt personnel, soit par correspondance.
D’autre part, au cas où la déclaration serait envoyée par lettre recommandée, la loi
exige l’accusé de réception.
49 Or, il se trouve que les autorités peuvent refuser soit la réception de la déclaration soit
la remise du récépissé, comme elles peuvent rejeter l’envoi recommandé et ne pas
signer l’accusé de réception qui devient la seule pièce justificative de la légalité de la
réunion. Il faut préciser que dans l’ancien texte, c’est-à-dire la version d’avant les
amendements de 2002, la condition d’« accusé de réception » était absente, ce qui
permettait aux déclarants de se contenter du récépissé de d’envoi recommandé. Par
ailleurs, si la loi dispense les associations reconnues de recourir à la déclaration
lorsqu’il s’agit des réunions internes, la pratique a démontré que les autorités exigent
parfois la déclaration préalable pour les réunions inter-associations, ce qui paraît
contraire à la loi. Si certaines associations refusent de se plier aux exigences illégales de
l’administration, cette dernière exerce parfois des pressions sur les responsables des
salles ouvertes au public pour leur demander d’exiger le récépissé. La formalité de la
déclaration permet à l’administration de mandater un délégué, comme le prévoit la loi,
pour assister aux réunions31. Or, les associations qui se voient contraintes d’agir ainsi
refusent souvent la présence de ce fonctionnaire, ce qui n’implique toujours pas une
réaction de l’administration d’interdire la réunion dans la mesure où cette dernière
était consciente que son comportement n’était pas légal32.
2. Les manifestations sur la voie publique
50 Pour organiser une manifestation publique, la loi exige comme pour les réunions
publiques, le dépôt d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
99
locale qui remet aux déclarants un récépissé. Si les déclarants n’obtiennent pas ce
document, ils peuvent adresser à la même autorité la déclaration par lettre
recommandée avec accusé de réception. La déclaration doit être signée par trois
personnes parmi les organisateurs dont le domicile se trouve dans la préfecture ou la
province où la manifestation doit avoir lieu. La déclaration doit être déposée ou
envoyée trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de
l’organisation de la manifestation.
51 L’administration dispose, comme par le passé, d’un large pouvoir d’appréciation pour
interdire la manifestation si elle estime qu’elle est de nature à troubler la sécurité
publique (au lieu de l’ordre public, dans l’ancien texte). Cette décision doit être écrite et
notifiée aux signataires de la déclaration à leur domicile (art. 13).
52 En vertu du nouveau texte, seuls les partis politiques, les formations syndicales, les
organismes professionnels et les associations régulièrement déclarées ont le droit
d’organiser des manifestations. On constate que les nouveaux amendements introduits
dans l’article 11 ont réduit la liberté d’organisation des manifestations en comparaison
avec l’ancien texte qui autorisait un groupe de personnes à organiser une manifestation
publique. Le ministre des droits de l’homme a insisté lors de la présentation de ce
projet sur la nécessité de limiter l’organisation de cette liberté aux seules organisations
ayant le droit, de par la constitution, d’encadrer les citoyens ainsi que les organisations
reconnues du moment qu’elles sont issues de la société civile. Si, dans de nombreux
pays, la déclaration préalable pour l’organisation des manifestations, est appliquée, les
autorités ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité de
son organisation. Au cas où elles abuseraient de leur pouvoir d’interdiction, la justice
redresse les torts, ce qui n’arrive que rarement au Maroc en raison du statut de la
justice. Par ailleurs, réserver l’organisation des manifestations aux seules associations
reconnues constitue sans aucun doute une restriction fondamentale de cette liberté et
se heurte aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
particulièrement à l’article 21.
3. Les attroupements
53 Le législateur marocain n’a défini que l’attroupement armé. Il le qualifie comme tel
lorsque plusieurs personnes portant des armes apparentes ou cachées ou d'engins
dangereux apparents n’ont pas été immédiatement expulsées de l'attroupement par les
individus qui en font partie (art. 18). L’article 17 du dahir de 1958 précise que
l’attroupement armé est interdit ainsi que tout attroupement non-armé qui pourrait
troubler la sécurité publique.
54 En raison des restrictions de l’organisation des manifestations sur la voie publique qui
est réservée aux seules associations reconnues, des citoyens qui ne font pas partie
d’organisations constituées et qui veulent manifester leurs mécontentements et attirer
l’attention des pouvoirs publics sur leur situation, n’ont d’autres choix que de recourir
à l’attroupement, ce qui arrive souvent aux diplômés-chômeurs qui n’ont pas pu
obtenir le récépissé relatif à la déclaration de constitution de leur association. Ces
derniers organisent souvent des sit-in devant le parlement ou sur la grande avenue
Mohammed V à Rabat sans perturber pour autant la circulation ou menacer l’ordre
public. Il semble que les autorités recourent souvent à la violence, si l’on se réfère aux
organisations de défense des droits humains, sans même respecter les dispositions
relatives à la dispersion des attroupements. En effet, la loi prévoit trois sommations
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
100
adressées, par porte voix, par l’agent dépositaire de la force publique avant de faire
intervenir les forces de l’ordre.
D. La liberté de presse
55 Les différentes constitutions qu’a connues le Maroc ont proclamé la liberté de presse.
La nouvelle constitution l’a également garantie dans son article 25 33, en reconnaissant à
l’ensemble des citoyens le droit d’exprimer et de diffuser librement des informations,
des idées et des opinions dans le respect des limites prévues par la loi. La constitution
interdit même la censure (art. 28)34. La liberté de la presse est régie par la loi du 15
novembre 1958 qui a connu plusieurs modifications (notamment en 1973 et 2002) 35.
56 Le problème de la liberté de la presse se pose au Maroc à deux niveaux : au niveau de la
procédure de parution des périodes et à celui des sanctions susceptibles d’être infligées
aux responsables des périodiques ainsi qu’aux journalistes, ce qui a une conséquence
immédiate sur la survie de ces périodiques.
1. Les problèmes posés par la procédure de la déclaration
57 Pour la parution de tout périodique, la loi prévoit le dépôt d’une déclaration préalable
auprès du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où se trouve le
siège principal du journal (art. 5). La déclaration, qui doit comporter plusieurs
informations et documents36, est signée et déposée par le directeur de publication. Le
parquet doit remettre au responsable de la publication un récépissé de dépôt 37. Il s’agit
d’un récépissé provisoire. Le récépissé définitif est remis dans un délai maximum de
trente jours 38, à défaut, le journal peut paraître (art. 6)39. Cette procédure paraît
formelle dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande d’autorisation, mais d’une
simple formalité permettant l’enregistrement des journaux à paraître, ce qui signifie
que le parquet dès qu’il constate que le dossier contient les documents exigés par la loi
remet un reçu aux responsables. Or, dans la pratique, le parquet se comporte
différemment. Dans certains cas, il refuse de délivrer ce document ou se dérobe de
réceptionner la déclaration lorsqu’il estime que les responsables font l’objet de
suspicion de la part des autorités. Ce comportement ne permet alors pas aux
responsables de publier leurs périodiques puisque le récépissé est le seul document
attestant de la légalité de ces derniers.
2. Les modalités de suspension et d’interdiction des périodiques
58 Jusqu’en 2002, la loi relative à la liberté de presse (art. 77) permettait au premier
ministre d’interdire les périodiques nationaux lorsqu’ils auront porté atteinte aux
fondements institutionnels, politiques ou religieux du Royaume ou lorsque leur
publication serait de nature à troubler l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur était
également compétent pour suspendre les périodiques et ordonner la saisie de tout
numéro du périodique. A partir de 2002, des modifications ont été apportées à la loi
relative à la liberté de la presse qui a supprimé les compétences du gouvernement
d’interdire ou de suspendre les périodiques en les transférant à la justice. Les
amendements de 2002 ont toutefois maintenu la saisie des journaux par le ministre de
l’intérieur.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
101
59 Si ces amendements constituent un progrès non négligeable, la nouvelle version de la
loi a cependant conservé voire renforcé les dispositions qui retreignent sensiblement la
liberté de presse. Ainsi, les motifs conduisant à des sanctions sont multiples et vagues.
En effet, l’article 41 permet des sanctions lorsque les journaux ou les écrits auront
porté atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité
territoriale. La nouvelle version de la loi a même ajouté la notion de « valeurs sacrées ».
Cette notion c’est-à-dire celle de « valeurs sacrées permet de restreindre encore plus la
liberté de presse et soumet les écrits des journalistes au pouvoir discrétionnaire du
juge40. Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre le terrorisme du 28 mai 2003 41 prévoit
également des dispositions ambigües donnant lieu à des interprétations larges pour
condamner les journalistes et instaurer une autocensure42. En outre, plusieurs
dispositions de la loi envisagent d’autres sanctions en cas de diffamation, atteintes aux
chefs de l’Etat étrangers, à la sûreté intérieur et extérieure de l’Etat, etc.
3. Les atteintes à la liberté de la presse
60 Depuis l’intronisation du roi Mohammed VI, beaucoup de périodiques indépendants ont
connu des difficultés avec les autorités politiques qui n’ont pas hésité à utiliser
différents moyens pour interdire certains d’entre eux ou faire juger les journalistes et
les responsables de ces publications. On constate que les journaux qui ont été
condamnés sont ceux qui abordent des sujets tabous c’est-à-dire la place du roi dans le
système politique, la corruption, la question du Sahara, les violations des droits de
l’homme, les services de sécurité, etc… Si l’on fait un inventaire des procès intentés aux
périodiques, on constate que les causes prévues par la loi ou/et invoquées par la
jurisprudence sont multiples : atteintes aux valeurs sacrées du Royaume, atteintes au
régime monarchique, atteintes à l'intégrité territoriale, atteintes à la religion
islamique, atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, offenses aux chefs
d’Etat étrangers, apologie ou/et assistance aux actes terroristes.
61 En guise d’illustration, nous allons maintenant passer en revue quelques les affaires
relatives aux atteintes aux valeurs sacrées du Royaume, à la diffamation et au
terrorisme et qui montrent les atteintes graves à la liberté de la presse.
a. Les atteintes aux valeurs sacrées du Royaume
62 Plusieurs journaux ont été condamnés pour atteintes aux valeurs sacrées du Royaume
et manquement au respect dû au roi. Les décisions des autorités politiques ou
judiciaires qui ont attiré l’attention de l’opinion publique et suscité des réactions des
organisations de défenses des droits de l’homme aussi bien nationales
qu’internationales sont relatives à l’interdiction administrative de l’hebdomadaire
francophone « Le Journal » et, surtout, aux procès intentés à M. Ali Mrabet, directeur
de deux publications.
i) L’interdiction de l’hebdomadaire « Le Journal »
63 Dans son numéro du 25 novembre au 7 décembre 2000, « Le journal », hebdomadaire
francophone, a consacré un dossier sur la gauche, l’armée et le pouvoir. Parmi les
documents publiés, on trouve une lettre du fquih Basri (ancien responsable de l’UNFP)
envoyée le 8 août 1974 à MM. Abderrahim Bouabid, leader de l’USFP de l’époque et
Abderrahmane Youssoufi relative à la tentative du coup d’Etat fomenté par le général
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
102
Oufkir en août 1972. Il ressort de cette lettre que les deux personnages de la gauche
étaient au moins au courant de la tentative du coup d’Etat sinon impliqués. Au
lendemain de cette publication, le gouvernement, dirigé par M. Abderrahman
Youssoufi, a décidé le 2 décembre 2000 d’interdire le journal, sur la base de l’article 77
du dahir relatif à la liberté de presse qui autorisait à l’époque une telle mesure. Le
premier ministre a également interdit le journal « Sahifa » qui a reproduit le même
dossier et « Demain » en raison de son appartenance, au même groupe que les deux
autres publications, Média Trust43. Officiellement44, les raisons de l’interdiction étaient
liées à la publication de plusieurs articles qui portent atteintes aux fondements
politiques, aux institutions constitutionnelles et aux forces armées royales et qui
consistent à déstabiliser le pays ainsi qu’à entraver son expérience démocratique. Le
gouvernement a ajouté que cette décision s’était posée au gouvernement depuis la
publication dans « Le journal » de la lettre de fquih Al Basri. Il a, par ailleurs, précisé
que ces publications avaient prétendu que les partis et l’Armée de l’époque préparaient
des complots contre le roi. Le premier ministre avait estimé plus tard que les raisons de
l’interdiction étaient relatives à la mise en cause de la monarchie qui aurait collaboré
avec les militaires français de l’époque lors de l’interception par l’armée française de
l’avion qui transportait les chefs historiques du FLN du Maroc vers la Tunisie.
ii) Les procès intentés aux journaux « Demain » et « Demain-magasine »
64 M. Mrabet fait partie des journalistes qui ont connu des difficultés avec les autorités
marocaines dans la mesure où les journaux qu’il dirigeait abordaient des sujets qui
transgressaient les lignes rouges comme la monarchie, la fortune du roi, le Sahara, etc.
Ses journaux « Demain » et surtout « Demain magazine » ont pris une orientation
satirique et commençaient à inquiéter le pouvoir. Trois procès ont dominé le parcours
de M. Ali Lamrabet en tant que responsable de ces publications. Nous évoquerons deux
qui ont été relatifs aux atteintes aux valeurs sacrées du Royaume.
65 Le premier procès est relatif au Palais royal de Shkirat. Dans le no du 20 octobre
200145de l’hebdomadaire « Demain magazine », M. Ali Lmrabet faisait état de
l'éventuelle vente du palais royal de Skhirat. Bien que M. Lmrabet ait évoqué cette
information au conditionnel, le substitut du procureur a estimé que le directeur de
cette publication avait diffusé de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre
public (art. 42 de la loi sur la liberté de presse) et de porter atteinte aux valeurs sacrées
du Royaume. Désormais, les valeurs sacrées du pays se sont élargies aux objets, ce qui a
suscité l’ironie de plusieurs observateurs46. M. Lamrabet a été condamné le 21
novembre 2001 par le tribunal de première instance de Rabat à une peine de quatre
mois de prison et à une amende de 30.000 dirhams47.
66 Le deuxième procès fait suite à la publication par l’auteur de plusieurs articles relatifs
au budget du Palais royal, à l’histoire de l’esclavage, à un photomontage mettant en
scène des personnalité politiques marocaines, le premier ministre de l’époque M.
Abderrahamne Youssoufi et plusieurs personnalités politiques (Abbès Fassi secrétaire
général du parti de l’Istiqlal, Smaïl Alaoui et Mohammed Nabil Benabdellah
respectivement secrétaire général et membre du bureau politique du Parti du progrès
et du socialisme (PPS). M. Lamrabet a également publié des extraits d’une interview de
l’ancien prisonnier politique et militant associatif M. Abdallah Zaâzaa accordée à un
journal espagnol dans laquelle il se déclare partisan de la république et pour
l’autodétermination de la population du Sahara. A la suite de ces articles publiés dans
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
103
ses deux hebdomadaires « Demain Magasine » et « Doumane », il sera poursuivi et
condamné le 21 mai 2003 par le tribunal de première instance de Rabat à quatre ans de
prison ferme et 20.000 dirhams d’amende pour outrage à la personne du roi, atteinte au
régime monarchique et à l'intégrité territoriale. Le tribunal a aussi interdit ses deux
publications et ordonné son incarcération immédiate à la sortie du Tribunal en
application des articles 400 et 425 du Code de procédure pénale. Le 17 juin suivant, la
Cour d’appel de Rabat a confirmé le jugement en réduisant la durée à trois ans de
prison ferme. M. Lmrabet sera gracié par le roi le 17 janvier 2004 avec d’autres
journalistes.
iii) Les difficultés des hebdomadaires Telquel et Nichane
67 Le directeur des hebdomadaires « Tel Quel » en français et « Nichane » en arabe, M.
Benchemsi sera poursuivi plusieurs fois pour « manquement au respect dû au roi ». En
2007, il le sera suite à son éditorial critiquant le discours royal du 30 juillet 2007 relatif
aux élections législatives. Son hebdomadaire Nichane a été saisi après avoir été
distribué sur l’ensemble du territoire alors que TélQuel l’a été à l’imprimerie en
violation de la loi qui ne prévoit pas de censure. En 2009, les mêmes hebdomadaires ont
publié un sondage sur le bilan des dix ans de règne du roi Mohammed VI 48. Ils se sont
associés avec le journal « Le Monde » pour effectuer ce sondage. Bien que le sondage
soit favorable à la monarchie49, le ministre de l’Intérieur n’a pas attendu leur
distribution, mais a ordonné leur saisine au sein de l’imprimerie dans lesquelles les
deux journaux sont imprimés et a décidé de leur destruction, ce qui constitue une
violation de la loi. Le ministre de l’Intérieur a estimé que « le concept même de sondage
sur la monarchie est totalement inacceptable au Maroc » alors que le ministre de la
Communication (déclaration à l’AFP) souligne que « la monarchie au Maroc n’est pas en
équation et ne peut faire l’objet d’un débat, même par voie de sondage » 50.
68 En raison des difficultés avec le pouvoir, M. Benchemsi a décidé de quitter le Maroc.
iv) Les procès relatifs à la maladie du roi : peines d’emprisonnement à l’égard des
responsables des publications
69 Suite au communiqué du ministère du ministère de la Maison Royale, du Protocole et
de la Chancellerie du 26 août 2009 relatif à la maladie du roi, deux publications en
langue arabe en l’occurrence « Aljarida al Oula » et « Al machaal » ont contredit
l’information officielle et se sont interrogées sur la vraie maladie du roi. Des poursuites
ont été aussitôt engagées contre les responsables de ces publications pour « publication
malintentionnée d’une fausse information, allégations et faits mensongers ». Le
responsable de l’hebdomadaire « Al Machaal » sera condamné à un an de prison ferme
et à une amende de 10.000 dirhams, alors que les deux autres journalistes associés à
l’article seront condamnés à trois mois de prison ferme et à des amendes de 5.000
dirhams. Quant au directeur du quotidien Al Jarida al Oula, M. Ali Anouzla, et la
journaliste ayant rédigé l’article, ils seront condamnés respectivement à un an de
prison avec sursis, une amende de 10.000 dirhams et à trois mois de prison avec sursis
et une amende de 5.000 dirhams.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
104
b) Les procès politiques relatifs à la diffamation
70 De nombreux journaux ont été traduits devant la justice pour diffamation. Toutefois,
plusieurs procès avaient un caractère plutôt politique ; sous couvert de diffamation, il
s’agit en fait de sanctionner des journaux et des journalistes qui osent franchir les
lignes rouges : la corruption des hauts responsables, la monarchie, le Sahara, les
violations des droits de l’homme, les services de sécurité, etc…
i) Les procès intentés au « Journal Hebdomadaire »
71 Après une première interdiction en décembre 2000, les responsables de l’hebdomadaire
ont déposé un dossier en vue de faire paraître un nouveau journal dénommé « Le
Journal hebdomadaire ». Autorisé à réapparaître en janvier 2001, il sera toutefois à
deux reprises condamné pour diffamation et finira par disparaître en raison des peines
pécuniaires exorbitantes.
ii) Procès intenté par le ministre des Affaires étrangères Mohammed Benaissa
72 Dans le cadre de ses enquêtes relatives à la corruption, aux violations des droits de
l’homme et aux abus du pouvoir, le journal a publié dans trois de ses numéros d’avril
200151 des articles qui font état de la vente à la résidence de l’Ambassadeur du Maroc à
Washington d’une villa d’un montant qui ne correspond pas à sa valeur réelle. Pour le
journal, l’ex-ambassadeur du Maroc M. Mohammed Benaissa, qui devient en 1998
ministre des Affaires étrangères, avait fondé une société qui avait acheté cette
résidence à 900.000 dollars américains pour la revendre à l’Ambassade du Maroc à
4.800.000 dollars.
73 Bien que les responsables de ces articles aient enquêté sur place et produit des preuves,
le Tribunal de première instance de Casablanca va condamner les responsables de cette
publication à trois mois de prison ferme, 10.000 dirhams d’amende et deux millions de
dirhams de dommage et intérêt qui doivent être versés au ministre des Affaires
étrangères de l’époque. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Casablanca
qui a réduit toutefois les peines.
iii) Procès intenté par l’ESISC (European Stratégic intelligence and securty center)
74 Suite à un rapport établi en 2005 par l’ESISC, domicilié en Belgique, sur le Front
POLISARIO qui estime que ce mouvement évolue vers le terrorisme, l’islamisme radical
voire la criminalité internationale et menace par conséquent la stabilité de l’Afrique
subsaharienne et l’Europe, l’hebdomadaire « Le Journal Hebdomadaire » publie en
décembre 2005 un dossier contestant la qualité scientifique de ce rapport. Il estime que
ce rapport est dépourvu d’arguments scientifiques et cite deux experts qui partagent
les mêmes conclusions52 en précisant qu’il abonde vers les thèses marocaines. Le
journal s’est interrogé sur les vrais commanditaires de ce rapport et s’il ne s’agissait
pas des autorités marocaines. La question du Sahara étant une question très sensible
pour les autorités marocaines et fait partie des sujets tabous, le dossier a suscité des
réactions négatives et le directeur de l’ESISC, M. Claude Moniquet, décide de recourir à
la justice marocaine pour diffamation.
75 Parallèlement au manque de sérieux de ce centre, la presse belge s’est intéressée à son
directeur M . Moniquet dont les activités faisaient l’objet de suspicion 53. Bien que de
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
105
doutes pèsent sur la probité et l’intégrité du responsable de l’ESISC, la justice
marocaine (en première instance et en appel) condamne le journal à des amendes et à
des dommages et intérêt d’un montant de plus de trois millions de dirhams 54.
76 En raison du montant exorbitant des dommages et intérêt infligé au directeur de la
publication, M. Boubker Jamai, ce dernier a été obligé de quitter le journal pour
permettre la survie du journal et de s’exiler à l’étranger, ce qui a conduit les autorités
marocaines à suspendre l’exécution du jugement. A son retour au Maroc et à la
direction de l’hebdomadaire en 2009, la Cour suprême a confirmé le 30 septembre 2009
le jugement et la justice a décidé de le mettre exécution en janvier 2010 en faisant
cesser la parution du périodique.
iv) Procès intenté contre M. Ali Lamrabet relatif aux Sahraouis de Tindouf
77 Dans une interview accordée à l’hebdomadaire marocain arabophone « Al-Mustakil »
dans son numéro du 12 janvier 2005, M. Lamrabet a affirmé que les Sahraouis vivant
dans les camps de Tindouf étaient des “réfugiés” selon la terminologie de l’Organisation
des Nations unies et a estimé que dire que les saharaoui de Tindouf sont des séquestrés
constitue un mensonge et une allégation. M Ahmed Khaï, au nom de « l’Association des
Parents des Sahraouis victimes de la répression dans les camps de Tindouf », proche du
pouvoir, intente un recours pour diffamation devant le tribunal de première instance
de Rabat qui a rendu sa décision le 12 avril 2005. Le tribunal a condamné M. Lmrabet à
une amende de 50.000 dirhams et l’a interdit d’exercer sa fonction de journalistes
pendant dix ans. Ce procès coïncide avec l’accomplissement par M. Lamrabet des
formalités en vue de faire paraître un nouveau journal. Au moment ou le procureur
auprès du Tribunal de première instance de Rabat se dérobe pour lui remettre le
récépissé comme le prévoit la loi, la décision de ce même tribunal est rendue publique,
ce qui a empêché M. Lamrabet à éditer son journal55.
v) Procès intentés au directeur du quotidien « Al Massae »
78 Le quotidien Al Massae a fait l’objet de plusieurs procès et condamnations. Toutefois,
l’affaire qui va conduire son directeur, M. Rachid Nini à la prison est celle relative à ses
chroniques qui ne sont point appréciées par les autorités. Dans ses chroniques (chouf-
tchouf) M. Nini traitait des affaires relatives à la corruption et, surtout, aux activités de
la Direction générale de la surveillance du territoire (DST) et de son directeur M.
Abdellatif Hammouchi dans sa politique relative notamment à la lutte contre le
terrorisme. M. Neni mettait en doute le bien fondé des activités de cette direction et
évoquait des cas de torture pratiquée dans un centre de détention de Témara (près de
Rabat).
79 M. Nini a été arrêté le 28 avril 2011 et poursuivi en détention préventive jusqu’à sa
condamnation en juin suivant. Il fut condamné à un an de prison ferme pour avoir ''jeté
du discrédit sur une décision de justice, tenté d'influencer la justice et publié des
informations sur des actes criminels non avérés''. Il a purgé l’intégralité de sa peine.
L’arrestation et la condamnation de M. Nini ont été condamnées par les organisations
de défense des droits de l’homme aussi bien marocaines qu’internationales.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
106
c) La presse et le terrorisme
80 La loi relative à la lutte contre le terrorisme adoptée en 2003 a prévu des dispositions
très restrictives à l’égard de la liberté d’expression. En effet, la loi prévoit des sanctions
(emprisonnement de 2 à 6 ans et amende de 10 000 à 200 000 dirhams) en cas d’apologie
d’actes terroristes par des moyens écrits ou verbaux (article 218-2 du Code pénal), c’est-
à-dire par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics
ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les
lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les
différents moyens d'information audiovisuels et électroniques sont sévèrement punies
(art. 218-2 du Code pénal). Cet article concerne aussi bien de simples citoyens que la
presse et risque de semer des doutes dans les esprits et de créer une situation de peur.
Désormais, les interprétations sont possibles pour sanctionner des citoyens qui osent
aborder par exemple les problèmes de terrorisme en expliquant leurs causes sans pour
autant les justifier. En somme, cette loi devient un moyen de terreur entre les mains
des autorités pour restreindre les libertés et instaurer un régime quasi d'exception
dans des situations normales. Sur la base de cette loi plusieurs journalistes ont été jugés
et condamnés à des peines d’emprisonnement.
81 Toutefois, l’affaire la plus récente qui a suscité l’indignation des défenseurs des droits
de l’homme est celle relative au directeur du site d’information en ligne « Lakome » M.
Ali Anouzla. Celui-ci a été arrêté le 17 septembre 2013 pour avoir publié trois jours
auparavant c’est-à-dire le 14 septembre un article sur le site « Lakome » relatif à une
menace terroriste formulée par l’Al qaida au Maghreb islamique (AQMI) à l'encontre du
Maroc et proposait un lien vers le quotidien espagnol « El Pais » qui avait publié
l’information et la vidéo. Après huit jours de garde à vue, M. Anouzla a été placé en
détention préventive et mis en examen pour «assistance délibérée à des criminels
ayant commis des actes terroristes », « fourniture de moyens pour des actions
terroristes », et « apologie de crimes terroristes ». Il encourt entre 10 à 30 ans de
réclusion criminelle.
82 Il faut rappeler que le directeur de ce site n’a fait que proposer un lien vers un autre
site sans publier la vidéo d’AQMI, ni sans même proposer le lien de cette vidéo, alors
que le directeur de Lakome en langue française M. Boubker Jamaii a publié la vidéo et
n’a pourtant pas été arrêté ni poursuivi. Ceci nous conduit à nous interroger sur les
vraies raisons de son arrestation. En effet, M. Anouzla est connu pour être un
journaliste d’investigation qui a publié de nombreux articles critiques sur la monarchie
(son dernier article relatif au coût de la monarchie), sur la question du Sahara dit
occidental et sur les monarchies du Golf notamment l’Arabie Saoudite, sur la
corruption, etc. L’article de M. Anouzla a constitué l’opportunité pour les autorités
pour le sanctionner à des lourdes peines sur son comportement vis-à-vis de la
monarchie. Le recours à la loi anti terroriste constitue également un avertissement à
l’ensemble des journalistes. Suite à des pressions internationales et à l’acceptation de
M. Ali Anouzla de suspendre son site électronique, celui-ci sera libéré le 25 octobre
2013. Il fait toujours l’objet de poursuites pénales sur la base de la loi pour la lutte
contre le terrorisme.
Conclusion
83 Bien que la constitution du 29 juillet 2011 soit un texte confus et contienne des
dispositions contradictoires qui réduisent la portée des libertés, peu de lois organiques
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
107
prévues par la constitution pour rendre effective certaines libertés ont été adoptées. Si
l’on se réfère aux deux lois organiques relatives à la chambre des représentants et aux
partis politiques, on constate, comme nous l’avons souligné précédemment, qu’elles ont
introduit des restrictions réduisant sensiblement l’exercice des libertés, telles que les
dispositions qui ne permettent aux marocains résidant à l’étranger de n’exercer leur
droit de vote que par délégation ou celles introduisant l’autorisation préalable pour la
constitution des partis. Les lois relatives au nouveau statut de la justice n’ont toujours
pas vu le jour. Pourtant, la constitution précise dans son article 117 que « le juge est en
charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et
des groupes, ainsi que de l’application de la loi ».
84 Il faut rappeler que la nouvelle constitution a hissé la justice au rang de pouvoir et
consacre de nouveaux principes susceptibles de garantir l’indépendance de la justice.
Désormais, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dispose de l’autonomie
administrative et financière (article 116). Il « veille à l’application des garanties
accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination,
leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline ». En matière disciplinaire, le
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs
expérimentés. L’élection, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du
pouvoir judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des
magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique ».
Dans l’attente d’adopter des lois qui rendent effectives les nouvelles dispositions
constitutionnelles, les institutions et les lois qui régissaient le statut de la justice
continuent d’être appliquées. Or, ces dispositions font du ministre de la justice
l’autorité principale dans le processus de promotion et de sanction des magistrats. Si le
ministre actuel de la justice et des libertés a préparé deux projets de lois organiques en
vue d’adapter la législation actuelle au nouveau texte constitutionnel, ces textes
demeurent à l’état de projet. Pourtant, la nouvelle constitution a été promulguée
depuis près de trois ans. En outre, la loi relative à la mise en œuvre de la disposition
constitutionnelle prévue par l’article 133 qui a introduit l’exception
d’inconstitutionnalité n’a pas non plus vu le jour. Les justiciables ne peuvent toujours
pas saisir les tribunaux par voie d’exception à l’égard des lois considérées comme non
conformes à la Constitution. La loi organique relative à la nouvelle Cour
constitutionnelle n’a pas non plus été adoptée, et c’est toujours l’ancien Conseil
constitutionnel qui assure ses nouvelles fonctions. On constate que les lois prévues par
l’actuelle constitution et qui sont susceptibles de renforcer la protection des droits et
des libertés ne sont pas prioritaires dans l’action du pouvoir politique, ce qui rend
problématique les réformes constitutionnelles et leur applicabilité dans le régime
politique marocain.
NOTES
1. Voir Omar Bendourou et al ; « La réforme Constitutionnelle marocaine de 1992 », Revue du droit
public et de la science politique en France et à l'étranger, 1993, pp. 431-446
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
108
2. Discours du roi du 20 août 1992.
3. Discours du roi du 20 août 1999.
4. Discours du roi du 12 octobre 1999.
5. Dans son premier discours du trône du 30 juillet 1999, le roi souligne : « Nous sommes
extrêmement attaché à la monarchie constitutionnelle, au multipartisme, au libéralisme
économique, à la politique de régionalisation et de décentralisation, à l’édification de l’État de
droit, à la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives, et au
maintien de la sécurité et de la stabilité pour tous ». Il réitère les mêmes idées au cours de
plusieurs discours.
6. Voir Al Bayane : http://www.albayane.press.ma/index.php?
option=com_content&view=article&id=15009:la-promotion-des-droits-de-lhomme-au-
maroc&catid=44:actualites&Itemid=118.
7. Il s’agit essentiellement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de
la concurrence, de l’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la
corruption, du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique,
du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance et du Conseil consultatif de la jeunesse et de
l’action associative (art. 165-170).
8. Voir Omar Bendourou, « La consécration de la monarchie gouvernante »,L’Année du Maghreb
, VIII, 2012, (CNRS, Paris), pp. 391-404.
9. Nous avons déjà posé cette problématique lors de l’analyse de la Constitution de 1992. Voir
Omar Bendourou, et al., « La réforme Constitutionnelle marocaine de 1992 », op. cit.
10. Voir Omar Bendourou, « La loi marocaine relative aux partis politiques », Année du Maghreb,
2006 (Paris, CNRS).
11. Voir Omar Bendourou, Libertés publiques et Etat de droit au Maroc, Collection Droit public,
Friedrich Ebert, Rabat, 2004.
12. L’article 19 dispose : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à
caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le
présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et
pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la
Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. L’Etat œuvre à la réalisation de la parité
entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte
contre toutes formes de discrimination ».
13. Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 27-11
relative à la Chambre des représentants, B.O. n° 5992 du 03-11-2011, p. 2346.
14. Depuis son indépendance en 1956, le Maroc a connu six constitutions promulguées
respectivement en 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011.
15. L’article 12 énonce : « Les associations de la société civile et les organisations non
gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la
Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics,
qu’en vertu d’une décision de justice ».
16. L’article 29 précise : « Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de
manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi
fixe les conditions d’exercice de ces libertés ».
17. L’article 12 énonce: « Les associations de la société civile et les organisations non
gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le
respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues,
par les pouvoirs publics, qu’en vertu d’une décision de justice. Les associations
intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
109
dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics.
Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux
conditions et modalités fixées par la loi. L’organisation et le fonctionnement des
associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux
principes démocratiques ».
18. L’’article 22 du Pacte précise que « Toute personne a le droit de s'associer librement avec
d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses
intérêts ».
19. « Maroc-Hebdo », 9/15-04-1999.
20. M. Omar Azziman avait évoqué le 5 avril 1999 au cours d'un dîner-débat organisé par l'USFP à
Casablanca, « la situation des juges et présidents de tribunaux qui sont toujours en attente des
instructions, ce qui laisse la justice repliée sur elle-même et impuissante à évoluer ». Voir
« Maroc-Hebdo », 9/15-04-1999.
21. M. Abbas El Fassi était à l’époque ministre d’Etat sans portefeuille sous le gouvernement
Jettou (2002-2007). Voir « Al Ittihad Al Ichtiraki », 14-11-2005.
22. Transparency Maroc, La corruption au Maroc, Synthèse des résultats des enquêtes
d’intégrité, 2005 (75 pages). Les résultats du baromètre mondial de la corruption publié
régulièrement par Transparency International confirme cette tendance. Ainsi, les résultats
publiés le 9 juillet 2013 par cette dernière placent la santé, la police, les administrations
publiques et le système judiciaire comme des secteurs les plus corrompus. Voir le communiqué
du bureau exécutif de Transparency Maroc du 9 juillet 2013: http://transparencymaroc.ma
23. Voir Omar Bendourou, La loi marocaine relative aux partis politiques, Op. Cit.
24. Déclaration du ministère de l’Intérieur, MAP, Rabat, 20/02/08. Dans cette affaire, 35
personnes ont été poursuivies pour « atteinte à la sécurité intérieure du pays ; formation d’un
groupe criminel visant à préparer et à commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet
collectif visant à menacer gravement l’ordre public par la terreur, la violence, le meurtre
prémédité et la tentative d’assassinat avec usage d’armes à feu avec préméditation ; transport et
détention d’armes à feu et de munitions pour l’exécution de visées terroristes ; falsification de
documents officiels et usurpation d’ identité ; don et collecte de fonds et de biens à exploiter dans
l’exécution de projets terroristes ; vols multiples et blanchiment d’argent ». Elles ont été
condamnées le 28 juillet 2009 par le Tribunal de première instance de Salé. Les peines variaient
entre un an de prison avec sursis et l’emprisonnement à vie à l’encontre de M. Belliraj.
25. Il sera gracié par le roi en avril 2011.
26. L’article 7 énonce : « Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la formation
politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu’à la promotion de leur participation à la vie
nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des
électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par
les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles. Leur constitution et
l’exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi . Le régime
du parti unique est illégal ».
27. L’article 9 précise par ailleurs que « Les partis politiques et les organisations syndicales ne
peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de
justice ».
28. Dahir ni 1-11-166 du 22 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 29-11
relative aux partis politiques, B.O. n° 5992 du 03-11-2011, p. 2360.
29. Dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958, B. O. du 27-11-1958, p. 1912,
modifié par le dahir n° 1-73-284 du 6 rebia I 1393, B. O. du 11-04-1973, p. 534.
30. Dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°
76.00 (adoptée par le parlement). B. O. n° 5048 du 17-10-2002, p. 1060.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
110
31. Le fonctionnaire peut prononcer, le cas échéant, la dissolution de la réunion soit sur demande
du bureau soit à son initiative s'il se produit des collisions ou des voies de fait (art. 7). Le
fonctionnaire n’est plus compétent, comme auparavant, pour dissoudre la réunion s’il constate
que la réunion porte ou est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Cette restriction, qui a
été ajoutée par les amendements de 1973, disparaît du texte actuel, ce qui réduit le pouvoir
discrétionnaire du fonctionnaire pour dissoudre la réunion au cas où il appréhenderait
uniquement ses conclusions et les conséquences de ses travaux.
32. Ces constations sont le fruit d’une enquête menée par l’auteur dans différentes régions du
pays.
33. L’article 25 énonce « Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous
toutes leurs formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d’exposition en
matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique ».
34. L’article 28 énonce : « La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par
aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser
librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, des informations,
des idées et des opinions…».
35. Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 du 15 novembre 1958, B. O. n° 2404 bis du 27/11/1958,
p. 1914, modifié par le dahir n° 1-73-285 du 6 rabia I 1393 (10 avril 1973), B. O. du 11-04-1973, p.
535. En 2002, le parlement a adopté des amendements promulgués par le dahir n° 1-02-207 du 25
rajab 1423 (3 octobre 2002), portant promulgation de la loi n° 77-00, B. O. n° 5080 du 6-2-2003, p.
131.
36. Ces informations portent sur le nom du périodique, son mode de publication et la langue de
publication; l’état civil du directeur du périodique et son domicile, l’état civil des rédacteurs
permanents, leur nationalité et leur domicile, l’imprimerie chargée de son impression, le capital
investi dans l’entreprise, son origine et la nationalité des actionnaires etc…(art. 5).
37. Pour les périodiques étrangers édités au Maroc, les responsables doivent obtenir une
autorisation préalable accordée par décret (art. 5 et 28).
38. L’ancien texte ne précisait pas la nature du récépissé qui est remis aux responsables ni le
délai au cours duquel le récépissé devait être délivré.
39. Dans le projet de loi initial présenté par le gouvernement, la parution automatique du journal
après le délai de 30 jours n'était pas prévue. Le texte permettait seulement aux intéressés
d'intenter un recours auprès du tribunal administratif en cas de non délivrance du récépissé
définitif un délai de six mois.
40. Sur la jurisprudence fondée sur « les valeurs sacrées », voir Omar Bendourou, Libertés
publiques et Etat de droit au Maroc , Collection Droit public, Rabat, 2004, pp. 175-180 ; Omar
Bendourou et Mohammed Sassi, La liberté d’expression au Maroc (en arabe), Association Adala,
2012.
41. Dahir n° 1-03.140 du 26 rabii 1 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03
relative à la lutte contre le terrorisme.
42. Voir Omar Bendourou, Libertés publiques et Etat de droit au Maroc, op. cit., p. 193-201.
43. Les directeurs des trois journaux ont porté l'affaire en déféré devant le tribunal administratif
de Rabat qui a rendu son arrêt le 20 décembre de la même année pour incompétence. Le juge des
référés a argué cette incompétence par le fait que la décision du Premier ministre a été prise
selon la loi qui lui conférait cette compétence. « L'opinion », 17-12-2000
44. C’est le porte-parole du gouvernement M. Al Achaari qui s’est expliqué à ce sujet, voir « Al
Ittihad Al Ichtiraki », 04-12-2000
45. Il faut souligner que les trois journaux du groupe Média Trust vont être autorisés à reparaître
en janvier 2001 avec des titres légèrement modifiés: «Le Journal hebdomadaire», «Assahifa al
ousbouya» et «Demain Magazine».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
111
46. «Le Journal» (8/12-12-2001) a précisé que «Ce retour délirant à l'âge de pierre n'ayant aucune
raison de s'arrêter là demain, ce seront les tomates ou les pamplemousses de telle ou telle ferme
royale qui seront défiées».
47. M. Lmrabet a mis en cause le général Hamidou Laânigri, à l’époque, responsable de la
Direction de la Surveillance du Territoire (DST, services de renseignements) et l'entourage du roi
à savoir MM. André Azoulay, conseiller du roi et Fouad Ali Al Himma, secrétaire d'Etat à
l'Intérieur pour avoir fomenté ce procès (Voir son interview publiée dans «Le Journal
Hebdomadaire», 24/30-11-2001.
48. Le 2 août 2009, le ministre de l’Intérieur a ordonné la saisie et la destruction des deux
hebdomadaires Télquel n° 386 et Nichane.
49. Voir Le Monde, 04 -08- 2009.
50. Voir le dossier sur l’affaire dans TélQuel n° 386-387 du 5 août au 4 septembre 2009, Le Monde,
04 août 2009.
51. Il s’agit du n°117, daté du 8 au 14 avril, du n° 118 daté du 15 au 21 avril et du n° 119 daté du 22
au 28 avril 2001.
52. Il s’agit de deux universitaires étrangers : Bernabé Lopez-Garcia et Khadija Mohsen-Finan.
53. Dans son édition du 17 février 2006, le journal belge « Le Soir » publie un article dans lequel le
journaliste Pascal Martin dresse un portrait négatif de cette personne. D’après l’enquête menée
par ce journaliste, M. Moniquet serait « agent ou proche du Mossad (les services secrets
israéliens), et en France de la DST ou de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) ». Il
est même décrit comme « un mercenaire », « un manipulateur », « un type qui se vend au plus
offrant ».
54. Le Tribunal de première instance de Casablanca a rendu le 16 février 2006 une décision
arrêtant un montant de trois millions de dirhams à verser, en dommage et intérêt, au CESC et
une amende de 50.000 dirhams à l’égard des deux responsables de l’hebdomadaire, MM. Fahd
Iraki et Boubker Jamai.
55. M. Lamrabet était contraint de quitter le Maroc pour s’installer à l’étranger (Espagne).
ABSTRACTS
If the new Moroccan constitution provides a long list of rights and freedoms, questions remain
about their effectiveness. It can indeed be find contradictions between the proclaimed rights and
legal limitations, involving emptiness of their substance. In addition, the exercise of several
pubic liberties reveals for decades the gap between the text and practice, and the problem of the
rule of law. Public authorities in charge to enforce the law tend to deny such of requirements.
Regarding the judges supposed to protect rights and freedoms, they don’t not have the required
independance to fulfill their missions, because on control to the executive power.
Si la nouvelle constitution marocaine prévoit une longue liste de droits et libertés, des
interrogations subsistent toutefois quant à leur effectivité. On relève en effet des contradictions
entre les droits proclamés et les restrictions qui les accompagnent, ce qui les vide de leur
substance. En outre, l’exercice de certaines libertés publiques depuis des décennies révèle le
décalage entre le texte et la pratique, ce qui pose le problème de l’Etat de droit. Les autorités
chargées d’appliquer la loi ont tendance à se soustraire à ses exigences. Quant à la justice qui est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
112
censée assurer la protection des droits et des libertés, elle ne dispose pas de l’indépendance
nécessaire à l’accomplissement de sa mission et reste soumise au contrôle de l’exécutif.
INDEX
Mots-clés: Droits de l’homme - droits politiques - liberté d’association - liberté de manifestation
- liberté de presse - partis politiques – terrorisme - justice
Keywords: Human rights - political rights - freedom of association - freedom of manifestation -
feedrom of the press - political parties – terrorism - justice
AUTHOR
OMAR BENDOUROU
Omar Bendourou est professeur à la faculté de droit de Souissi-Rabat. Il est responsable du
Master «Droit constitutionnel et science politique» ainsi que de l’«Equipe de recherche droit
constitutionnel et science politique »
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
113
La gouvernance des Droits de
l’homme en Tunisie
postrévolutionnaire : état des lieux,
difficultés et opportunités
Souheil Kaddour
Introduction1
1 On peut sans doute tous convenir que, presque tout naturellement, après les
révolutions, viennent à l’esprit les deux fameuses questions de Lénine : « Que faire ? » et
« Par où commencer ? ». Je souhaiterais, à cette occasion, partager l’état des lieux, les
difficultés et les opportunités de la gouvernance des Droits de l’Homme en Tunisie
après la Révolution du 14 janvier 2011.
2 Le nécessaire accord sur le sens des mots qui nous permettra de « penser ensemble » un
certain nombre d’idées, exige que les termes de notre sujet soient élucidés dans leur
acception la plus fondamentale2.
3 Ainsi, tout d’abord, par « Gouvernance », nous entendons « l’ensemble des valeurs, des
institutions, des règles, des mécanismes, et des processus, négocié et discuté, formalisé ou non,
par lequel les acteurs concernés participent à la décision, à l’exercice du pouvoir et à la mise en
œuvre de l’action publique, dans un but d’intérêt général »3. Pour plusieurs organisations
telles que l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE),
s’ajoute la notion de « bonne gouvernance » qui renvoie plutôt à une prescription
normative. Les organisations internationales utilisent celle-ci pour adopter des
mesures d’intervention et de financement auprès des pays se conformant aux critères
s’y référant. La «bonne gouvernance » inclut souvent les principes suivants : présence
d’un Etat de droit, absence de corruption, équité, responsabilité, efficacité,
transparence, participation4. Ces principes, tels qu’explicités dans divers documents
internationaux5 et de l’avis d’imminents auteurs, sont des conditions indispensables
pour assurer la protection et la promotion des Droits de l’Homme et l'instauration
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
114
d’institutions plus démocratiques. Comparée à la notion plus classique de
« gouvernement » d’une société, celle de « gouvernance » est intéressante en ce qu’elle
permet d’appréhender le fait que des responsabilités autrefois dévolues à l’Etat sont
actuellement progressivement partagées avec les acteurs sociaux et qu’émergent ainsi
de nouvelles articulations entre l’État et la société civile 6.
4 Ensuite, par l’expression « droits de l’homme », nous entendons « l’ensemble des facultés et
prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain » 7; nous
reprendrons à notre compte le mode de leur classement le plus communément admis :
droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits dits de
solidarité ou de 3ème génération.
5 Notre attention, en cette communication sur la gouvernance des Droits de l’Homme en
Tunisie, portera particulièrement sur l’exercice du pouvoir et la manière dont les normes
relatives aux droits de l’homme sont élaborées, décidées, légitimées, mises en œuvre et
contrôlées. Lorsqu’on aborde cette question d’importantes interrogations surgissent.
6 En premier lieu, des interrogations communes aux sociétés contemporaines, liées aux
demandes sociales toujours plus nombreuses, et mettant en exergue différentes
contradictions : Etat-providence versus Etat-gendarme ? Interventionnisme versus
Libéralisme ? Etat versus Société civile ? Démocratie représentative versus Démocratie
participative ? Participation politique versus Désaffection politique ? Légalité versus
Légitimité ? Centralisation versus Décentralisation ? Concentration versus
Déconcentration ?
7 En deuxième lieu, surviennent des interrogations spécifiques aux sociétés en transition,
liées aux priorités à aborder, et mettant en exergue différentes oppositions : Droit à la
vérité versus Droit à la justice ? Droit à la réparation versus Garanties de non répétition
(Assainissement et Réformes)? Impunité versus Réconciliation? Sécurité versus Stabilité?
Etat démocratique versus Etat profond?
8 Enfin, en troisième lieu, il existe des interrogations propre à la société tunisienne, liées
à son contexte social, économique, politique et géographique spécifique qui mettent en
exergue différents clivages : Modèle traditionnel du Droit étatique « impératif » «
autoritaire » versus Nouveau modèle de régulation « participatif » «collectif » ?
Légitimité constitutionnelle versus Légitimité révolutionnaire versus Légitimité
consensuelle? Exercice du pouvoir fondé sur une source unique d’autorité ou sur une
multiplicité des sources d’autorité? Respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales versus Lutter contre l’insécurité, le terrorisme, les atrocités du passé?...
9 La pratique de la gouvernance des droits de l’homme en Tunisie postrévolutionnaire a
progressivement mis en évidence la multiplication des acteurs impliqués dans la prise
de décision et la mise en œuvre des politiques publiques (I). Elle a révélé, en la matière,
au-delà de certaines tensions, l’accroissement indéniable de l’implication de la société
civile dans l’action de l’Etat (II).
I. La multiplication des acteurs impliqués dans la
gouvernance des droits de l’homme en Tunisie
postrévolutionnaire
10 La gouvernance des droits de l’homme en Tunisie, repose sur une multiplicité d’acteurs
différents et toujours plus nombreux8. Cette multiplication des acteurs et des structures
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
115
appelle des questionnements relatifs notamment à leur légitimité, à leur efficacité et à
la clarification de l’exercice des mandats. On distinguera les acteurs étatiques (A), des
acteurs non étatiques (B).
A. La pluralité des acteurs étatiques
11 L’institution d’acteurs étatiques offre des tendances hétérogènes de continuation, de
suppression, de création, de modification ou de constitutionnalisation des structures.
Après avoir dressé un état des lieux des acteurs intervenant dans le domaine des droits
de l’homme (1), on formulera quelques observations critiques relatives à leur
fonctionnement (2).
1. Etats des lieux
12 Interviennent ou ont été appelées à intervenir en matière des droits de l’homme,
l’Assemblée nationale constituant a) ; les organes du pouvoir exécutif ; c) les instances
nationales indépendantes c).
a) L’Assemblée nationale constituante
13 Après la vacance définitive de la Présidence de la République le 14 janvier 2011, ont été
dissous, en vertu du décret-loi n°2011-14 du 23 mars 2011 portant organisation
provisoire des pouvoirs publics9, les instances suivantes : la Chambre des Députés, la
Chambre des Conseillers, le Conseil économique et social, et le Conseil constitutionnel.
Le 23 octobre 2011, de l’avis de nombreux observateurs, « les premières élections libre de
l’histoire de la Tunisie » se sont tenues10.
14 Une Assemblée nationale constituante a été élue et chargée principalement d'élaborer
une nouvelle constitution pour la seconde République11. Elle exerce également le
pouvoir législatif et le contrôle de l'activité gouvernementale. L’action de l’Assemblée
nationale constituante en matière des droits de l’homme s’effectue à travers divers
mécanismes dont notamment ses séances plénières de questionnement du
Gouvernement ou ses différentes commissions constituantes, législatives et spécifiques.
b) La multiplicité des organes du pouvoir exécutif
15 On distinguera le président de la République, les organes gouvernementaux et les
organes administratifs.
i) Le président de la République
16 Pendant la première période transitoire, allant du 15 janvier 2011 au 23 octobre 2011,
date d’élection de l'Assemblée nationale constituante, le Président de la République par
intérim exerçait des fonctions à la fois législatives et fonctions exécutives. En vertu de
décret-loi n°2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, il pouvait ainsi intervenir, par voie décrétale (décrets-lois et décrets
réglementaires), dans le domaine des droits l’homme et des libertés fondamentales. La
pratique montrera d’ailleurs qu’il en a fait un usage très important.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
116
17 Après l’adoption de la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011 relative à
l'organisation provisoire des pouvoirs publics le rôle du président de la République en
matière droits l’homme et des libertés fondamentales s’est réduit considérablement au
profit du gouvernement.
ii) Les organes gouvernementaux
18 Tout d’abord, a été créée une Commission nationale du Droit international humanitaire 12.
Chargée de la vulgarisation des principes du droit international humanitaire, de la
diffusion de sa culture et de sa promotion, cette commission émet un avis consultatif
sur les questions relatives à ce droit et ses domaines d’application.
19 Ont, ensuite, été institués un ensemble de Conseils supérieurs consultatifs. Il s’agit des
Conseil supérieur du développement, Conseil supérieur de la promotion de l'emploi,
Conseil supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Conseil
supérieur de la promotion des ressources humaines, Conseil supérieur de la promotion
sociale et de la protection des personnes porteurs d'handicap, Conseil supérieur de la
protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. « Ces
conseils se veulent un espace pour l'étude, le dialogue et la concertation autour des politiques et
des programmes nationaux relevant de leurs compétences, ils s'intéressent également au suivi de
leur exécution »13. L’Histoire retiendra que ces « bonnes intentions » sont restées lettres
mortes. Après la Révolution, ce dispositif a été maintenu et a connu la création d’un
Conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs
et bien de l’Etat à côté.
20 Enfin, à côté des Départements chargés des droits de l’homme au sein de certains ministères
tels le ministère des Affaires étrangères et le ministère l’Intérieur, un ministère des
Droits de l’Homme et de la Justice transitionnelle a été créé le 19 janvier 2012. Il est chargé
de la présentation et du suivi de l’exécution de la politique portant sur les droits de
l’Homme. Il est également chargé, dans le cadre de son rôle de coordination et de
consultation avec les autres ministères, les structures, les organisations et associations
concernées, de contribuer à la préservation des Droits de l’Homme, à la consécration de
leurs valeurs et à la propagation de leur culture droits ainsi qu’à la garantie de leur
exercice conformément à la législation nationale, aux conventions et aux traités
internationaux s’y rapportant14.
21 Entre une justice qui fonctionne encore mal, pour certains, et qui attend sa réforme, et
des commissions multiples à la fonction limitée et critiquée, la décision du
gouvernement de fonder un ministère des Droits de l’Homme et de la Justice
transitionnelle était porteuse d’espoir. Le ministère est censé être « un guichet
unique » pour tout ce qui a trait aux Droits de l’Homme et à la justice transitionnelle, se
devant de faire la jonction entre les différents acteurs publics ainsi qu’avec les
organisations de la société civile. Face à des Commissions de vérité nommées sans
réelle consultation préalable et fustigées pour leur absence de stratégie », leur
« improvisation »15, leur « système désorganisé sans centralisation effectives»16 ou leur
« manque de coordination évident »), pour certains, « la création du nouveau ministère
apporte de la cohérence, en ce qu’il existe désormais un organe apte à centraliser les différentes
initiatives étatiques et administratives, tout en assurant leur coordination avec les mouvements
des droits de l’homme »17.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
117
22 Toutefois, « décrié » par certains, « salué »18 par d’autres l’initiative de créer un
ministère « chargé des Droits de l’Homme » n’a pas non plus fait l’unanimité. Des
préoccupations ont été exprimées par diverses parties prenantes devant le risque que
le ministère limite le rôle et la participation de la société civile dans la prise de décision
et la formulation des politiques publiques relatives aux droits de l’homme et à la justice
transitionnelle. Le ministère est perçu comme étant l’instrument par lequel le
gouvernement s’approprie le processus décisionnel dans une matière où il ne peut
pourtant être juge et partie19. Toutefois, dans la pratique, l’ouverture que le ministère a
manifestée envers la société civile a relativement dissipé ces appréhensions.
iii) Les organes administratifs
23 Nous nous contenterons de citer, à titre d’exemples, les structures suivantes :
24 L’équipe du Citoyen superviseur. Cette structure relève de la Présidence du
gouvernement20
25 Les établissements publics21. On relève deux types d’établissements publics : les
établissements publics à caractère administratif (ex. : Services du Médiateur
administratif22 ; Observatoire d’information, de formation, de documentation et des
études sur l’enfance23) et les établissements publics à caractère non administratif (ex. :
Centre de Recherches, d’Etudes, de documentation et d’Information sur la Femme
(CREDIF)24).On note également dans la législation tunisienne l’existence des
Observatoires et centres d’information, de formation, de documentation et des études
qui sont des établissements publics soit à caractère administratif soit à caractère non
administratif conformément au décret les créant25.
26 Les autorités administratives indépendantes26. On citera, principalement, l’Instance
nationale de protection des données à caractère personnel27
c) La multiplication des instances nationales indépendantes
27 Les instances nationales indépendantes prévues pour intervenir en matière de droits de
l’homme sont très nombreuses. Citons là encore en guise d’état des lieux :
28 Les instances ad hoc créées et disparues pendant la période de transition : l’Instance
supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et
de la transition démocratique28 ; Commission nationale d'investigation sur la
corruption et la malversation29 ; Commission nationale d'investigation sur les abus
enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu'à
l'accomplissement de son objet30.
29 Les instances préservées ou nouvellement créées : le Comité supérieur des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales31 ; l’Instance nationale indépendante pour la
réforme du secteur de l'information et de la communication (remplaçant le conseil
supérieur de la communication institué en 2008)32, la Haute Autorité Indépendante de
la Communication Audiovisuelle33, l’ Instance provisoire pour la supervision de la
justice judiciaire (remplaçant le conseil supérieur de la magistrature institué en 1969) 34,
l’ Instance supérieure indépendante pour les élections (remplaçant la 1 ère Instance
supérieure indépendante pour les élections créée en 2011)35, l’Instance nationale pour
la prévention de la torture36
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
118
30 Les instances constitutionnelles indépendantes prévues dans la nouvelle Constitution
promulguée le 27 janvier 2014 : l’instance des élections (art. 126 de la constitution),
l’instance de la communication audiovisuelle (art. 127 de la constitution), l’instance des
droits de l’homme (art. 128 de la constitution), l’Instance du développement durable et
des droits générations futures (art. 129 de la constitution), l’Instance de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption (art. 130 de la constitution).
2. Observations critiques
31 La pluralité des structures étatiques intervenant dans le domaine des droits de
l’homme en Tunisie, que l’on vient de présenter, n’a pas empêché les critiques à leurs
égards. Ces critiques se fondent généralement sur l’analyse de la législation, de la
doctrine, de la pratique, ou des rapports internationaux. La doctrine, les observateurs,
les organisations de la société civile et, en particulier, les défenseurs des droits de
l’homme n’ont pas manqué de relever certaines défaillances, lacunes et incohérences
entourant la manière dont les différentes structures étatiques participent à la décision,
à l’exercice du pouvoir et à la mise en œuvre de l’action publique en matière des droits
de l’homme. Plusieurs types d’insuffisances ont été soulignés.
a) Insuffisances liées aux compétences et aux attributions.
32 Pour certains, les structures étatiques œuvrant en matière des droits de l’homme en
Tunisie ne disposeraient pas de réel pouvoir décisionnel ; ils jouissent souvent de
pouvoirs principalement consultatifs. En outre, ils font l’objet de contrôles accrus : un
contrôle interne (appareil administratif) et/ou externe (pouvoir hiérarchique ou
autorité de tutelle)
b) Insuffisances liées à la composition
33 Certaines critiques visent les membres des structures étatiques. Elles s’adressent souvent
aux modalités de désignation et de révocation (membres généralement désignés et non
élus, ce qui pourrait affecter leur indépendance), au profil (membres ad honorem non
rémunérés), à la durée du mandat (parfois défaut de rotation entre les membres pour
garantir une certaine continuité), à la représentation prépondérante de l’exécutif et
réduite de la société civile, à l’indétermination des droits et des obligations (ce qui
affecteraient par la suite la détermination des responsabilités).
34 D’autres critiques portent sur le personnel des structures étatiques. Elles visent
généralement la composition du personnel (le personnel ne reflète pas parfois la
diversité de milieux, de compétences et de connaissances), le choix du personnel
(souvent la structure ne peut pas choisir et employer son propre personnel sur la base
d’exigence que lui seul détermine afin de garder l’indépendance de l’institution ;
certaines structures incluent des fonctionnaires détachés au sein de leur personnel au
détriment de leur propre personnel, ce qui représente un risque pour l’indépendance
de l’institution), l’immunité et la protection (le personnel ne jouit pas des privilèges et
immunités nécessaires à l’exercice indépendant de ses fonctions), la rémunération
(manque de rémunération adéquate en fonction des expériences et qualifications).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
119
c) Insuffisances liées aux modalités de fonctionnement
35 Sur ce plan, les structures étatiques sont critiquées pour le rattachement de leur
budget à l’organe de tutelle ou au budget de l’Etat, le manque des moyens matériels et
financiers pour pouvoir œuvrer tel que prévue dans leur mandat, l’absence de
représentation dans les régions, le manque de transparence (confidentialité des
audiences, des travaux, ou des rapports ; publication liée souvent à l’aval de l’autorité
de tutelle...), l’insuffisance des mécanismes de suivi et d’évaluation des propositions et
recommandations formulées, le manque d’efficacité (certaines structures se réunissent
une fois seulement par an).
B. La prolifération des acteurs non étatiques
36 La prolifération de nouvelles organisations, institutions et associations en Tunisie
depuis la Révolution, a fait qu’un nombre sans précédents de nouveaux acteurs
nationaux (1) et internationaux (2) compose la société civile. Dans la pratique, ces
différents acteurs sociaux semblent coexister et interagir en mêlant l’acceptation de
tensions et de conflits persistants et la reconnaissance et le respect des différences.
1. Foisonnement des Organisations de la Société Civile
37 Fréquemment, le terme « société civile » inclut des associations de participation
citoyenne marquant une opposition avec l’acteur « État ». L’Organisation des Nations
Unies définit ainsi la société civile comme « les associations de citoyens (…) auxquelles
ceux-ci ont décidé d’adhérer pour promouvoir leurs intérêts, leurs idées et leurs idéologies. Ce
terme ne renvoie pas aux activités à but lucratif (secteur privé) non plus qu’à l’action des
pouvoirs publics (secteur public). Présentent un intérêt particulier pour l’ONU les organisations
de masse (telles que les organisations de paysans, de femmes ou de retraités), les syndicats, les
associations professionnelles, les mouvements sociaux, les organisations de peuples autochtones,
les organisations religieuses et spirituelles, les associations d’universitaires et les organisations
non gouvernementales d’intérêt public»37. Nous dirons quelques mots respectivement, des
partis politiques des associations, des syndicats, des ordres professionnels et des
médias.
a) Les partis politiques
38 La légalisation de tous les partis politiques autrefois interdits est proclamée le 20
janvier 2011, soit sept jours après la Révolution. Le Rassemblement Constitutionnel
Démocratique, ancien parti au pouvoir, a été dissous par une décision de justice 38. Un
nouveau cadre juridique a été promulgué avec le décret-loi n°2011-87 du 24 septembre
2011, portant organisation des partis politiques39. Actuellement, plus de 160 partis
politiques exercent leurs activités au sein du système politique tunisien, contre 7 avant
la Révolution. Ces partis connaissent en ce moment d’importantes restructurations
sous forme de fusion ou de regroupement (front, mouvance, mouvement…).
b) Les associations
39 Bien que, pendant plusieurs décennies, la situation dans le pays n’ait pas été de nature
à encourager la société civile à œuvrer ouvertement pour les droits de l’Homme, la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
120
Tunisie a une longue tradition d’associations consacrées à la défense de ces droits.
Même sous l’ancien régime, une certaine société civile relativement indépendante a
existé, endurant une répression sévère et de graves violations des droits de l’Homme de
la part de l’Etat.
40 Le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 constitue le nouveau cadre juridique qui
régit les associations en Tunisie40. Ce texte établit un régime de déclaration
(notification) plutôt que d’autorisation (d’enregistrement) et facilite la coopération
entre les organisations non gouvernementales locales et internationales. De ce point de
vue, il est largement conforme aux normes internationales concernant la liberté
d’association.
41 La vie associative en Tunisie compte actuellement plus que 16 000 associations, contre
environ 9000 avant la Révolution. Les associations, instances, organisations
coordinations œuvrant dans les domaines ayant directement traits aux droits de
l’Homme avoisinent un millier (associations pour la promotion et la protection des
droits de l’enfant, de la femme, des personnes âgées, des personnes disparues… ;
associations de lutte contre la torture, la corruption, le chômage… ; associations pour le
développement de la transparence, de la bonne gouvernance, des régions
défavorisées…).
c) Les syndicats
42 Historiquement, les syndicats constituent une force vitale en Tunisie 41. L'Union
générale tunisienne du travail (UGTT) est la principale centrale syndicale de Tunisie
avec 750 000 adhérents. Elle a été fondée le 20 janvier 1946. Implantée pour l'essentiel
dans le secteur public, elle regroupe 24 unions régionales, 19 organisations sectorielles
et 21 syndicats de base. Certains lui reprochent néanmoins une centralisation du
pouvoir, une faible représentation des femmes et de certaines régions.
43 Après la Révolution, le pluralisme syndical est adopté : la Confédération générale
tunisienne du travail (CGTT), l'Union des travailleurs de Tunisie (UTT) et l'Organisation
tunisienne du travail (OTT) sont respectivement créés le 1 er février 2011, le 1er mai 2011
et le 26 août 2013.
d) Les ordres professionnels
44 Les organisations professionnelles jouent incontestablement un rôle important dans la
vie associative, particulièrement en ce qui concerne l’information, le contrôle,
l’évaluation et le suivi des politiques publiques. En Tunisie, les mouvements sociaux de
protestations déclenchés en décembre 2010 à Sidi Bouzid, se sont nettement amplifiés
avec la mobilisation et la grève des avocats suite à l'appel de l'Ordre national des
avocats de Tunisie.
45 Après la Révolution, l'Ordre national des avocats de Tunisie est considéré comme un
acteur social principal, et son rôle s’est manifestement accentué. Il fut ainsi un membre
actif de l'Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la
réforme politique et de la transition démocratique. Il est l’un des membres du Quartet
conduisant l’actuel dialogue national de sortie de crise.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
121
e) Les médias
46 Le secteur des médias en Tunisie compte depuis plusieurs années un large éventail de
chaînes de télévision (publiques et privées), stations de radio publiques et privées
(nationale et régionales), journaux et autres publications, dont le nombre est
considérablement renforcé après la Révolution. Ces médias sont restés les mêmes après
la Révolution, mais leur discours est désormais différent. Nombre d’entre eux ont
adopté une position critique à l’égard de la politique du Gouvernement, ce qui aurait
été impensable sous le régime précédent. La réglementation stricte à laquelle étaient
soumises les publications étrangères est, par ailleurs, considérablement assouplie.
47 Désirant remplacer les législations de la presse et de l’audiovisuel restrictives héritées
de l’ancien régime et faciliter la transition du pays vers la démocratie, en fournissant
des garanties juridiques pour un paysage médiatique libre, les autorités
postrévolutionnaires ont édicté un nouveau cadre législatif en la matière dont
principalement : le décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la
presse, l'imprimerie et l'édition et le décret-loi n°2011-116 du 2 novembre 2011 relatif à
la liberté de communication audiovisuelle et la création de la Haute Autorité
Indépendante de la Communication Audiovisuelle42.
48 Après une certaine réticence du Gouvernement, plusieurs mouvements de protestation
et des pressions exercées par les professionnels des médias et la société civile 43 et des
recommandations d’organisations internationales (gouvernementales et non
gouvernementales)44 ont finalement permis la mise en œuvre effective des dispositions
de ces deux textes avec notamment l’établissement et la nomination des membres de la
Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, le 3 mai 2013. Pour
les défenseurs de la liberté d’expression et de la presse, la mise en place de cette
instance indépendante d’autorégulation est le premier pas concret dans le processus de
réforme du secteur médiatique tunisien45.
49 Cependant, de l’avis de plusieurs observateurs, la plupart des acteurs sociaux dans la
Tunisie postrévolutionnaire souffrent d’une capacité d’organisation limitée. Il est
nécessaire, pour les aider à assumer leur rôle essentiel dans la société, de leur assurer
une formation et un soutien en matière de plaidoyer, de surveillance, de planification
organisationnelle et de communication. En outre, plus important encore, ces acteurs
doivent être sensibilisés aux droits de l’Homme et aux principes qui leur sont inhérents
afin de pouvoir œuvrer pour la pleine réalisation de ces droits 46.
50 Les observateurs relèvent également le problème épineux de la fragmentation et de la
politisation de la société civile, traditionnellement indépendante, après la Révolution
du 14 janvier 2011. Il est vivement recommandé à cet égard à tous les acteurs, étatiques
et sociaux, de faire des efforts pour que les différentes composantes de la société civile
puissent dialoguer et coopérer malgré leurs divergences idéologiques.
2. L’« avalanche » des acteurs internationaux
51 Etant le premier pays qui a déclenché l’étincelle de la Révolution et de la transition
dans les pays du « printemps arabe », la Tunisie a suscité un intérêt particulier auprès
des acteurs internationaux et régionaux : délégations officielles étrangères,
organisations internationales gouvernementales, organisation internationales non
gouvernementales, experts internationaux, centres de recherches, Cabinet de conseils,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
122
bureau d’études, banque de développement, médias… Les tunisiens assistent, à la fois
enthousiastes et perplexes, à une « avalanche » sans précédent de l’aide international.
52 Une Organisation non gouvernementale, l’Institut de Transitions Intégrés (ITIF), a
même mis en place le « Tunisia Transition Actor Mapping Project », dont le but est de
fournir un aperçu des principaux fournisseurs internationaux d’assistance techniques
aux décideurs tunisiens et aux acteurs de la société civile concernant les quatre
priorités stratégiques de la transition : la réforme des médias, la réforme judicaire, la
réforme du secteur de la sécurité et le chômage des jeunes. Le résultat de ce travail a
été publié, en mars 2013, dans un rapport intitulé : « Inside the transition bubble :
International Expert assistance in Tunisia »47.
53 Certains auteurs n’ont pas manqué néanmoins de relever « les effets pervers de ce qui a été
qualifié d’‘injonction démocratique’ sur la poursuite des processus démocratiques et sur
l’appropriation par les sociétés et populations des Etats aidés des valeurs démocratiques qui
risquent d’apparaître comme un article d’imploration accompagné de son cortège de modèles, de
techniques juridiques et d’articles politiques conçus ailleurs » 48. Pour Jean du Bois de
GAUDUSSON, « le discours dominant de la bonne gouvernance ne dissimule pas dans le fond,
bien que prétendant apolitique, l’adhésion à un projet politique qui tend à « dé-culturer » les
questions de gestion publique, les mécanismes fondamentaux de la démocratie ». Il enlève sa
charge idéologique et morale à la démocratie et aux droits de l’Homme, au nom d’un
universalisme qui est démenti à chaque volet du modèle (…) le champ politique en vient à être
considéré plus comme un lieu de gestion des ressources et un marché que comme un lieu d’accès
au pouvoir et aux processus de prise de position pour élaborer une projet de société » 49.
54 Ces critiques, bien que relativement fondées, ne peuvent dissimuler le rôle primordial
joué par les différents acteurs internationaux à l’appui des organisations de la société
civile tunisienne, après la Révolution du 14 janvier 2011, en particulier ceux qui
travaillent avec les défenseurs des droits de l’homme. Il y a lieu de noter,
particulièrement, les efforts inventifs déployés par les donateurs internationaux pour
que les composantes de la société civile travaillent main dans la main, au-delà des
clivages idéologiques et politiques.
II. L’accroissement de l’implication citoyenne dans la
gouvernance des droits de l’homme en Tunisie
postrévolutionnaire
55 Le plus grand défi auquel la Tunisie postrévolutionnaire est confrontée aujourd’hui est
la mise en place d’une nouvelle conception des institutions de l’Etat qui soient
entièrement responsables envers le peuple. Cette redéfinition exigera,
particulièrement, en matière des droits de l’homme, l’élaboration et la mise en œuvre
d’un nouveau cadre de gouvernance assurant une participation plus accrue et plus
effective de la société civile, à travers des mécanismes de dialogue plus ou moins
formels et plus ou moins poussés (information, consultation, discussion,
négociation…)50 (A).
56 Devant une hausse fulgurante des demandes sociales, une multiplication des acteurs et
des ressources toujours plus rares, il est indéniable que la Tunisie connait de nos jours
l’émergence d’une nouvelle démarche de gouvernance caractérisée par
l’approfondissement démocratique de la prise de décision et de l’action publique, et par
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
123
le déplacement progressif des légitimités de décisions et d’actions des acteurs étatiques
vers la société civile. Il est de plus en plus admis que les organisations, les usagers, les
experts ou les citoyens, sont mieux à même d’évaluer les besoins sociaux réels et de
proposer des solutions pertinentes. Ces acteurs sociaux doivent pouvoir
« contrebalancer » le poids des acteurs étatiques, pour ne faire de l’Etat qu’un acteur
« parmi les autres »51 (B).
A. L’amélioration de l’information de la société civile par l’Etat
57 L’information est une relation directionnelle de l’Etat vers les citoyens. C’est la
première étape à toute démarche de participation citoyenne. Il s’agit de donner le
sentiment au citoyen d’une attention particulière accordé à sa situation, en déployant
des efforts à son encontre. En matière des droits de l’homme, il est très important
d’informer en amont et en aval de la prise des décisions pour donner à la population le
sentiment d’être partie prenante au processus décisionnel. Les efforts entrepris, à cet
égard, par les pouvoirs publics tunisiens après la Révolution pour consolider sont
multiples et louables.
58 Le droit d’accès à l’information publique en Tunisie postrévolutionnaire évolue en effet
progressivement vers un partenariat entre l’administration et la société civile. En
atteste clairement, l’adoption du décret-loi n°41 du 26 mai 2011 relatif à l’accès aux
documents administratifs des organismes publics52.
59 Bien que certaines dispositions sont formulées d’une manière trop large et imprécises
laissant un champ considérable à l’interprétation, ce texte impose aux organismes
publics, pour la première fois en Tunisie, une obligation de communication dans le but
de promouvoir une culture de transparence et d’améliorer les relations entre le
gouvernement et les citoyens.
60 Il est utile de noter, à ce propos, l’initiative d’une association tunisienne qui a lancé en
juillet 2013 avec le soutien d’une organisation internationale la plateforme Marsoum 41
(qui signifie en arabe « Décret 41 »)53, un outil permettant de faciliter l’accès à
l’information publique en Tunisie. Ce portail internet permet en effet aux citoyens, via
un formulaire à compléter en ligne, d’adresser directement des demandes
d’information aux établissements publics tunisiens.
61 L’utilisation des NTIC pour mieux informer le public ne devient plus l’apanage des
organisations de la société civile tunisienne. Les acteurs étatiques se sont mis à
l’épreuve. Dans cette perspective, les Nouvelles technologies de l’information et de la
communication sont portées à être utilisées par les pouvoirs publics dans un esprit
d’ouverture, de transparence et de responsabilisation. A titre d’illustration, on peut
citer, d’une part, la création de sites web pour mieux informer sur législation, les
données et les politiques publiques (portail open data visant à faciliter l’accès aux
données publiques : http://www.data.gov.tn/ ; portail offrant des données sur les
marchés publiques : http://www.marchespublics.gov.tn ; portail d’information
juridique : www.legislation.tn ; portail de la justice en Tunisie : www.e-justice.tn ; pages
officiels sur les réseaux sociaux tels que la page du Ministère des Droits de l’Homme et
de la Justice Transitionnelle : https://www.ar-ar.facebook.com/mdhjt) ou, d’autre part,
l’utilisation des NTIC pour mieux impliquer les citoyens dans la formulation et la mise
en œuvre des normes et politiques publiques (portails permettant l’accès et le
commentaire des projets des textes juridiques : www.legislation.tn ; www.anc.tn portail
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
124
pour la lutte anti-corruption : www.anticor.tn ; http://www.anticorruption-
idara.gov.tn ; portail des consultations nationales en ligne : www.consultations-
publiques.tn).
B. Le renforcement de la coopération entre l’Etat et la Société civile
62 Dans nos sociétés contemporaines, comme le note à juste titre certains auteurs, les
rapports de pouvoir, mais aussi, les rapports d’autorité sont bouleversés. La
gouvernance se présente de plus en plus comme une alternative intéressante pour des
sociétés soumises à un véritable éclatement des sources d’autorité. Si le gouvernement
exerce habituellement son pouvoir à partir d’une source unique d’autorité, la
gouvernance repose sur une multiplicité des sources d’autorité, et par le fait même, de
pouvoir. Cela impose, notamment à l’État, de partager ce pouvoir avec des institutions
et des groupes avec lesquels il coopère. Le rapport de coopération devient ainsi de plus
en plus égalitaire entre les différents acteurs54. L’expérience de la société tunisienne
postrévolutionnaire en offre un exemple éclairant tant en ce qui concerne le recours
aux consultations (1) que l’institutionnalisation des mécanismes de dialogues et de
négociation (2).
1. Recours accru aux consultations
63 La consultation est une relation bidirectionnelle : l’acteur étatique concerné organise la
consultation et oriente la démarche et les questions adressées aux citoyens, qui en
retour, fournissent l’information nécessaire à l’acteur. Les autorités tunisiennes ont
multiplié, après la Révolution, la consultation des citoyens dans une logique de
recherche de consensus, et ce, au moyen de différents instruments, tels que les
communications, les comités consultatifs, les consultations nationales ad hoc, les
journées portes ouvertes, les journées d’information et de sensibilisation...
64 Ces consultations aident les autorités publiques à arbitrer, dans le domaine vaste des
droits de l’homme, entre les revendications et priorités concurrentes. Elles permettent
de mieux définir les politiques et élaborer les normes dans une perspective à plus long
terme.
65 Pour illustrer notre propos, il suffit de se référer aux consultations approfondies qui
ont accompagné deux textes fondamentaux dans l’expérience tunisienne
postrévolutionnaire : la Constitution, promulguée le 27 janvier 2014, et la loi organique
2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à
son organisation55.
2. Institutionnalisation des mécanismes de dialogue et de négociation
66 Signe de l’ère postrévolutionnaire en Tunisie, la formulation des politiques et des
stratégies, la résolution des conflits et des tensions, relatives notamment aux questions
politiques, sociales ou économiques, se font de façon accrue et d’une manière
permanente à travers les mécanismes de dialogue et de négociation sans qu’un des
acteurs concerné n’abuse de pression ou de coercition pour assurer son autorité. Les
exemples éloquents à cet égard ne manquent pas.
67 En premier, lieu citons l’exemple de l’actuel dialogue nationale de sortie de crise entre
l’Etat et l’opposition sous les auspices de la Société civile (initiative de la Quartette
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
125
(Union Générale Tunisienne du Travail, Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat, Ordre Nationale des Avocats de Tunisie, Ligue Tunisienne des Droits
de l’Homme), initié après l’assassinat d’imminents opposants politiques 56, et qui a
permis un transfert pacifique du pouvoir d’un gouvernement élu à un gouvernement
des compétences : une première dans l’Histoire politique de la Tunisie.
68 En deuxième lieu, citons l’exemple du dialogue national sur la justice transitionnelle
inauguré par les trois présidences en avril 2012, qui a impliqué plus de 2600
participants (représentant les différents régions et secteurs d’activité), plus de 70
organisations non gouvernementales, plusieurs experts internationaux, et qui a été
couronné en décembre 2013 par la promulgation de la loi relative à la justice
transitionnelle.
69 En troisième lieu, citons l’exemple du nouveau pacte social signé deux ans après la
Révolution, qui visent entre autres d’institutionnaliser un dialogue tripartite
permanent, régulier et global sur des questions d’intérêt commun au gouvernement, à
l’Union Générale Tunisienne du Travail et à l’Union tunisienne de l’Industrie, du
commerce et de l’Artisanat.
Conclusion
70 Dans le sillage de la Révolution du 14 janvier 2011, les droits de l’homme et les libertés
fondamentales ont besoin d’être renforcés. Conscient de ce but commun les parties
prenantes en Tunisie s’efforcent de façonner un modèle, aussi « inspiré » et « singulier
» que la Révolution, prenant particulièrement en compte les conflits et les tensions, et
s’appuyant sur un mode de gouvernement plus ouverts, plus participatif, et plus
inclusif.
71 Dans cette quête de compromis et de consensus, la communauté internationale a un
rôle primordial à accomplir, au-delà de l’aide financière ou technique : encourager,
sans parti pris, les différents acteurs à travailler main dans la main, loin des clivages
idéologiques ou politiques. C’est à ces conditions, seulement, que l’Etat profond,
autoritaire et corrompu, cèdera la place, sans risque de retour, à l’Etat de droit. Faut-il
rappeler qu'« il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression »57.
NOTES
1. Cette communication a été présentée à la Table ronde : "les Printemps arabe et les Droits
de l'Homme", organisée par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux
(CREDOF) à l'Université Paris Nanterre, Paris, France, le 10 Octobre 2013 ; une simple
mise à jour a été effectuée en avril 2014. Les points de vus exprimés dans cette
présentation ont caractère purement académique. Qu’il me soit permis, en avant-
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
126
propos de remercier les organisateurs de cette table ronde pour l’intérêt porté au «
printemps arabe » et aux « droits de l’homme », en particulier Mme. Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS et M. Malik BOUMEDIENE.
2. Sur l’exigence d’élucider les sens des mots dans une discipline, se rapporter très utilement à
l’ouvrage publié sous la direction de TUSSEAU Guillaume, Les Notions juridiques, Paris, Economica,
2009, 165 p.
3. Cette définition est inspirée de l’excellent article de LACROIX Isabelle et ST-ARNAUD Pier-
Olivier, « La gouvernance : tenter une définition », in Cahier de recherche en politique appliquée,
Automne 2012, Vol. IV, n°3, pp. 19-37. La littérature contemporaine offre un nombre considérable
d’études sur la notion de gouvernance, on se contentera de renvoyer aux références
bibliographiques citées par certains auteurs : LACROIX Isabelle et ST-ARNAUD Pier-Olivier, idem,
BASLE Maurice, « Evaluation des politiques publiques et gouvernance à différents niveaux de
gouvernement », in Cahier économique de Bretagne, 2000, n°2, pp.17-24.
4. Sur la notion de « bonne gouvernance », V. notamment, SMOUTS Marie-Claude,
BATTISTELLA Dario et VENNESSON Pascal, Dictionnaire des relations internationales :
Approches concepts doctrines, Paris, Dalloz, 2003, 553 p.
5. V. notamment, Union Européenne (U.E), « Gouvernance européenne (Un livre blanc) », sur le site
de la Commission européenne, [en ligne], eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/
com2001_0428fr01.pdf (page consultée le 30 septembre 2013).
6. V. en ce sens, par exemple, l'avis du Comité économique et social sur « le rôle et la
contribution de la société civile organisée dans la construction européenne », JO C 329
du 17.11.1999, p. 30.
7. CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, 1ère éd., Puf/Delta, Paris, 1987 ; En la matière la
doctrine est extrêmement abondante, on se limitera à renvoyer à la bibliographie citée dans des
articles encyclopédique dont notamment, SUDRE Frédéric, « Droits de l’Homme », in Rép. Inter.
Dalloz, Paris, Dalloz, 1998.
8. Sur cette question on se permet de renvoyer avec intérêt au document de travail élaboré par
M. Wahid FERCHICHI, « les structures officiels des Droits de l’Homme en Tunisie », version
préliminaire non publié, Kawakibi Democracy Transition Center et GIZ, mai 2013.
9. JORT 25 mars 2011 n°20. Ce texte est sorti de vigueur après l’adoption par l’ANC de loi
constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics, JORT 20 et 23 décembre 2011 n°97.
10. International Crisis Group Working to prevent conflict Worldwide, Tunisie : lutter contre
l’impunité, restaurer la sécurité, Rapport Afrique du Nord/Moyen-Orient n°123, 9 mai 2012, p. 1.
11. La première Assemblée nationale constituante a été élue au mois de mars 1956. La
Constitution a été adoptée le 1er juin 1959 et la République proclamée le 25 juillet 1957.
12. Décret n°1051-2006 du 20 avril 2006, JORT 25 avril 2006 n°33.
13. Décret n°2010-3080 du 1 er décembre 2010, 7 décembre 2010 n°98 tel que modifié et complété
par le décret n°2012-1425 du 31 août 2012, 31 août 2012 n°69.
14. Décret n°2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des Droits de
l’Homme et de la Justice transitionnelle et fixation de ses attributions ; Décret
n°2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à l'organisation du ministère des droits de
l'Homme et de la Justice transitionnelle, JORT 20 janvier 2012 n°6.
15. V. en ce sens, Wahid (FERCHICHI (dir.), La justice transitionnelle en Tunisie : Absence de stratégie
et prépondérance d’improvisation 14 janvier/23 octobre 2011 (Synthèse), mai 2012.
16. International Crisis Group Working to prevent conflict Worldwide, Rapport précité, p. 21.
17. Idem, p. 23.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
127
18. V. par exemple : ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des Droits
de l’Homme, Mission en Tunisie (27 Septembre – 5 Octobre 2012), A/HRC/22/47/Add.2 (Future), n°53, 22
Novembre 2012.
19. V. en ce sens, M. Wahid FERCHICHI, « les structures officiels des Droits de l’Homme en
Tunisie », précité ;
20. Décret n°1993-147, JORT 26 janvier 1993 n°7.
21. L’établissement public constitue un mode institutionnel de gestion des services publics. Il est
doté par son texte constitutif de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Une
classification consacrée distingue les établissements publics à caractère administratifs (EPA) des
établissements publics à caractère non administratif (EPNA). Les EPA sont chargé de service
public administratif et soumis, sauf exception, au droit public, BEN ACHOUR Yadh, op.cit., n°320 et
s.
22. C’est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, loi n°1993-51 du 3 mai 1993, JORT 11 mai 1993 n°35.
23. C’est un établissement public à caractère administratif, décret n°2002-327 du 14 février 2002,
JORT 22 février 2002 n°16, tel que modifié et complété ultérieurement.
24. Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. Le Centre est régi par la législation commerciale dans la
mesure où il n’est pas dérogé par la loi de création. Il est rattaché au Premier ministère et placé
sous la tutelle du secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et
de la famille. Le Centre est administré par un conseil d’administration présidé par un président
directeur général nommé par décret. Loi n°1992-121 du 29 décembre 1992 portant création du
Centre de Recherches, d’Etudes, de documentation et d’Information sur la Femme, telle que
modifiée et complétée ultérieurement, JORT 31 décembre 1992 n°88.
25. Loi n°1999-100 du 13 décembre 1999, telle que modifié et complété ultérieurement, JORT 17
décembre 1999 n°101.
26. Les autorités administratives indépendantes se situent à la frontière de l’administration
décentralisée et de l’administration déconcentrée. Sans avoir, en principe, la personnalité
juridique de la première catégorie, elles échappent au pouvoir hiérarchique de la seconde. Ce
sont des autorités. A ce titre, elles bénéficient de larges pouvoirs de décision. Ce sont des
autorités administratives. Elles restent donc comprises dans l’administration étatique, dépendant
du pouvoir exécutif. Ce sont des autorités indépendantes qui ne sont soumises ni à la hiérarchie,
ni à la tutelle de l’administration centrale, BEN ACHOUR Yadh, op.cit., n°17.
27. L’instance dispose de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière. Le budget de
l’Instance est rattaché au budget du ministère chargé des droits de l’Homme. Le président et les
membres de l’Instance sont désignés, pour trois ans, par décret, loi organique n°2004-63 du 27
juillet 2004, JORT 30 juillet 2004 n°31.
28. Instance publique indépendante, décret-loi n°2011-6 du 18 février 2011, JORT 22 février 2011
n°13.
29. Instance publique indépendante, décret-loi n°2011-7 du 18 février 2011, JORT 22 février 2011
n°13.
30. Instance publique indépendante, décret-loi n°2011-8 du 18 février 2011, JORT 22 février 2011
n°13.
31. C’est une institution nationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière, loi 2008-37 du 16 juin 2008, JORT 24 juin 2008 n°51. Cependant, elle n’est pas
considérée comme une institution nationale indépendante par le Comité international
de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme, qui accrédite les institutions sur la base des Principes de 1993
concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
128
droits de l’homme (Principes de Paris). Le Gouvernement provisoire a fait part, à la
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, de son
intention de réviser le statut du Comité de façon à doter celui-ci d’un mandat conforme
aux Principes de Paris; un projet de loi a été rédigé à cet effet, Rapport précité, n°54.
32. Instance nationale indépendante, décret-loi n°2011-10 du 2 mars 2011, JORT 4 mars 2011 n°14.
33. C’est une instance publique indépendante dotée de la personnalité civile et de
l’autonomie financière, décret-loi n°2011-116 du 2 novembre 2011, JORT 4 novembre
2011 n°84.
34. C’est une instance provisoire indépendante jouissant de l'autonomie administrative et
financière, loi organique n°2013-13 du 2 mai 2013, JORT 7 mai 2013 n°37.
35. C’est une instance publique indépendante et permanente dotée de la personnalité morale et
de l'autonomie administrative et financière, loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012, JORT
n°101 du 21 décembre 2012.
36. C’est une instance nationale indépendante, loi organique n°2013-43 du 23 octobre
2013, JORT n°85 du 25 octobre 2013.
37. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES. « Nous, peuples : société civile,
Organisation des Nations Unies et gouvernance mondiale. Rapport du Groupe de
personnalités éminentes sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la
société civile », Site de l’Organisation des Nations unies, http://www.un.org/reform/
a58_817_french.doc, p.15.
38. TPI de Tunis, affaire n°14332 du 9 mars 2011.
39. JORT 30 septembre 2011 n°74.
40. JORT 30 septembre 2011 n°74.
41. La Confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT) est le 1 er syndicat
tunisien fondé le 3 décembre 1924 par Mohamed Ali El Hammi. Elle sera dissoute plus
tard.
42. JORT 4 novembre 2011 n°84.
43. V. en ce sens, Nejiba HAMROUNI, Kamel LABIDI, Nabil JMOUR, « Lettre ouverte au
sujet de la création de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle », Site
web de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information et la Communication (INRIC), 2
avril 2013, [en ligne] http://www.inric.tn/fr/index.php?
option=com_content&view=category&id=1&layout=blog&Itemid=156 (page consultée le
5 octobre 2013).
44. V. par exemple, ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs
des Droits de l’Homme, Mission en Tunisie (27 Septembre – 5 Octobre 2012), précité, n°61 et s. ;
Human Rights Watch (HRW), Rapport mondial 2013 (version abrégé), Site web de HRW, 31
janvier 2013, [en ligne] http://www.hrw.org/fr/reports/2013/01/31/rapport-
mondial-2013-version-abregee (page consultée le 5 octobre 2013), p. 167 ; Organisation
ARTICLE 19, « Tunisie règlementation de l’audiovisuel », Site web ARTICLE 19, 30 avril
2012, [en ligne] http://www.article19.org/resources.php/resource/2942/fr/tunisie-:-
r%EF%BF%BD%C2%A9glementation-de-l%E2%80%99audiovisuel , (page consultée le 5
octobre 2013).
45. V. par exemple, Reporters Sans Frontières (RSF), « La HAICA voit enfin le jour », Site
web de RSF, 7 mai 2013, [en ligne] http://fr.rsf.org/tunisie-la-haica-voit-enfin-le-
jour-07-05-2013,44578.html (page consultée le 5 octobre 2013).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
129
46. V. en ce sens : ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des Droits de
l’Homme, Mission en Tunisie (27 Septembre – 5 Octobre 2012), A/HRC/22/47/Add.2 (Future), idem.
47. Institute For Integrated Transitions (IFIT), « Inside the transition bubble : International Expert
assistance in Tunisia » Site web de l’IFIT, Avril 2013, [en ligne] http://www.ifit-transitions.org/
publications/inside-the-transition-bubble-international-expert-assistance-in-tunisia (page
consultée le 5 octobre 2013).
48. DE GAUDUSSON Jean du Bois, « Droits, démocratie, bonne gouvernance et Francophone :
Interrogations sur l’opportunité de reconnaitre un « droit à la bonne gouvernance » »,
Marrakech, 26-28 février 2004, p. 117.
49. DE GAUDUSSON Jean du Bois, idem.
50. OCDE. « Des citoyens partenaires. Information, consultation et participation à la
formulation des politiques publiques », Site web de l’Organisation de Coopération et de
Développement économique, [En ligne].
51. Expressions empruntées de l’article de LACROIX Isabelle et ST-ARNAUD Pier-Olivier, précité.
La littérature contemporaine offre un nombre considérable d’études sur la notion de
gouvernance, on se contentera de renvoyer aux références bibliographiques citées par certains
auteurs : LACROIX Isabelle et ST-ARNAUD Pier-Olivier, idem, BASLE Maurice, « Evaluation des
politiques publiques et gouvernance à différents niveaux de gouvernement », in Cahier économique
de Bretagne, 2000, n°2, pp. 17-24.
52. JORT 31 mai 2011 n°39.
53. L’association « Touensa » ; Portail : www.marsoum41.org
54. KHOSROKHAVAR, Farhad « La gouvernance et la place du politique. Gouvernance, État et
société civile », La démocratie à l’épreuve de la gouvernance, Ottawa, Les Presses de l’Université
d’Ottawa, 2001, p. 122
55. JORT 31 décembre 2013 n°105.
56. Chokri BELAID homme politique et avocat assassiné le 6 février 2013 ; Mohamed BRAHMI
homme politique assassiné le 25 juillet 2013.
57. Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, ONU 10 décembre 1948.
ABSTRACTS
Sign of the post-revolutionary time in Tunisia, the governance of human rights knows a period of
"democratic transition” towards a more “opened”, “inclusive” and “participative” model. After
the Revolution of January 14 January 2011, the Tunisian civil society has gradually forged the role
of a key player in making decision and implementing public policies on human rights; the state,
once omnipotent, appears now as a "player among others". In this new mode of governance, the
plurality of state actors is "offset" by the proliferation of social actors. Other highlights:
institutions, rules, mechanisms, and processes relating to human rights are, increasingly,
formulated, legitimized, implemented and controlled in terms of the involvement citizen, away
from ideological or political differences, through information, consultation, dialogue and
negotiation. Tensions, crises and contradictions of Tunisian society in transition, inherent to the
social, economic, political and geographical difficulties, are treated by state and social actors in
an approach of compromise and consensus. The Revolutionary legitimacy gives way to the
consensual legitimacy.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
130
Signe des temps postrévolutionnaire en Tunisie, la gouvernance des Droits de l’Homme connait
une période de « transition démocratique » vers un modèle plus « ouvert », plus « inclusif » et
plus « participatif ». Après la Révolution du 14 janvier 2011, la société civile tunisienne s’est forgé
progressivement le rôle d’un acteur incontournable dans la prise de décision et la mise en œuvre
des politiques publiques relatives aux Droits de l’Homme. L’Etat, jadis omnipotent, apparaît
désormais comme un « acteur parmi les autres ». Dans ce nouveau mode de gouvernance, la
pluralité des acteurs étatiques est « contrebalancer » par le foisonnement des acteurs sociaux.
Autres faits marquants : les institutions, les règles, les mécanismes, et les processus portant sur
les Droits de l’Homme sont, de plus en plus, élaborées, décidées, légitimées, mises en œuvre et
contrôlées sous l’angle de l’implication citoyenne, loin des clivages idéologiques ou politiques, à
travers les techniques de l’information, de la consultation, du dialogue et de la négociation.
Les tensions, les crises et les contradictions de la société tunisienne en transition, inhérentes au
contexte social, économique, politique et géographique difficile, se traitent par les acteurs
étatiques et sociaux dans une approche de compromis et de consensus. La légitimité
révolutionnaire cède la place à la légitimité consensuelle.
INDEX
Mots-clés: Gouvernance - Droits de l’Homme - transition démocratique - société civile -
politiques publiques - l’implication citoyenne - légitimité révolutionnaire - légitimité
consensuelle
Keywords: Governance - Human Rights – Democratic transition - Civil society - Public policies -
Citizen involvement - Revolutionary legitimacy – Consensual legitimacy
AUTHOR
SOUHEIL KADDOUR
Souheil KADDOUR (1972, Tunisie) est actuellement Conseiller du Ministre de la Justice, des Droits de
l’Homme et de la Justice Transitionnelle. De janvier 2012 à février 2014, il a occupé les mêmes
fonctions, au Cabinet du Ministre des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle.
De 2001 à 2012, il est Enseignant Chercheur à l’Université de Sousse et Expert juridique auprès de
divers organismes, publics et privés, nationaux et internationaux.
Il a publié plusieurs études et a participé à diverses conférences, nationales et internationales,
dans les domaines de Droit fiscal, de Gouvernance, des Droits de l’Homme, de Justice
transitionnelle et de légistique.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
131
De l’opposition constituante à
l’opposition
constitutionnelle : réflexion sur la
constitutionnalisation de
l’opposition parlementaire à partir
des cas tunisien et marocain
Antonin Gelblat
« La démocratie ne saurait exister sans majorité
et minorité, majorité et opposition. »1
Moncef MARZOUKI
Président de la République tunisienne
1 Les printemps arabes, ces phénomènes révolutionnaires portés par des aspirations
démocratiques ont, suite à l’immolation de Mohammed BOUAZIZI le 17 décembre 2010,
embrasés le monde arabe, et conduit, plus ou moins directement, à l’adoption des
nouvelles constitutions marocaine du 01 juillet 2011 et tunisienne du 26 janvier 2014.
L’aspiration démocratique aurait donc trouvé une traduction constitutionnelle dans ces
deux Etats. Ainsi, après une méfiance première à l’égard de ces mouvements
révolutionnaires2, les observateurs ont, pour la plupart, salué l’adoption de ces
nouvelles constitutions supposées permettre d’instaurer ou de renforcer la démocratie,
l’Etat de droit et le respect des droits et libertés dans les Etats qui s’en sont dotés. Il en
irait d’ailleurs ainsi de la constitutionnalisation des droits de l’opposition
parlementaire, comme l’exprime le Président MARZOUKI lorsqu’il établit un lien
consubstantiel entre démocratie et opposition. Pourtant, et alors même qu’elle est, en
France, souvent saluée comme un fleuron du constitutionnalisme, cette inscription de
l’opposition parlementaire au sein du texte constitutionnel est relativement rare au
regard du droit comparé3. Les constituants se sont, pour la plupart, gardés d’inscrire
l’opposition au sein même de leurs textes fondamentaux.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
132
2 Cette réticence s’explique peut-être par la difficulté à définir une telle notion qui
renvoie à « une réalité insaisissable quelque part entre droit et politique, entre le jeu des
institutions et celui des rapports de forces »4. L’opposition se conçoit donc d’abord comme
« une activité politique » et serait « autant une action qu’une institution, celle-ci
précédant celle-là »5. Pour le professeur PIMENTEL, elle est « un rôle, une fonction endossée
par un groupe, mais non pas ce groupe lui-même »6. L’opposition se distingue donc de la
minorité car cette dernière ne suppose pas de jugement à l’égard du titulaire du
pouvoir, l’opposition en revanche désapprouve son positionnement politique et se
pose, généralement, en alternative. Faute de définition satisfaisante, l’opposition
s’appréhende alors le plus souvent à travers un ensemble de distinctions. On différencie
en fonction de son envergure l’opposition nationale ou locale. De même, selon le lieu où
elle s’exprime, elle peut-être parlementaire, partisane ou civile. L’opposition peut
également être différenciée en fonction de sa cible : la majorité, le Gouvernement, le
Chef de l’Etat ou enfin le régime en tant que tel. L’opposition est donc d’abord conçue
comme une activité plurielle, complexe, dont les manifestations varient en fonction de
la conjoncture politique. Son appréhension juridique ne va donc pas sans difficultés
puisque celle-ci entraine nécessairement un changement dans la manière de concevoir
l’opposition, non plus comme une activité politique mais comme une institution
juridique, conformément à l’idée exprimée par le doyen FAVOREU, selon laquelle, non
seulement « la politique est saisie par le droit » mais, surtout, elle devrait l’être 7.
3 Cette constitutionnalisation de l’opposition doit permettre, selon ses promoteurs, de
garantir le pluralisme politique et, partant, la démocratie. L’opposition, considérée
comme « une valeur en soi »8, consubstantielle à un régime démocratique et libéral,
serait protégée contre les risques de « tyrannie de la majorité » 9 et mieux à même de
jouer son rôle de contre-pouvoir. Cette reconnaissance constitutionnelle est alors vue
comme un progrès permettant de garantir le caractère démo-libéral des régimes ainsi
institués10. L’idée de « droits » conférés à l’opposition vient d’ailleurs renforcer
opportunément cette idée. Le professeur AVRIL faisait déjà ce constat au sujet du cas
français : « le vocabulaire du constituant mérite attention, pas seulement l'épithète ‘spécifiques’
mais aussi le mot ‘droits’ qui, parce qu'il s'oppose implicitement aux pouvoirs de la majorité,
comporte quelque chose de contentieux et de revendicatif sur quoi il faudrait s'arrêter » 11. Ce
mot évoque en effet une analogie entre les droits et libertés constitutionnellement
reconnus aux citoyens et les droits constitutionnels de l’opposition. Ces derniers
reproduiraient au sein du système politique, la dynamique minoritaire à l’origine de la
constitutionnalisation des premiers. L’octroi de droits constitutionnels à l’opposition
procéderait, in fine, d’une volonté de mieux garantir les droits et libertés
constitutionnelles, ce que nous chercherons à vérifier dans le cadre de la présente
étude. Mais celle-ci se verra nécessairement limitée par un regard étranger, d’abord, et
par l’absence de recul, ensuite, puisque les événements étudiés sont extrêmement
récents. Le présent travail revêt donc une dimension prospective et la volonté de
démonstration est susceptible de l’emporter sur la prudence nécessaire.
4 Il apparait toutefois, malgré ces incertitudes, que la constitutionnalisation des droits de
l’opposition parlementaire ne relève pas d’une logique de garantie des libertés
politiques contrairement à ce que la rhétorique utilisée suggère. Il ne s’agit pas de
reconnaitre des droits à l’opposition pour limiter le pouvoir de la majorité
conformément à l’idéal constitutionnaliste. L’inscription des droits de l’opposition dans
la constitution est d’abord dictée par des considérations politiques. Elle procède
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
133
davantage d’une volonté de légitimer le pouvoir que de le contraindre. Le constituant,
tunisien comme marocain, cherche, en reconnaissant l’opposition, à pérenniser son
œuvre en la présentant comme consensuelle, ce qui passe toutefois par la négation des
oppositions à son projet constitutionnel (I). Dès lors, la constitutionnalisation des droits
de l’opposition risque, contrairement à l’objectif affiché, de renforcer le pouvoir de la
majorité et la dépendance de l’opposition à son égard (II).
I. L’octroi d’un statut a une opposition parlementaire
pourtant ignorée du processus constituant
5 Le processus constituant a été marqué par le peu de considération apporté par le
rédacteur de la Constitution aux différentes formes d’oppositions qui se manifestent au
cours du processus constituant et se voient contraintes de mettre en œuvre des
stratégies d’obstruction (A). Les relations qu’entretient le titulaire du pouvoir
constituant avec ses opposants peuvent alors permettre de mieux comprendre les
considérations qui ont présidé à la reconnaissance constitutionnelle des droits de
l’opposition parlementaire (B).
A. Des oppositions minimisées au cours du processus constituant
6 En Tunisie comme au Maroc, la volonté de légitimer la Constitution en cours
d’élaboration implique de mettre en scène un consensus constituant (1) et de minimiser
les oppositions qui se manifestent à l’encontre du projet de constitution (2).
1) L’impossible opposition constituante
7 Dans les deux Etats, le choix de procéder à une nouvelle Constitution ne peut pas, du
fait du contexte révolutionnaire, faire l’objet d’une opposition politique. En Tunisie, le
processus constituant est bien le fruit d’une révolution au sens juridique du terme
puisqu’elle a conduit à la suppression de l’ordre constitutionnel en dehors des formes
prévues par celui-ci, par un pouvoir de fait12. Or cette révolution entraine une
dissolution de l’opposition parlementaire et une absence d’opposition au choix
constituant ensuite. La suppression de l’ancien régime et de son opposition
parlementaire débute avec la fuite du président BEN ALI le 14 janvier 2011. Après
l’annonce par le Conseil constitutionnel de l’empêchement absolu du Président 13, les
chambres, dont la composition portait la marque de l’ancien régime, vont, le 09 février
2011, se dessaisir de leur pouvoir législatif au profit du Président intérimaire. A cette
date, il n’existe donc plus à proprement parler d’opposition parlementaire, et la
déclaration du Président par intérim du 3 mars 2011 annonçant l’élection d’une
assemblée constituante enterre définitivement la Constitution du 1 er juin 1959 14.
L’instant révolutionnaire dissout toute forme d’opposition parlementaire issue de
l’ancien régime mais rend également impossible toute forme d’opposition au choix
constituant. Emportée par la vague révolutionnaire, l’opposition n’est pas en mesure de
s’exprimer puisque « le peuple souverain recouvre sa souveraineté et aucun acteur politique
identifié ne peut revendiquer une légitimité révolutionnaire sinon le peuple lui-même » 15. Les
partis appellent donc presque unanimement à l’élection d’une Assemblée
constituante16.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
134
8 Au Maroc au contraire, le processus constituant vise à endiguer une révolte (et
potentielle révolution) mais ne laisse pas davantage de place à la possibilité d’une
opposition au choix constituant. La réforme constitutionnelle est, au moins
partiellement, une conséquence des luttes du Mouvement populaire du 20 février
(M20F) qui réclamait l’instauration d’une monarchie parlementaire et a surpris les
partis politiques représentés au Parlement qui ne se joignent que timidement au
mouvement17. Cette frilosité de la scène partisane, « dans sa grande majorité réticente à se
solidariser avec la mobilisation, illustre l’atomisation et la domestication du champ politique par
le roi »18. L’opposition partisane et parlementaire semble avoir des difficultés à se
positionner par rapport à l’opposition « civile » incarné par le M20F 19. Le roi reprend
l’initiative en annonçant, le 21 février 2011, sa volonté de procéder à une réforme
constitutionnelle qui coupe court aux revendications du M20F et de l’opposition
parlementaire, sans paraitre céder à leurs pressions. Il manifeste sa volonté que «
chaque chose soit abordée au moment opportun, c’est-à-dire quand le monarque en prend
l’initiative et dans les termes qu’il choisit, sans que l’on puisse en retirer l’impression qu’il agit
sous la pression des évènements et qu’il ferait des concessions à des revendications inédites » 20.
Le discours royal du 09 mars 2011 le confirme. MOHAMMED VI n’y présente pas sa
décision de procéder à une réforme constitutionnelle profonde (incluant
l’affermissement du statut de l’opposition parlementaire) comme une réaction au
mouvement de protestation, mais l’inscrit dans un processus de modernisation plus
vaste. Le roi aurait, depuis son accession au trône, aménagé les circonstances propices
au changement constitutionnel.21. Cette annonce permet indubitablement au roi de se
présenter comme l’initiateur d’une réforme constitutionnelle dont il délimite à sa guise
les contours. Seule institution dotée d’une légitimité suffisante pour procéder à une
réforme souhaitée par ses opposants (davantage que par ses alliés), le roi annihile la
possibilité d’une contestation du choix constituant.
9 La Constitution, parce qu’elle est considérée comme un acte fondateur exprimant
directement la volonté du peuple souverain, implique donc la mise en scène d’un
consensus quant à la manière dont elle doit être élaborée. Ainsi, la force politique
détentrice du pouvoir constituant pare des atours de l’unanimisme la procédure
d’élaboration qu’il a déterminé. En Tunisie, la chute du régime ouvre une période
transitoire qui, jusqu’à l’élection de l’Assemblée nationale constituante, est marquée
par la volonté de créer « l’image lisse d’une démocratisation non problématique et
consensuelle »22. Il en va par exemple ainsi, au sein de l’Instance supérieure pour la
réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition
démocratique, organe ad hoc accueillant les représentants, bien que non élu, de
l’opposition historique au régime pour participer à la définition de la procédure
constituante23. Même si certaines tensions apparaissent au sein de ce « Protoparlement »
et commencent à structurer le futur paysage politique, il apparait difficile d’y voir une
véritable opposition parlementaire24. Si des conflits politiques surgissent dès cette
période, ils ne peuvent être institutionnalisés ni même exposés 25.
10 Au Maroc au contraire, le roi détermine seul la procédure constituante à suivre. Même
s’il la présente comme participative, sa définition est bien unilatérale. La révision
constitutionnelle est confiée à une Commission Consultative de Révision de la
Constitution (CCRC) dont les travaux sont, dans un délai de trois mois, proposés au roi
avant d’être soumis à un referendum26. Dès lors, le roi n’inclut pas le Parlement dans le
processus constituant et l’opposition parlementaire s’en voit ainsi exclue faute d’avoir
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
135
pu participer à sa définition27. Cette commission se voit tout de même adjointe une
instance dite « Mécanisme de suivi politique de la réforme constitutionnelle » dirigée
par le conseiller du souverain et composée des chefs des partis politiques et syndicats.
Il apparait alors, comme l’écrit le professeur BENDOUROU, que « ladite instance a pour but
de pallier le déficit de légitimité politique et démocratique dont souffre la commission
consultative »28. Elle est donc le lieu au sein duquel l’opposition parlementaire est invitée
à participer à la réforme constitutionnelle. Une telle instance permet alors de mettre
en scène un consensus ou du moins, un jeu de consensus 29.
2) La difficile opposition au projet constitutionnel
11 S’il est possible d’identifier différentes expressions d’une opposition au projet
constitutionnel, celles-ci sont réprimées par le titulaire du pouvoir constituant et
dépourvue de toute protection juridique. Ainsi, l’élection de l’Assemblée nationale
constituante tunisienne (ANC) a conduit à une structuration des forces politiques et à
une reformation de l’opposition. Pourtant le scrutin proportionnel et les phénomènes
de circulation des constituants entre groupes parlementaires n’en favorisaient pas
l’émergence30. C’est la question de l’étendue des pouvoirs de l’ANC qui va la première y
contribuer. Autrement dit, si la définition du processus constituant relevait du
consensualisme, sa mise en œuvre concrète relève désormais du principe majoritaire.
Selon la conception ainsi développée, l’élection confère « à des représentants la pleine
légitimité du suffrage universel pour conduire le travail d’établissement de la nouvelle
constitution. Et c’est bien ainsi que les vainqueurs de l’élection, détenteurs d’une majorité de
sièges à l’ANC, entendront la portée de ce scrutin. La souveraineté du peuple s’exerce à travers
celle de l’Assemblée…et donc de sa majorité »31. La minorité considère au contraire qu’il
convient de prendre en compte la nature spécifique de l’ANC et exige le maintien d’une
procédure consensuelle32. Or, si la loi relative à l’organisation des pouvoirs publics
aboutit tout de même à un compromis33, il n’en demeure pas moins que la procédure
définie laisse peu de place à l’expression d’une opposition 34. Si Ennahdha accepte
certaines concessions, c’est sans doute moins pour satisfaire ses opposants que pour
s’assurer du maintien de sa propre coalition. Ainsi, le parti majoritaire, « a contribué à
alimenter la bipolarisation […] de la scène politique tunisienne » provoquant la rupture du
paradigme consensualiste et la recomposition d’une opposition de type
parlementaire35. Ennahdha s’en accommode pourtant difficilement comme l’illustre
d’abord sa proposition de loi d’immunisation politique défavorable à l’opposition 36. Il
est surtout accusé d’une bienveillante neutralité à l’égard des assassinats politiques
d’opposants perpétrés par certains groupes radicaux37. Enfin, en novembre 2013, sa
tentative de révision du règlement intérieur de l’ANC, présentée comme une
modification technique visant à adapter le rythme des travaux de l’Assemblée à la
feuille de route décidée par le Dialogue national, a été dénoncée par l’opposition
comme une volonté d’affaiblir les prérogatives du Bureau de l’ANC et de son président
au profit de la seule majorité.
12 Au Maroc, la volonté royale de donner à voir une réforme constitutionnelle
consensuelle conduit également à minorer les critiques formulées à l’encontre de
l’avant-projet. Les modalités de travail de la CCRC permettent de maintenir l’apparence
d’un travail consensuel. Les différents partis ayant accepté l’initiative royale n’ont eu
qu’un mois pour faire connaitre leurs propositions à la Commission. A l’issue de ces
consultations, les partis représentés au sein du Mécanisme de suivi et de concertation
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
136
n’ont eu qu’un accès partiel à l’avant-projet, ce qui a provoqué le départ de certains
d’entre eux. Le roi, après avoir sans doute amendé le projet élaboré par les experts, en a
présenté les grandes lignes par un discours dès le 17 juin, en même temps qu’il
annonçait la tenue d’un référendum pour le 1er juillet. La procédure constituante est
donc marquée par la « précipitation qui a entouré l'adoption de la nouvelle Loi fondamentale ;
norme adoptée en urgence alors qu'une autre consultation d'envergure (celle sur la
régionalisation) était en cours. Plus encore qu'une rapidité ce sont les rapidités d'exécution qui
sont ici surprenantes : la CCRC n'a bénéficié que de trois grands mois de travail, aucune
consultation démocratique transparente ne s'est faite jour, aucun rapport n'a été publié de façon
officielle, il n'y a eu que 13 jours pour organiser, suite au discours du 17 juin 2011, le référendum
et, en conséquence, seulement 10 jours de campagne pour décider d'adopter (ou non) un texte
aussi important. Comment croire et soutenir que ces seuls dix jours ont permis l'expression libre
et pluraliste des opinions ? »38. La rapidité et l’opacité du processus permettent donc de
minimiser des oppositions qui, prises de court, ne peuvent pas véritablement peser sur
la rédaction du projet de Constitution et en sont réduites à un rôle légitimant.
13 Face à ces attitudes hégémoniques, l’opposition n’a d’autre possibilité que de mettre en
œuvre des stratégies d’obstruction au processus constituant en refusant d’y participer.
En Tunisie, le cadre constituant, qui contraint les différents protagonistes au
consensus, conduit à nier l’existence juridique de l’opposition qui se trouve dépourvue
de protection spécifique. A contrario, son accord est indispensable pour l’adoption de la
Constitution. Elle dispose donc des moyens de peser effectivement sur la rédaction du
projet. Il en va ainsi lorsqu’elle obtient la suspension des travaux de l’Assemblée
constituante par son président le 06 août 201339. La faculté de blocage de l’opposition va
dès lors être au cœur de la tactique parlementaire des deux camps. La reprise des
travaux, en l’absence des élus retirés, se fait par une décision du Bureau de l’ANC du 10
septembre qui décide, de surcroit, de laisser sa réunion « ouverte ». Cela lui permet de
prendre des décisions à la majorité quel que soit le nombre de présent et de s’affranchir
ainsi de l’exigence de quorum pour priver en définitive l’opposition de sa faculté de
blocage. En novembre 2013, l’opposition se retire à nouveau de l’Assemblée, refusant
d’entériner la révision du Règlement intérieur40. Finalement, Ennahdha devra se
résoudre à retirer les amendements controversés. Elle devra également renoncer au
Gouvernement pour que l’opposition accepte d’adopter la Constitution et obtiendra à
son sujet des concessions non négligeables.
14 A contrario, l’opposition marocaine n’échappe pas à l’alternative entre servilité et
stérilité. En effet, les forces parlementaires préfèrent se rallier à l’initiative royale dont
elles espèrent profiter, même si la nouvelle constitution est octroyée. En résumé, « les
responsables des organisations politiques installées et instituées se montrèrent prudents,
soucieux de ne pas affecter leurs inscriptions personnelles et institutionnelles dans les réseaux de
l’action publique et du parlementarisme »41. L’opposition extra-parlementaire refuse quant
à elle, à l’instar du M20F, cette procédure et appelle à l’élection d’une assemblée
constituante42. Or, là encore elle doit affronter certaines difficultés car si les partis
d’oppositions ont pu pour la première fois accéder aux médias officiels lors de la
campagne référendaire, il leur était interdit d’appeler au boycott de la consultation 43.
Les résultats de cette dernière ne pouvant d’ailleurs que laisser perplexe. Le consensus
étant dans ce cas de figure construit unilatéralement sur un rapport de force
déséquilibré, le meilleur moyen de maintenir son apparence est d’exclure l’opposition
de toute forme de participation.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
137
15 Le constituant, pour légitimer son œuvre, tend donc à minimiser les oppositions à la
réforme constitutionnelle mais il est pourtant conduit, parallèlement, à exalter
l’opposition parlementaire au sein de l’acte constitutionnel.
B. Une opposition reconnue à l’issue du processus constituant
16 Les textes constitutionnels tunisiens et marocains apparaissent bien plus protecteurs
que ceux de la plupart des démocraties occidentales qui ne reconnaissent pas de droits
explicites à l’opposition directement au sein de la Constitution. En Tunisie comme au
Maroc, le pouvoir constituant consacre un article spécifique à l’opposition
parlementaire. Cette constitutionnalisation ne permet toutefois pas de préciser les
contours de la future institution (1), mais elle revêt, aux vues des processus
constituants, une portée symbolique déterminante (2).
1) Un objet juridique indéterminé
17 La reconnaissance constitutionnelle de l’opposition a pour effet de transformer une
activité politique en institution constituée sans pour autant que les contours de cette
dernière puisse être identifiés. La reconnaissance de l’opposition au sein de la
Constitution est a priori gage du fonctionnement harmonieux du régime parlementaire.
D’ailleurs, « en principe, on pourrait croire que l’existence d’un rôle bien défini puisse garantir
la stabilité du système ainsi que la prévisibilité des interactions entre parlementaires » 44. Mais
les difficultés qu’elle soulève laissent à penser que cet objectif ne saurait être aisément
atteint car cette constitutionnalisation implique nécessairement de « figer une réalité
politique plurielle et fluctuante » 45. Dès lors, la question de l’opportunité de procéder à
une codification constitutionnelle de l’opposition se pose. Le professeur AVRIL considère
par exemple que « la conciliation entre l'usage critique des prérogatives et le fonctionnement
correct de l'assemblée suppose une appréciation politique du dosage acceptable par les uns et les
autres entre ces préoccupations antinomiques, ce qu'une codification formelle saurait
malaisément figer »46. Ce refus d’une constitutionnalisation de l’opposition n’est pas
nouvelle puisque, en son temps, Odilon BARROT affirmait déjà que « l’opposition ne peut
être ni comprimée ni définie, et c’est pour cela qu’on ne peut en faire un pouvoir constitué. La
garantie de la liberté est du reste dans cette impossibilité même. Si l’opposition se trouvait
concentrée dans une magistrature quelconque, il serait possible ou de corrompre cette
magistrature ou de s’en emparer »47.
18 L’opportunité d’une constitutionnalisation n’est donc pas évidente. Elle contribue à
faire de l’opposition parlementaire la seule forme d’opposition constitutionnellement
légitime. L’opposition n’est pas appréhendée comme une activité, un comportement ou
une attitude politique que chaque parlementaire est libre d’adopter mais comme un
pouvoir constitué au positionnement prédéterminé48. Dès lors, les droits qui lui sont
reconnus sont octroyés aux groupes parlementaires et non aux parlementaires eux-
mêmes. Il s’agit donc de compétences spécifiques, reconnues à une institution, et non
d’un droit individuel du parlementaire à s’opposer. L’opposition ne peut être mise en
œuvre qu’à l’échelle du groupe parlementaire et les députés qui n’appartiennent à
aucun d’entre eux sont ignorés.
19 De surcroît, en l’absence de reconnaissance des groupes minoritaires, la
constitutionnalisation de l’opposition peut conduire à une forme de bipolarisation,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
138
potentiellement artificielle, de ces régimes multipartisans. La constitutionnalisation de
l’opposition s’apparente ainsi à une recherche de structuration de l’espace et de
l’activité parlementaire. Elle dirige l’activité de l’opposition vers le seul couple majorité
/ gouvernement. En tout état de cause, ces constitutions n’envisagent pas l’hypothèse
d’une opposition au chef de l’Etat. Pourtant, au Maroc, le roi conserve malgré la
révision constitutionnelle des pouvoirs importants49. D’ailleurs la
constitutionnalisation de l’opposition peut être vue comme un moyen pour ce dernier
de contrebalancer le transfert de pouvoirs qu’il consent (ou déclare consentir) au chef
du Gouvernement pour conserver une situation enviable d’arbitre entre les deux
camps. Quant à la Constitution tunisienne, elle attribue, en théorie tout du moins, des
pouvoirs non négligeables au Président de la République50. Il n’est donc pas question de
penser constitutionnellement une opposition présidentielle ou royale quand bien
même ces institutions exerceraient effectivement des pouvoirs non négligeables 51. Dès
lors, l’octroi d’un statut à l’opposition peut être considéré comme un moyen de limiter
ses cibles potentielles. Volontairement ou non, la constitutionnalisation de l’opposition
contribue à réduire le champ des oppositions politiques légitimes sans permettre
d’identifier précisément celle qui peut se prévaloir de cette qualité.
20 Les Constitutions tunisiennes et marocaines restent en effet silencieuses sur les moyens
d’identifier l’opposition parlementaire. Celle-ci est bien plus complexe à appréhender
que la majorité ou la minorité puisqu’elle « renvoie à un positionnement politique, et non
plus à un simple constat arithmétique »52. Le choix d’un critère permettant d’identifier
l’opposition n’est donc pas opéré par le constituant. Ils sont pourtant tous également
problématiques et le choix de l’un d’entre eux, hautement politique, n’est pas sans
conséquence sur les contours de la future institution53. Certains chercheurs proposent
de distinguer les critères « institutionnels » des critères « comportementaux » 54. Parmi
les premiers, le critère fondé sur le résultat des élections législatives conduit à
identifier comme d’opposition les partis ayant subi une défaite. Mise à part l’absence de
définition de la défaite, il est possible qu’un parti, pourtant vaincu, continue
d’appartenir à une majorité composite. Le critère de la participation au gouvernement
présente également un inconvénient s’agissant des groupes qui peuvent, sans
participer au gouvernement, le soutenir néanmoins. Celui qui consiste à ériger en
opposition le plus important groupe minoritaire, apparait, lui, inadapté aux systèmes
multipartites. Quant aux critères comportementaux, celui fondé sur les attitudes des
députés apparait subjectif et susceptible de varier de manière importante en fonction
de la conjoncture politique (et ainsi manquer la volonté de structuration des forces
politique dont procède la constitutionnalisation de l’opposition). Le vote des
parlementaires (confiance, budget, projet de loi, proposition de loi de la majorité par
ordre d’importance) posent des difficultés similaires.
21 Reste le système subjectif des déclarations d’appartenance à l’opposition qui peut lui
aussi s’avérer potentiellement insatisfaisant. En premier lieu, ce système de
déclaration, s’il ne se fait pas à l’échelle individuelle mais à celle du groupe
parlementaire conditionne l’efficacité du dispositif au seuil quantitatif minimal pour
constituer un groupe. De surcroît, en l’absence de reconnaissance constitutionnelle de
groupes minoritaires en Tunisie et au Maroc, certains pourraient avoir intérêt à se
déclarer d’opposition pour jouir des droits spécifiques qui lui sont conférés et ce, même
s’ils n’entendent pas avoir une position tranchée et prédéterminée à l’égard du
Gouvernement. Il pourrait même en aller ainsi d’un groupe appartenant à une coalition
majoritaire qui déclarerait appartenir à l’opposition. Enfin, une question relative au
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
139
bicamérisme marocain peut se poser puisque l’opposition parlementaire est susceptible
de ne pas être la même suivant la chambre. Un tel système a pourtant été retenu au
Maroc et devrait probablement l’être également en Tunisie. Il semble être le mieux à
même d’encadrer et de structurer les différentes forces parlementaires tout en
respectant leurs volonté, surtout si la déclaration d’appartenance est annualisée.
22 Dès lors, si le constituant ne cherche pas à l’identifier précisément, c’est peut-être
parce que « le choix d’inscrire l’opposition dans la Constitution elle-même est éminemment
symbolique »55.
2) Une portée symbolique déterminante
23 Les textes constitutionnels marocain et tunisien consacrent solennellement
l’opposition et la mettent en valeur. Au Maroc, cette volonté est particulièrement
prononcée puisque pas moins de quatre articles la mentionnent. C’est surtout le long
article 10 qui vient consacrer, dès le titre premier relatifs aux dispositions générales (et
non dans le titre IV relatif au pouvoir législatif comme on pouvait s’y attendre),
l’opposition parlementaire et l’impressionnante liste de douze droits qui lui sont
conférés. En outre, le premier article du titre IV relatif au pouvoir législatif (Art. 60 C.),
voit le constituant affirmer que l’opposition est « une composante essentielle des deux
chambres ». La constitution marocaine va donc bien plus loin dans cette direction que la
plupart des constitutions occidentales, ce qui suscite l’appréciation positive de la
plupart des observateurs. Mais on peut également considérer qu’un tel affichage des
droits de l’opposition peut participer d’une opération de « marketing politique » 56 ou de
« révision communication »57 qui a présidé, selon certains auteurs, à la rédaction de la
constitution marocaine du 29 juillet 2011.
24 Dans le texte constitutionnel tunisien, l’opposition est consacrée, mais de façon moins
ostentatoire. Seul l’article 59 de la nouvelle constitution tunisienne, le dixième du titre
relatif à l’Assemblée des représentants du peuple, mentionne l’opposition
parlementaire. Elle y est cependant qualifiée, comme dans le texte marocain, de «
composante essentielle » de la chambre des représentants. Si l’opposition est ici moins
mise en valeur, cela s’explique peut-être en partie par le fait que cet article a connu un
processus de rédaction pour le moins heurté58. Malgré ces hésitations, cet article a
finalement été adopté quasi-unanimement59. La constitution tunisienne vient
finalement offrir une reconnaissance officielle à l’opposition sans que cet article n’ait
fait l’objet d’une instrumentalisation politique alors même que le processus constituant
incitait à en faire un objet de polémique60 : soit, conçu comme une disposition à
caractère technique, sa politisation a été jugée inopportune, soit, au contraire,
comprise comme une disposition symbolique, sa constitutionnalisation a fait
consensus.
25 Les raisons de cette emphase constitutionnelle plus ou moins prononcée sont à
rechercher dans l’idée selon laquelle l’opposition peut jouer comme un symbole
démocratique. En effet, particulièrement en Tunisie, la constitutionnalisation de
l’opposition permet d’afficher une rupture avec le régime précédent et d’affirmer la
possibilité d’une alternance démocratique. Le régime de Ben Ali ignorait en effet
l’opposition parlementaire tant dans le texte constitutionnel61 que dans la pratique
institutionnelle par laquelle l’opposition légale et parlementaire était cantonnée à un
rôle de « faire-valoir » et de légitimation du Parti-Etat dominant (le pouvoir ayant su
établir des relations clientélistes avec les partis d’opposition) 62. A ce titre, la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
140
consécration de l’opposition parlementaire comme composante essentielle du
parlement parait exprimer un objectif à atteindre et traduire une conception de la
Constitution comme moteur des changements politiques63. La constitutionnalisation
comporte une vocation performative : faire exister une opposition parlementaire
jusque-là ignorée et faire d’elle la seule opposition légitime. Au Maroc, cette dimension
est également présente, puisque « les discours royaux et la nouvelle constitution agissent en
effet dans l’objectif de redonner confiance » 64 dans une institution parlementaire
discréditée (notamment par une opposition inféodée au pouvoir).
26 Or « cette façon d’utiliser les clauses constitutionnelles repose bien évidemment sur l’idée selon
laquelle les dispositions constitutionnelles sont des symboles pourvus d’une charge positive (ou
du moins accompagnés de l’attente qu’ils fonctionneront effectivement de cette façon). Il se peut
cependant que les clauses en question se retournent contre leurs auteurs (ou leurs successeurs
au pouvoir) en acquérant une charge négative au fur et à mesure que le programme exposé n’est
pas réalisé »65. On peut en effet constater que les Etats qui se dotent d’une nouvelle
constitution, suite à la chute d’un régime autoritaire ou au cours d’un processus de
transition démocratique, sont plus enclins à consacrer des droits explicites de
l’opposition66. Mais on ne saurait négliger que la consécration constitutionnelle des
droits de l’opposition a également pu être instrumentalisée par des régimes
autoritaires pour mettre en scène une acceptation du pluralisme politique qui tarde
parfois à se concrétiser67. De surcroît, la reconnaissance solennelle de l’opposition ne
présente pas un avantage symbolique du seul point de vue du pouvoir constituant ; elle
apparait aussi comme une ressource pour l’opposition qui peut « prendre au sérieux les
clauses « symboliques » en les utilisant comme un mètre étalon » 68. Il faut également
envisager les droits constitutionnels de l’opposition comme un label à usage externe.
Leur constitutionnalisation peut-être un moyen de rassurer les organisations
internationales et les partenaires étatiques ou commerciaux sur le caractère
« démocratique » et conforme à la « bonne gouvernance » des réformes
constitutionnelles en cours. La réaction de la Commission de Venise au projet Tunisien
en est une illustration69. Il en va de même de celle du Conseil de l’Europe à l’égard de la
consécration des droits de l’opposition au Maroc70. Dans les deux cas, ces institutions se
sont félicitées d’une telle reconnaissance. Ainsi le professeur TOUZEIL-DIVINA considère
au sujet de la constitution marocaine que « dans certaines dispositions tout a été écrit pour
des observateurs étrangers à rassurer ; comme pour leur affirmer de circuler car
constitutionnellement parlant tout va désormais démocratiquement bien... dans le texte
fondamental au moins »71. Il nous semble que la reconnaissance de l’opposition participe
de cette dynamique.
27 La constitutionnalisation de l’opposition parlementaire apparait alors comme une
forme de compromis dilatoire72. Elle permet de donner des gages à ceux qui s’opposent
au projet constitutionnel et joue comme une promesse que l’opposition demeurera
possible après l’adoption du projet, sans pour autant que les contours de cette dernière
et ses prérogatives puissent être identifiés grâce au seul texte constitutionnel. Le
constituant espère ainsi pérenniser son œuvre en incitant au respect d’une opposition
parlementaire qui contribuerait au bon fonctionnement des institutions en devenant
l’unique canal de la contestation légitime du pouvoir. Les moyens dont dispose
l’opposition pour remplir cette tâche sont donc déterminants et il convient de se
pencher plus précisément sur ce que le constituant présente comme des droits qui
seraient reconnus à cette nouvelle institution. Mais cette rhétorique des droits s’avère
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
141
trompeuse et peut dissimuler, au contraire, une dépendance accrue de l’opposition
parlementaire vis-à-vis des autres pouvoirs constitués.
II. Des « droits » conditionnés à l’appréciation des
autres pouvoirs constitués
28 La constitutionnalisation de l’opposition parlementaire ne semble pas devoir permettre
d’envisager les « droits » qui lui sont reconnus comme des mécanismes juridiques de
protection des droits de l’homme ou de garantie du pluralisme. La
constitutionnalisation des droits de l’opposition parlementaire est au contraire
susceptible d’accroitre sa dépendance vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Elle se
doit d’adopter une attitude « positive » (A), sous peine de ne pouvoir exercer les droits
qui lui sont reconnus (B).
A. Le rôle coopératif assigné à l’opposition parlementaire
29 Si les nouvelles constitutions tunisiennes et marocaines octroient pour la première fois
des droits spécifiques à l’opposition parlementaire en vue de faire participer celle-ci à
la prise de décision majoritaire (1), ces derniers sont conçus comme la contrepartie de
devoirs aux contours indéfinis (2).
1) Les « droits » de l’opposition parlementaire
30 Il est notable que les droits spécifiquement conférés à l’opposition visent à l’associer à
la décision parlementaire et non à la protéger contre les agissements de la majorité, ce
qui relève des droits de la minorité. Au Maroc, la plupart des droits consacrés par
l’article 10 de la Constitution ne sont pas spécifiques à l’opposition. Certains
réaffirment pour elle des droits déjà reconnus plus généralement ailleurs (tels que la
liberté d’opinion, d’expression et de réunion déjà consacrées par les articles 25 et 29 de
la Constitution ou le bénéfice du financement public et la contribution à l’encadrement
et à la représentation des citoyens à travers les partis politiques déjà mentionnés à
l’article 7 de la constitution…). D’autres semblent plutôt être reconnus à l’ensemble des
parlementaires, quelle que soit leur position vis-à-vis du Gouvernement (telle que
l’affirmation d’une participation effective à la procédure législative et au contrôle du
travail gouvernemental, l’assurance d’une représentation proportionnelle au sein des
instances parlementaires ou encore l’octroi des moyens nécessaires à
l’accomplissement du travail parlementaire). Enfin, certains de ces « droits » ne
semblent conférer aucune compétence (comme « l’exercice du pouvoir dans le cadre
d’une alternance démocratique »). Finalement, deux droits sont spécifiquement
reconnus à l’opposition parlementaire : la présidence de la commission en charge de la
législation à la chambre des représentants et le droit de voir ses propositions de loi
examinées dans le cadre de la journée mensuelle réservée aux propositions de loi. En
Tunisie, au terme de l’article 59 de la Constitution, l’opposition se voit reconnaitre la
présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur de la commission
des affaires extérieures. De surcroit, elle peut demander annuellement la création
d’une commission d’enquête qu’elle préside.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
142
31 Ainsi, comme l’écrivait le professeur CARCASSONNE au sujet du cas français, la portée
d’une telle constitutionnalisation n’est pas négligeable ; elle est porteuse de certaines
ressources puisque l’opposition « est désormais dans une situation qui peut certes, toujours
être améliorée mais qui, en pénétrant dans le droit, est entré dans la modernité. En devenant un
objet juridique et plus seulement le bénéficiaire de quelques conventions occasionnelles, elle
dispose maintenant de capacités qui lui demeureront acquises en toutes circonstances » 73. Ces
capacités concernent en premier lieu le contrôle du Gouvernement. En obtenant la
présidence de certaines commissions parlementaires, l’opposition obtient les moyens
d’être, au moins partiellement, informée de l’activité gouvernementale et participe
ainsi d’une forme de contrôle du Gouvernement. Il en va de même du droit de créer une
commission d’enquête bien que l’octroi du poste de président, plutôt que de
rapporteur, n’aille pas au bout de cette logique. Au Maroc, l’opposition est également
associée, par le biais de la discussion de ses propositions de loi, à la fonction législative.
Elle est ainsi mise en mesure de faire connaitre un projet alternatif à celui de la
majorité.
32 Le contraste est saisissant si l’on compare ces droits spécifiques de l’opposition avec
ceux dont l’exercice est reconnu à une minorité de parlementaires et qui sont conçus
comme des droits individuels du parlementaire qui ne peuvent cependant être exercés
que collectivement. L’exemple topique à cet égard est la faculté de déclencher le
contrôle de constitutionnalité. Au terme de l’article 117 de la Constitution tunisienne,
cette faculté est ouverte à trente représentants de saisir la Cour constitutionnelle. Au
Maroc, en vertu de l’article 132, les lois et engagements internationaux peuvent être
déférés à la Cour constitutionnelle par un cinquième de la chambre des représentants
ou quarante membres de la chambre des conseillers. Cette compétence, qui est bien
souvent considérée en France comme le premier des droits de l’opposition, apparait,
quant à elle, conçue comme une véritable mesure de protection des droits de la
minorité, comme un contre-pouvoir, ou au moins comme la possibilité d’en déclencher
un. De la même manière, lorsque le constituant prévoit une majorité qualifiée pour un
vote auquel il attache une certaine importance, cette exigence vise à prévenir une
atteinte aux droits fondamentaux de la minorité par une majorité potentiellement
oppressive. Il en va par exemple ainsi de la révision constitutionnelle pour laquelle est
prévue la nécessité de réunir une majorité des deux tiers en Tunisie (Art. 140), comme
au Maroc (Art. 173 et 174). La même logique préside à la nomination des candidats aux
postes de juges constitutionnels qui doivent réunir une majorité des trois cinquièmes
en Tunisie (Art. 115), mais seulement des deux tiers au Maroc (Art. 130).
33 Ces droits de la minorité, dont l’opposition peut faire usage, relèvent donc d’une
logique très différente de ceux qui sont spécifiquement attribués à l’opposition. Les
premiers témoignent d’une logique négative et matérialisent une faculté d’empêcher
qui garantit « le droit de la minorité à l’existence »74. Ils peuvent s’inscrire dans une
logique de séparation des pouvoirs qui a été au cœur des revendications du printemps
arabe75. Les seconds illustrent une logique positive et une faculté de contribuer au
travail majoritaire. Ils confortent la distinction entre l’opposition dans le régime, qui a
vocation à accéder au pouvoir, et l’opposition au régime, qui refuse de participer au jeu
institutionnel.
34 Cette conception positive de l’opposition parlementaire que le constituant cherche à
associer à la décision majoritaire ne va toutefois pas sans contrepartie. L’octroi de
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
143
droits à l’opposition s’accompagne, tant en Tunisie qu’au Maroc, de l’affirmation des
devoirs de l’opposition parlementaire.
2) Les devoirs de l’opposition parlementaire
35 Les « droits », explicitement et spécifiquement reconnus par ces constitutions à
l’opposition parlementaire, ont pour point commun de tempérer le principe de
proportionnalité (lui aussi constitutionnalisé) qui régit le fonctionnement des
assemblées concernées. Le professeur AVRIL tire, au sujet de la situation française, des
conclusions applicables ici : « ce que l'on désigner (avec un peu d'emphase) sous le terme de
‘statut’ de l'opposition s'analyse en une discrimination positive, c'est-à-dire une dérogation aux
principes d'égalité et de proportionnalité qui régissent la situation des partis et des groupes
parlementaires en droit public : égalité dans l'expression, notamment à l'occasion des élections,
proportionnalité dans la participation des groupes au fonctionnement des assemblées
conformément à leur importance numérique, la proportionnalité n'étant en l'espèce que le
corollaire de l'égalité entre les élus. Le ‘statut’ évoqué depuis des lustres réside essentiellement
dans l'attribution à certains partis et à certains groupes de prérogatives supérieures à celles que
leur assure normalement cette importance numérique »76. En échange de ces privilèges,
l’opposition se doit donc d’être « prête à assumer ses devoirs et, en particulier, à jouer
loyalement son rôle de critique du gouvernement sans contester les « règles du jeu » » 77. En
Tunisie, l’article 59 de la Constitution impose à l’opposition, « parmi ses obligations, la
participation active et constructive dans le travail parlementaire ». Au Maroc, au terme de
l’article 10, « les groupes d’opposition sont tenus d’apporter une contribution active et
constructive au travail parlementaire ». Dès lors, en contrepartie de ses droits, l’opposition
parlementaire doit désormais remplir ses devoirs. C’est particulièrement explicite au
Maroc puisque ses droits ont pour objet de mettre l’opposition à même « de s’acquitter
convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique ». Mais
les missions dont l’opposition doit s’acquitter ne sont pas précisées 78.
36 En revanche, l’attitude qu’elle doit adopter pour y parvenir est clairement explicitée.
L’opposition ne peut plus se borner à la critique et se doit d’être « active »,
« constructive ». Plus que l’accomplissement d’une tâche déterminée, c’est bien un
comportement qui est attendu de l’opposition parlementaire. Ses droits lui sont
octroyés en contrepartie d’une mission qui, si elle demeure floue, doit être accomplie
de telle façon que leur utilisation par l’opposition ne saurait enrayer la prise de
décision et le bon fonctionnement des institutions. L’opposition en partage dorénavant
la responsabilité. Ses « droits » ne lui permettent donc pas d’empêcher ou même de
retarder la décision majoritaire. Bien au contraire, ils impliquent d’associer
l’opposition aux activités de la majorité. Ils ne participent donc pas de l’élaboration
d’un contre-pouvoir79 permettant de remettre en cause une décision liberticide mais
bien plutôt d’un organe consultatif dont la participation légitime la décision
majoritaire. Ainsi, la consécration constitutionnelle des devoirs de l’opposition
augmente l’impression de chantage : « Les droits spécifiques ne sauraient être mis en œuvre
que pour autant que l’opposition fait preuve de modération dans l’utilisation de ses prérogatives
et ne cherche pas à ralentir la production législative »80.
37 La consécration constitutionnelle des devoirs parlementaires a donc pour but de
condamner le recours à l’obstruction parlementaire. Ce qui constitue selon KELSEN « l’un
des problèmes les plus difficiles et les plus dangereux du parlementarisme » 81 peut être défini
comme une pratique parlementaire « qui consiste à faire un usage extensif de toutes les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
144
possibilités offertes par la Constitution et le règlement pour faire durer un débat parlementaire
et, si possible, empêcher l’adoption d’un texte »82. En obtenant un statut, l’opposition est
invitée à renoncer à cette pratique, caractérisée comme un abus de droit, souvent
qualifiée d’antidémocratique et accusée de nourrir une forme d’antiparlementarisme
en décrédibilisant l’institution. Pourtant, l’obstruction mérite surement une
appréciation plus nuancée. KELSEN lui-même, s’il disqualifiait l’obstruction physique
(qui relève de la violence physique ou verbale), refusait d’en faire de même s’agissant
de l’obstruction technique (qui relève d’une utilisation intensive des moyens de
procédure à disposition). Elle ne peut, selon lui, être rejetée « purement et simplement
comme incompatible avec le principe majoritaire que si l’on identifiait celui-ci avec la
souveraineté de la majorité ce qu’il ne convient pas de faire. De fait l’obstruction a servi souvent,
non pas à empêcher absolument toute décision parlementaire, mais à orienter finalement la
décision dans le sens d’un compromis entre majorité et minorité » 83.
38 L’obstruction peut, dans une certaine mesure, constituer pour l’opposition une forme
de désobéissance civique ou un moyen de « légitime défense constitutionnelle » 84. Comme
l’illustre le processus constituant tunisien, l’obstruction parlementaire s’est avérée être
un outil important pour lutter contre ce qui a pu être qualifié d’« exploitation intensive
du principe de majorité »85 et a incontestablement permis d’obtenir des concessions de la
part de la principale composante majoritaire. Dès lors, la logique décrite au sujet de
l’opposition française nous semble vouée à s’appliquer aux oppositions tunisienne et
marocaine : « l’obstruction parlementaire, souvent présentée comme la seule véritable capacité
de nuisance de l’opposition, est condamnée. A l’opposition d’assurer un fonctionnement
harmonieux des institutions et à elle d’assumer la responsabilité d’un échec » 86. Or, ces souhaits
constitutionnels d’une opposition responsable s’accompagnent pourtant d’une
condamnation du seul moyen qu’elle maitrise totalement et dont elle a justement la
responsabilité : « Elle décide seule, quand et comment elle souhaite le mettre en œuvre.
Néanmoins, l’utilité de ce moyen de contrôle est directement lié à la qualité de l’usage qui en est
fait, et notamment, de sa fréquence d’utilisation »87. D’ailleurs, cette dernière
caractéristique peut faire douter de l’efficacité de l’imprécation constitutionnelle à son
encontre. Celle-ci ne peut, à elle seule, retirer à l’opposition toute possibilité de
recourir à l’obstruction mais elle fournit au Gouvernement une ressource
supplémentaire pour discréditer de telles pratiques.
39 Finalement, le rôle assigné à l’opposition par le texte constitutionnel amène à douter,
avec le professeur AVRIL, de la pertinence d’utiliser, au sujet de l’opposition, l’image «
de ’droits subjectifs’ qu’elle ferait valoir à l’encontre d’une majorité » 88. Loin de permettre son
indépendance ou de renforcer son autonomie, les droits reconnus à l’opposition
parlementaire peuvent au contraire être conditionnés par d’autres acteurs
constitutionnels, s’ils jugent que celle-ci refuse de jouer correctement son rôle dont la
définition est pourtant laissée à leur libre appréciation.
B. Une mise sous tutelle de l’opposition parlementaire
40 L’opposition parlementaire ne participe pas à la mise en œuvre des droits qui lui sont
conférés. C’est le pouvoir majoritaire, en concrétisant les normes constitutionnelles (1),
et éventuellement le juge constitutionnel, en les interprétants, qui assurent cette tâche
(2).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
145
1) La mise en œuvre majoritaire
41 La majorité maitrise la portée des droits reconnus à l’opposition puisqu’elle est chargée
de les préciser à travers certaines normes infraconstitutionnelles. La technique du
renvoi, définie comme « l’invitation formelle, énoncée par la règle, à se reporter à une ou
plusieurs autres dispositions»89, est utilisée par le constituant marocain s’agissant des
droits de l’opposition. L’article 10 dispose en son dernier alinéa que « les modalités
d'exercice par les groupes de l'opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois
organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement ».
L’article 69 précise quant à lui que le Règlement intérieur des chambres fixe « les règles
d'appartenance, de composition et de fonctionnement concernant les groupes et groupements
parlementaires et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ». En Tunisie, au
contraire, la Constitution ne procède pas à des renvois explicites, mais des normes
infra-constitutionnelles n’en seront pas moins nécessaires pour préciser les contours
des droits de l’opposition. Ainsi, par exemple, du droit de former et de présider une
commission d’enquête. L’article 58 de la Constitution tunisienne se limite à énoncer que
l’Assemblée peut en créer et que toutes les autorités doivent les assister dans l’exercice
de leurs fonctions ce qui devra vraisemblablement être précisé. Il en va de même des
modalités de nomination du président de la commission des finances. L’intensité de la
nuisance pour la majorité variera sans doute si ce président est choisi par l’opposition
elle-même ou par la majorité parmi les membres de l’opposition. Il faudra donc
nécessairement que ces droits constitutionnels soient, pour pouvoir être mis en œuvre,
précisés par des normes de rang hiérarchique inférieur. Or, rien ne semble devoir
contraindre juridiquement la majorité à adopter de tels actes à défaut d’un recours
juridictionnel en carence. Au Maroc, cette concrétisation ne s’est d’ailleurs pas faite
sans difficultés, puisque, après une première révision préliminaire du Règlement
Intérieur de la chambre des représentants en janvier 2012, une seconde est intervenue
à l’été 2013. De même, après un premier rejet par le Conseil constitutionnel, la chambre
des conseillers vient tout juste d’adopter son nouveau règlement intérieur. Ces normes,
si elles sont pour la plupart soumises à une condition de majorité absolue (ce qui n’est
pas le cas des lois organiques marocaines selon l’article 85 C.), échappent aux exigences
de majorités qualifiées. Autrement dit, la majorité peut déterminer elle-même les
modalités d’exercice des droits de l’opposition et ne recueillera l’avis de cette dernière
seulement si elle le souhaite. En conséquence, le périmètre de ces droits est susceptible
d’être révisé à chaque alternance. Cette concrétisation majoritaire permet
certainement de ne pas trop figer le catalogue de droits reconnus à l’opposition et de
permettre une certaine adaptabilité à la pratique mais « en laissant au bon vouloir de la
majorité la définition des droits de l’opposition […] la question du sens même qu’il y a à accorder
des droits spécifiques à l’opposition parlementaire est encore une fois évitée » 90.
42 Cette maitrise majoritaire des droits de l’opposition est encore renforcée au niveau de
la pratique politique. Il est fréquent de qualifier le droit parlementaire de droit
politique pour insister sur l’importance revêtue par la pratique des parlementaires.
Ainsi, Eugène PIERRE, la figure tutélaire du droit parlementaire français, considérait
dans la préface à la seconde édition de son traité que le droit parlementaire est
politique puisque « ceux qui l’appliquent sont précisément ceux qui le créent », et d’expliquer
que telle est la cause de la difficulté « en matière politique, à fixer la portée d’un article in
abstracto, sans tenir compte des circonstances au milieu desquelles il doit fonctionner » 91. A ce
titre, il revient aux parlementaires d’interpréter les dispositions constitutionnelles,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
146
législatives et réglementaires afférentes aux droits de l’opposition. La majorité est donc
susceptible de produire une interprétation des droits de l’opposition qui peut faire
office d‘interprétation authentique de la Constitution92. Il est donc impossible de
prévoir, a priori, la portée qui sera conférée aux droits constitutionnels de l’opposition.
43 Il convient de remarquer que les futures majorités marocaines et tunisiennes seront en
mesure d’en minorer les effets. Il en va par exemple ainsi du droit de créer une
commission d’enquête. Le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs 93
pourrait être invoqué par la majorité pour refuser la création d’une commission
d’enquête qui, selon elle, mettrait en cause la responsabilité du Gouvernement ou du
chef de l’Etat, comme ce fut le cas en France94. De surcroit, au Maroc spécifiquement, en
vertu de l’article 67 alinéa 3 qui prévoit que sa mission prend fin dès l’ouverture d’une
information judiciaire, « le gouvernement peut arrêter le travail d'une commission d'enquête,
si elle constitue un danger ou une gêne pour le gouvernement en déclenchant la procédure
judiciaire »95. Par ailleurs, la mention constitutionnelle des devoirs de l’opposition
parlementaire offre à la majorité une ressource argumentative pour conditionner les
droits de l’opposition à une attitude qu’elle jugerait plus acceptable. Or, « la limite entre
l’utilisation d’un droit tel qu’il est conçu au départ et la dénaturation qui va y être apportée est
malaisée à déterminer. De même, distinguer le moment exact où l’action de la minorité va passer
d’une opposition parlementaire normale à l’obstruction s’avère délicat » 96. Elle est en tout cas
aisée à instrumentaliser à des fins politiques. La majorité risque de devenir juge de
l’attitude « positive » ou « constructive » de l’opposition, sous le contrôle éventuel d’un
Président de chambre dont l’autorité est toutefois corrélée au crédit que lui accorde
l’opposition quant à son impartialité. Si les dispositions constitutionnelles visent à
protéger l’opposition, elles peuvent tout aussi bien aboutir à accroitre sa mise sous
tutelle par le pouvoir majoritaire. Si le but affiché d’une telle constitutionnalisation est
l’établissement d’un contrôle par l’opposition d’un Gouvernement majoritaire et
responsable, il ouvre pourtant la voie à un contrôle par le Gouvernement majoritaire de
la responsabilité de l’opposition. Face à cette situation, reste à déterminer si le juge
constitutionnel peut être amené à jouer le rôle de garant de ces droits de l’opposition.
2) Le contrôle du juge constitutionnel
44 L’opposition peut-elle faire sanctionner la violation de ses droits constitutionnels
devant le juge constitutionnel, comme la rhétorique utilisée pourrait le laisser penser ?
Autrement dit, la constitutionnalisation des droits de l’opposition parlementaire
conduit-elle à en faire des droits justiciables ? Il est certain que les Cours
constitutionnelles marocaines et tunisiennes seront amenées à connaitre de la
concrétisation majoritaire de ces droits à travers le contrôle de constitutionnalité a
priori des règlements des chambres (Art. 117 de la Constitution tunisienne, Art. 132 de
la Constitution marocaine). Les oppositions parlementaires pourront en outre saisir
elles-mêmes le juge constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité
facultatif des lois97, en alléguant une violation de leurs droits au cours de la procédure
législative. Il s’agirait dès lors d’un contrôle a posteriori et concret de la violation
alléguée98. Mais en premier lieu, il n’est pas certain que le juge accepte de contrôler ce
qu’il pourrait analyser comme relevant de la légalité intérieure des chambres. Surtout,
alors que la plupart des droits de l’opposition concernent davantage le contrôle de
l’activité gouvernementale plutôt que l’élaboration de la loi, il semble que, les
concernant, les cours constitutionnelles marocaine et tunisienne ne soient pas amenées
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
147
à en connaître dans la mesure où celles-ci ne sont pas, à la lecture des deux textes
constitutionnels, habilitées à trancher les litiges susceptibles de s’élever entre le
Parlement et le Gouvernement. Il existe toutefois au Maroc une exception notable
puisque le Gouvernement ou le Président de la chambre peut saisir le Conseil
constitutionnel pour trancher un différend relatif aux commissions d’enquêtes 99. Par
contre, en Tunisie, la Cour constitutionnelle tunisienne ne devrait connaitre,
conformément à l’article 99 de la Constitution, que des conflits de compétences
susceptibles de s’élever entre les deux têtes de l’exécutif. Il est enfin peu probable que
la mise en place d’une exception d’inconstitutionnalité en Tunisie puissent permettre
au justiciable de défendre les droits de l’opposition et d’amener à un examen in concreto
du juge constitutionnel. C’est encore plus douteux au Maroc puisque l’article 133 de la
Constitution ne vise, dans le cadre de cette procédure, que « les droits et libertés garantis
par la Constitution ». Le Conseil constitutionnel marocain ne semble d’ailleurs pas
vouloir s’aventurer dans un contrôle plus concret du droit parlementaire et manifeste
ainsi un certain « self-restraint ». Dans l’attente de son remplacement par la nouvelle
Cour constitutionnelle, il s’est ainsi déclaré incompétent pour contrôler l’élection du
Président de la Chambre des représentants100. Plus décisif encore pour les droits de
l’opposition, il a refusé de connaitre du contentieux relatif à la formation des groupes
et groupements parlementaires101. Dès lors, c’est bien la sincérité de la déclaration
d’opposition qui ne peut être contrôlée et en conséquence, la réalité de l’opposition.
Contrairement à la présentation qui en est faite s’agissant des droits et libertés, le juge
constitutionnel n’est donc pas érigé en garant des droits de l’opposition.
45 Quand bien même les juges constitutionnels tunisien et marocain seraient amenés, par
une politique jurisprudentielle constructive, à connaitre des droits de l’opposition
parlementaire, rien n’indique qu’ils en développeront une conception nécessairement
exigeante. Peut-être est-ce là l’un des points communs aux droits de l’opposition et aux
droits fondamentaux. Comme le rappelle le professeur CHAMPEIL-DESPLATS au sujet du
contrôle juridictionnel de ces derniers : « outre les doutes que l’on peut exprimer sur la
possibilité d’une réelle indépendance et impartialité des institutions concernées, on peut rappeler
que celles-ci agissent à l’aune d’énoncés vagues et généraux. Or, rien ne garantit […] qu’elles
optimisent dans tous les cas la protection des droits et libertés » 102. Si un lien doit être établi
entre les deux notions, c’est sans doute celui-ci. D’ailleurs, la décision du Conseil
constitutionnel marocain rendue au sujet du règlement intérieur de la chambre des
représentants a illustré le fait que le contrôle juridictionnel peut jouer en faveur de la
majorité103. L’exemple du temps de parole alloué à l’opposition, s’il constitue davantage
un droit de la minorité qu’un droit spécifique de l’opposition, est significatif. Le Conseil
a en effet censuré l’article 207 du règlement intérieur qui prévoyait la répartition en
trois parts égales du temps de parole entre gouvernement, majorité et opposition. La
Constitution impose selon le juge que le gouvernement dispose d’un temps de parole
égal à celui des parlementaires ne laissant que 25% du temps total à l’opposition. Le
groupe parlementaire d’opposition marocain de l’UFSP vient d’ailleurs de présenter
une proposition de loi pour la mise en œuvre des droits de l’opposition consacrés à
l’article 10 de la Constitution104. Si l’opposition, « saisie par le droit », devient un objet
juridique, celui-ci est aussitôt et en retour « saisie par la politique ». Autrement dit, la
politique « reprend ses droits », sans qu’il faille y voir une révolution.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
148
NOTES
1. Déclaration prononcée à la suite de son élection par l’ANC à la présidence provisoire de la
République. Citée par BRAS Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons
tunisiennes », in L’année du Maghreb, n°8, 2012, p. 115.
2. BITAR Karim Emile, « Les intellectuels français et le printemps arabe », in La Revue internationale
et stratégique, 3, n°83, 2011, pp. 141-148.
3. Outre le Maroc et la Tunisie, on peut citer parmi les Etats ayant constitutionnalisé l’opposition
dans le désordre et sans prétendre à l’exhaustivité : la France, le Portugal, le Sénégal, la
République démocratique du Congo, Madagascar, le Burundi, les Comores, la République de
Guinée, le Niger, le Togo ou encore le Bouthan.
4. PIMENTEL Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », in Pouvoirs, n°108,
(« L’opposition »), 2004, p. 45.
5. JAN Pascal, « Les oppositions », in Pouvoirs, n°108 (« L’opposition »), 2004, p. 24.
6. PIMENTEL Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », op. cit., pp. 48-49.
7. FAVOREU Louis, La politique saisie par le droit : alternances, cohabitations et Conseil constitutionnel,
Paris, Economica, 1988, 153 p.
8. PONTHOREAU Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », in Revue de droit
public et de science politique en France et à l’étranger, n°4, 2002, p. 1127.
9. TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique, Paris, Gosselin, 1835, Vol. 2, P. 2, Chap. VII,
p. 137
10. Le démo-libéralisme est théorisé par le professeur CHEVALLIER Jean-Jacques, Histoire des idées
politiques ; de l’Esprit des Lois (1748) à nos jours, Paris, Les cours du Droit, 1964, Fascicules I à III ;
spéc. II ; pp. 93 et s.
11. AVRIL Pierre, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé », in Les petites affiches, n°254,
19 décembre 2008, p. 9.
12. Voir ainsi : K ELSEN Hans, Théorie pure du droit [1934], trad. C. Eisenmann, Paris, LGDJ, 1999, pp.
209-211 et p. 271-272 ; SCHMITT Carl, Théorie de la Constitution, [1928], trad. L. Deroche, Paris, PUF,
Quadrige, 2008, p. 232.
13. L’article 57 de la constitution du 1er juin 1959 va être retenu comme fondement par le Conseil
constitutionnel pour prononcer l’empêchement absolu du Président et maintenir le fil d’une
légalité constitutionnelle. Déclaration du Conseil constitutionnel du 15 janvier 2011.
14. Puisque l’article 57 de cette constitution prévoyait l’élection d’un nouveau Président de la
République.
15. BRAS Jean-Philippe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op.
cit., p. 105.
16. Le président d’honneur et fondateur du PDP, Ahmed Nejib CHEBBI s’est toutefois opposé à
l’élection d’une assemblée constituante et a appelé à une élection présidentielle dans le cadre de
la Constitution de 1959. Voir : GOBE Eric, « Tunisie an I : Les chantiers de la transition », in L’année
du Maghreb, n°8, 2012, p. 448.
17. Si les partis extraparlementaires de gauche ont appuyé plus ou moins rapidement le
mouvement, les partis gouvernementaux s’en sont gardés même si certains dirigeants lui ont
apporté leur soutien. Quant au Parti de la Justice et du Développement, principal parti islamiste
de l’opposition parlementaire à cette date, il a refusé d’y prendre part.
18. TOURABI Abdellah & ZAKI Lamia, « Maroc : Une révolution royale ? », in Mouvements, n°66, 2011,
p. 99
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
149
19. Comme le confirme un des militants du Mouvement : LOTFI Chawqui ; « Maroc : les ressorts de
la monarchie, les conditions de la contestation », in Alternatives sud, n°19, 2012, p. 153-169. Voir
également : DESRUES Thierry, « Le Mouvement du 20 février et le régime marocain : contestation,
révision constitutionnelle et élections », in L’Année du Maghreb, n°8, 2012, pp. 363-364.
20. Ibid., p. 365.
21. Pour une analyse favorable à ce scénario d’un découplage de la réforme constitutionnelle et
du mouvement de protestation voir : FERRIÉ Jean-Noël & DUPRET Beaudouin « La nouvelle
architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine », in
Confluences Méditerranée, 3, n°78, 2011, pp. 25-34.
22. ALLAL Amin & G EISSIER Vincent, « La Tunisie de l’après Ben-Ali, Les partis politiques à la
recherche du peuple introuvable », in Cultures et conflits, n°83, 2011, p. 118.
23. L’article 3 du décret-loi n°2011-6 du 18 février 2011 dispose que son conseil est formé « de
personnalités politiques nationales, de représentants des partis politiques, des instances, des
organisations et des composantes de la société civile concernées par les affaires nationales dans
la capitale et les régions, parmi ceux qui ont participé à la révolution ou qui l’ont soutenue, qui
seront nommés par arrêtés du ministre sur proposition des organismes concernés ».
24. BEN ACHOUR Rafaâ & BEN ACHOUR Sana, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité
constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », in Revue française de droit constitutionnel, 4,
n°92, 2012, p. 720.
25. Par contre, ces forces politiques divisées entre elles s’accordent pour s’opposer au
Gouvernement provisoire auquel elles dénient « toute légitimité […] le cantonnant à un registre
purement technocratique, rappelant son caractère éphémère, tout en poursuivant avec lui des médiations
et des négociations qui, en retour, finissent par lui donner une certaine crédibilité », ALLAL Amin et
GEISSIER Vincent, « La Tunisie de l’après- Ben Ali, Les partis politiques à la recherche du peuple
introuvable », op. cit., p. 118.
26. Cela constitue tout de même un changement par rapport aux précédentes réformes
constitutionnelles qui étaient préparés directement par le cabinet d’Hassan II.
27. TOURABI Abdellah et ZAKI Lamia, « Maroc : Une révolution royale ? », op. cit., p. 102. Voir
également : BRAS Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons
tunisiennes », op. cit., pp. 111-114.
28. BENDOUROU Omar ; « La consécration de la monarchie gouvernante », in L’année du Maghreb,
n°8, 2012, p. 392.
29. Voir à ce propos : EL MOSSADEQ Rkia, Consensus ou jeu de consensus ?, Pour le réajustement de la
pratique politique au Maroc, Casablanca, Imprimerie Najah El Jadida – Sochpress distributeur, 1995.
30. Ces élections (dont le taux de participation a été de 54%) a conduit à la victoire d’Ennahdha
qui remporte 89 sièges sur les 217 à pourvoir. Le CPR de Moncef MARZOUKI obtient 29 sièges, la
pétition populaire obtient 26 siège, Ettakatol 20 sièges, le PDP 16 sièges, le PDM 5 sièges tout
comme l’Initiative. Afek Tounes en obtient 4, le PCOT 3, Achab et le MDS obtenant chacun 2
sièges. Les 16 restants ont été répartis entre des petits partis et des listes indépendantes qui
obtiennent chacun un siège. Ces résultats ne reflètent plus les effectifs des groupes puisque de
nombreux constituants ont changés de groupes parlementaires depuis.
31. BRAS Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op.
cit., p. 110.
32. Ils dénoncent ainsi la répartition des trois présidences (de la République, du Gouvernement et
de l’Assemblée) entre les trois partis de la coalition majoritaire et le rejet d’un gouvernement
d’union nationale. Le CPR obtient la Présidence de la République, Ennahda la présidence du
Gouvernement et Ettakatol celle de l’ANC.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
150
33. Loi constituante n°6-2011 du 16 décembre 2011 qui aboutit au compromis au terme duquel la
future constitution devra être adoptée à la majorité absolue article par article puis dans son
ensemble à la majorité des deux tiers ou à défaut, être soumise à référendum.
34. Ainsi, et à titre d’exemple, ni la loi constituante du 16 décembre 2011 ni le règlement
intérieur de l’ANC ne mentionnent l’opposition.
35. CHOUIKHA Larbi & GOBE Eric, « La Tunisie en 2012 : heurs et malheurs d’une transition qui n’en
finit pas », in L’année du Maghreb, n°9, 2013, p. 388. Ce processus a été entamé avec la création du
Parti Républicain (qui regroupe notamment le PDP et Afek Tounes), de la Voie démocratique et
sociale (composée du PC tunisien, du PTT et d’une Partie du PDM) et s’est poursuivi avec la
création, le 16 juin 2012, du parti Nidaa Tounes. Cette coalition électorale se présente comme
ayant vocation à regrouper l’ensemble des opposants à la coalition au Pouvoir. Cette
bipolarisation apparait toutefois artificiel, voire néfaste à certains auteurs. Voir ainsi : FERJANI
Mohammed Chérif, « Révolution, élections et évolution du champ politique tunisien », in
Confluences Méditerranée, n° 82, pp. 112-115.
36. Cette loi, en interdisant aux anciens responsable du RCD de BEN-ALI d’exercer des fonctions
politiques importantes, visait à empêcher le Président de Nidaa Tounes et certains de ses cadres
de se présenter aux prochaines élections.
37. Lofti Nagdh, coordinateur régional d’Inaa Tounes à Tataouine est lynché le 18 octobre 2012,
Chokri BELAID, dirigeant du Mouvement des patriotes démocrates est assassiné le 6 février 2013
comme Mohammed BRAMHI, membre de l’opposition à la constituante le 25 juillet 2013.
38. TOUZEIL-DIVINA Mathieu, « Un rendez-vous constituant manqué ? Où fleuriront au Maroc le
jasmin et la fleur d'oranger » in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger,
n° 3, 2012, p. 691.
39. Suite à la crise politique provoquée par l’assassinat de Mohammed BRAMHI.
40. Voir supra au sujet de cette révision du règlement.
41. CATUSSE Myriam, « Au-delà de "l'opposition à sa Majesté" : mobilisations, contestations et
conflits politiques au Maroc », in Pouvoirs, n°145 (« Le Maroc »), 2013, p. 40. L’auteur invite
toutefois à dépasser cette seule grille de lecture en s’intéressant à d’autres formes d’opposition.
42. Pour une critique de cette conception qui relèverait de « l’anxiété culturelle de la gauche
marocaine » et une défense du processus constituant par un membre de la CCRC voir : BERNOUSSI
Nadia, « La constitution marocaine du 29 juillet 2011 : Entre continuité et rupture », in Revue du
droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n°3, 2012, p. 663-685, spéc. pp. 667-670.
43. BENDOUROU Omar, « La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 : le changement,
entre mythe et réalité », in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n°3,
2012, pp. 640-641.
44. FAGES Marie-Laure, « L’opportunité manquée d’un statut de l’opposition en France », in
Politeia, n°16, 2009, p. 338.
45. VIDAL-NAQUET Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », in Revue française de droit
constitutionnel 1, n°77, 2009, p. 166.
46. AVRIL Pierre, « L'improbable "statut de l'opposition" (à propos de la décision 537 DC du
Conseil constitutionnel sur le règlement de l'Assemblée nationale) », in Les petites affiches, n°138,
12 juillet 2006, p. 9.
47. Cité par BOUSQUET François Charles, Le statut de l’opposition sous la Ve République, Thèse, Droit,
Paris I, Paris, 2005, 1 Vol., 544 p. (dactyl.).
48. D’autant plus au Maroc ou la Constitution frappe de déchéance le parlementaire qui quitte le
groupe politique avec lequel il a été élu et ce afin de lutter contre la transhumance parlementaire
massive (Art. 61).
49. Voir à ce sujet les articles des professeurs BENDOUROU et TOUZEIL-DIVINA cités supra.
50. Voir notamment les articles 76 à 81 de la Constitution.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
151
51. Pour reprendre le titre de l’article du professeur PONTHOREAU au sujet du cas français :
PONTHOREAU Marie-Claire, « Les droits de l’opposition en France. Penser une opposition
présidentielle », in Pouvoirs, n° 108 (« L’opposition »), 2004, pp. 101-114.
52. THIERS Eric, « La majorité contrôlée par l’opposition : pierre philosophale de la nouvelle
répartition des pouvoirs ? », in Pouvoirs, n°143 (« La séparation des pouvoirs »), 2012, p. 63.
53. Cette question des critères d’identification est étudiée de manière plus approfondie à propos
du cas français par le Pr. VIDAL NAQUET Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit.,
spéc. pp. 158-166.
54. ROZENBERG Olivier et THIERS Eric, « Enquête sur l’opposition parlementaire », in L’opposition
parlementaire, ROZENBERG Olivier et THIERS Eric (dir.), Paris, La documentation française, 2013, pp.
12-14.
55. VIDAL-NAQUET Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., p. 155.
56. L’expression a été utilisée par le professeur Bendourou lors de la table ronde organisée lors
de la conférence « Constitutions et printemps arabes » organisée par le Laboratoire
méditerranéen de droit public le 19 mars 2012 à l’Institut de France.
57. TOUZEIL-DIVINA Mathieu, « Printemps et révolutions arabes : un renouveau pour la séparation
des pouvoirs ? », in Pouvoirs, n°143 (« La Séparation des pouvoirs), 2012, pp. 42-45.
58. En août 2012, un premier projet de Constitution issu de la mise en commun du travail des
différentes commissions constituantes de l’ANC a été publié. A cette date, ce « brouillon du projet
de constitution » ne mentionnait pas les droits de l’opposition parlementaire mais seulement,
dans un titre consacré aux dispositions générales, le droit de s’organiser en opposition politique.
Le second brouillon, publié en décembre 2012, ne mentionne plus du tout l’opposition. C’est la
commission constituante des pouvoirs législatifs et exécutif et des relations entre eux qui va
réintroduire en mars 2013 (soit au moment où les relations entre majorité et opposition sont
extrêmement tendues) un article spécifiquement consacré à l’opposition parlementaire en listant
neuf droits essentiels qui lui seraient reconnus et ne va pas sans rappeler l’article 10 de la
constitution marocaine. Cependant ces droits ne se retrouvent pas dans le projet de Constitution
présenté le 22 avril 2013 qui reconnait l’opposition parlementaire mais ne précise plus les droits
qui lui sont attribués. C’est dans la version du premier juin 2013 que le droit de proposer et de
présider annuellement une commission d’enquête réapparait. Il faudra finalement attendre un
amendement de la commission de consensus, qui accorde à la future opposition parlementaire la
présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur au sein de la commission des
relations extérieures, pour étoffer les droits spécifiquement reconnus et dépasser la simple
déclaration d’intention.
59. 138 voix pour, 20 voix contre et 20 abstentions.
60. Voir supra I] A/ 2), concernant les relations entre majorité et opposition au cours du
processus constituant tunisien.
61. Toutefois, le cadre juridique mis en place sous Ben Ali n’ignorait pas totalement l’opposition
parlementaire puisque la loi électorale lui réservait un quota minimum de sièges depuis 1994.
Voir : GOBE Éric, « Plasticité du droit constitutionnel et dynamique de l’autoritarisme dans la
Tunisie de Ben Ali », in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], n°130, février
2012, mis en ligne le 21 février 2012, consulté le 24 janvier 2014. URL : http://
remmm.revues.org.faraway.u-paris10.fr/7499.
62. Pour une étude de l’opposition tunisienne avant le printemps arabes voir entre autres : GOBE
Eric & CHOUIKHA Larbi, « Opposition et élections en Tunisie », in Monde arabe Maghreb-Machrek,
n°168, 2000, p. 29-40 et le dossier « S’opposer au Maghreb » de l’Année du Maghreb, n° 5, 2009.
63. H EUSCHLING Luc, « La Constitution formelle », in Traité international de droit constitutionnel :
Théorie de la Constitution (Tome 1), TROPER Michel et CHAGNOLLAUD Dominique (dir.), Paris, Dalloz,
2012, p. 294.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
152
64. BERNOUSSI Nadia, « La constitution de 2011 et le juge constitutionnel », in La constitution
marocaine de 2011, analyses et commentaires, ROUSSET Michel (dir.), Paris, LGDJ/Lextenso, 2012, p.
208.
65. SMITH Eivind, « Les fonctions symboliques des constitutions », in Traité international de droit
constitutionnel : Théorie de la Constitution (Tome 1), TROPER Michel et CHAGNOLLAUD Dominique (dir.),
Paris, Dalloz, 2012, p. 775.
66. Il en va par exemple ainsi au Portugal (voir l’article 114 de la constitution qui ne peut
d’ailleurs faire l’objet d’une révision constitutionnelle en vertu de l’article 288), en Croatie (art.
92, 124, 125) ou au Sénégal (voir le Titre V consacré à l’opposition parlementaire).
67. Voir GILLES William, « L’opposition parlementaire : étude de droit comparé », in Revue du droit
public et de la science politique en France et à l’étranger, 5, n°122, 2006, pp. 1363-1364.
68. SMITH Eivind, « Les fonctions symboliques des constitutions », op. cit., p. 776.
69. CDL-AD(2013)032F, Avis sur le projet final de la constitution de la République tunisienne, adoptée
par la commission de Venise lors de sa 96ème session plénière (Venise, 11/12 octobre 2013).
70. V OLONTE Luca, L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Maroc, Conseil de
l’Europe, Assemblée parlementaire, Commission des questions politiques et de la démocratie,
Doc. 13230, 10 juin 2013.
71. TOUZEIL-DIVINA Mathieu, « Un rendez-vous constituant manqué ? Où fleuriront au Maroc le
jasmin et la fleur d'oranger », op. cit., p. 713.
72. Cette notion de compromis dilatoire a été théorisée par Carl Schmitt qui les définit comme «
des compromis apparents parce qu’ils ne portent sur aucune décision de fond obtenue par des concessions
mutuelles : leur nature consiste justement à repousser et ajourner cette décision. Le compromis consiste en
effet ici à trouver une formule qui satisfasse toutes les exigences contradictoires et laisse irrésolus les vrais
points d’achoppement grâce à une expression ambigüe. Cette formule ne contient donc qu’une juxtaposition
extérieure, verbale, de sens foncièrement inconciliables. De faux compromis de ce genre sont en un sens de
vrais compromis : ils seraient impossibles s’il n’y avait aucune entente entre les partis. Mais cette entente
ne porte pas sur le fond : On tombe d’accord uniquement pour ajourner la décision et se ménager les
possibilités d’interprétation les plus diverses. Le compromis ne porte donc pas sur la résolution du fond d’un
problème grâce à des concessions mutuelles, l’accord consiste au contraire à se contenter d’une formule
dilatoire qui satisfait toute les revendications ». SCHMITT Carl, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 162.
Pour le professeur AVRIL, les compromis dilatoires sont « des rédactions acceptables sur le moment
par les acteurs mais qui [dissimulent] des arrières pensées contradictoires dont il [convient] tacitement
de renvoyer à l’avenir le règlement ». AVRIL Pierre, « Enchantements et désenchantements
constitutionnels sous la Ve République » in Pouvoirs, n° 126 (« La Ve République »), 2008, p. 8.
73. CARCASSONNE Guy, « L’opposition parlementaire comme objet juridique : une reconnaissance
progressive », in L’opposition parlementaire, op. cit., p. 87.
74. KELSEN Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, Trad. C. Eisenmann (1932), Paris, Dalloz, 2 e éd.,
2004, p. 63.
75. TOUZEIL-DIVINA Mathieu, « Printemps et révolutions arabes : Un renouveau pour la séparation
des pouvoirs ? », op. cit., pp. 29-45.
76. Ibid., p. 9.
77. PONTHOREAU Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », op. cit., p. 1136.
78. A la différence de l’article 18 de la Constitution du Bhoutan qui précise que l’opposition
s’assure que le parti majoritaire et le Gouvernement agissent conformément aux dispositions de
la Constitution, contribue à la bonne gouvernance et s’efforce de promouvoir l’intérêt national et
de remplir les aspirations du peuple. Elle doit de surcroit promouvoir l’intégrité nationale,
l’unité, l’harmonie et la coopération entre les différentes sections de la société. Il s'efforce de
promouvoir et de participer à un débat constructif et responsable au Parlement tout en offrant
une opposition saine et digne au Gouvernement. Le parti d’opposition ne doit pas laisser ses
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
153
intérêts prévaloir sur l’intérêt national. Son objectif doit être de rendre le gouvernement
responsable, comptable et transparent. L’opposition doit aider et supporter le Gouvernement en
cas de menaces extérieures, de calamités naturelles ou de crises nationales lorsque la sécurité et
l’intérêt national sont en jeu.
79. Voir contra au sujet de la situation française qui consacre des droits similaires : NABLI Beligh,
« L’opposition parlementaire : un contre-pouvoir politique saisi par le droit », in Pouvoirs, n°133
(« La Californie »), 2010, pp. 127-141.
80. MULLER Renaud, « Un nouveau rôle pour l’opposition dans la procédure législative ? », in
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n°10 (« Esclavage et travail forcé »), 2012, p. 105.
81. KELSEN Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, op. cit., p. 74.
82. MAUS Didier, « Obstruction » in Dictionnaire de droit constitutionnel, DUHAMEL Olivier & MENY Yves
(dir.), Paris, PUF, 1992, p. 672.
83. KELSEN Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, op. cit., p. 75.
84. MARINESE Vito, « L’obstruction parlementaire disparaîtra…Bon débarras ? », in Politeia, n°16,
2009, p. 311.
85. BENDANA Kmar, « Le parti Ennahdha à l’épreuve du pouvoir en Tunisie », in Confluences
Méditerranée, n°82, 2012, p. 196.
86. VIDAL-NAQUET Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., p. 173.
87. MARINESE Vito, « L’obstruction parlementaire disparaîtra…Bon débarras ? », op. cit., p. 311.
88. AVRIL Pierre, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé », op. cit., p. 9.
89. MOLFESSIS Nicolas, « Le renvoi d’un texte à un autre », in Les mots de la loi, MOLFESSIS Nicolas
(dir.), Paris, Economica, 1999, p. 55 (note 1).
90. FRANÇOIS Bastien, « L’impensé de l’opposition parlementaire sous la Vème République », in
L’opposition parlementaire, op. cit., p. 104.
91. PIERRE Eugène, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, deuxième éd., Paris, Librairies
imprimeries-réunies, 1902, p. V. Voir plus récemment PEZANT Jean-Louis, « Quel droit régit le
Parlement ? », in Pouvoirs, n°64 (« Le Parlement »), 1993, pp. 63-74 ; ou encore BENETTI Julie, « Les
rapports entre Gouvernement, groupes de la majorité et groupes d’opposition », Jus Politicum,
hors-série (« Le Parlement français et le nouveau droit parlementaire »), 2012, p. 83.
92. Voir à ce sujet : GIRAUD Thomas, L’interprétation de la constitution par les organes non
juridictionnels, Thèse, Droit, Université Paris Ouest Nanterre, Hauts de Seine, 2005, 1 vol., 464 p.
(dactyl.).
93. Ce principe est mentionné par le préambule de la Constitution tunisienne et l’article premier
de la Constitution marocaine.
94. DESROSIERS Jean-Philippe, « Droit parlementaire. Réflexions sur les possibilités de création
d’une commission d’enquête parlementaire. L’exemple de la commission d’enquête sur les
sondages de l’Elysée », in Revue française de droit constitutionnel, 1, n°85, p. 175-186.
95. BENDOUROU Omar, « La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 : Le changement,
entre mythe et réalité », op. cit., p. 657.
96. SOMMACCO Valérie, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, Paris,
LGDJ, Coll. nouvelle bibliothèque des thèses, 2002, p. 65.
97. L’article 118 de la Constitution tunisienne ne mentionne toutefois que le contrôle des projets
de loi, et non des propositions, ce qui peut conduire à ce que ces dernières échappent au contrôle
de constitutionnalité a priori.
98. Cette opposition entre contrôle concret et abstrait est ici opérante mais ne peut constituer,
comme l’illustrent les cas tunisiens et marocains, un critère de classification des systèmes de
justice constitutionnelle. TUSSEAU Guillaume, Contre les « modèles » de justice constitutionnelle, essai
de critique méthodologique, Bologne, Bononia university press, 2009, pp. 37-45.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
154
99. En vertu de l’article 18 de la loi organique n°085-13 du 31 juillet 2014 relative aux modalités
de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire.
100. Décision du Conseil constitutionnel n°826-2012 du 17 janvier 2012, B.O. n°6014 du 19 janvier
2012, p. 359.
101. Décision du Conseil constitutionnel n°830-2012 du 14 février 2012, B.O. n°6025 du 27 février
2012, p. 745.
102. CHAMPEIL-DESPLATS Véronique, « Effectivité et droits de l’Homme : Approche théorique », in A
la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, CHAMPEIL-DESPLATS Véronique et LOCHAK Danièle
(dir.), Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2008, p. 20.
103. Décision du Conseil constitutionnel n° 924-2013 du 22 aout 2013.
104. BENEZA Hajar, « Parlement. L’USFP se mobilise pour les droits de l’opposition » in
L’économiste, n° 4186, 06 janvier 2014.
ABSTRACTS
Whereas the constitutionnal texts emphatically recognize the competences of the parliamentary
opposition in Morocco and Tunisia, the place set aside for this opposition during the
constitutional process gives grounds for doubting the sincerity of such a consecration.
Furthermore, the implementation of these clauses remains in the hands of the majority, while
their protection by the constitutional judges is failing. Those points question the relevance of the
so-called « rights of opposition ».
Si les textes constitutionnels marocain et tunisien consacrent avec une certaine emphase ces
compétences de l’opposition parlementaire, le traitement qui lui a été réservé au cours du
processus constituant, conduit à douter de la sincérité d’une telle consécration. De surcroit, leur
concrétisation est maitrisée par la majorité et leur protection par le juge constitutionnel apparait
restreinte. Ceci remet en question la pertinence d’une qualification en termes de « droits » de
l’opposition.
INDEX
Mots-clés: Printemps arabes - Séparation des pouvoirs - Constitutionnalisation - Parlement -
Justice constitutionnelle - Démocratie - Etat de droit - Droits de l’opposition - Opposition
parlementaire - Majorité - Minorité - Obstruction
Keywords: Arab springs - Separation of power - Constitutionalisation - Parliament -
Constitutional review - Democracy - Rule of law - Opposition rights - Parliamentary opposition -
Majority - Minority - Filibustering
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
155
AUTHOR
ANTONIN GELBLAT
Antonin Gelblat est ATER de droit public à l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense et
doctorant au CREDOF où il prépare une thèse sur "les constitutionnalisations du droit
parlementaire" sous la direction du professeur Touzeil-Divina.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
156
La Constitution égyptienne de
2014 est-elle révolutionnaire ?
Nathalie Bernard-Maugiron
1 La nouvelle Constitution égyptienne, adoptée par référendum en janvier 2014, a été
présentée par les autorités égyptiennes comme une Constitution révolutionnaire, un
modèle de protection des droits de l’homme et une avancée significative vers une
véritable transition démocratique. Elle est venue clore une transition constitutionnelle
particulièrement chaotique, entamée avec la chute du président Hosni Moubarak le 11
février 2011. L’Egypte a en effet connu deux déclarations constitutionnelles provisoires 1
et deux Constitutions, la première n’étant restée en vigueur que six mois avant d’être
suspendue le 3 juillet 20132 puis remplacée en janvier 20143.
2 Alors que la Constitution de 2012 avait été rédigée par une assemblée élue 4, c’est un
comité de 50 membres (« Comité des 50 »), nommé par le président par intérim, qui est
à l’origine du texte de 20145. Il avait été reproché à la Constitution de 2012 d’avoir été
élaborée de façon autoritaire par une assemblée non représentative dominée par les
islamistes. Il est vrai que cette constituante comprenait près de 70% d’islamistes 6, mais
il s’agissait de la première assemblée constituante jamais élue par le pouvoir législatif,
alors que les membres du Comité des 50, eux, ont tous été nommés par le président par
intérim7. La plupart des membres de ce Comité étaient des libéraux ou des
représentants d’institutions proches de l’appareil d’Etat, qui avaient été en
confrontation directe avec le gouvernement de Mohamed Morsi. Les Frères musulmans
n’y étaient pas représentés, puisque les deux sièges réservés aux partis islamistes
étaient occupés par un membre du parti salafiste al-Nour et par un dissident de la
Confrérie. Cinq femmes (sur 50) siégeaient dans le Comité contre sept (sur 100) dans la
constituante de 2012.
3 Le délai de six mois octroyé par la Déclaration constitutionnelle de mars 2011 (art. 60) à
la constituante de 2012 pour rendre son projet s’était révélé très court et avait conduit
le président Morsi à le prolonger de deux mois en novembre 2012 8, avant que le
président de la constituante ne décide finalement de passer au vote lors d’une session
marathon qui se termina à l’aube du 30 novembre, de crainte que la Haute Cour
constitutionnelle ne déclare l’inconstitutionnalité de l’Assemblée lors de son audience
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
157
prévue pour le 2 décembre. Le Comité des 50, quant à lui, ne s’était vu attribuer qu’un
délai de 60 jours pour mener à bien ses travaux, délai très court et peu propice aux
débats et à la recherche de compromis, qu’il réussit à étirer en ne comptabilisant que
les jours ouvrables, repoussant ainsi la date limite de remise du texte au 3 décembre
2013 au lieu du 8 novembre.
4 Si les séances plénières de la constituante de 2012 firent l’objet d’une grande publicité
et furent retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision, le Comité des 50
décida fin octobre 2013 de se réunir à huis clos, allant jusqu’à interdire aux membres
suppléants et aux dix experts auteurs de l’avant-projet d’amendements d’assister aux
débats. Un compte rendu officiel était publié chaque jour par le porte-parole du Comité.
Ce manque de transparence fut critiqué et suscita nombre d’interrogations quant à ses
motivations réelles. Seules les séances du 30 novembre et du 1 er décembre, consacrées à
l’adoption du texte, furent retransmises en direct. Et lorsque quatre articles n’obtinrent
pas la majorité requise de 75% des voix9, le Comité se réunit à huis clos, avant de
reprendre les débats publics quelques heures plus tard et de terminer l’adoption du
texte.
5 La Constitution fut adoptée par référendum les 14 et 15 janvier 2014. Le « oui » était
tellement sûr de l’emporter, que rien n’avait été prévu en cas de rejet. La plupart des
opposants ayant appelé au boycott, le seul véritable enjeu pour le gouvernement
résidait dans le taux de participation. Celui-ci se devait d’être supérieur aux 32%
enregistrés en 2012 pour l’adoption de la précédente Constitution. Le texte fut
finalement adopté à 98,1%, contre 63,8% pour la Constitution de 2012, avec un taux de
participation de 38,6%. En fait, le vote ne porta pas tant sur la Constitution elle-même
que sur la légitimité du régime de transition issu du renversement de Morsi le 3 juillet
2013. Il permit également de plébisciter la candidature du ministre de la Défense, le
général Sissi, aux élections présidentielles à venir, puisqu’il avait fait savoir trois jours
avant le scrutin qu’il se présenterait si le peuple manifestait clairement son désir de le
voir être candidat. Sa candidature était donc conditionnée à un taux de participation
élevé. Pour beaucoup d’Egyptiens, las des bouleversements et de l’instabilité politique
qui avait laissé l’économie exsangue, le vote en faveur de la Constitution constituait
sans doute également un pas vers la stabilité, la sécurité et l’espoir d’un retour de la
croissance économique10.
6 Cette nouvelle Constitution devait constituer une rupture avec le passé et rectifier celle
de 2012, présentée comme la Constitution islamique d’un Etat théocratique. L’analyse
de son contenu, et en particulier des dispositions relatives aux droits de l’homme et
celles traitant de l’identité de l’Etat montre toutefois qu’elle se situe davantage dans la
continuité que dans la rupture de l’ordre constitutionnel égyptien.
I - Une Constitution plus respectueuse des droits de
l’homme ?
7 La Constitution de 2014 a été présentée comme une étape importante vers une plus
grande protection des droits de l’homme et la mise en place d’un Etat civil respectueux
des minorités religieuses. Si elle présente effectivement des avancées au niveau des
droits proclamés, les mécanismes de mise en œuvre restent toutefois insuffisants pour
garantir un réel respect de ces dispositions.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
158
A - Une liste importante de droits et libertés
8 La Constitution de 2014 a étendu la liste des droits garantis. Elle protège mieux les
droits de la femme et met en place des mécanismes de discrimination positive.
1. Trois générations de droits
9 Des droits et libertés peuvent être trouvés dans le titre 2 de la Constitution Des
fondements de la société11, le titre 3 Des droits, libertés et devoirs publics ainsi que dans le
titre 4 De l’Etat de droit. Plusieurs de ces dispositions figuraient déjà dans les
Constitutions précédentes, comme le principe d’égalité des chances entre tous les
citoyens sans discrimination (art. 9)12, la liberté personnelle (art. 54)13, le droit au
respect de la vie privée (art. 57)14, l’inviolabilité du domicile (art. 58)15, l’interdiction
d’être expulsé de son pays ou empêché d’y revenir (art. 62)16, la liberté d’opinion (art.
65)17, le droit de propriété (art. 32 à 37)18, le droit de vote et de candidature (art. 87)19 ou
le droit de créer des partis politiques sur simple déclaration (art. 74) 20. L’accès aux
informations, données, statistiques et documents officiels est un droit assuré par l’Etat
à tout citoyen (art. 68)21. Comme en 2012, les libertés de réunion (art. 73)22 et
d’association (art. 75)23 peuvent s’exercer sur simple déclaration 24. La Constitution de
2014 reprend également l’essentiel des droits relatifs à une bonne administration de la
justice, comme le droit d’ester en justice (art. 97)25, le droit à un procès équitable (art.
96)26 respectant les droits de la défense (art. 54 et 96) 27, la présomption d’innocence
(art. 96)28, le principe de la légalité des délits et des peines (art. 95) 29 ou la non-
rétroactivité des lois pénales (art. 95 et 225)30. Les prisons sont considérées comme un
lieu de redressement et de réhabilitation (art. 56)31.
10 De même, on retrouve des droits économiques et sociaux ou des droits de la troisième
génération qui figuraient déjà dans les textes précédents, comme le droit au travail et
l’interdiction du travail forcé (art. 12)32, le droit à des soins médicaux (art 18)33 et à la
protection sociale (art. 17)34 ou le droit de grève pacifique (art. 15) 35. La liberté
syndicale est également garantie, mais un seul syndicat professionnel par profession
est autorisé (art. 76 et 77)36. L’Etat s’engage à mettre en place un plan visant à éradiquer
l’analphabétisme (art. 25)37. Tout individu a le droit de vivre dans un environnement
sain, que l’Etat a l’obligation de protéger (art. 46)38.
11 La Constitution renforce la protection de droits qui figuraient déjà dans les textes
précédents, comme les droits de l’enfant (art. 80)39 ; l’interdiction de la torture -
considérée comme un crime imprescriptible et non plus seulement comme une
pratique interdite (art. 52)40 ou la liberté de la presse - avec interdiction des peines
d’emprisonnement pour délits de presse (art. 70 à 72). Comme en 2012, toute censure
sur les médias est interdite, sauf à titre exceptionnel en temps de guerre ou de
mobilisation générale (art. 71)41, et la traite sexuelle des êtres humains est prohibée
(art. 89)42.
12 L’éducation est gratuite dans les écoles publiques et obligatoire jusqu’au secondaire
(art. 19)43. L’Etat s’engage à développer et à garantir l’indépendance des universités
(art. 21)44 et continue de garantir la liberté de recherche scientifique (art. 66 et 67) 45. La
Constitution ne reprend pas l’obligation qui figurait dans la Constitution de 2012 (art.
12) d’encourager l’arabisation de l’enseignement, des sciences et des connaissances
mais confirme que la langue arabe, l’éducation religieuse et l’histoire nationale sont les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
159
matières de base de l’enseignement pré-universitaire (art. 24) 46. Quant aux universités,
elles s’engagent à enseigner les droits de l’homme, ainsi que les valeurs et l’éthique
professionnelle propres à chaque discipline scientifique (art. 24) 47. L’article 19, en
déclarant que le but de l’éducation est notamment de forger la personnalité égyptienne
et de maintenir l’identité nationale, a toutefois suscité quelques inquiétudes et
interrogations, l’éducation ne semblant plus être un but en soi, mais constituer un
moyen au service d’un autre objectif, particulièrement vague.
13 La Constitution prévoit pour la première fois la mise en place d’un système de taxation
progressive tenant compte de la capacité contributive de chacun (art. 38). L’Etat
s’engage à réduire les écarts entre les revenus par la fixation d’un salaire minimum et
d’une retraite permettant une vie décente, et à fixer par la loi un salaire maximum pour
tous les salariés du secteur public (art. 27). Comme dans la Constitution de 2012, l’Etat
devra assurer la durabilité des ressources naturelles de manière à garantir les droits
des générations à venir (art. 46)48. De même, comme en 2012, il prend l’engagement de
protéger ses mers, plages, lacs, voies d’eau (art. 45) 49, ainsi que le Nil (art. 44)50. Le droit
de chaque citoyen à un logement décent est garanti dans des termes plus larges que
dans la Constitution de 2012 (art. 78)51, de même que le droit de chacun à une
alimentation saine et à l’eau potable (art. 79)52. Le droit à pratiquer un sport est
également garanti, comme en 2012 (art. 84)53.
14 La Constitution de 2014 a également étendu la liste des droits protégés. C’est ainsi
qu’elle affirme pour la première fois le droit de tout enfant né d’un père égyptien ou
d’une mère égyptienne d’obtenir la nationalité égyptienne (art. 6) 54 Elle garantit
également le droit de l’accusé à garder le silence (art. 55) ainsi que le droit de faire don
de ses organes de son vivant ou après sa mort (art. 61). Des droits de la troisième
génération se voient mentionnés pour la première fois : l’Etat s’engage à protéger les
zones de pêche (art. 30), les ressources naturelles (art. 32), à développer et entretenir le
Canal de Suez (art. 43). Il doit protéger et développer les espaces verts dans les zones
urbaines, protéger les richesses botaniques, animalières et piscicoles, les espèces
menacées et prévenir la cruauté envers les animaux (art. 45). Il doit préserver l’identité
culturelle égyptienne dans ses différentes origines (art. 47) et protéger, conserver et
restaurer les antiquités (art. 49). La culture est un droit pour tout citoyen, garanti par
l’Etat (art. 48).
2. Une protection des droits de la femme renforcée
15 La Constitution de 2014 renforce le statut de la femme par rapport au texte de 2012. Elle
a réintroduit une longue liste non exhaustive de fondements discriminatoires
interdits55 : religion, croyance, sexe, origine, race, couleur, langue, handicap, classe
sociale, appartenance politique ou géographique ou toute autre raison (art. 53) 56. Elle
pose également le principe de l’égalité entre hommes et femmes et le droit des femmes
à occuper des fonctions publiques, notamment dans les institutions judiciaires :
16 Article 11 de la Constitution de 2014 :
17 « L’Etat s’engage à réaliser l’égalité entre hommes et femmes pour tous les droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la
présente Constitution.
18 L’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une représentation
adéquate des femmes au sein des assemblées parlementaires, conformément à la loi. Il
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
160
garantit aussi le droit des femmes à accéder sans discrimination aux fonctions
publiques et aux postes de direction au sein de l’Etat et à être nommées dans les corps
et organes judiciaires.
19 L’Etat s’engage à protéger les femmes contre toute forme de violence et à leur
permettre de concilier leurs obligations familiales et les exigences de leur travail. De
même qu’il procure soutien et protection à la maternité et à l’enfance, aux femmes
soutiens de famille, aux femmes âgées et aux femmes les plus démunies ».
20 Si l’Etat doit réaliser l’égalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne les droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Constitution, et
dans l’accès aux fonctions publiques, la Constitution précise toutefois qu’il doit
également permettre à la femme de concilier ses devoirs familiaux et son travail dans la
société, reprenant ainsi la vision stéréotypée des rapports hommes/femmes qui figurait
déjà dans les textes de 197157 et 2012 58. La Constitution de 2014 reprend également
l’engagement de l’Etat à soutenir la maternité et l’enfance, déjà mentionns dans la
Constitution de 2012 (art. 10). Or cette disposition, qui figurait pourtant elle-aussi dans
la Constitution de 197159, avait été très critiquée et considérée comme emblématique de
la priorité accordée par les islamistes aux valeurs familiales et de leur volonté
d’enfermer les femmes dans leurs tâches domestiques de mères de famille 60.
21 Pour la première fois, l’Etat s’engage à protéger les femmes contre toute forme de
violence61. Au niveau politique, il doit leur assurer une « représentation adéquate » au
sein du Parlement. De plus, l’art. 180 demande que 25% des sièges au niveau local leur
soient réservés62.
22 L’article 11 de la Constitution n’a toutefois pas empêché de jeunes diplômées en droit
de se voir refuser le droit de se présenter au concours d’entrée du Conseil d’Etat 63 en
janvier 2014. La présidente du Conseil national de la femme protesta vigoureusement
auprès du président du Conseil d’Etat, lui reprochant de discriminer à l’encontre des
candidates et l’accusant de violer la Constitution. Le club des juges du Conseil d’Etat la
menaça de poursuites pour ingérence dans les affaires de la justice. Un juge à la Cour
d’appel du Caire affirma que la Constitution n’exigeait pas l’ouverture de la
magistrature aux femmes, et que la décision devait être laissée à chaque ordre de
juridiction individuellement et sans aucune ingérence.
23 De même, aucune femme n’a été nommée gouverneur et le ministre du Développement
municipal a déclaré en septembre 2014 qu’aucune femme ne serait nommée
gouverneur dans un proche avenir, parce qu’il fallait d’abord « les préparer » avant
qu’elles puissent être nommées à de telles fonctions.
24 Enfin, le projet initial de loi électorale pour les législatives prévoyait, en application de
l’article 11, de réserver trois sièges par liste pour les femmes 64. Devant les protestations
du Conseil national de la femme, ce quota fut renforcé pour atteindre désormais 56
sièges.
3. Des mesures de discriminations positives en faveur de certains groupes
vulnérables
25 La Constitution de 1971 avait déjà consacré des mesures de discrimination positive,
réservant la moitié des sièges des assemblées représentatives - Assemblée du peuple 65,
Conseil consultatif66, conseils populaires locaux67 ou même conseils d’administration
des unités du secteur public68 aux ouvriers et paysans, afin que ces groupes, sous-
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
161
représentés, puissent participer activement au pouvoir. La Constitution de 2012 (art.
229) n’avait conservé cette discrimination positive que pour la première élection
législative suivant l’adoption de la Constitution, ainsi qu’au sein des conseils
d’administration des unités du secteur public (art. 27).
26 La Constitution de 2014 a multiplié les cas de discrimination positive. Certains secteurs
de la société, considérés comme particulièrement vulnérables, se voient reconnaître un
traitement préférentiel. C’est ainsi que les personnes âgées bénéficient de mesures
spéciales de protection. L’Etat doit leur garantir le droit à la santé et aux loisirs, ainsi
que les droits économiques, sociaux et culturels et leur fournir des retraites
appropriées permettant de leur assurer un niveau de vie décent et de participer à la vie
publique (art. 83). Certaines professions, comme les pêcheurs, doivent être soutenues et
l’Etat s’engage à leur donner les moyens d’effectuer leur travail sans causer de
dommages aux écosystèmes (art. 30). De même, les enseignants, « pilier de
l’éducation », se voient garantir le développement de leurs compétences académiques
et professionnelles, l’Etat s’engageant à prendre soin de leurs droits matériels et
moraux afin d’assurer la qualité de l’enseignement (art. 22) 69. L’Etat va améliorer les
conditions de travail des médecins, du personnel infirmier et des employés du secteur
de la santé (art. 18). Il garantit les droits et la protection des fonctionnaires (art. 14) et
protège les agriculteurs et les travailleurs agricoles contre toute exploitation (art. 29)
ainsi que les intérêts des Egyptiens vivant à l’étranger (art. 88) 70.
27 L’Etat s’engage à protéger les droits des enfants handicapés et à assurer leur
réadaptation et leur insertion dans la société (art. 80)71. Il veille à offrir des possibilités
d’emploi aux blessés de la révolution, anciens combattants âgés, blessés de guerre,
familles de disparus lors d’une guerre, ou personnes blessées lors d’opérations de
sécurité, ainsi qu’à leurs conjoints, enfants et parents (art. 16) 72. Il garantit également
les droits à la santé, aux loisirs, au sport, ainsi que les droits économiques, sociaux et
culturels des handicapés et des nains (art. 81). L’Etat doit leur offrir des possibilités
d’emploi et mettre en place des quotas (art. 81). Les handicapés doivent également être
représentés de façon appropriée dans les conseils locaux (art. 180). La création d’un
Conseil national pour les personnes handicapées est également prévue (art. 214).
28 Les jeunes et les chrétiens devront eux-aussi se voir reconnaître une « représentation
appropriée » au sein de la première Chambre des représentants qui sera élue après la
promulgation de la Constitution. C’est la loi qui devra déterminer cette
« représentation appropriée ». Conformément à l’art. 180, un quart des sièges des
conseils locaux doivent être réservés aux jeunes de moins de 35 ans et parmi eux. Les
Egyptiens expatriés se voient eux-aussi garantir une « représentation appropriée » sein
de la première assemblée législative (art. 244).
29 L’Etat s’engage à développer dans les dix ans un plan de développement économique et
urbain des zones frontalières et des régions défavorisées, y compris la Haute Egypte, le
Sinaï, Matrouh et la Nubie, en tenant compte des modèles culturels et
environnementaux des communautés locales (art. 236). Il doit également développer
des projets pour réinstaller les Nubiens dans leurs régions d’origine (art. 236).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
162
B - Un mécanisme de mise en œuvre qui reste insuffisant
30 Une protection effective des droits de l’homme exige la mise en place par la
Constitution de mécanismes concrets de mise en œuvre et de supervision. Or, la
Constitution de 2014 offre insuffisamment de garanties en ce domaine.
1. Un encadrement insuffisant du législateur
31 Comme les textes qui l’ont précédée, la Constitution de 2014 renvoie très fréquemment
à la loi pour organiser et définir le contenu des droits de l’homme. Certains droits sont
toutefois formulés de manière absolue, comme la protection de la dignité humaine (art.
51), la liberté de croyance (art. 64), le droit de réunion privée pacifique (art. 73), le droit
d’ester en justice (art. 97), la liberté de pensée et d’opinion (art. 65), l’interdiction de la
torture (art. 52), l’interdiction de l’esclavage ou de la servitude (art. 89), ou le droit à un
juste procès et à la protection des droits de la défense (art. 96).
32 Par contre, le droit de former des partis politiques par simple notification est
réglementé par la loi (art. 74), de même que le droit de se réunir en public ou de
manifester (art. 73), le droit de participer à la vie publique (art. 87) ou la protection du
secret de la correspondance (art. 57). Des lois devront donc être adoptées par le
prochain parlement pour les mettre en œuvre. Le législateur disposera d’une grande
marge de liberté pour délimiter ces droits, et les garde fous fixés par la Constitution
pour limiter la liberté du législateur pourraient s’avérer impuissants à contenir une
majorité hostile au concept même de droits de l’homme.
33 L’article 121 prévoit ainsi que les lois de mise en œuvre des dispositions relatives aux
droits de l’homme devront être adoptées à la majorité des 2/3 du parlement 73. Cette
disposition, destinée à s’assurer de l’existence d’une majorité proche du consensus et
non d’une simple majorité, devrait permettre d’éviter que les droits ne soient définis de
façon restrictive. Mais l’exigence d’une telle majorité rendra également difficile
l’amendement de lois liberticides actuellement en vigueur.
34 L’article 92, quant à lui, prohibe toute suspension ou réduction des droits et libertés
inhérents à la personne des citoyens et interdit au législateur de porter atteinte à
l’essence et à la substance d’un droit sous prétexte d’en réguler la mise en œuvre. Ce
principe figurait déjà dans la Constitution de 2012 (art. 81), mais il était précisé que les
droits et libertés s’exerçaient « sans contradiction avec les principes mentionnés au
titre L’Etat et la société de la Constitution », ce qui avait soulevé les plus grandes
inquiétudes (voir ci-après). Quant à l’appréciation du fondement et de l’essence d’un
droit, elle sera laissée au pouvoir souverain du parlement, sous le contrôle, le cas
échéant, de la Haute Cour constitutionnelle.
35 L’article 93, qui affirme pour la première fois que l’Etat s’engage à respecter les traités,
les accords et les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par
l’Egypte, et leur donne force de loi après leur publication, a été considéré comme une
innovation très positive. Mais il ne prévoit pas la supériorité du droit international sur
le droit national et ne confère que force de loi aux traités auxquels l’Egypte est partie 74.
En cas de conflit entre une loi et un traité, le dernier texte adopté prévaudra donc,
même s’il s’agit de la loi et qu’elle est contraire à un traité ratifié antérieurement. De
plus, cette disposition n’invite pas expressément le juge à faire un recours plus
systématique aux conventions internationales ratifiées par l’Egypte. Elle pourra
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
163
toutefois être utilisée par les ONG pour faire pression sur les autorités égyptiennes afin
qu’elles adaptent la législation en vigueur aux standards internationaux relatifs aux
droits de l’homme.
36 Enfin, conformément à l’article 226, les dispositions relatives aux principes de liberté et
d’égalité mentionnés dans la Constitution ne pourront être amendées, sauf pour en
renforcer les garanties. Il est donc interdit d’amender la Constitution pour diminuer le
niveau de protection des citoyens.
37 La Constitution de 2014 (art. 94), comme celles qui l’ont précédée 75, affirme que
l’indépendance et l’immunité de la justice constituent des garanties fondamentales de
la protection des droits de l’homme.
2. Une mise en œuvre onéreuse
38 Le titre 2 de la Constitution contient une longue liste de droits sociaux, économiques et
culturels que l’Etat s’engage à garantir. Mais leur mise en œuvre va exiger des moyens
financiers importants et ces articles risquent de rester lettre morte si l’Etat ne parvient
pas à réunir les fonds nécessaires.
39 La Constitution a prévu de consacrer un pourcentage du produit intérieur brut (PIB) à
certaines dépenses. Les dépenses de santé bénéficieront ainsi d’un pourcentage des
dépenses publiques qui ne doit pas être inférieur à 3% du PIB (art. 18), l’enseignement
primaire et secondaire d’un pourcentage minimum de 4% (art. 19), l’enseignement
universitaire d’un pourcentage minimum de 2% (art. 21) et la recherche scientifique un
pourcentage minimum de 1% (art. 23). La Constitution précise que l’Etat devra mettre
en œuvre progressivement ses engagements et que ces taux devront être atteints dans
le budget de l’année fiscale 2016/2017 (art. 23876. L’Egypte traverse des difficultés
économiques telles que consacrer 10% de son PIB à ces dépenses - soit le double du
montant actuel - risque de représenter un vrai défi77. Or, toute modification des taux
nécessitera la mise en œuvre de la procédure d’amendement de la Constitution. Par
ailleurs, quelle sanction prévoir en cas de non-respect de ces taux en pratique ? Le
budget de l’Etat pourrait-il faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la
Haute Cour constitutionnelle ?
3. Des restrictions possibles au nom de l’ordre public
40 L’article 86 de la Constitution renvoie à l’obligation de préserver la sécurité nationale :
41 « Préserver la sécurité nationale est un devoir et l’engagement de tous à l’observer est
une responsabilité nationale garantie par la loi. La défense de la patrie et la protection
de son territoire sont un honneur et un devoir sacré. Le service militaire est obligatoire
conformément à la loi ».
42 Quant à l’article 237, il demande à l’Etat de lutter contre tous les types et toutes les
formes de terrorisme et de traquer ses sources de financement dans un délai précis, au
vu de la menace qu’il représente pour la nation et ses citoyens 78. Même s’il précise que
l’Etat devra respecter les droits et libertés publiques, cet article ainsi que l’article 86,
pourraient être invoqués pour restreindre de façon excessive la liberté d’expression ou
le droit de manifester. Les notions de « sécurité nationale » et de « terrorisme » sont en
effet particulièrement floues et pourraient faire l’objet d’interprétations extensives.
Certes, la police est priée de se conformer aux obligations prévues par la Constitution et
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
164
par la loi et de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales 79, mais
aucun mécanisme spécifique de sanction n’est prévu en cas de non-respect de cette
obligation.
4. Le jugement de civils par la justice militaire
43 La comparution de civils devant les tribunaux militaires continue à être autorisée, alors
même que plusieurs membres du Comité des 50 avaient fait part de leur hostilité à une
telle disposition. Les crimes concernant les forces armées, leurs officiers, leurs
membres et ceux qui relèvent de leur autorité, de même que les crimes commis par les
membres des services de renseignements pendant leurs missions ou à cause d’elles sont
soumis de manière exclusive à la justice militaire (art. 204) 80.
44 La Constitution de 2014 (art. 204) autorise les civils à comparaître devant la justice
militaire pour les crimes qui représentent
45 « une attaque directe contre les installations militaires, les casernements des forces
armées, ou tout ce qui relève de leur autorité; contre des zones militaires ou
frontalières indiquées comme telles ; contre les équipements des forces armées, leurs
véhicules, armes, munitions, documents, contre les secrets militaires, leurs biens
publics ou les usines militaires ; pour des crimes liés à la conscription ; pour des crimes
qui sont des attaques directes commises contre des officiers ou des membres des forces
armées en raison de l’exercice de leurs fonctions ».
46 Si la Constitution de 1971 ne mentionnait pas cette compétence, laissant la loi régler
leur domaine de compétence81, celle de 2012 autorisait déjà les tribunaux militaires à
juger des civils en cas de crime « de nature à nuire aux forces armées » (art. 198). La loi
devait déterminer ces crimes et fixer les autres attributions de la justice militaire.
Certes la Constitution de 2014 donne une liste, mais celle-ci est très extensive. Les
crimes commis par des militaires contre des civils, en cas de dispersion de
manifestations par exemple, relèveront de la justice militaire. De même que ceux
commis par des personnes « qui relèvent de leur autorité ». Les installations relevant
de l’empire économique de l’armée peuvent être concernées elles-aussi. Une simple
dispute dans une station-service, un hôtel, une entreprise ou même un supermarché
appartenant à l’armée entre un employé et un client pourrait entraîner le transfert du
civil devant la justice militaire82.
47 Un tel privilège est fortement critiqué par l’opposition et par de nombreux militants,
qui y voient la preuve de la mainmise de l’armée sur la vie politique et dénoncent une
justice militaire expéditive et peu respectueuse des droits de la défense. Quant à ses
défenseurs, ils invoquent le fait que l’Egypte traverse une période d’instabilité et que
l’armée doit pouvoir lutter contre le terrorisme et se mettre à l’abri de tout risque de
manipulation. Cette disposition a fait l’objet d’intenses négociations au sein du Comité
des 50, l’armée refusant toute concession en ce domaine. Elle a finalement été adoptée
avec une forte majorité83.
48 Si les dispositions relatives aux droits de l’homme n’auront peut-être pas la portée
qu’on leur prête, celles relatives à la place de la religion ne constituent pas vraiment
elles non plus une rupture dans l’histoire constitutionnelle égyptienne 84.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
165
II - Des références religieuses moins nombreuses?
49 Les débats autour de l’identité de l’Etat et de la place de la religion dans le système
normatif constituèrent l’un des principaux enjeux du processus d’élaboration des
Constitutions de 2012 et 2014. L’analyse des différentes dispositions à connotation
religieuse de la Constitution de 2014, comparée avec celles figurant dans les
Constitutions égyptiennes antérieures, permettra de déterminer si cette Constitution a
réellement constitué une rupture.
50 L’un des principaux reproches adressés au régime de l’ex-président Morsi était d’avoir
islamisé le droit à travers l’adoption d’une Constitution islamique et la mise en place
d’un Etat théocratique dictatorial où le religieux aurait la haute main sur le politique. Il
est vrai que plusieurs dispositions du texte de 2012 comportaient des références
religieuses. Mais certaines avaient été reprises de la Constitution antérieure (art. 2) et
d’autres ne faisaient que porter au niveau constitutionnel des dispositions déjà
présentes dans le droit égyptien (art. 3, 43, 44). Enfin, deux des articles les plus
controversés (art. 219 et 4) n’auraient peut-être pas entraîné les bouleversements
annoncés.
A - LaConstitution de 2014 se place dans la continuité des textes
antérieurs
1 - Les principes de la charia, source principale de la législation
51 L’article 2 de la Constitution de 1971, selon lequel « Les principes de la charia islamique
sont la source principale de la législation85 », repris mot pour mot dans le texte de
201286, figure également dans la Constitution de 2014, alors même que le Comité des 50
était composé à majorité de libéraux, représentants de partis de gauche et membres de
l’appareil d’Etat, et ne comprenait que deux représentants des partis islamistes. Cette
constance dans la référence constitutionnelle à la valeur normative de la charia ne
signifie toutefois pas nécessairement la revendication d’un rôle juridique ou politique
spécifique pour les normes religieuses. Elle peut s’expliquer aussi par un souci de
réalisme et par la prise en considération du fait que la société égyptienne est pieuse et
conservatrice, et que la religion y fonctionne comme un marqueur identitaire. Une
suppression par le Comité des 50 de la référence à la charia aurait en effet pu être
utilisée politiquement par les Frères musulmans comme la preuve de l’hostilité du
nouveau gouvernement non seulement envers la Confrérie mais également envers
l’Islam. En fait, pour une bonne partie de la population, la charia pourrait avoir une
dimension éthique plus que juridique87. Son invocation pourrait être la traduction
d’une aspiration à un retour à l’ordre et à la stabilité, à une plus grande justice sociale,
à la mise en œuvre des prescriptions religieuses d’ordre moral ou à l’amélioration de la
gouvernance publique. Des salafistes qui manifestaient en novembre 2012 en faveur de
l’application intégrale de la charia ne scandaient-ils pas des slogans affirmant que son
respect entraînerait une plus grande justice sociale, la fin de la corruption, la lutte
contre le trafic de drogue et l’éradication du chômage ?
52 Un autre facteur important à l’origine du consensus du Comité des 50 en faveur du
status quo est que la Haute Cour constitutionnelle a donné une interprétation très
progressiste et moderniste de l’article 2, réduisant considérablement sa portée et donc
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
166
la place de la charia dans le système juridique égyptien 88. Cette juridiction, composée de
juges ordinaires formés dans les facultés de droit égyptiennes et non de spécialistes de
théologie musulmane, a ainsi décidé en 1985, dans un premier arrêt de principe, que les
juges du fond ne pouvaient refuser d’appliquer une loi qu’ils estimaient contraire à la
loi islamique et lui substituer un principe tiré de la charia. L’article 2 constitue une
injonction à l’adresse du législateur et non du juge et il revient au premier, et à lui seul,
de modifier les textes en vigueur pour les rendre conformes à la loi islamique 89.
L’article 2 n’a donc pas d’effet direct. De plus, dans le même arrêt, la Cour a décidé que
l’article 2 ne s’appliquerait qu’à partir de l’amendement du 22 mai 1980 qui avait fait
des principes de la charia la source principale de la législation (et non plus une source
principale), et qu’il n’avait donc pas d’effet rétroactif : la réforme constitutionnelle a
introduit une obligation nouvelle qui ne doit s’imposer qu’à partir de la date de son
édiction. Seules les lois postérieures au 22 mai 198090 pouvaient donc être déclarées
inconstitutionnelles pour violation de l’article 2 de la Constitution. Tous les textes
adoptés par le législateur avant cette date échappaient au contrôle de la Cour et
resteraient en vigueur tant qu’ils n’auraient pas été abrogés ou amendés par le
législateur.
53 Dans un deuxième arrêt de principe, adopté en 199391, la Cour a établi une distinction
au sein des principes de la charia entre les principes absolus et les règles relatives.
Seuls les premiers sont contraignants et figés et s’imposent en tant que quels au
législateur. Ce sont des principes qui représentent des normes islamiques non
contestables que ce soit dans leur source92 ou dans leur signification et qui doivent être
obligatoirement appliqués. Ils sont figés, immuables, ne peuvent donner lieu à
raisonnement interprétatif et ne peuvent donc évoluer avec le temps. A ce corps de
principes absolus, la Haute Cour opposa un ensemble de règles considérées comme
relatives soit dans leur origine93, soit dans leur signification, soit dans les deux à la fois.
Elles sont sujettes à interprétation, évolutives dans le temps et dans l’espace,
dynamiques, ont donné lieu à des divergences d’interprétation et s’adaptent à la nature
et aux besoins changeants de la société. Cette jurisprudence, qui renforce les pouvoirs
de l’Etat, octroie une très grande liberté aux autorités étatiques pour adapter les règles
relatives de la charia à « l’évolution de la société ». C’est en effet au législateur qu’il
revient de procéder à l’interprétation des principes de la charia en se référant à l’une
ou l’autre école juridique94. La Cour s’attribue également un pouvoir très important,
puisque c’est elle qui détermine le contenu des normes de la charia et opère la
distinction entre principes absolus et relatifs.
54 Il fallut attendre un arrêt ultérieur de la Cour95 pour que soient précisées les conditions
dans lesquelles cet effort interprétatif qui permettra d’adapter les règles relatives aux
changements socio-temporels, doit s’effectuer : fondé sur la raison, il appartient au
« détenteur de l’autorité » qui n’est, en la matière, limité par aucune opinion
antérieure. Le fait qu’une de ces règles existe depuis longtemps ne constitue pas un
obstacle à son remplacement par une nouvelle norme, si l’intérêt de la société l’exige.
Le juge constitutionnel devait avoir l’occasion d’appliquer cette distinction dans
différentes affaires dont il fut saisi. Il considéra ainsi comme principes absolus le fait
que l’obligation d’entretien des enfants mineurs pèse sur le père seul 96, le droit du mari
musulman à avoir quatre épouses97, l’obligation pour la femme de se vêtir de façon
pudique et le droit du détenteur de l’autorité à intervenir pour leur imposer des règles
en ce domaine98, l’obligation d’obéissance de la femme à son mari99 ou l’interdiction de
l’usure100. Mais cette reconnaissance s’effectua presque toujours dans des obiter dicta,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
167
qui n’avaient pas d’incidence sur le fond de l’affaire, et la Cour valida par exemple la
totalité des dispositions de la loi sur le statut personnel de 1985 qui furent soumise à
son contrôle101.
2 - Liberté religieuse et statut des minorités non musulmanes
55 L’article 3 de la Constitution de 2012 avait fait des principes des lois des Egyptiens
chrétiens et juifs la source principale des législations organisant leur statut personnel,
leurs affaires religieuses ainsi que le choix de leurs chefs spirituels. Ce système de la
personnalité des lois en matière de droit de la famille était déjà prévu par un texte
législatif102 mais il se voyait consacré pour la première fois au niveau constitutionnel. Il
ne concernait toutefois que les chrétiens et les juifs, c’est à dire les religions du Livre.
Les autres non musulmans restaient soumis au droit général égyptien, c’est à dire au
droit de la famille des musulmans tel que codifié par le législateur égyptien.
L’introduction de cette disposition dans la Constitution avait constitué une concession
de l’assemblée constituante envers les Eglises, pour compenser les nombreuses
références à la charia et à l’islam.
56 A la demande des représentants des Eglises, cette disposition a été reprise mot pour
mot dans la Constitution de 2014, qui limite elle-aussi sa portée aux seuls chrétiens et
juifs, alors même que plusieurs membres du Comité des 50 s’étaient prononcés en
faveur de son extension à tous les non musulmans. Sous la pression d’al-Azhar et du
représentant salafiste, pour lesquels un tel amendement risquait d’entraîner un
bouleversement de l’ordre social et d’ébranler les fondements de la société égyptienne,
le Comité décida finalement de ne pas modifier cet article.
57 Certaines associations coptes avaient toutefois protesté contre l’insertion d’une telle
disposition dans la Constitution, considérant qu’elle donnait trop de pouvoirs aux
Eglises sur leurs fidèles103 et qu’une soumission au droit général égyptien, plus ouvert
que les lois religieuses chrétiennes en matière de rupture du mariage 104, aurait été
préférable. De plus, cet article remet en question le principe de citoyenneté selon
lequel tous les Egyptiens sont égaux et soumis au même droit dans tous les domaines.
58 L’article 43 alinéa 1 de la Constitution de 2012 proclamait que la liberté de croyance
était garantie, mais précisait dans son alinéa 2 que la liberté de pratiquer son culte et
de construire des lieux de culte était réservée aux seules religions révélées, c’est à dire
aux musulmans, chrétiens et juifs, privant ainsi les autres confessions du droit
d’exercer leurs rites en public. S’il était permis à chacun de croire librement en son for
intérieur, seules ces trois religions pouvaient être pratiquées en public. Cette
restriction, déjà connue en droit égyptien, s’était vue consacrée pour la première fois
en 2012 au niveau constitutionnel105. La Constitution de 2014, quant à elle, affirme dans
son article 64 que la liberté religieuse est « absolue », mais limite elle-aussi dans son
deuxième alinéa l’exercice des pratiques religieuses et la construction de lieux de culte
aux seuls adeptes des religions célestes. Elle renvoie par ailleurs à la loi pour organiser
l’exercice de ce droit.
59 L’article 235 de ce texte, disposition transitoire, invite par ailleurs le législateur à
adopter dès la première législature après l’entrée en vigueur de la Constitution, une loi
organisant la construction et la rénovation des églises, qui garantisse aux chrétiens la
liberté de pratiquer leurs rites religieux. On peut noter que l’article 6, selon lequel
aucun Egyptien ne peut être privé de ses papiers d’identité, pourrait être invoqué par
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
168
des citoyens risquant de se voir privés de leurs papiers d’identité pour avoir quitté
l’islam ou revendiqué son appartenance à une religion non reconnue par l’Etat
égyptien.
3- Pénalisation de l’offense aux prophètes
60 La Constitution de 2012 interdisait toute insulte ou diffamation envers les messagers et
les prophètes de Dieu (art. 44)106. L’interdiction étant formulée de façon très générale, il
devait revenir au législateur d’en préciser les cas d’application et de fixer les sanctions.
Si cette pénalisation de l’offense aux prophètes figurait pour la première fois dans un
texte constitutionnel et limitait le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 45
de ce même texte, il existe depuis 1982 dans le code pénal un article 98f pénalisant
l’exploitation de la religion pour propager oralement, par écrit, ou par tout autre
moyen des opinions extrêmes dans le but d’attiser des troubles, avilir l’une des
religions célestes ou l’une des communautés en faisant partie ou nuire à l’unité
nationale. La sanction prévue est de six mois à cinq ans de prison et/ou une amende
d’un montant maximum de 1 000 LE. Sur la base de cet article, ont été condamnés des
individus accusés de prosélytisme ou des membres de communautés jugées déviantes,
comme des chiites ou des soufis, accusés de porter atteinte à la cohésion sociale. Cette
disposition a également été utilisée pour sanctionner des conversions de musulmans au
christianisme, jugées contraires à la loi islamique. L’insulte ou l’offense envers les
messagers et les prophètes de Dieu rentre tout à fait dans le champ d’application de
l’article 98f et peut donc être sanctionnée, en l’absence même de référence
constitutionnelle. Si l’article 44 n’a pas été repris dans la Constitution de 2014, il n’en
reste pas moins que le code pénal n’a pas été amendé et que l’article 98f continue à
s’appliquer.
4- Interdiction des partis à référence religieuse
61 La Constitution de 2012 avait supprimé l’interdiction de créer des partis politiques
fondés sur la religion, introduite par Moubarak en 2007107 pour empêcher les Frères
musulmans d’être reconnus comme partis politiques. Elle s’était contentée de stipuler
qu’un parti politique ne pouvait être créé sur la base de la discrimination entre les
citoyens fondée sur la race, le sexe, l’origine ou la religion 108. La Constitution de 2014 a
réintroduit dans son article 74 l’interdiction de former des partis politiques sur une
base religieuse :
62 Art. 74 « Les citoyens ont le droit de former des partis politiques sur notification définie
par la loi. Aucune activité politique ne peut s’exercer, et aucun parti politique ne peut
être créé sur une base religieuse ou sur la distinction fondée sur le sexe ou l’origine ou
sur une base sectaire ou géographique, de même qu’aucune activité hostile aux
principes démocratiques, clandestine, ou ayant un caractère militaire ou paramilitaire
ne peut être pratiquée. Les partis ne peuvent être dissous que par une décision de
justice ».
63 Mais que signifie être fondé « sur une base religieuse » ? Un parti appelant à la mise en
œuvre de l’article 2 pourrait-il être considéré comme un parti religieux et être interdit
à ce titre ? Il reviendra aux tribunaux, le moment venu, de trancher 109.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
169
64 Si la Constitution de 2014 contient toujours des références religieuses, elle a toutefois
supprimé des dispositions de la Constitution de 2012 qui avaient suscité un grand
nombre de critiques.
B - Des références religieuses moins nombreuses qu’en 2012
65 Tant l’article 219 de la Constitution de 2012, qui donnait une définition
particulièrement extensive des principes de la charia islamique, que l’article 4 relatif au
rôle consultatif d’al-Azhar dans le domaine religieux, ont été retirés du texte de 2014.
D’autres références indirectes à la loi islamique ont également disparu.
1. Disparition de l’article 219 de la Constitution de 2012
66 Alors que les salafistes n’avaient pas obtenu la modification de l’article 2, ils avaient
toutefois réussi à faire introduire dans la Constitution de 2012 une nouvelle disposition,
l’article 219110, qui bien que placé à la fin du texte, parmi les « dispositions générales »,
visait à définir le concept de « principes de la charia islamique » mentionné à l’article 2.
Selon cet article, « Les principes de la charia islamique incluent ses sources
scripturaires111, ses bases fondamentales et jurisprudentielles, ainsi que ses sources
reconnues par les écoles des gens de la Tradition et de la Communauté 112. Si peu de
spécialistes en Egypte pouvaient prétendre avoir la formation suffisante en théologie
ou en droit musulman pour comprendre toutes les subtilités que recouvraient ces
concepts techniques et complexes de la tradition juridique islamique médiévale, il n’en
reste pas moins que l’intention du constituant était manifestement d’élargir au
maximum le corpus de principes à prendre en considération 113. Cet article visait à
contrecarrer l’interprétation moderniste de l’article 2 adoptée par la Haute Cour
constitutionnelle, ainsi qu’à lier les autres interprètes de la Constitution (parlement,
gouvernement, chef de l’Etat, etc.) et à leur retirer la possibilité de procéder à leur
propre interprétation de ce concept. De plus, en imposant à l’interprète de tenir
compte de l’ensemble des avis émis par les jurisconsultes du passé, sans distinction, il
remettait en question la jurisprudence du juge constitutionnel qui avait déclaré ne pas
se sentir lié par les avis antérieurs et procédait à sa propre interprétation. Considérant
que cet article risquait d’imposer une conception beaucoup plus stricte et rigide du
concept de « principes de la charia islamique » et d’entraîner des applications beaucoup
plus radicales et rigoristes de la charia que par le passé, plusieurs membres libéraux et
séculiers de la constituante, ainsi que les représentants des Eglises, s’étaient retirés en
signe de protestation.
67 En pratique, toutefois, le fait de demander aux interprètes de prendre en considération
un ensemble aussi vaste et diversifié de sources et de principes fondamentaux de la
jurisprudence islamique, des plus modérées et progressistes aux plus réactionnaires et
archaïques, aurait pu paradoxalement continuer à leur octroyer une très grande
liberté, puisqu’au sein de toutes ces interprétations adoptées à travers le temps et
l’espace, ils auraient probablement réussi à trouver une opinion même isolée légitimant
la décision à laquelle ils voulaient parvenir114. Tout aurait donc été tributaire de
l’attitude des futurs interprètes, et notamment de l’appartenance politique de la
nouvelle majorité parlementaire et des convictions des membres présents et futurs de
la Haute Cour constitutionnelle. Quant à la référence aux seules écoles sunnites, elle
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
170
n’aurait pas entraîné de grands bouleversements, puisque les écoles chiites n’avaient eu
dans le passé qu’une influence très marginale sur le droit égyptien.
68 La Haute Cour constitutionnelle n’eut qu’une seule occasion de se prononcer sur la
portée de l’article 219. Dans une décision de juin 2013115, donc un mois avant la
suspension de la Constitution de 2012, elle fut amenée à vérifier la conformité à la
Constitution d’une loi attaquée pour violation des principes de la charia. La Cour reprit
intégralement son interprétation antérieure de l’article 2 et sa distinction entre les
principes absolus et les règles relatives, sans faire la moindre référence à l’article 219.
Implicitement, la Cour considérait donc que son interprétation était conforme à la
nouvelle Constitution, malgré la présence de l’article 219, et que ce dernier n’apportait
rien de fondamentalement nouveau par rapport à la Constitution de 1971. La définition
large du concept de « principes de la charia » adoptée par l’article 219 préservait
finalement la liberté de l’interprète, qui pouvait continuer à opérer un choix au sein
des principes et des règles en vigueur au sein des différentes écoles sunnites de droit,
souvent très différentes voire même parfois contradictoires.
69 Pendant l’année où Mohamed Morsi exerça le pouvoir116, de juin 2012 à juin 2013, aucun
texte de loi ne vint réislamiser le droit égyptien, sécularisé depuis la fin du XIXe siècle
dans toutes ses branches117 sauf le droit de la famille 118. Même le code pénal, lui aussi
sécularisé, ne fut pas modifié, alors même qu’il existe un grand nombre de règles en ce
domaine issues de la loi islamique. En particulier, les Frères musulmans ne
réinstaurèrent pas les châtiments corporels, estimant impossible de les appliquer tant
que près de la moitié de la population vivrait dans la pauvreté. Ils ne pourraient être
réinstitués que lorsque la société aurait évolué et que les principes de l’islam seraient
véritablement respectés et tous les besoins élémentaires de la population assurés.
70 Si elle a conservé l’article 2 sans le modifier, la Constitution de 2014 a toutefois abrogé
l’article 219 et précise dans le préambule que les principes de la charia islamique
doivent être interprétés conformément à la jurisprudence de la Haute Cour
constitutionnelle en ce domaine.
2 - Suppression de la consultation d’al-Azhar pour les affaires relatives à la charia
71 Conformément à l’article 4 de la Constitution de 2012, le Conseil des grands ulémas d’al-
Azhar119 devait être consulté pour les affaires relatives à la charia islamique. Pour la
première fois, la Constitution faisait donc intervenir une autorité religieuse dans la
gestion de l’Etat en l’associant à l’exercice du pouvoir : le Conseil des grands ulémas
d’al-Azhar120. Mais cet organe devait seulement être « consulté » et donnait donc un
simple avis, qui pouvait ou non être suivi par les institutions concernées. De plus,
l’article 4 ne précisait pas qui devait saisir al-Azhar, à quel moment et dans quels
domaines, laissant donc une grande marge d’autonomie à l’interprète. Tout allait
dépendre de la place que le législateur, le juge constitutionnel, le gouvernement ou le
président allaient bien vouloir accorder aux opinions de ces jurisconsultes et de la
fréquence avec laquelle ils allaient se sentir tenus de les consulter. Le rôle du Conseil
des grands ulémas allait également dépendre de sa composition et des convictions
religieuses de ses membres, ainsi que de l’influence qu’allait pouvoir exercer sur eux le
cheikh d’al-Azhar. Quant à la Haute Cour constitutionnelle, elle restait en charge du
contrôle de la constitutionnalité de toutes les lois121, y compris le cas échéant celles
accusées de violer l’article 2 de la Constitution, donc la charia islamique.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
171
72 Cette intervention d’al-Azhar était la seule hypothèse où la Constitution de 2012
réservait un rôle de nature politique à une institution religieuse. Or, dans le passé, al-
Azhar avait déjà été régulièrement consultée par le législateur au cours du processus
d’élaboration de textes législatifs touchant à la charia, particulièrement lors des
réformes du droit de la famille. Elle intervenait déjà également pour la censure et la
saisie d’ouvrages touchant à la religion122. L’article 4 avait été introduit dans la
Constitution de 2012 sous la pression des salafistes et contre l’avis du cheikh d’al-Azhar,
qui cherchait avant tout la reconnaissance constitutionnelle de l’indépendance d’al-
Azhar et la garantie de ressources financières suffisantes, ainsi que l’assurance de ne
pas être révoqué. Il se serait sans doute contenté d’une reconnaissance de l’autorité
morale d’al-Azhar, de crainte qu’un renforcement de son rôle ne l’entraîne trop loin sur
le terrain du politique et que des partis ultra conservateurs ne tentent de le destituer et
de prendre le contrôle de l’institution pour substituer à une vision modérée de l’islam
une idéologie beaucoup plus fondamentaliste.
73 Pas plus qu’elle n’avait invoqué l’article 219, la Haute Cour constitutionnelle ne s’estima
tenue par l’article 4 de consulter le Conseil des grands ulémas d’al-Azhar lorsqu’elle
examina en juin 2013 la conformité d’une loi à la Constitution. Il est vrai que cette
position de la Cour pouvait s’expliquer par le fait que sa composition n’avait pas changé
- même si la Constitution de 2012 avait réduit le nombre de ses membres à 11 au lieu de
18 - et qu’on aurait pu s’attendre à une interprétation beaucoup plus stricte des articles
4 et 219 si des membres plus proches des Frères musulmans et des salafistes avaient fini
par y être nommés.
74 L’article 4 trouva tout de même à s’appliquer à l’initiative du législateur et cette
application déjoua toutes les prévisions. En janvier 2013, le ministère des Finances
prépara un projet de loi sur la finance islamique (soukouk islamiyya) qu’il soumit à la
chambre haute du parlement, à qui la Constitution de 2012 avait confié le pouvoir
législatif en l’absence de chambre basse, jusqu’aux prochaines élections
parlementaires. L’Assemblée consultative consulta al-Azhar, sur la base de l’article 4. Le
Conseil des grands ulémas reprocha à plusieurs dispositions du projet de menacer les
actifs de l’Etat et de porter atteinte à sa souveraineté en autorisant des étrangers à
acquérir des parts dans des sociétés nationales. Il considéra également qu’il attribuait
trop de pouvoirs au président et au gouvernement aux dépens du parlement. Après
avoir amendé le projet de loi pour tenir compte des remarques émises par al-Azhar, la
chambre haute estima que l’article 4 ne l’obligeait pas à en soumettre la version révisée
au Conseil des grands ulémas. Devant les protestations des salafistes et du cheikh d’al-
Azhar, la chambre procéda à un vote où la majorité Frères musulmans se prononça
contre un deuxième renvoi à al-Azhar, estimant que l’article 4 ne donnait pas le dernier
mot au Conseil des grands ulémas et que de toutes façons le projet amendé était
conforme à la charia. Devant les critiques suscitées par ce refus, le président décida de
soumettre quand même le texte à al-Azhar, et la loi finit par être promulguée en mai
2013.
75 Face à l’exercice du pouvoir, les forces politiques s’étaient donc repositionnées. Après
avoir cédé aux pressions des salafistes en incluant l’article 4 dans la Constitution de
2012, les Frères musulmans, majoritaires au parlement, luttèrent pour préserver
l’indépendance du législateur face à l’autorité d’al-Azhar. Le cheikh d’al-Azhar, quant à
lui, protesta et exigea d’exercer pleinement un pouvoir dont il n’avait pas voulu à
l’origine. On constate aussi qu’al-Azhar ne se prononça pas uniquement sur les aspects
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
172
strictement « religieux » du projet de loi, mais procéda à une interprétation extensive
de son mandat et de la charia islamique, sanctionnant le projet de loi pour avoir
attribué trop de pouvoirs au président et ne pas avoir suffisamment protégé la
souveraineté de l’Etat. Ce qui peut expliquer le refus de la chambre haute de le
consulter à nouveau et la suppression du qualificatif « islamique » de l’intitulé du projet
de loi, pour en faire une simple loi sur la finance et tenter de le faire échapper au
contrôle d’al-Azhar. Or, si une assemblée parlementaire composée à 90% d’islamistes
avait procédé à une interprétation aussi restrictive de l’article 4, qu’en aurait-il été
d’un parlement à majorité libérale et séculière ?
76 La Constitution de 2014 a supprimé cette attribution d’al-Azhar. L’article 7 123 dispose
qu’elle constitue « la référence fondamentale pour les sciences religieuses et les affaires
islamiques »124, ce qui continue à lui assurer une place centrale dans l’interprétation
des normes religieuses et surtout signifie qu’aucune autre institution ne peut
représenter l’islam, et en particulier pas les Frères musulmans.
3- Suppression du renvoi au principe de constitutionnalité des peines
77 L’article 76 de la Constitution de 2012 avait posé le principe de la personnalité des
peines dans les termes suivants : « Aucune infraction et aucune peine ne peut être
établie qu'en vertu d'un texte constitutionnel ou législatif ». Cet article reprenait le
principe de droit pénal nulla poena sine lege déjà garanti par la Constitution de 1971 125,
mais y ajoutait la référence aux textes constitutionnels, qui ne figurait pas dans les
textes antérieurs. Comme la Constitution ne comprenait pas de dispositions imposant
directement des sanctions mais renvoyait à la loi en ce domaine, cet ajout fut considéré
comme visant à incorporer en droit égyptien des sanctions ne figurant pas dans les
textes législatifs en vigueur, comme les châtiments corporels prévus par la charia et qui
auraient été incorporés via l’article 2 de la Constitution et la référence aux principes de
la charia126. La Constitution de 2014 est revenue à la formulation originelle de ce
principe.
4- Suppression de la clause de dérogation générale
78 Enfin, l’article 81 de la Constitution de 2012, placé à la fin du titre 2 consacré aux Droits
et libertés, aurait pu être interprété comme posant une dérogation générale à tous les
droits fondamentaux garantis dans le texte. Après avoir affirmé que les droits et
libertés liés à la personne du citoyen ne pouvaient être entravés ni diminués, et que
toute loi organisant l’exercice des droits et libertés ne pouvait les restreindre de façon
à porter atteinte à leur fondement et à leur substance, le dernier alinéa de cet article
ajoutait en effet que « Les droits et libertés s’exercent sans contredire les fondements
posés dans le titre sur L’Etat et la société de la présente Constitution », soit les articles 1 à
30 de la Constitution. On pouvait en déduire que tous les droits et libertés devaient être
exercés d’une manière conforme à la charia (art. 2), au caractère authentique de la
famille (art. 10) ou aux bonnes mœurs et à la moralité (art. 11), ce qui aurait constitué
effectivement une interprétation potentiellement liberticide.
79 Cet article n’a pas trouvé à s’appliquer pendant les sept mois où la Constitution est
restée en vigueur et a disparu du texte de 2014.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
173
5- Le préambule renvoie à la notion de gouvernement civil
80 Pendant très longtemps, les différentes versions successives de la Constitution de 2014
ont affirmé le caractère civil de l’Etat égyptien. Mais devant les objections conjointes
des représentants d’al-Nour et d’al-Azhar et les menaces de retrait des représentants
des Eglises au cas où ce concept serait retiré du texte, un compromis fut finalement
trouvé et le préambule affirme que l’Egypte est un Etat moderne, démocratique, dirigé
par un « gouvernement civil »127. Ce terme est suffisamment ambigu pour signifier à la
fois un gouvernement non religieux et un gouvernement non militaire.
81 On ne saura jamais si les institutions en place auraient toutes et toujours eu les moyens
et la volonté politique de résister à une réislamisation du droit. On ne saura pas non
plus ce que les Frères musulmans entendaient concrètement par « réislamisation du
droit » ni quelles en auraient été les modalités concrètes de mise en œuvre. La charia
semblait représenter pour eux davantage un slogan politique et une aspiration à l’ordre
moral qu’un programme précis de réforme du système juridique égyptien.
82 Enfin, il faut souligner que c’est au sein d’une assemblée constituante et d’un parlement
élus, institutions inconnues du droit islamique, que les partis de l’islam politique ont
lutté pour faire adopter une nouvelle Constitution et des lois, concepts totalement
étrangers au droit islamique eux-aussi. Quelles que soient les erreurs politiques
commises par les Frères, ils ont toujours revendiqué leur légitimité populaire et
électorale, et non une souveraineté divine. Ils ont lutté pour remporter les élections et
contrôler le processus d’élaboration des nouvelles normes et non pour réinstaurer un
modèle de constitutionalisme islamique où la loi ne pourrait être que l’expression de la
volonté de Dieu, où les normes seraient élaborées dans les mosquées par des juristes
théologiens et où le concept d’Etat serait inconnu. Cette acceptation des catégories du
politique contemporain se reflète dans la Constitution de 2012, dont l’article 6
proclame sans ambiguïté les principes sur lesquels est fondée l’organisation de l’Etat 128.
De même, l’article 5 de la Constitution de 2012 affirme que la souveraineté appartient
au peuple qui est la source de tout pouvoir. Les salafistes, qui auraient préféré confier
la souveraineté à Dieu, ont dû là encore faire des concessions.
Conclusion
83 Faute de consensus ou même de majorité qualifiée, la constituante n’a pas réussi à
trancher des questions particulièrement cruciales pour la suite du processus de
transition, comme l’ordre de la feuille de route et le choix du mode de scrutin,
renvoyant sur tous ces points au législateur. Or, en l’absence de parlement, c’est le
président de la République qui exerce le pouvoir législatif et c’est donc à lui qu’est
revenue la décision. L’article 230 de la Constitution de 2013 qui, reprenant la
Déclaration constitutionnelle du 8 juillet 2013, prévoyait que les élections législatives
précéderaient les élections présidentielles et se tiendraient dans un délai de 30 à 90
jours après l’entrée en vigueur de la Constitution, a en effet été rejeté lors de l’adoption
du texte et remplacé par une formulation beaucoup plus ambigüe, selon laquelle les
premières élections qui seront organisées, que ce soient les législatives ou les
présidentielles, devront l’être entre 30 et 90 jours suivant la ratification de la
Constitution. Les procédures pour l’autre élection devront commencer dans les six mois
suivant le référendum, sans préciser quel sera le premier scrutin. Il est donc revenu au
président par intérim de décider l’ordre dans lequel allaient se dérouler les élections. Il
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
174
a choisi d’organiser d’abord les élections présidentielles, puis les législatives. Les
présidentielles se sont tenues en mai 2014. Fin octobre 2014, les dates des législatives
n’avaient pas encore été fixées.
84 De plus, la Constitution de 2014 contient par ailleurs un certain nombre de
contradictions internes : comment un gouvernement peut-il être civil (préambule)
alors que le ministre de la Défense doit nécessairement être un officier militaire ?
Comment peut-on interdire les partis politiques à référence religieuse alors que la
charia est la source principale de la législation ? Comment affirmer la non-
discrimination et la liberté religieuse alors que les minorités non-musulmanes n’ont
pas le droit d’exprimer leur culte en public ?
85 Le processus constitutionnel - particulièrement chaotique - qu’a connu l’Egypte depuis
2011 est caractéristique des processus de transition dans les pays arabes après les
« printemps arabes », qui se sont cristallisés autour de la référence constitutionnelle. La
Constitution est en effet devenue le symbole de tous les positionnements. Tentant
d’infléchir le contenu des textes, les différentes forces politiques ont recouru à la
norme juridique pour construire ou renforcer leur légitimité politique. Même les partis
islamistes se sont réappropriés le concept de Constitution, se plaçant d’emblée dans la
continuité du courant du constitutionalisme égyptien et hors du cadre de la tradition
classique.
86 Mais loin d’être un document de compromis autour d’une vision commune de la
société, la Constitution égyptienne de 2014 consacre les intérêts corporatistes des
différentes institutions de l’Etat qui ont fait chuter le président Frère musulman :
armée, magistrature, police, al-Azhar. Elle a redonné une place centrale au président au
sein du pouvoir de l’Etat, alors que la Constitution de 2012 avait renforcé les
attributions du gouvernement et du parlement. Cumulant ses larges pouvoirs
constitutionnels avec une légitimité électorale et un pouvoir de fait, le président reste
l'organe exclusif d'impulsion et d'exécution de la politique nationale.
87 Reflet de l’équilibre actuel des pouvoirs dans le pays, elle ne réforme pas les
dysfonctionnements de l’Etat et renforce le pouvoir, plutôt qu’elle ne l’encadre. Elle se
situe dans la continuité des Constitutions antérieures et reste encore loin des
aspirations démocratiques des révolutionnaires de 2011.
NOTES
1. La Constitution de 1971 a été suspendue le 11 février 2011 par le Conseil suprême des
forces armées (CSFA) puis amendée par référendum le 15 mars 2011 avant d’être
remplacée par la Déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011, adoptée par le CSFA
dans le plus grand secret. Cette dernière fut amendée le 17 juin 2012 par le CSFA pour
accroitre ses pouvoirs, puis le 12 août 2012 par le président Mohamed Morsi
fraîchement élu pour abroger les amendements de juin, diminuer les pouvoirs de
l’armée et accroître ceux du président. Une nouvelle Déclaration constitutionnelle fut
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
175
promulguée par le président par intérim le 8 juillet 2013, après avoir été élaborée elle-
aussi dans le plus grand secret.
2. La Déclaration constitutionnelle du 3 juillet 2013 a révoqué le président Mohamed
Morsi, confié la présidence par intérim au président de la Haute Cour constitutionnelle
et suspendu la Constitution de 2012, accusée d’avoir trahi les idéaux de la Révolution.
Un mois auparavant, le 2 juin 2013, la Haute Cour constitutionnelle avait déclaré
inconstitutionnelle la loi d’organisation de l’Assemblée constituante qui avait élaboré la
Constitution de 2012, pour avoir immunisé les décisions de la constituante contre tout
recours devant le Conseil d’Etat. La Cour a cependant précisé que l’adoption de la
Constitution par référendum en décembre 2012 l’avait légitimée a posteriori et qu’elle
devait rester en vigueur.
3. Bien que présentée comme « la Constitution de 2014 », ce texte ne constitue en fait
juridiquement qu’une version révisée de celle de 2012 et le texte publié au journal
officiel du 18 janvier 2014 s’intitule « Constitution amendée de la République arabe
d’Egypte ». La Déclaration constitutionnelle du 8 juillet 2013 (art. 29) indiquait que le
Comité des 50 serait chargé de préparer un projet d’amendement de la Constitution de
2012 qui venait d’être suspendue. La Constitution de 2014 comprend 247 articles, contre
236 pour celle de 2012 et 211 pour celle de 1971, avec un préambule entièrement
nouveau. Il est précisé dans son article 246 que toute disposition contenue dans la
Constitution de 2012, mais non reprise, est abrogée à compter de son entrée en vigueur.
Cependant, les effets qui en découlaient ne sont pas affectés.
4. Une première assemblée constituante, à majorité islamiste, élue en mars 2012 par le
parlement, fut déclarée inconstitutionnelle par le Conseil d’Etat le 10 avril 2012 parce
que la moitié de ses membres avait été choisie au sein du parlement. La seconde
constituante, élue le 12 juin 2012 par une chambre basse contrôlée à 70% par des
islamistes (47% de Frères musulmans et 24% de Salafistes) et une chambre haute à plus
de 80% islamiste, comptait près de 70% d’islamistes. L’opposition l’accusa de ne pas
refléter l’ensemble des forces de la nation et une dizaine d’élus refusèrent d’y siéger. La
plupart des membres non islamistes démissionnèrent avant la fin des travaux pour
protester contre la conduite des travaux. Un recours en inconstitutionnalité fut déposé
devant le Conseil d’Etat, qui décida finalement en octobre 2012 qu’il n’était pas
compétent et transféra l’affaire à la Haute Cour constitutionnelle. Malgré un décret
présidentiel du 22 novembre 2012 lui interdisant d’examiner ce recours, la Haute Cour
constitutionnelle décida de se réunir quand même le 2 décembre 2012. Mais le jour dit,
des manifestants encerclèrent le siège de la Cour, l’empêchant de se réunir. La Cour
dénonça ces pressions «psychologiques et matérielles » et décida de se mettre en grève.
5. Le président par intérim avait tout d’abord nommé un comité de dix experts,
constitué de quatre professeurs de droit constitutionnel et de six magistrats, qui
disposa d’un mois pour élaborer un avant-projet d’amendement de la Constitution de
2012.
6. La Déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011 (art. 60) prévoyait que la nouvelle
Constitution serait rédigée par une assemblée de 100 membres choisie par le
parlement.
7. Le Comité des 50 était formé de représentants des différents secteurs de la société
(al-Azhar (3), Eglises (3), partis islamistes (2), partis libéraux (2), partis de gauche (1),
partis nationalistes (1), syndicat des ouvriers (2), paysans (2), médecins (1), ingénieurs
(1), journalistes (1), écrivains (1), avocats (1), syndicat des professions techniques (1),
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
176
syndicat des arts appliqués (1), Conseil suprême de la Culture (1), Fédération des
chambres de tourisme (1), Union des chambres industrielles (1), Fédération des
chambres de commerce (1), Union des syndicats des étudiants (1), mouvements de
jeunes (4), ONG (1), Conseil national de la femme (1), Conseil national de la mère et de
l’enfant (1), Conseil national des droits de l’homme (1), Conseil suprême des Universités
(1), Conseil national pour les besoins particuliers (1), armée (1) et police (1), choisis de
façon opaque par leurs corps respectifs puis nommés par le président. Dix
personnalités publiques, toutes libérales, nommées par le cabinet de façon à
représenter la diversité régionale, vinrent compléter la composition du Comité.
8. Déclaration constitutionnelle du 22 novembre 2012 qui, de plus, révoqua le
procureur général - en principe inamovible - accorda une immunité juridictionnelle à
toutes les décisions prises par le président et l’autorisa à prendre toute mesure
nécessaire pour protéger la révolution, l’unité et la sécurité nationale.
9. Le vote au sein du Comité des 50 devait se faire par consensus ou, à défaut, à la
majorité qualifiée de 75%. Quatre articles furent rejetés en première lecture avant
d’être reformulés (pour les deux premiers) et adoptés en deuxième lecture : l’article 229
sur le mode de scrutin pour les législatives qui instituait à l’origine un système mixte
avec 2/3 de scrutin individuel et 1/3 de scrutin de liste ; l’article 230 qui décrivait la
feuille de route et prévoyait que les élections parlementaires se tiendraient avant les
présidentielles ; l’article 243 qui garantit aux ouvriers et aux paysans une
« représentation appropriée » au sein de la première Chambre des représentants élue
après l’adoption de la Constitution et l’article 244 qui contient la même garantie pour
les jeunes, les chrétiens, les personnes handicapées et les Egyptiens expatriés.
L’Assemblée constituante de 2012 avait adopté la Constitution à une majorité de 67% en
première lecture (un deuxième vote à la majorité de 57% était prévu en deuxième
lecture, après un délai minimum de 48h, mais tous les articles furent adoptés en
première lecture).
10. Selon plusieurs observateurs nationaux et internationaux, la campagne s’est
déroulée dans un contexte répressif où une couverture médiatique biaisée en faveur de
l’adoption de la Constitution n’a pas permis de véritable débat autour du texte.
L’opposition était muselée et quiconque appelait à voter contre le texte était qualifié de
traitre et de partisan des Frères musulmans, donc du terrorisme (voir par ex. le rapport
de Transparency International Observation Mission, Egypt Constitutional Referendum
Preliminary Report, publié le 16 janvier 2014 http://www.transparency.org/files/
content/pressrelease/Preliminary_Statement_Egypt.pdf Site consulté le 21 octobre
2014, ainsi que le communiqué du Centre Carter : “Carter Center Urges Inclusive
Constitutional Reform Process and Increased Political Space Ahead of Egypt's
Referendum” 6 janvier 2014 http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/
egypt-010614.pdf Site consulté le 21 octobre 2014 et « Carter Center Urges Dialogue and
Constitutional Change to Strengthen Democratic Governance in Egypt”, 12 mars 2014.
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-constitution-031214.pdf
Site consulté le 21 octobre 2014 ainsi que Amnesty International, Egypt three years on,
wide-scale repression continues unabated, 23 January 2014,
http://www.amnesty.org/en/news/egypt-three-years-wide-scale-repression-
continues-unabated-2014-01-23 Site consulté le 21 octobre 2014).
11. Ce titre est divisé en trois chapitres : fondements sociaux (art. 7 à 27), fondements
économiques (art. 28 à 46), fondements culturels (art. 47 à 50).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
177
12. Art. 9 (2012), art. 8 (1971).
13. Art. 34 et 35 (2012), art. 41 (1971).
14. Art. 38 (2012), art. 45 (1971).
15. Art. 39 ( 2012), art. 44 (1971).
16. Art. 42 (2012), art. 50 à 52 (1971).
17. Art. 45 (2012), art. 47 (1971).
18. Art. 21 et 24 (2012), art. 30 à 37 (1971).
19. Art. 55 (2012), art. 62 (1971). L’Etat doit inscrire d’office sur les listes électorales
tout citoyen qui remplit les conditions pour être électeur.
20. Art. 51 (2012). L’art. 5 (1971), tel qu’amendé en 2007, renvoyait à la loi pour
réglementer les conditions de création d’un parti.
21. La loi doit en réglementer l’accès, la disponibilité et la confidentialité. L’art. 47
(2012) précisait que ce droit ne devait pas porter atteinte à l’inviolabilité de la vie
privée, aux droits des tiers, ni à la sécurité nationale. Ce droit ne figurait pas dans la
Constitution de 1971.
22. Art. 50 (2012).
23. Art. 51 ( 2012).
24. Les art. 54 et 55 (1971) renvoyaient à la loi pour en fixer les conditions d’exercice.
25. Art. 75 (2012), art. 68 (1971),
26. Art. 77 (2012), art. 67 (1971).
27. Art. 77 et 78 (2012), art. 71 (1971).
28. Art. 77 (2012), art. 67 (1971),
29. L’art. 76 (2012) ajoutait un principe de constitutionnalité des peines, qui avait
soulevé des polémiques (voir ci-après). Art. 66 (1971).
30. Art. 76 (2012), art. 66 et 187 (1971).
31. L’art. 37 (2012) les définissait comme un lieu de discipline, d’éducation et de
redressement.
32. Art. 64 (2012), art. 13 (1971).
33. Cet article affirme que tout citoyen a le droit à la santé. Art. 62 (2012), art. 16 (1971).
34. Art. 66 (2012) et art. 17 (1971).
35. Art. 64 (2012). Ce droit ne figurait pas dans la Constitution de 1971.
36. Art. 52 et 53 (2012), art. 56 (1971). Cette restriction, qui ne figurait pas dans la
Constitution de 1971, avait été introduite par celle de 2012 (art. 53). Elle serait justifiée
par le fait que le syndicat professionnel agit comme un ordre de profession libérale, en
contrôlant l’accès à la profession.
37. Art. 61 (2012). L’éradication de l’analphabétisme était déjà présentée par la
Constitution de 1971 (art. 21) comme un devoir national.
38. Art. 63 (2012). L’art. 59 de la Constitution de 1971, telle qu’amendée en 2007, avait
déjà fait de la préservation de l’environnement un devoir national.
39. L’enfant est défini comme une personne de moins de 18 ans. Il a droit à un nom, à
des papiers d’identité, à la vaccination obligatoire gratuite, à des soins médicaux, à une
alimentation de base, à un logement sûr, à une éducation religieuse, à son
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
178
développement intellectuel et moral. L’Etat s’engage à le protéger contre toute forme
de violence et d’exploitation commerciale ou sexuelle. Il est interdit d’employer un
enfant qui n’a pas atteint l’âge de fin d’études élémentaires. L’Etat doit mettre en place
un système judiciaire pour les mineurs. L’art. 70 (2012) ne contenait pas de définition
de l’enfant et ne lui offrait pas une protection aussi poussée. La Constitution de 1971 ne
contenait pas de disposition spécifique aux droits de l’enfant.
40. Mais la Constitution ne donne pas de définition de la torture et le code pénal en a
adopté une conception restrictive, la limitant aux seuls cas où l’auteur cherchait à
obtenir un aveu de la victime (art. 126). Art. 36 (2012).
41. Art. 48 (2012).
42. Art. 73 (2012).
43. La Constitution de 1971 (art. 18) rendait obligatoire la seule éducation primaire et
celle de 2012 (art. 58) avait étendu cette obligation jusqu’au niveau élémentaire.
44. Art. 59 (2012).
45. Art. 59 (2012), qui ne mentionnait pas la liberté de création artistique. Article 49
(1971).
46. Art. 60 (2012).
47. La Constitution de 2012 (art. 60) ne mentionnait pas l’enseignement des droits de
l’homme.
48. Art. 18 (2012).
49. Chaque citoyen a le droit d’en jouir conformément à la loi. Art. 20 (2012).
50. Chaque citoyen a le droit de profiter du Nil. Art. 19 (2012).
51. Art. 68 (2012).
52. Art. 68 (2012).
53. Art. 69 (2012).
54. Elle consacre ainsi au niveau constitutionnel un principe qui avait été introduit au
niveau législatif en 2004 (auparavant, seul le père pouvait transmettre sa nationalité à
ses enfants). Par contre, l’épouse égyptienne ne peut toujours pas transmettre sa
nationalité à son époux étranger.
55. Alors que la Constitution de 1971 (art. 40) prévoyait que : “Les citoyens sont égaux
devant la loi. Ils ont les mêmes droits et devoirs publics, sans distinction de sexe,
d'origine, de langue, de religion ou de croyance ”, l’art. 33 de celle de 2012 affirmait
seulement : « Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et devoirs
publics, sans aucune distinction entre eux », et ne faisait donc plus mention explicite
d’une liste de fondements – en particulier le sexe - sur la base desquels il était interdit
de discriminer.
56. De plus, une commission indépendante contre la discrimination doit être mise en
place (art. 53).
57. Art. 11 (1971) : « L'Etat assure à la femme la compatibilité entre ses devoirs au sein
de la famille et son rôle dans la société, son égalité avec l'homme dans les domaines
politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la loi
islamique ».
58. L’Assemblée constituante de 2012 avait envisagé dans un premier temps de
reprendre l’art. 11 (1971) mais cet article, pourtant passé inaperçu dans la Constitution
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
179
précédente, suscita de telles réactions de rejet au sein des ONG de droits des femmes
que la version finale abandonna la référence à la charia islamique, tout en continuant
de charger l’Etat d’aider la femme à concilier ses devoirs envers sa famille avec son
activité publique.
59. Art 10 (1971) : « L'Etat garantit la protection de la maternité et de l'enfance, veille
sur l'enfance et la jeunesse et leur assure les conditions appropriées au développement
de leurs vocations ”.
60. L’alinéa 2 de l’art. 10 (2012), selon lequel « L’Etat et la société veillent à la
sauvegarde du caractère authentique de la famille égyptienne, à sa cohésion et à sa
stabilité et à la consolidation ainsi qu’à la protection de ses valeurs morales », avait
soulevé lui-aussi des inquiétudes. Or il s’inspirait de l’article 9 de la Constitution de
1971, selon lequel « La famille est à la base de la société. Elle s’appuie sur la religion, la
morale et le patriotisme. L’Etat veille à la sauvegarde du caractère authentique de la
famille égyptienne, des valeurs et des traditions qu’elle représente, à l’affirmation et au
développement de ce caractère dans les relations au sein de la société égyptienne ». Les
termes « cohésion » et « stabilité », qui ne figuraient pas dans le texte de 1971, avaient
fait craindre un retour en arrière dans le domaine du divorce : l’Etat pourrait-il décider
de faire prévaloir la cohésion et la stabilité de la famille sur les droits individuels et
restreindre les cas où la femme pourrait demander la dissolution de son mariage ?
61. Une loi contre le harcèlement sexuel a été adoptée le 5 juin 2014.
62. La Constitution de 1971 avait été amendée en 2007 pour autoriser le législateur à
mettre en place un quota pour la représentation des femmes au sein du parlement. La
loi électorale avait alors réservé aux femmes 14% des sièges, soit 64 sièges sur 454. La
Constitution de 2012 ne prévoyait rien par rapport à la représentation politique des
femmes.
63. Une quarantaine de femmes, qui exerçaient jusque-là au sein du Parquet
administratif et de l’Autorité du contentieux de l’Etat, ont été nommées dans les
tribunaux ordinaires en 2007 et 2008 par une décision du ministre de la Justice. Mais en
2010, l’Assemblée générale du Conseil d’Etat a refusé à 334 votes contre 42 d’ouvrir la
justice administrative aux femmes.
64. Le territoire était découpé en huit circonscriptions et seulement 20% des sièges
devaient être réservés au scrutin de liste, les autres étant pourvus au scrutin individuel.
65. Art. 87 (1971).
66. Art. 196 (1971).
67. Art. 162 (1971).
68. Art. 26 (1971).
69. Ce qui pourrait ouvrir des recours contre des salaires faibles, des conditions de
travail déplorables ou un manque de formation
70. Une disposition analogue figurait déjà dans la Constitution de 2012 (art. 56).
71. Cet article reprend l’art. 70 (2012).
72. La Constitution de 2012 (art. 65) mentionnait plus spécifiquement « les blessés de la
révolution du 25 janvier ». L’art. 15 (1971) donnait une priorité dans l’accès à l’emploi
aux anciens combattants, blessés de guerre, épouses et enfants de martyrs.
73. Elles sont considérées comme des lois organiques.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
180
74. Les Constitutions de 1971 (art. 151) et 2012 (art. 145) attribuaient déjà force de loi
aux traités internationaux ratifiés par l’Egypte, mais ne mentionnaient pas
spécifiquement les obligations internationales de l’Egypte dans le domaine des droits
de l’homme.
75. Art. 74 (2012), art. 65 (1971).
76. Art. 238 (2014).
77. D’autant plus que certains droits de la 3 e génération, comme le droit à la protection
de l’environnement, exigent eux-aussi des investissements de grande ampleur pour
pouvoir être mis en œuvre.
78. L’art. 179 (1971) avait été amendé en 2007 pour autoriser l’adoption par le
parlement d’une loi anti-terrorisme qui n’aurait pas été tenue de respecter certains
droits fondamentaux garantis par la Constitution (liberté personnelle, inviolabilité du
domicile et secret des communications et de la correspondance).
79. Art. 206 (2014). L’art. 199 (2012) affirmait que la police devait assurer aux citoyens
leur tranquillité et protéger leur dignité, leurs droits et leurs libertés.
80. La Constitution de 2012 (art. 98) limitait cette compétence aux crimes concernant
les forces armées, leurs officiers et leur personnel.
81. L’art. 183 de la Constitution de 1971 renvoyait à la loi pour organiser la justice
militaire et déterminer ses attributions, dans la limite des principes énoncés par la
Constitution . La loi n° 25 de 1966 sur la justice militaire autorisait le président à
recourir aux tribunaux militaires pour juger des civils lorsque l’Etat d’urgence était
proclamé. Moubarak avait recours aux tribunaux militaires lorsqu’il voulait s’assurer
d’un jugement rapide et conforme à ses attentes. C’est ainsi que des dizaines de Frères
musulmans furent jugés par la justice militaire à partir des années 90.
82. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé le procureur de la justice militaire en déclarant que
les stations-services gérées par l’armée seraient de son ressort.
83. L’article 204 a été adopté par 41 voix pour, 6 contre, 1 abstention.
84. Pour une évaluation de la situation des droits de l’homme en Egypte et des
violations des dispositions relatives aux droits de l’homme contenues dans la
Constitution de 2014, voir par ex. la résolution du Parlement européen du 17 juillet
2004 sur la liberté d’expression et d’assemblée en Egypte http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-
TA-2014-0007 Site consulté le 21 octobre 2014.
85. La Constitution de 1971 avait consacré pour la première fois la valeur normative de
la loi islamique, affirmant tout d’abord que les principes de la charia étaient
« une source principale de la législation », avant d’être amendée en 1980 pour en faire
« la » source principale de la législation.
86. Les salafistes auraient souhaité renforcer la valeur normative de la loi islamique en
remplaçant le terme « principes » par celui plus précis de « règles », ou même tout
simplement faire de « la charia » la source principale de la législation. Mais les autres
forces politiques et sociales représentées au sein de l’Assemblée constituante, y compris
al-Azhar, choisirent par consensus de ne pas modifier cet article.
87. DUPRET Baudouin, La charia, La Découverte, 2014, p.7.
88. V. BERNARD-MAUGIRON Nathalie, Le politique à l’épreuve du judiciaire : la justice
constitutionnelle en Egypte, Bruylant, Bruxelles, 2003 et BERNARD-MAUGIRON Nathalie et
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
181
DUPRET Baudouin, « Les principes de la sharî‘a sont la source principale de la législation.
La Haute Cour constitutionnelle et la référence à la loi islamique », Égypte-Monde arabe,
n° 2, 1999, nouvelle série, p. 107 et s.
89. Haute Cour constitutionnelle (HCC), 4 mai 1985, n° 20/1 e, Recueil des décisions de la
Haute Cour constitutionnelle (Rec.), vol. 3, p. 209 et s. Pour une traduction de l’arrêt, v.
Richard Jacquemont, « La Haute Cour constitutionnelle et le contrôle de
constitutionnalité des lois », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1988, IV,
p. 569 et s.
90. Date de la publication des résultats du référendum demandant au peuple,
conformément à l’article 189 de la Constitution de 1971, d’approuver les amendements
constitutionnels proposés par l’Assemblée du peuple.
91. HCC, 15 mai 1993, n° 7/8e, Rec., vol. 5, part. 2, p. 290 et s.
92. Les sources considérées comme absolues en fiqh classique sont le Coran, l’ensemble
des traditions, le consensus de la communauté et le raisonnement analogique.
93. Elles ne tirent pas leur origine de l’une des quatre sources fondamentales mais
d’autres sources, comme le bien public, l’équité, ou la coutume.
94. Quatre écoles sunnites du droit musulman sont officiellement reconnues : shaféite,
malikite, hanafite et hanbalite, du nom de leur fondateur. L’école officielle en Egypte
est l’école hanafite, qui était l’école de l’Empire ottoman. Elle est dans l’ensemble plus
rigoureuse à l’égard de la femme que les écoles shaféite ou surtout malikite (cette
dernière étant en vigueur notamment au Maroc).
95. HCC, 26 mars 1994, n° 29/11e, Rec., vol. 6, p. 231 et s.
96. HCC, 15 mai 1993, n° 7/8e, Rec., vol. 5, part. 2, p. 290 et s.
97. HCC, 14 août 1994, n° 35/9e, Rec., vol. 6, p. 331 et s.
98. HCC, 18 mai 1996, n° 8/17e, Rec., vol. 7, p. 657 et s.
99. HCC, 3 mai 1997, n° 18/14e, Rec., vol. 8, p. 611 et s.
100. HCC, 18 mai 1996, n° 93/6e, Rec., vol. 7, p. 709 et s.
101. Pour une critique de l’interprétation par la Cour des principes de la charia
islamique, voir C. B. Lombardi, « Islamic Law as a Source of Constitutional Law in Egypt:
The Constitutionalization of the Sharia in a Modern Arab State », Columbia Journal of
Transnational Law, 37, 1998, p. 81 et s. Voir aussi Nathan Brown et Clark Lombardi, “Do
Constitutions Requiring Adherence to Shari`a Threaten Human Rights? How Egypt's
Constitutional Court Reconciles Islamic Law with the Liberal Rule of Law,” 21 American
University International Law Review, 2006, 379-435.
102. L’article 6 alinéa 2 de la loi n° 462 de 1955 portant abolition des tribunaux
religieux et des tribunaux confessionnels et transfert des requêtes pendantes aux
tribunaux nationaux avait ainsi prévu que chaque communauté religieuse continuerait
à être régie par ses propres lois en ce qui concerne le statut personnel. Le texte précise
toutefois que cette dérogation ne s’appliquera qu’à condition que les deux parties non
musulmanes soient de même communauté et de même confession. Ce principe a été
repris par la loi n° 1 de 2000 sur la procédure en matière de statut personnel dont l'art.
4 a abrogé la loi n° 462 de 1955.
103. En pratique, cette autonomie permet à l’Eglise copte orthodoxe de refuser de
reconnaître la validité de divorces prononcés par les tribunaux égyptiens et de ne pas
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
182
autoriser le remariage de ces couples divorcés. Elle permet aussi aux Eglises de refuser
de reconnaître la conversion de leurs fidèles à une autre croyance ou à un autre rite.
104. Depuis l’amendement en 2008 du règlement de 1938 sur le statut personnel des
coptes orthodoxes, le divorce n’est plus possible pour les membres de cette
communauté qu’en cas d’adultère, alors que les musulmanes peuvent introduire une
requête en divorce devant les tribunaux pour absence prolongée du mari pendant plus
d'un an sans motif légitime, condamnation de l’époux à une peine de prison de plus de
trois ans, maladie grave incurable ou aliénation mentale du mari, défaut de paiement
de la pension alimentaire ou préjudice (y compris polygamie).
105. L’art. 46 (1971) prévoyait seulement : « L’Etat garantit la liberté de croyance et la
liberté de pratique religieuse ».
106. L’art. 31 interdit toute insulte envers les individus.
107. Art. 5 (1971), tel qu’amendé en 2007 : « […] Il est interdit de mener une activité
politique ou de créer des partis politiques sur une référence ou une base religieuse ou
en discriminant sur la base du sexe ou de la race ».
108. Art. 6 (2012).
109. Le parti Justice et Liberté des Frères musulmans a été interdit par une décision de
juin 2014, mais sur un autre fondement.
110. « Le grand marchandage des salafistes et les coulisses de l’élaboration de la
nouvelle constitution », Al-churûq, 24 décembre 2012, traduction CEDEJ (http://
egrev.hypotheses.org/184)
111. Le Coran et la sunna.
112. Nom historique des pères fondateurs des écoles sunnites.
113. Pour une analyse approfondie de l’article 219, voir Nathan Brown & Clark
Lombardi, Islam in Egypt’s New Constitution, Foreign Policy, Dec. 13, 2012, disponible en
ligne http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/12/13/
islam_in_egypts_new_constitution.
114. C’est d’ailleurs par ces techniques du takkayyur (choix de règles au sein des
différentes écoles sunnites) et du talfiq (combinaison de règles appartenant à
différentes écoles) que les législateurs du monde arabe ont réussi à réformer leurs
codes de la famille en puisant des normes au sein d’autres écoles juridiques et assouplir
ainsi certaines positions de leur école officielle.
115. HCC, 2 juin 2013, n° 41/26, JO n° 23 bis (b) du 10 juin 2013.
116. Les priorités affichées par Mohamed Morsi étaient de restaurer l’ordre public et de
mettre fin à la crise économique, pas de réislamiser le droit.
117. Pour une étude des vestiges de la loi islamique dans le droit égyptien
contemporain, voir N. Bernard-Maugiron, « Droit national et référence à la charia en
Egypte », in B. Dupret (ed.), La charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique,
La Découverte, 2012, p. 95-111.
118. Des groupes salafistes appelèrent à l’abrogation des réformes du droit de la famille
introduites sous le règne de Hosni Moubarak et déposèrent au parlement des projets
d’amendements, mais ils ne furent pas adoptés et la chambre basse fut dissoute en juin
2012.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
183
119. Al-Azhar, avec à sa tête le cheikh d’Al-Azhar, est la plus haute autorité de l’islam
sunnite et un lieu réputé d’enseignement de la théologie musulmane.
120. Le Conseil des grands ulémas d’al-Azhar est formé de 40 membres, connus pour
leur piété et leurs connaissances, nommés tout d’abord par le cheikh d’al-Azhar puis
cooptés par la suite. C’est ce Conseil qui sera chargé d’élire le nouveau cheikh d’al-
Azhar qui, jusqu’en 2012, était nommé par le président de la République.
121. Art. 175 (2012).
122. Le Centre de recherche islamique d’al-Azhar avait déjà le droit de censurer toute
publication jugée offensante pour l’islam et même, depuis 2004, d’en demander la
saisie.
123. Cet article se situe dans le chapitre relatif aux fondements sociaux de la société et
non plus dans les fondements politiques de l’Etat et de la société, comme dans la
Constitution de 2012.
124. L’art. 7 (2014) préserve le statut d’autonomie d’al-Azhar et continue à obliger l’Etat
à lui procurer les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le cheikh reste
inamovible.
125. Art. 66 (1971) : « La peine est personnelle. Aucune infraction et aucune peine ne
peut être établie qu'en vertu d'une loi […] ».
126. Les châtiments corporels prévus par le droit pénal islamique pour les crimes les
plus graves (ex. vol, relations sexuelles hors mariage, consommation d’alcool) ont
disparu du code pénal égyptien depuis le XIXe siècle et ont été remplacés par des
peines de prison et/ou des amendes.
127. L’art. 227 (2014) fait de la Constitution et de son préambule un tout indivisible.
128. Art. 6 (2012) : « Le régime politique repose sur les principes de la démocratie, de la
consultation, de la citoyenneté qui confère à tous les citoyens les mêmes droits et
devoirs publics, sur le pluralisme politique et le multipartisme, l’alternance pacifique
du pouvoir, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, la souveraineté de la loi, le respect
des droits de l’homme et de ses libertés, de la manière indiquée dans la présente
constitution ».
ABSTRACTS
The Egyptian Constitution of 2014 has been described as a revolutionary document, a model for
the protection of human rights and a significant step forward to establish a genuine democratic
transition. The Constitution was the last step of a particularly chaotic constitutional transition,
that was initiated by the fall of president Hosni Mubarak in 2011.
Through a comparative analysis of the Constitution of 2014 with the two documents that
preceded it (2012 and 1971), and in particular of the human rights provisions and the provisions
dealing with state identity, this paper shows how this Constitution, which was to perform a break
with the past and correct that of 2012 - described as the Islamic Constitution of a theocratic state
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
184
- constitutes a continuity more than a rupture of the Egyptian constitutional order, and
strengthens the power more than it frames it.
La Constitution égyptienne de 2014 a été présentée comme un texte révolutionnaire, un modèle
de protection des droits de l’homme et une avancée significative vers une véritable transition
démocratique. Elle est venue clore une transition constitutionnelle particulièrement chaotique,
entamée avec la chute du président Hosni Moubarak en 2011.
A travers une analyse comparative de la Constitution de 2014 avec les deux textes qui l’ont
précédée (2012 et 1971), et en particulier des dispositions relatives aux droits de l’homme et
traitant de l’identité de l’Etat, cette contribution montre que ce texte, qui devait constituer une
rupture avec le passé et rectifier celle de 2012 - présentée comme la Constitution islamique d’un
Etat théocratique, se situe davantage dans la continuité que dans la rupture de l’ordre
constitutionnel égyptien et renforce le pouvoir plus qu’il ne l’encadre.
INDEX
Mots-clés: Egypte – Constitution- Islam – Charia - Droits de l’homme - Minorités
Keywords: Egypt - Constitution - Islam - Charia - Human rights - Minorities
AUTHOR
NATHALIE BERNARD-MAUGIRON
Nathalie Bernard-Maugiron est directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD, CEPED) et a été co-directrice de l’IISMM (Institut d’études de
l’Islam et des sociétés du monde musulman) de 2010 à 2014. Juriste, elle a obtenu son
doctorat en droit public à la Faculté de droit de l'Université Paris Ouest Nanterre et sa
HDR à la Faculté de droit de Grenoble. Elle a séjourné plusieurs années en Égypte, où
elle a mené divers programmes de recherche portant sur le droit égyptien. Elle co-
anime un séminaire de recherche à l’IISMM sur le droit contemporain des pays
musulmans. Ses travaux de recherche actuels portent sur les processus de transition
post-révolutionnaires dans les pays arabes.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
185
Quelques observations sur la place
des droits fondamentaux dans les
nouvelles constitutions tunisienne
et égyptienne
Rahim Kherad
Les nouvelles constitutions dans les pays arabes, notamment celle de la Tunisie du 27
janvier 2014 et celle de l’Egypte en particulier, sont la résultante du mouvement de
révolte de ces peuples pour la démocratisation. La pratique montre que le chemin de la
démocratisation est semé d’embûches. Aux illusions théoriques du départ, succèdent
des désillusions pratiques, ce qui conduit nombre d’auteurs à considérer que le
processus de démocratisation engagé dans ces pays reste à parfaire. Pour autant, cela
ne signifie nullement, comme d’aucuns le suggèrent, que les peuples arabes n’étaient
pas prêts à l’instauration de la démocratie, ou pire, qu’un gouvernement autoritaire
leur conviendrait mieux. Au-delà du mépris scientifique dont se teinte une telle
affirmation, elle est surtout en décalage criant avec la réalité. « Le peuple tunisien a
révélé, au cours des derniers évènements, que l’idée démocratique n’était ni orientale,
ni occidentale, ni du Nord ni du Sud, qu’elle dépassait le territoire et les frontières, et
qu’elle était constitutive de notre humanité »1.
Dans le même sens, Boutros Boutros Ghali souligne que « la démocratie n’appartient à
personne. Elle peut être et elle doit être assimilée par toutes les cultures. Elle est
susceptible de s’incarner dans des formes multiples afin de mieux s’inscrire dans la
réalité des peuples. La démocratie n’est pas un modèle à copier sur certains Etats, mais
un objectif à atteindre par tous les peuples »2. Qu’en est-il donc du constitutionalisme
égyptien et tunisien ? Peut-il être considéré comme démocratique ? L’élaboration d’une
Constitution qui garantisse les droits fondamentaux de l’homme est-elle suffisante pour
engendrer la démocratie ?
Le processus de démocratisation dans le monde arabe à partir de l’année 2011 résulte
de la confiscation par des régimes dictatoriaux, après les indépendances, de leur droit à
l’autodétermination interne. Quel intérêt aurait « un peuple à lutter et à consentir
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
186
mille souffrances et sacrifices pour mettre fin à la domination étrangère sans que cela
lui donne le droit de choisir des régimes et des institutions qui lui permettront de faire
valoir ses aspirations ?»3. Pour autant, pendant plus de trente ans, ces gouvernements
anti-démocratiques, en se fondant exclusivement sur le critère d’effectivité,
représentaient leurs peuples au sein des instances internationales.
A cet égard, Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra, soulignait que « l’Etat est le plus
froid de tous les monstres froids, il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de
sa bouche : moi l’Etat, je suis le peuple ». Le critère de l’effectivité de l’exercice du
pouvoir, enraciné dans la pratique des Nations unies, conduisait l’Organisation à
admettre la représentativité de gouvernements anticonstitutionnels. Or l’effectivité à
elle seule ne suffit pas4 ; il faut que le gouvernement soit légal, c'est-à-dire issu du
suffrage universel. Dans ce sens, l’Assemblée générale des Nations unies a donc
progressivement abandonné l’idée que tous les régimes politiques devaient être
considérés comme équivalents, conformément à une interprétation stricte de la
souveraineté de l’Etat. Depuis 1990, avec l’effondrement de l’Union soviétique, l’on
constate que l’organe délibérant multiplie les références à la démocratie pluraliste et,
du même coup, fait réapparaître l’importance de la volonté populaire comme source
première de tout pouvoir politique.
Le mouvement de démocratisation dans le monde arabe est précisément l’incarnation
de cette volonté populaire contre les régimes dictatoriaux. La Tunisie fut la première,
on le sait. Par la suite, d’autres peuples ont emprunté le même chemin, en Egypte, au
Yémen, en Jordanie, en Lybie, au Bahreïn, au Maroc, en Arabie Saoudite et en Syrie.
Il convient de préciser que la particularité de chacun de ces pays, non seulement au
niveau politique et institutionnel, mais aussi au niveau de la structure sociale, de la
diversité ethnique et tribale, rend impossible l’instauration d’un modèle unique
transposable à toutes ces situations. Avant même ces révoltes, cette diversité se
manifestait d’ailleurs à travers la variété de textes constitutionnels observable dans le
monde arabo-musulman.
Ceci n’empêche nullement une aspiration commune pour l’alternance démocratique.
Mais pour quelle alternative ? La réponse à cette question est en partie fournie par
l’étude des processus constituants enclenchés dans les Etats arabes pour modifier
l’ordre juridique en vigueur ; si certains Etats, comme le Maroc, se sont contentés d’une
révision constitutionnelle partielle5, suffisante pour apaiser les tensions, d’autres,
comme l’Egypte et la Tunisie, ont choisi la voie plus longue de l’élaboration d’une
nouvelle Constitution. L’Assemblée nationale constituante (ANC) de Tunisie a achevé
ses travaux, aux termes de presque deux années, en adoptant la Constitution le 27
janvier 2014. Quant à la loi fondamentale égyptienne, elle été modifiée deux fois depuis
le départ de l’ancien chef de l’Etat : les frères musulmans, parvenus au pouvoir par le
truchement d’élections au suffrage universel, avaient élaboré une première
Constitution le 26 décembre 2012. Renversé par l’armée le 3 juillet 2013, ce
gouvernement constitutionnel, dirigé par le président Morsi, a donc été remplacé par
un gouvernement intérimaire. Ce dernier décida de rédiger un nouveau texte
constitutionnel, adopté par référendum les 14 et 15 janvier 2014. Mais la légitimité de
ce texte a fait l’objet de débats. Selon la Commission électorale égyptienne, le « oui » l’a
emporté lors de cette consultation populaire par 98,1 %, mais avec 38,6 % de
participation, ce qui signifie que seuls 37,8% du corps électoral a réellement approuvé
ce texte.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
187
La question centrale se rapporte à la protection des droits fondamentaux de l’homme
prévue par ces deux constitutions. Cela me conduit, d’une part, à étudier
successivement la nature démocratique du régime politique (I), le respect des
engagements internationaux de l’Etat (II), les rapports entre la religion et le droit (III),
et enfin la protection des droits de la femme (IV).
I. L’instauration d’un régime politique démocratique
Le régime démocratique, on le sait, est caractérisé à la fois par l’alternance, qui
implique le respect du pluralisme, et par l’application de la règle majoritaire, laquelle a
pour corollaire la protection des droits des minorités. En la matière, les deux
constitutions semblent apporter en partie les garanties nécessaires. Le Préambule du
texte constitutionnel tunisien contient des déclarations d’intention rassurantes : il
entend poser « les fondements d’un régime républicain démocratique et participatif,
dans le cadre d’un Etat civil, où la souveraineté du peuple s’exerce, à travers
l’alternance pacifique au pouvoir, par des élections libres ». En outre, il rappelle que
« la liberté d’association, conformément au principe de pluralisme, de neutralité de
l’administration et de bonne gouvernance, est la condition de la compétition
politique ». Quant à l’article 2 de la Constitution, frappé d’une interdiction de révision,
il dispose : « la Tunisie est un Etat civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et
la primauté du droit ».
A la lecture des dispositions de la nouvelle Constitution égyptienne, le constat peut
paraître tout aussi encourageant. La rédaction du Préambule, caractérisé par un style
emphatique, proche du syndrome pharaonique ( !), offre certaines garanties : les
constituants y affirment « leur croyance à la démocratie, comme voie, comme avenir, et
comme mode de vie ; [au] pluralisme politique et à la transmission pacifique du
pouvoir » ainsi qu’au « droit du peuple à bâtir son avenir », en tant que « la seule
source du pouvoir ». Par ailleurs, l’article 1er précise la nature de l’Etat égyptien : « La
République Arabe d’Égypte est un État souverain, unifié et indivisible, et dont le régime
est une république démocratique fondée sur la citoyenneté et l’autorité de la loi ».
L’article 5 est encore plus précis, puisqu’il énonce que « le régime politique est fondé
sur le pluralisme politique et le multipartisme, la transmission pacifique du pouvoir, la
séparation et l’équilibre des pouvoirs, le fait que toute autorité suppose une
responsabilité et le respect des droits de l’homme et de ses libertés, conformément aux
dispositions de cette Constitution ».
Si l’insertion de telles dispositions dans les constitutions tunisiennes et égyptiennes
semblent plutôt enclines à favoriser l’instauration de la démocratie et le respect des
droits fondamentaux de l’homme, seule la pratique révèlera si ces textes
constitutionnels demeurent une rhétorique séduisante ou bien au contraire s’ils
prennent corps et façonnent pour longtemps le paysage politico-juridique des deux
Etats.
En effet, les expériences passées ont montré que certains principes constitutionnels
demeuraient purement déclaratoires, dès lors que les autorités étatiques les
méprisaient. Ainsi, sous le régime de Ben Ali comme celui de Moubarak, on le sait, le
multipartisme, bien que constitutionnellement garanti, n’a jamais été respecté. De la
même façon, l’impossibilité de réviser l’article relatif au nombre de mandats
présidentiels figurait déjà dans la précédente Constitution tunisienne de 1959. Son
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
188
article 40 prévoyait que le président ne pouvait renouveler son mandat plus de trois
fois. Par une loi constitutionnelle de 1974, le président Bourguiba fit amender cet
article, en s’arrogeant « à titre exceptionnel et en reconnaissance de son rôle dans la
libération nationale », le droit de garder à vie la fonction de président de la République.
Le président Ben Ali ayant destitué son prédécesseur en raison de son état de santé, il
fit de nouveau inscrire dans la Constitution la limitation du nombre de mandat
présidentiel. Or, quelques années plus tard, il transgresse lui-même la règle, en
supprimant l’amendement en question pour se maintenir en fonctions, à l’issue de ses
deux premiers quinquennats.
II. La valeur des engagements internationaux
Aux termes de l’article 93 de la Constitution égyptienne, « l’Etat s’engage à respecter les
traités, accords et conventions internationales relatifs aux droits de l’homme ratifiés
par l’Egypte. Ils ont force de loi après leur publication, avec les réserves spécifiées ».
Cette disposition laisse sous-entendre que le pouvoir législatif peut en toute discrétion
écarter, contourner, voire contredire les engagements internationaux de l’Etat.
Quant à la Constitution tunisienne, son article 19 pose une règle de hiérarchisation des
normes, semblable à celle de la Constitution française de 1958 : les traités sont
supérieurs aux lois, la Constitution est supérieure aux traités. Ceci implique qu’avant
d’accepter un nouvel engagement conventionnel international, la Tunisie devra
s’assurer de sa compatibilité avec la norme suprême. Quant à la supériorité des traités
sur les lois, elle contraint le législateur tunisien à se conformer aux conventions
internationales ratifiées par la Tunisie, notamment celles relatives à la protection des
droits de l’homme.
Selon la Commission de Venise6, organe consultatif du Conseil de l’Europe, la rédaction
de cette disposition pourrait paraître entièrement satisfaisante au regard du principe
pacta sunt servanda, si elle ne recelait pas une certaine équivocité ; en effet, l’article 19
s’applique aux traités « approuvés par l’Assemblée des représentants, et ensuite
ratifiés ». Dans la mesure où cette disposition fait référence à la future « Assemblée des
représentants », la Commission estime incertain qu’elle s’applique également aux
traités déjà ratifiés. Or, cet argument est dénué de portée, puisqu’une telle pratique
porterait atteinte à la continuité de l’Etat, règle fondamentale en matière de succession
d’Etats.
III. La source de la législation
S’agissant de l’Egypte, le Préambule ainsi que l’article 2 de la Constitution disposent
que « les principes de la Charî’a islamique sont la source principale de la législation ».
L’insertion de l’adjectif « principale » montre que la loi islamique doit être considérée
comme une source majeure du droit égyptien, mais que ce dernier peut avoir d’autres
fondements. En ce sens, l’article 3 de la Constitution précise que « les principes des lois
religieuses des Égyptiens chrétiens et juifs sont la principale source des législations qui
régissent leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants
spirituels ». Cette disposition introduit donc une protection particulière des minorités
religieuses. Il est à regretter que la Constitution ne mentionne à aucun moment la
question des droits des minorités.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
189
Quant à la place de la charî’a dans le nouvel édifice juridique tunisien, elle a fait l’objet
de vives controverses au sein de l’ANC. Le parti majoritaire Ennahda, voulait faire
figurer la mention de la charî’a comme source du droit ; mais les tensions au sein de
l’assemblée, ainsi que l’attachement d’une partie importante de la population
tunisienne à une certaine tradition de laïcité de l’Etat, ont fini par avoir raison de cette
proposition du parti islamiste. L’article premier de la nouvelle Constitution est donc
repris à l’identique de celui de la Constitution de 1959 de Bourguiba : il dispose que « la
Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, et que « l’Islam est sa religion ».
Cependant, l’article 2 nuance la portée de cette assertion, en affirmant que « la Tunisie
est un Etat civil ». De nombreux commentateurs, dont la Commission de Venise,
s’entendent pour dire que la conjugaison de ces deux articles présente quelques
difficultés. Il semble en effet paradoxal de concilier l’islam en tant que religion de l’Etat
avec le caractère civil de ce dernier. Ce paradoxe peut néanmoins être dépassé si l’on
admet que « l’article premier a toujours été interprété par la doctrine juridique comme
se référant à l’islam en tant que religion de la Tunisie et non à l’islam comme religion
de l’Etat. Il a une portée sociologique et non légale. Il n’est ni opposable à l’Etat ni aux
citoyens »7. Ainsi appréhendé, l’article 1er apparaît conforme aux standards
internationaux. Dans le même sens, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion est garanti à l’article 18 du Pacte international relatifs aux droits civils et
politiques, que l’Egypte et la Tunisie ont toutes deux ratifié. Comme l’indique
l’Observation générale n°22 du Comité des droits de l’homme, « le fait qu’une religion
est reconnue en tant que religion d’Etat, ne doit porter en rien atteinte à la jouissance
de l’un quelconque des droits garantis par le Pacte, ni entrainer une discrimination
quelconque contre les adeptes d’autres religions, ou les non-croyants » 8.
IV. La protection des droits de la femme
Les deux textes constitutionnels égyptiens et tunisiens intègrent chacun une
disposition entièrement consacrée à la protection des droits de la femme. La question
de l’égalité entre l’homme et la femme est bien sûr au cœur du débat. L’article 9 de la
Constitution égyptienne est relatif à l’obligation qui incombe à l’Etat de garantir
« l’égalité des chances entre tous les citoyens, sans discriminations ». Plus loin, l’article
11 est consacré aux droits de la femme et aux engagements de l’Etat en la matière.
L’effet d’annonce est prometteur : l’Etat « s’engage à réaliser l’égalité entre les femmes
et les hommes dans les domaines des droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels », conformément aux dispositions des deux pactes internationaux de New
York de 1966.
En revanche, la parité n’est pas envisagée de manière stricte, puisque il s’agit
simplement pour l’Etat de « prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une juste
représentation des femmes au sein du Parlement ». Enfin, la disposition par laquelle
« l’État s’engage à protéger les femmes contre toutes les formes de violence » a son
importance.
Des engagements similaires figurent dans la Constitution tunisienne, mais avec
davantage de précision, ce qui renforce leur portée. L’article 21 proclame que « les
citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la
loi, sans discrimination ». Pour être parfaitement conforme à la formulation retenue
par les deux Pactes internationaux de 1966, la reconnaissance de ce principe d’égalité
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
190
aurait pu être accompagnée de la mention des formes spécifiques et diverses de la
discrimination, à savoir la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques, l’origine sociale, ou encore la nationalité. Il
me parait par ailleurs surprenant que cet article n’évoque pas clairement l’égalité
homme-femme.
Dans le même sens, l’Etat tunisien s’engage clairement en vertu de l’article 46
à protéger les droits acquis de la femme et œuvre à les renforcer et les développer.
L’égalité des chances est strictement protégée, puisqu’elle s’applique à « toutes les
responsabilités » et dans « tous les domaines ». L’Etat œuvre également à réaliser la
parité entre l’homme et la femme dans les assemblées élues (règle qui a d’ailleurs été
imposée pour l’élection de l’Assemblée constituante elle-même 9).
En définitive, ces observations nous amènent à dire avec Georges Burdeau que « la
démocratie n’est pas dans les institutions, mais dans les personnes. Il n’y a pas de
démocratie, il n’y a que des démocrates »10.
NOTES
1. Y. Ben Achour, « Rien ne sera plus comme avant en Tunisie », Jeune Afrique, quotidien consulté
en novembre 2013 et disponible à l’adresse : www. jeuneafrique.com.
2. B. Boutros-Ghali, Le droit international à la recherche de ses valeurs : paix, développement,
démocratisation, RCADI, 2000, t. 286, p. 32.
3. Madjid BENCHIKH, « La confiscation du droit des peuples à l’autodétermination interne », in Droit
du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 808-809.
4. Il est tout à fait significatif que les conditions posées en matière de reconnaissance dans les
deux déclarations adoptées le 16 décembre 1991 à Bruxelles par les ministres des Affaires
étrangères des Etats membres de la Communauté économique européenne ne mentionnent pas le
critère de l’effectivité. En revanche, elles subordonnent la reconnaissance des nouveaux Etats
issus de la dissolution de la RSFY à plusieurs conditions. La première d’entre elles concerne « le
respect des dispositions de la Charte des Nations Unies et des engagements souscrits dans l’Acte
final d’Helsinki et la Charte de Paris, notamment en ce qui concerne l’Etat de droit, la démocratie
et les droits de l’homme »
5. Approuvée par référendum le 1er juillet 2011, la réforme constitutionnelle marocaine a infléchi
le régime dans le sens du respect des droits et des libertés, du renforcement du pouvoir exécutif,
de l'élargissement du domaine de la loi et de l'indépendance de la justice. Elle ne réduit
cependant pas les prérogatives du Roi, qui demeure au centre de la vie politique marocaine.
6. Pour de plus amples développements, cf. M-S BERGER « La Commission de Venise et
l’élaboration de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », Mélanges en l’honneur de Rafaâ Ben
Achour, à paraitre en 2015.
7. H. REDISSI, « La Constitution tunisienne de 2014. Raison publique et laïcité islamique », Esprit,
02 juillet 2014, disponible en ligne à l’adresse www.esprit.presse.fr, Rubrique Actualités,
consultée le 15 septembre 2014.
8. Comité des droits de l’homme, Observation générale n°22. Article13, 48 ème session, Doc.
HRI\GEN \1\Rev.1, 1993.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
191
9. La combinaison des principes de parité et d’alternance femme/homme dans les listes
présentées établie par l’article 16 du décret-loi électoral avait permis à environ 5.000 femmes
d’être candidates à l’élection. Quant au corps électoral, il était composé de 45% de femmes, ce qui
est une proportion honorable.
10. G. BURDEAU, La démocratie, Paris, Seuil, 1956, 185 p.
ABSTRACTS
The new constitutions in Arab countries are the product of the movement of revolt of peoples for
the democratization. The Tunisian and Egyptian constitutions grant a important place to the
fundamental rights. Such an importance leads us to question the place of the charî’a as for source
of legislation, the protection of women rights and the respect for the international conventions.
Les nouvelles constitutions dans les pays arabes sont la résultante du mouvement de révolte de
ces peuples pour la démocratisation. Les constitutions tunisienne et égyptienne accordent une
place importante aux droits fondamentaux. L’importance de ces droits nous conduit à
s’interroger sur la place de la charî’a comme source de la législation, sur la protection des droits
de la femme ainsi que sur le respect des engagements internationaux.
INDEX
Mots-clés: Constitution - Droits fondamentaux -Régime démocratique - Engagements
internationaux - Femme
Keywords: Constitution - Fundamental rights - Democracy - International conventions - Women
AUTHOR
RAHIM KHERAD
Rahim Kherad est professeur de droit public à l’université d’Angers, membre du Centre Maurice
Hauriou pour la recherche en droit public de l’université Paris Descartes (Sorbonne Cité). Ses
travaux portent principalement sur la notion d’Etat, le processus de démocratisation, la Cour
pénale internationale, les conflits internationaux et les droits de l’Homme. Il a organisé de
nombreux colloques autour de ces thématiques, dont un s’est tenu récemment à l’Institut du
monde arabe sur « la démocratisation dans le monde arabe : alternance pour quelle alternative ? ».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
192
La protection ambivalente de
l’égalité formelle dans la
Constitution iranienne : après la
Révolution de 1979
Hiva Khedri
1 La célébration du 35e anniversaire de la Révolution islamique offre l’occasion de se
pencher sur la façon dont les constituants iraniens ont appliqué le principe d’égalité
formelle, c’est-à-dire la norme d’égale protection de la loi.
2 En 1979, l’Iran, l’un des pays les plus importants du monde musulman, a connu un
bouleversement politique, passant d’un régime monarchique à une « république
islamique » et adoptant comme nouvelle dénomination : « République islamique
d’Iran »1.
3 Tant au niveau national qu’au niveau international, ce bouleversement est connu sous
le nom de « Révolution islamique »2.
4 La naissance de ce nouveau régime a été marquée par l’adoption d’une nouvelle
Constitution. Les révolutionnaires ont élaboré cette Constitution sur un modèle
classique, avec un préambule et des articles répartis en chapitres bien délimités. En
décembre 1979, la Constitution a été approuvée lors d’un référendum puis, a été
révisée, en 19893.
5 Mais, comme le souligne à juste titre le professeur Jdalili :
6 « Comme son nom l’indique, la nature profonde de la révolution est une révolution dont les
visions, les références, les objectifs sont plus étroitement liés à l’islam qu’au fait national iranien.
Elle s’adresse aux musulmans du monde entier et, au-delà, à tous les déshérités, du Sud comme
du Nord. […] le législateur islamique, une fois installé aux commandes, va traduire en
obligations constitutionnelles et légales ses prescriptions religieuses 4. »
7 C’est dans cet esprit et sur un substrat idéologique précis que l’article 4 de la nouvelle
Constitution énonce :
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
193
8 « L’ensemble des lois, des règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs,
culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les préceptes de l’Islam. Ce principe
s’applique de manière absolue et générale à tous les articles de la Constitution ainsi qu’à toutes
les autres lois et tous les autres règlements, l’appréciation de cette matière est du ressort des
jurisconsultes religieux (fouqaha) membres du Conseil gardien5. »
9 Alors que l’un des grands héritages de la Révolution française de 1789 est le principe
d’égalité6, les révolutionnaires iraniens prennent un autre chemin. Ils ont opéré un
autre choix, qui s’est traduit ; comme nous allons le voir, par des flagrantes inégalités
de droits entre citoyens iraniens.
10 D’emblée, il faut remarquer que le premier texte de la Constitution a été élaboré à
Paris, avant l’arrivée de l’ayatollah Khomeiny en Iran, en 1979. Ensuite, à Téhéran, au
printemps de la même année, une assemblée constituante a rédigé le premier projet de
Constitution7.
11 Au mois d’août, l’Assemblée constituante est devenue l’« Assemblée des experts de la
Constitution », qui, dominée par le Parti de la République islamique, a permis
progressivement d’inclure des dispositions discriminatoires dans le projet
constitutionnel.
12 Le principe d’égalité est certes mentionné dans les articles 19 et 20. Toutefois, il existe
un grand problème, pour son application, qui réside à la fois dans sa formulation et
dans son articulation avec les autres dispositions de la Constitution, notamment celles
qui traitent sur du sexe et de la religion. Il convient de préciser que la première version
du projet constitutionnel n’avait pas mentionné les inégalités reposant sur le sexe. Elle
faisait néanmoins référence à la charia.
13 Dans cette étude, nous analyserons comment le constituant islamique assure la norme
d’égale protection de la loi -c’est-à-dire l’égalité formelle-, qui est prévue par l’article
26 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP).
14 Nous allons nous concentrer sur l’égalité formelle, car c’est une norme fondamentale,
avec un caractère indérogeable, qui constitue la pierre angulaire de la protection
internationale des droits de l’homme, affirmée tant par la Charte des Nations unies que
par tous les instruments internationaux de protection des droits de l’homme 8.
15 Le PIDCP indique que toutes les personnes « ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi ». Afin de préciser ce que nous comprenons par la « norme d’égale
protection de la loi », nous avons emprunté la définition qui en est donnée par le
professeur Olivier De Schutter :
16 « La règle qui garantit à tous une égale protection de la loi interdit les lois discriminatoires, c’est-
à-dire qui opèrent des différences de traitement entre catégories de destinataires qui n’ont pas de
justification objective et raisonnable (discrimination directe), ou bien qui, bien que d’apparence
neutres, entraînent une discrimination du fait de leur impact disproportionné sur une certaine
catégorie de personnes (discrimination indirecte)9. »
17 En somme, nous entendrons ici, par norme d’égale protection de la loi, une égalité formelle
qui s’adresse au législateur, à la différence de la règle garantissant l’égalité devant la loi,
qui s’adresse, quant à elle, aux responsables de l’application des lois au sein de
l’exécutif ou du judicaire10. Selon O. de Schutter, il existe une confusion conceptuelle
entre ces deux types de normes. Pourtant, « ce sont des garanties distinctes, qui ne
s’impliquent pas nécessairement l’une l’autre »11.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
194
18 Il faut enfin rappeler que l’Iran, qui a ratifié les deux pactes internationaux de 1966, fait
aussi partie des signataires de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
19 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 26, dispose :
20 « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les
personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation 12. »
21 Dans le cadre de ses engagements envers le pacte et plus précisément l’article 26 dudit
traité, se pose dès lors la question essentielle de savoir comment le constituant
islamique assure la norme d’égale protection de la loi dans la Constitution 13. Ce qu’on
pourrait penser être à première vue, pour les citoyens du pays, une protection assurée
par les articles 19 et 20 (I), se révèle néanmoins être trompeuse et discriminatoire au
regard de l’ensemble de la Constitution (II).
I. Une protection assurée en apparence par les articles
19 et 20 de la Constitution
22 Pour une partie de la doctrine, les articles 19 et 20 de la Constitution iranienne
garantissent le principe d’égalité. En effet, l’article 19 de la Constitution iranienne
dispose : « Tous les Iraniens, quelle que soit leur origine (tribu ou famille), jouissent de droits
égaux et la couleur, la race, la langue, etc., ne confèrent aucun privilège. »
A. Une égalité partiellement garantie par l’article 19
23 Le constituant semble énoncer, dans cet article 19, un article d’une portée normative
générale, voire illimitée et absolue. Mais il convient de remarquer que l’égalité formelle
ne concerne en réalité que seulement quatre critères : l’« origine », la « race », la
« couleur » et la « langue ».
24 Il ne précise pas d’autres éventuels motifs de discrimination, tels que le « sexe » ou la
« religion », ce qui soulève un problème au regard du Pacte14.
25 Afin de comprendre pourquoi le constituant religieux ne mentionne que ces seuls
motifs de couleur, de race et de langue ou d’origine, nous examinerons les discours
tenus et les documents présentés par les autorités iraniennes devant les instances
onusiennes. Il est important, à ce propos, de relever que, en 1976, l’Iran a ratifié la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. En 1979, tout de suite après la Révolution, le gouvernement a présenté son 6 e
Rapport périodique devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-
après CERD), malgré les évènements et la situation chaotique du pays. Le représentant
iranien a indiqué que son gouvernement avait rédigé son premier rapport en toute
hâte, « afin qu’après la Révolution iranienne le dialogue avec le Comité puisse être repris dès que
possible15 ».
26 Selon la délégation de la République islamique d’Iran :
27 « La République islamique de l’Iran apportera son plein appui au Comité dans tous les efforts
déployés pour éliminer la discrimination raciale. Le Rapport reflète la philosophie de la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
195
République d’Iran, fondée sur l’Islam. L’Islam respecte entièrement les droits et libertés
fondamentaux et, selon son enseignement, tous les êtres humains sont égaux ; il condamne toutes
les formes de discrimination fondées sur l’origine, la couleur ou la race 16. »
28 On remarquera que ce rapport se limite aussi, pour la reconnaissance de l’égalité, à
trois critères : l’« origine », la « couleur » et la « race ». Dans le même esprit, à propos
de la discrimination raciale, la République islamique d’Iran, dans son 8 e Rapport
périodique 1984, a souligné :
29 « La discrimination raciale a toujours été étrangère à notre culture et à notre histoire, en
particulier depuis la conversion des Iraniens à l’islam. […]
30 Interrogé sur sa nationalité, le musulman parlera de l’unité religieuse et de son appartenance à
l’Ummah islamique (c’est-à-dire à la nation islamique). Par cette réponse ferme et globale fondée
sur le Coran, il a rejeté le racisme… »
31 Force est de constater que l’accent est mis sur le terme coranique d’Ummah qui désigne
la communauté des croyants par son unité religieuse et musulmane. Sur cette base, on
estconduit à constater que la similarité entre le verset n° 13 de la sourate 49 et l’article
19 de la constitution n’est pas due au hasard. Cette similarité est illustrée également
dans un autre document présenté par l’Iran selon lequel :
32 « Le fondement philosophique de la République islamique de l’Iran étant l’Islam, c’est dans son
livre sacré, le Coran, que se trouvent les principes de base qui déterminent les relations sociales
en Iran. Le verset n° 13 de la Sourate 49 (Al-Hujurat) du Coran déclare : ’ O hommes, nous vous
avons procréés d’un homme et d’une femme, nous vous avons partagés en familles et tribus, afin
que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne devant le Dieu est celui d’entre vous qui
craint le plus Dieu. Or Dieu est savant et instruit de tout.’ Ainsi, seule la foi confère à l’homme
une dignité particulière, et ce verset condamne en fait, et avec une autorité supérieure à celle de
toute loi humaine, toute discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la couleur ou la
race. Cette loi divine se trouve transposée dans l’article 19 de la Constitution de la République
islamique d’Iran17. »
33 Le caractère religieux de l’article 19 de la Constitution, qui fonde le principe d’égalité
formelle sur les motifs d’origine, de couleur et de race, peut dès lors s’expliquer. En
d’autres termes, ce principe ne découle pas d’une philosophie universaliste fondée sur
l’obligation de protéger des droits de l’homme, mais d’un principe religieux. Le
constituant assure donc, en partie, le principe d’égalité formelle car l’islam a proscrit la
discrimination en raison de l’origine, de la couleur ou de la race des personnes.
34 S’agissant du critère de la langue, il n’est pas en contradiction avec l’islam : le
constituant religieux le prend en considération en raison de la diversité ethnique et
linguistique existant en Iran18. Malgré cette interprétation, quant au droit garanti par
l’article 19, la doctrine est divisée sur la portée dudit article. Certains seraient d’avis
que l’article 19 de la constitution présente une norme avec une portée générale, les
critères retenus faisant force d’exemple. En outre, la locution adverbale « etc »
donnerait une portée non limitée à la norme d’égale protection de la loi énoncée par ledit
article19. Or, si l’on prend en compte les diverses dispositions de la Constitution, cette
assertion n’est pas solidement fondée. L’unité du texte constitutionnel peut nous amener à
considérer que l’expression « etc » est trompeuse20.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
196
B. Une égalité conditionnée par l’article 20 de la Constitution
35 Certains spécialistes tentent de pallier l’insuffisante protection accordée aux citoyens
par le principe de l’égalité formelle de l’article 19 en faisant appel à une autre
disposition de la loi. M.R. Dolatraftar s’appuie ainsi sur l’article 20 de la
Constitution selon lequel :
36 « tous les individus de la nation, aussi bien les femmes que les hommes, sont de façon égale sous
la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et
culturels, dans le respect des préceptes de l’Islam 21 ».
37 L’auteur soutient que, par le biais du rattachement de l’article 20 à l’article 19, une
éventuelle lacune juridique serait couverte. Mais il ne prend pas en considération le
caractère ambigu de cette notion de « préceptes de l’Islam ». Etant donné le manque de
clarté et de prévisibilité que cette notion recèle, elle peut en effet difficilement parfaire
le principe d’égalité formelle. Son application pose dès lors de sérieux problèmes. Avec
une formulation si vague, comment savoir en effet jusqu’où, exactement, elle peut
améliorer les droits d’individus mal protégés par le principe d’égalité formelle ?
38 En effet, comment savoir à quelle obédience religieuse l’on se réfère (chiite ou sunnite)
? A quelle interprétation de la doctrine ? Dans le cas où, par exemple, l’on se réfère à
l’islam chiite (religion d’Etat) : à quelle école de pensée ? Car, au sein de l’islam chiite
même, existent des courants de pensée divergents. N’est-il pas toujours possible, à
partir d’une divergence d’interprétation de la charia, de considérer une idée ou un
comportement comme nuisible aux « préceptes de l’Islam » ? Ne peut-on pas considérer
même que, dans le cas improbable où ces « préceptes de l’Islam » mentionnés dans
l’article 20 auraient été clairement définis, le principe d’égalité formelle serait tout de
même violé, l’association d’accorder une égale protection de la loi (comme un droit
fondamental) aux citoyens, avec le respect de préceptes d’une religion constituant
intrinsèquement une violation du principe d’égalité ?
39 En effet, les restrictions imposées par l’article 20 au droit à l’égalité formelle n’ont pas
de justification objective et raisonnable, et, dans ces conditions, le manque de clarté et
de prévisibilité que recèle la notion « dans le respect des préceptes de l’Islam » peut tout
aussi bien ouvrir la voie à des restrictions d’accès aux droits prévus par le Pacte,
notamment aux libertés de pensée, de conscience et de religion, à la liberté
d’expression, à l’exercice de la liberté de réunion et d’association.
40 Les individus et les membres de partis politiques qui ne partagent pas les convictions
des autorités sur la « pensée islamique » ou expriment des opinions divergents
pourraient être victimes d’une discrimination légale.
41 En conclusion, l’expression « dans le respect des préceptes de l’Islam » contenue dans
l’article 20 de la Constitution ne protège pas de manière égalitaire les citoyens iraniens,
car avec cette formulation, le constituant religieux « donne d’une main pour mieux
reprendre de l’autre ».
II. Une protection trompeuse au regard de l’ensemble
de la Constitution
42 S’agissant de l’égalité formelle, la Constitution iranienne ne prend pas en compte certains
critères comme celui de sexe (A) ou ceux de la conviction et de la religion (B). Bien
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
197
évidemment les conséquences qui en résultent sont des lois discriminatoires qui n’ont
pas de fondement ni de justification objective et raisonnable. On retrouve les
conséquences dans l’ensemble de la législation iranienne, surtout en matière civile et
pénale22.
A. Des inégalités fondées sur le sexe
43 Il existe une différence de traitement entre hommes et femmes dans la Constitution, du
moins concernant certains droits politiques dont sont privées les femmes. En effet,
faute d’harmonie dans l’ensemble de la Constitution, on ne saurait adopter une
interprétation large de l’article 19. Par conséquent, en ce qui concerne les femmes, le
principe d’égalité formelle n’est pas assuré par l’article 19 de la Constitution, car il est
dans l’intention du pouvoir constituant d’écarter la prohibition de la discrimination
fondée sur le sexe de la portée dudit article.
44 Autrement dit, la différence de traitement entre hommes et femmes instituée dans
l’ensemble des dispositions de la Constitution ne nous permet pas d’affirmer que
l’article 19 a une large portée ni d’affirmer qu’une égale protection de la loi s’applique à
tous les individus. La Constitution opère une discrimination à l’égard des femmes,
directe et indirecte, fondée sur l’appartenance sexuelle (le genre) ; celles-ci ne jouissent
pas des mêmes droits politiques que les hommes.
45 Nous allons voir également que, dans la Constitution iranienne, les droits des femmes
varient : ils ne sont pas semblables suivant qu’il s’agit d’être éligibles (1) ou électrices
(2).
1. Le droit d’être élue
46 Le droit d’être élues pour les femmes iraniennes varie selon l’institution devant
laquelle elles se présentent. Il a été soutenu qu’en vertu de la Constitution les femmes
seraient exclues des postes de Guide suprême, de membre de l’Assemblée des experts, du
Conseil gardien, du Conseil pour le discernement de l’intérêt du régime islamique (ci-après
CDIRI), de président et de chef du pouvoir judiciaire23.
47 Ces postes ont été réservés exclusivement aux hommes dont la plupart sont aussi des
religieux24. Pourtant, cet avis n’est pas partagé par tous les universitaires, à tout le
moins, concernant quelques postes.
a) Le président de la République islamique
48 Le président de la République islamique est élu au suffrage universel direct 25. Selon les
conditions prévues par le constituant, le candidat à l’élection présidentielle doit:
49 Etre un homme [rodjale] religieux et politique ;
50 De nationalité iranienne et d’origine iranienne26 ;
51 Gestionnaire, avisé et habile ;
52 Pourvu de bons antécédents, digne de confiance et vertueux ;
53 Pieux et attaché aux fondements de la république islamique ;
54 Avoir la religion officielle du pays (l’islam de confession chiite Dja’farite duodécimain).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
198
55 Il convient de préciser qu’il existe deux interprétations opposées concernant le droit
d’accès à la fonction présidentielle pour les femmes. Elles se fondent sur le sens donné à
un terme : celui de Rodjal. Il y a ceux pour qui ce terme aurait une double signification
dans la langue persane et se traduirait par « personnalité » ou/et « dignitaires »,
religieux et politiques27 sans indication de genre. Pour ceux-là, les femmes pourraient
ainsi accéder à la fonction présidentielle. Mais il y a aussi ceux qui, se référant à une
version terminologique arabe, considèrent que Rodjale est le pluriel du mot d’origine
arabe Radjole (qui signifie « homme »). Ils excluent donc les femmes de la fonction
présidentielle à laquelle elles aspireraient. Ainsi, pour le Professeur S.M. Hachémie, en
langue arabe (l’origine du mot), rodjale désigne les seuls « hommes » (s’opposant au
terme « Néssa’, désignant les « femmes »)28. En outre, cette définition est bien précisée
dans le grand dictionnaire de la langue persane, Farhang-é-Moine 29. Pareillement, la
juriste iranienne M. Kar, estime qu’il ne faut pas ignorer la signification masculine
(signification genrée) de la notion rodjale30.
56 Il est ici important de préciser que, dans le premier projet de la loi constitutionnelle, il
n’existait aucun critère fondé sur le sexe31. C’est à la suite du processus d’élaboration du
projet de Constitution que ce mot rodjale a été ajouté. Ayatollah Khomeiny s’était en
effet opposé à la présidentielle pour les femmes. Il considérait que puisque, selon la
charia, les femmes ne pouvaient pas être juges, elles ne pouvaient pas non plus devenir
présidente de la République islamique32.
57 Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que, jusqu’à présent, le « Conseil gardien » 33
qui est l’organe de contrôle de la validité des candidatures, n’ait validé le nom d’aucune
candidate. Le Conseil gardien, à chaque élection présidentielle, les a exclues des listes
quelle qu’aient été leurs compétences. Pour ne citer que cet exemple, aucune des trente
femmes ayant déposé leurs candidatures pour la dernière élection présidentielle du 14
juin 2013 n’a été admise à être éligible 34.
b) Les membres de l’Assemblée des experts
58 A l’heure actuelle, l’Assemblée des experts (Majlis-e-khobregân) compte quatre-vingt-six
religieux, élus au suffrage universel direct pour un mandat de huit ans. La désignation
et la révocation du Guide suprême est à la charge de cette Assemblée 35. Ces religieux
ont aussi la tâche de réviser la Constitution en collaboration avec les autres membres
du groupe d’une éventuelle révision constitutionnelle36.
59 Le constituant reste silencieux sur l’identité sexuelle requise pour se porter candidat à
devenir membre de l’Assemblée des experts. Cela peut laisser croire que rien n’interdit
aux femmes de se présenter à cette élection.
60 Toutefois, il faut souligner que l’une des conditions prévues par la loi électorale pour
être élu membre de l’Assemblée des experts est d’être jurisconsulte religieux
(Mojtahid)37. Or, en ce qui concerne l’Ijtihad38des femmes, le droit à l’interprétation des
édits par les femmes, les opinions divergent. Certains affirment qu’il est absolument
interdit aux femmes d’être Mojtahid, car, selon eux, le Coran a interdit aux femmes de
délivrer des édits religieux. D’autres acceptent que les femmes soient Mojtahid, mais à
condition que leurs édits ne concernent que les femmes (la référence fatwa n’est valable
que pour les femmes). Enfin, d’autres encore, très minoritaires, acceptent leur
nomination39. Quoi qu’il en soit, jusqu’à maintenant, aucune femme n’a été élue
membre de cette Assemblée des experts.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
199
c) Le Guide suprême
61 Le Guide suprême40 est désigné par les experts élus par le peuple (l’Assemblée des experts
susmentionnée) pour un mandat à durée indéterminée. Il joue un rôle à la fois religieux
et politique reposant sur le concept de tutelle absolue du jurisconsulte religieux 41. D’après
le Professeur Hachémi, puisque le peuple choisit les membres de l’Assemblée des
experts pour qu’ils élisent à leur tour le Guide suprême, ce système est comparable au
système parlementaire42.
62 Il est important de souligner que les conditions exigées du Guide, prévues par la
Constitution, ne mentionnent pas explicitement l’identité sexuelle. D’après M. Kar,
puisque la Constitution ne mentionne pas explicitement l’appartenance au sexe
masculin comme condition préalable à la désignation comme Guide suprême, une
femme peut être désignée à ce poste au même titre qu’un homme. Mais cet avis n’est
pas partagé par tous les auteurs. Le juriste iranien M. Hachémi, par exemple, souligne
que, pour occuper le poste de Guide suprême, l’un des critères principaux est
l’appartenance au sexe masculin, bien que cette appartenance ne soit pas explicitement
inscrite parmi les conditions requises. Il précise qu’il est impossible pour une Iranienne
de devenir Guide suprême.
63 Les deux camps ont fondé leurs argumentations sur le sujet controversé de l’accès des
femmes iraniennes à la magistrature, mais ils en tirent des résultats différents.
64 En la matière, M. Kar s’appuie sur les idées de l’ayatollah Youssef San‘i, selon qui l’islam
n’interdit pas aux femmes de devenir juges ni d’émettre des édits religieux ou de
diriger le pays43.
65 En revanche, S.M. Hachémi considère que, puisque pour la majorité absolue des clercs
les femmes ne sont pas autorisées à avoir accès à un poste de magistrat 44, elles ne
peuvent pas non plus, a fortiori, être désignées comme Guide suprême.
66 D’autres auteurs fondent leur argumentation sur l’idée que l’islam impose aux femmes
un statut juridique subalterne, au moins au sein de la famille et dans la vie conjugale, se
réfèrant aux versets coraniques qui déclarent : « Les hommes ont autorité sur les femmes en
raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils
font de leurs biens45 », ou encore à un autre verset : « Quant à elles[les femmes], elles ont des
droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont
cependant une prédominance sur elles »46. De même, se référant au Coran, les clercs de
haut rang soutiennent que :
67 « Même dans l’hypothèse où on entend par les versets coraniques la domination masculine en
milieu familial, si Allah tout-Puissant ne permet pas à une femme d’avoir le contrôle et l’autorité
sur son propre petit foyer, comment serait-elle autorisée à avoir le contrôle et l’autorité sur
l’ensemble des foyers de la population et l’Ummah islamique47 ? »
68 Par conséquent, en vertu de la doctrine religieuse dominante, la prééminence 48 de
l’homme est une préférence divine qui ne supporte aucune contestation 49. Bien qu’il
n’existe aucun consensus en la matière donc50, la jurisprudence51 islamique présente
une entrave majeure à l’accès des femmes au poste de Guide suprême en Iran. La
position politique subalterne des femmes en Iran est la conséquence de cette vision
conservatrice transposée dans la Constitution après la révolution de 1979. Par
conséquent, même avec une interprétation stricte, l’inéligibilité des femmes iraniennes
demeure dans la Constitution, à tout le moins pour les fonctions susmentionnées.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
200
69 A l’exception de l’Assemblée des experts52, où les musulmans sunnites sont autorisés à
présenter leur candidature, les débats sur la candidature aux postes susmentionnés
concerne exclusivement les femmes musulmanes pratiquant la religion officielle du
pays, l’obédience chiite Djafarite duodécimaine. Les citoyennes iraniennes non
musulmanes sont automatiquement exclues en raison des conditions exigées dans la
Constitution.
70 Nous pouvons ainsi considérer cette incapacité juridique des femmes non musulmanes
comme relevant d’un ostracisme supplémentaire s’ajoutant à l’ostracisme dû à la
hiérarchie des sexes déjà existante53.
2. Le droit d’être électrice
71 En revanche, les citoyennes iraniennes sont autorisées à voter quelle que soit leur
religion54. En réalité, c’est en 1963 que les femmes ont obtenu le droit de vote malgré
l’opposition de l’ayatollah Khomeiny et du clergé de haut rang 55. L’ayatollah Khomeiny,
en adressant un télégramme au Chah d’Iran, avait déclaré que l’octroi des droits
politiques aux femmes était incompatible avec l’islam :
72 « En octroyant le droit de vote aux femmes, le gouvernement a enfreint l’islam et a provoqué
l’inquiétude des oulémas et autres musulmans56 .»
73 Cependant, après l’établissement du régime islamique et malgré la régression des droits
des femmes, le droit de vote a été maintenu. Par conséquent, les citoyennes iraniennes
ont le droit de se rendre aux urnes et de participer aux élections des conseils locaux,
lors des élections municipales, aux élections législatives, aux élections présidentielles,
aux élections de l’Assemblée des experts ainsi qu’aux référendums 57.
74 En revanche, l’exercice du droit de vote est dorénavant freiné par une sélection des
candidats en fonction de critères prédéterminés, subjectifs et discriminatoires. Avant
chaque élection, un choix est opéré par les organes de contrôle parmi ceux qui
postulent à un poste éligible. A titre d’exemple, pour l’élection législative, aux termes
de l’article 99, le Conseil gardien supervise les candidatures, écarte certaines personnes
en fonction de leur religion, de leur l’opinion politique ou de son expression... Par
conséquent, la restriction imposée limite le choix des électeurs. Une telle pratique va à
l’encontre de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politique.
75 En somme, la Constitution prive les femmes du droit prendre part à la direction des
affaires publiques. Le droit de vote et le droit d’accéder, dans des conditions générales
d’égalité, à des fonctions nationales, ne sont pas assurés pour les femmes 58. Comme le
souligne à juste titre le professeur Kian-Thiebaud, « la révolution de 1979 a
institutionnalisé les inégalités entre les sexes59 ».
B. Des inégalités fondées sur la religion
76 Par ailleurs, le constituant religieux a créé juridiquement une distinction fondée sur la
religion et la croyance des iraniens. Cette distinction aboutit à des limitations et
restrictions de la pleine jouissance des droits des citoyens selon leur appartenance
religieuse. De ce fait, le statut juridique des adeptes de l’islam (1) est différent de celui
des non-musulmans (2).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
201
1. Le statut juridique des musulmans et les différences d’accès aux droits selon
l’obédience religieuse
77 L’article 12 de la Constitution dispose que « la religion officielle de l’Iran est l’islam de
confession chiite Dja’farite duodécimain, et que « cet article est éternellement
immuable ». Comme le Comité des droits de l’homme le souligne, la reconnaissance
d’une religion donnée dans la Constitution n’est pas elle-même discriminatoire 60.
Pourtant, le constituant religieux ne s’arrête pas à la seule reconnaissance d’une
religion donnée comme religion d’Etat. Il va plus loin, accordant certains privilèges aux
membres de la religion prédominante et officielle du pays.
a) La différence entre les musulmans dans l’exercice des droits
78 La Constitution, dans cet article 12, opère une distinction entre musulmans de croyance
chiite et sunnite, et énumère cinq confessions religieuses susceptibles de bénéficier
d’une liberté confessionnelle. Quatre écoles sunnites y sont énumérées : Hanéfite,
Chaféite, Malékite et Hanbalite, le constituant énonçant « qu’elles bénéficient d’un respect
intégrale ». D’après le constituant, les adeptes de ces confessions sont libres d’accomplir
leurs rites religieux selon leur jurisprudence religieuse fiqh. Ils sont libres de décider de
leur éducation et de leur instruction religieuse, ainsi que de leur statut personnel
(mariage, divorce, succession, testament) et le contentieux judiciaire qui peuvent
découler de ce statut sont reconnus officiellement… Outre ces quatre écoles sunnites,
est mentionné à leur côté le nom d’une obédience chiite dite Zaydite. L’article 12
reconnait des droits et libertés à ces cinq obédiences.
79 S’agissant de à la jouissance des droits et libertés, le constituant ne prévoit pas une
égale protection de la Constitution. Selon le constituant, seuls les cinq adeptes
énumérés dans cette disposition bénéficient d’un égal respect dont les conséquences
juridiques diffèrent de la protection égale énoncée par l’article 26 du pacte. L’égalité
formelle n’est donc pas non plus garantie entièrement pour les cinq adeptes énumérés
par l’article 12 de la Constitution. Dès lors, cela va de soi, l’article 12 de la Constitution
limite la portée de l’article 19. Autrement dit, s’agissant des citoyens musulmans non
chiites reconnus par la Constitution, le constituant précise qu’ils sont respectés, mais il
ne dit pas qu’ils sont égaux avec les citoyens chiites de la confession D’jafarite
duodécimain. Les différences quant aux conséquences juridiques des deux concepts sont
flagrantes.
80 Par ailleurs, le constituant religieux n’énumère qu’une seul confession de l’islam chiite,
ainsi que quatre écoles sunnites. Il exclut ainsi de la jouissance des droits et libertés
constitutionnels aux autres obédiences de l’islam (par exemple, l’obédience ismaélite
issue de l’islam chiite, est exclue)61.
b) Le privilège accordé à la religion d’Etat chiite Dja’farite duodécimain
81 Le rédacteur de la Constitution manifeste une volonté délibérée d’accorder des
privilèges à la religion d’Etat, en l’occurrence l’obédience chiite Dja’farite duodécimain.
Comme on l’a mentionné précédemment, l’éligibilité à la présidence ou l’accès à
certaines fonctions publiques sont exclusivement réservés aux croyants de cette
religion.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
202
82 Depuis la révolution 1979, en outre, la pratique du régime affirme aussi une distinction
au bénéfice de la religion officielle puisque les musulmans ayant une autre confession
que chiite Dja’farite duodécimain sont exclus des postes de Guide suprême, du Conseil des
gardiens, du Conseil pour le discernement de l’intérêt du régime islamique et de chef
du pouvoir judiciaire. Dans la Constitution, on constate une distinction entre les
croyants de différents courants de l’islam.
2. Le statut juridique des non-musulmans : une différence de traitement
83 L’application de la norme d’égale protection de la loi se trouve davantage restreinte
pour les Iraniens non musulmans. La Constitution distingue implicitement mais
clairement les non-musulmans en deux catégories : les non-musulmans reconnus par la
Constitution (a) et les non-musulmans non reconnus par elle et dépourvus de droits.
a) Les non-musulmans reconnus par la Constitution
84 En la matière, l’article 13 dispose : « Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont
reconnus comme les seules minorités religieuses qui, dans les limites de la loi, sont
libres d’accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à l’éducation
religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie ».
85 Plusieurs éléments peuvent être soulignés au sujet de cet article. D’une part, les
minorités reconnues dans cet article sont certes « libres d’accomplir leurs rites
religieux », mais cette liberté est définie par des lois qui ne sont ni claires ni précises.
D’autre part, pour ces mêmes minorités religieuses, l’article est également très ambigu
sur leur droit de manifester leur conviction. En effet, comme le signale à juste titre le
professeur Sudre en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme: « le droit de manifester sa religion inclut […] ‘ le droit d’essayer de
convaincre son prochain’, protégeant en conséquence le prosélytisme 62». Or, en Iran, la
réponse à la question de savoir si « les minorités religieuses reconnues par l’article 13
sont libres de convertir les autres citoyens - y compris les Iraniens musulmans- à leurs
religions »63 n’est pas claire. En outre, un défi majeur demeure car, si le constituant se
contente de reconnaître des minorités religieuses en leur accordant quelques libertés,
cela n’implique pas une égale protection de la loi quant à la pleine jouissance des droits
et libertés prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
86 De nombreux exemples peuvent illustrer le non-respect de la norme d’égale protection
de la loi vis-à-vis des non-musulmans et des minorités religieuses dans les lois
ordinaires, comme le Code civil et le Code pénal, ce qui instaure une discrimination
légale envers les minorités religieuses reconnues par l’article 13 : « la religion de
l’auteur ou de la victime de l’homicide volontaire ou involontaire influe » notamment
« sur la réponse pénale en droit iranien64 ». Enfin, l’une des critiques adressées au
constituant religieux réside aussi dans l’exclusivité65 de la reconnaissance du statut de
minorités religieuses aux seules trois anciennes religions monothéistes.
b) L’absence de reconnaissance des non-musulmans dans la Constitution
87 Force est de constater que le constituant, en mettant l’accent sur « les seules minorités
religieuses reconnues », écarte les citoyens non musulmans ayant une autre confession
que celles énumérées par la Constitution. Les adeptes d’autres religions - comme les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
203
Bahaïs66, Mandâiyyaân (adeptes du mandéisme)67, les Yârsân68…- se retrouvent sans
aucune protection légale.
88 Face à ce constat, certains auteurs soutiennent que l’absence de prise en compte
d’autres religions par l’article 13 pourrait être compensée par l’article 20 de la
Constitution selon lequel, on le rappelle, tous les hommes bénéficient de façon égale de
la protection de la loi et jouissent de tous les droits, mais « dans le respect des « critères
de l’Islam », entendu dans le respect de la pratique religieuse islamique telle qu’instituée
par la Révolution. La solution proposée ne comble toutefois pas le vide juridique. Nous
avons déjà souligné que les termes « dans le respect des critères de l’islam » constituent un
obstacle à l’application et la garantie d’une égale protection de la loi. C’est une
expression vague et imprécise. En prenant en considération l’ensemble des lois
iraniennes, les adeptes des nouvelles religions - y compris des religions nées après
l’islam- ne sont pas protégés, et sont même parfois considérés comme des hérétiques en
vertu de certaines interprétations de ces critères. A tout le moins, en ce qui concerne
l’égalité formelle, ils ne sont pas protégés au même titre que les citoyens pratiquant la
religion officielle.
89 La préférence des rédacteurs de la Constitution pour les anciennes religions
monothéistes reconnues par l’islam – bien qu’il ne les protège pas au même titre que les
citoyens musulmans chiites de confession D’jafarite duodécimain – est évidente et a pour
but d’écarter les nouvelles religions. Un constat comparable s’applique aux citoyens
non-croyants ou aux athées. L’article 20 ne pourrait non plus s’appliquer aux athées, du
fait du « respect des critères de l’islam ».
90 En somme, bien que le constituant religieux prétende avoir assuré l’égalité formelle aux
termes des articles 19 et 20 de la Constitution, le corpus constitutionnel (l’unité du
texte constitutionnel) montre que la norme fondamentale et indérogeable d’égale
protection de la loi n’emporte pas d’obligation constitutionnelle effective. A contrario, en
se fondant sur la nature idéologique de la révolution islamique de 1979 et sur des
prescriptions religieuses, le pouvoir constituant a institué une discrimination entre les
iraniens (citoyens) en plaçant certains individus dans une situation de supériorité
juridique. Une discrimination de jure, résultant des différences de traitement fondées,
implicitement et explicitement, sur les critères de sexe, de religion et de conviction qui
ne sont ni raisonnablement ni objectivement justifiées. Au regard du postulat général de
l’égale dignité de tous les êtres humains69 issu des engagements de l’Iran envers PIDCP ainsi
que d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme, une
révision constitutionnelle nous parait donc nécessaire.
NOTES
1. DJALILI Mohamad-Reza, «Dimension internationales de la révolution islamique », in SFDI,
Révolution et droit international : Colloque de Dijon, Paris, Pedone, 1989, pp. 129-143.
2. Selon certains auteurs, ce régime s’est construit à partir des rapports de force établis, après la
Révolution, entre les différents courants politiques qui l’avaient conduit à la victoire, et
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
204
différents groupes d’opposition de gauche ou de droite. Cf. PARHAM Ramin et TAUBMANN
Michel, L’histoire secrète de la Révolution iranienne, Paris, Denoël, 2009. Selon le professeur
Khosrokhavar « l’élan révolutionnaire de 1979 débute par le mouvement de protestation d’un groupe
restreint d’intellectuels laïques, une année avant la révolution islamique. En ce moment, les islamistes n’ont
encore aucune présence massive sur la scène sociale. » KHOSROKHAVAR Fardad, « Les intellectuels
post-islamistes en Iran », in Le Trimestre du monde, 1994, p. 59. Sur l’histoire de la Révolution
iranienne Cf. AMIRARJPMAND Saïd, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, New
York, Oxford University Press, 1998, p. 283. Pour une analyse sociologique de la révolution
iranienne Cf. KHOSROKHAVAR Farhad, L’utopie sacrifiée : sociologie de la révolution iranienne, Paris,
Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1993, p. 337. Du même auteur Cf.
L’anthropologie de la révolution iranienne : le rêve impossible, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 271.
Egalement l’article de KHOSROKHAVAR Farhad, « révolution française et révolution islamique,
esquisse d’une comparaison », in L’image de la Révolution française : communication/ présentées lors
du Congrès mondial pour le bicentenaire de la Révolution, Michel VOVELLE (dir.), Sorbonne, Paris, 6-12
juillet 1989. pp. 1841-8. Voir aussi, FOULADVIND Hamed, « les jacobins de l’islam : éléments pour
une approche comparative», Ibid. p. 1849. Cf. DELANNOY Christian et RICHARD Jean-Pierre,
Khomeiny : la Révolution trahie, Paris, Éditions Carrère, 1988.
3. CLARET DE FLEURIEU Marie, L’Etat musulman, entre l’idéal islamique et les contraintes du monde
temporel : la relativité de l’impact de l’islam sur le droit constitutionnel des Etats musulmans, Thèse de
doctorat, Droit public, Université René Descartes, Paris 5, I vol, 2009, p. 222. Elle comporte un
préambule, 14 chapitres, et 177 articles. (« Principes généraux », « Les droit à la nation », « Le droit de
souveraineté populaire et les pouvoirs qui en découlent », « La révision de la Constitution »,…), ibid.
4. DJALILI Mohamad-Reza, «Dimension internationales de la révolution islamique », in SFDI,
Révolution et droit international : Colloque de Dijon, op.cit., pp. 130 et 131.
5. Il faut noter que pour la première fois c’est l’article 2 de la Constitution de 1906-1907 qui
prévoit l’interdiction pour l’Assemblée nationale d’adopter des lois contraires aux règles de
l’islam. Cela a été introduit dans la Constitution par les clergés chiites.
6. AUBIN Claire et JOLY Benjamin, « De l’égalité à la non-discrimination : le développement d’une
politique européenne et ses effets sur l’approche française, in Droit Social, n° 12, décembre 2007,
p. 1295. Pour une comparaison entre la révolution iranienne et la révolution française voir
l’article : AULAGNE Françoise et GOLDSTONE Jack, « Révolutions dans l’histoire et l’histoire de la
révolution », in Revue française de sociologie, n° 30-3-4,1989. pp. 405-429.
7. L’actuel président de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), M. Karim
Lahidji, a fait partie des cinq membres de l’Assemblée constituante. Au fil de l’évolution du
régime politique il a dû s’exiler en France en 1982. SCHIRAZI Asghar, The Constitution of Iran.
Politics and State in the Islamic Republic (traduit de l’allemand par John O’Kane), Londres-New York,
I.B. Tauris, 1998.
8. SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 9 e éd. Paris, PUF, 2012, p.
269. Voir également Obs. gén. n°18, CCPR/C/21/Rev. (Non-discrimination), par. 2. 19 mai 1989.
9. DE SCHUTTER Olivier, « article 26 », in Le pacte international relatif aux droits civils et politique :
Commentaire article par article, DECAUX Emmanuel (dir.), Paris, Economica, 2011, p. 580.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. L’article 7 de la DUDH prévoit que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».
13. Nous nous bornons à examiner la constitution car l’analyse de l’ensemble de la législation
iranienne nécessite une étude vaste et approfondie. Néanmoins au cours de la présente étude,
quelques exemples seront avancés afin de renforcer les arguments présentés.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
205
14. Cela a été relevé par les membres du Comité des droits de l’homme à plusieurs reprises : la
Constitution ne précise pas qu’il ne saurait y avoir de discriminations fondées sur le sexe ou la
religion. Cf., CCPR/C/28/Add.15.
15. 6e rapport périodique d’Iran, CERD/C/66/Add.5, soumis le 28 décembre 1979.
16. Ibid.
17. 8e rapport périodique d’Iran, CERD/C/118/Add.12, soumis le 20 juin 1984.
18. La population iranienne est constituée de diverses ethnies et langues dont les Arabes, les
Azéris, les Baloutches, les Kurdes, les Lors, les Perses, les Turkmènes, etc. Cf. CERD/C/IRN/20 et
CERD/C/IRN/18-19, 7 November 2008.
19. Cf., DOLATRAFTAR HAGHIGHI Mohamad-reza, Human Rights in Contemporary World, Viewpoints
of Iranian Lawyers & Islamic Scholars: On the Occasion of the 60th Anniversary of DUHR, Qom, Etnésharté
aain-é-ahmad, 2009, p. 459.
20. Nous allons étudier quelques dispositions discriminatoires de la Constitution qui, n’ont pas de
justifications objectives et raisonnables, dans la deuxième partie de cette étude.
21. Cf., DOLATRAFTAR HAGHIGHI Mohamad-reza, Human Rights in Contemporary World, Viewpoints
of Iranian Lawyers & Islamic Scholars: On the Occasion of the 60th Anniversary of DUHR, Qom, Etnésharté
aain-é-ahmad, 2009, p.459.
22. De nombreux exemples dans différentes lois iraniennes peuvent illustrer cette discrimination
fondée directement sur le sexe la religion ou l’opinion politique. On peut signaler à titre
d’exemple un traitement différent suivant le sexe ou la religion de l’individu en droit pénal
iranien. « le sexe féminin de l’auteur ou de la victime de certaines infraction [,,,]influe sur le traitement
pénal qui leur est réservé ; ou bien la religion de l’auteur ou de la victime de l’homicide volontaire ou
involontaire influe également sur la réponse pénale en droit iranien. », NADJAFI Ali-Hossein, « La
réception des instruments internationaux en droit pénal iranien : une réception tumultueuse » in
Archives de politique criminelle, n° 25, 2003/1. p.190. URL : www.cairn.info/revue-archives-de-
politique-criminelle-2003-1-page-183.htm. Au sein de la législation iranienne, on peut également
donner l’exemple des enfants nés hors mariage, discriminés par rapport aux enfants issus d’une
union maritale.
23. Dans une perspective historique il est important de signaler qu’avant la révolution les
femmes iraniennes n’avaient obtenu leur droit d’éligibilité qu’en 1963. En 1975, on comptait trois
femmes au Sénat. Voir KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Des résistances conservatrices à la citoyenneté
politique des femmes », in Femmes et parlements. Un regard international, TREMBLAY Manon (dir.),
Montréal. Éditions du Remue-ménage, 2005, pp. 225-249.
24. TOHIDI Nayereh, « Iran country rating», in Women’s rights in Middle East and North Africa:
Progress Amid Resistance. Freedom in the World, KELLY Sanja and BRESLIN (dir.), Lanham Maryland,
Rowman Littlefield Publishers, 2010, pp.125.
25. L’article 114 de la constitution stipule que : « le président de la république est élu au suffrage
universel direct pour une période de quatre ans et sa réélection consécutive n’est possible que pour un seul
mandat. »
26. Le critère d’« origine iranienne » implique une double discrimination : d’une part,
envers les femmes (car la famille du candidat doit avoir une « origine paternelle
iranienne », ce qui constitue une discrimination directement fondée sur le sexe) ;
d’autre part, envers les citoyens de nationalité iranienne qui ne sont pas d’origine
iranienne (condition également imparfaitement définie dans la Constitution).
Toutefois, selon le professeur Hachemi, le critère d’origine iranienne va au-delà de la
nationalité par filiation. Le candidat doit être né d’un père et aussi d’un grand-père
paternel de nationalité iranienne par filiation. Autrement dit, dans le cas où le grand-
père aurait acquis la nationalité iranienne, le candidat ne saurait pas être considéré
d’origine iranienne, et donc ne remplirait pas la « condition d’origine iranienne ».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
206
HACHEMI S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, Tome II,
Téhéran, Dadgostar, 199, pp. 334.
27. Pour aller plus loin, voir KAR Mehrangiz, rafa’-é tab’eez az zanan, Muqayesey-é konvansion-é rafa’
tab’eez az zanan ba qawaniné dakheliy-é Iran (L’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes : la comparaison entre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et les lois internes en Iran), Téhéran, Nachr-é ghatreh (203),
2000. Et REISI Mahdi, Barresi-é féqhi va hoqouqi-é élhaq ya adam-é élhaq-é- jomhouri-é éslami-é
Iran bé konvansion-é rafé koliéh-é- ashkalé tab’eez alayheh zana (la convention sur les femmes :
une étude de Charia et de droit de l’adhésion ou non-adhésion d’Iran à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), Nachr-é Nasim-é quds,
2003.
28. HACHEMI S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, op.cit., p. 335.
29. Ibid.
30. KAR Mehrangiz, L’élimination de discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les lois internes
en Iran, op.cit.,
31. HACHEMI, S.M, Droit constitutionnel iranien : Souveraineté et institutions politiques, op.cit., p. 335.
32. SCHIRAZI Asghar, Nézâm-e Hokumati-ye Jomhouri-ye Eslâmi-ye Iran : Din, Qânoun va
Motlaqiyyat-e Qodrat. Vincennes, Cesmandaz, 2009, p.27. Pour la version anglaise cf. The
Constitution of Iran. Politics and State in the Islamic Republic (traduit de l’allemand par John O’Kane),
Londres-New York, I.B. Tauris, 1998.
33. Dans une perspective comparative, le Conseil gardien serait l’équivalent du conseil
constitutionnel en France. Aux termes de l’article 91 de la constitution, le Conseil gardien est
chargé de juger la compatibilité des lois avec la Constitution et la charia. Dans le projet de loi
constitutionnelle original, le Conseil gardien a été inspiré du modèle du Conseil constitutionnel
français de la Constitution de Ve République. VIJEH Mohammad-Réza, « Contribution sur le
Conseil gardien de la constitution Iranienne et l’Etat de droit », VI -e congrès français de droit
constitutionnel, Montpellier, juin 2005.
34. 47 femmes en 2001, 89 femmes en 2005, 42 femmes en 2009, ont présenté leur candidature à
l’élection présidentielle. Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle
forme d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale, n° 46,
2010, p. 57. (Disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-critique-
internationale-2010-1-page-45.htm)
35. Article 107 de la Constitution.
36. L’article 177 de la Constitution prévoit les modalités de la révision.
37. Mojtahide est celui qui produit l’effort de réflexion de l’idjtihade
38. L’effort d’interprétation des docteurs de la foi (étude individuelle des sources religieuses).
39. Voir Kar Meherangiz, L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : la comparaison entre
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les lois
internes en Iran, op.cit. Pour ce groupe « dans les principaux textes islamiques, rien ne prouve ou ne
justifie le fait que l’islam interdise aux femmes de délivrer des édits religieux ou de devenir des sources
d’imitation. En revanche, dans les sources secondaires[les interprétations des autorités religieuses],
quelques indications existent.» Les phrases mentionnées appartiendraient au Hojjt-ol Eslam Mohsen
Saidzadeh qui avait publié un article à propos du droit des femmes à l’accès à la magistrature
dans un magazine iranien sous pseudonyme en 1992. Il avait été traduit devant le Tribunal du clergé,
emprisonné et défroqué en juin 1998 pour ses visions réformistes. » KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le
féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d’assujettissement ou émergence de sujets
agissants ?, op.cit., p.61.
40. D’après la Constitution iranienne pendant l’absence de l’imâm caché, c’est le Vali-é-faqih (le
guide suprême) qui gouverne l’Etat islamique. En effet, cette notion de la tutelle absolue du
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
207
jurisconsulte religieux réalisée dans la Constitution iranienne est récente et revient à la base de
l’islam chiite. Pour B. AGAHI-ALAOUI : « Selon le chiisme pour que la Communauté chiite ne soit pas
privée de guide, pendant la période d’occultation du douzième imâm caché, le imâmat ou la wilâyat
[velâyate] revient à un faqih que les croyants considèrent comme leur guide. Un tel Guide est considéré
comme représentant intermédiaire de l’imâm caché ; il a la mission de guider et de protéger la communauté
chiite, en attendant l’instauration de la justice absolue après le retour de l’imâm caché. » AGAHI-ALAOUI
Bahieh, L’autorité maritale en droit iranien et marocain, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 29. Il convient de
mentionner que c’est l’ayatollah Khomeiny qui est à l’origine du concept du velâyat-é-faqih (la
tutelle de jurisconsulte religieux- concept qui, avec l’amendement de la constitution en 1989, prend
la forme d’une tutelle absolue du jurisconsulte religieux).
41. Article 57 : « Les pouvoirs souverains dans la République islamique d’Iran sont le pouvoir législatif, le
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui sont exercés sous le contrôle de la Tutelle absolue du
jurisconsulte (Vélayaté Motlaghéye Amr) et du Guide divin de la communauté islamique des croyants
(Emmamaté Ommat), conformément aux articles suivants de la présente loi. Ces pouvoirs sont
indépendants l’un de l’autre ».
42. HACHEMI, op. cit., p.44. C’est une comparaison qui suscite des controverses. Un paradoxe lié
au processus de désignation est évident car les candidats à l’Assemblée des experts, avant leur
élection par le peuple, doivent être approuvés par le Conseil gardien de la Constitution, dont six
des douze membres sont désignés par le Guide suprême.
43. Kar Mehrangiz, op. cit., pp. 157-158. Il convient de préciser qu’en Iran les femmes peuvent
être nommées magistrate consultative, mais ne peuvent pas être nommées juge. Les minorités
religieuses non-musulmanes, non plus, n’ont pas accès aux postes de la magistrature.
44. Ce sujet controversé a également des répercussions sur la magistrature des femmes
au niveau international. Dans l’esprit que les femmes ne peuvent pas être juges et avoir
accès à la magistrature, les efforts accomplis par la délégation iranienne lors de la
Conférence de Rome pour la création de la Cour pénale internationale sont significatifs.
Durant le débat sur l’article 36 du Statut de Rome – qui décrit les critères de
qualification pour le poste de juge –, la délégation iranienne et ses alliés,
majoritairement musulmans, ont exercé une grande pression pour imposer leurs vues.
Plus précisément, l’article 36.8 a iii a été ciblé pour que les femmes et les hommes ne
soient pas paritairement représentés dans la Cour. A la demande de la délégation
iranienne, le terme de parité a été supprimé et remplacé par équitable. L’article 36.8 a iii
a établi ainsi que, « dans le choix de juges, les Etats-parties tiennent compte de la nécessité
d’assurer une représentation équitable des hommes et des femmes ». La délégation iranienne a
fait valoir que, dans les pays en développement, le taux de femmes instruites et
compétentes pour le poste de juge était très faible. Finalement, les autres Etats se sont
inclinés devant les arguments et l’exigence de la délégation iranienne, consentant à une
limitation du nombre de femmes juges au sein de Cour. ALE HABIB Eshaq, International
Criminal Court and Islamic Republic of Iran, Tehran, Institute for Political and
International Studies of the Ministry of Foreign Affairs, 1999, p. 514.
45. Coran, « Les femmes », sourate 4, verset 34.
46. Coran, « La vache », sourate 2, verset 228.
47. REISI Mahdi, Barrasi-é féqhi va hoqouqi-é élhaq ya adam-é élhaq-é jomhouri-é éslami-é Iran bh
konvention-é raf’-é koliéh achkal-é tabiz alayhé zanan (Etude sur le droit et de faqih pour l’adhésion
et non-adhésion de la République islamique d’Iran à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes), Qom, Nasim-é quds, 2009, pp.79-80
48. En ce qui concerne l’interprétation de ces versets, il existe deux courants : celui qui affirme
que la prédominance des hommes sur les femmes est limitée à la vie familiale, et celui qui étend
leur domination à la sphère publique.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
208
49. AGAHI-ALAOUI Bahieh, L’autorité maritale en droit iranien et marocain, op.cit.
50. Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme
d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale, n° 46, 2010, pp.
45-66. Disponible en ligne sur : http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1-
page-45.htm
51. A propos de consensus en islam, voir BERNAND-Baladi Marie, « L’Ijma, critères de validité
juridique », in CHARNAY Jean Paul (dir.) Normes et valeurs dans l’islam contemporain, Payot, 1966.
52. Les musulmans sunnites sont aussi autorisés à se présenter à l’élection de l’Assemblée des
experts.
53. Hiérarchie des sexes est un terme employé par la sociologue Chahla CHAFIQ dans un article
publié le 06/02/2014 dans Le monde avec l’intitulé « Théorie » du genre : Ce que révèle l’alliance de
certains musulmans avec la droite réactionnaire ».
54. Cf. Observation générale n°25 CCPR/C/21/Rev .1/Add.7 du 27 août 1996.
55. KIAN-THIEBAUD Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme
d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale. Op.cit., pp.48-49.
56. Cité par KIAN-THIEBAUD Azadeh, ibid. Cf. KIAN-THIEBAUT Azadeh, « Des résistances
conservatrices à la citoyenneté politiques des femmes », in TREMBLY Manon (dir.), Femmes et
parlements. Un regard international, Montréal, Editions du Remue-ménage, 2005, pp. 225-249.
57. Il est important de souligner que, suivant les discours du Guide suprême et les appels
présentés par les Imams lors de la prière de vendredi, se rendre aux urnes est devenu un devoir
religieux pour l’ensemble des citoyens iraniens. Ce qui peut expliquer l’importance, pour le
régime, de la présence massive des femmes, en vue de lui conférer une plus grande façade de
légitimité.
58. Cf. Obs. gén. n°28 CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (égalité des droits entre hommes et femmes
(art.3)) du 29 mars 2000. Comme on en a donné déjà quelques exemples, il existe une
différence de traitement entre les hommes et les femmes dans les différentes
dispositions législatives. Par exemple, pour un crime, le témoignage de la femme n’a de
valeur juridique, ou le témoignage de deux femmes a une valeur équivalente à celui
d’un seul homme, les lois restreignant l’exercice du droit des femmes à la liberté de
circulation, etc. Il faut souligner que, dans le préambule de la Constitution, dans un
chapitre consacré à aux femmes sous l’intitulé « les femmes dans la constitution », le
constituant religieux défini les femmes comme mères et femmes au foyer, dévouées au
service de la famille et à la défense d’une idéologie spécifique. « La famille est l'unité de
base de la société et le foyer principal de la croissance et de l'élévation de l’Homme ; et l'entente
idéologique et idéale est un principe fondamental dans la fondation de la famille, qui est le
principal facteur constructif du mouvement évolutif et progressif de l’Homme ; fournir des
moyens destinés à atteindre cet objectif fait partie des tâches de l'Etat islamique. La femme, dans
cette conception de l'unité familiale, quitte son état "d'objet" ou "d'instrument de travail" au
service du développement de la consommation et de l'exploitation, et tout en retrouvant son
devoir précieux et estimable de mère dans l'éducation des êtres idéologiques d'avant-garde, elle
combat aux côtés des hommes dans les domaines actifs de l'existence; en conséquence, elle
assumera une responsabilité plus noble et une valeur et une munificence plus grande lui seront
reconnues du point de vue islamique ». On constate que le constituant définit
explicitement et implicitement les droits et les devoirs des femmes au sein de la famille
comme devant servir des buts idéologiques. Cf. KOOHESTANI Amin Reza, « Towards
Substantive Equality in Iranian Constitutional Discourse », in Muslim World journal of
Human Rights, Vol.7, Iss.2, Article 2, 2011.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
209
59. KIAN-THIEBAUD Azadeh, « Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme
d’assujettissement ou émergence de sujets agissants ? », in Critique internationale, op.cit.,
p. 51.
60. Le Comité des droits de l’homme, dans son observation n°22, souligne que la
reconnaissance d’une religion comme religion d’Etat ne doit pas entraver la jouissance
de l’un quelconque des droits énoncés dans le pacte, ni entraîner une discrimination
quelconque envers les adeptes d’autres religions ou envers les non-croyants, car le
droit à la liberté de religion et de conviction et l’interdiction de la discrimination ne
sont pas subordonnés à la condition que ladite religion ou conviction soit officiellement
reconnue. Cf. Obs. gén. n°22, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (le droit à la liberté de pensées, de
conscience et de religion (Art.18)) 27 septembre 1993.
61. Au cours de l’interview réalisée avec le magistrat et avocat du barreau de Téhéran
Hedayatolah Matin-daftari, ce magistrat a confirmé que les autres minorités chiites, tels les
ismaélites, ne sont pas reconnues dans la Constitution.
62. SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 9 e éd. Paris, Presses
universitaires de France, 2012, pp. 512-513.
63. LAHIDJI Abdolkarim, La démocratie et les droits de l’homme en Iran ; la troisième décennie
de la République islamique, Paris, éditions Khavaran, 2010, p. 392. Précisions que les
minorités religieuses reconnues par la Constitution ont le droit de siéger au Parlement.
Ils sont représentés comme suite : les Zoroastriens un député, les Juifs un député, les
Chrétiens assyriens et kaldanites un député, les Arméniens des régions du Nord un
député et enfin, les Arméniens des régions du Sud un député. Mais leur pouvoir à
l’Assemblée consultative islamique (Parlement) est limité par la charia du fait du
contrôle du Conseil des gardiens.
64. ADJAFI Ali-Hossein, « La réception des instruments internationaux en droit pénal iranien :
une réception tumultueuse » in Archives de politique criminelle, op. cit., p. 6.
65. LAHIDJI Abdolkarim, La démocratie et les droits de l’homme en Iran ; la troisième décennie de la
République islamique, op. cit., pp. 392.
66. GHANEA-HERCOCK Nazila, «Human rights, the UN and the Bahia’s in Iran », Royaume-Uni,
Oxford, 2002, p. 628.
67. Pour aller plus loin, cf. E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran: Their Cults, Customs, Magic,
Legends, and Folklore, Leiden, E.J.Brill, 1962. Disponible en ligne à l’adresse : https://archive.org/
details/MN41560ucmf_1,
68. Pour aller plus loin Cf. VALI Shahab, Les figures de l'Iran pré-islamique dans la littérature des
Ŷarsâns, courant religieux kurde, Thèse de doctorat, Sciences religieuses, Paris, EPHE, 2008.
69. SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, ibid., p.269.
ABSTRACTS
After the Islamic revolution of Iran in 1979, the principle of formal equality was imprecisely
defined in the new Constitution. This vagueness creates controversy. The article examines the
principle of formal equality in the Iranian Constitution, and the reasons the ambiguity affects its
definition and application. The study is based on Article 26 of the International Covenant on Civil
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
210
and Political Rights 1966 (ratified by Iran), which provides the standard of being entitled to the
equal protection of the law. The findings show that the Iranian Constitution does not meet the
requirements of the principle of formal equality established by the Article 26 of the ICCPR. This
conclusion can be drawn on the basis of analysing the Sharia law–based Constitution, which
discriminates individuals on the basis of sex, religion and political opinion. In addition, the
conclusion is supported by the review of speeches and documents submitted by Iran before the
UN bodies. The study argues that the Constitution and some elements of Iranian legislation
should be amended to reflect international norms.
Le droit à l’égalité est au fondement de la création des dispositions visant à assurer la protection
des droits de l’homme. Après la Révolution islamique de 1979 en Iran, les promoteurs de la
Constitution iranienne ont défini le principe d’égalité formelle de façon très imprécise. Ce manque
de précision a suscité nombre de controverses.
Le présent article examine ce principe d’égalité formelle tel qu’il est développé dans la Constitution
iranienne, ainsi que les raisons de l’ambiguïté dont souffrent sa définition et son application.
L’étude se fonde sur l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966 (ratifié par l’Iran), qui prévoit la norme d’égale protection de la loi.
En nous attachant à son étude, ainsi qu’à celle des législations, discours et documents présentés
par les autorités iraniennes devant les instances onusiennes, nous avons constaté que le principe
d’égalité formelle n’est pas assuré par la Constitution iranienne.
Fondée sur la charia, la protection que cette dernière accorde aux citoyens est discriminatoire ou
lacunaire, différente selon leur sexe, leur religion ou leurs convictions et opinions politiques.
Une révision de la Constitution et de l’ensemble de la législation iranienne se révèle dès lors
nécessaire.
El derecho a la igualdad está a la base de la creación de los dispositivos que tienen como meta
asegurar la protección de los derechos humanos. Después de la Revolución islámica de 1979 en
Irán, los promotores de la Constitución iraní definieron al principio de igualdad formal de manera
muy imprecisa. Esta falta de precisión suscitando muchas controversias. Este artículo examina al
principio de igualdad formal tal como se desarrolla en la Constitución iraní, así como también las
razones de la ambigüedad de su definición y de su aplicación. El estudio se funda en el artículo 26
del Pacto Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por Irán),
que prevé la norma de igual protección de la ley. Estudiando este instrumento jurídico internacional
al mismo tiempo que las legislaciones, discursos y documentos presentados por las autoridades
iraníes ante las instancias de las Naciones Unidas, constatamos que el principio de igualdad
formal no está garantizado por la Constitución de Irán. Fundada en la charia, la protección que
esta última concede a los ciudadanos es discriminatoria o deficiente, presentando diferencias
según el sexo, la religión o las convicciones y opiniones políticas de los ciudadanos. Se revela
entonces una necesaria revisión de la Constitución y del conjunto de la legislación iraní.
INDEX
Mots-clés: Egalité formelle - Révolution de 1979 - Constitution iranienne - Constituant religieux
- loi discriminatoire - Religion - Sexe - race - Distinction
Keywords: Formal equality - Revolution of 1979 - Iranian constitution - Conservative constituent
assembly -Discriminatory law - Religion - Gender (sex) - Race - Distinction
Palabras claves: Igualdad formal - Revolución de 1979 - Constitución iraní - Constituyente
religioso - Ley discriminatoria – Religión - Género (sexo) – Raza - Distinción
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
211
AUTHOR
HIVA KHEDRI
Hiva Khedri est doctorante au CREDOF.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
212
Analyses et libres propos
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
213
Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme:
particularités, percées et défis
Éric Tardif
Le développement du droit international des droits de l’homme est probablement l’une
des plus importantes avancées juridiques des XXème et XXIème siècles, et l’Amérique
latine a, sans doute aucun, joué un rôle important dans cette évolution. Comme
l’explique l’ancien président et actuel juge de la Cour interaméricaine, Diego GARCIA
SAYAN, c’est d’ailleurs en Amérique Latine, au début du XVIème siècle, que le concept
de ce qui est aujourd’hui connu comme droits de l’homme est né, quand Bartolomeo de
las Casas, défenseur des droits des peuples indigènes au début de la colonisation du
continent par la couronne espagnole, déclara que tous les êtres humains étaient égaux 1.
Plusieurs mécanismes de protection et mise en valeur des droits de l’homme existent
au niveau mondial ; cependant, seuls trois systèmes régionaux, présents sur les
continents européen, africain, et américain, ont mis en place des moyens
juridictionnels supranationaux permettant aux victimes présumées d’exiger que justice
leur soit rendue. Ce dernier système fait montre d’un dynamisme certain ; en
témoignent les nouveaux règlements internes de la Commission 2 et la Cour 3
interaméricaines en vigueur depuis 2010, le nombre croissant de cas entendus par la
Cour, qui a désormais franchi le cap des 100 affaires, la qualité de la jurisprudence dont
elle est la source et qui a renforcé sa réputation comme tribunal international 4, ainsi
que le modèle de réparations qu’elle a mis en place et qui est applaudi dans plusieurs
milieux5.
L’évaluation du fonctionnement du système interaméricain passe nécessairement par
deux étapes : un survol des instruments et organes qui le constituent (I), et l’analyse de
la pratique mise de l’avant par ses institutions qui nous permettra en particulier
d’étudier le régime des réparations, fleuron du système, tout comme les
développements qui se sont récemment produits en son sein (II).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
214
I. Initiation au système interaméricain
Le continent américain est sans conteste une terre de contrastes : 35 pays intègrent
l’Organisation des États américains (OÉA), depuis les tout-puissants États-Unis aux plus
modestes pays des Antilles, représentant des systèmes juridiques à développements
variables. Ses principaux organes sont l'Assemblée générale, qui tient une session
ordinaire annuellement, dans un pays de l’Organisation, et se réunit au besoin de façon
extraordinaire ; le Conseil permanent, qui relève directement de l’Assemblée, est
chargé de mettre en œuvre les décisions prises par elle ; le Comité juridique
interaméricain travaille quant à lui pour le développement progressif et la codification
du droit international, et étudie les problèmes juridiques ayant trait à l'intégration des
pays du continent6.
Le système interaméricain de protection des droits de l’homme est, plus
spécifiquement, basé sur une série de traités (A), et d’organes qui mettent en pratique
les dispositions qu’ils contiennent (B).
A. Évolution normative
L’ordre international issu de la fin de la seconde guerre mondiale motiva la convocation
de la Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et de la paix, tenue à
Mexico, durant laquelle on décida de la formation d’une organisation
intergouvernementale régionale, tout comme de la participation des États du continent
à l’ONU. Cette organisation, dont les objectifs principaux sont le renforcement de la
paix et la sécurité, la promotion et consolidation de la démocratie représentative et
l’éradication de la pauvreté extrême7, vit finalement le jour lorsque la Charte de l’OÉA8
fut adoptée lors de la 9ème Conférence internationale des États américains tenue à
Bogota (Colombie) en 1948. Lors de cette conférence, la Déclaration américaine des
droits et des devoirs de l’homme fut également approuvée, précédant ainsi de quelques
mois la Déclaration universelle des droits de l’homme9. Par ailleurs, l’acte final de la
Conférence de Bogota recommandait déjà la rédaction d’un statut portant création
d’une Cour en matière de droits de la personne, tâche qui fût confiée au Comité
juridique interaméricain10.
La Charte de l’OÉA ne prévoyait pas originellement d’institutions spécialisées en
matière de droits de la personne. En 1959, la Commission interaméricaine des droits de
l’homme fut établie par résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation, comme
un organe autonome de celle-ci, chargé de promouvoir le respect de ces droits sur le
continent11. En 1967, le Protocole de Buenos Aires, qui vint bonifier la Charte, faisait
allusion dans son article 112, à la Commission interaméricaine - dont la structure et les
compétences seraient définies dans un traité subséquent – enchâssant à toutes fins
pratiques cet organe dans l’instrument constitutif de l’Organisation. Ce traité de portée
générale en matière de droits de l’homme se concrétisa finalement en 1969, lors d’une
conférence tenue à San José (Costa Rica), et à laquelle fut convié René Cassin en tant
qu’expert12; l’approbation du texte final de la Convention américaine suivit de cette
façon le même cheminement que celui entrepris au sein de l’ONU qui, trois ans
auparavant avait adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 13. La
Convention américaine - aussi connue sous le nom de Pacte de San José - obtint
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
215
finalement la dernière ratification dont elle avait besoin pour entrer en vigueur en
1978 ; conséquemment, la Commission opéra durant deux décennies en l’absence d’un
instrument régional énonçant des obligations en matière de droits de l’homme liant
juridiquement les États membres de l’Organisation14.
S’agissant de son contenu, on soulignera que la Convention américaine, dans son
énumération des droits protégés, va plus loin que d’autres instruments internationaux
qui visent des objectifs similaires. Elle prévoit par exemple le droit de réplique à des
déclarations injurieuses réalisées dans les médias, et protège également mieux le droit
à la propriété15. Elle octroie en outre plus de protection que le Pacte onusien, en
particulier en ce qui a trait aux garanties judiciaires ou de la liberté d’expression ; dans
ce dernier cas, on peut aussi considérer que la Convention offre plus de protection que
son équivalent européen16. La Convention, à laquelle 23 États sont actuellement parties,
fut complétée par le Protocole additionnel à la Convention américaine traitant des
droits économiques, sociaux et culturels - Protocole de San Salvador - adopté en 1988 et
en vigueur depuis 1999, ainsi qu’un second protocole, sur l’abolition de la peine de
mort, signé en 1990 et entré en vigueur l’année suivante.
B. Organes clefs
Les deux organes principaux du système interaméricain sont donc la Commission,
ayant son siège à Washington, et la Cour, basée à San José (Costa Rica) ; chacune des
institutions tient cependant périodiquement des sessions dans divers pays membres de
l’OÉA. Ces organes sont tous deux composés de sept membres, nationaux des États de
l’organisation, et élus à titre personnel parmi les juristes de la plus haute autorité
morale et de compétence reconnue en matière de droits de l’homme; le mandat des
commissaires est de quatre ans alors que celui des juges est de six ans, tous pouvant
être réélus une fois.
1. La Commission
Tel qu’indiqué précédemment, la Commission interaméricaine devint un organe de
plein droit de l’OÉA quand les amendements à la Charte prévus par le Protocole de
Buenos Aires entrèrent en vigueur17.
Durant les trois premières décennies de son existence, le travail principal de la
Commission se résuma à l’émission de rapports concernant les efforts déployés par les
États pour mettre en œuvre les obligations acquises en matière des droits de l’homme,
identifiant les avancées et les défis caractérisant la situation de chaque pays membre,
bien qu’à partir de 1966, un système de plaintes ait été établi permettant aussi à la
Commission de recevoir des communications écrites acheminées par des individus,
mécanisme clef dans l’optique du développement du droit international des droits de
l’homme18. Ceci est sans contredit dû au fait que bien des États contre lesquels des
plaintes spécifiques étaient présentées refusaient de comparaître devant la
Commission, et que, par ailleurs, les violations commises dans plusieurs pays étaient
systématiques et pratiquées à grande échelle, faisant de l’étude de cas individuels un
procédé peu efficace pour faire face aux centaines, voire milliers de violations
rapportées à la Commission19.
La Commission considéra rapidement que sa mission incluait la supervision de la
situation propre à chaque État, par le biais, au besoin, de visites in situ, et la recherche
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
216
de solutions concrètes lorsqu’elle recevait des plaintes. Malgré le fait que les rapports
de la Commission aient été émis à titre consultatif, le fait de les rendre publics joua sans
contredit un rôle primordial de promotion du respect des droits de l’homme dans la
région, bien avant que des organisations comme Human Rights Watch ou Amnistie
internationale n’entreprennent d’élaborer et de diffuser des rapports similaires. Durant
les années 1970 en particulier, la Commission a su se tailler une place importante,
faisant face aux régimes dictatoriaux qui recouraient communément aux disparitions
forcées, à la torture et aux exécutions extra-judiciaires20. La Commission réalisa, entre
autres, une visite en Argentine en 1979, durant laquelle elle reçut plus de 5000 plaintes
individuelles, la plupart d’entre-elles ayant trait à des personnes qui avaient été
détenues par des agents de l’État et avaient par la suite disparu. Ces plaintes permirent
d’établir, pour la première fois dans le cadre d’une organisation internationale, la
pratique de la disparition forcée comme une politique systématique, mise en œuvre par
le gouvernement argentin21.
Notons que la Commission continue à effectuer des visites in situ sur invitation des pays
membres. En décembre 2013, un groupe de fonctionnaires s’est notamment rendu en
République Dominicaine, suite à l’émission d’un arrêt de la Cour constitutionnelle de ce
pays qui avait eu pour conséquence de laisser apatrides plus de 200 000 individus
d’origine haïtienne ; près de 4000 témoignages, plaintes et communications avaient
alors été recueillis22.
La transition de plusieurs pays du continent vers la démocratie a conduit à ce que le
travail de la Commission, depuis la fin des années 1990, se concentre désormais sur
l’étude de plaintes qui lui sont acheminées par les intéressés eux-mêmes ou par une
organisation non-gouvernementale reconnue par un pays de l’OÉA 23 ; les rapports sur
l’état des droits de l’homme dans les pays de l’organisation ont été relégués à un second
plan. Notons qu’à cette époque, certains gouvernements ont par ailleurs commencé à
questionner l’émission de rapports par la Commission, considérant que cet outil était
certes approprié dans le cas de régimes dictatoriaux, mais pas dans celui de systèmes
démocratiques24.
Lorsqu’elle reçoit des plaintes, la Commission effectue les recherches qu’elle estime
pertinentes quant aux faits invoqués, et tente d’orienter le pétitionnaire et l’État vers
une solution amiable. Si cette option s’avère impossible, la Commission émettra alors
un rapport dans lequel elle recommandera à l’État d’adopter certaines mesures. Si l’État
refuse d’obtempérer, la Commission pourra alors s’en référer à la Cour 25. Le règlement
de la Commission lui permet également de solliciter d’un État qu’il adopte des mesures
conservatoires relatives « à des situations graves ou urgentes qui présente un risque de
causer un dommage irréparable à des personnes, à l’objet d’une pétition ou d’une
affaire pendante devant les organes du Système interaméricain » 26. Par ailleurs, l’ordre
public n’étant évidemment pas assujetti au droit des parties, le règlement à l’amiable
entre l’État et la victime, s’il survient, ne pourra néanmoins faire en sorte que soient
maintenues dans l’ordre interne des lois qui sont violatrices des droits de la personne 27.
À l’heure actuelle, la Commission reçoit plus d’un millier de plaintes, organise une
centaine d’audiences, et émet une vingtaine de rapports relatifs à des cas particuliers,
de façon annuelle28. On relèvera qu’un pourcentage élevé de plaintes sont rejetées
parce qu’elles ne respectent pas les conditions préalables posées par l’article 46 de la
Convention, relatives notamment à l’épuisement des voies de recours internes.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
217
Dans le cadre de son rôle de promotion des droits de l’homme, la Commission travaille
par ailleurs sous trois facettes spécifiques : la dissémination, c’est-à-dire la
conscientisation des citoyens des Amériques relativement à leurs droits; la promotion
du système auprès de ses habitants; et la poursuite d’une campagne d’éducation
relative à l’importance d’incorporer les droits de l’homme aux droits internes des
États29.
Il faut également souligner qu’à la fin du XXème siècle, la Commission a ouvert des
bureaux de rapporteurs (aujourd’hui au nombre de neuf) chargés du suivi de questions
d’intérêt spécifiques pour la Commission : la liberté d’expression, les droits des
femmes, des enfants, des peuples autochtones, des individus privés de leur liberté, des
migrants, des « afro-descendants », des défenseurs des droits de l’homme, des
lesbiennes, gays et personnes trans, bisexuelles et intersex. Une Unité sur les droits
économiques, sociaux et culturels a également vu le jour en 2012. Ces bureaux ne
peuvent cependant pas être comparés aux organes onusiens similaires, notamment en
raison du fait que leur travail est réalisé à temps partiel, la plupart d’entre eux étant
d’ailleurs présidés par l’un des sept Commissaires.
Par ailleurs, selon l’article 45 du Pacte de San José, un État partie peut saisir la
Commission relativement à une violation présumée d’une disposition de la Convention
par un autre État partie ayant accepté ce procédé, indépendamment de la nationalité
des victimes. Les États sont en général peu enclins à y consentir, et seuls 11 pays ont
effectivement reconnu la compétence de la Commission pour intervenir dans de tels
cas. Cette procédure n’a été utilisée que deux fois, étant données les conséquences
potentiellement adverses sur le commerce qui pourraient se présenter pour le pays qui
déciderait d’y avoir recours30. Certains auteurs avancent que l’existence même de ce
procédé est sûrement significative, puisqu’elle met en exergue le droit d’un État de
défendre les intérêts supérieurs établis par un traité signé par la plupart des pays de
l’OÉA. Il est ainsi reconnu que la violation d’une disposition du Pacte de San José par un
État affecte le droit subjectif de chacun d’entre eux31. Le recours épisodique à ce
procédé met cependant en doute son utilité concrète32.
Au cours des dernières années, la Commission a augmenté sensiblement le nombre
d’affaires qu’elle soumet à la Cour. Ce changement est plus marqué depuis 2001, date à
laquelle est entré en vigueur un nouveau règlement – déjà remplacé - prévoyant que
lorsqu’un État décide de ne pas mettre en œuvre une recommandation qu’elle a
adoptée, la Commission s’en réfèrera à la Cour33. Cependant, il est à souligner que,
même si la Commission établit officiellement l’existence d’une responsabilité, ses
recommandations n’ont pas force obligatoire, et moins encore d’autorité définitive. La
Cour interaméricaine a en effet le pouvoir de réviser toutes les conclusions émises par
la Commission34. Certains soulignent également, comme une faiblesse de la
Commission, les délais considérables pour l’examen des cas qui lui sont soumis, tout
comme pour l’émission de la décision finale35.
En définitive, comme il a été mentionné précédemment, la Commission ayant été créée
avant l’adoption de la Convention américaine, elle conserve les prérogatives quasi
judiciaires qui étaient les siennes envers les États membres de l’Organisation qui n’ont
pas ratifié ce traité36. Elle évalue ainsi leur aptitude au respect des droits de l’homme à
l’aune de la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme de 1948 37.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
218
2. La Cour
La Cour interaméricaine fut établie le 18 juillet 1978 du fait de l’entrée en vigueur du
Pacte de San José. Les premiers juges du tribunal furent élus en 1979, au beau milieu
d’une situation de répression qui prévalait dans plusieurs États, ainsi qu’une politique
interventionniste des États-Unis dans la région38.
Une certaine rivalité s’installa initialement entre la Cour et la Commission, cette
dernière ne voyant pas d’un bon œil la création de ce nouvel organe sans lequel elle
avait opéré durant deux décennies, qui pourrait interférer avec son autonomie et
diminuer son prestige. Ainsi, la Commission refusa de référer plusieurs cas contentieux
à la Cour, dont les activités se virent alors limitées à émettre des avis consultatifs. Les
relations entre les deux institutions se sont néanmoins améliorées au courant des
années 1990, même si le Tribunal a de temps à autre rejeté les interprétations faites par
la Commission, tant en matière de faits que de droit 39.
La Cour, dont les juges siègent à temps partiel à San José - la plupart d’entre eux
occupant des fonctions académiques dans leur pays d’origine 40 - effectue aussi
périodiquement des sessions itinérantes qui l’ont emmenée dans une quinzaine de
pays; au cours des dernières cinq années, elle a par exemple siégé à Bogota, Guayaquil,
Bridgetown, Mexico et Asuncion. Ces sessions extra muros permettent aux
fonctionnaires, associations civiles, académiques, étudiants, et au public en général de
se familiariser avec le fonctionnement du système interaméricain.
Comme c’est le cas pour d’autres tribunaux internationaux, la Cour interaméricaine
possède donc une double juridiction: consultative, et contentieuse 41 (pour les 20 États
parties à la Convention américaine qui reconnaissent sa compétence).
a) Juridiction consultative
Dans le cadre de la première facette de son activité, les États membres de l’OÉA peuvent
requérir de la Cour un avis sur l’interprétation de la Convention américaine, tout
comme d’autres traités relatifs à la protection des droits de la personne dans les
Amériques, ainsi que sur la compatibilité de leur droit interne avec ces instruments
internationaux; de leur côté, les prérogatives des organes de l’OÉA se limitent à pouvoir
demander à la Cour qu’elle interprète le Pacte de San José et les traités connexes. La
Cour interaméricaine a interprété l’idée d’«autres traités » comme incluant tous les
instruments ratifiés par un ou plusieurs États membres de l’Organisation, même si des
États non membres de l’OÉA en sont également partie.42 Par exemple, l’avis consultatif
no. 16 de la Cour43 a établi sa compétence pour interpréter l’article 36 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires44.
Durant les trois premières décennies de son existence, la Cour a ainsi émis 20 avis, la
majorité desquels ayant été demandés par un État membre; 13 d’entre eux visaient
l’interprétation de la Convention américaine, alors que quatre se référait à
l’interprétation d’autres traités régionaux; quatre encore avaient pour but d’examiner
la compatibilité du droit national d’un État avec des obligations régionales en matière
de droits humains45. Le dernier avis en date, sur les droits des mineurs dans le contexte
de la migration, a été émis en août 201446.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
219
b) Compétence contentieuse
La compétence contentieuse de la Cour est, elle, relative à son pouvoir de décider des
affaires qui sont introduites devant elle, et principalement basées sur des violations
présumées des dispositions de la Convention américaine ; lors de son interprétation de
cet instrument, la Cour adopte le principe pro homine, c’est-à-dire en faveur de
l’individu et de sa dignité, objets de la protection internationale 47. Les affaires peuvent
être présentées par la victime présumée ou son représentant, ou par un État
(notamment s’il désire contester la décision de la Commission quant à sa
responsabilité)48, et peuvent parfois mettre en cause deux ou plusieurs pays membres
de l’Organisation49.
L’article 1 (1) du Pacte de San José établit l’obligation générale pour les États d’assurer
l’exercice - libre et plein - des droits et libertés consacrés par le traité ; ainsi, dans ses
arrêts, la Cour déclare une violation à l’article 1 en accompagnement des articles
relatifs aux droits garantis par la Convention américaine dont elle a constaté la
violation. L’article 2 a, quant à lui, trait au devoir général des États signataires de
conformer leur droit interne aux dispositions de la Convention, appliquant ainsi la
norme d’origine coutumière selon laquelle un État ayant ratifié un traité doit
introduire dans son système juridique les modifications nécessaires au respect des
obligations prévues dans le traité souscrit50. Ces deux articles se lisent, dans la version
officielle du Pacte en français, comme suit51:
« Article 1
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur
compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la
naissance ou toute autre condition sociale.
2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne.
Article 2
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions
législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions
constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres
nécessaires pour effet aux dits droits et libertés ».
Depuis la fin des années 1990, l’étendue des articles du Pacte de San José objet des
affaires entendues par la Cour s’est grandement diversifiée; la Commission a en effet
commencé à lui référer des cas relatifs aux droits des peuples autochtones, à la liberté
d’expression, aux droits des enfants, qui viennent s’ajouter aux cas de violations
systématiques au droit à la vie et à la prohibition du recours à la torture, qui
constituaient initialement la presque totalité de son travail52.
La Cour peut finalement émettre des mesures provisoires, visant à prévenir des
dommages irréparables dans des cas de gravité et d’urgence extrêmes. Ces mesures
pourront être décrétées à la demande de la Commission, même si l’affaire n’est pas
pendante devant la Cour. Dans la pratique, ces mesures sont le plus souvent employées
pour obliger un État à suspendre l’application imminente de la peine capitale, ou à
octroyer une certaine protection à des individus ayant reçu des menaces à l’encontre
de leur intégrité physique. Durant ses premières 30 années de vie, la Cour a émis 81 de
ces ordonnances53.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
220
c) La Cour créatrice du droit international
La Cour, qui avait timidement commencé par résoudre trois affaires durant la période
1987-1989, a rendu 37 arrêts entre 2006 et 200854. Le nombre de décisions émises dans le
cas d’affaires contentieuses, durant l’année 2013, est de 17 55.
Dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées, la Cour interaméricaine a
régulièrement eu recours à l’interprétation de traités internationaux comme la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (affaires Villagran Morales c.
Guatemala56 et Massacre de Mapiripan c. Colombie57). Elle a également employé des
dispositions de soft law empruntées par exemple au Protocole modèle des Nations Unies
pour l’enquête d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (affaire Juan
Humberto Sanchez c. Honduras)58. La Cour a par ailleurs établi sa compétence pour
constater des violations à des traités interaméricains59, comme la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, la Convention
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, la Convention interaméricaine
sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
(Convention de Belém do Pará), qui font partie du corpus iuris interaméricain 60.
Depuis sa création, la Cour a aussi procédé à des interprétations novatrices adoptées
lors d’avis consultatifs, par exemple quant au droit à l’assistance consulaire –
interprétation qui fut par la suite confirmée par la Cour internationale de justice dans
les affaires Avena et LaGrand ; elle a également reconnu le droit à une vie digne comme
faisant partie du droit à la vie, tout comme le droit à réaliser un projet de vie, ou le
droit au travail pour les migrants sans papiers61.
Les contributions de la Cour à l’avancement du droit international incluent aussi de
nombreuses références au jus cogens : par exemple, la prohibition de l’esclavage, de la
torture physique et psychologique, des disparitions forcées, des exécutions
extrajudiciaires ou l’exclusion de l’impunité pour les individus ayant commis des
crimes contre l’humanité. Comme l’observe le juge CANÇADO TRINDADE, la Cour de San
José est probablement le tribunal international ayant le plus contribué à l’expansion de
la notion de jus cogens62.
II. Fonctionnement: le système en pratique
Il convient, dans un premier temps, de distinguer le système interaméricain de son
équivalent européen (A) ; une de ces différences tient en particulier aux mesures que le
tribunal de San José dicte dans le but de réparer les violations commises par les États
(B). Certains développements récents méritent par ailleurs d’être mentionnés (C).
A. Parallèle avec le système européen
Les rédacteurs de la Convention américaine ont en grande partie calqué l’organisation
originelle de la Cour et sa relation avec la Commission sur la structure du système
européen de protection des droits de la personne, tel qu’il existait dans les années 1960.
Néanmoins, depuis ses tout débuts, le Tribunal de San José a développé une
jurisprudence ainsi que des pratiques institutionnelles la séparant nettement de son
homologue européen. Ces différences se retrouvent particulièrement à cinq niveaux.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
221
En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour européenne fut créée pour
superviser un groupe de pays démocratiques où l’État de droit était une valeur acquise.
En revanche, la Cour interaméricaine vit le jour au cœur d’une situation bien
différente, dans laquelle plusieurs États parrainaient eux-mêmes des crimes, ce qui
permit au tribunal de développer une doctrine fournie en matière de disparition forcée,
amnistie, droit des victimes à la vérité, l’obligation des États de poursuivre les
perpétrateurs de violations et les garanties judiciaires. Le deuxième point a trait à
l’évolution de la jurisprudence de la Cour interaméricaine en matière de réparations.
Alors que le Tribunal de Strasbourg se contente généralement d’identifier les violations
à la Convention européenne, et de permettre à l’État fautif de remédier à la situation au
moyen d’une compensation monétaire, la Cour interaméricaine émet régulièrement de
longues listes d’actions que l’État doit entreprendre pour réparer les violations dont il
est l’auteur63. Le tribunal européen n’adopte des mesures réparatrices que lorsque
celles prévues par l’État sont estimées insuffisantes, l’aspect subsidiaire de la résolution
s’accentuant alors, comparativement aux déterminations provenant de normes et
instances nationales64. Le travail consultatif de la Cour de San José, centré sur
l’interprétation des normes plutôt que sur son application concrète, la distingue
également de son homologue européen65. Un quatrième aspect sépare les deux
tribunaux, au sujet, cette fois, de la supervision de l’exécution des arrêts. Dans le cadre
européen, une fois la décision émise, la Cour de Strasbourg est dessaisie du dossier,
cédant sa place au Comité des ministres, un organe politique chargé de superviser la
mise en œuvre par l’État de la décision de la Cour. En revanche, en Amérique, c’est le
Tribunal qui est chargé de superviser l’exécution de ses décisions en matière de
réparation, et celui-ci émet normalement une ordonnance enjoignant à l’État de faire
rapport périodiquement de ses avancées à ce titre. Finalement, au niveau de la
technique jurisprudentielle, il est à noter que, dans les arrêts qu’il émet, le tribunal
interaméricain effectue une analyse approfondie de la preuve lui ayant été soumise,
notamment pour pallier aux déficiences qui peuvent se présenter s’agissant de certains
tribunaux nationaux66 ; l’évaluation de la preuve se fait selon le critère appelé de la «
sana critica », c’est-à-dire en suivant les règles de la logique et l’expérience.
B. Le fleuron du système: le modèle de réparations
Les tribunaux internationaux ont généralement déployé des schémas de réparation peu
imaginatifs, et souvent tragiquement inadéquats67. Dans l’établissement des réparations
octroyées aux victimes, la Cour interaméricaine « a fait preuve d’une hardiesse qui ne
s’explique pas sans la personnalité des juges de sa période inaugurale » 68, et comme
nous l’avons indiqué précédemment, c’est sans doute là l’aspect le plus intéressant de la
jurisprudence émanant de la Cour de San José69.
1. Cadre général
Les États de la communauté internationale ont créé un concept moderne de droits de la
personne à partir des législations nationales ainsi que des instruments internationaux.
Ils ont aussi mis en exergue que la reconnaissance et la protection de ces droits au sein
des Etats s’avèrent souvent insuffisants, restant en-dessous d’un standard minimum
indispensable70.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
222
Une douzaine de mécanismes internationaux permettent à des victimes de violations
de droits de la personne de dénoncer les abus dont elles ont été l’objet par un État
partie à un Traité. Parmi eux, citons eux le Comité des droits de l’homme, l’UNESCO,
l’OIT, ou encore les organismes créés en vertu de la Convention internationale sur l'
élimination de toutes formes de discrimination raciale ou la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, la
majorité de ces organismes ne peuvent qu’émettre des recommandations aux États
fautifs, se trouvant empêchés d’ordonner des réparations71. Tout comme sur les
continents européen et africain, le système interaméricain permet aux individus qui se
sentent lésés dans les droits que leur confère le Pacte de San José et les traités
connexes, d’exiger que réparation leur soit faite du préjudice qu’ils ont souffert.
Le pouvoir inhérent des tribunaux d’octroyer des réparations provient du droit de la
responsabilité internationale des États, qui les oblige à réparer le tort causé par leurs
actions ou omissions, tel que la Cour permanente de justice internationale l’a
clairement formulé dans son fameux arrêt Chorzow.
Par ailleurs, comme l’observe le juge CANÇADO TRINDADE, le mot « réparer » tire son
origine du latin « reparare » (disposer à nouveau). Selon cet éminent juriste, il semble
donc adéquat d’envisager une réparation constructive, prenant en compte l’intégralité
de la personnalité de la victime, sa réalisation comme être humain ainsi que la
reconstruction de son projet de vie72.
Dans ce sens, le Comité des droits de l’homme a adopté, en 2004, l’Observation générale
n° 31 sur la nature des obligations imposées aux États dans le cadre de l’application du
Pacte sur les droits civils et politiques73; le paragraphe 16 dudit document affirme que,
selon les situations, les réparations en matière de droits de l’homme peuvent inclure
des mesures de satisfaction comme les excuses publiques, des mémoriaux, des garanties
de non répétition, et des changements normatifs et de pratiques, tout comme la
poursuite en justice des perpétrateurs des violations. De son côté, l’Assemblée générale
des Nations unies a pour sa part adopté, en décembre 2005, les “Principes fondamentaux
et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire”; bien que ce document ne codifie pas le droit positif, et se
contente plutôt d’énoncer des recommandations quant à une réparation pleine et
effective des violations causées74, il est toutefois considéré comme un tournant majeur
dans l’histoire du droit international des droits de l’homme et de la justice pénale
internationale, plusieurs États – latino-américains en particulier - ayant incorporé ses
lignes directrices dans leurs législations en matière de réparation 75.
Finalement, il convient ici de rappeler que le projet d’articles sur la responsabilité
internationale de l’État (préparé par la Commission du droit international de l’ONU)
prévoit que le préjudice causé peut faire l’objet de trois mesures de compensation: la
restitution (art. 35), l’indemnisation du dommage matériel et moral (art. 36), et la
satisfaction (art.37).
2. Typologie des réparations dans le système interaméricain
L’article 63 (1) du Pacte de San José sanctionne les États ayant violé les droits humains
prévus par ce traité, et à l’instar du modèle qu’offrait la Convention européenne des
droits de l’homme, le projet préparé par le Conseil interaméricain de jurisconsultes
prévoyait un caractère subsidiaire pour les réparations que la Cour décrèterait.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
223
L’article 52 (1) du projet soumis à la Conférence de San José en 1959 finit par conférer à
la Cour interaméricaine la compétence de fixer une indemnisation pour la « partie
lésée », lorsqu’elle établirait la violation d’un droit ou une liberté. Toutefois, faisant
suite à une suggestion de la délégation guatémaltèque, présidée par le juriste Carlos
Garcia Bauer, il fut décidé d’inclure trois concepts fondamentaux dans la version finale
de l’article: la réparation des conséquences de la décision ou la mesure ayant violé les
droits ou libertés de la partie lésée; la garantie pour la victime de la jouissance du droit
ou de la liberté enfreints; et le paiement d’une indemnisation juste. L’esprit innovateur
qui domina les travaux de la conférence ouvrit donc la voie aux modalités de
réparations désormais en place76. Le texte final est ainsi rédigé77:
« Article 63
1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été
violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté
enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure
ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste
indemnité à la partie lésée.
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il
s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge
pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de
telles mesures sur requête de la Commission ».
La jurisprudence interaméricaine, dans le but de compenser de façon adéquate le tort
causé à la victime, prend en compte aussi bien les origines que les effets de l’infraction.
Elle opère selon deux principes : idonéité et conséquence, c’est-à-dire que les
réparations « doivent être conséquentes si l’on considère la nature et les effets des
violations perpétrées, et idoines pour leur faire face et les repousser ». 78
Les violations qui ont causé un préjudice individuel entraînent par ailleurs l’adoption
de mesures de réparations qui concernent uniquement la victime, alors que les
violations qui mettent en évidence l’existence d’un défaut structurel dans l’ordre
interne de l’État fautif entraînent l’adoption de mesures produisant des effets généraux
ayant pour effet de prévenir les violations futures.79
a) Réparations du préjudice individuel
Comme conséquence de l’obligation de « garantir » - article 1 (1) du Pacte de San José -,
les États ont le devoir de prévenir, réaliser les enquêtes nécessaires et sanctionner, le
cas échéant, les responsables80. Dans ce sens, la jurisprudence interaméricaine analyse
en détail les obstacles que le droit interne peut poser à l’exercice de la justice pénale.
Initialement, l’attention de la Cour s’est portée sur les lois d’auto-amnistie qu’elle a
estimées incompatibles avec le système mis en avant par la Convention américaine. Par
la suite, elle analysa les dispositions de prescription et d’établissement de mesures
tendant à exclure la responsabilité et la sanction des responsables de violations graves
des droits de la personne (affaire Barrios Altos)81. Dans le même sens, on peut également
inclure la localisation et l’identification de restes humains, pour satisfaire tant des
exigences de poursuites que des obligations morales, spirituelles, ou culturelles; la Cour
a par exemple requis la création d’un système d’informations génétiques pour
identifier et déterminer la filiation d’enfants disparus 82.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
224
S’agissant de mesures de réhabilitation, dans le cas des Dix-neuf commerçants c. Colombie,
le jugement rendu en 2004 requérait de l’État qu’il fournisse une aide médicale et
psychologique aux familles des 19 victimes exécutées, prenant en compte les besoins de
chacun des individus affectés, sans fixer de montant spécifique 83. Cette pratique a été
reprise par la Cour dans de nombreux arrêts subséquents. Dans l’affaire Cantoral
Benavides c. Pérou84, les membres des familles des victimes d’exécutions reçurent des
bourses pour compléter leurs études primaires ou secondaires.
Dans son arrêt émis dans le cadre de l’affaire Loayza Tamayo c. Pérou, la Cour a, pour la
première fois, accepté le concept de « projet de vie », lié à la satisfaction, comme une
forme de réparation85. Dans cette affaire, où la victime - une professeure universitaire -
avait été accusée d’appartenir à une organisation terroriste, arrêtée, torturée, et
soumise à un procès devant des juges « sans visages » (dont l’identité était gardée
secrète), la Cour a soutenu qu’un tel dommage inclut les frustrations que la violation
imposent au projet de vie légitime et raisonnable de l’individu (réalisation intégrale de
son projet de vie, atteinte prévisible au potentiel de l’individu, attentes raisonnables
qu’il pourrait avoir selon ses capacités). On considère également le reproche à l’État qui
aurait dû garantir les droits et libertés de l’être humain, et qui a trahi sa mission
naturelle tout comme l’espoir posé en lui par l’individu. La compensation monétaire du
dommage au projet de vie n’a cependant pas été ordonnée par le Tribunal, qui s’est
contenté d’opter pour des mesures destinées à rétablir le cours de la vie, récupérer
d’une certaine façon le terrain perdu, et réanimer l’espoir86. En l’espèce, elle a exigé de
l’État qu’il fournisse à la victime une opportunité d’enseigner dans une institution
publique qui lui offre les mêmes bénéfices dont elle jouissait au moment de sa
détention, et lui restaure tous les avantages en matière de pension et retraite auxquels
elle avait droit avant sa détention87.
Dans le calcul des dommages monétaires - en particulier en ce qui concerne la perte de
revenus - le montant octroyé par la Cour est souvent basé sur les activités de la victime.
Cependant, dans les cas de victimes qui n’avaient pas de profession spécifique ou
lorsque les victimes étaient des enfants de la rue88, la Cour a établi, en se basant sur un
principe d’équité, une estimation de revenus en employant parfois le salaire minimum
mensuel applicable dans le pays en question89.
Finalement, le tribunal interaméricain a souligné à maintes reprises que les mesures
préventives visant la non-réitération des faits doivent commencer par la révélation et
la reconnaissance des atrocités commises dans le passé, la société dans son ensemble
ayant le droit de connaître la vérité relative aux crimes commis pour qu’elle soit
capable de prévenir leur répétition à l’avenir90. Dans le cadre de son arrêt dans l’affaire
Masacre de Mapiripan c. Colombie91, elle détermina par exemple que l’État devait
identifier, juger et sanctionner les responsables, et prendre les mesures nécessaires
pour diffuser les résultats des procès ainsi entamés, de telle sorte que la société
colombienne puisse connaître toute la vérité entourant les faits avérés.
b) Le cas particulier des peuples autochtones
Sur le continent américain, les communautés autochtones ont souvent souffert des
violations à leurs droits humains les plus basiques, perpétrées par l’État ou par des
tiers, agissant librement, sans interférence de ce dernier; des membres de ces
communautés ont été tués, les droits qu’ils possédaient sur leurs terres ancestrales ont
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
225
été éteints, leurs coutumes ont été dénigrées, et leurs terres envahies par des
personnes cherchant à exploiter les ressources naturelles qu’elles renfermaient 92.
La Cour et la Commission reconnaissent et protègent les différences culturelles qui
distinguent les peuples autochtones des cultures dominantes dans la plupart des États.
Elles ont par exemple obligé le gouvernement du Nicaragua à réviser son droit
électoral, qui le restreignait de façon disproportionnée, en ne prenant pas en compte
les coutumes et les traditions des peuples indigènes et ethniques de ce pays. La Cour et
la Commission ont également reconnu une violation du Guatemala quant au droit à la
religion, alors que cet État ne permettait pas au peuple Maya d’enterrer les membres de
sa communauté selon leur coutume. Le Tribunal a encore reconnu que le droit de la
propriété prévu dans la Convention américaine inclut le droit à la propriété collective
des terres93. En 2004, dans l’affaire Plan de Sanchez c. Guatemala, la Cour a été placée
devant la tâche ardue de déterminer la réparation la plus adéquate à octroyer suite au
massacre de 250 individus membres d’une communauté Maya; au-delà de la
compensation monétaire, le tribunal a condamné l’État à adopter une pléiade d’actions
ayant pour but la réparation des dommages causés94.
c) Mesures visant à corriger le préjudice causé à la société dans son ensemble
Il est normalement plus important pour les individus victimes des violations à leurs
droits humains d’obtenir la garantie de vivre dans la sécurité d’un environnement
redevenu humain que de se voir alloués certains avantages financiers; la
reconnaissance par l’État des méfaits commis par le passé équivaut à signaler une
réorientation générale de sa politique95.
Dans ce sens, la Cour a, à partir de 2001, enjoint les États déclarés responsables de
violations des droits de la personne à admettre publiquement cette responsabilité. Dans
17 cas sur 28 répertoriés, les autorités des États visés ont obtempéré, ce qui constitue
sans aucun doute une réussite remarquable96, si l’on considère que le Tribunal fixe des
délais ainsi que certaines caractéristiques pour l’acte officiel de reconnaissance, auquel
doivent assister des fonctionnaires de haut rang97. Dans certains cas, l’acte public de
reconnaissance a eu lieu au cours même de l’audience tenue devant le tribunal, comme
en 2005, dans l’affaire Gutierrez-Soler c. Colombie, lorsque chacun des représentants de
l’État présents dans la salle se sont levés et déplacés pour demander pardon à la victime
de torture aux mains d’agents de l’État, et à sa famille 98.
Par ailleurs, le jugement est en lui-même une forme de réparation, puisqu’il permet de
rétablir l’ordre juridique objectif aussi bien que le subjectif; c’est dans ce sens que la
Cour a fréquemment ordonné la diffusion de son arrêt, par des moyens de
communication divers, et dans des langues d’intérêt pour le cas (langue de groupes
autochtones, ou celle de la victime – par exemple dans la langue de Molière à l’occasion
de l’affaire Tibi99 où la victime était citoyen français). Le tribunal a en particulier
ordonné la publication de la section de son arrêt qui décrit les faits qu’il considère
avérés et détaille les contextes historique et social dans lesquels les violations se sont
produites ; cette partie de l’arrêt qu’émet la Cour constitue, au niveau de la technique
jurisprudentielle, un trait caractéristique parmi les juridictions internationales 100.
Récemment, dans le cadre de l’affaire connue comme Campo algodonero (“Champs
cotonnier”, du nom de l’emplacement où furent trouvés plusieurs cadavres de jeunes
femmes, dans la périphérie de la ville de Ciudad Juarez, à la frontière mexicano-
américaine)101, la Cour a appliqué la Convention de Belem do Pará, constatant que l’État
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
226
mexicain avait commis de graves violations par voie d’omission, allant à l’encontre du
devoir général de garantie énoncé à l’article 1 (1) de la Convention américaine. En plus
d’ordonner des mesures visant à réaliser des enquêtes adéquates et un acte de
reconnaissance publique de responsabilité, la Cour a disposé, dans le cadre de
réparations ayant des prétentions intégrales ou structurelles, que l’État prenne des
mesures visant à éliminer les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société, objet
de discrimination et de victimisation, et développe des programmes permanents
d’éducation et de formation pour les fonctionnaires des paliers de gouvernements
responsables, axés sur la perspective de genre; il ne s’agit donc plus uniquement de
mesures visant directement les victimes (survivants et membres de la famille exigeant
justice), mais bien de la prévention générale du comportement causant préjudice 102.
Dans d’autres affaires, la Cour a en outre établi des mesures réparatrices alternatives,
comme par exemple : la dotation de ressources pour l’entretien d’une chapelle, la
création d’un registre unifié répertoriant les morts violentes, l’amélioration radicale
des conditions de vie carcérale, l’inscription des noms de victimes sur des plaques, rues,
monuments, édifices publics et places, etc…103.
Dans certains cas, l’arrêt a pour effet des changements profonds dans le système
juridique du pays visé. Le tribunal interaméricain a, par exemple, provoqué une
réforme constitutionnelle au Chili en matière de liberté d’expression afin que cet Etat
supprime la censure104. Il a également exigé la révision des normes portant sur la peine
de mort, l’exclusion de châtiments corporels cruels, inhumains et dégradants, la
modification d’une loi dans le but de satisfaire au droit à la révision des décisions
judiciaires ou encore la révision de dispositions matérielles et processuelles relatives à
l’exercice de droits politiques105. Il a également établi la définition du terrorisme et de
la disparition forcée. Dans l’affaire Radilla Pacheco c. Mexique 106, notamment, relative à
une disparition forcée survenue en 1974, la Cour a de nouveau affirmé que le crime de
disparition forcée est une violation de la Convention continue et permanente qui ne
cesse que lorsque la victime est finalement retrouvée ou lorsque les circonstances de sa
mort sont établies. Elle l’avait déjà ainsi décidé lors de l’arrêt Blake relatif à la
disparition et meurtre de deux citoyens américains au Guatemala en 1985 et dont les
restes ont été retrouvés en 1989107. Le tribunal a exigé, en suivant une jurisprudence
constante établie à l’occasion d’autres affaires, la modification de l’ordre juridique
militaire dans le but d’établir des limites matérielles et personnelles à cette
juridiction108.
Il est à noter finalement que le système de protection des droits de l’homme n’ayant
pas de vocation pénale, et les États ne comparaissant pas devant la Cour comme
défenseurs dans une action pénale, la Cour de San José n’octroie pas de dommages
punitifs ou exemplaires109.
3. Supervision de l’exécution des arrêts
C’est à l’occasion de l’affaire Baena Ricardo et al. c. Panama 110 que la Cour interaméricaine
a établi le fondement légal qui lui permet de superviser la mise en œuvre de ses
décisions. Le gouvernement panaméen avait alors argumenté que la Cour n’avait pas
l’autorité requise pour exiger des États qu’ils fournissent les informations qui
serviraient à apprécier jusqu’à quel point les mesures qu’elle a dictées ont
effectivement été mises en places. La Cour statua cependant qu’elle avait la compétence
nécessaire pour déterminer l’étendue de sa juridiction, considérant que la supervision
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
227
en était une partie inhérente ; elle ajouta que ses décisions ayant pour but de protéger
effectivement les victimes et leur octroyer des réparations, cet objectif ne pourrait être
atteint que si les décisions sont pleinement mises en œuvre 111.
La Cour a codifié dans son nouveau Règlement la pratique qu’elle avait développée
depuis 2006 relative à la supervision de l’exécution de ses jugements 112. Les audiences
de supervision qui réunissent les représentants des victimes, de l’État, et la Commission
devant un comité de trois ou quatre juges cherchent à faciliter les accords entre les
parties quant à la mise en œuvre des mesures prescrites par le Tribunal 113. Ce dernier
émet subséquemment un rapport dans lequel il énumère les actions que l’État doit
entreprendre pour satisfaire pleinement ses exigences, demeurant saisi de l’affaire
jusqu’à ce qu’il considère qu’elles ont été mises en œuvre114.
À titre indicatif, à la fin de 2013, 148 affaires contentieuses se trouvaient en cours de
contrôle d’exécution. Ceci est en partie dû au fait que la nature de certaines réparations
dictées par la Cour – comme celles relatives aux investigations judiciaires, la création et
modification de normes légales, ou des changements structurels, font en sorte que
l’étape de contrôle doive demeurer ouverte pour une durée supérieure à celle
qu’exigeraient d’autres types de réparation moins complexes à mettre en œuvre. 115
B. Développements récents, et regards sur l’avenir
Le dynamisme dont fait preuve le système interaméricain se reflète d’une part au
niveau de certaines nouveautés qui y ont été incorporées au cours des dernières
années, et également par l’influence croissante de la jurisprudence de la Cour de San
José dans les décisions adoptées par les tribunaux nationaux des pays membres de
l’OÉA.
1. Nouveautés
Le système interaméricain a adopté dernièrement deux nouvelles figures juridiques, et
en a modifié une troisième. Il convient ici d’en faire mention: un fonds d’assistance
pour les victimes, un défenseur interaméricain et un changement des conditions de
recours aux juges ad hoc.
a) Victimes
Le Pacte de San José n’aborde pas expressément la place qui doit être faite aux
individus relativement à la procédure devant la Cour interaméricaine 116. Dans ce sens,
une des principales réformes introduites par le nouveau Règlement prévoit que c’est
aux victimes présumées et à leurs représentants que reviendra désormais le rôle
principal lors d’un procès se déroulant devant la Cour, la Commission étant reléguée au
second plan117.
Un Fonds d’assistance légale a été créé par l’Assemblée générale de l’OÉA en 2008, et le
Conseil permanent de l’Organisation a adopté, fin 2009, des règles générales relatives à
son utilisation. Étant donné que le Fonds ne dispose pas de ressources provenant du
budget ordinaire de l’OÉA, la Cour a dû chercher des contributions volontaires afin
d’assurer son entrée en vigueur. La première contribution a été faite par le
gouvernement norvégien, suite à la signature d’un accord de coopération, en février
2010. D’autres gouvernements ont par la suite réalisé des apports 118. La Cour est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
228
chargée de décider si une victime présumée pourra ou non bénéficier des ressources du
Fonds. Le cas échéant, elle devra démontrer qu’elle ne dispose pas des moyens
économiques qui lui permettent de faire face aux dépenses encourues, et indiquer avec
précision quels aspects de sa représentation elle prétend acquitter grâce aux ressources
du Fonds. La Présidence de la Cour évalue chacune des demandes présentées,
déterminant au cas par cas son bien-fondé. Entre 2010 et 2013, la Cour a autorisé l’accès
au Fonds dans 25 affaires119.
Dans le cas des victimes présumées se trouvant dans l’impossibilité de se faire
représenter auprès de la Cour par leur propre avocat, le Règlement prévoit par ailleurs
la possibilité pour le tribunal de leur désigner un défenseur interaméricain 120. La Cour a
ainsi conclu un accord avec l’Association interaméricaine des défenseurs publics, qui
permettra sa collaboration pour nommer des avocats dans chaque cas particulier 121. La
représentation légale mentionnée est gratuite, et l’Association ne percevra que le
remboursement des dépenses que la défense du cas lui occasionne. Dans la mesure du
possible, la Cour contribuera à défrayer, via le Fonds d’assistance légale, les dépenses
raisonnables et nécessaires encourues par le défenseur interaméricain désigné. À la fin
de 2013, l’intervention de l’Association avait été requise dans quatre affaires 122.
Il convient ici de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur de cette réforme, la Commission
interaméricaine était l’organe chargé de conseiller les victimes présumées et d’agir
dans leur intérêt devant la Cour lorsqu’elles ne disposaient pas d’une représentation.
De cette manière, on cherchait à garantir l’accès à la justice interaméricaine pour les
personnes qui ne disposaient pas d’une représentation et requéraient une assistance
technique.
Finalement, il est à souligner que, depuis 2011, la Cour a occasionnellement recours à
l’obtention de témoignages par le truchement de médiums audiovisuels, permettant
ainsi que les victimes présumées, de même que n’importe quel autre déclarant, aient
une participation active et directe dans les procès suivis devant elle. Ceci permet
d’amenuiser les complications, notamment financières, rencontrées par plusieurs
victimes pour donner suite à la procédure entamée à Washington, et continuée par la
suite à San José123.
b) Juges ad hoc
L’article 55 de la Convention américaine prévoit qu’un État appelé à se présenter
devant la Cour peut nommer un juge ad hoc qui fera partie du panel qui connaîtra cette
affaire si aucun des sept juges n’a la nationalité de cet État. Cette disposition visait
initialement à assurer qu’au moins un membre du panel comprendrait parfaitement le
système juridique concerné, ce qui est souvent important pour l’analyse de
l’épuisement des voies de recours internes. Le Pérou et le Guatemala ayant en
particulier adopté la pratique de nommer des juges qui rendaient invariablement des
opinions dissidentes plus favorables à l’État qui les avait nommés, la Cour a fermé la
porte à ces abus en 2009, en émettant un avis consultatif124 interprétant l’article 55 visé,
de telle sorte que les juges ad hoc ne peuvent dorénavant être nommés que dans le cas
où un État serait poursuivi par un autre devant sa juridiction125.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
229
2. Pénétration de la jurisprudence interaméricaine dans les ordres juridiques
internes
Bien que les opérateurs de justice des Amériques soient peu enclins, par nature, à
accepter l’ingérence des institutions interaméricaines dans leur système juridique, dû
au fait que plusieurs constitutions latino-américaines garantissent l’indépendance des
magistrats et procureurs126, les tribunaux supérieurs de plusieurs pays du continent ont
reconnu l’autorité des arrêts de la Cour interaméricaine, et ont fait l’objet
d’ordonnances visant par exemple à obliger les juges mexicains à recevoir une
formation en perspective de genre, ou les juges guatémaltèques à cesser d’appliquer la
peine de mort127. Dans les 114 arrêts où le tribunal de San José a émis des ordonnances
de réparations (entre 1979 et 2009), les mesures ordonnées requéraient l’intervention
du pouvoir judiciaire dans 78, soit plus des deux tiers128. Par ailleurs, à partir de 2006, le
tribunal interaméricain a développé une doctrine du contrôle de conventionalité, au
travers duquel les juges nationaux sont amenés à assurer la compatibilité du système
juridique interne avec les dispositions de la Convention américaine 129.
La Cour constitutionnelle du Pérou a, en particulier, reconnu au tribunal
interaméricain le rôle de « gardien ultime des droits humains dans la région ». Elle
admet ainsi que son propre recours aux normes internationales est insuffisant tout en
s’engagent à prendre en considération l’interprétation faite de ces normes par le
tribunal de San José130. Dans l’affaire Barrios Altos (précitée), la Cour interaméricaine a
établi l’inadmissibilité des dispositions internes adoptées par l’État péruvien prévoyant
une amnistie qui aurait pour conséquence d’empêcher les enquêtes et la sanction des
responsables de violations graves des droits de l’homme (torture, disparitions forcées,
exécutions sommaires, etc). Le gouvernement transitoire du Pérou, ayant reçu la
notification de la décision du tribunal de San José, renvoya la décision à la Cour
suprême, qui la fit parvenir aux tribunaux inférieurs accompagnée de l’instruction
selon laquelle les causes criminelles relatives à l’affaire Barrios Altos devaient être
rouvertes, étant donnée la nature obligatoire du jugement de la Cour
interaméricaine131.
À l’occasion d’un autre jugement de la Cour constitutionnelle péruvienne émis en juin
2007, le tribunal a repris le raisonnement établi par la Cour interaméricaine dans
l’affaire Yatama c. Nicaragua, réaffirmant ainsi le droit de tout individu à un recours
effectif, devant un tribunal compétent pour protéger ses droits contre des actes qui
violentent ses droits fondamentaux132.
En Argentine, l’arrêt Simon, émis en 2005 par la Cour suprême de ce pays, eût pour
conséquence de laisser sans effets juridiques certaines lois dont celle connue sous le
nom de « point final », permettant ainsi la condamnation de Julio Hector Simon à une
peine de 25 ans de prison, et la réouverture d’un millier d’affaires pénales dans
lesquelles était mise en cause la responsabilité d’effectifs militaires et ex militaires liés
à la répression s’étant institutionnalisée dans ce pays entre 1976 et 1983. Le jugement
conclut que les individus ayant bénéficié de ces lois ne pouvaient invoquer la chose
jugée en vertu des principes établis par la Cour interaméricaine, en particulier dans
l’affaire Barrios Altos. Le même tribunal argentin, dans une décision adoptée en 2007,
déclara inconstitutionnel le décret du pouvoir exécutif émis en 1989 qui graciait le
général Santiago Riveros, en s’appuyant sur les arrêts Barrios Altos et Almonacid 133.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
230
En République Dominicaine, la Cour suprême a, conformément à ses compétences, par
jugement, créé un mécanisme de protection juridictionnel de droits et libertés
fondamentaux (recours d’amparo) en se fondant sur l’article 25.1 du Pacte de San José
qui consacre le droit à “un recours simple et rapide”. Cela est justifié par le fait qu’il
n’existait pas dans ce pays de loi conférant une compétence expresse à un tribunal pour
accueillir des actions de ce type134. Dans une autre affaire, le même tribunal a par
ailleurs accordé une priorité à l’article 19 de la Convention américaine, ainsi qu’à l’avis
consultatif n° 17 de 2002 sur la protection des droits des enfants 135, pour établir les
règles processuelles applicables dans le cadre de l’obtention d’une déclaration d’un
mineur comparaissant comme victime, témoin ou co-imputé dans un procès dans ce
pays136.
Dans le cas du Costa Rica, cet État a demandé et obtenu de la Cour interaméricaine
l’émission de deux avis consultatifs, relatifs à la modification de la disposition de sa
constitution en matière de naturalisation, et sur le regroupement obligatoire en
corporation professionnelle des journalistes dans ce pays. L’État a donné pleins effets
juridiques à ces avis137.
S’agissant de la Colombie, la Cour constitutionnelle a développé d’importants principes
dans un cas relatif à l’interprétation du code de procédure pénale de ce pays. Le
tribunal colombien a cité l’avis consultatif n° 9 de 1987 138 émis par le Tribunal de San
José, spécifiant que l’inexistence de solutions effectives contre les violations de droits
reconnus dans la Convention américaine équivaut à une violation de ce traité 139.
La jurisprudence de la Cour interaméricaine a donc pour effet d’influencer la
réinterprétation radicale de certaines normes de droit interne, à la lumière de
principes considérés comme constituant un ordre normatif supérieur 140.
Conclusion
L’universalisation des droits de l’homme telle que décrite par Norberto Bobbio a
constitué un développement certain dans la consolidation de la protection des droits de
la personne. Le défi actuel tient essentiellement à la correcte mise en œuvre des
obligations internationales par les États141. Sur le continent américain, l’attention du
système n’est plus centrée exclusivement sur les violations massives du droit à la vie ou
autres droits fondamentaux, mais sur d’autres types d’abus. L’accent est désormais mis
sur l’obligation pour les États d’amender leur législation et de réorienter leur
jurisprudence et leur pratique pour les rendre compatibles avec les standards
internationaux142. Cependant, les obstacles à la mise en œuvre des droits de la personne
dans les Amériques sont nombreux : pauvreté extrême, sociétés divisées, ravagées par
des conflits internes brutaux, des systèmes judiciaires faibles, et des démocraties
fragiles143. S’ajoute à ces conditions déjà difficiles un défaut d’homogénéité parmi les
États s’agissant de la ratification des traités: le Belize, le Canada, les États-Unis et
certains pays des Caraïbes n’ont pas ratifié la Convention américaine ni accepté la
juridiction de la Cour, alors que trois autres pays ont ratifié la Convention mais ne
reconnaissent pas la compétence de la Cour. Ceci ne peut que compliquer le
fonctionnement du système interaméricain144.
Certains mettent en doute l’efficacité du régime de réparation adopté par la Cour
interaméricaine qui, en étant très précise sur ses exigences envers les pays concernés,
contrairement au modèle européen, ne contribue pas à améliorer le taux de réalisation
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
231
des mesures. Néanmoins, les compensations monétaires ordonnées par la Cour sont
mises en œuvre dans 81% de cas145. Par ailleurs, force est d’admettre que certaines
situations, telle la disparition forcée, peuvent difficilement être compensées par un
montant forfaitaire146.
Par ailleurs, avec l’expansion du nombre de membres du Conseil de l’Europe, les
affaires qui parviennent au tribunal de Strasbourg se sont diversifiées, et dans certains
cas les violations ont atteint des seuils de gravité importants. Il est donc possible
d’envisager que l’expérience acquise au sein de la Cour de San José pourrait devenir
utile comme point de référence pour la Cour européenne147. Sans parler
d’ « américanisation » du droit européen, le tribunal de Strasbourg cite désormais avec
une certaine fréquence des arrêts interaméricains148.
A l’inverse, comme l’indique l’ancien juge GARCIA RAMIREZ, l’avenir du système
interaméricain pourrait évoluer en donnant un rôle plus actif à la victime devant la
Cour, en lui conférant la possibilité d’y accéder directement, comme dans le cas
européen149. Pour ce faire toutefois, le budget destiné aux travaux de la Cour
interaméricaine devra être révisé, afin de permettre, par exemple, que ses juges se
consacrent à leurs fonctions à temps plein. C’est là un des nombreux sujets déjà
considérés pour améliorer et consolider le système150.
NOTES
1. D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and
constitutionalism in Latin America”, Texas Law Review, vol. 89, juin 2011, p. 1835.
2. Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ; disponible sur https://
www.cidh.oas.org/Basicos/French/u.reglement.cidh.htm.
3. Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme; disponible sur http://www.corteidh.or.cr/
sitios/reglamento/nov_2009_fr.pdf.
4. J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, 2ième
éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 7.
5. Pour Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, la jurisprudence de la Cour «mérite
désormais la plus grande attention, tant à raison de sa richesse que de l’audace qui la
caractérise», Droit international public, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 256.
6. Pour une étude thématique du système interaméricain, voir notamment le livre de D. SHELTON
et P. G. CAROZZA, Regional protection of human rights, 2ème éd., Oxford, Oxford University Press,
2013.
7. J. PASQUALUCCI, “The Americas”, in D. MOECKLI, International human rights law, 2ème ed.,
Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 399.
8. Charte de l’Organisation des États Américains ; sa version actualisée est disponible sur http://
www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm
9. Bien qu´entendue comme un document qui ne liait pas les États membres, la Déclaration
américaine contient une définition et une interprétation qui font autorité relativement aux
obligations auxquelles sont soumis les États ayant signé la Charte de l’OÉA, telle qu’amendée par
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
232
le Protocole de Buenos Aires; la Cour interaméricaine a en effet confirmé que la Déclaration est le
texte définissant les droits de la personne auxquels la Charte fait référence, et est donc une
source d’obligations internationales pour ces États. B. FARRELL, "The right to habeas corpus in
the Inter-american human rights system", Suffolk transnational law review, vol. 33, été 2010, pp.
200-202.
10. Ibidem, p. 205.
11. La création de la Commission, en 1959, constitue en partie une réaction à la
révolution cubaine et à l’établissement de la dictature de Trujillo en République
dominicaine. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights
system”, Victoria University of Wellington Law Review, vol. 40, 2009, p. 115.
12. S. GARCIA RAMIREZ, “Panorama de la jurisdiccion interamericana sobre derechos
humanos”, in A. VON BOGDANDY, E. FERRER MAC-GREGOR, et M. MORALES
ANTONIAZZI, (Coord.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿hacia un ius
constitucionale commune en America latina?, t. II, México, Instituto de investigaciones
jurídicas - Instituto iberoamericano de derecho constitucional - Max Planck Institut für
ausländisches öffentliches rechts und völkerrecht, 2010, pp. 341-342.
13. F. GONZALEZ, op. cit., p. 106.
14. Deux raisons semblent expliquer l’adoption de la Convention américaine dans un
contexte plutôt hostile de gouvernements dictatoriaux et autoritaires sur le continent
américain : un nombre important d’États n’avait sans doute pas l’intention de ratifier la
Convention, et certains d’entre eux concevaient sans doute les dispositions qu’elle
contenait comme les déclarations des droits de l’homme enchâssés dans leurs
constitutions, c’est à dire comme des clauses dont le respect n’était pas impératif. F.
GONZALEZ, op. cit., pp. 106-107. Par ailleurs, la Convention doit sans doute en partie son
entrée en vigueur aux pressions exercées par le gouvernement du président américain
Carter sur les gouvernements du reste du continent. Il est intéressant de noter que bien
que le président Carter ait signé le Pacte pendant sa première année de mandat, le
sénat américain ne consentit jamais à le ratifier. L. SHAVER, “The Inter-american
human rights system: an effective institution for regional rights protection ?”,
Washington University global studies law review, vol. 9, 2010, pp. 643-644.
15. G. L. NEUMAN, “Import, export, and regional consent in the Inter-american Court of
human rights”, European journal of international law, vol. 19, no. 1, 2008, p. 106.
16. F. GONZALEZ, op. cit., p. 107.
17. B. FARRELL, op. cit., p. 202.
18. F. GONZALEZ, Sistema interamericano de derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valence, 2013, p.
35.
19. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., pp.
105-106.
20. A. HUNEEUS, "Courts resisting courts: Lessons from the Inter-american Court´s
struggle to enforce human rights", Cornell international law journal, vol. 44, automne
2011, pp. 498-499.
21. Ch. M. CERNA, "How the Inter-american system for the protection of human rights has
contributed to the development of international law", in O. DELAS, Les juridictions internationales:
complémentarité ou concurrence?, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 130-131. Entre la fin des années
1970 et le début des années 1980, les gouvernements latino-américains auraient ordonné la
disparition d’entre 11000 et 13000 personnes. L. SHAVER, op. cit., p. 667.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
233
22. Commission interaméricaine des droits de l’homme, Communiqué de presse : « CIDH culmina
visita a República Dominicana»; disponible sur: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/
2013/097.asp
23. Cette dernière possibilité a sans doute permis au système de connaitre des cas qui autrement,
par crainte d’intimidation ou manque de moyens financiers, ne lui seraient pas parvenus (J. M.
PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, op. cit., p. 5).
24. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 117.
25. Articles 44 et suivants du Pacte de San José.
26. Article 25.
27. S. GARCIA RAMIREZ, « El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos”, in P. HÄBERLE et D. GARCÍA BELAUNDE
(Coord.), El control del poder – homenaje a Diego Valades, t. I, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2011, p. 103.
28. A. HUNEEUS, op. cit., pp. 498-499. Au cours des 10 dernières années, le nombre de plaintes
soumises a presque doublé, mais le nombre de celles qui sont déclarées recevables n’a pas fluctué
de façon proportionnelle. Selon le rapport annuel de la Commission, durant l’année 2013, celle-ci
a reçu 2,061 plaintes concernant 27 pays : http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/indice.asp.
29. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 119.
30. J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., pp. 403-404.
31. R. RIVIER, “Responsibility for violations of human rights obligations: Inter-
american mechanisms”, in J. CRAWFORD et al. (Ed.), The law of international responsibility,
New York, Oxford University Press, 2010, pp. 755-756.
32. J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 404.
33. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 116.
Entre 2004 et 2009, la Commission a soumis en moyenne 12 cas par année à la Cour. A. HUNEEUS,
op. cit., p. 499. La situation pour les trois dernières années est la suivante : en 2010, le nombre
d’affaires soumises s’élevait à 16, ayant atteint le sommet de 23 pour l’année 2011, pour retomber
à 12 en 2012, et 11 en 2013 d’après le rapport annuel de la Cour. Cour interaméricaine des droits
de l’homme, Rapport annuel (2013), disponible sur http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/FRE/
fre_2013.pdf.
34. R. RIVIER, op. cit., p. 754.
35. Voir dans ce sens l’étude réalisée par Ariel DULITZKY, "Too little, too late: the pace of
adjudication of the Inter-american Commission on human rights", Loyola of Los Angeles
international & comparative law review, vol. 35, printemps 2013. Le délai qui s’écoule entre la
présentation initiale de la plainte devant la Commission et son introduction au greffe de la Cour,
le cas échéant, est d’en moyenne huit ans (J. PASQUALUCCI, « The Americas », op. cit., p. 402).
36. C’est le cas pour 11 États membres de l’Organisation, dont les États-Unis et le Canada.
37. G. L. NEUMAN, op. cit., pp. 102-103.
38. A. HUNEEUS, op. cit., p. 499
39. G. L. NEUMAN, op. cit., p. 103.
40. Voir dans ce sens L. BURGORGUE-LARSEN, “Les méthodes d’interprétation de la
Cour interaméricaine des droits de l’homme - Justice in context”, Revue trimestrielle des
droits de l’homme, n°97, 2014, pp. 40-46.
41. L’ancien juge GARCIA RAMIREZ ajoute à ces deux facettes de ce qu’il appelle la «mission
protectrice» de la Cour, un aspect préventif et un autre exécutif. S. GARCIA RAMIREZ, "Panorama
de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos", op. cit., p. 354.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
234
42. Cour interaméricaine des droits de l’homme, "Otros Tratados" Objeto de la Función
Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A n° 1.
43. Cour interaméricaine des droits de l’homme, El Derecho a la Información sobre la
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva
OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A n° 16.
44. D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, "The Inter-american human rights system:
selected examples of its supervisory work", in S. JOSEPH et A. Mc BETH, Research
handbook on international human rights law, Northampton, Edward Elgar, 2010, pp.
365-366.
45. L. SHAVER, op. cit., p. 649.
46. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto
de la migración y/o en necesidad de protección internacional : opinion consultiva OC-21/14 del 19 de
agosto de 2014. Serie A, n° 21.
47. J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure of the Inter-american Court of human rights, op. cit.,
p. 12.
48. L. SHAVER, op. cit., p. 654.
49. D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 367. Parmi les 35 Etats qui forment
l’OÉA, 20 reconnaissent présentement la compétence contentieuse de la Cour:
Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador,
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République
Dominicaine, Surinam, et Uruguay ; nous rappellerons ici que le Vénézuela a annoncé
en septembre 2012 qu’il dénonçait le Pacte de San José.
50. L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme,
Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 45-46.
51. Convention américaine relative aux droits de l’homme, disponible sur le site internet de la
Commission : http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm.
52. A titre indicatif, selon le rapport annuel de la Cour pour 2008 (p. 77), les violations les plus
souvent déclarées dans ses arrêts sont relatives aux garanties judiciaires (81 occasions), la
protection judiciaire (79), droit à l’intégrité de la personne (66), droit à la liberté personnelle (51),
droit à la vie (48), l’obligation d’adopter des dispositions de droit interne (41); les chiffres pour les
autres violations reconnues par la Cour aux dispositions du Pacte de San José et aux traités
connexes tombent par la suite à 13 (dans le cas de la Convention interaméricaine pour la
prévention et la répression de la torture). Le rapport est disponible sur le site internet de la Cour:
http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/spa20081.pdf
53. L. SHAVER, op. cit., p. 649
54. Ibidem, p. 659.
55. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel (2013), précité, p. 34.
56. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C n°. 63.
57. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C n° 134.
58. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C n°
99.
59. Le texte de ces instruments est disponible à partir du site internet de la Cour : http://
www.corteidh.or.cr/sistemas.cfm?id=2
60. D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., pp. 370-372.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
235
61. G. L. NEUMAN, op. cit., pp. 116-117.
62. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123; opinion séparée du juge
CANÇADO TRINDADE, § 92. Certains auteurs considèrent par ailleurs que les interprétations du
tribunal de San José vont, à l’occasion, trop loin ; voir, dans ce sens, G. L. NEUMAN, op. cit., p. 123.
63. A. HUNEEUS, op. cit., pp. 500-503.
64. S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos, op. cit., pp. 94-95.
65. L. SHAVER, op. cit., p. 670.
66. A. PAUL, “La Corte interamericana in vitro: comentarios sobre su proceso de toma de
decisiones a propósito del caso Artavia”, Derecho publico iberoameicano, n°2, 2013, p. 328.
67. T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-
american Court of human rights and beyond”, Columbia journal of transnational law, vol.
46, 2008, p. 354.
68. Ch. TOMUSCHAT, « La protection internationale des droits des victimes », in J.-F.
FLAUSS, La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes,
Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 19.
69. L. BURGORGUE-LARSEN et U. DE TORRES AMAYA, Les grandes décisions de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 257.
70. Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 8.
71. D. SHELTON, “The jurisprudence of human rights tribunals on remedies for human
rights violations”, in J.-F. FLAUSS, op. cit., pp. 69-70.
72. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Cantoral Benavides vs. Perú.
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C n°88; opinion
séparée, § 10.
73. General Comment No. 31 [80] “Nature of the General Legal Obligation Imposed on
States Parties to the Covenant”, Document CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, adopté le 29 mars
2004.
74. Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 11.
75. M. C. BASSIOUNI, “International Recognition of Victims’ Rights”, Human Rights Law
Review, vol. 6, n°2, 2006, p. 278.
76. S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos
humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. constitucional bajo la
reforma de 2011)”, in M. CARBONELL et P. SALAZAR (Coord.), La reforma constitucional de derechos
humanos: un nuevo paradigma, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, pp.
175-176.
77. Disponible sur: http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm
78. S. GARCIA RAMIREZ, ”El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 93.
79. L. SEMINARA, op. cit., p. 373.
80. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso El Amparo vs. Venezuela.
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C n° 28.
81. S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 104.
82. Ibidem, p. 116. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de las Hermanas Serrano Cruz
vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de marzo de 2005. Serie C n° 120.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
236
83. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C, n° 109, §278.
84. Arrêt Cantoral Benavides c. Pérou, précité, § 80.
85. A. A. CANÇADO TRINDADE, “Reminiscencias de la Corte interamericana de derechos
humanos en cuanto a su jurisprudencia en materia de reparaciones”, in A. VON
BOGDANDY, E. FERRER MAC-GREGOR, et M. MORALES ANTONIAZZI (Coord), op. cit., p.
208.
86. S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos”, op. cit., pp. 105-106.
87. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C n°. 42, § 192.
88. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y
otros) vs. Guatemala, précité.
89. D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit, p. 375.
90. S. GARCIA RAMIREZ, "El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos", op. cit., p. 108.
91. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia,
precité, §298.
92. J. M. PASQUALUCCI, "The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-
American Human Rights System", Human Rights Law Review, vol. 6, n° 2, 2006, p. 282.
Voir également l’article de D. CONTRERAS-GARDUÑO et S. RAMBOUTS, “Collective
reparations for indigenous communities before the Inter-american Court of human
rights”, Merkourios – Utrecht journal of international and European law, vol. 27, n° 72, 2010.
93. J. M. PASQUALUCCI, “The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American
Human Rights System”, op. cit., pp. 320-322.
94. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala.
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C n° 116, § 90 ss.
95. Ch. TOMUSCHAT, op. cit., p. 21.
96. T. M. ANTKOWIAK, “An emerging mandate for international courts: Victim-
centered remedies and restorative justice”, Stanford journal of international law, été 2011,
p. 297-298.
97. S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 116-117.
98. T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-american
Court of human rights and beyond”, op. cit., p. 379.
99. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C n° 114.
100. T. M. ANTKOWIAK, “Remedial approaches to human rights violations: The Inter-
american Court of human rights and beyond”, op. cit., p. 381.
101. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) vs
Mexico. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de
2009. Serie C n° 205.
102. S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos
humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. constitucional bajo la
reforma de 2011)”, op. cit., pp. 195-196.
103. S. GARCIA RAMIREZ, “El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos”, op. cit., p. 118-119.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
237
104. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo
Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C
n°. 73
105. S. GARCIA RAMIREZ, op. cit., pp. 113-114.
106. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Radilla Pacheco vs. Mexico. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C n°
209.
107. R. RIVIER, op. cit., pp. 743-744.
108. S. GARCIA RAMIREZ, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos
humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. constitucional bajo la
reforma de 2011)”, op. cit., pp. 196-197.
109. R. RIVIER, op. cit., pp. 748-749.
110. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panama. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C n° 72.
111. D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 378.
112. Article 69.
113. J. SCHÖNSTEINER et al., “Reflections on the human rights challenges of
consolidating democracies: recent developments in the inter-american system of
human rights”, Human rights law review, vol. 11, no. 2, 2011, p. 386.
114. A. HUNEEUS, op. cit., pp. 500-502.
115. Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, p. 77.
116. D. RODRIGUEZ-PINZON et C. MARTIN, op. cit., p. 369.
117. F. GONZALEZ, Sistema interamericano de derechos humanos, op. cit., pp. 130 et s.
118. J. SCHÖNSTEINER et al., op. cit., p. 387. Selon le Rapport de la Cour (p. 93), à la fin de 2013,
suite à des contributions de la Norvège et du Danemark, le montant total affecté au financement
du Fonds s’élevait à USD 355000.
119. Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, p. 96.
120. Voir, en ce sens, l’article de M. F. LOPEZ PULEIO, “La puesta en escena del defensor público
interamericano”, Anuario de derechos humanos, no. 9, 2013. Selon le Rapport de la Cour (p. 83),
l’assistance au défenseur interaméricain a été allouée dans quatre cas.
121. J. SCHÖNSTEINER et al., op. cit., pp. 387-388.
122. Rapport annuel de la Cour interaméricaine (2013), précité, pp. 101-102.
123. P. A. ACOSTA ALVARADO, Tribunal europeo y Corte interamericana de derechos
humanos: escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?,
Bogota, Universidad externado de Colombia, 2008, partie I, passim.
124. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Artículo 55 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie
A No. 20
125. L. SHAVER, op. cit., pp. 645-646.
126. A. HUNEEUS, op. cit., pp. 494-495.
127. Ibidem, p. 496.
128. Ibidem, p. 502.
129. Voir notamment, en ce sens, K. A. CASTILLA, “ ¿Control interno o difuso de
convencionalidad ? Una mejor idea: la garantía de tratados”, Anuario mexicano de derecho
internacional, vol. XIII, 2013.
130. D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism
in Latin America”, op. cit., pp. 1839-1840.
131. Ibidem, pp. 1841-1843.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
238
132. Ibidem, p. 1854.
133. L. A. FRANCO, "Recepción de la jurisprudencia interamericana en el ordenamiento jurídico
argentino", in S. GARCIA RAMIREZ, et M. CASTAÑEDA HERNANDEZ (Coord.), Recepción nacional del
derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte
interamericana, México, Universidad Nacional Autónoma de México – Secretaria de relaciones
exteriores – Corte interamericana de derechos humanos, 2009, pp. 166-168.
134. M. E. VENTURA ROBLES, "Algunos ejemplos de los efectos de la aplicación de la doctrina y
jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos en Costa Rica, Guatemala y la
Republica Dominicana", in S. GARCIA RAMIREZ et M. CASTAÑEDA HERNANDEZ (Coord.), op. cit.,
pp. 241-242.
135. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Condición Jurídica y Derechos Humanos
del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A n° 17.
136. R. ABREU BLONDET, "La incidencia de la jurisprudencia de la Corte interamericana de
derechos humanos en las decisiones de los tribunales de la República Dominicana", in S. GARCIA
RAMIREZ et M. CASTAÑEDA HERNANDEZ (Coord.), op. cit., p. 186.
137. M. E. VENTURA ROBLES, op. cit., pp. 222-230.
138. Cour interaméricaine des droits de l’homme. Garantías Judiciales en Estados de
Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9.
139. D. GARCIA SAYAN, “Constitutional review: the Inter-american Court and constitutionalism
in Latin America”, op. cit., pp. 1853-1854.
140. Ibidem, pp. 1851-1852.
141. Ibidem, pp. 1835-1836.
142. F. GONZALEZ, “The experience of the Inter-american human rights system”, op. cit., p. 125.
143. G. L. NEUMAN, op. cit., p. 101.
144. C’est la conclusion à laquelle arrivent les deux auteurs ayant publié récemment des
ouvrages exhaustifs sur le système interaméricain : J. M. PASQUALUCCI, The practice and procedure
of the Inter-american Court of human rights et F. GONZALEZ, El sistema interamericano de derechos
humanos (précités).
145. J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 414.
146. A. HUNEEUS, op. cit., p. 519. Pour une analyse détaillée du sujet, voir l’article de C.
M. BAILLET,
“Measuring compliance with the Inter-american Court of human rights: The ongoing
challenge of judicial independence in Latin America”, Nordic journal of human rights, vol.
31, no. 4, 2013, ou encore celui de F. BASCH et al., "The effectiveness of the Inter-
american system of human rights protection: A quantitative approach to its
functioning and compliance with its decisions", SUR – Revista internacional de derechos
humanos, vol. 7, n° 12, juin 2010.
147. "Fifty years of the European Court of human rights viewed by its fellow
international courts - Remarks by Paolo Carozza, President of the Inter-american
Commission on human rights", Strasbourg, 30 janvier 2009, pp. 5-6; vu sur: http://
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3B662702-FFDB-4187-
AAC5-6B926725DF35/0/30012009PresidentCarozzaSeminar_eng_.pdf. Voir également, en ce
sens, J. PASQUALUCCI, “The Americas”, op. cit., p. 414.
148. European Court of human rights, Research report: References to the Inter-american court of
human rights in the case-law of the European court of human rights, 2012; disponible sur http://
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
239
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7EB3DE1F-C43E-4230-980D-63F127E6A7D9/0/
RAPPORT_RECHERCHE_InterAmerican_Court_and_the_Court_caselaw.pdf
149. S. GARCIA RAMIREZ, "El amplio horizonte de las reparaciones en la jurisprudencia
interamericana de derechos humanos", op. cit., p. 102.
150. Commission interaméricaine des droits de l’homme, "Plan estratégico 2011-2015",
http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP26757S-2.pdf. Voir également l’article d’A. URREJOLA, “El
sistema interamericano de derechos humanos: el debate sobre su fortalecimiento en el
seno de la Organización de Estados Americanos”, Anuario de derechos humanos, no. 9,
2013, ainsi que les contributions de M. PINTO, J. E. TAIANA, et V. KRSTICEVIC publiées
dans une section dédiée à l’avenir du système interamericain de Human rights brief, vol.
20, no.2, hiver 2013.
ABSTRACTS
The Inter-American system of human rights protection, as one of the three regional mechanisms,
has several features which separate it from its African and European counterparts. Two
specialised organs of the Organisation of American Sates – the Commission and the Court – are
the pillars of the system. The first is in charge, among other tasks, of receiving and analysing the
complaints filed by individuals who consider themselves a victim of a violation of the rights
granted by the American Convention on Human Rights; the Court issues advisory opinions
generally focusing on the interpretation of this treaty, considers the complaints forwarded by
the Commission, and orders the reparations it believes to be fit. This is precisely what separates
the system from others, as reparations ordered by the Court go far beyond a mere monetary
compensation. The dynamic character of the system is reflected by many changes that have
occurred in the last few years, aimed at improving it.
Le système interaméricain de protection des droits de l’homme, comme l’un des trois
mécanismes régionaux existant, comporte plusieurs particularités qui le distinguent de ses
homologues africaine et européenne. Deux organes spécialisés de l’Organisation des États
américains - la Commission et la Cour – sont les piliers du système. Le premier a pour mission,
entre autres, de recevoir et analyser des plaintes formulées par des particuliers qui estiment
avoir été victimes de violations des droits prévus dans la Convention américaine des droits de
l’homme; la Cour émet des avis consultatifs portant généralement sur l’interprétation de ce
traité, étudie les plaintes que la Commission lui transmet, et ordonne les réparations qu’elle
estime pertinentes. C’est à ce titre que le système se distingue, les réparations ordonnées par la
Cour allant bien au-delà d’une simple compensation monétaire. Le dynamisme du système est par
ailleurs reflété par différents changements intervenus en son sein au cours des dernières années,
qui cherchent à en améliorer le fonctionnement.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
240
INDEX
Mots-clés: Cour interaméricaine, Commission interaméricaine, Organisation des États
Américains, droits de l’homme, Amériques
Keywords: Inter-American Court, Inter-American Commission, Organisation of American States,
Human rights, Americas
AUTHOR
ÉRIC TARDIF
Éric Tardif est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, et détient un doctorat en droit de
l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), où il est professeur titulaire (par voie de
concours) en droit international public ; il fait également partie du Système national de
chercheurs (SNI) administré par le Gouvernement du Mexique. Entre 2008 et 2011, il a été
Conseiller auprès du Sous-ministre chargé des affaires juridiques et internationales, au Bureau
du Procureur général de la République mexicaine.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
241
Des idéaux à la réalité.Réflexions
comparées sur les processus de
sélection et de nomination des
membres des Cours européenne et
interaméricaine des droits de
l’homme
Laurence Burgorgue-Larsen
AUTHOR'S NOTE
Cet article est le résultat d’une étude présentée en mars 2014 à Notre Dame Law School
(USA), à l’invitation de Paolo G. Carozza, lors d’un séminaire de réflexions concernant le
« Futur du système interaméricain des droits de l’homme ». L’idée était de présenter
plusieurs types de propositions afin d’améliorer les procédures existantes au sein du
système interaméricain en se basant sur l’expérience européenne. Le lecteur
comprendra, ce faisant, qu’à de nombreux égards cet article a gardé son allure originale
de « rapport ».
1 L’indépendance et l’impartialité des tribunaux ont toujours attiré l’attention des
chercheurs1. Si pendant longtemps le curseur analytique s’était arrêté sur la
problématique à l’échelle interne, la multiplication des juridictions internationales 2 a
renouvelé ces approches en attirant l’intérêt doctrinal des internationalistes 3. De
nombreux facteurs – institutionnels, financiers, procéduraux et juridiques – participent
à assurer ces deux principes4 ; les processus internes et internationaux de sélection et
de nomination des juges en font partie. Depuis l’accroissement des juridictions
internationales, une imposante littérature juridique a vu le jour – incluant des rapports
produits par des organismes d’experts à l’instar de l’Institut de droit international 5 – qui a
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
242
clairement mis en évidence les liens particulièrement étroits entre les processus de
sélection et l’indépendance des membres des juridictions 6. Le système interaméricain
ne fait évidemment pas exception7. Alors qu’il est en train de vivre une de ses plus
graves crises politiques depuis sa création8, la question du processus de sélection et de
nomination des membres des organes interaméricains devient d’autant plus cruciale
afin de renforcer leur légitimité9.
2 Les approches idéalistes et réalistes ont toujours marqué le cours des réflexions
théoriques et pratiques relatives au droit des droits humains. Il s’agit d’un mouvement
pendulaire qui irrigue toute étude en la matière10. Si les idéaux sont systématiquement
présents, les objectifs fixés ont peu de chance d’être atteints et de se transformer en
politiques publiques effectives ; pire, ils peuvent être complètement détournés,
dénaturés, viciés. A l’inverse, si le principe de réalité – pour ne pas dire la Real politik –
est le seul et unique point de vue pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’une politique, le cynisme peut être ravageur et aucun progrès normatif ne peut voir
le jour.
3 Cet article tente de proposer – dans le cadre d’une démarche comparative où les
procédures des deux systèmes européens sont analysées de façon critique 11 – certaines
améliorations du processus de sélection et de nomination des membres de la
Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l’homme. Les deux extrêmes
que sont l’Idéalisme et le Réalisme ont été, de façon récurrente, à l’origine des réflexions
qui vont suivre: le premier fut un aiguillon stimulant afin de présenter des propositions
innovantes voire extrêmes ; le second fut un rappel incessant d’une tendance, pour ne
pas dire d’une règle d’airain, selon laquelle le ‘Mieux est l’ennemi du Bien’. Au bout du
compte, un équilibre a tenté d’être trouvé afin que l’idéalisme puisse déboucher sur
une approche réaliste en termes politiques s’agissant des processus complexes de
sélection et de nomination des juges.
4 Il sera successivement examiné les processus nationaux (I) et internationaux (II) de
sélection et de nomination des candidats aux fonctions de commissaires et de juges
interaméricains. Ces deux questions seront analysées tout à la fois sous un angle
procédural, afin d’identifier – sur la base d’une approche comparative – les meilleurs
critères permettant d’inciter les Etats, mais aussi l’OEA comme telle, à mettre en place
des bonnes pratiques de gouvernance judiciaire, mais également sous un angle matériel
(afin de discerner le profil professionnel des candidats, leur sexe, leur origine ethnique
etc...).
I. Les processus nationaux de sélection des candidats
5 Comment éviter que les processus de sélection des candidats soient le moins opaques
possibles ? Comment éviter qu’ils soient marqués par les stigmates des intérêts
exclusivement politiques voire du népotisme ? En un mot, comment faire pour que les
seules compétences professionnelles des candidats soient prises de compte ? Si ces
interrogations ne sont pas nouvelles12, elles n’ont engendré en réalité aucune réponse
satisfaisante dans la mesure où cette problématique a longtemps relevé des «affaires
intérieures» des Etats au nom du sacro-saint principe de souveraineté nationale.
Toutefois, ce dernier est aujourd’hui quelque peu battu en brèche par la montée en
puissance de l’exigence de transparence. Du coup, même si le droit international ne
peut entièrement réguler cet aspect national du processus de sélection des candidats à
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
243
des fonctions judiciaires internationales, il peut néanmoins arriver à l’orienter, voire à
l’encadrer. Une approche comparative (A) permettra de prendre la mesure des enjeux
qui se présentent aux acteurs du système interaméricain (B).
A. Etat des lieux comparatif
6 Aujourd’hui, à l’échelle internationale, il n’y a guère que le Statut portant création de la
Cour pénale internationale (CPI) qui a intégré des règles très précises en la matière 13.
Ainsi, l’article 36§4 a) enjoint les Etats parties au Statut de présenter un candidat soit i)
selon la procédure de présentation des candidatures aux plus hautes fonctions
judiciaires dans l’Etat en question ; soit ii) selon la procédure de présentation des
candidatures à la Cour internationale de justice prévue dans le statut de celle-ci.
7 Dans le cadre de la garantie régionale des droits de l’homme, on ne recense aucun texte
conventionnel conclu par les Etats contractants qui précise les modalités de sélection
des candidats à la fonction de commissaire ou de juge. Toutefois, les organisations
internationales qui abritent les activités des systèmes interaméricain et européen des
droits de l’homme (OEA et Conseil de l’Europe) ont commencé à présenter des
directives minimales en ce sens.
8 A l’échelle européenne, ce sont plusieurs textes de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (recommandations et résolutions) qui se sont attachés à mettre en
avant des éléments jugés cruciaux afin d’assurer – notamment – les qualifications
professionnelles des juges14. Il faut dire que l’adhésion de nombreux pays de l’Est
européen au Conseil de l’Europe et, ce faisant, l’intégration de nouveaux juges en
provenance de ces pays, engendrèrent de sérieux problèmes concernant le profil et les
qualités professionnelles des candidats dans le contexte de la disparition de la
Commission et de l’instauration de la Cour «unique»15. Du coup, l’Assemblée
parlementaire – en étant d’ailleurs à cet égard souvent en opposition frontale avec le
Comité des ministres qui a longtemps estimé que les procédures nationales de sélection
relevaient de la souveraineté nationale – s’est fait un point d’honneur à dégager au fil
du temps une série de principes de base que doivent respecter les candidats présentés
par les Etats. Elle n’a eu de cesse de rappeler qu’afin de maintenir l’efficacité mais aussi
la légitimité de la Cour européenne, les procédures devaient être tout à la fois
équitables, transparentes et aussi homogènes que possibles entre les Etats parties. Les
deux fléaux qu’elle entend combattre au stade de la procédure interne de sélection sont
la politisation à outrance et la présentation de candidats insuffisamment qualifiés 16.
9 A cet égard, la résolution n°1646 (2009) est significative 17. L’Assemblée parlementaire
enjoint les Etats de respecter les règles suivantes quand ils sélectionnent puis désignent
des candidats à la Cour européenne (point 4) : 4.1. Procéder à des appels à candidature
ouverts et publics (notamment à travers la presse spécialisée) ; 4.2. Décrire les
modalités selon lesquelles les candidats proposés ont été sélectionnés ; 4.3. Transmettre
à l’Assemblée les noms des candidats dans l’ordre alphabétique ; 4.4. Veiller à ce que les
candidats aient une connaissance active de l’une des deux langues officielles du Conseil
de l’Europe et une connaissance passive de l’autre ; 4.5. Ne présenter, si possible, aucun
candidat dont l’élection pourrait entraîner la nécessité de nommer un juge ad hoc.
10 Ce lobbying de l’Assemblée parlementaire a fini par être pris au sérieux par le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe. En effet, en plus des nombreuses «pathologies»
révélées par les chroniques du professeur Flauss depuis l’instauration de la Cour unique
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
244
consécutive à l’entrée en vigueur du Protocole n°1118, les péripéties liées au processus
de sélection du dernier candidat français19 ont fini par convaincre tous les acteurs qu’il
était temps d’être très ferme à l’égard du niveau des candidats en rendant effectives les
directives établies par l’Assemblée parlementaire.
11 C’est dans ce contexte que le Comité des ministres établissait, le 29 mars 2012, des
Lignes directrices concernant la sélection des candidats pour le poste de juge à la Cour
européenne des droits de l’homme20, document qu’il convient de lire de façon combinée
avec le rapport explicatif, particulièrement éclairant sur les bonnes pratiques à
suivre21. Dans la foulée, la Déclaration de Brighton – qui accueillait une Conférence de
haut niveau des Etats parties du Conseil de l’Europe (avril 2012) – rappelait
l’importance de la qualité professionnelle des juges qu’elle reliait expressément à
«l’autorité et la crédibilité de la Cour» (point 21 de la Déclaration) 22.
12 La pratique étatique est extrêmement variable. Pendant longtemps, elle a révélé dans la
grande majorité des cas la mainmise des Exécutifs sur le processus interne de
sélection23. Il n’empêche, les pressions répétées des deux organes principaux du Conseil
de l’Europe – Assemblée parlementaire dans un premier temps, qui finit par être rejoint
par le Comité des ministres – ont été bénéfiques et ont révélé la mise en place
progressive de «bonnes pratiques» dans certains Etats, même si tout est loin d’être
encore parfait.
13 Il faut signaler à ce stade qu’il est extrêmement difficile de disposer d’un état des lieux
précis et circonstancié des procédures nationales de sélection en Europe. Certains Etats
transmettent en effet de façon officielle à l’Assemblée parlementaire leur procédure de
sélection en la rendant, ce faisant, publique et accessible : c’est le cas de la Slovaquie 24.
Ce n’est pas toutefois la règle. Pour la plupart des autres Etats, les informations
obtenues ont ainsi été le fruit de la combinaison de plusieurs éléments : l’accès à des
sources doctrinales pertinentes, l’accès à des rapports spécifiques des organes du
Conseil de l’Europe et in fine des discussions menées avec certains juges de la Cour
européenne et des membres du greffe25. Cette difficulté d’accès à l’information révèle
en soi que la transparence est loin d’être effective ; il faudrait imaginer un rapport
publié à intervalles réguliers par les services du Conseil de l’Europe (plus
particulièrement ceux de l’Assemblée parlementaire), auquel il serait octroyé une large
publicité et qui dresserait un état des lieux les plus circonstanciés possibles sur toutes
les procédures nationales de sélection. Partant, le contrôle externe (par les ONG et les
universitaires notamment) serait renforcé et s’ajouterait au processus interne de
monitoring. Encore faudrait-il que les Etats transmettent, de bonne foi, les
informations pertinentes en ce sens...
14 Ceci étant dit, on décèle grosso modo trois catégories de procédures nationales de
sélection conformément à ce qu’un rapport de l’Assemblé parlementaire du Conseil de
l’Europe mit en évidence : les procédures ad hoc ; les procédures mises en place sans
base juridique formelle et, pour finir, les procédures établies grâce à une base juridique
formelle26.
15 S’agissant des procédures ad hoc – qui existent dans quatorze pays – 27, il a été choisi de
présenter les pratiques du Royaume-Uni et du Luxembourg. S’agissant de l’approche
britannique, elle se déroule comme suit : «An advertisement for the position is put in
the national press, with a closing date for written applications the following month. A
month later a panel meets to select candidates for interview. The panel interviews
potential candidates and recommends three nominations. The three nominees are
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
245
approved by UK ministers and the list is transmitted to the CoE by the end of that
month. The whole process takes about three months28». Pour les élections à la Cour en
200429, le Panel indépendant était présidé par Sir Hayden Phillips, Secrétaire permanent
de la Direction des affaires constitutionnelles et composé par le Président de la Cour de
Cassation (Lord Cullen), l’ancienne présidente de la Commission pour l’égalité des
chances (Joanna Foster) et du Conseiller juridique du Ministère des affaires étrangères
et du Commonwealth (Sir Michaël Wood).
16 Quant à la procédure luxembourgeoise, elle ne repose sur aucune base juridique ; le
poste vacant est publié au Mémorial (JO luxembourgeois) et, plutôt qu'un comité
d'évaluation, il y a une sélection discrétionnaire par le Conseil de gouvernement qui
transmet par la suite la liste à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Lors
de la réélection de Dean Spielmann (actuel président de la Cour européenne), aucun
autre candidat ne s'est manifesté. Partant, une annonce a dû être faite à la radio pour
motiver de potentiels candidats... Ce fut un échec relatif, des noms de fonctionnaires
qui n'étaient pas particulièrement enthousiastes – et qui savaient que Dean Spielmann
allait de toute manière être réélu – furent apposés sur la liste de trois noms,
uniquement pour satisfaire formellement aux exigences posées par l’Assemblée
parlementaire... On prend la mesure, avec cet exemple, des difficultés qu’il y a, pour un
«petit pays», à trouver des candidats à la hauteur du poste.
17 Quinze pays ont mis en place des procédures sans base juridique formelle 30, parmi eux,
la Belgique et la France.
18 En Belgique, le remplacement de la juge et Vice-présidente Françoise Tulkens – dont le
mandat arrivait à terme en 2012 – s’est fait selon la procédure informelle suivante 31. Un
appel à candidature a été lancé au Journal officiel belge, dans la presse spécialisée, dans
le cadre des activités des Cours suprêmes, de l’ordre des Barreaux des avocats et au sein
des Universités. Treize postulants se sont manifestés et ont ensuite été auditionnés par
un jury de six personnes chargées de sélectionner les profils les plus adéquats. La
présence, au sein de ce Panel d’experts, de deux membres du bureau de l’agent du
gouvernement belge devant la Cour européenne n’a pas été jugée opportune par de
nombreux observateurs. La procédure révèle que le gouvernement a continué à jouer
un rôle clé dans le processus. En effet, les cinq postulants présélectionnés par le Panel
ont finalement été soumis au Conseil des ministres qui fut l’instance qui présenta la
liste des trois candidats à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Aucune
femme n’y figurait, alors que le professeur Eva Brems – dont les compétences ne
peuvent être contestées –s’était portée candidate.
19 La France dispose d’une longue tradition en matière de sélection des juges
internationaux, non exempte de critiques toutefois comme on le verra. Cette tradition
prend appui sur les «règles classiques» mises en place dans le cadre des «groupes
nationaux» de la Cour permanente d’arbitrage32. On sait que le statut de la Cour
internationale de Justice a prévu de confier la sélection nationale de ces candidats à ces
groupes nationaux. Dans ce contexte, la France a élargi les fonctions de son «groupe
national»33 : non seulement, il participe à la sélection des candidats à la CIJ, mais
également à celle des candidats à la CEDH et à la CPI. Autrement dit, la France a
«homogénéisé» au maximum la procédure de sélection de «ses» candidats aux
fonctions de juges internationaux en généralisant le mécanisme prévu par le statut de
la CIJ – dont on a vu qu’il avait été «codifié» par l’article 36§4 ii) du statut de la CPI. En
soi, il n’y a là rien de négatif. Toutefois, la composition du groupe national (dont les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
246
membres sont désignés par l’Exécutif, plus précisément par le Ministère des Affaires
étrangères), révèle non pas l’absence de qualifications (la compétence des membres est
absolument indiscutable), mais un corporatisme évident et continu. La présence au sein
du groupe français de la CPA de juristes du Ministère des affaires étrangères et de
Conseillers d’Etat (qui en général suivent des carrières dans ces deux institutions)
démontre le «verrouillage» du système en faveur de ceux qui ont fait carrière au «Quai
d’Orsay» (comme diplomates et agents du gouvernement) et/ou au Conseil d’Etat.
Partant, en France, les choses sont claires et il s’agit d’un «classique» de la culture du
pays : la place des universitaires est quasi-nulle au sein des juridictions internationales
car ils n’ont jamais été majoritaires au sein du «groupe français» de la CPA. Pendant
longtemps, leur présence a été inexistante ; elle est aujourd’hui réduite à la «portion
congrue»34. Dans toute l’histoire de la sélection française, aucun universitaire n’a
accédé aux fonctions de juge international (à la CIJ, à la CEDH, à la CJUE, à la CPI, ou
encore au TPIY ...). La seule exception – notable – a existé pour le poste de juge au
Tribunal International de Droit de la Mer (TDIM) : l’universitaire en question (J-P. Cot) a
toutefois été également un «politique» (puisqu’il avait été ancien ministre de la
coopération sous le gouvernement de François Mitterrand).
20 Ce sont seulement sept pays qui ont établi une base juridique formelle afin de mener à
bien la sélection des candidats, parmi eux, la Slovaquie et la Roumanie 35.
21 En Slovaquie, la Constitution de 1992 prévoit les grandes lignes de la procédure de
sélection au sein d’instances judiciaires internationales. En effet, selon l’article 141 a).
§4 d. de la Constitution, il appartient au Conseil de la Magistrature (CM) de soumettre
au Gouvernement des propositions de candidats pour les fonctions de juge au sein
d’instances judiciaires internationales. Le Gouvernement peut, quand il doit approuver
la sélection des candidats, se prononcer uniquement sur la proposition soumise par le
Conseil de la Magistrature. On a donc affaire à un mécanisme régulé au niveau
constitutionnel et qui laisse une importante marge de manœuvre à une instance
indépendante. Toutefois, le Gouvernement n’est pas obligé de suivre l’avis du Conseil
de la magistrature (cf «peut»). Dans la pratique toutefois, il a jusqu’à présent suivi les
avis du CM. Organe suprême du système judiciaire, le CM est en effet indépendant du
pouvoir législatif et exécutif ; il comprend dix-huit membres, qui sont tous des juges en
exercice. Pour sélectionner dans ce cas-ci les candidats à la fonction de juge de la Cour
européenne, le Conseil s’est acquitté de ses obligations conformément à la procédure
nationale prévue à l’article 27g) de la loi 185/2002 sur le Conseil de la magistrature,
telle que modifiée (ci-après «loi sur le Conseil de la magistrature»). En vertu de l’article
27g § 1 de la loi, la désignation de candidats en vue de l’élection à la fonction de juge
d’une instance internationale peut être proposée au Conseil par : a). un membre du
Conseil de la Magistrature; b). le Ministre slovaque de la Justice ; c. une organisation
professionnelle de juges ; ou d). d’autres organisations professionnelles de juristes 36. La
candidature à la fonction de juge d’une instance internationale est soumise au CM. Pour
être approuvée, elle doit réunir la majorité des voix de ses membres lors d’un vote à
bulletins secrets.
22 En Roumanie, la procédure de sélection nationale des candidats est réglementée par
l’Ordonnance du Gouvernement n° 94/1999 relative à la participation de la Roumanie
aux procédures devant la CEDH et devant le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe. Conformément à l’art. 5 al. 1, la nomination des candidats à la fonction de
juge à la Cour EDH se fait par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil Supérieur
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
247
de la Magistrature (CSM) suite à leur audition. Sans avoir une procédure détaillée de
sélection – qui soit réglementée par la législation primaire ou secondaire – le CSM a
émis en 2007 une procédure de sélection, suite à la demande du Ministère des Affaires
Etrangères. Par conséquent, il existe trois étapes de la procédure :
23 La publicité de l’appel aux candidatures : cet appel est publié sur la page d’Internet du
CSM, accompagné par le modèle de CV proposé par le Conseil de l’Europe, par le
calendrier communiqué par le secrétaire général du Conseil de l’Europe, ainsi que par
tous les documents supplémentaires transmis au Ministère des Affaires Etrangères.
L’appel est aussi publié dans un journal de la presse quotidienne et il comprend le
descriptif des conditions pour postuler : la jouissance de la plus haute autorité morale ;
satisfaire les conditions pour l’exercice des hautes fonctions judiciaires ou être un
juriste à la compétence notoire ; avoir une expérience dans le domaine des droits de
l’homme ; connaître au moins l’une des deux langues officielles de la Cour, être capable
de travailler dans l’une de ces deux langues.
24 ) L’audition des candidats est assurée devant l’Assemblée plénière du CSM. Les questions
portent, surtout, sur l’expérience des candidats dans le domaine des droits de l’homme,
l’application de la législation en la matière et la connaissance de la jurisprudence de la
Cour EDH.
25 L’envoi des candidatures. Après l’audition, le CSM envoie la liste des candidats retenus à
plusieurs commissions parlementaires pour avis consultatif (la Commission juridique,
disciplinaire et des immunités ; la Commission pour les droits de l’homme, les cultes et
les minorités nationales de la Chambre des Députés ; la Commission pour les droits de
l’homme et les minorités du Sénat) et au Gouvernement qui est le seul, in fine, qui
décide de transmettre parmi les candidats retenus pour audition, la liste de 3 noms
transmise au Conseil de l’Europe.
26 Sur la base de ces exemples européens tirés de la pratique, que serait-il opportun de
mettre en place dans le cadre du système interaméricain ?
B. Propositions pour le système interaméricain
27 Le système interaméricain a déjà commencé, bien que timidement, à tenter de mettre
sous «pression» les Etats membres de l’OEA comme en témoigne la résolution 2166 de
l’Assemblée générale (adoptée le 6 juin 2006)37. Les Etats sont encouragés à intégrer la
société civile dans le processus national de sélection des candidats à la Commission et à
la Cour interaméricaines, comme à assurer une certaine transparence des candidats in
fine retenus (par la mise en ligne de leurs CV notamment). Toutefois, aucune autre
directive plus précise n’a été établie afin de contraindre les Etats à harmoniser leur
procédure de sélection nationale. Il s’agit d’un début, mais qui doit absolument être
non seulement réitéré, mais également renforcé afin que les Etats parties prennent au
sérieux l’obligation de rendre leurs processus de sélection transparents. Pour ce faire, il
faudrait que d’autres résolutions plus précises soient adoptées afin de dégager les
critères de bonne gouvernance en la matière38.
28 Il serait important que ces critères soient les mêmes pour la Commission comme pour
la Cour interaméricaine : il s’agit des deux «piliers» du système interaméricain qui,
pour continuer d’asseoir et de renforcer leur légitimité, devraient être guidés par les
mêmes principes quant au processus de sélection de leurs membres. Les critères
proposés ci-après doivent s’entendre comme s’appliquant à ces deux instances. Deux
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
248
idées principales ont guidé les propositions qui vont suivre : permettre une
«objectivation» de la procédure afin d’éviter tout type de politisation et de
«corporatisme».
29 La première règle de bonne gouvernance consisterait à faire en sorte que la procédure
nationale de sélection repose sur une base juridique précise et accessible.
30 L’existence d’une base juridique précise contribue incontestablement à assurer un
degré de prévisibilité, de cohérence et de transparence à la procédure de sélection. En
réalité, il s’agit d’une règle élémentaire que tout Etat de droit se doit de suivre.
L’opinion publique en général et les éventuels candidats en particulier doivent
connaître, à l’avance, les règles du jeu.
31 La nature de la base juridique peut être variée. Un seul pays en Europe a opté pour une
réglementation constitutionnelle (Slovaquie) ; la plupart des pays qui ont adopté pour
une base juridique39 ont choisi des textes émanant en général de l’Exécutif (Russie,
Roumanie, Ukraine), avec de rares exceptions en faveur du Législateur (Slovénie,
Finlande).
32 Quoiqu’il en soit, ce qui est important, c’est l’existence d’une base juridique préétablie
qui organise, de façon claire et précise, la procédure nationale de sélection. L’Europe
doit encore énormément progresser sur la question et l’Amérique latine pourrait, sur
ce point, montrer l’exemple.
33 En ce sens, il conviendrait d’assurer à la norme qui organise la procédure de sélection la
plus large diffusion possible en utilisant pour ce faire toute la palette des moyens de
communication comme des instances de diffusion : publication au Journal officiel ; sur
le site web du Ministère de la Justice et des Affaires étrangères ; dans les journaux
nationaux (et le cas échéant les journaux des Etats fédérés) ; dans les revues juridiques
spécialisées ; sur le site web des organismes judiciaires (Hautes cours de justice,
associations de juges, associations d’avocats etc..) ; sur le site web des Ombudsmen et/
ou des commissions nationales des droits de l’homme ; sur le site web des Universités et
des centres de recherche consacrés à l’étude des droits de l’homme ; sur le site web des
ONG spécialisées en matière de droits de l’homme. On pourrait également imaginer que
les sites web de la Commission et de la Cour interaméricaines mettent en ligne les
informations sur les procédures nationales de sélection. Il y aurait ainsi une visibilité
accrue des procédures nationales. Surtout, cela permettrait que des juristes puissent se
porter candidats dans des pays dont ils ne sont pas les ressortissants. Ce point est
d’autant plus important que l’article 53§3 de la Convention américaine dispose que : «
When a slate of three is proposed, at least one of the candidates shall be a national of a
state other than the one proposing the slate.» Un délai suffisant devrait être prévu
pour permettre aux postulants intéressés de répondre à l’appel à candidature : trois
mois semblent raisonnables.
34 La deuxième règle de bonne gouvernance consisterait à faire en sorte que la procédure
nationale de sélection soit effectuée par un Comité d’experts indépendants. Plusieurs
questions ici méritent d’être examinées : elles concernent les modalités de la création
du Comité (qui l’institue ?) ; les règles gouvernant sa composition (qui le compose ?) ;
les modalités de son évaluation (comment décide il ?) et la portée de sa décision (que
décide-t-il ?).
35 - La pratique européenne démontre que les panels d’experts mis en place ont tous
pratiquement été constitués par les Exécutifs (en général sous la tutelle du Ministère
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
249
des affaires étrangères, parfois sous la tutelle du Ministère de la Justice). En soi, il n’y a
donc pas d’indépendance au sens politique du terme avec le pouvoir exécutif. La
pratique démontre également que certains de ces panels ont toutefois réussi à mener
leurs tâches de façon indépendante grâce à leur composition (Royaume-Uni
notamment). Il reste toutefois que le «cordon ombilical» avec l’organe créateur
(l’Exécutif) ainsi que la présence au sein des panels d’experts de représentants du
gouvernement jette toujours, au sein de l’opinion publique et parmi les observateurs
avertis, une suspicion néfaste (comme en atteste le cas belge). L’OEA devrait se
distinguer sur ce point ; elle pourrait inciter les Etats afin que les pouvoirs judiciaires
aient en charge la tâche de constituer ces Comité d’experts indépendants. Ce serait
logique puisqu’il s’agit de sélectionner des candidats à des postes où il est question de
rendre la justice. Plusieurs pays latino-américains ont créé des Conseils supérieurs de la
Magistrature : ainsi de l’Equateur, de la Colombie, du Salvador, du Mexique, du
Venezuela, du Paraguay, du Pérou et de l’Argentine.
36 La mise en place, dans ces pays, d’un Panel d’experts par le Conseil supérieur de la
Magistrature serait un gage d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif ; cela
éviterait tout type de «politisation» du processus. D’autres pays toutefois ne disposent
pas de Conseils supérieurs de la Magistrature – c’est le cas du Chili, de l’Uruguay, du
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de la République dominicaine et du Panama. Ce
sont les Cours suprêmes qui, dans ces pays, ont la mainmise sur la désignation des juges
des instances inférieures. Dans ce cas, on pourrait imaginer qu’il revient aux Cours
suprêmes de ces pays de créer le Comité d’experts indépendants. Pour les pays dont les
juges sont élus par le Peuple (Bolivie), par les Parlements (Haïti, Puerto Rico, Costa
Rica) ou par le Président de la République (Brésil), il faudrait trouver une solution
particulière (qui serait in fine institutionnalisée) afin d’écarter les risques que de tels
processus par nature «politisés» n’aient des conséquences néfastes sur la sélection
interne. La mise en place du Comité d’experts indépendants pourrait être alors confiée
à l’Association nationale des avocats ou à une Institution universitaire de recherche
reconnue à l’échelle du pays.
37 Séparer au maximum l’instance de sélection de l’instance de nomination officielle est
un des points clés de la dépolitisation de la procédure. L’analyse qui va suivre relative à
la composition du Comité a quant à elle pour objectif d’éviter tout type de
corporatisme. En effet, la composition du Panel d’experts nationaux doit être la plus
«représentative» possible en octroyant une place aux différents «acteurs» qui
incarnent des statuts et des légitimités différentes.
38 - La composition du Comité d’experts est cruciale pour son indépendance et pour éviter
la mainmise d’un statut professionnel sur un autre dans le processus de sélection
(comme le cas français le démontre malheureusement). Il devrait être
systématiquement composé (et ce quelle que soit l’autorité qui le constitue), à parts
égales : d’un représentant de la magistrature, de l’ordre des avocats et du monde
académique. Ces trois premiers éléments sont «classiques» et nécessaires. Ils se
retrouvent, peu ou prou, dans les Panels mis en place de façon ad hoc dans certains
pays européens (cf exemples britanniques et belges). En revanche, les particularismes
propres au contexte latino-américain impliquent d’ajouter deux autres types de
représentants : un provenant de l’univers des ONG et un autre représentant
l’institution de l’Ombudsman, i.e. du Defensor del pueblo).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
250
39 Compter sur un représentant de la société civile est essentiel au regard de la force de
celle-ci au sein des Etats latino-américains, mais également dans l’univers des Etats
anglo-saxons (qui se trouvent, pour la plupart, sous la juridiction de la Commission
IDH). En outre, le rapport des ONG au système interaméricain est ancien et permanent.
Ancien, car sans les ONG, le système aurait eu du mal à «démarrer» ; permanent, car ce
sont elles qui lui permettent notamment de continuer à se consolider. Les ONG sont en
effet celles qui soutiennent de nombreuses pétitions et qui présentent de nombreux
amici curiae. Si on ajoute à ces éléments, le fait que l’OEA elle-même entretient des
rapports soutenus avec le monde de la «société civile»40, il y a comme une évidence à lui
faire une place au sein du Panel d’experts nationaux.
40 Quant à la présence d’un représentant de l’institution de l’Ombudsman/Defensor del
Pueblo, cela permettrait de prendre en considération cette institution majeure qui
existe dans la quasi-totalité des pays d’Amérique latine 41 (exception faite il est vrai des
pays anglo-saxons comme les Etats-Unis d’Amérique). La présence au sein du Comité
d’experts de l’Ombudsman national serait particulièrement bienvenue et ce pour deux
grands types de raisons : non seulement parce qu’ils jouissent en général d’un réel
prestige dû à une indépendance avérée42, mais également parce que leurs fonctions –
axées sur la médiation et l’éducation en matière de droits de l’homme – les désignent
particulièrement pour faire partie d’un tel Comité. Au vu de ce qui précède, il serait
opportun que le Comité d’experts ne soit pas composé de plus de cinq personnes. Les
pays qui ne disposeraient pas de la figure de l’Ombudsman, pourraient se contenter de
désigner quatre personnes ou trouver une institution équivalente dans leur système
juridique (ainsi de la Commission nationale des droits de l’homme par exemple).
41 A la question de la représentativité statutaire des membres du Comité d’experts, se pose
celle de leur «représentativité ethnique et sexuelle ». Plus la présence de femmes et de
représentants de communautés ethniques (afro-descendants, indigènes) sera
encouragée en amont (au stade des sélections nationales), plus on peut espérer qu’au
final, la composition des organes interaméricains43 reflète la variété des sociétés du
continent américain. Dans ce contexte, il faudrait que le Comité d’experts, comme tel,
soit composé au moins d’une femme et d’un représentant «ethnique» (afro-descendant
ou indigène), c’est à dire 2 membres sur 5. Il faut immédiatement signaler que
l’exigence de représentativité ethnique ne pourrait pas être imposée à un pays qui n’a
pas «constitutionnalisé» le fait indigène ou qui ne dispose pas en son sein de
Communautés indigènes ou afro-descendantes conséquentes. En revanche, elle devrait
l’être dans le cas contraire. En réalité – excepté le Chili, l’Argentine et l’Uruguay 44 –,
tous les autres Etats du continent disposent de communautés afro-descendantes (ex.
Barbades, Brésil, Colombie, Etats-Unis, Haïti, Jamaïque, Suriname, Venezuela) et
indigènes (tous les pays du continent). Plus le Comité d’experts sera «à l’image» de la
société, plus il sera susceptible de sélectionner, à compétences égales, des femmes et
des membres des minorités ethniques. Ici, là encore le continent américain arriverait à
se distinguer car, pour l’heure, en Europe, cette exigence n’apparaît que plus tard, au
niveau du choix des candidats par le Comité (voir infra c).) et au niveau de la procédure
internationale de sélection (voir infra II.)
42 La question des modalités de prises de décisions par le Comité est un point important
de la procédure. Sur la base juridique établie par chaque Etat présentant l’appel à
candidature – qui doit prévoir notamment les délais pour y répondre (trois mois
seraient suffisants) – les membres du Comité, après réception des CV des candidats (qui
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
251
pourraient être des «CV types» que l’OEA élaborerait à l’instar de ce qu’a fait le Conseil
de l’Europe et que les Etats utiliseraient pour leur procédure nationale de sélection,
voir infra II.), devraient procéder à leur audition. Ces entretiens individuels existent
dans les pays européens et permettent d’évaluer de façon sérieuse et efficace les
candidats. Si le nombre de CV reçus est trop important (pour que les candidats puissent
tous être interviewés), alors une short list pourrait être établie afin que ne soit
auditionnés que les candidats qui prima facie remplissent les critères d’excellence en
termes : de qualifications (juridiques) ; d’expérience (dans le domaine des droits de
l’homme) ; de capacités linguistiques (il faudrait absolument que les candidats
maîtrisent de façon correcte tant l’espagnol que l’anglais, afin d’éviter – notamment au
niveau de la Cour interaméricaine – des frais importants pour la traduction des pièces
de procédure).
43 Il serait bon que la liste des candidats jugés aptes à remplir les fonctions de
Commissaires ou de Juges soit établie par «consensus». En cas de division
insurmontable, il pourrait être procédé, en dernier ressort, au vote. Dans cette
hypothèse, il faudrait que chaque représentant au sein du Comité (représentant du
monde judiciaire, académique, de l’avocature, des ONG et des Ombudsmen) dispose
d’une voix et que la short list de deux ou trois candidats 45 retenus par le Comité
d’experts indépendants soit établie à la majorité simple. Il serait également pertinent
que la décision du Comité soit motivée. Le fait de motiver le choix de deux ou trois
candidats sera là encore un gage pour assurer, au maximum, la «dépolitisation» de la
procédure. Il y aura comme la mise en place d’une procédure de «démocratie interne»
car les membres du panel engageront leur crédibilité en motivant leur choix. Celui-ci,
surtout, sera transparent et par définition, a priori, le plus «objectif» possible.
44 L’analyse comparée avec les pratiques des Etats européens démontre que les pouvoirs
des Panels d’experts ne sont pas contraignants. Ils ne font que délivrer des avis simples
que l’Exécutif (soit le Ministère de la Justice, soit celui des Affaires étrangères, soit la
Présidence de la République en fonction des traditions nationales) n’est pas obligé de
suivre. Il y a là une survivance des règles classiques existant dans le champ des
relations extérieures. Ce monopole de l’Exécutif devrait, dans ce domaine, disparaître.
Là encore, le système interaméricain pourrait inciter les Etats à rendre contraignante
l’évaluation effectuée par les Comités d’experts. Ainsi, le Comité d’experts délivrerait
un avis conforme et le gouvernement devrait suivre. Autrement dit, l’Exécutif ne serait
que la courroie de transmission à l’Assemblée générale de l’OEA de la short list de trois
candidats sélectionnés de façon effective par le Comité.
45 Cette pratique impose des bouleversements importants. En effet, dans le cadre du
système interaméricain, le libellé de l’article 53§2 de la Convention américaine n’est
que «potestatif» : «Each of the States Parties may propose up to three candidates...», là
où il est obligatoire dans le champ conventionnel européen : «The judges shall be
elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High Contracting Party by
a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High
Contracting Party» (article 22). Il faudrait que cette simple faculté existant dans le
cadre du SIDH se transforme en une obligation46 afin que la procédure de sélection
ultérieure (i.e., à l’échelle internationale proprement-dite) serve également de «filtre»
effectif en prenant appui sur une évaluation effective et réelle de plusieurs
candidatures proposées par les Etats (voir les propositions faites dans la II° partie de ce
rapport). Introduire une obligation de transmission d’une liste de deux candidats ou de
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
252
trois (s’il existe des candidats ressortissants d’autres pays qui ont in fine été
sélectionnés) pourrait prendre deux formes. La première serait la révision de la
Convention américaine selon les termes de l’article 76. Il s’agit évidemment d’une
solution compliquée, ne serait-ce que pour arriver à convaincre l’AG de se lancer dans
un processus d’amendement où il faudrait obtenir le vote des 2/3 des Etats ; surtout,
elle serait politiquement très délicate au regard de la crise vécue par le système
interaméricain depuis 2010. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore : les Etats à la tête de la
fronde contre la Commission et la Cour interaméricaines (Bolivie, Equateur, Venezuela,
et dans une certaine mesure le Brésil), pourraient en profiter pour diminuer les
garanties existantes… La seconde forme consisterait à réussir à instaurer une coutume
qui s’imposerait grâce aux incitations de l’AG de l’OEA et les fortes pressions de la
société civile (à l’échelle de chaque Etat et à l’échelle du système comme tel). C’est à
l’évidence la solution la plus réaliste qui arriverait, sans doute, à produire des effets
positifs.
II. Les procédures internationales d’examen des
candidatures
46 Examiner le renforcement des processus européens de nomination des juges (A), est
pertinent afin de dresser un état des lieux comparatif de la question qui permettra,
ensuite, de proposer des formules adaptées au contexte interaméricain (B).
A. Etat des lieux comparatif
47 En Europe, il est symptomatique de constater un mouvement convergent entre les deux
systèmes supranationaux relatifs aux procédures de sélection et de nomination des
juges. En effet, tant le système juridique de l’Union européenne (1) que celui de la
Convention européenne (2) ont amélioré le processus international d’examen des
candidatures et ce, face aux nombreuses critiques qui s’étaient manifestées. Le point
commun des deux procédures européennes est l’instauration d’un Comité de sélection
composé d’experts indépendants.
1. Le système de l’Union européenne (CJUE)
48 Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (1er décembre 2009), les membres de
la Cour et du Tribunal de l’Union européenne étaient nommés d'un commun accord par
les gouvernements des États membres, sous la seule réserve des compétences requises
des personnalités choisies. Les États étaient seuls acteurs et responsables de la
procédure de nomination et du choix des membres de ces deux juridictions de l’Union.
Inévitablement, ce mode de désignation ne faisait qu’entériner des désignations
opérées au niveau national ; or, leurs critères étaient opaques, souvent discutés et
parfois politiques. L’article 255 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE)47 a perfectionné les modalités de nomination des juges et des avocats généraux
pour renforcer la transparence de cette procédure suite aux nombreuses critiques qui
s’étaient manifestées en doctrine. Il prévoit la création d’un Comité – nommé le
«Comité 255» – qui doit formuler un avis sur l’adéquation du profil des candidats à
l’exercice des fonctions de juge et d’avocat général. Sur la base de la même grille
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
253
d’analyse utilisée plus haut48 on va succinctement présenter son mode de création, sa
composition, son fonctionnement et la portée de ses décisions 49.
49 C’est le Conseil de l’Union (l’institution qui représente les Exécutifs des Etats membres
au niveau ministériel) qui non seulement a établi les règles de fonctionnement du
Comité50, mais a également désigné ses membres – sur proposition du président de la
CJUE et du Parlement européen – sur la base des indications de l’article 255, al.2 TFUE 51
50 .
51 Il est composé de sept membres, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois ;
six sont proposés au Conseil de l’Union par le Président en exercice de la Cour de justice
(M. Skouris), un par le Parlement européen. Les sept membres ont été choisis parmi : les
anciens membres de la Cour de justice de l’UE et du Tribunal (Peter Jann, ancien juge
autrichien de la CJUE ; Mme V. Tilli, ancienne juge finlandaise au Tribunal de l’Union
européenne) ; les membres des juridictions nationales suprêmes (Lord Mance, juge à la
Cour suprême du Royaume-Uni ; T. Melchior, ancien président de la Cour suprême du
Danemark ; P. Paczolay, ancien président de la Cour constitutionnelle de Hongrie ; J-M.
Sauvé, Vice-Président du Conseil d’Etat français) ; des juristes possédant des
compétences notoires, dont l’un est proposé par le Parlement européen (Ana Palacio,
Avocate, Professeur de droit, ancienne membre du Parlement européen et conseillère
d’Etat en Espagne). Certains ont craint un certain «corporatisme» des anciens juges de
l’Union, dans la mesure où six des candidats proposés l’ont été par le Président en
exercice de la Cour de justice. En réalité, on constate que ce sont les juges suprêmes qui
se trouvent en position de force numérique, qui plus est quand on mentionne que le
Conseil de l’Union a désigné, comme président du Panel, le Vice-président du Conseil
d’Etat français (J-M. Sauvé) (article 4 de l’annexe sur les règles de fonctionnement du
Comité, décision du 25 février 2010).
52 Pour exercer ses missions, le comité met en œuvre une procédure qui permet un
examen approfondi des candidatures. Il dispose, en particulier, de pouvoirs d’instruction.
Il demande en effet aux Gouvernements la transmission d’informations sur la
procédure nationale qui a été mise en œuvre pour sélectionner le candidat et sur la
motivation de cette proposition. Les dossiers de candidature doivent en outre
comporter, en plus d’un curriculum vitae, la liste des publications des candidats ou de
certaines de celles-ci et une lettre de motivation. Le comité se réserve également de
prendre en considération toute information publiquement disponible ou qui lui serait
soumise, après avoir, le cas échéant, procédé à un débat contradictoire avec le candidat
et l’Etat qui l’a présenté. Le point-clé de l’instruction menée par le comité est une
audition non publique dont le comité a fixé la durée à une heure, qui fait une large place
aux questions posées par ses membres. Aux termes des règles de fonctionnement du
comité, une telle audition n’a toutefois lieu que pour les nouveaux candidats et non
pour les juges sollicitant le renouvellement de leur mandat.
53 Outre les conditions d’examen des candidatures, le comité, se fondant sur les
stipulations du TFUE, a été conduit à préciser les critères d’évaluation des candidats.
L’examen de deux critères – celui des capacités juridiques et celui de l’expérience
professionnelle, en particulier au regard de son niveau, sa durée et sa diversité –
permet au comité d’apprécier si le candidat réunit les conditions requises pour exercer
de hautes ou de très hautes fonctions juridictionnelles ou s’il peut être regardé comme
un jurisconsulte présentant des compétences notoires, au sens des dispositions de
l’article 253 du TFUE. Le comité examine aussi l’aptitude du candidat à exercer les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
254
fonctions de juge ainsi que ses connaissances linguistiques et sa capacité à travailler
dans un environnement international dans lequel sont représentées plusieurs
traditions juridiques. Le comité porte enfin une attention particulière aux garanties
d’indépendance et d’impartialité offertes par le candidat.
54 Le point le plus critique du fonctionnement du comité est l’absence de publicité donnée à
ses avis. Dès son premier rapport d’activité, il justifia cet élément par la rappel des
normes de l’Union en matière de protection des données personnelles (Règlements (CE)
n° 1049/2001 et (CE) n° 45/2001), telles qu'interprétées par la Cour de justice 52. Le
standard posé par la Cour de justice a conduit le Comité à estimer que tant ses avis que
les auditions, ne pouvaient être rendus publics. Les membres du Comité expliquent
toutefois que la transparence de son fonctionnement est in fine assurée. Il est
intéressant à cet égard de reproduire ici in extenso le point de vue du Président du
Comité, le Français J-M. Sauvé : «Toutefois, le comité, par les rapports d’activité qu’il a
décidé d’établir et de publier, comme par les interventions publiques de ses membres,
notamment devant le Parlement européen, s’attache à assurer une réelle transparence
sur ce qu’il fait : il rend ainsi compte de ses méthodes d’instruction des candidatures,
des critères précis d’évaluation retenus par lui et de leur application concrète, enfin, de
la statistique détaillée des avis favorables ou défavorables. Avant de prôner une plus
grande transparence, il faut, me semble-t-il, prendre garde à ne pas appauvrir le
processus actuel – par exemple en dissuadant des candidatures qui, alors même qu’elles
ne rempliraient pas certains critères, en particulier celui des années d’expérience
attendues, pourraient en définitive être regardées comme adéquates. Il faut surtout
veiller à concilier le principe de transparence avec la protection de la vie privée des
candidats et la pleine liberté de choix que confère le Traité aux Etats membres : la
publicité des auditions ou des avis serait ainsi de nature à porter, sans nécessité,
excessivement préjudice aux candidats à propos desquels le comité a émis un avis
défavorable. Car l’audition ne constitue en rien une simple formalité et l’avis rendu,
tout en veillant à respecter les personnes, ne cache pas les clairs déficits de certaines
candidatures53».
55 Le Comité rend des avis simples (i.e. non contraignants) qui ne sont transmis qu’aux
seuls Etats membres qui restent compétents pour présenter les juges à la CJUE et les
nommer. Le Président du Comité estime qu’au fil du temps la « valeur morale »
attribuée aux avis du Comité s’est renforcée. Surtout, selon lui, l’architecture du
processus de nomination compense l’absence de force contraignante des avis rendus par
le Comité sur chaque candidature. En effet, le principe étant celui de la nomination
d’un commun accord (article 253 al.1 TFUE)54, c’est-à-dire à l’unanimité, il faut et il
suffit qu’un seul Etat s’oppose à une nomination pour qu’il y soit fait échec. Par
conséquent, il faudrait, pour passer outre à un avis défavorable du comité, que la
totalité des Etats s’accorde pour ce faire. Or, une telle unanimité ne s’est jamais
rencontrée pour prendre une direction opposée à celle proposée par le comité. En effet,
lorsqu’un avis défavorable a été émis, les candidatures présentées ont en règle générale
été retirées par les Etats qui les avaient présentées. Dans un cas, les Etats réunis en
conférence intergouvernementale ont constaté l’absence de consensus sur la
candidature présentée...ce qui montre que, dans les faits, il est très difficile pour ne pas
dire impossible pour les Etats de s’opposer aux avis du Comité.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
255
2. Le système de la Convention européenne (CEDH)
56 Le système conventionnel européen de sélection des juges de la CEDH ressemble au
système de l’Union en ce qu’il a mis en place un Comité d’experts indépendants (a),
toutefois il s’en distingue car son avis n’est pas transmis aux Etats, mais à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe qui par un vote opère le choix final et élit un des
trois candidats proposés. En outre, le choix de l’Assemblée passe par une procédure de
«contrôle interne» dans la mesure où une «sous-commission» est censée évaluer de
nouveau la crédibilité des candidatures. La pratique démontre toutefois que les
considérations politiques peuvent encore l’emporter au sein de cette «sous-
commission» au détriment de la qualification des candidats (b).
57 a) Première phase de la procédure : l’intervention d’un Comité consultatif d’experts
58 Le Comité a été créé55 sur la base d’une résolution du Comité des ministres du Conseil
de l’Europe du 10 novembre 201056 – avec pour objet d’examiner la pertinence des listes
de trois candidats présentées par les Etats parties avant qu’elle ne soit transmise à
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
59 Le panel de sept membres a été constitué le 8 décembre 2010. Ses membres ont été
choisis par le Comité des ministres en accord avec le Président de la Cour européenne
conformément au paragraphe 3 de la Résolution (2010) 26 du Conseil de l’Europe. Il est
composé des personnalités suivantes, conformément au §2 de la même résolution : les
membres des plus hautes Cours nationales (Mme Katarzyna Gonera, Cour suprême de
Pologne ; Chief Justice John L. Murray, Cour suprême d’Irlande) ; Mr Sami Selçuk,
professeur et Président de la Cour d’appel turque ; Mr V. Zorkin, Président de la Cour
constitutionnelle russe) ; les anciens membres de cours internationales, y compris de la Cour
européenne des droits de l’homme (Mme Renate Jaeger, ancienne juge allemande à la Cour
EDH ; Mr M. Pellonpää, ancien juge finlandais à la Cour EDH ; Mr Lucius Wildhaber,
ancien Président suisse de la CEDH) ; des juristes aux compétences reconnues. On peut
constater que cette dernière catégorie de «juristes aux compétences reconnues» n’a pas
été «pourvue». Seuls les juges nationaux et anciens juges internationaux ont eu grâce
aux yeux du Comité des ministres. Il est intéressant de relever qu’il a été tenu compte,
conformément au §3 de la Résolution, d’une représentation géographique équilibrée
(présence de juristes de l’Ouest comme de l’Est du continent) ainsi que d’une
représentation au regard du sexe des membres (2 femmes sur 7).
60 Le mandat du Comité consultatif doit conseiller, de façon confidentielle, les Etats
parties afin qu’ils puissent évaluer si les candidats au poste de juge remplissent tous les
critères posés à l’article 21 de la Convention57. Il reçoit les CV de trois candidats
proposés par les Etats ; le principe étant que l’instruction menée par le Panel
consultatif est écrite. En plus du CV, le Panel utilise tout son réseau (essentiellement
celui de juges) pour avoir une opinion plus précise sur le profil des candidats. S’il
l’estime nécessaire, il peut procéder à des auditions (elles ne sont donc pas obligatoires).
Bien que le Comité ait suggéré qu’il devrait publier un rapport annuel (transmis au
Comité des ministres), sa proposition n’a pas été suivie d’effets 58.
61 Si la liste des trois candidats fournie par l’Etat ne pose pas de problème quant à sa
qualité, le Panel en informe l’Etat qui pourra transmettre sa liste à l’Assemblée
parlementaire. En revanche, si un ou plusieurs noms sur la liste posent problème, le
Panel demande de plus amples informations à l’Etat ; ici se trouve la raison d’être de sa
fonction : donner des avis à l’Etat qui doivent rester confidentiels. Le dialogue est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
256
bilatéral et confidentiel (Panel>Etat). Si le Panel n’est toujours pas convaincu de la qualité
des candidatures après entretien avec l’Etat, il peut les refuser : il en informe l’Etat qui
est alors censé présenter de nouveau une liste de trois noms59. » Un rapport du Comité
Directeur des Droits de l’Homme (Steering Committee of Human Rights) du Conseil de
l’Europe, en date du 29 novembre 2013, pointe certaines lacunes dans la procédure telle
qu’elle a fonctionné jusqu’à présent et présente certaines propositions pour améliorer
le mécanisme.
62 Le premier élément d’ordre négatif est que certains avis ne sont pas suivis d’effet 60.
Dans ce contexte, le Comité directeur propose que : «While the opinion of the Advisory
Panel is non-binding, it may be assumed that the Sub-Committee of the Parliamentary
Assembly gives due consideration to an opinion of the Advisory Panel on a particular
list of candidates ».
63 Il faut préciser toutefois qu’il y a au moins un contre-exemple concernant la France : en
effet, le processus de succession du juge français et président de la Cour européenne –
Jean-Paul Costa – au cours de l’année 2010 donna à voir, dans un premier temps, des
manœuvres politiques désastreuses (pour l’image de la France) puisque le
gouvernement de Nicolas Sarkozy avait présenté une liste de trois candidats dont l’un
n’avait absolument pas les qualifications requises... Le contrôle effectué par le Panel
d’experts porta ses fruits puisque la France n’hésita pas à présenter une nouvelle liste,
plus crédible. Il faut dire que cette manière de procéder s’ébruita dans la presse et ce
fut la réputation de la France qui fut malmenée dans l’enceinte du Palais des droits de
l’homme à Strasbourg ! La lecture combinée du rapport du CCDH et de l’expérience
française démontre que la «bonne foi» des Etats est à géométrie variable. L’avis négatif
du Panel consultatif a été un véritable camouflet pour la France qui, très vite, s’est
ressaisie pour présenter une nouvelle liste. D’autres Etats n’ont évidemment pas la
même politique juridique extérieure et le même rapport à un «standing», une
réputation politique et juridique qu’il faut maintenir...
64 La seconde lacune qui fut mise en exergue est une attitude passablement cynique des
Etats qui n’attendent pas que le panel ait rendu son avis...en transmettant directement
leur liste à l’Assemblée parlementaire61. Pour le Comité directeur, ceci est évidemment
inadmissible62.
65 La troisième lacune concerne l’existence de règles de fonctionnement par trop
restrictives : «The Advisory Panel indicated that it found the original Operating Rules
too restrictive, i.e. with respect to the holding of meetings and the use of information
from sources other than the government. In its view, this warrants a re-evaluation of
the Operating Rules in place. In the Operating Rules, a primarily written procedure is
foreseen. The Advisory Panel can decide to hold a meeting “where it deems this
necessary to the performance of its function”. In practice, seven meetings of the
Advisory Panel were convened between January 2011 and October 2013 which seems to
suggest that meetings have become the rule and not the exception. The Advisory Panel
suggests making meetings the norm, considering that a purely written procedure does
not allow for a meaningful discussion based on direct exchange of views. The CDDH
recalls that the Resolution foresees flexibility to accommodate the need for a meeting,
assuming this is necessary for effective consultations on lists of candidates. However,
when organising meetings, due account must be taken of budgetary constraints» 63.
66 b) Deuxième phase de la procédure : intervention de la Sous-commission des affaires juridiques
de l’Assemblée parlementaire
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
257
67 L’article 22 de la Convention européenne énonce que « Les juges sont élus par
l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité
des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie
contractante. » Les autorités nationales doivent par conséquent transmettre
directement leur liste à l’Assemblée. Afin de s’acquitter le plus efficacement possible de
son mandat, l’Assemblée a créé, dès 1997, une Sous-commission de la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme chargée de la question de l’élection des juges.
L’annexe à la Résolution 1432 (2005)64 précise qu’une fois soumise à l’Assemblée, la liste
ne doit plus être modifiée, sauf à titre exceptionnel (para. 1). Si l’un des trois candidats
inscrit sur une liste se retire avant le premier tour de scrutin, l’Assemblée interrompt
la procédure et demande au gouvernement concerné de compléter la liste (para. 2).
Toujours aux termes de l’annexe, l’Assemblée ne dévie pas de sa pratique consistant à
présenter les candidats dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote, soulignant que
l’expression d’une préférence de la part du gouvernement n’influe aucunement sur les
délibérations de la sous-commission sur l’élection des juges (para. 3). La Sous-
commission procède à l’audition des candidats (les frais de transport et de séjour sont
inscrits au budget du Conseil de l’Europe). Les critères pris en considération concernent
les compétences linguistiques et l’égalité des sexes.
68 S’agissant des compétences linguistiques, il faut que les candidats connaissent de façon
active une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (français ou anglais). Au
cas où un candidat considéré par ailleurs comme étant qualifié pour l’exercice de la
fonction de juge ne posséderait pas le niveau de compétences linguistiques requis à la
date de l’élection, certains ont proposé que l’intéressé, au moment de l’élection, prenne
l’engagement ferme de suivre des cours intensifs de l’une des langues officielles de la
Cour avant de prendre ses fonctions ou, à titre exceptionnel, au début de son mandat.
69 Quant à l’égalité des sexes, il est important de souligner que l’Assemblée parlementaire a
pris une mesure novatrice en 2004 en matière de discrimination positive, en décidant
de n’accepter les listes des trois candidats au poste de juge à la Cour qu’à la condition
que celles-ci contiennent au moins un membre du «sexe sous-représenté». Elle alla
même plus loin en invitant le Comité des Ministres à amender l’article 22 pour prendre
en compte cette exigence65. Toutefois, certains Etats, et notamment les plus petits, dans
lesquels le nombre de femmes qualifiées peut être limité, ont souligné qu’il était
difficile de remplir ce critère. Partant, si la Convention était modifiée, ils ne pourraient
pas la respecter... C’est à la suite d’un contentieux avec Malte (qui, à deux reprises, ne
présenta que des candidatures masculines pour remplacer le Juge maltais Giovanni
Bonello), que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe saisit la Cour européenne
pour avis. La Cour déclara que bien que l’approche générale de l’Assemblée relative à la
promotion de l’égalité des sexes soit sensée, l’application automatique de la règle, sans
aucune exception, n’est pas conforme à l’article 21 de la Convention 66. A la lumière de
l’avis consultatif de la Cour et à la suite de deux débats très controversés au sein de
l’Assemblée, elle décida, dans sa Résolution 1627 (2008) adoptée le 30 septembre 2008,
d’autoriser des exceptions à cette règle, mais uniquement dans les cas où un Etat partie
démontre avoir essayé de trouver un candidat qualifié du sexe sous-représenté, sans
succès.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
258
B. Propositions pour le système interaméricain
70 L’expérience des deux systèmes européens de sélection des candidats aux postes de
juges démontre plusieurs choses : tout d’abord qu’il est très difficile d’arriver à un
système irréprochable ; ensuite et surtout, le système qui, a priori, pouvait être
considéré comme le plus aboutis (celui du Conseil de l’Europe), n’en a pas moins recelé,
dans la pratique, d’importantes carences. Au vu de l’expérience qui se dégage des deux
systèmes européens de sélection, je propose des pistes de réflexion qui prennent en
compte les dérives nées de la pratique européenne afin d’éviter au maximum qu’elles
puissent se reproduire au sein du système interaméricain des droits de l’homme.
71 La première règle de bonne gouvernance consisterait à créer un Comité d’experts
indépendants au sein de l’OEA.
72 S’agissant de l’autorité de création du Comité, il faudrait laisser à l’Assemblée Générale de
l’OEA le pouvoir de création du Panel d’experts. Dans les systèmes européens, ce sont
les deux instances intergouvernementales (représentant les Etats à l’échelle
ministérielle) qui ont créé les Comités d’Experts. Cette donne «intergouvernementale»
ne peut pas être éradiquée ; il serait en effet irréaliste de vouloir changer trop
radicalement à ce stade les choses. Ici, le principe de réalité doit être pris en compte.
On peut imaginer que, dans le cadre de cette tâche, l’AG soit secondée par le Comité
juridique interaméricain – the Inter-American Juridical Committee (IAJC) –conformément
au libellé de l’article 99 de la Convention américaine67.
73 En ce qui concerne la composition du Comité d’experts interaméricains, on a vu que les
deux Comités d’experts européens étaient composés de sept membres. Ce nombre
donne entière satisfaction. On peut penser qu’il en irait de même dans le cadre du
système interaméricain. L’AG de l’OEA doit avoir pour contrainte, dans la
détermination de la composition du Panel, de prendre en compte la représentativité
des différentes cultures juridiques, des différentes aires géographiques, des différences
en termes de gender et last but not least, pour le continent américain, en termes
«ethniques». Plus le Comité sera représentatif, plus il sera légitime et sera également
en mesure d’être particulièrement sensible aux candidatures – à compétence égale – de
femmes et de représentants des minorités ethniques. Les sept membres seraient
nommés par l’AG pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, toujours par
elle (afin de permettre la mise en place d’us et coutumes dans le travail d’évaluation des
candidatures et de leur sélection).
74 Les «critères» européens pour choisir les experts du Panel peuvent être repris, en y
ajoutant toutefois un autre, essentiel dans le contexte interaméricain : celui de la place
de la société civile. De même, il serait bon d’inscrire une règle qui fixe précisément le
nombre d’experts par «origine» (pour éviter une éventuelle surreprésentation d’un
«statut» sur un autre), tout en accordant une légère préférence à la représentativité des
anciens membres de la Cour IDH et de la Commission IDH au regard de leur expérience.
75 Ainsi, le Panel d’experts interaméricains pourrait être composé :
76 De deux membres des plus hautes Cours nationales ;
77 Ces «plus hautes cours nationales» sont celles des Etats ayant accepté la juridiction de
la Cour IDH pour les candidats aux postes de juges ;
78 En revanche, pour l’examen des candidatures aux postes de commissaires, les «plus
hautes Cours nationales» sont celles de tous les Etats membres de l’OEA
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
259
79 De trois anciens membres de la Cour IDH (pour le poste de juge) ;
80 ou
81 - De trois anciens membres de la Commission IDH (pour le poste de commissaire) ;
82 De deux représentants de la société civile ;
83 Il s’agirait de choisir parmi les ONG reconnues dans le cadre de l’OEA.
84 S’agissant du processus décisionnel au sein du Comité, la pratique européenne démontre
que la procédure d’instruction ne peut pas se contenter d’être seulement écrite. Il faut
que les auditions soient obligatoires, car elles s’avèrent essentielles pour la perception
effective et concrète des qualifications des candidats. Les auditions et les frais y
afférents seraient pris en compte par l’AG de l’OEA (à l’instar de ce qui se passe en
Europe). Le CV transmis par les candidats devrait être un CV type, élaboré à l’image de
celui que l’AG du Conseil de l’Europe a élaboré afin que les éléments de comparaison
soient le plus possible équivalents. Si les membres du Comité ne s’accordent pas sur une
liste présentée par un Etat – la considérant comme particulièrement « faible » – alors le
Comité pourrait demander à l’Etat d’en proposer une autre dans un délai déterminé (un
mois par exemple) ; à défaut, il pourrait considérer que l’Etat a renoncé à présenter des
candidats.
85 Il est important également de rendre obligatoire la publication d’un rapport annuel, qui
serait ainsi un gage de transparence du processus de sélection et qui participerait à
asseoir la légitimité du Comité. Il est très intéressant à cet égard de voir les pratiques
divergentes des deux Comités européens. Les rapports du «Comité 255» comme les
interventions solennelles des membres du Comité, participent comme l’a fait
remarquer J-M. Sauvé, à la transparence de ces méthodes d’évaluation : cela a permis
d’asseoir peu à peu sa légitimité tout en ayant réussi à préserver la vie privée des
candidats (notamment pour ceux qui sont « recalés »). Or, le fait que le Panel d’experts
indépendants du Conseil de l’Europe n’ait pas été en mesure jusqu’à présent de publier
un rapport annuel a été un facteur de « frustration » pour ses membres et a participé
au caractère très confidentiel de son action, ce qui n’est pas positif. Dans le cadre de
son rapport annuel, il présenterait notamment le nombre de postulants, le nombre de
femmes et de représentants ethniques, leur profil (magistrats, avocats, professeurs) et
les critères qui ont été pris en compte pour la sélection68.
86 En ce qui concerne la portée de la décision adoptée par le Comité d’experts
interaméricain, intervient ici le point central, car sans doute le plus «osé», des
propositions. La pratique dans le cadre de l’Union européenne démontre que l’avis
simple (qui a priori était une faiblesse) s’est transformé en réalité dans la pratique en un
avis conforme, les Etats membres de l’Union prenant au sérieux la «valeur morale»
(dixit J-M. Sauvé) de l’avis délivré par le Panel. L’avis délivré concernant l’ensemble des
candidatures, il faudrait l’unanimité des Etats pour renverser le point de vue exprimé
par le Panel d’experts, ce qui ne s’est jamais produit. La pratique dans le cadre du
Conseil de l’Europe – qui a priori est vue comme plus démocratique – a eu les effets
pervers décrits plus haut. Non seulement l’expertise délivrée n’est pas encore
systématiquement prise au sérieux par certains Etats, mais encore la «démocratie
interne» au Conseil de l’Europe a démontré que les marchandages politiques au stade
de l’élection, non seulement pouvaient faire fi de l’avis du Panel d’experts
indépendants, mais également de l’avis de la «sous-commission» de l’Assemblée
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
260
parlementaire. Pour résumer, la démocratie est allée plusieurs fois à l’encontre de la
compétence.
87 On sait que dans le système interaméricain, la question ne porte pas de façon aussi
cruciale sur la compétence des membres de la Cour comme de la Commission 69. Il faut
dire qu’élire sept juges et sept commissaires permet d’accéder plus facilement à
l’excellence professionnelle que quand il s’agit d’en élire vingt-huit (CJUE) ou pis,
quarante-sept (CEDH). Ce qui doit compter pour le système interaméricain, c’est la
transparence de la procédure laquelle doit reposer sur une objectivité de l’examen de
candidatures qui permettra, ensuite, de ne plus porter atteinte à la crédibilité des
membres de ces deux institutions. Il faut donc octroyer au Comité d’experts un pouvoir
de décision (garant de la valorisation de la compétence) puis éradiquer le pouvoir
électif qui se trouve jusqu’à présent entre les mains de l’AG de l’OEA, dont on sait qu’il
génère un phénomène classique «d’achat de votes» (vote trading). Cette solution aura
également l’intérêt d’éviter que des Etats (par leur puissance économique et politique)
emportent plus facilement que d’autres l’élection d’un de leur ressortissant à la
Commission et à la Cour70, en laissant une chance aux très bons candidats issus de plus
« petits » pays71.
88 C’est donc le Comité qui doit avoir le pouvoir de décision. Cette innovation serait
d’autant plus facile à accepter que ce serait l’AG de l’OEA (en partenariat avec le Comité
juridique interaméricain) qui désignerait les membres du Comité pour une durée de
quatre ans (renouvelable une fois). Il y aurait donc en amont du processus un certain
pouvoir accordé aux Etats ; en revanche, en aval du processus, ils devraient accepter le
choix des experts. Cette solution radicale est la seule à même d’éviter tout type de
marchandage politique par l’élection72 . Il est in fine préjudiciable à l’image des élus 73.
Pour faire accepter cette règle par les Etats, on pourrait imaginer une sorte de «clause
de sauvegarde» consistant à affirmer que seule l’unanimité serait à même de
«renverser» le choix du Panel.
89 La seconde règle de bonne gouvernance concerne les critères à prendre en considération au
moment de la sélection.
90 Le Comité consultatif, au regard de sa composition, devra prendre plus
particulièrement en considération les critères suivants :
91 - La compétence spécifique des candidats dans le domaine des droits de l’homme. L’analyse
du profil des juges ayant siégé à la Cour IDH démontre que cette exigence n’a pas été
systématiquement prise en considération antérieurement. Autrement dit, la question
au sein des Amériques – contrairement à l’Europe – ne concerne pas les qualifications
comme telles des candidats, mais plutôt leur orientation. En effet, le niveau des juges
interaméricains est remarquable à de nombreux égards ; en revanche, l’examen de leur
profil démontre qu’ils n’ont pas tous été issus de l’univers des droits de l’homme. Or, il
est légitime de renforcer l’effectivité de cette exigence – mentionnée dans les textes 74 –
pour des fonctions à la Cour et à la Commission interaméricaines des droits de
l’homme.
92 - Le régime des incompatibilités devrait être scruté avec attention par les membres du
Comité (articles 71 de la Convention ADH75 et 18§1 du Statut de la Cour 76 pour les juges
et article 4 du règlement de la Commission77). Les juges comme les commissaires ne
travaillant pas à temps plein, un contrôle particulièrement strict du régime des
incompatibilités en amont devra être mis en œuvre pour s’assurer que les fonctions
exercées dans leur pays, par les candidats, soient parfaitement compatibles avec celles
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
261
pouvant être exercées dans le système interaméricain. L’exception prévue par le texte
de la Convention pour les fonctions de juge (article 18§1 du Statut) devrait être
interprétée de façon très stricte – pour ne pas dire être écartée dans la pratique. En
effet, outre le problème réel d’indépendance que pose le fait de travailler au sein d’un
organe de l’Exécutif (même s’il n’entraîne pas le « contrôle direct » de l’Exécutif sur le
candidat) ou dans le cadre d’une mission diplomatique, c’est toute l’image et donc la
légitimité de la Cour qui peut en pâtir in fine.
93 - Les compétences linguistiques. En Europe, ce point est devenu crucial car il faut
absolument – au sein d’une juridiction internationale bilingue comme la Cour
européenne, pouvoir maîtriser de façon active une des deux langues officielles et
maîtriser au moins passivement l’autre langue (c’est-à-dire suffisamment pour
comprendre les nuances de textes juridiques complexes). Ce point est également
important dans le cadre du système interaméricain. Il est crucial pour ne pas dire
élémentaire s’agissant des postes de commissaires (au regard de la localisation de son
siège et de l’étendue de sa « juridiction ») ; il l’est également pour la Cour
interaméricaine. Ce serait une manière d’assurer plus fortement l’unité entre les
mondes anglo-saxon et latin tout d’abord, ce qui renforcerait l’approche « commune »
des cultures juridiques et l’interprétation des droits ; ensuite, sous un angle plus
pragmatique, ce serait s’assurer à l’avenir, si un juge provenait d’un pays anglo-saxon,
que les débats comme la prise de connaissance des pièces de procédure, ne génèrent
aucun frais de traduction. Au cas où un candidat considéré par ailleurs comme étant
qualifié pour l’exercice de la fonction de juge, ne posséderait pas le niveau de
compétences linguistiques requis à la date de l’élection, le Comité d’experts
interaméricain pourrait exiger de l’intéressé, au moment de l’audition, qu’il prenne
l’engagement ferme de suivre des cours intensifs avant de prendre ses fonctions ou, à
titre exceptionnel, au début de son mandat.
94 - La représentativité ethnique ainsi qu’en matière d’égalité des sexes. Cette question est à
mon sens majeure. Elle devrait être à l’agenda de l’Assemblée générale de l’OEA et des
principales organisations de la société civile en Amérique latine dans les prochaines
années afin d’encourager fortement la présentation de candidats féminins et issus des
minorités ethniques, plus spécifiquement dans les pays qui ont « constitutionnalisé » le
fait indigène. Si la composition de la Commission a été sur ce point relativement
équilibrée, et ce, depuis plusieurs années, on ne peut pas dire que ce fut le cas de la
Cour interaméricaine. En trente-cinq ans d’activités, seulement quatre femmes en ont
fait partie78 tandis qu’aujourd’hui, la Cour interaméricaine est exclusivement
masculine. L’idée ici n’est pas d’imposer des qualifications ethniques et féminines mais
d’encourager la présentation de candidatures dument qualifiées de femmes et de
représentants ethniques. Il est à cet égard assez difficile d’imaginer que de pays
importants en termes politiques et économiques ne puissent trouver de telles
candidatures79. En revanche, on peut penser que des « petits pays » soient confrontés
(comme l’a été Malte) à la difficulté de dresser des listes où des femmes et/ou des
représentants de minorités ethniques soient présents. Dans ce cas-là, il faudra que
l’Etat démontre qu’il a procédé, au niveau de la procédure de sélection interne, à toutes
les exigences présentées dans la première partie de cette étude, pour susciter des
candidatures de femmes et de représentants ethniques afin que leur absence éventuelle
soit une exception80.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
262
95 Je terminerai cette analyse sur un autre point, celui du mandat des juges et des
commissaires ; bien qu’il ne fasse pas partie, au sens strict, des questions relatives à leur
processus de sélection et d’élection, il est important de mentionner que leur
indépendance serait beaucoup mieux préservée si leur mandat était plus long et non
renouvelable. Or, aujourd’hui, les juges interaméricains sont élus pour six ans et
peuvent être réélus une seule fois (article 54 CADH)81, tandis que les Commissaires sont
élus pour quatre ans et peuvent également être réélus une seule fois (article 6 du Statut
de la Commission et de 2§1 de son règlement)82. Il serait préférable de faire coïncider
leur mandat en le rallongeant et en interdisant leur renouvellement. L’expérience
européenne est ici majeure. Le Conseil de l’Europe – après avoir opté pour plusieurs
solutions et prenant la mesure des très graves inconvénients de l’existence de mandats
renouvelables – a opté, avec le Protocole n°14, pour un mandat de neuf ans non
renouvelable83. Cela a été salué unanimement par les praticiens (avocats et ONG), les
représentants du monde universitaire et last but not least, par les juges eux-mêmes 84.
Dans ce contexte, on pourrait imaginer un mandat identique de huit ou neuf ans pour
les juges et les commissaires sans possibilité de réélection. La cohérence et la continuité
de la jurisprudence seraient assurées comme l’indépendance des membres de la
Commission et de la Cour qui pourraient, sans difficultés aucune, mettre en œuvre le
célèbre « devoir d’ingratitude » à l’égard de leur Etat d’origine.
96 Il faut toutefois préciser ici que cette proposition s’avère être trop idéaliste au regard
de la conjoncture politique particulièrement délicate existant aujourd’hui au sein des
Amériques. Cela impliquerait en effet une nécessaire révision de la Convention
américaine (tout du moins pour le mandat des juges) ; or, cela serait trop compliqué et
surtout dangereux car les Etats pourraient instrumentaliser le processus de réforme. En
tout état de cause, c’est toutefois un élément qui doit être pris en compte à long terme :
il apparaît de façon claire qu’il s’agit d’un gage d’indépendance qui renforce la
légitimité des juridictions internationales.
Conclusion
97 Cet article – écrit sous forme de rapport – a exploré seulement un des nombreux
facteurs qui ont un impact sur l’indépendance des organes internationaux. Il s’avère
cependant majeur. A l’heure où de plus en plus de décisions des Cours européenne et
interaméricaine sont contestées à l’échelle des Exécutifs des Etats parties, il est crucial
que l’excellence soit le moteur de tout processus de désignation et d’élection de juges. Il
s’agit d’une exigence élémentaire qui va de soi ; pourtant, on l’a vu, elle doit sans cesse
être améliorée. La doctrine doit, pour sa part, continuer à mettre en place une veille
critique s’agissant de ces procédures : il y va également de son indépendance.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
263
NOTES
1. Ces deux notions (indépendance et impartialité) ne sont pas équivalentes. La première fait
référence à la capacité des membres d’un organe judiciaire de résister à une pression extérieure
afin d’être en mesure de prendre des décisions sans qu’aucun type d’interférences inappropriées
ne puisse agir sur le processus décisionnel juridictionnel ; le second est relatif à la capacité d’un
juge, à l’occasion d’un procès donné, d’être le plus neutre possible. Sur ces distinctions, on
renvoie au Dictionnaire de droit international public publié sous la direction de Jean Salmon,
Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 562 et 570.
2. Parmi une littérature foisonnante, on citera le colloque de Lille de la SFDI, La
Juridictionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 2003.
3. L. R. Helfer, A-M. Slaughter, “Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication”, 107,
Yale Law Journal, 1997, pp. 273-391. ; R. Mackenzie, P. Sands, “International Courts and Tribunals
and the Independence of the International Judge”, 44, Harvard International Law Journal, 2003, pp.
271-285 ; H. Ruiz-Fabri, J-M. Sorel (dir.), Indépendance et impartialité des juges internationaux, Paris,
Pedone, 2010, 302 p. (Col. Contentieux international). practice of international courts and tribunals : a
Practioners' journal.
4. Le rapport « Cilevics » de mai 2014 adopté par le Comité des affaires juridiques et des droits de
l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est intéressant à cet égard. Il met
notamment en exergue le fait qu’à côté des modes de sélection des juges, d’autres éléments sont
loin d’être négligeables pour assurer l’indépendance des juridictions internationales (à l’instar du
système des retraites et des privilèges et immunités) mais également – élément trop peu exploré
jusqu’alors – les modes de recrutement des membres du greffe, v. Assemblée parlementaire,
Committee on Legal Affairs and Human Rights, Reinforcement of the independence of the European
Court of Human Rights, 26 mai 2014, Rapporteur Boriss Cilevics (Socialist Group, Latvia).
5. On se reportera à cet égard à la Résolution adoptée par la 6° Commission à l’occasion de la
Session de Rhodes en 2011, The position of International Judge, (9 September 2011, 6 RES EN FINAL).
(Rapporteur G. Guillaume, Ancien juge français au sein de la CIJ).
6. Il est symptomatique de relever que les recherches juridiques sur la question
démarrèrent quand le juge international Charles de Vissher n’a pas été réélu à la CIJ en
1951 (voir G. Guillaume, “De l’indépendance des membres de la Cour internationale de
Justice”, Boutros Boutros-Ghali Amicorum. Paix, développement, démocratie, Bruxelles,
Bruylant, Vol. 1, 1998, p. 476). Toutefois, c’est l’accroissement considérable des
juridictions internationales qui fut le déclencheur de l’ébullition doctrinale relative aux
processus de selection et de nomination des juges internationaux. Voir, à titre non
exhaustif, Mackenzie R., Malleson K., Martin P., Sands P., Selecting International Judges,
Principles, Process and Politics, Oxford, OUP. ; J. Malenovsky, «L’indépendance des juges
internationaux», Recueil des Cours de l’Académie de droit international, vol. 349, 2011, 276 p.
; A. Remiro Brotons, “Nomination et élection des juges à la Cour internationale de
justice”, Unité et Diversité du Droit international. Ecrits en l’honneur du professeur Pierre-
Marie Dupuy/ Unity and Diversity of International Law. Essays in Honour of Professor Pierre-
Marie Dupuy, Brill, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, pp. 639-660 ; A. Seibert-Fohr,
“International Judicial Ethics”, The Oxford Handbook of International Adjudication, Oxford,
2014, pp. 757-778 ; S. Szurek, “La composition des juridictions internationales
permanentes : l’émergence de nouvelles exigences de représentativité”, Annuaire
français de droit international, 2010, pp. 41-78. C. Tomushat, “National Representation of
Judges and Legitimacy of International Jurisdictions: Lessons from ICJ to ECJ ?”, Pernice
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
264
I. et al. (eds), The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective, Baden-
Baden, 2006, pp. 183-190.
7. H. Fáundez Ledesma, “La independencia e imparcialidad de los miembros de la Comision y de
la Corte : paradojas y desafios”, J. Méndez & F. Cox (eds), El futuro del sistema Interamericano de los
Derechos Humanos, IIDH, San José, 1998, pp.170-210 ; O. Ruiz-Chiriboga, “The Independence of the
Inter-American Judge”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2012, pp. 111-135
; J. Schönsteiner, “Alternative Appointment Procedures for the Commissioners and Judges in the
Inter-American System of Human Rights”, 2007, 46 Revista IIDH, pp.196-205.
8. D. Cassel, “Regional Human Rights Regime and State Pushback: the Case of the Inter-American
Human Rights System (2011-2013)”, Human Rights Law Journal, 2013, vol. 33, pp. 1-10 ; voir
également le numéro special de Human Rights Brief, « The Future of the Inter-American System of
Human Rights », vol. 20, n°2, hiver 2013.
9. Les processus nationaux et internationaux de sélection et de nomination des
candidats ont une incidence directe sur l’indépendance et l’impartialité des
commissaires et des juges, conditions indispensables pour que le public ait confiance
dans la justice interaméricaine. Elles doivent absolument être conformes aux normes
internationales garantissant l’indépendance de l’ordre judiciaire. Si les procédures
nationales de sélection et les procédures internationales de nomination présentent des
lacunes, il existe en outre un risque que les juges ne soient pas suffisamment qualifiés
pour s’acquitter de leur mandat, et ce au détriment de la légitimité et de l’autorité des
juridictions internationales. La question de la légitimité des juridictions internationales
est devenue aujourd’hui un sujet majeur de la littérature juridique, v. à titre d’exemple,
A. Von Bogdandy, I. Venzke, « In Whose Name ?, An investigation of International
Courts’ Public Authority and its Democratic Justification », 23 European Journal of
International law, 2012, pp. 7-41.
10. Le titre du fameux ouvrage de Christian Tomushat en témoigne, Human Rights.
Between Idealism and Realism Oxford, 2008.
11. S’ils servent en quelque sorte de « mesure d’étalon », on verra qu’ils ne sont pas exempts de
critiques.
12. Il n’est pas inutile ici de rappeler que c’est dès le début du XX siècle – au moment de
la création de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) – que des efforts ont
été déployés en vue de limiter la marge de manœuvre discrétionnaire des Etats dans la
sélection nationale des juges internationaux.
13. Ce fut une manière de prendre en considération de nombreuses critiques formulées
à l’endroit de la composition des tribunaux pénaux ad hoc (TPIY et TPIR).
14. C’est donc l’Assemblée qui fut l’aiguillon, en Europe, d’une amélioration du
standard en matière de sélection des candidats. A cet égard, il faut mentionner la
Recommandation n°1649 (2004) du 30 janvier 2004 ; la Résolution 1082 (1996), et la
Recommandation 1295 (1996) toutes les deux adoptées en avril 1996 ; la Résolution 1200
(1999) de septembre 1999 et la Résolution 1646 (2009) de janvier 2009.
15. Toute les analyses du professeur J-F. Flauss (voir bibliographie) ont parfaitement
démontré cette donne sans aucune concessions à l’égard du système du Conseil de
l’Europe et avec une extrême liberté de ton.
16. En effet, des procédures de sélection trop disparates ne permettent pas de proposer
des candidatures «homogènes» en termes de compétences.
17. Assemblée parlementaire, Résolution n°1646 (2009) du 27 janvier 2009 (4° session),
«Nomination des candidats et élection des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
265
18. Flauss J-F., RTDH, 2008, p.715.
19. Voir infra II. Les procédures internationales d’examen des candidatures. A. Etats
des lieux comparatif.
20. Comité des Ministres, CM (2012) 40 final, 29 mars 2012.
21. Ministers’ Deputies, CM (2012) 40 addendum final, 29 march 2012, 1138 Meetings,
Human Rights. 4.4. Guidelines of the Committee of Ministers on the Selection of
candidates for the post of judge at the European Court of Human Rights. Explanatory
Memorandum.
22. Le point 21 de la Déclaration se lit précisément ainsi : «L’autorité et la crédibilité de
la Cour dépendent en grande partie de la qualité de ses juges». Le point 22 précisait ces
exigences en les élargissant aux membres du greffe : «22 Le haut niveau des juges élus à
la Cour est fonction de la qualité des candidats présentés à l’Assemblée parlementaire.
Le choix de candidats ayant la plus haute envergure possible, opéré par les Etats
parties, est de ce fait primordial pour préserver le succès de la Cour, tout comme l’est
un Greffe de grande qualité, composé de juristes choisis en raison de leurs compétences
juridiques et de leurs connaissances du droit et de la pratique des Etats parties, qui
apporte un soutien inestimable aux juges de la Cour.»
23. J-F. Flauss, révélait ainsi qu’en 2004, «dans la quasi-totalité des cas, la liste nationale
des candidatures a été, soit présentée, approuvée ou décidée par le gouvernement
(Pologne, Allemagne, Croatie, Grèce, Malte, Liechtenstein, Irlande, Islande, Azerbaïdjan,
Estonie, Norvège), le chef de l’Etat (Russie, Lituanie, Bosnie Herzégovine), soit
communiquée par l’Etat (Portugal, Suède, Belgique, République tchèque, France) ou les
autorités nationales (Arménie, Pays-Bas), ce qui signifie que ce sont les autorités
exécutives du pays qui ont eu la haute main sur la sélection des candidats», RTDH, 2005,
p. 19.
24. Assemblée parlementaire, Election des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme. Liste des curriculae vitae des candidats présentés par le Gouvernement de la
République Slovaque. Communication. Secrétaire général de l’Assemblée, Doc.13232, 13
juin 2013. Le document présente avec force détails la procédure interne de sélection.
25. Ces discussions – dues à la connaissance personnelle de certains juges et de certains
membres du greffe – ont été axées expressément ces derniers mois sur les processus de
sélection ; l’objectif était d’obtenir le plus de renseignements pratiques possibles afin
d’élaborer ce rapport.
26. Assemblée parlementaire, Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme, Rapport, Nomination des candidats et élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme, 1er décembre 2008, Doc. 11767 (rapporteur, Christophe Chope,
RU, Groupe démocrate européen).
27. Elles existent dans les pays suivants : Arménie, Bulgarie, République tchèque,
Finlande, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Norvège, Pologne, Saint-
Marin, Serbie, Royaume-Uni.
28. Miller V., «The European Court of Human Rights: the election of Judges», House of
Commons, International Affairs and Defence Section, 2011, SN/IA/5949, p.8.
29. Flauss J-F., RTDH, 2005, pp.19-20.
30. Il s’agit de l’Azerbaïdjan de l’Autriche, de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de
la France, de l’Allemagne, de la Hongrie, de l’Irlande, du Liechtenstein, de Malte, de
Monaco, des Pays Bas, de la Suède et de la Suisse.
31. Eléments obtenus grâce à plusieurs entretiens informels avec des membres de la
Cour.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
266
32. On sait que la constitution de ces groupes remonte à la Convention internationale
sur le règlement des conflits internationaux de La Haye de 1907 dont l’article 44 fixe la
composition.
33. On rappellera ici que chaque groupe national ne peut comprendre au plus que 4
personnes «d’une compétence reconnue dans les questions de droit international,
jouissant de la plus haute considération morale et disposées par ailleurs à accepter les
fonctions d’arbitre en tant que Membres de la Cour». Elles sont nommées pour une
durée de 6 ans renouvelable.
34. On trouve à l’heure actuelle sur la liste telle qu’établie en 2013, deux anciens
conseillers d’Etat qui furent deux anciens juges internationaux (Gilbert Guillaume et J-
P. Puissochet), déjà plusieurs fois nommés sur la liste de la CPA (le premier en 1980 et
2011 et le deuxième en 1990 et 2010). La troisième personne est également Conseiller
d’Etat, actuellement Directrice du Service juridique des Affaires étrangères (Edwige
Belliard) ; enfin, on recense un professeur d’Université, Geneviève Burdeau, professeur
à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I), qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Il s’agit, pour ces deux dernières personnes, de la première nomination sur la
liste de la CPA.
35. Il s’agit de la Bosnie-Herzégovine, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Roumanie, de la
Fédération de Russie, de la Slovénie, de l’Ex-République yougoslave de Macédoine, de
l’Ukraine et de la Slovaquie.
36. Les critères que doivent satisfaire les candidats à la fonction de juge d’une instance
internationale sont les suivants:
a. avoir achevé une formation juridique sanctionnée par un Master de la faculté de
droit d’une université slovaque, ou posséder un diplôme de droit obtenu après
l’achèvement d’études de même niveau dans une université étrangère pour autant que
le diplôme soit reconnu ou qu’il ait été validé en Slovaquie;
b. être une personnalité intègre aux compétences reconnues en droit et posséder des
qualités morales qui garantissent qu’elle exercera dûment son mandat;
c. avoir sa résidence permanente en Slovaquie;
d. avoir pleinement la capacité légale et un état de santé lui permettant de s’acquitter
de ses obligations judiciaires;
e. avoir réussi l’examen professionnel judiciaire, l’examen de procureur, l’examen du
barreau ou l’examen de notaire et avoir une expérience juridique de cinq ans au moins.
37. OAS General Assembly, AG/RES. 2166 (XXXVI-O/06), 6 June 2006. Voir en annexe le
texte dans son ensemble.
38. Est-ce qu’il serait bon à cet égard que l’AG délègue ce travail à un autre organe de
l’OEA ? La question reste posée. Il serait intéressant de voir quel est l’organe dont les
travaux seraient le plus «pris au sérieux» par les Etats et dont les propositions auraient
le plus de poids. Il pourrait s’agir soit du Comité juridique interaméricain, soit du
Comité des affaires juridiques et politiques (Committee on Juridical and Political affairs,
CJPA).
39. On a vu que la très grande majorité des Etats avait opté pour des procédures ad hoc ;
or, elles ont le grand défaut d’être concoctées à la hâte, afin de répondre, sous la
pression, à un besoin urgent : elles sont donc clairement à éviter.
40. Permanent Council, Guidelines for Participation of Civil society Organizations in
OAS Activities, OEA.Sec.G./CP Res. 759 (1217/99), 15 December 1999.
41. Gonzalez Volio L., «The Institution of the Ombudsman. The Latin American
Experience», Revista IIDH, Enero-Junio 2003, n°37, pp. 219 et ss. ; Rosales de Conrad M-
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
267
T., El Defensor del pueblo. Un estudio con especial referencia al Ecuador, Montevideo,
Fondation Konrad Adenauer, 2004, 327 p.
42. Est-il besoin de rappeler ici que les Ombudsmen se sont déjà portés parties
intervenantes devant la CIDH contre leur propre Etat ? Cette simple démarche
démontre, à n’en pas douter, leur indépendance.
43. A cet égard, la composition actuelle de la Cour interaméricaine n’est pas in se le
reflet de la diversité ethnique du continent ; de même, le fait que ne s’y trouve plus
aucune femme, pose un problème en termes d’équité et de représentativité. D’ailleurs,
le fait qu’il n’y ait eu que quatre femmes depuis sa création démontre a contrario qu’il y
a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le constat n’est pas le même s’agissant de la
composition de la Commission IDH, beaucoup plus équilibrée d’une manière générale.
44. Bien qu’il existe des communautés indigènes au Chili et en Argentine (ainsi des
Mapuches), elles ne constituent pas une part importante de la population de ces pays du
fait des guerres d’exterminations menées à la fin du XIXème siècle (v. La « Conquête du
Désert » Conquista del Desierto et la Pacification de l’Araucanie / Pacificacion de la
Araucania).
45. La liste sera de deux candidats s’il n’y a pas de ressortissants d’un autre Etat partie à
l’OEA qui s’est présenté et qui a été retenu ; dans le cas contraire, la liste sera de trois
candidats (cf le libellé de l’article 53§3 de la Convention américaine).
46. Ce point est d’autant plus important que la pratique démontre que les Etats ne présentent en
réalité qu’un seul candidat.
47. Le texte de l’article 255 TFUE est reproduit en annexe.
48. V. supra I° partie.
49. Toutes les informations qui suivent ont été extraites des rapports annuels du «Comité 255»,
des discours de certains de ses membres (Lord Mance, J-M. Sauvé), autant de documents intégrés
dans la bibliographie à la fin de ce document.
50. Décision du Conseil du 25 février 2010 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu
à l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2010/124/UE).
51. Décision du Conseil du 25 février 2010 portant désignation des membres du Comité prévu à
l’article 255 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2010/125/UE).
52. CJUE, 29 juin 2010, Commission européenne c. The Bavarian Lager Co. Ltd, Contrôleur européen de la
protection des données (CEPD), aff. C-28/08 P).
53. J-M. Sauvé, «Sélection des juges de l’Union européenne : la pratique du Comité de l’article
255», Intervention lors du Séminaire, Selecting Europe’s Judges : A critical Appraisanl of Appointment
processes to the European Courts, Collège d’Europe, Bruges, 4 novembre 2013.
54. Article 253 al. 1 TFEU : «...They shall be appointed by common accord of the governments of
the Member States for a term of six years, after consultation of the panel provided for in Article
255 ».
55. Il s’agit d’une initiative du Président français Jean-Paul Costa qui prit à la lettre la Déclaration
d’Interlaken (18-19 Février 2010). Elle avait en effet appelé à “the full satisfaction of the
Convention’s criteria for office as a judge of the Court, including knowledge of public
international law and the national legal systems as well as proficiency in at least one official
language”. It should be noted that following the Interlaken Declaration, the Committee of Ministers
adopted Guidelines on the selection of candidates for the post of judge at the European Court of Human
Rights (doc. CM(2012)40 & Addendum), which go further than the Interlaken Declaration on the
question of linguistic competence (“Candidates must, as an absolute minimum, be proficient in
one official language of the Council of Europe ... and should also possess at least a passive
knowledge of the other”), referring to Parliamentary Assembly Resolution 1646 (2009), para. 4.4
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
268
56. Comité des Ministres, CM/Res (2010) 26, 10 novembre 2010. Ce document est reproduit en
annexe.
57. “The judges shall be of high moral character and must either possess the
qualifications required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of
recognised competence.
58. On en apprend plus en lisant la suite du rapport du Comité directeur des droits de l’homme :
« The activities of the Advisory Panel have, however, twice been discussed during exchanges
between the Chair of the Panel and the Ministers’ Deputies (on 4 April 2012 & 30 January 2013:
see DH-GDR(2013)005). In addition, it is worthwhile mentioning that there have been informal
meetings between the Chair of the Panel and representatives of the Parliamentary Assembly,
such as the Chairperson of the Sub-committee on the Election of Judges, the President of the
Parliamentary Assembly and the Secretary General of the Parliamentary Assembly », Steering
Committee of Human Rights (CDDH), CDDH report on the review of the functioning of the Advisory
Panel of experts on candidates for election as judge to the European Court of Human Rights, Strasbourg,
29 November 2013, CDDH(2013)R79 Addendum II, §27.
59. Voici un panorama plus détaillé de la procédure en termes temporels : «The
members shall give their opinion on a list of candidates within five working days
following the receipt of the list from its Secretariat. This should ensure that there is
sufficient time to request additional information from the government concerned, if
necessary. Within four weeks after the State Party submits the names of the proposed
candidates and their curricula vitae (using the model CV form as supplied by the
Parliamentary Assembly), the Government is informed of the views of the Advisory
Panel. Given the fact that governments are requested to provide the necessary
information to the Advisory Panel six weeks before the time-limit set by the Parliamentary
Assembly for submission of the national list of candidates, this then leaves only two
weeks to present a new candidate in case the Advisory Panel expresses doubts as to the
qualifications of any of the candidates. Before the State Party submits the list to the
Assembly, the newly proposed candidates’ qualifications should also be assessed by the
Advisory Panel Steering Committee of Human Rights (CDDH), CDDH report on the review
of the functioning of the Advisory Panel of experts on candidates for election as judge to the
European Court of Human Rights, Strasbourg, 29 November 2013, CDDH(2013)R79
Addendum II, §23.
60. «Although neither is the government concerned required to follow the Advisory Panel’s
advice, nor is the Parliamentary Assembly required to act consistently with it, it was noted that
there was an instance in 2012 when despite the Advisory Panel’s view that a candidate was not
qualified, the Government concerned maintained that person on the list of candidates and the
Parliamentary Assembly subsequently elected that person to the Court» (§30, CDHH Report).
61. «There have been instances in which State Parties have submitted lists of
candidates to the Parliamentary Assembly and the Advisory Panel simultaneously, or
only to the Parliamentary Assembly, without awaiting the Advisory Panel’s opinion and
despite the Advisory Panel having requested additional time for examination of the
curricula vitae concerned. In two instances, the Advisory Panel requested the
Parliamentary Assembly not to proceed with the election process before it had been
able to issue an opinion» (§33, CDHH Report).
62. «The CDDH considers such practices by States Parties to be incompatible with the
raison d’être of CM Resolution (2010) 26. States Parties are reminded of the need to
submit lists of candidates well before the deadline by which they must submit their list
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
269
to the Parliamentary Assembly. Likewise, the Parliamentary Assembly is invited not to
proceed with the election process without allowing the Advisory Panel a reasonable
time within which to inform the State Party concerned of its views on the intended
candidates. Where a list of candidates has already been transmitted to the
Parliamentary Assembly, the Advisory Panel should simultaneously transmit its views
to the latter.» (§34, CDHH Report).
63. Comité directeur des droits de l’homme, Rapport, §§40 and 41.
64. Cette importante Résolution est reprise dans le Règlement de l’Assemblée, Strasbourg, janvier
2012, p. 155.
65. Assemblée parlementaire, Recommandation 1649 (2004), Candidatures à la Cour européenne des
droits de l’homme, 30 janvier 2004, 8ème session.
66. Cour européenne des droits de l’homme, 12 février 2008, Avis consultatif, sur certaines
questions juridiques relatives aux listes de candidats présentées en vue de l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme.
67. «The purpose of the Inter-American Juridical Committee is to serve the Organization as an
advisory body on juridical matters» et 100 de la Charte de l’OEA : «The Inter-American Juridical
Committee shall undertake the studies and preparatory work assigned to it by the General
Assembly».
68. Voir infra, règle n°2 de bonne gouvernance.
69. En effet, même si des ONG aussi importantes que CEJIL ont pu affirmer le contraire (CEJIL,
Aportes, 2005, p.9) et même si dans l’histoire du système interaméricain il ait pu arriver de
constater que certaines personnes ne possédaient pas entièrement toutes les qualifications
requises (surtout au sein de la Commission plus que de la Cour), je pense que l’existence de « cas
isolés » ne peut pas être comparée au problème de fond qui a fortement déstabilisé le système
européen en la matière (voir première partie) au point de malmener très fortement la
« légitimité » de la Cour européenne.
70. Le Mexique dispose à l’heure actuelle (en 2014) de trois importants représentants
au sein du Système Interaméricain : le Président de la Commission, le Secrétaire
Général Exécutif de la Commission et un juge à la Cour). Cela démontre la puissance
politique du pays qui a « réussi » à faire élire trois personnalités aux compétences
incontestées ; aujourd’hui, on peut considérer que cet élément est positif car la
politique juridique extérieure du Mexique est marquée tout à la fois par la valorisation
d’un processus d’excellence dans le cadre des nominations internationales (CEJIL, 2008,
p. 19) et par la « défense » du système inter-américain. Toutefois, on peut imaginer
l’effet dévastateur si un pays – à la politique juridique extérieure plus contestable –
arrivait au même résultat…
71. Dans le même ordre d’idées, il est symptomatique de constater que certains pays
n’ont jamais eu de juges de leur nationalité à la Cour (ainsi de la Bolivie, du Salvador, du
Guatemala ou encore du Paraguay), alors que la Colombie, le Costa Rica, le Venezuela,
mais aussi le Chili et le Mexique ont obtenu à plusieurs reprises des juges de leur
nationalité.
72. Quelle que d’ailleurs les modalités de l’élection : celle des représentants des Etats (OEA) ou
celle des représentants des peuples (comme l’expérience de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe le démontre).
73. Ici, il est clair que je suis assez « radicale » et sans doute très (voire trop ?) idéaliste. En effet,
si tous les auteurs ont pu dénoncer le processus de « politisation » de l’élection des commissaires
et des juges – en 1998, H. Fáundez Ledesma, “La independencia e imparcialidad de los miembros
de la Comision y de la Corte : paradojas y desafios”, J. Méndez & F. Cox (eds), El futuro del sistema
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
270
Interamericano de los Derechos Humanos, IIDH, San José, 1998 ; en 2007, J. Schönsteiner, Revista IIDH,
2007 ; en 2012, O. Ruiz-Chiriboga, “The Independence of the Inter-American Judge”, The Law and
Practive of International Courts and Tribunals, 2012 – ils n’ont pas été jusqu’à proposer la
suppression du système électif.
74. Article 4§1 du Statut de la Cour et 2§1 du Statut de la Commission.
75. Article 71 de la Convention américaine : “The position of judge of the Court or member of the
Commission is incompatible with any other activity that might affect the independence or
impartiality of such judge or member, as determined in the respective statutes.”
76. L’article 18§1 du Statut de la Cour : “1. The position of judge of the Inter-American
Court of Human Rights is incompatible with the following positions and activities: 1.
Members or high-ranking officials of the executive branch of government, except for
those who hold positions that do not place them under the direct control of the executive branch
and those of diplomatic agents who are not Chiefs of Missions to the OAS or to any of its member
states; 2. Officials of international organizations ; 3. Any others that might prevent the
judges from discharging their duties, or that might affect their independence or
impartiality, or the dignity and prestige of the office.”
77. Article 4 du règlement de procédure de la Commission interaméricaine : “The
position of member of the Inter‐American Commission on Human Rights is
incompatible with the exercise of activities which could affect the independence or
impartiality of the member, or the dignity or prestige of the office. Upon taking office,
members shall undertake not to represent victims or their relatives, or States, in
precautionary measures, petitions and individual cases before the IACHR for a period of
two years, counted from the date of the end of their term as members of the
Commission.”
78. Il s’est agi de Cecilia Medina Quiroga (2004-2009, Chili), de Sonia Picado Sotela (1988-1994,
Costa Rica), de Rhadys Iris Abreu Blondet (2007-2012, République dominicaine), et Margaret May
Macaulay (2007-2012, Jamaïque). J. Mo Pasqualucci a prsenté un portrait passionnant du parcours
de Sonia Picado qui fut nommée Ambassadeur du Costa Rica aux Etats-Unis après sa fonction de
juge à la Cour : «Sonia Picado, First Woman Judge on the Inter-American Court of Human Rights,
Human Rights Quaterly, vol.17, n°4 (Nov.1995), pp.794-806. Mentionnons également les travaux
académiques de Cecilia Medina Quiroga qui fut la seule universitaire parmi les quatre femmes
juges nommées, v. entre autres choses, C. Medina Quiroga, The Battle of Human Rights, Gross
Systematic Violations and the Inter-American System, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 363 p. ; La
Convencion americana : vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial,
Universidad de Chile, Facultad de derecho, Centro de derechos humanos, 2005, 428 p.
79. Il est assez décevant de constater qu’en dépit d’une très importante littérature sur les
approches féministes du droit qui a tenté de faire “bouger les lignes” – ad ex. H. Charlesworth,
Sexe, Genre et droit international, Paris, Pedone, 2013, p. (Col. Doctrines) – les pratiques à l’échelle
internationale continuent d’être marquées par des paramètres classiques.
80. Avec la Cour EDH, la Cour pénale internationale et la Cour africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples possèdent des règles non contraignantes encourageant la
représentation équitable des sexes dans leur composition.
81. Article 54§1 de la Convention américaine : “The judges of the Court shall be elected for a term
of six years and may be reelected only once.”
82. Article 6 : « The members of the Commission shall be elected for a term of four
years and may be reelected only once. Their terms of office shall begin on January 1 of
the year following the year in which they are elected. »
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
271
83. Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human rights and
Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention, par. 50 : “The judge’s terms of
office have been changed and increased to nine years. Judges may not, however, been reelected.
These changes are intended to reinforce their independence and impartiality, as desired notably
by the Parliamentary Assembly in its Recommendation 1649 (2004).
84. Popescu C-L., «La Cour européenne des droits de l’homme», Indépendance et
impartialité des juges internationaux, Ruiz-Fabri H., Sorel J-M., (dir.), Paris, Pedone, 2010,
p.83.
ABSTRACTS
Many factors – institutional, financial, procedural, legal – are participating to insure the
independence as well as the impartiality of International Judges. The national and international
processes to select and nominate candidate is one of them. Following a comparative approach
(focusing in the European experiences of the EU and Council of Europe legal orders), this article
study national and international processes to select and nominate candidates to an Inter-
American judge or commissioner mandate; it analyzes these two issues from a procedural angle
in order to identify –– the best criteria to encourage States, but also the OAS as such, to set up
good practices in terms of judicial governance, as well as from a material angle so as to identify
the candidates’ profile, their gender, ethnic origin etc.
De nombreux facteurs – institutionnels, financiers, procéduraux et juridiques – participent à
assurer l’indépendance comme l’impartialité des juges internationaux ; les processus internes et
internationaux de leur sélection et de leur nomination en font partie. Sur la base d’une approche
comparative (centrée sur les expériences européennes de l’UE et du Conseil de l’Europe), cet
article analyse les processus nationaux et internationaux de sélection et de nomination des
candidats aux fonctions de commissaires et de juges interaméricains. Ces deux questions sont
analysées tout à la fois sous un angle procédural, afin d’identifier les meilleurs critères
permettant d’inciter les Etats – mais aussi l’OEA comme telle – à mettre en place des bonnes
pratiques de gouvernance judiciaire, mais également sous un angle matériel afin de discerner le
profil professionnel des candidats, leur sexe et leur origine ethnique notamment.
INDEX
Mots-clés: Justice internationale – Indépendance – Impartialité - Critères de sélection –
Transparence - Cour interaméricaine des droits de l’homme - Commission interaméricaine des
droits de l’homme - Cour européenne des droits de l’homme - Cour de justice de l’Unio
Keywords: International Judiciary – Independence – Impartiality - Selection process –
Accountability -Inter-American Court of Human Rights - Inter-American Commission on Human
Rights -European Court of Human Rights - Court of justice of the European Union
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
272
AUTHOR
LAURENCE BURGORGUE-LARSEN
Laurence Burgorgue-Larsen est professeur de droit public à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, membre de l’IREDIES (Institut de Recherche en droit international et
européen de la Sorbonne). Comparatiste, s’intéressant à l’étude des rapports de
systèmes et au pluralisme constitutionnel, elle s’est notamment spécialisée dans l’étude
des systèmes régionaux de protection des droits de l’homme.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
273
La première décision au fond de la
Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples
(Arrêt du 14 juin 2013 sur les affaires jointes Tangayika Law Society &
The Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher
R. Mtikila c. Tanzanie)
Alain Didier Olinga
1 La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
était attendue par l’ensemble de ceux qui s’intéressent au fonctionnement et au
devenir du système africain de garantie des droits fondamentaux 1. Après de
nombreuses décisions d’incompétence2, l’occasion lui en a été offerte par le groupe
d’affaires n° 009/2011 et 011/2011 contre la République Unie de Tanzanie, l’un des rares
Etats à avoir souscrit la déclaration de l’article 36 paragraphe 4 du Protocole de
Ouagadougou et à être ainsi exposé au risque d’être attrait devant la Cour par des ONG
et des individus3. On ne peut que saluer ce premier pas, car il permet de voir comment
la Cour aborde des questions de fond du droit, ou de droit substantiel, et comment sur
ces questions elle se positionne par rapport à l’acquis jurisprudentiel de la Commission
de Banjul. Pour autant, il n’est pas sûr que cette première sortie au fond laissera un
souvenir indélébile ; en effet, à notre avis, elle laisse interrogateur sur un certain
nombre d’aspects, au point de créer une situation d’incertitude sur des aspects
processuels et de fond dans le système de protection articulé autour de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples. Avant de les relever, il importe
naturellement de revenir un tant soit peu sur les faits de la cause.
2 Les données factuelles qui ont donné lieu à l’arrêt du 14 juin 2013 sont simples. En 1992,
est adoptée en Tanzanie une révision constitutionnelle prescrivant l’affiliation à un
parti politique de tout candidat potentiel aux élections présidentielles, parlementaires
et locales et excluant, de jure et de facto, toute candidature indépendante 4. Cette révision
sera contestée devant les instances judiciaires par M. Mtikila, avec succès, puisque en
octobre 1994 la Haute Cour lui donne raison. En décembre 1994, l’Assemblée nationale
adopte un projet de loi réaffirmant l’interdiction des candidatures indépendantes, loi
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
274
entrée en vigueur en janvier 1995. M. Mtikila conteste à nouveau cette loi devant la
Haute Cour en 2005, soit dix ans après son entrée en vigueur, avec succès, car la Haute
Cour lui donne une fois de plus raison. Cette décision de la Haute Cour est contestée en
2009 par l’Attorney General devant la Cour d’Appel, laquelle, dans un arrêt du 17 juin
2010, infirme la position de la Haute Cour et confirme l’interdiction des candidatures
indépendantes. Il s’agit ainsi d’un processus judiciaire interne assez saccadé, étalé sur
près de vingt ans. C’est suite à cette décision de la Cour d’Appel que deux requêtes vont
être déposées devant la Cour africaine les 2 et 10 juin par les premier et second
requérants, à l’effet de faire constater que l’interdiction des candidatures
indépendantes méconnaît le droit de participer à la direction des affaires publiques de
son pays, la liberté d’association, le droit à l’égalité et à la non discrimination et le
principe de l’Etat de droit. La Cour, à l’unanimité, après un peu plus de deux ans de
procédure (du 2 juin 2011 au 16 juin 2013) va constater la violation par la Tanzanie des
deux premiers droits ; à la majorité de sept contre deux, elle constate la violation du
troisième droit, mais les deux juges dissidents n’ont pas formulé, comme ils en ont le
droit sans y être pour autant astreints, d’opinion dissidente explicitant leur position.
Elle estime que la question de la violation de l’Etat de droit est sans intérêt. La Cour
ordonne à la Tanzanie de « prendre toutes les mesures constitutionnelles, législatives et autres
dispositions utiles dans un délai raisonnable, afin de mettre fin aux violations constatées et
informer la Cour des mesures prises à cet égard ». Elle réserve la question de la réparation à
un examen ultérieur, le temps que M. Mtikila précise ses exigences à cet égard.
3 La décision concerne ainsi une question constitutionnelle de la plus haute importance
et de grande sensibilité pour de nombreux Etats africains. D’ailleurs, le défendeur a fait
valoir que « la question des candidatures indépendantes est une question politique et
non juridique » (paragraphe 94 de l’arrêt). Cette question a déjà été abordée par
d’autres mécanismes internationaux de contrôle, notamment le Comité des droits de
l’homme5 et la Cour interaméricaine des droits de l’homme 6. Pour mieux apprécier les
enseignements que l’on peut tirer de cette première décision au fond, il semble indiqué
d’aborder successivement les questions de procédure, dont le traitement apparaît
prometteur, puis les aspects de fond proprement dits, dont l’examen paraît plus
discutable et moins convaincant.
I. Un traitement prometteur des questions de
procédure par la Cour
4 La procédure est un aspect essentiel du contentieux, et particulièrement du
contentieux international7. Elle est un élément qui légitime le travail technique du juge,
et prépare ce faisant l’acceptation de ses décisions. Dans cette affaire, l’on a observé
une continuité dans la rigueur avec laquelle est appliqué le principe de récusation des
juges, avec l’abstention à siéger du juge Ramadani, de nationalité tanzanienne 8. La
jonction des requêtes a paru plus hésitante. Au paragraphe 78, elle est justifiée du fait
de « positions sensiblement similaires » des deux requérants, alors qu’au paragraphe
89.1, ces positions sont « essentiellement identiques », même si la Cour se réserve de
traiter différemment les deux requêtes quand cela serait nécessaire. De telles formules
ne sont pas sans susciter quelque perplexité quant à la pratique de la jonction des
requêtes devant la Cour. Au-delà de ces aspects, trois questions méritent un examen
particulier sur le terrain de la procédure : la question du locus standi des requérants,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
275
l’examen des conditions de recevabilité par la Cour et la question de la compétence
ratione temporis de la Cour.
A. La question du locus standi des requérants
5 La Cour s’est assurée que la Tanzanie avait souscrit le déclaration de l’article 34(6) du
Protocole de Ouagadougou, et que les ONG auteurs du premier recours avaient bien le
statut d’observateurs auprès de la Commission de Banjul. De ce point de vue, tous les
requérants avaient incontestablement qualité pour agir. Mais cette qualité est
potentiellement la même pour tous ceux qui se trouvent dans cette situation, à l’égard
d’un Etat ayant souscrit la déclaration de l’article 34(6). Cela leur confère-t-il, pour
autant, en toutes situations de violations alléguées des droits, le locus standi ? La Cour ne
s’est pas spécialement intéressée à ce point, probablement parce que le défendeur lui-
même n’a pas eu à cet égard une attitude particulièrement offensive et combative. Seul
le juge Ouguergouz, dans son opinion individuelle, a invité la Cour à se montrer à
l’avenir plus vigilante sur la question de l’intérêt pour agir des requérants. Au
paragraphe 26 de son opinion, il estime qu’ « une action devant la Cour n’est en effet
recevable que si son auteur justifie de son intérêt propre à l’engager. Pour faire la
preuve de cet intérêt, le requérant doit en conséquence démontrer que l’action ou
l’abstention de l’Etat défendeur concerne un droit dont ledit requérant est titulaire ou
le droit d’un individu au nom duquel le requérant souhaite intervenir ». En réalité,
l’auteur de la requête doit démontrer en quoi il est « victime » de ce qu’il impute à
l’Etat comme fait illicite au regard de la Charte, ou en quoi ceux au nom desquels il agit
sont « victimes » de la violation alléguée. De manière plus générale, la Cour doit
clarifier le point de savoir si le droit de recours actionné devant elle par des individus
ou des ONG est un droit de recours potentiellement objectif, une démarche d’actio
popularis. Cette question n’est pas banale, car les Etats encore hésitants à entrer dans le
jeu de la déclaration de l’article 34(6) pourraient se montrer encore plus réticents à
l’intégrer, si le prétoire de la Cour devait être encombré de requêtes à propos
desquelles les plaignants n’auraient pas besoin de montrer en quoi ce qu’ils imputent à
l’Etat leur a causé un préjudice ; une telle situation pourrait transformer le prétoire de
la Cour en une tribune de contestation générale des évolutions politiques et sociales au
sein des Etats parties à la Charte.
6 Dans le cas sous examen, les requérants agissent, pour les premiers, pour le compte de
leurs membres, membres dont l’identité n’est pas connue et dont il n’est établi à aucun
moment que l’application des dispositions constitutionnelles querellées leur a causé le
moindre préjudice et, le second, pour son propre compte. Là encore, si ce dernier,
responsable de parti ayant pris part aux élections dans son pays sans succès, a contesté
au niveau des juridictions nationales l’exclusion des candidatures indépendantes, il
n’établit pas en quoi cette exclusion lui a concrètement causé un préjudice. Dans les
deux cas, le dommage causé ou susceptible de l’être à des individus concrets, est vague.
L’on est donc en plein contentieux objectif, et l’on peut se demander si la Cour,
désireuse sans doute d’avoir enfin une décision au fond et entraînée par la
communauté des ONG, n’a pas ouvert une voie qu’elle pourrait avoir du mal à refermer,
même si ce faisant elle rejoint une approche déjà essayée au niveau de la Commission 9.
Il serait judicieux pour la Cour, dans le respect de son autonomie, de s’inspirer de la
démarche de son homologue européenne. Devant la Cour de Strasbourg en effet, une
ONG ne peut introduire un recours et se prétendre victime simplement parce qu’elle a
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
276
pour mandat, par ses statuts, de promouvoir une cause relative aux droits de l’homme.
Elle doit être victime, elle-même, d’un acte ou d’une omission qui viole la Convention
européenne des droits de l’homme. De même, pour ce qui est de l’individu, sous réserve
des situations de victime indirecte ou de victime potentielle, il doit avoir un intérêt
personnel à agir et ne peut demander un examen in abstracto de la conformité d’un
texte national à l’instrument international. Le comportement querellé de l’Etat ne doit
pas seulement « concerner un droit », selon les termes du juge Ouguergouz, mais lui
porter atteinte de manière spécifique et concrète10.
7 En tout état de cause, comme il n’y avait pas de dommage individualisé, toute la
discussion judiciaire est restée pour beaucoup un exercice théorique, un discours
principiel. Or, l’on peut douter de ce que la fonction d’une instance judiciaire soit
d’effectuer des exercices théoriques de ce type, plutôt que de trancher, dans des causes
bien précises, des problèmes mettant en jeu des droits concrets et effectifs.
8 Deux affirmations de la Cour sont à cet égard problématiques à notre avis. Au
paragraphe 110 in fine, elle affirme qu’ « une affaire comme celle en l’espèce ne peut et
ne doit pas être examinée comme s’il s’agissait d’une action personnelle et il serait
dangereux pour la Cour de donner cette impression. S’il y a violation, elle affecte tous
les Tanzaniens ; et si la Cour fait droit à la requête introduite par le Requérant, cette
décision profitera à tous les Tanzaniens ». Au paragraphe 111, elle conclut en affirmant
que « les Tanzaniens ne sont donc pas libres de participer à la direction des affaires
publiques de leur pays, directement ou par le libre choix de leurs représentants ». Ces
deux affirmations laissent réellement songeur. Si le droit de recours ouvert aux
individus et ONG est une déclinaison du recours individuel, il est clair que les actions
introduites, à défaut d’être personnelles, doivent être personnalisées, individualisées,
cibler des atteintes portées à des droits dans le chef d’individus concrets et
identifiables. Le recours individuel n’est pas un recours dans l’intérêt direct et objectif
du droit des droits de l’homme, mais d’abord dans l’intérêt de droits subjectifs
d’individus concrets. Or, il n’y avait pas devant la Cour un requérant ou une victime
nommé (e) « les Tanzaniens ». De plus, les Tanzaniens n’ont mandaté ni les deux ONG, ni
M. Mtikila pour défendre leurs droits à Arusha. Il n’est même pas démontré dans l’arrêt
que, au-delà des actions des requérants, en Tanzanie puis devant la Cour, la question
objet des requêtes agitait particulièrement la société tanzanienne et que les Tanzaniens
la considéraient comme une question cruciale et vitale pour l’exercice de leurs droits
politiques11. Affirmer, sur la seule base de l’exclusion des candidatures indépendantes,
que « les Tanzaniens ne sont pas libres de participer à la direction des affaires
publiques de leur pays » paraît si exagéré que l’on se demande comment la Cour a pu
réunir l’unanimité sur une telle conclusion.
9 Si la Cour estime qu’il est « dangereux » pour elle de donner l’impression que l’action
judiciaire de M. Mtikila est une action personnelle, individuelle, il faudrait déterminer
sur quel fondement l’on va octroyer une réparation à ce deuxième requérant. Le
paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation aurait pour objet de
réparer exactement quel préjudice, quel dommage personnellement subi ? Cette
question est importante car, de bout en bout de l’arrêt, il n’est fait nulle part mention
d’un dommage matériel subi par le deuxième requérant intuitu personae, sauf l’allusion
faite au paragraphe 110 au « fardeau que représente la création et l’entretien d’un parti
politique», fardeau non quantifié exprimé par la Cour et dont ne s’est pas plaint le
requérant ! Si l’on est en présence d’un recours objectif, d’un préjudice objectif, d’une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
277
violation objective de la Charte, il faut que tout cela se termine par une réparation
objective. On voit mal par quelle logique juridique l’on devrait compenser par une
réparation matérielle ou indemnitaire un préjudice objectif, puisqu’il fallait surtout
éviter d’aborder la requête de M. Mtikila comme une action personnelle ! En somme, la
Cour a semblé faire abstraction de la notion de victime dans l’appréciation du locus
standi des requérants, ouvrant la voie devant elle à une logique d’actio popularis, laquelle
ne peut manquer de déteindre sur l’examen de la compétence et, surtout, de la
recevabilité.
B. L’examen des exceptions d’irrecevabilité par la Cour
10 Compte tenu de ce que la Cour et la Commission de Banjul fonctionneront en
complémentarité sur le terrain de la recevabilité12, et au regard de la longue pratique
de cette dernière13, l’attention devra être vigilante quant à la démarche de la Cour sur
le terrain de la recevabilité, non seulement en ce qui concerne l’interprétation de
l’article 5614 de la Charte que les deux institutions interprètent chacune en ce qui la
concerne, mais aussi en ce qui concerne la démarche méthodologique suivie par la
Cour.
11 La première remarque d’ordre général à faire est que, à ce stade du fonctionnement de
la Cour, l’on peine à donner un contenu procédural à la différence entre les articles 38 15,
3916 et 40 17 du Règlement de la Cour. En particulier, l’on se demande comment
distinguer l’examen préliminaire de la recevabilité, effectué proprio motu par la Cour, et
l’examen normal de la recevabilité, une fois que l’affaire a été inscrite au rôle de la
Cour.
12 La deuxième remarque porte sur l’ordre d’examen par la Cour des questions de
compétence et de recevabilité. Cet ordre est résumé au paragraphe 88 de l’arrêt en ces
termes : « les requêtes étant recevables et la compétence en l’espèce étant établie, la
Cour procède à l’examen de l’affaire au fond… ». Cette démarche peu habituelle, à en
croire le juge Ngoepe dans une « opinion individuelle » elle-même d’une tonalité
inhabituelle, divise la Cour. Le juge Ngoepe signale en effet que les arguments en faveur
d’un ordre d’examen plutôt qu’un autre sont « solides », même si ces arguments
respectifs ne sont pas exposés, ce d’autant plus que selon lui, « le ciel ne s’effondrera
pas simplement parce que dans une affaire, la Cour a commencé par traiter de la
recevabilité au lieu de la compétence, ou vice versa ». Pourtant, si l’on réserve le cas
particulier d’une exception d’irrecevabilité tirée de ce que l’objet de la requête ne
rentre pas dans le champ matériel de la compétence de la Cour (article 56-2 de la
Charte), exception qui est à la fois une exception d’incompétence matérielle de la Cour
et d’irrecevabilité ratione materiae de la requête, la compétence et la recevabilité sont
évidemment distinctes et l’examen de la première précède logiquement celui de la
seconde. A cet égard, l’on ne peut qu’adhérer à la position de bon sens, de logique et de
principe des juges Niyungeko et Ouguergouz exprimée dans leur opinion individuelle
respective. Comme le dit en effet l’ancien Président de la Cour, « est-ce que cela aurait
un sens qu’il (le juge) commence à s’occuper de ce qu’on lui demande de faire, sans au
préalable se préoccuper de savoir s’il peut le faire ? La logique et le bon sens
commandent que la Cour s’assure d’abord qu’elle a compétence avant d’examiner la
requête sous l’angle de la recevabilité ». Pour le juge Ouguergouz, « la Cour doit d’abord
s’assurer qu’elle a compétence pour connaître d’une requête avant d’examiner la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
278
recevabilité de celle-ci ; elle doit le faire proprio motu même lorsque l’Etat défendeur n’a
pas soulevé d’exceptions d’incompétence ». Le juge Ngoepe, avons-nous dit, évoque de
« solides arguments » en faveur de la thèse opposée. Sauf le respect du secret du
délibéré, l’on est curieux d’en prendre connaissance. Car l’enjeu de la question n’est
certes pas à la mesure d’un risque d’effondrement du ciel, mais il serait pour le moins
cocasse pour la Cour d’avoir à constater qu’elle est incompétente après avoir déclaré
une requête recevable18. Sans compétence établie, il n’y a pas d’aptitude à trancher la
question de la recevabilité.
13 La troisième remarque générale à faire concerne la démarche de la Cour en ce qui
concerne l’examen des conditions de recevabilité, démarche qui tranche nettement,
dans cette affaire, avec celle suivie par la Commission de Banjul. Selon la jurisprudence
établie de cette dernière, les conditions de recevabilité de l’article 56 sont solidaires et
doivent, toutes, être examinées à l’occasion d’une affaire, que la partie défenderesse ait
ou non soulevé des objections à cet égard. Ainsi, la Commission a-t-elle développé une
pratique consistant à examiner des conditions de recevabilité à propos desquelles les
parties ne sont pas du tout en désaccord, ou à continuer l’examen de la recevabilité
alors même qu’elle avait déjà constaté le non respect d’une condition, ce qui en
principe devrait arrêter ledit examen19. De même, cette approche a abouti à faire de
l’examen de la recevabilité, un stade procédural incontournable et autonome, au terme
duquel la Commission doit aboutir à une décision, avant d’entamer le fond de l’affaire.
En somme, la recevabilité est examinée de manière systématique, et non dans le cadre
d’une procédure incidente destinée à évacuer une exception d’irrecevabilité. A la
lecture de l’arrêt de la Cour, l’on se rend compte que cette dernière a limité son examen
aux conditions de recevabilité dont le non respect a été soulevé par le défendeur, sans
évoquer les autres. Une telle démarche est pertinente et devrait être maintenue par la
Cour elle-même et accueillie par la Commission de Banjul. Elle devrait l’être pour au
moins deux raisons. D’abord, le procès est l’affaire des parties, et l’organe de contrôle,
sauf si le texte adopté par les Etats et l’instituant l’exige, n’a pas à créer des points de
divergence que les parties elles-mêmes n’ont pas soulevés. Ensuite, le but de la
procédure étant d’examiner une demande au fond relative à des allégations de
violation des droits, toute l’énergie procédurale doit être mobilisée à cette fin et n’être
contrariée qu’en cas d’incident de procédure exprimé à travers une exception formelle.
L’organe de contrôle ne peut prendre sur lui le risque de trouver, par lui-même, un
motif d’irrecevabilité non soulevé par le défendeur20. Il faut d’ailleurs espérer que les
futurs amici curare se garderont d’agir de la sorte.
14 Ces remarques faites, il importe de suivre l’analyse par la Cour des exceptions
d’irrecevabilité soulevées, au nombre de deux : le non épuisement des voies de recours
internes, le retard dans l’introduction de la requête. L’épuisement des voies de recours
internes est la condition de recevabilité la plus examinée devant les mécanismes
internationaux de protection des droits de l’homme, et la jurisprudence de la
Commission de Banjul est déjà abondante à son sujet 21. La Cour s’est alignée, pour
l’essentiel, sur l’œuvre de la Commission et des autres mécanismes internationaux de
garantie, présentée au paragraphe 82.1 comme « la jurisprudence établie ». Elle
s’appuie sur l’acquis jurisprudentiel concernant la nature des recours concernés, à
savoir les recours judiciaires, les caractéristiques de ces recours, à savoir leur
disponibilité et efficacité, entre autres. Sur ce point, la Cour n’innove pas. Son
alignement sur l’approche de la Commission de Banjul et sur celle de ses devancières
européenne et interaméricaine vient conforter une situation normative largement
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
279
stabilisée. Il est du reste à noter que le défendeur lui a particulièrement facilité la
tâche, avec cette insistance étrange sur le processus parlementaire qui aurait été en cours
sur la question des candidatures indépendantes. La Cour remporte une victoire trop
facile, exprimée au paragraphe 82.3 in fine en ces termes : « quelle que soit la nature
démocratique du processus parlementaire, celui-ci ne peut pas équivaloir à un
processus judiciaire indépendant devant lequel on peut faire valoir des droits consacrés
par la Charte ». L’on peut cependant regretter la formule de la Cour contenue dans le
même paragraphe selon laquelle « nous constatons que les Requérants ont épuisé les
voies de recours internes prévues à l’article 6(2) du Protocole lu conjointement avec l’article
56(5) de la Charte »22. Une telle formule est inutilement équivoque, car l’article 6(2) du
Protocole ne traite d’aucune voie de recours interne, ni même d’aucune condition de
recevabilité et se borne à renvoyer à l’article 56 de la Charte. Il vaut mieux s’en tenir à
ce renvoi, en considérant simplement que ce dernier article, en dépit de sa non révision
formelle, est aujourd’hui délesté de la référence à la Charte de l’OUA au profit de l’Acte
Constitutif de l’Union africaine, comme l’exprime l’article 40 du Règlement de la Cour. 23
15 En ce qui concerne le délai d’introduction de la requête, le défendeur estimait qu’il était
long et que les requérants devaient être considérés comme forclos. L’argumentation de
la Cour sur la question est particulièrement sommaire, alors même que, tout comme
sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, la « jurisprudence
établie » au niveau de la Commission africaine et ailleurs est importante. Sur ce point
précis, la Commission de Banjul s’est alignée sur le délai de 6 mois suivant l’acte interne
querellé, délai retenu au niveau européen, sauf circonstances spéciales liées au cas sous
examen. La Cour, pour des besoins de sécurité juridique, aurait pu reprendre
explicitement cette ligne de conduite pertinente. Certes, elle prend en compte les
circonstances, puisque son appréciation est effectuée « compte tenu des
circonstances » liées à l’attente, par les requérants, de la réaction du Parlement après
l’arrêt de la Cour d’Appel confirmant l’interdiction des candidatures indépendantes.
L’on retient donc que la Cour statue in concreto. Il est vrai que la circonstance évoquée
peut être déroutante, puisqu’il s’agit du processus parlementaire consécutif à l’arrêt de
la Cour d’Appel. Or, au moment de l’introduction de la requête, ce processus était,
semble-t-il, précisément en cours, sans que l’on sache certes quelles en seraient la
durée et l’issue. Si les requérants étaient en droit d’ « attendre la réaction du
Parlement », à partir de quel moment pouvait-on estimer que cette attente était libérée
parce que la réaction du Parlement tardait à se manifester ? La Cour ne se penche pas
particulièrement sur cette question.
C. La question de la compétence ratione temporis de la Cour
16 Le défendeur estimait que la situation à la base des requêtes, à savoir l’interdiction en
1992 des candidatures indépendantes, était antérieure à l’entrée en vigueur du
Protocole de Ouagadougou pour la Tanzanie (soit après le 10 février 2006, date de dépôt
de l’instrument de ratification de cet Etat), et à la souscription de la déclaration
reconnaissant le droit des individus et des ONG à saisir directement la Cour (29 mars
2010, date du dépôt de la déclaration par la Tanzanie). En conséquence, la Cour ne
saurait en connaître. La Cour n’est pas de cet avis, car estime-t- elle, les droits dont la
violation est alléguée sont protégés par la Charte de 1981, ratifiée par le défendeur bien
avant la survenance des faits litigieux (en 1984). Ces faits se sont prolongés après la
ratification du Protocole, ainsi qu’après la souscription de la déclaration de l’article
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
280
34(6) par la Tanzanie. La Cour se réfère, ce faisant, à la notion de « violation continue »
bien connue du contentieux international des droits fondamentaux 24. L’on pouvait se
demander si le recours à l’idée d’allégations de violation qui se prolongent était utile
dans ce contexte. En effet, sur la même question de l’interdiction des candidatures
indépendantes, il y a eu des actes normatifs, parlementaires ou judiciaires, à différentes
périodes de la vie politique de la Tanzanie, et de la vie du droit africain des droits de
l’homme dans l’ordre juridique de la Tanzanie. En 1992, il y a eu un acte du Parlement
excluant les candidatures indépendantes ; en 1994, un acte judiciaire en faveur des
candidatures indépendantes ; en 1994, un acte du parlement réaffirmant l’interdiction
des candidatures indépendantes ; en 2006, un acte judiciaire en faveur des candidatures
indépendantes ; en 2010, un acte judiciaire contre les candidatures indépendantes. Mais
pendant toute cette période, au-delà des actes juridiques, la réalité sur le terrain
électoral était celle de l’interdiction des candidatures indépendantes. La compétence de
la Cour à l’égard des requêtes individuelles et des ONG visant la Tanzanie débute à
partir du dépôt de sa déclaration en vertu de l’article 34(6). Seuls les faits produits à
partir de cette date peuvent être déférés à la Cour par ces demandeurs. Les faits
antérieurs ne peuvent l’être que si, entamés avant cette date, ils se poursuivent eux-
mêmes ou dans leurs effets après cette date. Tel est bien le cas de la situation de
l’interdiction des candidatures indépendantes. Ayant débuté avant même la naissance
de la Cour, elle persiste au moment où la Cour en est régulièrement saisie. Pour la Cour,
il ne peut s’agir d’un fait antérieur consommé, mais d’un fait actuel.
17 Les juges Niyungeko et Ouguergouz ont reproché à la Cour, dans leur opinion
individuelle respective, de n’avoir pas suffisamment distingué les choses, mêlant les
obligations en vertu de la Charte avec celles en vertu du Protocole ou même de la
déclaration de l’article 34(6). Pour le premier, « l’on n’aperçoit pas très bien quelle
conclusion la Cour tire de la date d’entrée en vigueur de la Charte, par rapport à
l’argument de non rétroactivité du Protocole avancé par l’Etat défendeur »
(paragraphe 11 de l’opinion). Quant au second, il affirme que « la Cour ne peut être
saisie d’allégations de violations des droits de l’homme et des peuples par un individu
ou une ONG que si les violations alléguées sont postérieures à l’entrée en vigueur à
l’égard de l’Etat concerné non seulement de la Charte africaine mais également du
Protocole et surtout de la déclaration facultative » (paragraphe 21 de l’opinion). Cette
charge des deux juges peut sembler excessive. On se demande en effet si, même si le
propos peut sembler mêlé, ce que le juge Ouguergouz affirme ne se trouve pas au
paragraphe 84 de l’arrêt. A notre avis, en substance, la Cour exprime dans ce
paragraphe ce que dit, de manière plus savante et professorale assurément, le juge
Ouguergouz. Cependant, l’on peut se demander quelle portée il faut accorder au propos
du juge Ouguergouz selon lequel « la Cour aurait dû opérer une distinction plus nette
entre les obligations de l’Etat défendeur au titre de la Charte africaine et celles qu’il a
contractées au titre du Protocole et de la déclaration facultative » (paragraphe 20 de
l’opinion individuelle). Techniquement, la Charte, le Protocole et la déclaration sont
des instruments juridiques distincts, mais intimement liés, notamment par le fait que le
réservoir d’obligations substantielles est dans un instrument unique, la Charte, y
compris les textes adoptés ultérieurement pour la compléter ou l’enrichir. Les
obligations en vertu de la déclaration se ramènent à l’acceptation d’être cité à
comparaître par des individus et ONG, sans plus. Cependant l’objet de la citation n’est
pas dans la déclaration, mais plutôt dans la Charte. Par nature, une déclaration de
l’article 34(6) ne traite pas de questions de substance des droits et tout Etat qui le ferait
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
281
effectuerait un détournement de finalité de la déclaration25. Ensuite, la ratification du
Protocole comporte l’obligation de se soumettre aux procédures diligentées devant la
Cour par les attributaires du droit de saisine, ainsi que de contribuer au
fonctionnement de la Cour. Là encore, cette ratification n’a pas d’effet sur la substance
des droits, sous réserve de l’élargissement par l’article 3 du Protocole du droit
applicable devant la Cour. En somme, la séparation des obligations ne saurait être
exagérée, puisque la Charte reste dans tous les cas le seul réservoir d’obligations
substantielles. Les obligations en vertu du Protocole ou de la déclaration de l’article
34(6) ne signifient rien dès lors que l’on fait abstraction de la Charte. Dans le contexte
de la complémentarité entre la Commission et la Cour, l’on ne doit pas exclure a priori
que la Cour puisse se retrouver en train d’examiner, sur renvoi de la Commission, une
affaire concernant un Etat par rapport auquel, suivant l’approche classique de la non
rétroactivité, la Cour en principe ne devrait pas exercer sa compétence, parce que
probablement elle n’aurait même pas d’effets continus, la violation alléguée ayant été
consommée définitivement (meurtre, torture, par exemple).
18 Quoiqu’il en soit, la Cour devra toujours davantage clarifier son propos. Ce qui est
valable au plan de la procédure l’est encore plus lorsque l’on aborde la manière dont la
Cour s’est saisie des questions de fond des requêtes.
II. Une analyse insatisfaisante des questions
substantielles soulevées par les requêtes
19 Si la Cour africaine doit exercer un leadership technique sur le système africain des
droits de l’homme, c’est sur le terrain de l’interprétation substantielle des droits
énoncés dans la Charte qu’il lui faudra construire ce positionnement, vis-à-vis de la
Commission de Banjul et aussi des juridictions des communautés économiques
régionales26, lesquelles ont des règles de procédure spécifiques et ne partagent avec les
mécanismes dédiés au contrôle international de la Charte que la substance des droits,
libertés et devoirs énoncés dans la Charte de 198127. A la lecture de l’arrêt du 14 juin
2013, il est clair que si des tendances interprétatives s’affirment nettement, des efforts
substantiels sont encore nécessaires pour espérer se hisser, au plan de la démarche
technique, au niveau de ses homologues européenne et interaméricaine. Le problème
de fond que la Cour avait à adresser est une question de droit constitutionnel partagée
par de nombreux Etats parties à la Charte, à savoir la conformité de la prohibition des
candidatures indépendantes aux élections et l’obligation symétrique d’être affilié à un
parti ou d’être présenté par un parti pour participer aux élections à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples. La République Unie de Tanzanie, comme de très
nombreux Etats africains, a retenu depuis 1992 ce système. C’est cette organisation des
choses qui est sur la sellette dans les deux requêtes. C’est elle qui est abordée à travers
les droits examinés par la Cour, à savoir le droit de participer à la direction des affaires
de son pays, la liberté d’association et le droit à l’égalité et à la non-discrimination. La
position générale de la Cour est sans équivoque : l’obligation d’affiliation à un parti
pour se porter candidat aux élections viole de la même manière tous ces droits. La Cour
a repris, à l’occasion de l’examen des requêtes au fond, la démarche jurisprudentielle
adoptée par ses homologues européenne28 et interaméricaine 29, et par la Commission
africaine. Cette démarche comprend les éléments d’appréciation suivants : nécessité de
l’ingérence dans une société démocratique, proportionnalité de l’ingérence à l’objectif
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
282
poursuivi, légitimité du but poursuivi par l’ingérence, limitation des motifs d’ingérence
à ceux énoncés à l’article 27(2), construction d’un juste équilibre entre les exigences de
l’intérêt général de la communauté et les impératifs de protection des droits
individuels fondamentaux. Dans cette démarche la Cour emprunte 30 massivement aux
autres organes de protection, ce qui réduit sa marge de novation et d’autonomie dans
l’interprétation. On ne peut que se réjouir de la réception, par la Cour, d’un fond de
principes d’examen des ingérences étatiques dans l’exercice des droits qui ont fait leurs
preuves au regard de leur haut niveau d’exigence. Pour autant, leur usage massif dans
le contexte de la présente affaire laisse un goût mitigé. Pour s’en convaincre, il importe
d’examiner successivement les trois droits traités par la Cour.
20 Auparavant, il est à relever que la Cour a refusé de discuter du moyen tiré de la
violation de l’Etat de droit, estimant que « le concept de l’état de droit est un principe
d’ensemble dont relèvent tous les droits de l’homme et qui ne saurait être traité dans
l’abstrait ou dans la globalité. De plus, l’argument des Requérants selon lequel l’état de
droit n’a pas été respecté n’est rattaché à aucun droit spécifique » (paragraphe 121 de
l’arrêt). Le refus d’examiner le moyen tiré de la violation de l’Etat de droit peut
étonner. D’abord parce que la Cour a retenu la notion de « société démocratique»
(paragraphe 106.1) qui ne figure pourtant pas comme telle dans la Charte, notion qui
n’est pas en substance éloignée de celle d’Etat de droit ; ensuite parce que, en traitant
de sa compétence matérielle au paragraphe 85 in fine, « la Cour considère que les
violations alléguées relèvent du champ d’application » de l’article 3(1) du Protocole. Or
parmi ces « violations alléguées » figure bien la violation de l’Etat de droit. Il n’est pas
logique d’affirmer en même temps que les violations alléguées relèvent, toutes, de la
compétence matérielle de la Cour, et que l’une d’elles ne peut être traitée par la Cour
du fait de sa globalité et parce qu’elle ne cible aucune disposition de la Charte. Il eut été
plus simple de ne pas retenir ce moyen, parce que « incompatible avec la Charte » au
sens de l’article 56 (2) de ladite Charte. Enfin, le préambule de la Charte renvoie à la
Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle, dans le considérant 3 de son
propre préambule, énonce qu’ « il est essentiel que les droits de l’homme soient
protégés par un régime de droit… », les droits de l’homme étant les choses de l’Etat de
droit et de la société démocratique. Le Pr Weckel a salué ce refus d’examiner l’Etat de
droit, en avançant « le principe de l’indifférence du droit international à l’égard des
questions constitutionnelles »31. Ce principe d’indifférence est à relativiser, la
jurisprudence internationale des droits de l’homme, en Afrique même, en particulier
devant la Commission de Banjul, ayant déjà abordé des questions à impact
constitutionnel direct32, confirmant ainsi l’idée selon laquelle le droit international des
droits de l’homme est un élément au service de la mesure de la qualité de l’ordre
constitutionnel, si ce n’est un élément de « l’internationalisation des constitutions » 33.
21 Cette précision faite, il est temps de revenir à l’examen circonstancié des droits dont la
violation est alléguée par les requérants.
A. L’interdiction des candidatures indépendantes au regard du droit
de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays
22 La discussion de la Cour sur le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays a occupé une part importante de l’examen au fond des requêtes ; cette
discussion a, pour ainsi dire, influencé les conclusions au sujet de la légitimité des
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
283
ingérences dans les autres droits. Ce droit est consacré à l’article 13(1) de la Charte. Les
requérants ayant contesté la légitimité de l’interdiction des candidatures
indépendantes, l’Etat tanzanien a estimé que cette interdiction était justifiée par un
certain nombre de nécessités liées à la réalité historique et nationale tanzanienne. Au
paragraphe 90.1, il est mentionné la nécessité de « garantir la bonne gouvernance et
l’unité du pays » ; au paragraphe 94, il est fait allusion aux « nécessités sociales du
pays » et aux « réalités historiques » ; au paragraphe 102, il est évoqué « la structure de
l’Union, la République Unie de Tanzanie étant composée de la Tanzanie continentale et
de Tanzanie Zanzibar », ainsi que la nécessité « d’éviter tout tribalisme en Tanzanie ».
Face à ces arguments, la position de la Cour est nette, telle qu’exprimée au paragraphe
109 : « toute loi qui exige du citoyen d’être membre d’un parti politique avant de se
présenter aux élections présidentielles, législatives et locales est une mesure inutile,
qui porte atteinte au droit du citoyen de participer directement à la vie politique et
constitue donc une violation d’un droit ». Il s’agit là d’une condamnation de principe de
l’interdiction des candidatures indépendantes, ne découlant nullement de la mise en
œuvre de la méthode de recherche du juste équilibre entre les droits individuels et les
exigences de l’intérêt général que la Cour a pourtant dit faire sienne, alors même que le
défendeur l’y invitait en évoquant l’arrêt de la Cour interaméricaine en l’affaire
Castaneda Gutman c. Mexique. Une telle condamnation de principe rend sans objet
l’examen des arguments de l’Etat pour justifier la mesure adoptée au plan national. De
deux choses l’une : ou bien, en soi, l’interdiction des candidatures indépendantes est
une violation de la Charte et il suffit de constater son existence pour conclure à la
violation ; ou bien il n’en est pas ainsi et l’examen des arguments de l’Etat peut avoir
lieu sur le terrain de la légalité, de la nécessité, de la proportionnalité, etc.., et le propos
général du paragraphe 109 par conséquent ne mérite pas de figurer dans l’arrêt.
23 Dès le paragraphe 99 de l’arrêt, et avant même d’avoir mené son analyse, la Cour
conclut en ces termes : « vu la clarté manifeste du libellé de l’article 13 (1) de la Charte
(…), exiger d’un candidat qu’il soit membre d’un parti politique avant d’être autorisé à
participer à la vie politique en Tanzanie constitue certainement une violation des droits
consacrés à l’article 13 (1) de la Charte ». Nous avons la faiblesse de penser que ce
propos, là où il est situé, constitue une faute méthodologique. En concluant avant
d’avoir examiné la pertinence des arguments de l’Etat tanzanien justifiant le modèle
tanzanien d’aménagement de la candidature à divers types d’élections, la Cour s’est
condamnée à motiver à tout prix, à sens unique, dans le sens de la conclusion posée,
quitte à faire plus assaut d’amoncellement d’énoncés empruntés çà et là qu’à
argumenter in concreto de manière autonome. L’argument de la « clarté manifeste » du
droit en cause est une illusion, laquelle a le défaut de faire croire à la Cour qu’elle est
dispensée de dire, d’abord, en quoi consiste précisément le droit dont elle constate
d’emblée la violation. Or, ce droit ne peut se réduire au droit d’être candidat
indépendant à des élections. Les formes de participation à la direction des affaires
publiques de son pays sont nombreuses et variables ; elles ne sont pas toutes (voire pas
du tout) déclinées dans la Charte de 198134. Le citoyen peut participer à la direction des
affaires publiques en tant qu’électeur, en tant que militant de parti, en tant que
candidat, dans les conditions prévues par la loi, ce qui implique qu’en la matière les
Etats ont une marge d’appréciation35. De quelle étendue ? La Cour n’en dit mot. La Cour
ne se penche sur le contenu du droit examiné que treize paragraphes après en avoir
affirmé la violation, au paragraphe 107.3, et en recourant à une interprétation extra
africaine, celle exclusive de l’Observation générale du Comité des droits de l’homme
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
284
n°25, que la Cour fait sienne et considère comme « une déclaration faisant autorité (…),
qui reflète l’esprit de l’article 13 de la Charte et qui, en vertu de l’article 60 de la Charte,
est ‘un instrument adopté par les Nations Unies relatif aux droits de l’homme’ dont la
Cour peut ‘s’inspirer’ pour sa propre interprétation »36. En fait, l’on n’a aucune
démarche interprétative, mais l’adhésion à une posture adoptée par une instance quasi
juridictionnelle dans un contexte non contentieux. Cette adhésion, dans le contexte de
la présente affaire, peut dérouter puisque la Cour affirme au paragraphe 123 qu’il est
« inutile » d’examiner l’application, notamment, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques dans l’affaire en l’espèce. Finalement, la Cour n’aura pas «
appliqué » le Pacte, mais se sera « inspirée » de son interprétation à froid 37donnée par le
Comité des droits de l’homme pour traiter du moyen tiré du non respect du droit de
prendre part à direction des affaires publiques de son pays. D’un autre côté, l’on ne
peut se lancer dans un exercice d’examen de la légitimité de ce que l’on appelle
rapidement des « restrictions » ou « limitations » d’un droit, sans l’avoir déjà bien
défini, et surtout après avoir affirmé sa violation. La violation ne devrait être constatée
que si la restriction établie dans la jouissance ou l’exercice d’un droit, au contenu
précisé, est dépourvue de légitimité, de nécessité, de proportionnalité, etc. C’est au
terme de l’examen des motifs de limitation allégués, au regard de l’ampleur des
limitations opérées, que l’on peut, en cas de déséquilibre injustifié au détriment du
droit atteint, conclure à la violation. En ayant inversé l’ordre des éléments de l’analyse,
la Cour s’est retrouvée obligée d’explorer une somme inutilement intimidante
d’espèces jurisprudentielles tirées de partout mais, surtout, d’avoir un discours pro
domo, tel que cela apparaît aux paragraphes 107.2, 109 in fine, 110 et 111 de l’arrêt.
24 En tout état de cause, la Cour n’a pas procédé à une analyse rigoureuse de la situation. A
notre sens, elle devait d’abord dire ce qu’impose l’article 13 (1) aux Etats et quelle est la
marge d’appréciation à cet égard. Ensuite, elle devait dire en quoi l’obligation
d’affiliation à un parti par tout potentiel candidat est constitutive, a priori, d’une
atteinte au droit garanti par l’article 13 (1). Cela fait, la Cour devait examiner les
arguments avancés par l’Etat pour justifier l’orientation de sa réglementation sur le
terrain de la légalité, de la nécessité, de la proportionnalité, de manière concrète et
contextuelle, et non en général. Ce n’est qu’au terme d’une telle démarche que la Cour
pouvait conclure à la violation du droit visé. Or, la Cour commence par affirmer la
violation et, seulement ensuite, essaie de l’établir par tous les moyens. Elle commence
par traiter longuement, sans raison impérieuse, de l’approche des restrictions aux
droits par les divers mécanismes internationaux relatifs aux droits. Après quoi, la Cour
examine l’application de cette approche au cas sous examen, si l’on peut dire (car en
fait il n’en est rien, les arguments tanzaniens étant plus évacués qu’examinés). Puis la
Cour énonce le contenu même du droit dont elle assure la sanction, et achève par des
développements généraux sur l’inutilité38 des candidatures patronnées par les partis
politiques. Il est évident qu’une telle démarche analytique est tout sauf rigoureuse et
intelligible. Le paragraphe 107.2, en particulier, est insatisfaisant, en ce qu’il affirme
plus qu’il ne démontre. De plus, il est difficilement compréhensible, lorsqu’il énonce
que « les besoins de la population tanzanienne, auxquels sont soumis les droits
individuels, doivent, à notre avis être conformes aux obligations individuelles, comme
le prévoit l’article 27(2) de la Charte et respecter la sécurité collective, la morale,
l’intérêt commun et la solidarité ». Cette phrase est difficilement lisible. Pour la Cour,
les restrictions « ne sont pas proportionnelles à l’objectif avancé, qui est le
renforcement de l’unité et de la solidarité nationale ». Naturellement, la Cour ne
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
285
démontre pas en quoi il y a disproportion par rapport à l’objectif légitime poursuivi.
Finalement, de postulats en généralités, la Cour en arrive non seulement à l’affirmation
du paragraphe 109 déjà citée, mais aussi aux paragraphes 110 et 111 où la cause dépasse
même les requérants pour concerner « les Tanzaniens » dans leur ensemble. A notre
sens, l’affirmation du paragraphe 109 est si générale dans sa formulation que l’on peut
douter a priori de sa pertinence. Seul le juge Ouguergouz, dans son opinion individuelle,
s’est démarqué de cette prise de position de principe de la Cour. Au paragraphe 28 de
son opinion individuelle, il écrit : « je considère que l’interdiction des candidatures
indépendantes à certaines élections et l’obligation corrélative d’appartenir à un parti
politique ne sont pas en elles-mêmes des violations des articles 10 et 13(1) de la Charte
africaine ; elles ne constituent des violations de ces dispositions que si elles peuvent
s’analyser comme des restrictions non raisonnables ou non légitimes à l’exercice des
droits consacrés ». Comme la violation de l’article 13(1) a été acquise à l’unanimité, l’on
aurait aimé savoir en quoi, pour le juge Ouguergouz, la réglementation tanzanienne
était dépourvue de légitimité et de caractère raisonnable.
B. L’interdiction des candidatures indépendantes face à la liberté
d’association
25 Sur la lancée de ses conclusions relatives au droit de participer à la direction des
affaires publiques de son pays, la Cour va aborder la liberté d’association et parvenir à
une conclusion identique, à savoir la violation de cette liberté par la Tanzanie. Pour la
Cour, « le fait que le Défendeur exige de ses citoyens d’adhérer à un parti politique et
d’être investi par celui-ci comme préalable pour se porter candidat aux élections
locales, législatives ou présidentielles constitue une entrave à la liberté d’association,
puisque les individus sont contraints d’adhérer à une association ou d’en créer une,
avant de pouvoir se porter candidat à des postes électifs » (paragraphe 114 de l’arrêt).
Pourtant, comme pour le premier moyen, le raisonnement par lequel la Cour parvient à
cette conclusion n’est pas convaincant et, une fois de plus, l’on ne peut que marquer de
l’étonnement face à l’unanimité des membres de la Cour.
26 La première remarque à faire est relative à la décision de la Cour d’aborder la question
sous l’angle de la liberté d’association tout court. En effet, si les partis politiques sont
des formes associatives, il ne s’agit pas d’associations comme les autres, mais des
associations politiques, dont la fonction première, depuis l’émergence de ce type
organisationnel, est de contribuer à la structuration de l’offre politique, à la formation
politique des citoyens, à la formation et à la sélection du personnel politique dirigeant,
à l’expression du suffrage. L’histoire politique de l’Afrique, marquée par le phénomène
du parti unique, peut justifier une méfiance vis-à-vis de l’obligation d’être patronné par
un parti pour être éligible. Mais cela ne saurait autoriser sur le principe une
condamnation du rôle des partis dans le jeu politique. Parce qu’ils assument une
fonction d’un intérêt public évident pour la régulation de la société politique, les partis
politiques, sous certaines conditions, accèdent généralement au financement public de
l’Etat. Un parti politique n’est-il qu’une association comme les autres, dont le régime
doit être apprécié à l’aune de la liberté générale d’association, sans aucune
particularité ? La Cour n’a pas cru devoir se prononcer sur cette question, pourtant
importante à notre avis39. Elle s’est bornée à rappeler le libellé de l’article 10(2) de la
Charte : « nul ne peut être obligé de faire partie d’une association, sous réserve de
l’obligation de solidarité prévue à l’article 29 ». La Cour reconnaît aux Etats « une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
286
certaine marge de discrétion concernant la limitation à la liberté d’association, dans
l’intérêt de la sécurité collective, de la morale, de l’intérêt commun et qui respecte les
droits et les libertés d’autrui ». Cependant, la Cour ne confronte pas l’interdiction des
candidatures indépendantes avec les clauses de limitation relevées, pour apprécier si la
Tanzanie a, en l’occurrence, abusé de la « mesure de discrétion » reconnue en la
matière aux Etats. Plutôt que cette démonstration circonstanciée, elle énonce une
considération de principe : « la Cour estime qu’il ya atteinte à la liberté d’association
dès lors qu’un individu est contraint de s’associer avec d’autres personnes. La liberté
d’association est aussi bafouée lorsque les autres citoyens sont obligés de s’associer
avec un individu. En d’autres termes, la liberté d’association signifie que chacun est
libre de s’associer et libre de ne pas le faire » (paragraphe 113). Sans aucune
explication, elle décrète au paragraphe 115 ne pas être « convaincue que les nécessités
sociales avancées soient conformes aux critères des exceptions prévues à l’article 29 (4)
et à l’article 27(2) de la Charte, au point de justifier la limitation du droit du citoyen de
choisir de s’associer ou de ne pas s’associer, selon son choix ». Or ce que la Cour devait
établir est que, dans le contexte tanzanien concerné, l’intérêt des individus de prendre
part à titre individuel à la compétition électorale est parfaitement compatible avec la
préservation des réalités sociales, la structure de l’Union, l’unité du pays, etc… ; que le
besoin social de voir les partis jouer un rôle de premier plan dans le fonctionnement de
la société politique tanzanienne, vu ses réalités, peut se concilier avec la volonté des
individus de participer à la vie politique et aux élections en dehors des partis
politiques. Il n’était pas impossible de l’établir ; il appartenait à la Cour de le faire.
27 Avec la référence à l’article 29 (4), on est obligé de relativiser la position exprimée par
la Cour au paragraphe 107.1 de l’arrêt, où elle « s’accorde avec la Commission africaine
pour dire que les limitations aux droits et aux libertés prévues dans la Charte ne
peuvent être uniquement que celles qui sont précisées à l’article 27 (2) de la Charte… ».
L’examen de la liberté d’association montre clairement que la Cour s’est accordée un
peu précipitamment avec la Commission de Banjul, au regard du renvoi explicite de
l’article 10(2) de la Charte à l’article 29 de celle-ci, c'est-à-dire à une clause de
limitation autre que l’article 27(2).
28 Dans le cadre de la Charte, le propos suivant lequel « la liberté d’association signifie que
chacun est libre de s’associer et libre de ne pas le faire » est excessif, voire erroné en
droit, au regard du libellé même de l’article 10 (2) de la Charte. L’obligation de
solidarité qui y est mentionnée a précisément pour objet de justifier que l’on puisse
contraindre une personne à faire partie d’une association. La contrainte à l’association
fondée sur l’obligation de solidarité n’est pas une atteinte à la liberté d’association au
regard de la Charte, mais bien plutôt une dimension de cette liberté. La liberté
d’association aurait ainsi trois dimensions dans la Charte de 1981 : la liberté de
s’associer, la liberté de ne pas s’associer, l’obligation de s’associer dans la mesure où
l’obligation de solidarité de l’article 29 l’exige, c'est-à-dire lorsqu’il faut « préserver » et
« renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est
menacée ». Ainsi, il y aurait deux niveaux d’appréciation de la légitimité des ingérences
étatiques par rapport à la liberté d’association. D’une part, l’article 27(2), clause
générale de limitation ; d’autre part l’article 29, clause spéciale de limitation. Si la
clause générale de limitation est jugée inopérante par l’organe de contrôle, il resterait
toujours à apprécier la clause spéciale de limitation. De par l’article 27(2), la liberté
d’association (de s’associer ou de ne pas s’associer) doit s’exercer dans le respect,
notamment, de « l’intérêt commun ». De par l’article 29(4), la liberté d’association dans
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
287
son volet négatif (ne pas s’associer) peut être contrainte, en vue « de préserver et de
renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement (pas exclusivement, donc)
lorsque celle-ci est menacée ». Ce que la Cour avait à établir, pour respecter l’approche
en termes de « juste équilibre », c’est que l’intérêt commun possiblement allégué ne
pouvait justifier l’obligation d’affiliation à un parti politique pour prétendre à la
candidature à des fonctions électives. Ce que la Cour avait à démontrer, c’est que la
préservation et le renforcement de la solidarité sociale et nationale ne pouvaient
justifier, en l’occurrence, l’obligation de s’affilier à un parti pour prétendre être
candidat à des fonctions de représentation politique au sein de l’Etat. Ces
démonstrations, la Cour ne les a pas faites, et sa position est ainsi fragile sur le terrain
de l’argumentation juridique. Il ne suffit pas de dire que la Cour n’est pas convaincue
des nécessités avancées par l’Etat ; encore faut-il démontrer en quoi ces nécessités ne
sont pas convaincantes. Faute de le faire, la Cour elle-même ne convainc pas. Dès lors,
les affirmations contenues aux paragraphes 113 et 114 n’emportent nullement la
conviction sur le terrain de l’interprétation du droit.
C. L’interdiction des candidatures indépendantes au prisme de la
non-discrimination et de l’égalité devant la loi
29 Les requérants ont fait valoir que l’interdiction des candidatures indépendantes
constituait une atteinte au droit à la non discrimination énoncé à l’article 2 de la
Charte, lequel doit être lu en relation avec le droit à l’égalité devant la loi consacré à
l’article 3(2) de la Charte. Au paragraphe 116 de l’arrêt, il est dit qu’ils soutiennent que
les dispositions constitutionnelles ont pour effet de créer une discrimination à l’égard
de la majorité des Tanzaniens. Au paragraphe 117, cet argument est étayé par celui en
vertu duquel « seuls ceux qui sont membres d’un parti politique et qui sont parrainés
par celui-ci peuvent se présenter aux élections présidentielles, parlementaires ou
locales », les autres en étant exclus. Il y a donc une « différence de traitement entre
Tanzaniens» du fait des dispositions constitutionnelles querellées. Le propos est confus.
Tantôt, les requérants affirment que la discrimination est un « effet » des dispositions
constitutionnelles (paragraphes 116 et 119), tantôt, en citant au paragraphe 117 in fine
la décision de la Commission de Banjul en l’affaire Legal Resource Foundation c. Zambie,
que les dispositions constitutionnelles visaient à (et donc avaient pour but de) exclure
certains citoyens du processus démocratique, et finalement au paragraphe 119 que la
différence de traitement était « inscrite dans les amendements constitutionnels ». La
Cour partage l’argumentation des requérants sur l’existence d’une différence de
traitement, et sur le fait qu’une telle différence ne peut être justifiée par les nécessités
invoquées par l’Etat.
30 La Cour estime au paragraphe 119 que « à la lumière de l’article 2 de la Charte(…), la
discrimination alléguée pourrait être apparentée à une distinction basée sur une
‘opinion politique ou …toute autre opinion’ ». Ce propos visiblement peu élaboré laisse
dubitatif. On ne perçoit pas clairement ce que la Cour considère comme une « opinion »
sur le fondement de laquelle il y aurait eu une attitude discriminatoire de la part des
autorités tanzaniennes. Est-ce le fait de contester l’interdiction des candidatures
indépendantes ? Si telle est l’ « opinion » retenue par la Cour, il est à relever que la
réglementation tanzanienne n’exclut pas de la candidature les contestataires de
l’obligation d’affiliation partisane. Du reste, quoique contempteur déclaré d’une telle
obligation, M. Mtikila a été admis à prendre part aux élections dans son pays en tant
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
288
que candidat, sans que l’expression de son opinion, en tant que telle, lui ait valu
l’exclusion de la compétition électorale. Il n’a été démontré, ni par les requérants, ni
par la Cour, que les dispositions constitutionnelles tanzaniennes avaient pour but
affiché ou caché, au moment de leur élaboration, d’exclure une certaine opinion
politique.
31 En tout état de cause, le raisonnement de la Cour sur la non discrimination est, à notre
avis, faible. En effet, il n’est pas expliqué pourquoi la distinction à examiner sur le
terrain de la non- discrimination est celle qui oppose les citoyens « membres d’un parti
politique » et les citoyens « non membres d’un parti politique ». A notre sens, la
distinction pertinente n’est pas celle-là. La distinction à prendre en compte est celle qui
existe entre les Tanzaniens qui veulent se présenter comme candidats aux élections et
ceux qui, quoique participant également à la vie politique de leur pays en tant que
citoyens, n’entendent pas le faire dans la posture de candidats. La citoyenneté ne se
réduit pas à l’éligibilité ; cette dernière est une situation spécifique par rapport à
laquelle l’on peut examiner la légitimité d’éventuelles différences de traitement. Or, si
l’on considère que la situation comparable de base n’est pas le statut général de
citoyen, lequel est d’un spectre large, mais le statut de candidat, lequel ne concerne
qu’une catégorie circonscrite de citoyens, l’on doit noter que tous les citoyens
tanzaniens, absolument tous, sans distinction, désireux d’être candidats aux divers
types d’élections, sont soumis aux mêmes règles régissant la candidature, y compris
l’obligation d’être affilié à un parti politique. De telles règles, faut-il le rappeler, ne
peuvent être définies de manière exhaustive par un instrument international ou même
un organe international compétent en matière de droits fondamentaux, la marge
d’appréciation des Etats étant, dans un domaine où les considérations d’opportunité et
autres sont inévitables, incompressible40. Il y aurait une distinction de caractère
défavorable, une discrimination, si, parmi les citoyens désireux d’être candidats,
certains étaient libérés par la loi ou par la pratique, pour des motifs illégitimes, de
l’obligation d’affiliation à un parti, alors que d’autres y étaient astreints. Au regard des
faits de l’affaire tels qu’ils ont été reproduits dans l’arrêt, l’on voit difficilement
comment, en dehors de cette approche, la Cour pouvait établir un comportement
discriminatoire de la part de la Tanzanie.
Conclusion
32 La Cour d’Arusha a conclu son premier arrêt au fond sur une condamnation de l’Etat
tanzanien. La réparation quant à elle pourrait intervenir ultérieurement. On peut
néanmoins se demander si la Cour a le droit, comme elle l’a fait au paragraphe 124 in
fine de son arrêt, d’inviter un requérant, si ce denier le souhaite, à demander une
compensation ou une réparation. Au regard de la lettre des articles 27(1) du Protocole
et 63 du Règlement intérieur de la Cour, l’on est en droit d’en douter. Le premier article
autorise la Cour, de son propre chef, à décider d’une compensation ou d’une réparation
lorsqu’elle constate une violation, ce qu’elle n’a pas fait alors que les premiers
requérants le lui avaient explicitement demandé. Le second article prévoit que la Cour
statue sur une demande de réparation introduite par le requérant, ce que le requérant
n’a pas fait tout au long de la procédure, alors même qu’il s’était réservé le droit « de
compléter l’analyse juridique » sur la question dans sa requête introductive d’instance.
Il est clair, à notre sens, que le droit réservé devait s’exercer avant le délibéré et ne
devait pas être mis en mouvement seulement après le prononcé de l’arrêt constatant la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
289
violation, dans un tête à tête processuel entre le demandeur et la Cour, à l’exclusion du
défendeur. La circonstance que la Cour puisse se prononcer sur la réparation « dans un
arrêt séparé », distinct de l’arrêt sur le principal « si les circonstances l’exigent »,
n’implique pas que la demande de réparation doive être présentée en dehors et après la
procédure sur le principal. La demande de réparation, détaillée, doit faire partie des
conclusions du demandeur communiquées au défendeur pendant le procès. Si, selon
l’article 34 (5) du Règlement de la Cour, le principe de la demande de réparation doit
figurer dans la requête initiale, le montant de celle-ci et les éléments de preuve y
relatifs pouvant être soumis « ultérieurement », ce stade ultérieur ne peut aller au-delà
du délibéré et du prononcé de l’arrêt sur le principal. La distinction possible des arrêts
sur le principal et sur la réparation n’implique nullement une autonomisation des
procédures sur le fond et sur la réparation. Une approche différente, soit ouvrant un
nouveau procès, soit organisant une procédure en dehors du défendeur, heurterait à
notre sens le principe de bonne administration de la justice.
33 Cela dit, loin de nous la prétention d’épuiser la richesse du premier arrêt au fond de la
Cour africaine des droits de l’homme. Il montre le courage d’une jeune juridiction qui
n’hésite pas à aborder des questions sensibles de droit constitutionnel, voire de
pratique politique, avec leurs implications sur le terrain des modalités de compétition
pour le pouvoir et de représentation politique au sein des Etats. Ce faisant, comme la
Commission de Banjul, la Cour se positionne comme l’un des postes avancés de
l’accompagnement des Etats africains vers la consolidation de leur ouverture
démocratique et vers le renforcement de pratiques constitutionnelles et politiques
respectueuses des droits fondamentaux, des principes démocratiques 41. C’est pourquoi,
avec la perspective réelle d’accueillir des allégations de violation de la Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance42, la Cour devrait éviter de refuser
purement et simplement d’aborder le moyen tiré de la violation de l’Etat de droit.
L’Etat de droit est un concept dont les éléments structurants sont suffisamment
identifiables et dont les interactions avec les droits fondamentaux sont si évidentes
qu’il importe que la Cour, méthodiquement bien entendu, s’en saisisse à bras le corps,
pour aider les jeunes démocraties africaines sur le vaste chantier de la construction de
sociétés politiques humaines, décentes, conviviales, épanouissantes pour tous.
Naturellement, il lui faudra faire preuve de prudence tactique, en évitant des postures
de principe trop générales et catégoriques, et en retenant une approche contextuelle
du juste équilibre entre les nécessités sociales et les droits fondamentaux de l’individu.
La Cour ne doit pas se plier au contexte africain des droits de l’homme, souvent
dangereux pour les droits, mais doit se positionner de manière à en accompagner
résolument, mais méthodiquement, la subversion. Dans cette démarche faite de
résolution ferme et de prudence méthodique, la Cour doit pouvoir résister aux
pressions de la communauté des ONG des droits de l’homme, laquelle pourrait l’acculer
à un maximalisme interprétatif incompatible avec la prudence nécessaire attendue du
juge, y compris le juge préposé à la garantie des droits de l’homme. Le dynamisme
interprétatif doit refléter aussi, autant que possible, la réalité des évolutions concrètes
de la garantie des droits en Afrique. Rien ne serait plus abstrait que d’avoir à Banjul et à
Arusha une jurisprudence futuriste, supportant la comparaison technique avec celle
des autres mécanismes internationaux, mais avec une réalité timide des progrès des
droits de l’homme sur le continent. Les amateurs de belles formules techniques
auraient matière à s’en donner à cœur joie et à remplir les revues de commentaires
savants, mais tout cela serait comme une machine tournant à vide. A cet égard, l’on ne
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
290
peut s’empêcher d’exprimer quelque amusement gêné devant le rappel, par des
protagonistes de l’affaire, des circonstances dans lesquelles tout cela a été déclenché,
comment M. Mtikila a été presque sollicité pour voir la Cour rendre un premier arrêt au
fond43. Si les Etats, encore frileux dans leur grande majorité à souscrire la déclaration
de l’article 34(6) de la Charte, venaient à être convaincus que la Cour pourrait se
transformer en une arène où l’on vient effectuer des jeux de droit, ce serait un coup dur
pour l’avenir du recours individuel devant la juridiction africaine exclusivement dédiée
à la garantie des droits de l’homme sur le continent. Nous n’en sommes pas là,
heureusement, et il faut espérer que de tels augures ne se réaliseront pas.
NOTES
1. Olinga A. D., « L’émergence progressive d’un système africain de garantie des droits de l’home
et des peuples ». in Olinga A. D. (dir.), La protection internationale des droits de l’homme en Afrique.
Dynamique, enjeux et perspectives trente ans après l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples. Yaoundé, Editions Clé, 2012, pp. 13-35.
2. Voir état des affaires devant la Cour africaine in http://www.african-court.org/fr/index.php.
19 février 2014. Sur la première décision de la Cour, voir Olinga A.D. « Regards sur le premier
arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme ». RTDH, n° 83, 2010, pp.749-768. Voir également
Kilangi A. « Legal personality, responsibility and immunity of the African Union: Reflection on
the decision of the African Court on Human and peoples’ Rights in the Femi Falana case”, AUCIL
Journal of International Law, vol. 1, 2013, pp. 95-139 ; voir aussi Koagne Zouapet Apollin. « Une si
évidente décision…une cour bien confuse : quelques observations sur l’arrêt de la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples en l’affaire Femi Falana c. Union Africaine (affaire
n°001/2011) ». in www.africancourtcoalition.org Août 2012.
3. Au 31 décembre 2013, sept Etats avaient souscrit la déclaration de l’article 34(6) de la Charte, à
savoir : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Rwanda, la Tanzanie.
4. Voir Lekene Donfack E.C., « La candidature indépendante et la liberté de suffrage en droit
camerounais », Revue Africaine des Sciences Juridiques, 1 (2000), pp. 21-52.
5. Observation Générale n° 25 du Comité adoptée lors de sa 57è session, le 12 juillet 1996,
Participation aux affaires publiques et droit de vote. Texte disponible in HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.
I), 27 mai 2008, pp. 255-260.
6. Notamment l’arrêt de la Cour en l’affaire Castaneda Gutman c. Mexique, 6 août 2008.
7. Voir Santulli C., Droit du contentieux international. Paris, Montchrestien/Domat, 2005.
8. Voir Olinga A.D., « Pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
en 2011 », RTDH, n°93, 1er janvier 2013, pp. 123-142.
9. Voir Olinga A.D., « Vers un contentieux objectif à Banjul ? L’affaire Lawyers for Human Rights
contre Royaume du Swaziland devant la Commission africaine des droits de l’home et des
peuples », Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, 2007, 1, pp. 28-52.
10. Voir, sur la victime, Tulkens F., « Victimes et droits de l’homme dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme », in Archives de Politique Criminelle, 2002/1, n°24, pp.
41-59. Pour une variation synthétique récente sur cette question, voir Renucci J.-F., « La notion
de ‘victime’ au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme », Recueil
Dalloz, 2014, pp. 38 et s.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
291
11. Le paragraphe 74 de l’arrêt renseigne que c’est au lendemain de l’arrêt la Cour d’appel
qu’« un processus de consultation visant à recueillir l’opinion des citoyens Tanzaniens sur une
éventuelle modification de la Constitution » a été lancé, processus en cours au moment de la
saisine de la Cour, et probablement au moment du prononcé de l’arrêt, lequel serait venu
interférer dans un processus politique interne.
12. Voir Ebobrah Solomon T., « Towards a positive application of complementarity in the African
Human Rights System: issues of functions and relations”, EJIL (2011), vol.22, n°3, pp.663-688.
13. Ayina Ayissi F. & Zanga M.J. « La procédure d’examen des communications devant la
Commission de Banjul ». in Olinga A.D. (dir.), La protection internationale des droits de l’homme en
Afrique. Dynamique, enjeux et perspectives trente ans après l’adoption de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples. Yaoundé, 2012, pp. 151-189.
14. Voir Ouguergouz F . « Article 56 », in Kamto M. (Dir.), La Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples et le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples. Commentaire article par article », Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de l’Université de
Bruxelles, 2011.
15. Rejet d’une requête manifestement mal fondée.
16. Examen préliminaire de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête.
17. Conditions de recevabilité des requêtes.
18. Il faut relever pourtant, pour le déplorer, que la Cour persiste dans son approche, avec une
situation particulièrement chaotique dans l’arrêt de la Cour en l’affaire Urban Mkandawire c.
Malawi en date du 21 juin 2013. Ici, la Cour examine d’abord une exception d’incompétence
ratione temporis (paragraphe 32), puis évacue l’exception d’irrecevabilité liée à la saisine par le
requérant d’un autre mécanisme international de règlement (paragraphe 33), puis revient aux
aspects de la compétence, à savoir les compétences ratione materiea, ratione personae et encore
ratione temporis (paragraphes 34, 35 et 36), et conclue par l’examen particulier de la condition
relative à l’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 38 à 40.2). Comme l’ont à juste
titre relevé les juges Guissé et Niyungeko dans leur opinion dissidente commune, cette démarche
est confuse et manque de cohérence.
19. Voir sur cette question Olinga A.D. « Remarques introductives sur l’interprétation de la
Charte africaine des droits de l’home par la Commission de Banjul », in Olinga A.D. (Dir.) La
protection internationale des droits de l’homme en Afrique. Dynamique, enjeux et perspectives trente ans
après l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Yaoundé, Editions Clé, 2012,
pp. 219-248.
20. Malheureusement, il faut se rendre à l’évidence que la Cour ne s’en est pas tenue à cette
approche pertinente bien longtemps, puisque au cours du même mois de juin 2013, dans l’affaire
Urban Mkandawire c. Malawi, la Cour va précisément aboutir à ce résultat invraisemblable que l’on
redoutait, à savoir prononcer l’irrecevabilité d’une requête sur la base du non respect par le
requérant d’une condition de recevabilité dont le non respect n’a pas été soulevé par l’Etat
défendeur, en l’occurrence la condition d’épuisement des voies de recours internes. Dès le
paragraphe 33, la Cour estime que l’exception de litispendance est non fondée, mais ajoute tout
de suite que « ce constat ne signifie pas nécessairement que la requête est recevable, car elle doit
encore remplir d’autres critères de recevabilité en particulier le Requérant doit satisfaire aux
dispositions de l’article 6(2) du Protocole, lu conjointement avec l’article 56(5) de la Charte et
démontrer qu’il a épuisé les voies de recours internes ». C’est au paragraphe 38 de l’arrêt que la
Cour se livre à cet examen : « le Défendeur n’a pas soulevé d’exception de non –épuisement des
recours internes. La Cour a cependant le devoir de faire respecter les dispositions du Protocole et
de la Charte. Elle est tenue de s’assurer que la requête est conforme, entre autres, aux conditions
de recevabilité énoncées dans le Protocole et dans la Charte. La loi ne doit pas faire débat. Le fait
pour le Défendeur de ne pas soulever la question de la non-conformité avec les exigences
inscrites dans le Protocole et la Charte ne peut pas rendre recevable une requête qui est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
292
autrement irrecevable. L’épuisement des recours internes est une règle fondamentale dans la
relation entre les Etats Parties avec le Protocole et la Charte et avec les juridictions nationales
d’une part, et avec la Cour, d’autre part. Les Etats Parties ratifient le Protocole en tenant pour
acquis que les recours internes doivent d’abord être épuisés avant que la Cour ne soit saisie ; la
déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole est également faite sur cette base ». Ce propos
est d’une portée procédurale considérable. Il signifie tout d’abord que la Cour s’aligne finalement
sur la doctrine de la Commission d’examen des conditions de recevabilité au-delà des exceptions
soulevées explicitement par le défendeur. Pour autant, cet examen ne semble pas nécessairement
systématique, puisque la Cour, en ne traitant que de la condition de l’épuisement des voies de
recours internes, et non des autres conditions, semble considérer cette dernière comme celle
dont l’examen s’impose en tout état de cause à l’organe de contrôle, parce qu’elle participerait de
l’esprit même de subsidiarité dans lequel a été conçue la mécanique internationale de garantie,
esprit qui serait le fondement même de l’adhésion des Etats à cette mécanique. Finalement, au-
delà de la perspective de l’examen systématique des conditions de recevabilité, la Cour vient de
consacrer pour la condition d’épuisement de voies de recours internes, le statut d’une condition
impérative, dont la Cour doit « s’assurer du respect », que l’Etat défendeur soulève ou non
d’exception à cet égard. Avec cette évolution, le système africain se signale comme le seul où un
organe international de contrôle peut prendre sur lui de déclarer irrecevable une requête, sur la
base du non respect, découvert par ledit organe, d’une condition de recevabilité dont le respect
n’a pas été contesté par le défendeur, une condition qui devient dès lors une condition d’ordre
public. Une telle évolution des choses est inattendue et déconcertante.
21. Pour une étude riche et particulièrement bien menée, voir Nsogurua J. Udombana, «”So far,
so fair: the local remedies in the jurisprudence of the African Commission on Human and
Peoples’ Rights”, in The American Journal of International Law, vol. 7, 1, 2003, pp. 1-37.
22. Nos italiques.
23. Il est vrai qu’en l’absence de révision formelle de la Charte de 1981, pour la délester de toutes
les références à la Charte de l’OUA, on peut se montrer dubitatif, au plan purement technique,
sur la substitution automatique de l’Acte constitutif de l’UA à la Charte de l’OUA. Certes, l’un et
l’autre instrument sont à la base de la mise en place de l’organisation continentale au sein de
laquelle est créée la Cour ; toutefois, le contenu substantiel de ces deux instruments n’est pas
identique. L’Acte Constitutif de l’UA est incontestablement plus fourni en matière de principes et
de règles relatives aux droits de l’homme que la Charte de l’OUA.
24. Voir Sudre F., Droit international et européen des droits de l’homme, Paris, PUF, 5è édition, 2001, p.
420.
25. On peut se demander, à cet égard, quelle portée devrait être accordée, sur le terrain de la
détermination de la compétence matérielle de la Cour, au renvoi à la Constitution de la
République de Tanzanie opéré dans la déclaration de ce pays en vertu de l’article 34(6), de
manière générale et, spécifiquement, dans le contexte de l’affaire sous examen. Si ce renvoi
signifie que les plaignants en vertu des articles 5(3) et 34(6) du Protocole ne peuvent introduire
contre la Tanzanie que des requêtes compatibles, non seulement avec l’Acte constitutif de
l’Union africaine et la Charte de 1981, mais aussi avec la Constitution de la Tanzanie, alors il
faudrait simplement dire que les requêtes ayant conduit à l’arrêt, mettant directement en cause
une clause de la Constitution tanzanienne, ne pouvait être « in adherence to the Constitution of the
United Republic of Tanzania » selon les termes de la déclaration du 29 mars 2010.
26. Voir Djoumessi Kenfack S. B., « L’application de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples par les juridictions des Communautés économiques régionales », in Olinga A.D. (dir.),
La protection internationale des droits de l’homme en Afrique. Dynamique, enjeux et perspectives trente
ans après l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Yaoundé, Editions Clé,
2012, pp. 251-279.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
293
27. Voir Adjolohoun Horace S. « The ECOWAS Court as human rights promoter? Assessing five
years’ impact of the Koraou Slavery judgment ». in Netherlands Quarterly of Human Rights, vol.
31/3, 2013, pp. 342-371; voir aussi Karen J. Alter, Laurence R. Helfer & Jacqueline R. Mc Allister, “
A new international human rights court for West Africa: the ECOWAS Community Court of
Justice”. The American Journal of International Law, 2013, vol.107, pp. 737 et s.
28. Ost F., « Originalité des méthodes d’interprétation de la Cour européenne des droits de
l’homme », in Delmas-Marty M. Raisonner la raison d’Etat. Paris, PUF, 1989, pp. 405-463.
29. Burgorgue-Larsen Laurence, « Les méthodes d’interprétation de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme. Justice in context », RTDH, n° 97/2014, pp. 23-71.
30. Voir Olinga A.D., “Les emprunts normatifs de la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples aux systèmes européen et interaméricain de garantie des droits de l’homme »,
RTDH, n° 62/2005, pp. 501-537.
31. Weckel Ph. « Présentation ». in Adjovi R. (Dir.) Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
L’affaire Rev. Mtikila c. Tanzanie. Dossier du Pôle Afrique de Sentinelle. http://www.sentinelle-droit-
international.fr., 02 mars 2013, p. 3.
32. Voir, notamment, les affaires suivantes : Legal Resource Foundation c. Zambie, 2001 ; Lawyers
for Human Rights c. Swaziland, 2005 ; Mouvement Ivoirien des droits humains c. Côte d’Ivoire ;
John K. Modise c. Botswana, 6 novembre 2000 ; Zimbabwe Lawyers for Human rights and
Associated Newspapers of Zimbabwe c. Zimbabwe; Kevin Mgwanga Gumne et al. C. Cameroun,
2009. Les juridictions sous régionales ne sont pas en reste, comme le montre l’arrêt de la Cour de
justice de la CEDEAO en l’affaire Aneganvi Manavi Isabelle et autres c. Togo du 7 octobre 2011,
arrêt qui met sur la sellette un problème de mandat impératif, question constitutionnelle s’il en
est. La Cour de la CEDEAO a condamné l’Etat du Togo dans la cause.
33. Voir Ondoua Alain, « L’internationalisation des Constitutions en Afrique subsaharienne
francophone et la protection des droits fondamentaux », RTDH, n°98, pp.437-457. L’auteur relève,
en page 455, que la condamnation de la Tanzanie par la Cour « est prononcée alors même que la
Cour d’appel de Tanzanie n’y avait décelé aucune inconventionnalité ». Sauf erreur de notre part,
il ne semble pas que le moyen tiré de la violation de dispositions conventionnelles ait été jamais
soulevé devant les juridictions tanzaniennes par M. Mtikila, le débat ayant été mené par rapport
aux principes gouvernant l’Etat de droit, dans le cadre de l’ordre juridique et politique de la
Tanzanie. Par deux fois devant la Haute Cour, en 1993 puis en 2005, M. Mtikila a toujours fait
valoir des arguments relatifs à la non-conformité de l’interdiction des candidatures
indépendantes à la Constitution tanzanienne. Du reste, dans sa décision du 5 mai 2006, près de
douze ans après la première rendue sur la même question le 24 octobre 1994, la Haute Cour
estime que « les modifications contestées violaient les principes démocratiques et la doctrine des
structures fondamentales inscrites dans la Constitution » (paragraphe 72 de l’arrêt).
34. Parce que ces obligations ne sont pas déclinées dans la Charte, la référence à l’article 27 de la
Convention de Vienne de 1969 (paragraphe 108) ou à l’article 32 du Projet d’articles de la
Commission du Droit International sur la responsabilité internationale des Etats n’est pas
pertinente. Lorsque l’étendue de l’obligation est liée à la marge nationale d’appréciation, lorsque
le droit interne est invité à participer à la circonscription du champ de l’obligation elle-même, les
notions de « non exécution du traité » et de « manquement aux obligations », sans disparaître,
sont à relativiser.
35. Voir Kovler Anatoly, « La Cour européenne des droits de l’homme face à la souveraineté
d’Etat », in L’Europe en formation, 2013/2, n° 368, pp. 209-222.
36. La qualification attribuée à l’observation générale peut étonner. De toute évidence, il ne s’agit
pas à notre avis d’un « instrument adopté par les Nations Unies relatif aux droits de l’homme ».
37. Sur le « flottement entre interprétation et application » lié au terme « inspiration », voir
Decaux E., « Article 60 ». in Kamto M. (dir.), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
294
Commentaire article par article ». Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de l’Université de Bruxelles,
2011, notamment p. 1112.
38. L’on se demande s’il appartient à un mécanisme international de garantie de se prononcer
sur l’utilité des mesures nationales. L’intrusion dans ce domaine peut confiner à un contrôle
d’opportunité, lequel en principe ne relève pas de la compétence des instances internationales.
39. Voir Tajadura Tejada Javier, « La doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme sur
l’interdiction des partis politiques », RFDC, 2012, 2, n° 90, pp. 339-371.
40. Voir Levinet Michel, « Droit constitutionnel et Convention européenne des droits de
l’homme. La confirmation de l’autonomie des Etats en matière de choix des systèmes électoraux.
Brèves réflexions sur l’arrêt rendu par le Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Yumak et Sadak c. Turquie (Gr. Ch., 8 juillet 2008) », RDFC, n° 78, 2009, pp. 423-430.
41. Olinga A.D. « L’impératif démocratique dans l’ordre régional africain », Revue de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, vol. 6, n° 2, 1998, pp. 57-80.
42. Djpoumessi Kenfack S. B., La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à
l’épreuve des changements anticonstitutionnels de gouvernement, Mémoire, Master II en Contentieux
International, IRIC, Yaoundé, 2012, 187 p.
43. Lire à cet égard Adjovi R. « Historique de l’affaire Rév. Mtikila c. Tanzanie ». in Adjovi, R.
(dir.), Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. L’affaire Ré. Mtikila c. Tanzanie, op. cit., pp.
5-7.
ABSTRACTS
With the Reverend Mtikila vs Tanzania case, the African Court on Human and People’s Rights
isued it first decision on merits. Apart from issues related to procedure, about which the
members of the Court did not agree, the decision is an instructive one, as it deals with the
conformity to the African Charter of the obligation to be affiliated to a political party for taking
part to elections. In the view of the Court, such an obligation violates the right to participate in
the government of his country, the right to assemble with others, the right to be protected from
discrimination. The Court finds that the principle of the rule of law is not relevant. Although the
reasoning of the court can be difficult to follow, the decision is an important step for its mission
in favour of human rights in Africa.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu, en l’affaire Révérend Mtikila c/
Tanzanie, son premier arrêt au fond. Au-delà de certains aspects de procédure sur lesquels les
juges ont eu quelque difficulté à s’accorder, la décision est instructive, car elle traite de la
conformité de l’obligation d’affiliation partisane pour tout candidat aux élections avec la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples. Pour la Cour, une telle obligation viole le droit de
participer à la direction des affaires publiques de son pays, la liberté d’association et le droit à la
non-discrimination. En revanche, l’atteinte au principe de l’Etat de droit n’est pas retenue. Si l’on
peut avoir du mal à suivre la logique argumentative de la Cour, il reste que cet arrêt constitue
une contribution importante à l’œuvre inaugurale de cette juridiction en faveur des droits de
l’homme en Afrique.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
295
INDEX
Mots-clés: Compétence – Recevabilité - Locus standi – Restrictions - Droit de participer à la
gestion des affaires publiques - Liberté d’association - Non-discrimination - Partis politiques -
Etat de droit
Keywords: Competence – Recevability - Locus standi – Restrictions - Right of participation to the
public policies - Freedom of association - Non-discrimination - Political parties - Rule of law
AUTHOR
ALAIN DIDIER OLINGA
Alain Didier Olinga, Docteur/HDR en Droit Public de l’Université de Montpellier I, est
Maître de Conférences à l’Université de Yaoundé II (Cameroun). Il est chef du
Département de Droit International à l’Institut des Relations Internationales du
Cameroun (IRIC), au sein de cette Université.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
296
Contribution à la clarification du
régime juridique de la
responsabilité de l’Etat résultant
d’un placement en cellule de
dégrisement
Thierry Edouard
Le 7 janvier 2011, les gendarmes du village de Camopi (Guyane française) étaient requis
par une jeune femme se plaignant de violences conjugales. Le fauteur, M. A ., était
finalement interpellé dans la soirée et conduit à la brigade territoriale. Son état
d’ébriété manifeste justifiait qu’il soit immédiatement placé en cellule de dégrisement,
dans l’attente de sa garde à vue. Au petit matin, l’époux violent est retrouvé sans vie,
pendu au cordon de son calimbé2.
Indépendamment du caractère dramatique d’un tel événement, se posent pour le
juriste une série de questions éminemment : le placement en cellule de dégrisement
était-il nécessaire3 ? Quels sont les fondements juridiques d'une telle privation de
liberté ? Comment cet homme a-t-il pu mettre fin à ses jours avec un objet qu’il n’était
pas censé posséder ? Pourquoi est-il demeuré aussi longtemps (près de huit heures)
avant que les services de gendarmerie constatent le décès ? , etc…Ceci suppose que l'on
sache clairement de quoi l'on parle lorsqu'on fait référence à la notion de dégrisement ;
la plupart des acteurs pensent que les choses sont effectivement claires et qu'il n'y a
pas à épiloguer la dessus. Pourtant, il n'est pas certain que ce soit toujours le cas.
On rappellera, en premier lieu, que le terme « dégrisement » provient du verbe « dégriser
» qui signifie « faire passer l’ivresse ». Ainsi, lorsqu’une personne est trouvée dans un état
d’ivresse sur la voie publique, elle peut être conduite indistinctement en « cellule de
dégrisement », ou « chambre de sûreté ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme
rappelle que « la détention (…) dans une unité de dégrisement s’analyse en une privation de
liberté, au sens de l’article 5§ 1 de la Convention »4. Pour le Conseil constitutionnel, il s’agit
d’une «mesure privative de liberté, au même titre que l’hospitalisation d’office », qui exige que
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
297
« le juge judiciaire (intervienne) dans le plus court délai possible » 5. Pour sa part, la Cour de
cassation tend à garantir les droits de la défense et ce, à tous les stades de la
procédure6. A ce titre, la Haute juridiction demeure qualifiée pour contrôler, non pas le
placement en cellule de dégrisement lui-même, mais la procédure subséquente à la
commission d'une infraction7. Il s'agit là d'une interprétation extensive des droits de la
défense8, conforme à la jurisprudence européenne qui pose comme garantie du procès
équitable une exigence d'effectivité des droits de la défense 9.
Mais, à dire vrai, ce n’est pas tant le terme de « dégrisement » ou « d’ivresse publique et
manifeste » (IPM) qui fait difficulté. D’abord, parce que, à l’instar de beaucoup d’autres
notions juridiques, elle porte en elle une grande ambiguïté et une profonde polysémie.
Ensuite, la réflexion n’est pas non plus éclairée si l’on utilise une autre terminologie
(rétention, mesure de sûreté, etc…). En réalité, ce qui est en cause, c’est une question de
fond, ce n’est pas une question d’appellation, car quelle que soit l’option retenue par les
forces de l’ordre, le placement en cellule de dégrisement demeure fondamentalement
une atteinte à la liberté individuelle. Cette privation se traduit également par
l'obligation, pour les autorités judiciaires, d'assurer la surveillance effective de celui
qui en est l'objet. C’est pourquoi les forces de l’ordre ont la garde de la personne
qu’elles auront interpellée, au sens où le conçoit le Code civil, ce qui suppose une
surveillance effective et constante de la personne retenue. Or, curieusement, il n’existe
pas de durée préfixe à une telle mesure. Cette lacune avait d’ailleurs été dénoncée par
une mission des quatre inspections (Inspection générale de l’administration, Inspection
générale des affaires sociales, Inspection générale des services judicaires et Inspection
de la gendarmerie nationale)10. Celle-ci proposait de retenir une durée de douze heures,
ce qui aboutirait à sécuriser, mutatis mutandis, l’action des services interpellateurs 11.
Cette forme de « sécurisation » est prévue à l’article 225 du règlement intérieur
d’emploi de la Police nationale, qui prévoit que « le chef de poste effectue des rondes au
moins toutes les quinze minutes ou désigne un fonctionnaire à cet effet. Le commandement
augmente la fréquence des rondes et multiplie les mesures de précaution en fonction du
comportement connu du ou des individus à surveiller ». En revanche, ce texte n’a pas son
équivalent dans la gendarmerie nationale, qui ne dispose, a priori, d’aucune référence
exploitable en la matière12.
On montrera donc qu'à travers "l'affaire de Camopi" se pose le problème des
conséquences d'une privation de liberté et la capacité, pour l'Etat, de répondre à une
dualité conjoncturelle consistant à concilier les exigences du respect des droits de
l'Homme (droits de la défense, droit au procès équitable, notamment), d'une part, avec
le déclenchement programmé des poursuites judiciaires (en l'espèce, il s'agissait de
violences volontaires aggravées), d'autre part. On avancera que c'est bien la question
de la responsabilité de l'Etat (et de ses services) et des conditions d'engagement de
celle-ci à l'égard d'un accident13 survenu durant la phase de dégrisement, malgré
l'obligation de surveillance pesant sur lui. Le postulat de présomption de la
responsabilité conduit, dans un premier temps, à envisager les fondements juridiques
du placement en cellule de dégrisement (I). Par suite, il conviendra d'examiner la
conciliation de la responsabilité de l'Etat face aux droits de la défense (II).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
298
I. Les fondements juridiques du placement en cellule
de dégrisement
A. Les critères de décision du placement en cellule de dégrisement14
1) la finalité du placement en cellule de dégrisement
Fondamentalement, le placement en cellule de dégrisement présente une dualité
caractéristique. Il s’agit de maintenir l’ordre public, d’une part, et de protéger la
personne retenue, d’autre part. Naturellement, elle ne se solde pas systémiquement par
un placement en garde à vue15, car l’objectif consiste à dissiper les effets générés par
l’état d’ivresse. De même, une telle décision ne peut être décidée que par les agents
relevant de la police ou de la gendarmerie nationales. C’est la loi du 23 janvier 1873
tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme, dite «
loi Roussel », qui fut le premier texte à prévoir un régime juridique approprié. Par la
suite, ce dispositif a été intégré dans le code des débits de boissons et des mesures
contre l’alcoolisme par le décret n° 55-222 du 8 février 1955 (article L. 76 du code des
débits de boissons), pour être finalement traduit par l’article L. 3341-1 du code de la
santé publique16. Dès l’origine, ce dispositif a présenté une certaine dichotomie, dans la
mesure où sa mise en œuvre relevait à la fois d’une mesure de police administrative,
illustrée par un placement en chambre de sûreté, et d’un dispositif judiciaire réprimant
l’état d’ivresse publique, et dont l’auteur était passible d’une peine
contraventionnelle17.
Le droit positif18 prévoit désormais qu’« une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux
publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le
plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la
raison » (alinéa1). Il en résulte que les agents interpellateurs peuvent, « par mesure de
police », conduire, à ses frais, une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu
public « au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue
jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». Conformément à deux circulaires du
Ministère de la Santé19, la personne doit préalablement être examinée par un médecin.
Seule la délivrance d’un certificat de non-hospitalisation permet d’établir la
compatibilité de l’état de la personne avec la mesure envisagée. Autrement dit, le fait
générateur est le constat d’ébriété résultant non seulement de faits matériels vérifiés
mais également du comportement de l’individu20.
La nécessité de sortir du flou juridique est d’autant plus impérieuse qu’elle est favorisée
par la Cour européenne des droits de l'homme, au regard des principes de
proportionnalité et de prévisibilité, inspirés par le régime de la garde à vue 21. Cet aspect
a de quoi interpeller, d’autant que les services de gendarmerie interviennent
traditionnellement en milieu rural ou dans des zones suffisamment éloignées, dans un
contexte justifiant une vigilance accrue à l’égard d’un retenu. A dire vrai, l’absence de
fixation d’une durée précise semble d’abord répondre à la variété des situations
possibles. C’est pourquoi le Conseil a estimé qu’une telle absence ne constituait pas une
cause d’inconstitutionnalité dès lors que la disposition ne prévoit pas une privation de
liberté à durée indéterminée : en clair, le placement en chambre de sûreté n’est permis
que le temps nécessaire pour que la personne recouvre la raison, c'est-à-dire quelques
heures au maximum.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
299
Autrement dit, il est possible d’affirmer qu’il n’existe pas de définition légale de
l’ivresse et des conditions de sa constatation, pas plus qu’une durée préfixe à l'égard
d'une telle mesure: en réalité, l’interpellation d’un individu présumé en état d’ivresse
repose principalement sur une appréciation subjective et pragmatique de la part des
services interpellateurs. L’état d’ébriété résultera de signes extérieurs (haleine sentant
fortement l’alcool, logorrhée, troubles de l’humeur et de la parole, injection
conjonctivale, perte d’équilibre…). Cette pratique sera complétée par deux circulaires
du ministère de la santé, l’une du 16 juillet 1973, l’autre du 9 octobre 1975, qui
prévoient, notamment, que la personne trouvée en état d’ivresse, avant d’être placée
en chambre de dégrisement, est présentée à l’hôpital pour qu’il soit délivré un «
certificat de non admission à l’hôpital»22.
Un tel héritage normatif et technique, qui peut être analysé comme un atout, s’avère
particulièrement difficile lorsqu’il s’agit, in concreto, de mettre en œuvre le dispositif.
En effet, la nature et la portée d’une telle décision présente un caractère alternatif, qui
peut être administratif ou judiciaire, en fonction des éléments recueillis par les services
interpellateurs.
2) L'ambivalence dans la privation de liberté23
A supposer que la personne soit finalement appréhendée, on conçoit aisément les
difficultés auxquelles sont confrontés les services interpellateurs. On relèvera que
lorsqu’il s’agit de constater ou de réprimer une infraction, la privation de liberté
relèvera de la compétence judiciaire24. La mesure sera de nature judiciaire si elle a pour
objet de diligenter une enquête pénale. Tel est le cas, par exemple, d’une enquête
menée à la suite d’un contrôle routier d’alcoolémie, préalablement à des poursuites
pour « conduite en état d’ivresse », conformément aux articles L 234-1 et suivants du Code
de la route. Autrement dit, lorsqu’elle est d’ « intention »25 judiciaire, le placement en
cellule de dégrisement relèvera de la compétence de l’autorité judiciaire. Deux raisons
peuvent expliquer une telle hypothèse. D’abord, la durée du placement en chambre de
sûreté doit être nécessairement consignée par les agents interpellateurs. C’est
précisément ce « cahier » de consignation qui est régulièrement visé par le Procureur
de la République. Ensuite, la durée de la privation de liberté est défalquée de la durée
de la garde à vue, au même titre que la retenue douanière (art. 323-9 C. douanes), de la
rétention pour vérification d'identité (art. 78-4 C. pr. pén.) ou de la retenue des
étrangers pour vérification de séjour. De telles précautions ne sont pas anodines, car
elles permettent une mise en conformité de notre droit avec les exigences
conventionnelles aux termes desquelles « il est essentiel, en matière de privation de
liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi
soit prévisible dans son application, en ce sens qu’elle doit être suffisamment précise
pour permettre au citoyen de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de
la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé » 26. Ainsi, la
directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des
procédures pénales, aboutit à impacter considérablement la notion interne du
dégrisement. En effet, son article 7 prévoit que « 1. Lorsqu’une personne est arrêtée et
détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les
documents relatifs à l’affaire en question (...) soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou
de son avocat. (…) ». En vertu de cet article, dès lors qu’une personne est arrêtée (il s’agit
ici de la condition d’ouverture du droit), elle doit pouvoir, avec son avocat, obtenir la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
300
communication de tous les éléments de son dossier nécessaires au contrôle de la
légalité de son arrestation (il s’agit là du contenu du droit). Dans la mesure où la
personne retenue est une personne « arrêtée » au sens de l’article 7 de la directive (la
condition d’ouverture du droit est donc remplie), elle (ou son avocat) 27 doit pouvoir
contrôler la légalité de son arrestation et doit être mise en mesure de consulter tous les
actes de procédure28 ayant conduit à son arrestation.
En revanche, la perspective n’est pas du tout la même lorsqu’il s’agit d’une mesure
administrative, c'est-à-dire lorsque le dégrisement résulte d’une mesure préventive,
destinée à garantir l'ordre public. Pour certains auteurs29, c’est le raisonnement de la
Cour de cassation qui prévaut puisque la personne qui en est l’objet est regardée
comme hors d’état d’être entendue. Dès lors, aucune mesure de garde à vue ne peut
être envisagée, pas plus que la notification des droits qui y sont attachés. 30 C’est ainsi
que, dans sa décision du 8 juin 201231, le Conseil constitutionnel a estimé que le
dégrisement, décidé sur la base de l’article L 3341-1 du code de la santé publique, est
une mesure de « police administrative destinée à prévenir les atteintes à l'ordre public et
protéger la personne »32. Les Sages de la Rue de Montpensier rejoignent ainsi la position
de la Cour de cassation33, de même que celle du Tribunal des conflits du 18 juin 2007 34.
Cette option privative de liberté était déjà prévue à l’article 5 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme. La Cour européenne a, en effet, précisé
l’interprétation à donner au terme « alcoolique » à la lumière de l’objet et du but de
l’article 5 § 1 e) de la Convention. Celui-ci ne doit pas être entendu uniquement dans le
sens restreint d’une personne dans un état clinique d’« alcoolisme » mais également
comme « les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool
constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes » 35. A propos des détenus, la
Cour Européenne des Droits de l’Homme a été amenée à savoir si les autorités avaient
connaissance d’un risque certain et immédiat pour la vie de l’intéressé et, dans le cas de
l’affirmative, si elles ont bien pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement
attendre d’elles36. Dans tous les cas, la Cour de Strasbourg s’assure de l’existence de
précautions usuelles (retrait de ceinture et lacets, rondes régulières), comme de
l’attention à des indices devant conduire à adopter des mesures particulières de
surveillances37. On ajoutera que l’infraction commise au cours d’une opération de police
administrative n’entraîne pas, mutatis mutandis, un changement de nature de
l’opération. Il en résulte que cette phase, dénommée « parenthèse administrative » 38,
laquelle survient après le constat d’état d’ivresse (simple ou manifeste) mais avant le
placement en garde à vue (ou toute autre opération de police judiciaire), constitue une
opération de nature fondamentalement administrative.
Par conséquent, ce qui apparaît à travers ces observations, c’est que, quelle que soit
l’option choisie, le placement en cellule de dégrisement est toujours un moyen et non
une fin. Il prélude à d’autres mesures, qui se révèlent mieux encadrées sur le plan de la
pratique et du droit. Il reste que le placement en cellule de dégrisement présente un
caractère bref 39 et alternatif. Dans la mesure où il s'agit d'une mesure privative de
liberté, il convient d'examiner la répartition des compétences juridictionnelles
amenées à en connaître.
B. La difficile répartition des compétences juridictionnelles
Dans ses observations relatives à l’affaire « R. », le Commissaire du gouvernement
Philippe Dondoux a rappelé un principe désormais bien fixé : « si l’acte incriminé est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
301
relatif à l’organisation même du service public judiciaire, la juridiction administrative est
compétente. Au contraire, le juge judiciaire est seul compétent si l’acte est relatif à l’exercice de
la fonction juridictionnelle ou implique une appréciation à porter sur la marche même des
services judiciaires »40. Ce raisonnement est confirmé par la jurisprudence du Tribunal
des conflits41, qui a toujours distingué l’exercice des fonctions juridictionnelles (juge
judiciaire) de l’organisation du service judiciaire (juge administratif). La résultante de
l'événement survenu à Camopi permet d'envisager la problématique de la compétence
juridictionnelle.
1) La dualité dans la répartition juridictionnelle
En France, la coexistence des deux ordres juridictionnels apparaît essentiellement en
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique42, d'hospitalisation d'office et,
plus récemment, dans le cadre des missions du Groupes d’Intervention Régionaux
(GIR)43. S’agissant du placement en cellule de dégrisement, cette dichotomie résulte
essentiellement de l’objet de la mesure envisagée : s’agit-il d’une opération de nature
strictement administrative ou revêt-elle un caractère strictement judiciaire ? A dire
vrai, cette opération de nature double, entraîne des difficultés que le juge doit
nécessairement trancher. Dans l’arrêt Robineau c/ France" du 26 septembre 2013 44, la
Cour Européenne des Droits de l’Homme avait jugé que cette « séquence procédurale» 45
pouvait justifier « la mise en place d’un cadre juridique plus précis, afin de ne pas faire peser
sur les seuls policiers l’appréciation de la situation psychologique et du risque suicidaire de la
personne escortée ». Elle estime que « dès lors qu’aucun risque particulier n’a été identifié ou
aurait dû l’être, les mesures de précaution prises en l’espèce étaient suffisantes et rien ne laisse
apparaître un manquement de l’Etat à ses obligations découlant de l’article 2 (droit à la vie) de la
Convention européenne des droits de l’homme ».
On objectera qu’il ne s’agit pas d’une jurisprudence topique, puisque, dans notre
analyse, l’événement est intervenu durant la phase de dégrisement (décision
administrative), mais antérieurement au placement en garde à vue (mesure
judiciaire)46. Néanmoins, les dispositions de l’article 2 de la CEDH peuvent trouver
application dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’obligation positive de protection à
la vie a été manifestement méconnue par les gendarmes, d’une part 47, et que l’enquête
sur les circonstances et les causes du décès n’a pas été diligentée, d’autre part. On
pourrait penser que, dans ces conditions, le dommage qui en résulte relèverait, du
moins en principe, de la compétence administrative. En effet, l’approche téléologique 48
montre qu’en examinant l’objet de l’opération, c'est-à-dire le but en vue duquel
l’autorité (de police ou de gendarmerie) est intervenue49, la solution juridique peut être
trouvée. Pour le juge, le primat doit être accordé au critère finaliste dans la mesure où
il recherchera si l’intention des services interpellateurs était conforme à la mesure
envisagée 50. C’est précisément ce raisonnement qui a été retenu par la Cour
administrative d’appel de Lyon à propos du suicide survenu le 23 novembre 2003 au
commissariat de police de Dijon. En l’espèce, il s’agissait de rechercher un « individu
décrit comme armé » et ayant tiré des coups de feu. M. S. a donc été interpellé par les
policiers, sur les fondements de l’article 62-2 du CPP (ancienne version) puisqu’il était
soupçonné d’avoir commis une infraction et d’être sur le point d’en commettre une
nouvelle. Même si son état d’ébriété justifiait, du moins dans un premier temps, son
placement en cellule de dégrisement, l’action engagée par les policiers avait d’ores et
déjà le caractère d’une opération judiciaire.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
302
A priori, c'est d'abord le critère finaliste qui est l'élément essentiel, voire décisif 51,
notamment dans la détermination du régime de la responsabilité résultant d'un suicide
survenu lors d'un dégrisement. Dans ce contexte, il serait parfaitement envisageable
que le respect de la « garantie judiciaire » soit exigé pour des mesures de rétention
ressortissant de la police judiciaire. Ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 13 mars 200352, « l’article 66 de la Constitution exige que toute privation
de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire ». De même, les exigences
conventionnelles, en particulier l’article 5 de la Convention européenne seraient
préservées53. Autrement dit, même si « le caractère inopiné du placement en chambre de
sûreté justifie qu’une autorisation préalable ne soit pas exigée de la part de l’autorité judiciaire »
54, le contrôle judiciaire a posteriori demeure indispensable pour éviter toute mesure
injustifiée ou disproportionnée au regard de la mesure envisagée. C’est dire comment
l’encadrement juridique du placement en cellule de dégrisement appelle à une véritable
clarification.
2) Le cadre juridique à fin de clarification
Il existe une abondante littérature relative à l’encadrement des mesures privatives de
liberté. A ce sujet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme estime que « la privation
de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins
sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public
exigeant la détention »55. Dans l’arrêt TAIS c/ France du 1er juin 200656, la Cour européenne
des droits de l'homme a d’abord rappelé la nécessité d’optimiser l’encadrement
juridique de telles mesures privatives de liberté. C’est ainsi que la France a été
condamnée57 pour violation de l’article 2 (droit à la vie) dans une procédure ayant pour
origine le décès d’une personne au cours de son placement en chambre de dégrisement.
La motivation est toutefois fondée sur les négligences des services de police au regard
de l’état de la personne placée en cellule. Cette préconisation sera confirmée dans la
décision du 21 juin 200758, dans laquelle la Cour avait déclaré recevable la requête
contre la France de M. Castelot qui critiquait l’absence d’encadrement légal de la
privation de liberté59. Le Conseil constitutionnel60 estime que la jurisprudence relative
aux personnes atteintes de troubles mentaux était transposable au régime du
dégrisement en ce qu’elle met en jeu la conciliation entre, d’une part, la protection de
la santé et de l’ordre public et, d’autre part, les libertés constitutionnellement garanties
en cause (liberté d’aller et de venir et liberté individuelle) 61.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de répondre au postulat initial, dans la
mesure où, comme il a été observé, la notion d’état d’ivresse, envisagée dans sa double
acception, demeure juridiquement floue et lacunaire. Or, précisément, ce relatif vide
juridique semble contredire le principe de légalité des peines qui impose, pour chaque
infraction, une définition claire et précise. Dans cette perspective, et s’inspirant des
préconisations issues d’un rapport 2008, le Conseil constitutionnel avait été amené à
préciser la notion d’« état d’ivresse »62, en soulignant le caractère obsolète et lacunaire
de l’encadrement juridique de l’ivresse publique et manifeste 63. Cet édifice juridique
« en pointillé » semble amplifier la problématique initiale, qui est celle de savoir s’il y a
eu une véritable enquête postérieurement au suicide du dégrisé, d’une part, et si des
investigations internes ont été menées, d’autre part.
Rappelons qu’aux termes de l’article 74 CPP64, c’est d’abord à l’Officier de police
judiciaire (OPJ) qu’il revient de mettre en musique ces opérations de nature
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
303
fondamentalement judiciaire. Dès lors que les causes de la mort lui sont inconnues ou
paraissent suspectes, il est tenu d’informer « immédiatement » le Parquet après s’être
rendu sur les lieux aux fins de constatations. Si cet élément n’appelle aucune objection
particulière quant à l'application « normale » de cet article, il en est tout autrement
lorsque l’officier de police judiciaire initialement saisi s’abstient volontairement de
mener une enquête postérieurement aux faits qu'il constate. Dans ces conditions,
quelles peuvent être les conséquences (judiciaires et administratives) face à une telle
carence, en particulier lorsqu’il s’agit d’un décès en cellule de dégrisement ? Répondre
à la question revient à se tourner une nouvelle fois vers l’élément intentionnel, qui
semble réapparaître après une incursion au début de la mesure de dégrisement.
C'est d'abord l’explication plausible sur l’origine des blessures (ou traces) observées sur
le corps de la victime qu’il convient d’établir en premier lieu 65, pour obvier l’absence de
toute preuve exploitable66. Or, curieusement, le suicide de Camopi n’a pas donné lieu à
une enquête permettant de déterminer avec précision les causes et les circonstances du
décès. Un tel événement, survenu dans le cadre d’une mission de service public
judiciaire, suppose que soit envisagée la conciliation de la responsabilité de l'Etat et les
droits de la défense.
II. La conciliation de la responsabilité de l'Etat et des
droits de la défense
Dans la mesure où M. A. a fait l'objet d'une privation de liberté résultant de son
placement en cellule de dégrisement, les droits de la défense devaient nécessairement
être préservés à son égard. Or, plusieurs éléments permettent d'établir que ces droits
ont été méconnus par les gendarmes interpellateurs. Les critères de la responsabilité de
l'Etat (A) témoignent de l'insolubilité des droits de la défense dans la mise en oeuvre du
placement en cellule de dégrisement (B).
A. Les critères de la responsabilité de l’Etat67
Il existe peu de commentaires consacrés à la responsabilité de l'Etat résultant d’un
décès survenu en cellule de dégrisement68. L'imputabilité administrative dont il s'agit
résulte d'une responsabilité extracontractuelle caractérisée par la négligence des
services de l’Etat. De même, ce critère de responsabilité est matériel et non organique,
car il repose sur le contenu et l’objet des actions (ou inactions) et non sur la qualité des
auteurs. C'est en cela que subsiste, s'agissant de M. A., la notion de cas fortuit. Enfin, et
surtout, la privation de liberté dont il a été l'objet était un acte préparatoire à une
décision juridictionnelle (condamnation ou classement sans suite), qui échappe
nécessairement à la compétence du juge administratif69.
1) la persistance du cas fortuit
Au même titre que la force majeure, la notion de cas fortuit constitue une cause
d’exonération de la responsabilité de l’Etat. C’est pourquoi ces deux notions sont
parfois confondues70. La force majeure est généralement assimilée à un fait juridique
exceptionnel, difficilement prévisible, extérieur et irrésistible 71. L’addition des trois
éléments - extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité - qui, dans leur acception
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
304
cumulative (et non alternative) permet de caractériser le cas de force majeure. Ces
éléments répondent à des facteurs exogènes qui sont, par nature, difficilement
contrôlables. En revanche, s’agissant du cas fortuit, le doyen Hauriou observe qu’ « il
s’agit d’événements qui ne sont que provisoirement au-dessus des forces humaines, et qui, plus
tard, avec des progrès de la prévision de la technique, pourront être conjurés » 72. En clair, cette
notion exprime la faculté, pour les services saisis, de prévenir la gravité d’un
événement, qui peut être potentiellement mortel, à l’instar d’une autolyse en cellule de
dégrisement. C’est un élément endogène, c'est-à-dire résultant d’une défaillance
humaine, qui sera la cause déterminante du dommage, même s’il demeure indirect.
Bien que la frontière entre les deux notions soit aujourd’hui relativement ténue 73, le
critère de l’extériorité parait étiolé dans le cas fortuit, puisque l’imprévisibilité s’avère
aléatoire. De même, l’irrésistibilité de l’événement, c’est-à-dire celui qui est lié au
comportement de (ou des) individu(s) pendant la réalisation, son caractère
insurmontable, etc…, sera facilement écarté par les mesures destinées à prévenir tout
incident74. Dans le cas fortuit, la possibilité d’empêcher l’accident a donc existé, du
moins à un moment donné, et seule la négligence des services de l’Etat fait disparaître
l’insurmontabilité.
On objectera que la distinction traditionnelle entre la « force majeure » et le « cas fortuit
» est aujourd’hui écartée, tant par la jurisprudence que par une partie de la doctrine 75,
cette dernière ne se référant plus qu’à la première acception. Toutefois, dans l'affaire
de Camopi, c'est l'interpellation et le placement subséquent en cellule de dégrisement
qui caractérise l'atteinte à la liberté individuelle, ce qui suppose l'obligation, pour
l'Etat, de protéger celui qui en est l'objet. Le fait causal est endogène, assurément
humain. Il n’y a jamais eu d’événement climatique ou sismique susceptible de
caractériser le cas de force majeure. Autrement dit, il semble que ce soit plutôt
l’élément endogène qui soit à l’origine du suicide de camopi, car le facteur mortifère est
résulté d’un élément interne, de la défectuosité du système de surveillance qui a facilité
le passage à l’acte. Il faut rappeler qu’avant son suicide, l’individu est demeuré plus de
huit heures sans surveillance, alors que les gendarmes étaient informés de sa
dangerosité potentielle. Par conséquent, il était techniquement possible d’éviter
l'autolyse, en tenant compte non seulement des facteurs humains exogènes (la
vulnérabilité psychique et physique de l'individu) mais également des éléments
endogènes des circonstances de l’espèce (les moyens de mise en œuvre du placement en
dégrisement).
Il en résulte une carence fautive de l'Etat, caractérisée, notamment, par l'absence de
surveillance effective et l’absence d’enquête judiciaire post mortem. Dans ces conditions,
la responsabilité judiciaire individuelle du prescripteur entraînera subséquemment une
imputabilité partagée avec l'autorité judiciaire.
2) la responsabilité judiciaire individuelle
Ce qui apparaît, à travers ces observations, c’est que la décision de placer M. .A. en
cellule de dégrisement revêtait, dès son amorce, le caractère d’un acte préparatoire à la
mise en mouvement de l’action publique76. Cela signifie que les services interpellateurs
avaient bien l’intention de le placer en garde à vue, 77 mais que les conditions légales
pour y parvenir n'étaient pas réunies.
Durant cette phase, il faut s'interroger sur l'hypothèse où l'officier de police judiciaire
s'abstiendrait, sciemment, d'informer le Procureur de la République postérieurement à
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
305
ce décès. Peut-on raisonnablement concevoir que cet agent, directement assimilé à un
magistrat78, soit animé de l’« intention » de se soustraire à des dispositions légales,
notamment celles relevant de l’article 74 du Code de Procédure Pénale ? Or, il faut bien
rappeler qu'il s'agissait d'une "mort suspecte", terme qui ne désigne pas la mort elle-
même, mais précisément les conditions dans lesquelles un décès est survenu, y compris
en cellule de dégrisement. Dans ces conditions, la mise en perspective de l'article 74 du
Code de procédure pénale s'imposait, afin de déterminer la cause du décès, qu'elle soit
violente ou non, soit inconnue ou suspecte79. Ensuite, il revenait à l'officier de police
judiciaire de distinguer selon qu’il s’agit d’une mort d'origine naturelle, accidentelle ou
volontaire80. On observera, à cet égard, que c’est l’impératif qui figure dans le texte de
l'article 74 CPP (« l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le
procureur de la République » (…) », ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté
laissée à l’appréciation du préposé judiciaire, mais bien d’une obligation de faire. La
Cour de cassation estime qu’une telle hypothèse « réclame des investigations
complémentaires, au besoin coercitives, afin d’éclaircir le mystère et, plus précisément, de
s’assurer qu’elle ne dissimule pas une atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité physique
(…). C’est la raison d’être (de) l’article 74 du Code de procédure pénale » 81. Autrement dit,
seules les premières constatations permettaient de déterminer le cadre juridique
topique résultant du décès de M...A. (suicide, accident domestique, mort naturelle,
etc…).
Telle est précisément la finalité de l'article 126, alinéa 6 du décret du 20 mai 1903 82,
portant règlement sur le service de la gendarmerie, qui fut longtemps présenté comme
la référence pour les gendarmes. Cette « charte » de l’Arme » 83 rappelait que « les
prescriptions de l'enquête de mort suspecte s'appliquent aux “découvertes de cadavre laissant,
au départ de l'enquête, l'officier de police judiciaire dans l'ignorance ou le doute quant à la cause
réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire ou crime”. Ce texte visait « le
doute », et même « l'ignorance » de la cause du décès. En dépit de son abrogation totale 84,
le décret de 1903 a le mérite d’avoir institué une véritable déontologie professionnelle
pour l’Officier de Police Judiciaire de la gendarmerie. Il a surtout permis d’asseoir la
distinction traditionnelle entre la faute de service et la faute personnelle, la seconde
pouvant apparaître « dans l’exercice des fonctions de l’agent », qui s’abstiendrait
d’intervenir postérieurement à la survenance d’un décès en cellule de dégrisement. Dès
lors, cette carence serait assimilée à des sévices ou des brutalités, dont les critères de
responsabilité ont été établis par la jurisprudence85. A la vérité, qu’elle soit
intentionnelle ou « suscitée », l’absence d’information du procureur de la survenance
d’un tel décès constitue une faute grave pour l’officier de police judiciaire qui, à l’instar
de tout fonctionnaire, est tenu de dénoncer de tels faits dès lors qu’il en a connaissance,
conformément à l’article 40 du code de procédure pénale86. C’est pourquoi il nous
semble que l’arrêt TAIS peut s’appliquer puisqu’il porte sur les responsabilités pour
faute personnelle résultant de tels manquements87.
Pour autant, l’élément intentionnel suffit-il, à lui seul, à déterminer le régime de la
responsabilité pour faute personnelle « dans l’exercice des fonctions » d’un Officier de
Police Judiciaire ? En clair, peut-on sérieusement imaginer qu’un Gendarme puisse
avoir « l’intention » de ne pas diligenter une enquête conforme à l’article 74 Code de
Procédure Pénale dès lors qu’il est saisi et avisé de la découverte d’un cadavre en cellule
de dégrisement88 ? Rien n’est moins sûr et, à moins qu’il s’agisse d’une soustraction de
preuve89, l’approche téléologique ne suffit pas, à elle seule, d’établir la responsabilité de
cet agent.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
306
La réponse est donc ailleurs : il ne s’agit pas tant de savoir si cet officier de police
judiciaire avait « l’intention » d’enquêter mais d’observer qu’une telle rétiveté ne peut
trouver sa source qu’auprès d’une autorité judiciaire « supérieure », à savoir le Parquet.
On assistera, dès lors, à un véritable dévoiement du système judiciaire, puisque le
mauvais vouloir remplace l'obligation de faire prévue à l’article 74 du code de
procédure pénale. En d'autres termes, la responsabilité personnelle de l’officier de
police judiciaire ne peut, à elle seule, résister au postulat initial. Elle sera
nécessairement partagée avec l’autorité judiciaire « supérieure ».
3) La responsabilité judiciaire partagée
La théorie du partage des responsabilités à propos du fait d’un agent, « en admettant
même que ces agissements aient constitué des fautes personnelles » est relativement
ancienne90. Dès 1911, le Conseil d’Etat avait, en effet, estimé qu’un même préjudice
pouvait être dû à la fois à une faute personnelle et à une faute de service, avec la faculté
pour la victime d’agir pour le tout contre la personne publique 91. Il est également admis
qu’une faute personnelle peut faire présumer une faute d’organisation du service (ou
une faute de surveillance ayant rendu possible la faute personnelle) 92. Ainsi est apparue
la théorie de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, d’abord
consacrée par Léon BLUM93, puis affirmée par deux arrêts de principe du Conseil
d’Etat94. Progressivement, la jurisprudence a distingué selon qu’il s’agit d’une faute
« radicalement » différente de la fonction de l’acte fonctionnel, c'est-à-dire celui
commis par le fonctionnaire à l’occasion de son activité administrative 95. Désormais, le
Conseil d’Etat considère que « toutes sortes d’éléments et d’événements peuvent désormais
faire qu’une faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service » 96. A dire vrai,
l’idée selon laquelle l'officier de police judiciaire, saisi du suicide de camopi, aurait
l’intention d’investiguer mais qu’il en serait empêché, voire dissuadé, par une autorité
judiciaire « supérieure », est donc parfaitement envisageable. Est-ce, pour autant, à dire
que ces autorités auraient donné l’ordre de ne pas diligenter l’enquête, de négliger
certaines pistes, ce qui rend délicate l'imputation aux services initialement saisis d’une
éventuelle responsabilité (administrative et/ou judiciaire) individuelle ? Dans de telles
conditions, la frontière entre « l’organisation » du service et son « fonctionnement »
s’avère particulièrement ténue, surtout lorsque l’on sait que l’organisation d’un service
est toujours la condition de son fonctionnement, y compris judiciaire.
Il faut rappeler qu’il s’agit d’un suicide suspect, c'est-à-dire d’un acte volontaire dont
les causes réelles demeurent inconnues. Les premières constatations devaient inciter
les gendarmes à faire preuve de la plus grande parcimonie, d’autant qu’il pourrait s’agir
d’un acte ante mortem ou post mortem susceptible de dissimuler un homicide. L’attitude
qui prévaut est celle de mettre en œuvre l’article 74 CPP, et d’établir un lien judiciaire
continu, à tous les stades de l’enquête, phase durant laquelle le Procureur de la
République et le Procureur général sont nécessairement informés. Or, tel n’a pas été le
cas. L’attitude passive (intentionnelle puis matérielle) des parquetiers peut, dès lors,
être assimilée à une aide matérielle effective, prévue par le deuxième alinéa de l'article
223-6 du Code pénal97. Au mieux, il s’agira d’une forme de complicité pénale (127-1 CP)
et, au pire, d’une non dénonciation de crime, prévue à l’article 434-1 du code pénal 98.
Un tel tropisme a de quoi surprendre et peut même justifier une étude de science
administrative, au regard de la pusillanimité dont il a été fait preuve. Faut-il rappeler
que le Procureur de la République est « à la fois superviseur des investigations judiciaires,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
307
interlocuteur des acteurs des politiques locales de sécurité et ordonnateur des orientations des
poursuites pénales et de l’accusation ». A l’instar du Procureur général, il est chargé de
veiller à la garantie des libertés individuelles et, à ce titre, il doit avoir la même
diligence, la même écoute, la même vigilance, surtout lorsqu’il s’agit d’une mort
violente, après avoir été suspecte99. Or, ici nous sommes face à une volonté de ne pas
faire toute la lumière sur les causes de la mort, pratique éminemment contraire non
seulement au texte mais aussi à l’esprit de l’article 74 CPP. Une telle défection est fort
regrettable, puisque les objectifs de l’article 74 CPP ne seront finalement jamais
atteints. En effet, il sera impossible de déterminer avec précision les circonstances et
les causes du décès, d’autant que M. A., qui n’a pas été autopsié 100, a été inhumé très peu
de temps après son décès101.
Ces lacunes systémiques ne sont que l'expression de doutes, de légèreté dans le
traitement de judiciaire de "l'affaire de Camopi". Nonobstant, la personne interpellée
était un usager du service public de la justice judiciaire, d'une part, et faisait l'objet
d'une "accusation pénale", d'autre part. A ce titre, elle pouvait exciper des droits de la
défense, lesquels demeurent insolubles en cas de mesure privative de liberté.
B. l'insolubilité des droits de la défense dans le placement en cellule
de dégrisement
1) Un statut juridique embryonnaire
Le droit à la sûreté personnelle, élaboré comme une garantie face aux arrestations et
détentions arbitraires, se situe au cœur de la philosophie de l’organisation politique de
la nation. A ce titre, la Déclaration de 1789 proclame que " le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. ". L’article 7 énonce que " nul ne
peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par loi, et selon les formes qu’elle a
prescrites". C'est pour cela que l’affirmation de la compétence de l’autorité judiciaire est
rattachée à la liberté individuelle, aux termes de l’article 66 de la Constitution 102.
En l'espèce, il s'agit de savoir s'il existe un véritable statut juridique pour la personne
retenue en cellule de dégrisement. On rappellera, d'une part, que, dès lors qu'une
personne suspecte fait l'objet d'une mesure de contrainte (interpellation, transport
menotté, mise en cellule de dégrisement, etc..), elle ne peut être auditionnée que sous
le régime de la garde à vue103. D'autre part, cette privation de liberté suppose
nécessairement la mise en oeuvre des droits de la défense, dont il n'existe aucune
définition légale, mais qui résulte essentiellement d'une construction
jurisprudentielle104. C'est ainsi que le droit à un procès équitable permet, par exemple, à
un détenu d'avoir accès à son dossier pénal105. Il peut s'agir également de l'obligation
étatique, pour toute personne privée de sa liberté, de bénéficier des conditions de
détention conformes au respect de la dignité humaine, tel que prévu, notamment, par
l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 106.
L'existence du principe de respect des droits de la défense dans les procédures
juridictionnelles avait déjà été reconnue, dès 1913, par le Conseil d'Etat 107. Pour sa part,
la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler, dans deux
arrêts importants, la nécessité d'assurer une meilleure garantie des droits de la défense
et ce, à tous les stades de la procédure108. Ainsi, comme la Cour européenne des droits
de l'homme,109 la Haute juridiction judiciaire s'assure de l'effectivité des droits de la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
308
défense, y compris dans le cas d'une personne retenue en cellule de dégrisement 110.
Autrement dit, même si « les mesures privatives de liberté s’accompagnent
inévitablement de souffrance et d’humiliation », l’article 3 « impose à l’Etat de s’assurer
que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité
humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une
épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une
telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et
son bien-être sont assurés de manière adéquate ; (...) en outre, les mesures prises dans
le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime
poursuivi »111.
Néanmoins, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence d'un
statut juridique topique. Il semble que seule la référence au statut de la personne
détenue112 soit envisageable. En effet, par analogie, on observera que M. A était visé par
une "accusation pénale"113 et, qu'à ce titre, il pouvait exciper des droits de la défense, au
même titre que le détenu114. Cette doctrine semble avoir inspiré le Législateur dans la
loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures
pénales115. On objectera que la nouvelle législation ne résout pas le problème
initialement posé, puisque c'est essentiellement la garde à vue qui y est visée 116.
Néanmoins, l'examen des nouveaux articles 61-1117 (audition sans privation de liberté)
et 803-6 (remise d'un document énonçant les droits)118 du code de procédure pénale
montre que, dès lors qu'une personne est visée par une "accusation pénale", elle peut
se prévaloir de protections identiques à celles prévues dans le cadre de la garde à vue.
Dans ces conditions, l'application du nouvel article 62 du code de procédure pénale 119
est parfaitement envisageable, dans la mesure où les forces de l'ordre disposent
désormais de la faculté d'auditionner, sans contrainte et dans une durée limitée 120, une
personne visée par ces dispositions. Mais le statut de "suspect libre", tel que prévu par
l'article 61-1 du code de procédure pénale, ne pouvait correspondre au cas de M. A.
puisque, rappelons-le, ce dernier a été conduit au poste de gendarmerie sous la
contrainte121. Autrement dit, la loi 28 mai 2014 n'apporte aucun élément relatif au statut
juridique d'une personne retenue en cellule de dégrisement. On observera également
que le statut du détenu résulte de l'exécution d'une décision judiciaire 122, ce qui n'est
pas le cas s'agissant de M. A., dont la privation de liberté résultait d'un acte
préparatoire à l'engagement des poursuites judiciaires. Autrement dit, seule
l'application de l'arsenal des droits préexistant, à savoir les droits de la défense (dans
leur dimension active123 et passive 124) est susceptible de définir un statut juridique in
concreto, sous le contrôle nécessaire du juge judiciaire. Ce postulat met en perspective,
outre le fait que M. A était l'objet d'une une accusation pénale, sa qualité d'usager du
service public125 de la justice judiciaire, au sens de l'article L 141-1 du Code de
l'organisation judiciaire126. Dès lors, il en concevable que l'action en responsabilité de
l'Etat en cas de survenance d'une autolyse subséquemment à cette mesure privative de
liberté soit engagée.
2) L'action en responsabilité de l’Etat
Parce qu'une personne placée en cellule de dégrisement est un sujet de droit et, à ce
titre, est un usager du service public judiciaire, les événements survenus
postérieurement à sa privation de sa liberté peuvent donner lieu à l'engagement de la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
309
responsabilité de l'Etat. S'agissant de M..A., il est parfaitement envisageable que sa
famille puisse engager une action contre l’Etat pour demander réparation, sur le
fondement, notamment, de la loi du 5 juillet 1972 (art. 11) 127 qui prévoit que « l’Etat est
tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » en
cas de faute lourde128 ou de déni de justice. A cet effet, une plainte pour « homicide
volontaire » pourrait répondre aux souhaits de la famille du défunt. Une seconde
option, relative à l’atteinte au droit à la vie (article 2 CEDH) est également envisageable.
a) La plainte pour « homicide involontaire »
Il est incontestable que ce sont les tribunaux judiciaires qui ont compétence pour
connaître des actions mettant en cause le service public judiciaire 129. Tel est le sens de
l'important arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1956, qui a permis d’établir le
principe général de responsabilité de l’Etat du fait de dysfonctionnements des services
judiciaires130.
Dans l’hypothèse envisagée, une option consiste, pour la famille du défunt, à se
constituer partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction sur la base de l'article
223-6 du Code pénal. Dans ce cas, le déclenchement des investigations n’est pas « subi »
mais bien « provoqué » dans la mesure où l’action judiciaire résulte de la famille du
défunt et non de l’autorité légalement investie du pouvoir d’enquête. Si ce premier
outil est un précieux viatique pour les ayant droits, il semble que l’article 221-6 du code
pénal131 soit plus approprié. En effet, ce texte prévoit que « le fait de causer, dans les
conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par
la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (alinéa 1). En cas de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende » (alinéa 2). S’agissant des sanctions proprement dites, l’article 221-6 du Code
pénal prévoit, à titre principal, un emprisonnement de trois ans et une amende de
45000 €. La circonstance aggravante sera retenue en cas de « violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement »132. Dans cette hypothèse, elle sera assimilée au délit d’exposition d’autrui à
un risque de mort, prévu à l’article.
Les débats parlementaires ont clairement montré la nécessité d’énumérer les critères
permettant d’engager la responsabilité pénale de la personne, qu’elle soit d’ailleurs
physique ou morale133. Il s’agit de l’imprudence, la maladresse, l’inattention, la
négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par
la loi ou le règlement. Plus que le décès en lui-même, c’est d’abord la causalité qu’il
convient d’établir, la mort n’étant qu’un élément constitutif de l’infraction. Or,
précisément, dans notre analyse, la matérialité de l’infraction ne rencontre aucune
difficulté particulière, puisqu’il s’agit d’une autolyse. En revanche, l’élément
intentionnel s’avère plus délicat, puisqu’il s’agit non seulement de dénoncer
l’imprudence des gendarmes, caractérisée par l’absence de précautions, mais
également de révéler l’inertie « caractérisée »134 des autorités judiciaires supérieures.
Autrement dit, en cas de désignation, le juge d’instruction devra établir la matérialité
de la violation de l’obligation de prudence des gendarmes, d’une part, et la rétiveté des
autorités judiciaires supérieures, d’autre part. En somme, il lui reviendra de démontrer
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
310
que ces deux organes institutionnels n’avaient pas, a priori, l’intention de diligenter une
enquête sérieuse, conforme aux prescriptions légales. Il nous importe peu de savoir si
la responsabilité d’un organe est plus forte que celle de l’autre. Il suffit de constater la
carence de la chaîne judiciaire qui s’est avérée incapable de faire la lumière sur une
mort violente et mutatis mutandis, d’en tirer les conséquences de droit.
Néanmoins, l’acception n’est pas du tout la même selon qu’il s’agit de la responsabilité
d’une personne physique ou morale poursuivie pour homicide involontaire. On sait, en
effet, que la responsabilité pénale de la personne morale n'est en aucune façon une
responsabilité pénale du fait de ses préposés. La Cour de cassation a d’ailleurs estimé
qu’une personne morale ne pouvait être responsable pénalement qu’en cas d’infraction
commise par un de ses organes ou un de ses représentants. Par voie de conséquence, la
juridiction saisie devra vérifier l’existence d’une délégation de pouvoir, ou préciser les
attributions des agents mis en cause pour en faire des représentants avant tout
engagement des responsabilités135. Dans sa décision du 2 octobre 2012, la Cour de
cassation a pris soin de rappeler le principe, désormais bien établi, de la nécessité de
rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un organe ou d’un
représentant de la personne morale136. Il en ressort que ce sont d’abord les éléments
permettant de caractériser l’intention de « ne pas faire » qu’il convient de déceler,
préalablement à toute répression pénale et/ou civile. S’il n’est peut être pas aussi
évident qu’il le parait d’écarter l’option de la plainte pour homicide involontaire, telle
qu’elle résulte de l’article 223-6 du Code pénal, la mise en musique de ce texte suppose,
au préalable, le dépôt d’une consignation, dont le montant, fixé par le juge
d’instruction, peut s’avérer prohibitif, voire rédhibitoire.
En revanche, il est envisageable de privilégier une autre option, moins spectaculaire et
moins onéreuse, consistant à engager la responsabilité de l’Etat pour atteinte au droit à
la vie, sur les fondements de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales.
b) La plainte pour atteinte au droit à la vie
Naturellement, cette hypothèse n’est envisageable que si toutes les voies de droit
internes sont épuisées. Cette option suppose également que l’on sache de quoi l’on
parle lorsqu’on fait référence au droit à la vie. L’article 2 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit que, « le droit
de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas
où le délit est puni de cette peine par la loi (1). La mort n'est pas considérée comme infligée en
violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument
nécessaire: pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale (a), pour
effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue (b), pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection (c)». Il se
retire de cela que les Etats signataires ont non seulement le devoir de s’abstenir de
provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi celui de prendre les
mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction,
notamment par la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un
mécanisme d’application137. On observera également que l’absence d’une responsabilité
directe d’un Etat dans la mort d’un individu n’exclut pas pour autant l’application de
l’article 2138. Néanmoins, le droit à la vie n’est pas un droit absolu 139 dans la mesure où
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
311
sa mise en œuvre suppose des conditions strictes d’application 140. Nous retiendrons
qu’il s’agit essentiellement d’obligations positives d’ordre procédural, l’Etat ayant
notamment le devoir de mener une enquête sur les décès éventuellement survenus en
violation des dispositions de la Convention141. Ainsi, il s’agit, d’abord, de vérifier si
l'application des lois internes qui protègent le droit à la vie a été respectée. Ensuite,
dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que
ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité
142.
En toute hypothèse, l’enquête doit répondre aux exigences d’indépendance, de célérité,
de diligence et doit montrer la capacité à établir les faits pertinents. En outre, elle doit
prévoir l’accès du public et des proches143. C’est ainsi que dans plusieurs affaires
récentes, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2
au motif qu’aucune véritable mesure d’enquête n’avait été prise par les procureurs
chargés de l’enquête144. Pour la Cour, il suffit qu’il y ait violation de l’obligation
procédurale d’enquête pour que la mort soit directement imputable aux forces de
l'ordre145. Elle estime, notamment, que l'enquête incombant aux autorités nationales ne
peut normalement pas être suppléée par des mesures d'instruction, notamment une
enquête sur place, qu'elle-même ordonnerait146, cela « sans préjudice d'hypothèses dans
lesquelles les autorités s'avèrent incapables de fournir une explication satisfaisante de la mort en
détention d'une personne »147. Au regard de ces éléments, il s’avère que c’est
essentiellement l’obligation de fournir des explications satisfaisantes quant au sort des
personnes « confiées » dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités de
l'État qui trouve application148. Les autorités se voient sommées de fournir une
explication plausible quant aux causes du décès en cas d’arrestation, y compris celle
revêtant un caractère sensible149. De même, La Cour estime que les autorités avaient ou
auraient dû avoir connaissance d’un risque certain et immédiat pour la vie de l’intéressé
et cherche à déterminer si elles ont bien pris les mesures que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elles150.
CONCLUSION
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la notion juridique du «
dégrisement » s’avère particulièrement difficile à cerner, ce qui rend difficile
l’appréhension du régime applicable à la privation de liberté qui en découle. La mise en
œuvre d’une telle mesure demeure également lacunaire au regard des droits de la
défense. Au delà, l’affaire du « suicidé de Camopi » a surtout permis de mettre en
exergue une problématique bien française, consistant à définir les frontières d'une
dualité juridictionnelle, d’une part, et la défaillance politique et sociale de l’Etat
(central et local) à l’égard des droits de la défense, d’autre part. Ce constat montre,
itérativement, la nécessité de généraliser les cas contentieux pour tirer des conclusions
touchant à l’organisation même du service public judiciaire et à son fonctionnement.
Cela signifie qu’au-delà du simple recours individuel, c’est l’ensemble des politiques
publiques consacrées aux lieux de privation de la liberté qu’il convient désormais de
repenser. En attendant le « véritable encadrement juridictionnel de la privation de la liberté,
dès les premiers instants, sous l’égide d’un magistrat indépendant » 151, la France risque, une
nouvelle fois, de s’échouer sur les récifs européens des droits de l’homme et des exigences
européennes152.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
312
NOTES
2. Il s’agit de la tenue traditionnelle de la plupart des groupes ethniques Amérindiens
d’Amazonie.
3. Alors qu’une personne en état d’ébriété ne doit pas forcément être privée de sa liberté Elle
peut parfaitement être conduite dans un établissement de santé publique ou à son domicile .
Voir, en ce sens, CEDH 4 avril 2000, Witold Litwa c. Pologne, §§ 78 et 79.
4. CEDH 4 avril 2000, op cit.
5. Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010. Melle Danielle S.
6. Cass, crim. 8 janv. 2013, n°12-80.465, FS-P+B Crim. 15 juin 2010, n°09-88.193, Dalloz
actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 939, obs. J.-F. Renucci ; dans le même
sens: Cass, crim. 14 avr. 2012, n° 11-86.898, Dalloz actualité, 29 mai 2012, obs. C. Fleuriot
7. Sur ce point, s'agissant de l'infraction d'ivresse publique, voir Delphine Le Drevo,
« Placement en cellule de dégrisement, compétence administrative et respect des droits
de la défense »., Commentaire de l'arrêt Cass. Crim. 8 janv. 2013, n°12-80.465 in Dalloz
actualités (pénal), 25 janvier 2013 (http://www.dalloz-actualite.fr)
8. En témoigne un arrêt de la chambre criminelle qui casse le jugement d’une
juridiction de proximité ayant refusé sans motif la demande de renvoi d’une affaire
sollicité par un prévenu en raison de l’absence de l’avocat de son choix (Crim. 15 juin
2010, n° 09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 939, obs. J.-F.
Renucci ; dans le même sens, V. Crim. 14 avr. 2012, n° 11-86.898, Dalloz actualité, 29 mai
2012, obs. C. Fleuriot
9. CEDH 10 mai 2007, Seris c. France, Dalloz actualité, 22 mai 2007, obs. A. Darsonville
10. Rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste, IGA, IGAS, IGSJ, IGN,
février 2008, 180 pages.
11. En effet, il est difficile d’être encore en état d’ivresse alcoolique plus de douze heures après
avoir cessé de boire (le taux d’alcoolémie décroissant en moyenne de 0,18 gr/l par heure)
12. Il semble que ce soit plutôt le « bon sens » qui préside à la mise en œuvre d’un tel
régime. Les seuls documents sont relatifs au régime de la garde à vue : Circulaire MA/
GEND/T n° 38200 du 4 octobre 1967 relative à la surveillance des personnes gardées à
vue dans les chambres de sûreté. Note expresse n° 2000 DEF/GEND/OE/PJ du 23 janvier
1992 relative à l’examen médical des personnes gardées à vue.
13. En l'espèce, il s'agit d'une autolyse par pendaison.
14. Sur la question juridique de la mise en dégrisement -notamment en analysant la
QPC du conseil constitutionnel de 2012-, voir: Roseline Letteron: http://
libertescheries.blogspot.fr/2012/06/qpc-le-conseil-constitutionnel-voit.html.12 juin
2012
15. Cass. crim, 9 septembre 1998, n° 98-80662 et 11 mai 2004, n° 03-86479.
16. Codifié par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.
17. L’article R. 3353-1 du CSP dispose en effet que « Le fait de se trouver en état d’ivresse
manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe ». Toutefois, le dispositif administratif vise « l’ivresse »,
tandis que le dispositif judiciaire fait référence à « l’ivresse manifeste ». (Voir,
également : Conseil d’État, 25 octobre 2002, Conseil national de l’ordre des médecins, n°
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
313
233.551 et Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° C3620), les Sages rejoignent la position
de la Cour de cassation selon laquelle l’état d’ivresse peut être prouvé par tout moyen
(Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.854), en particulier « à l’aide du témoignage des
sens sans qu’il soit nécessaire que le rapport qui l’atteste, relate à l’appui des signes
particuliers » (Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-81.515 : Bull. crim. n° 152).
18. En particulier la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
19. Circulaires du 16 juillet 1973 et du 9 octobre 1975.
20. Cette hypothèse ne doit pas être entendue uniquement dans le sens restreint d’une
personne dans un état clinique d’« alcoolisme » mais également comme les personnes
dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une
menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes (CEDH 4 avr. 2000, Witold Litwa c.
Pologne).
21. L’article 78-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale limite à quatre heures la durée de la
vérification pour un contrôle d’identité.
22. Circulaire n° 1312 du 16 juillet 1973 et n° 2731 du 9 octobre 1975 relative à l’admission des
sujets en état d’ivresse dans les services hospitaliers.
23. Alternativement, il peut s'agir de la préservation de l'ordre public ou d'une action répressive.
24. Camille VINET, Rapporteur public, conclusions sous CAA Lyon 10 janvier 2013 n° 11LY02052.
25. C’est nous qui soulignons.
26. Voir, par exemple : CEDH, 27 juillet 2006, Zervudacki c. France, n° 73947/01, § 43
27. Ce qui laisserait supposer, désormais, la présence de l’avocat dès le début du dégrisement.
28. Y compris le cahier de consignation.
29. Notamment Jean-Marc VIE, « Police et responsabilité administratives et judiciaires : où se
situe la frontière ? » in AJDA, 2010, pp. 771 et s.
30. Cass. Crim 28 juin 1995, Droit pénal, 1996, Chron. 21.
31. Décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012.
32. La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter deux précisions
sur la procédure suivie devant le juge en cas d'ivresse publique et manifeste, dans un
arrêt du 8 janvier 2013 (Cass ; crim 8 janvier 2013, n° 12-80465). Voir, également :
Conseil d’État, Il n’en demeure pas moins que la solution dégagée par le Conseil, dans sa
décision du 8 juin 2012, pose une autre difficulté : celle de la précision de plusieurs
infractions qui englobent dans leur définition la notion d’« état d’ivresse ». Ainsi, l’
article R. 3353-1 du Code de la santé publique érige en contravention de deuxième
classe « le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à
l’article L. 3341-1 ». De même, l’article L. 234-1, II, du Code de la route dispose que « le
fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste » est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Par ailleurs, plusieurs infractions
voient leurs peines principales aggravées en raison de l’état d’ivresse de leur auteur au
moment des faits – par exemple : les violences (article 222-13, 14°, du Code pénal) ou le
viol (article 222-24, 12°, du Code pénal) –. Or, nous savons que, conformément au
principe de légalité pénale, les infractions doivent être définies de manière claire et
précise (voir, encore récemment, à propos du harcèlement sexuel : Cons. const., déc. n°
2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel] –
ADL du 9 mai 2012), exigence qui n’apparaît pas satisfaite au regard du caractère
particulièrement flou de la notion d’« état d’ivresse ». Pour autant, à propos de la
contravention d’ivresse manifeste sur la voie publique, la Chambre criminelle de la
Cour de cassation a rejeté un pourvoi en cassation invoquant l’imprécision de cette
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
314
incrimination (Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 05-87.613).25 octobre 2002, Conseil
national de l’ordre des médecins, n° 233.551 et Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° C3620.
33. Cass. crim., 20 mars 2002, n° 01-85.854 et Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-81.515 : Bull. crim. n°
152)
34. TC 18 juin 2007 n° C 3620. Voir aussi : CEDH, 4 avril 2000, Witold Litwa c. Pologne, Req. n°
26629/95
35. CEDH, 4 avr. 2000, Witold Litwa c. Pologne, précit.
36. CEDH, 16 nov. 2000, Tanribilir c. Turquie.
37. CEDH, 3 avril 2001, Keenan c. Royaume Uni.
38. J.M. VIE, op cit.
39. Généralement cantonnée à quelques heures et consignée par les forces de l’ordre Le temps
passé en rétention pour ivresse publique doit être défalqué de celui de la durée de la garde à vue,
à l’instar de la retenue douanière (art. 323-9 code des douanes).
40. P. Dondoux. concl. sur CE 14 mars 1975, "R" in RDP 1975, p. 823.
41. T. confl., 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane, Rec. 642, GAJA, 18 ème édit., pp. 452 et s.
42. Yves JEGOUZO, Pierre BON, Dominique MUSSO, Gilbert GANEZ-LOPEZ, « Réforme de
la procédure judiciaire d'expropriation. A propos du décret du 13 mai 2005 », Dossier
établi dans le cadre du séminaire permanent. Droit de l'aménagement du GRIDAUH in
AJDI, 2005, pp. 537 et s. Néanmoins, il existe de nombreuses situations dans lesquelles la
coexistence des deux ordres juridictionnels apparaît avec plus ou moins de clarté dans
la répartition des compétences (urbanisme, droit de la construction et de l’habitation,
mutations domaniales, régime des SPIC, etc…).
43. Anne WUILLEUMIER, « L’implication des GIR dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Rapport INHESI », 2010, pp. 537 et s.
44. CEDH, 26 septembre 2013, Evelyne Robineau et autres c. la France, Req. n° 58497/11. En
l’espèce, il s’agissait d’une personne mise en cause ayant trouvé la mort après
défénestration d’une salle du tribunal où elle avait été déférée.
45. C’est nous qui soulignons
46. Dans l’affaire Robineau c. France, l’événement s’est produit postérieurement à la garde à vue,
mais préalablement à la présentation du prévenu au Magistrat du Parquet ;
47. CEDH 2ème sect. 15 décembre 2009, Maiorano et autres c. Italie, Req. n° 28634/06
48. Ou critère finaliste.
49. Voir, en ce sens les conclusions de Mme Camille VINET, Rapporteur public à la CAA de Lyon,
au sujet du suicide de Franck S. le 23 /11/03 dans la cellule de dégrisement de Dijon.
50. CAA LYON, Chambre 4, 10 Janvier 2013, n° 11LY02052, Inédit, Abada-Soprana c.
Ministère de l’Intérieur.
51. Pour une étude complète, voir: Tribunal des Conflits. Rapport 2005, pp 15-19. Il n’est toutefois
pas exclusif, puisque le Conseil d’Etat a, par une jurisprudence aussi constante qu’ancienne admis
que l’ordre judiciaire était compétent pour les litiges en responsabilité nés d’un acte de police
judiciaire. Sur ce point, notamment, CE 11 mai 1951, Baud, S. 1952, 3, note Roland Drago, concl.
Delvolvé.
52. « Les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés
constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre
public » ; « que, en dehors des cas où ils agissent sur réquisition de l’autorité judiciaire, les agents
habilités ne peuvent disposer d’une personne que lorsqu’il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu’elle vient de commettre une infraction ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l’empêcher d’en commettre une » et « qu’en pareil cas, l’autorité
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
315
judiciaire doit en être au plus tôt informée et le reste de la procédure placé sous sa surveillance »
(Cons. const., déc. n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, cons. 9 et 10)
53. Ce qui n’exige l’intervention d’un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires que
dans le cas où l’intéressé à été privé de liberté. Cette présence s'explique par le fait qu'il existe à
son encontre des « raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de
s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
54. Cons. const. 8 juin 2012, n°2012-253 QPC.
55. CEDH, 4 avril 2000 Witold Liwa c. Pologne, Req. n° 26629/95 § 61.
56. CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, Req. no 39922/03.
57. CEDH, troisième section, 21 juin 2007, décision sur la recevabilité de la requête n° 12332/03
présentée par
Claude Castelot contre la France.
58. Ibid.
59. L’affaire a finalement été radiée à la suite d’un règlement amiable
60. CEDH, troisième section, 21 juin 2007, décision sur la recevabilité de la requête n° 12332/03
présentée par Claude Castelot contre la France.
61. Ainsi, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mme Danielle X, le Conseil doit
vérifier si la disposition contestée n’entrave pas la liberté individuelle par une rigueur qui ne
serait pas nécessaire. Il doit s’assurer que les atteintes portées à la liberté d’aller et de venir et à
la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées.
62. L’article R. 3353-1 du Code de la santé publique érige en contravention de deuxième
classe « le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à
l’article L. 3341-1 ». De même, l’article L. 234-1, II, du Code de la route dispose que « le
fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste » est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Par ailleurs, plusieurs infractions
voient leurs peines principales aggravées en raison de l’état d’ivresse de leur auteur au
moment des faits – par exemple : les violences (article 222-13, 14°, du Code pénal) ou le
viol (article 222-24, 12°, du Code pénal). A propos de la contravention d’ivresse
manifeste sur la voie publique, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté
un pourvoi en cassation invoquant l’imprécision de cette incrimination (Cass. crim., 20
septembre 2006, n° 05-87.613).
63. L’« absence de définition de l’IPM dont la constatation, de surcroît, ne s’appuie sur aucune
mesure objective de l’alcoolémie mais est appréciée par les forces de sécurité (police ou
gendarmerie) au travers de diverses manifestations extérieures comme l’haleine, l’équilibre, les
propos, le regard … ; d’autre part, « une base juridique lacunaire pour ce qui relève pourtant
d’un aspect majeur de la question : l’aspect médical. Celui-ci n’est traité que par deux circulaires
de 1973 et 1975 qui ne l’envisagent que sous l’angle hospitalier ». Enfin, il est observé « un vide
qui concerne aussi des aspects touchant aux libertés publiques : durée de la rétention,
computation du temps de dégrisement et du temps de garde à vue…, op. cit., p. 16.
64. « En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais
si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé
informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les
lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend
sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la
nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un
officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes
prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
316
d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur
instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des
causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes
prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue
d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations
peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la
République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les
dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de
découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est
inconnue ou suspecte ».
65. voir aussi CEDH, 4 décembre 1995, Ribitsch c. Autriche, Req. n°. 18896/91.
66. CEDH, 5 avril 2005, Afanassiev c. Ukraine, Req. n° 38722/02 et CEDH, 11 juillet 2006, Boicenco c.
Moldova, Req. n° 41088/05).
67. Rappelons que la garde des locaux appartenait, au moment du suicide, à la gendarmerie
nationale (CA Paris, 2 février 1955, JCP 1955.II.8619, note Esmein. L'article L 141-1 du Code de
l'organisation judiciaire énonce que "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement
défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que
pour une faute lourde ou par un déni de justice". Il peut s'agir d'une série de faits traduisant
l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass.1ère civ; 17
juin 2010, n° 0967.311). Cet article peut également être utilisé en combinaison avec l'article 6 § 1
de la convention européenne des droits de l'homme, qui n'exige pas l'existence d'une faute
lourde.
68. On se référera au commentaire de Jean-Marc Vié : « police et responsabilité administratives et
judiciaires : où se situe la frontière ? » in AJDA, 2010, p. 771 et s.
69. TC 19 décembre 1988, Rey, Rec. 496 ; Gaz.Pal. 18-20 juin 1989, concl. M. Laroque.
70. AUBRY et RAU, Cours de droit civil, Paris, 5ème éd., t. 4, p. 166 et PLANIOL, Traité
élémentaire de droit civil, 6ème édit, t. 2, n° 231. L’article 1148 du code civil, consacré à la
théorie de la faute, permet d’établir une cause d’exonération de la responsabilité. Pour
sa part, la législation du droit du travail opère une distinction, certes de principe, entre
les deux théories et permet, in concreto, d’exonérer le patron d’une partie de sa
responsabilité.
71. Ph. Antonmattéi, « Ouragan sur la force majeure », JCP G 1996, I, 3907, n° 9. Voir aussi : L. Bloch,
« Force majeure : le calme après l'ouragan », Resp. civ. et assur. 2006, Étude 8, spéc. n°3 ; L. Leveneur,
« Contrats », conc. consom. 2006, comm. 152 ; E. Savaux : Defrénois 2006, p. 1216 ; Adde, notre note : JCP G
2006, II, 10087.
72. Maurice HAURIOU, « La distinction de la force majeure et du cas fortuit », Note sous
Conseil d’Etat, 10 mai 1912, Ambrosini, S. n° 1912.3.161. Rec. p. 549. Plus récemment :
Paul-Henri Antonmattei : « Ouragan sur la force majeure », op. cit. ; Patrice Jourdain,
RTD civ., 2003 p. 301 et RTD civ. (4) oct-déc. 1994, p. 872 ; Geneviève Viney, Traité de droit
civil - Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 1998 - 2° éd. Voir aussi J.-C. Saint-Pau,
Jurisclasseur Code civil, 2004 Fasc. 11-30 ; F. Ferré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil - les
obligations, Dalloz, 8ème éd., n° 582, p. 560. Pour une analyse approfondie et pertinente,
on se référera à l’avis de l’Avocat général De Gouttes (Cass. au sujet des pourvois n°
04-18.902 et n° 02-11.168). Selon M. De Gouttes, il y a lieu de procéder à une distinction
trilogique (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) reposant sur l’appréciation du
comportement humain aux trois stades successifs (avant, pendant, après) de
l’événement. De même, les directives européennes et la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne permettent de dégager trois critères de la force majeure :
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
317
l’événement exonératoire doit être étranger à la personne qui l’invoque ; il doit être
anormal et imprévisible ; il doit rendre l’exécution du contrat impossible malgré les
efforts fournis par le débiteur pour tenter d’exécuter le contrat. Directive 97/5/CE du
27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ; Directive 90/314/CE
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait : arrêts de la CJCE n° C-263/97 du
29 septembre 1998 ("The queen v. Intervention Board ...", n° 148/85 du 5 février 1987
(Denkavit) ; n°C-236/99 du 16 mars 2000 (Commission c. Belgique).
73. J.-C. Saint-Pau, jurisclasseur Code civil, 30 juillet 2004, fasc. 11-30
74. Décret du 20 mai 1903 applicable aux seuls gendarmes
75. cf : J. C. Saint-Pau, op cit.
76. Au même titre que tous les actes de police judiciaire, même préparatoires. Sur ce point : CE,
sec. 11 mai 1951, consorts Baud, Rec. 205.
77. En l’espèce, il s’agissait de violences aggravées, peine prévue et réprimée par l’article 222-12,
4°du code pénal
78. CA Paris 8 mai 1946, Sureau c/ Baux, D. 1946, p. 316.
79. Il peut s’agir de « toutes les espèces de décès suspects sont visées par le texte, indépendamment des
moyens d'administration de la mort ». Sur ce point: Lexisnexis jurisClasseur Procédure pénale. Fasc. 20 :
« mort, blessures graves et disparition suspectes », Cote 03, 2005, p. 10
80. V. A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, Litec, 2e éd. 1998, n°892 s. ;
F. Gollety, « Les morts suspectes », Rev. sc. crim., 1958, p. 913. – R. Merle et A. Vitu, Traité de droit
criminel, Procédure pénale, t. 2 : Cujas, 4e éd. 1987, n°1078. ; J. Pradel, Procédure pénale, Cujas,
11e éd. 2002/2003, n°531 ; M.-L. Rassat, Le Ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ,
1967, n°243 et s. ; M.-L. Rassat, Traité de procédure pénale , PUF, coll. Droit fondamental, 2001,
n°334 et 338. ; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz, 19e éd., 2004,
n°622.
81. L’enquête de mort suspecte est une forme d’investigation judiciaire ancienne,
puisqu’elle existait déjà sous l’empire du Code d’instruction criminelle (art. 44 al. 1). La
Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer cette disposition (Cass, crim 15 mars 1890 :
DP 1892, 5, p. 540 note Lambert). Avec la loi du 9 mars 2004, le champ d’application de
l’article 74 CPP a été étendu aux personnes grièvement blessées. Sur ce point : Fabrice
DEFFERRARD in Lexisnexis : Fasc. 20 : « mort, blessures graves et disparition
suspectes ».
82. Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la
gendarmerie : Bull. des Lois, 12e S., B. 2468, n° 43414, abrogé par la loi n° 2009-971 du 3
août 2009 relative à la gendarmerie nationale, art. 25.
83. Assemblée nationale : Avis n° 1690 présenté par M. François VANNSON, député, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République sur le projet de loi (N° 1336) adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, relatif à
la Gendarmerie nationale (art. 8).
84. Cette abrogation est intervenue en 2009. En discussion au Parlement, il s’est avéré que la
plupart des dispositions de ce décret contenaient des dispositions de natures législatives en
application de l’article 34 de la Constitution. Son abrogation est donc intervenue par le biais
d’une disposition législative.
85. CE 14 février 1936, Boiero, Rec., p. 207
86. « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie
la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.(al.1). Toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
318
sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs(al.2) »
87. J-M VIE, « Police et responsabilité administrative et judiciaires : où se situe la frontière ? »,
AJDA, 2010, pp. 771 et s.
88. Par les autorités judiciaires agissant hiérarchiquement : l’habilitation d’OPJ est alors
suspendue, voire même retirés définitivement dans le ressort de la cour d’appel. Cette
mesure est susceptible d’être étendue sur le territoire national, dans les cas extrêmes
89. Article 434 du Code pénal : « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou
l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets
quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à
faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des
coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions,
est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».
90. CE 12 février 1909, Comp. Commerciale de colonisation du Congo, Rec., p. 154. Pour Gaston Jèze,
cette théorie se formait avec la mise en cause de la responsabilité publique même en cas de faute
personnelle.
91. CE 3 février 1911, Rec. p. 146 ; S. 1911, 3, 137, note Hauriou.
92. CE 14 novembre 1919, Lhuillier, Rec. p. 819
93. CE 29 juillet 1918, Rec., p. 761, concl. Blum ; S. 1918-1919, 3, 41, concl. Blum et note Hauriou :
D. 1918, 3, 9. concl. Blum in RDP 1918, p. 41, chron. Jèze.
94. CE, Ass., 18 novembre 1949, Rec.,,p. 492. Mimeur, Defaux et Besthelsemer.
95. CE 13 juillet 1962, Dame veuve Roustan, Rec. p. 487
96. Sur ce point : Bernard PACTEAU, à propos du commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat 18
novembre 1988, Req n° 74952 ; Min. de la Défense c. Epoux Raszewski in La Semaine juridique. Edition
générale n° 16, 19 avril 1989, II 21211.
97. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne
s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement
de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers,
il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
98. Ceci suppose que la notion de « non dénonciation de suicide », voire de « complicité au
suicide », soit écartée, d’autant qu’elle n’est pas réprimée.
99. La mort violente est celle « qui résulte de l’emploi de la force ou de quelque brusque
accident » : il peut s’agir d’un décès volontaire procédant de la volonté de mettre fin à ses jours
(suicide), d’une mort provoquée par un accident quelconque, ou d’une mort résultant d’un crime
ou d’un délit. En revanche, la « mort suspecte » désigne non pas la mort elle-même, mais les
conditions dans lesquelles le décès est intervenu. La mort est donc d’abord suspecte avant d’être
violente. Elles peuvent également être concomitantes, Fabrice DEFFERRARD, op cit.
100. Au vu du certificat médical "bleu", il n'y avait pas d'obstacle médico-légal à son inhumation.
101. M....A a été inhumé le surlendemain de son suicide.
102. Sur ce point, notamment: Commission nationale consultative des droits de l'homme. Etude
sur les droits de l'homme en prison (propositions).Assemblée plénière, 11 mars 2004, pp 57-58.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
319
103. Il convient désormais de se référer aux nouvelles dispositions de l'article 62-2 CPP.
104. Il s'agit d'un ensemble de droits inspirés de la Déclaration française des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948.
105. Ce droit s'accompagne souvent du droit d'accès à un tribunal, sans lequel l'article 6 de la
CEDH n'aurait aucun intérêt. Grâce à leur interprétation téléologique, les juges européens ont
étendu le contenu de l'article 6 CEDH en y ajoutant le droit au juge. La récente loi du n° 2014-535
du 27 mai 2014 confirme cette tendance.
106. Curieusement, la Constitution française ne garantit pas explicitement les droits de la
défense. Le Conseil constitutionnel a donc d’abord fait appel, en 1976, à la catégorie des «
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », avant de les rattacher à la « garantie
des droits » proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, décision n° 2006-535 DC du 30
mars 2006, cons. 24.
107. CE 20 juin 1913, Tery, Rec., p. 736 et CE Sect. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier. Dès lors
que la décision administrative revêt un caractère de gravité suffisante et qu'elle est prise en
fonction du comportement de la personne concernée ou de ses activités, l'administration doit
respecter ce principe, Rec. p. 133 (D. 1945.110, concl. Chenot, note de Soto ; RD publ. 1944.256,
concl. Chenot, note Jèze).
108. Crim. 15 juin 2010, n° 09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; RSC
2010. 939, obs. J.-F. Renucci ; dans le même sens, V. Cass. crim. 14 avr. 2012, n°
11-86.898, Dalloz actualité, 29 mai 2012, obs. C. Fleuriot.
109. L'article 3 CEDH, résulte d'une création prétorienne et concerne des droits qui ne
sont pas expressément garantis par la Cour de Strasbourg. Sur ce point, notamment: F.
Sudre, « L'article 3 bis de la Convention européenne des droits de l'homme: le droit à
des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine », in Libertés,
Justice, Tolérance. Mélanges en homme au Doyen Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004. pp.
1500-1514. Aussi: «Les équivalents de l’article 3 de la Convention européenne dans le
système interaméricain des droits de l’homme », C-A. CHASSIN (dir.), La portée de
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp.
23-46.
110. A ce sujet: Delphine Le Drevo, « Placement en cellule de dégrisement, compétence
administrative et respect des droits de la défense », Commentaire de l'arrêt Cass. Crim.
8 janv. 2013, n°12-80.465 in Dalloz actualités (pénal), 25 janvier 2013 (http://www.dalloz-
actualite.fr). Plus récemment: Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-81.554 JurisData
n° 2014-002946. En l'espèce, la juridiction de proximité a énoncé qu’il n’y avait pas lieu,
à défaut de comparution du prévenu, d’un avocat ou d’une personne munie d’un
mandat spécial de faire droit à la demande de renvoi formulée par le prévenu.
111. CEDH (5e Sect). 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09 – ADL du 29 avril
2013. Pour une analyse approfondie: Nicolas Hervieu, « Les acquis européens de la
protection des détenus à l’épreuve de la casuistique » in Lettre « Actualités Droits-
Libertés » du CREDOF, 4 novembre 2013 (Lien : http://wp.me/p1Xrup-2jW et [PDF]).
112. V. notamment B. Belda, « L'innovante protection des droits du détenu élaboré par le juge européen
des droits de l'homme », AJDA, 2009, p. 406 ; J.-P. Céré, « La mise en conformité du droit pénitentiaire avec
les règles pénitentiaires européennes : réalité ou illusion ? », Revue de droit pénal, 2009, p. 111.
113. « Accusations en matière pénale » au sens des stipulations de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'« accusation » peut se définir
comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
320
une infraction pénale (sur ce point: arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A no 119, avis de la
Commission, p. 37, § 31).
114. Au sens de l'article 6 CEDH. Depuis 1976, la Cour définit l’accusation en matière
pénale en utilisant trois critères : la qualification juridique donnée aux faits par le droit
national, la nature même des faits ou des comportements, la nature et le degré de
sévérité de la sanction. Le premier de ces critères se révèle décisif lorsque le droit
interne retient la qualification pénale ; dans l’hypothèse inverse, les deux autres
critères se relaient pour placer la question dans la sphère pénale. Sur ce point: CEDH 18
juin 1976, Engel c/ Pays-Bas, GACEDH, n°23. On se référera également aux arrêts Salduz
(27 nov. 2008) et Dayanan (13 oct. 2009) et Brusco c. France du 14 octobre 2010. Sénat.
Rapport de Jean-Pierre Michel (sur le projet de loi portant transposition de la directive
2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative à
l'information dans le cadre des procédures pénales. 19 février 2014. p. 3.
115. Adoptée définitivement par le Parlement le 15 mai 2014. Elle a été publiée au Journal Officiel
le 28 mai 2014 et est entrée en vigueur le 2 juin 2014, date limite à laquelle devait être transposée
la directive précitée, dite "directive B", JORF n°0123 du 28 mai 2014, p. 8864
116. Il faut toutefois rappeler que c'est d'abord la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qui a
profondément réformé le régime de la garde à vue et renforcé de façon importante les
droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. Pour une explication, voir :
Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale
applicables le 2 juin 2014 de la loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans
le cadre des procédures pénales. Bulletin officiel du Ministère de la justice. NOR :
JUSD1412016C. 81 p.
117. Art. 61-1 CPP: "La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue
librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu
présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; ; 2° Du
droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d'être
assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui
lui sont posées ou de se taire; 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un
délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de
sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi
par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est
informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide
juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de
poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas
échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification
des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. Si le
déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en
vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit
d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les
modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils
juridiques avant cette audition. Le présent article n'est pas applicable si la personne a été
conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire".
NOTA : Conformément à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 15, les dispositions du 5°
et l'avant-dernier alinéa de l'article, entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Ces
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
321
dispositions s'appliquent également au cours d'une enquête préliminaire ou une
enquête douanière. La nouveauté de ce texte réside dans la notification du droit au
silence, comme en matière de garde à vue, et du droit de bénéficier des conseils
juridiques.
118. Art. 803-6 CPP: "Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative
de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification
de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une
langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en
application du présent code : 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu
de l'infraction qui lui est reprochée ; 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 3° Le droit à
l'assistance d'un avocat ; 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ; 5° Le droit d'accès aux
pièces du dossier ; 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités
consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté
dont elle fait l'objet ; 7° Le droit d'être examinée par un médecin ; 8° Le nombre maximal d'heures
ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une
autorité judiciaire ; 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de
l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de
liberté. Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est
informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend.
L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une
langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard".
119. Art. 62 CPP: "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les
enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête
le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire
à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. Si, au cours de l'audition
d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il
apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les
informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son
placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2. Si, au cours de l'audition
d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou
un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la
disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui
est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1".
120. D'une durée maximale de quatre heures.
121. Art. 63-1 CPP version en vigueur au 2 juin 2014. Circulaire du 23 mai 2014, op. cit; p. 3
122. Pascal Combeau, « Responsabilité du fait des services judiciaires et pénitentiaires », in
Lexisnexis. Jurisclasseur Administratif, Fasc. 900. 27 décembre 2013. p.3
123. Droit à la vie, droit à un procès équitable, droit au juge, etc...
124. Obligation étatique, pour toute personne privée de sa liberté, de bénéficier des conditions de
détention conformes au respect de la dignité humaine, tel que prévu, notamment, par l'article 3
de la Convention européenne des droits de l'homme.
125. Ce sont (..) les parties au procès judiciaire ou les personnes visées par la procédure, c'est à
dire celles qui demandent ou contre lesquelles est demandée une décision judiciaire (par
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
322
exemple, Cass. 1ère civ., 25 janv. 2005, n° 02-21.613, Jurisdata n° 2005-026626. Sur ce point, voir:
Pascal Combeau, op cit, p.8.
126. "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service
de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute
lourde ou par un déni de justice".
127. L'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire permet également d'engager la
responsabilité de l'Etat en cas de dommage causés par le fonctionnement défectueux du service
de la justice. Il peut s'agir de "toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits
traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi". Sur
ce point, voir: Cass. ass. plén., 23 février 2001, n° 99-16. 165, Bolle: jurisdata n° 2001-008318.
S'agissant de l'erreur commise par le Ministère public sur les conditions juridiques de
l'engagement des poursuites: Cass. 1ère civ., 14 mars 2006, n° 04-15.458: jurisdata n° 2006-032657
128. La faute lourde n’est désormais plus exigée.
129. Sur ce point : Abdoulaye Coulibaly : répartition des compétences en matière de service
public de la justice judiciaire in lexisnexis. Jurisclasseur administratif. Cote 03, 2007. Aussi : F.
Casorla : dysfonctionnements du service de la justice et responsabilité de l’Etat, la justice séparée
in LPA, 12 juillet 2007, p. 4 et s.
130. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du vendredi 23 novembre 1956 N° de
pourvoi: 56-11871. Notons toutefois qu’il n’est fait référence qu’aux seuls collaborateurs
« occasionnels » de la police judiciaire
131. Modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011-art. 185.
132. Art. 221-6 alinéa 2, cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75000€.
133. C. pén, art. 121-2 al. 3 et 121-3; Cass. Crim. 18 janvier 2000, n° 99-80.318 Cass, crim
2 octobre 2012
Selon la cour de cassation, les organes de la personne morale sont les personnes physiques que
celle-ci désigne et mandate pour agir en son nom, c'est-à-dire ses représentants légaux ou
statutaires
134. Le terme « caractérisée » est révélateur d’une désinvolture évidente de son auteur. Philippe
Conte, Droit pénal spécial, o. cit., p. 51.
135. Voir arrêt Cass, crim. 11 octobre 2011 n°10-87.212 et Cass Crim 11 avr.2012 n°10-86.974.
136. Cass, Soc. 2 oct. 2012 n°11-84.415.
137. L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998 ; Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998.
138. Anguelova et Iliev c. Bulgarie, Req. n° 55523/00, arrêt du 26 juillet 2007, § 93.
Cependant, les obligations positives découlant de l’article 2 « [doivent être
interprétées] de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou
excessif »
139. Bertrand MATHIEU , « La vie en droit constitutionnel comparé. Eléments de réflexions sur un droit
incertain » in RIDC 1998, n° 4, p. 1031.
140. En témoigne l’arrêt « Giuliani et Gaggio c/ Italie » (CEDH, GC, 24 mars 2011, Req. n° 23458/02) à
propos des circonstances du décès d’un manifestant lors du sommet de Gênes, le 20 juillet 2001.
141. McCann et autres c. Royaume-Uni, précit.
142. Anguelova c. Bulgarie, n° 38361/97, § 137, Jasinskis c. Lettonie, Req. n° 45744/08, arrêt
du 21 décembre 2010, § 72.
143. Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 14 mars 2002, Req. n° 46477/99. L’affaire
concernait le meurtre du fils des requérants par un codétenu. Violation de l’article 2 en
raison de deux défauts (bien que l’enquête ait rempli la plupart des autres critères
d’effectivité) : absence de pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et absence
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
323
de publicité de la procédure – les requérants n’ayant pu assister que pendant trois jours
aux travaux de la commission d’enquête. Voir également l’affaire Seidova et autres c.
Bulgarie (Req. n° 310/04, arrêt du 18 novembre 2010), dans laquelle les proches de la
victime furent exclus de l’enquête sur la mort de leur époux et père.
144. Par exemple : Kolevi c. Bulgarie ( Req. n° 1108/02) arrêt du 05 novembre2009 :
impossibilité d’engager des poursuites contre le procureur général soupçonné par la
famille d’être l’instigateur du meurtre de la victime et sous le contrôle duquel l’enquête
était menée. La Cour a conclu à la violation de l’article 2 dans un certain nombre
d’affaires bulgares en raison du recours à la force par la police, ou du caractère
ineffectif d’enquêtes et de poursuites concernant des meurtres et des blessures
(Anguelova et Iliev c. Bulgarie, arrêt du 26 juillet 2007; Ognyanova et Choban c. Bulgarie,
arrêt du 23 février 2006, Anguelova c. Bulgarie, arrêt du 13 juin 2002 : disponibles sur
HUDOC. D’après la jurisprudence constante de la Cour, il incombe aux Etats de fournir
une explication plausible sur l’origine des blessures ou sur les décès survenant
lorsqu’un individu se trouve en garde à vue (Salman c. Turquie, Req. n° 21986/93, arrêt de
Grande Chambre du 27.06.2000, § 99).
145. CEDH, 28 juill. 1998, Ergi c/ Turquie, § 78 ; CEDH, 2 sept. 1998, Yasa c/ Turquie, § 97. ; CEDH,
14 mai 2002, Semsi Önen c/ Turquie, § 86 ; CEDH, 15 janv. 2004, Tekdag c. Turquie, § 75 :
disponibles sur HUDOC.
146. CEDH, 24 janv. 2008, Osmanoglu c/ Turquie, § 51.
147. CEDH, 10 avr. 2001, Tanli c/ Turquie, § 146. – CEDH, 13 juin 2002, Anguelova c. Bulgarie,
§ 112 ; CEDH, 27 juill. 2004, Ikincisoy c. Turquie, § 73 ; CEDH, 13 janv. 2005, Ceyhan Demir c.
Turquie, § 105, précit.
148. CEDH, 24 mars 2005, Akkum c. Turquie, § 211. En revanche, un tel renversement de
la charge de la preuve n'a pas lieu d'être lorsque le décès est intervenu au cours d'une
opération ordinaire de maintien de l'ordre
149. CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, § 91-95. Ainsi, contreviennent à cette
obligation l'incertitude existant quant aux faits survenus entre une visite médicale
riche en incidents et le placement en cellule ainsi que la contradiction entre les
mentions rassurantes de la feuille d'écrou et la réalité des événements ayant eu lieu la
nuit du drame. Dans leurs opinions, MM. Costa, Lorenzen et Kovler s'insurgent contre le
renversement de la charge de la preuve à quoi équivaut le raisonnement de la majorité
consistant à admettre que ce sont bien des coups portés par les policiers qui ont
entraîné la mort du fils des requérants, conclusion que rien dans le dossier n'étaie. La
Cour n'hésite pas à imputer à l'État l'activité homicide de personnes agissant pour son
compte, quand bien même il ne s'agit pas de fonctionnaires publics, les risques liés à
l'utilisation de volontaires civils pour l'accomplissement de fonctions de maintien de
l'ordre étant expressément soulignés (CEDH, 10 juill. 2001, Avsar c. Turquie, § 414). Il
appartient d'ailleurs à l'État de prendre les mesures propres à éviter d'éventuelles
usurpations de fonctions.
150. CEDH 16 nov. 2000, Tanribilir c/ Turquie.
151. Sur ce point, on lira particulièrement l’article de Nicolas Hervieu in droit à la liberté et à la
sûreté (art. 5 CEDH) : "nouveau coup de semonce européen sur la garde à vue et le rôle du
parquet français" in La Revue de droits de l’homme. CREDOF, 1 er juillet 2013, p.1
152. Nicolas Hervieu, op cit.
1. Il s’agit de la tenue traditionnelle de la plupart des groupes ethniques Amérindiens
d’Amazonie.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
324
ABSTRACTS
On January 7th 2011, gendarms From Camopi village (French Guyana) were required by a woman
complaining about her violent spouse. The trouble- maker, M.A., finally caught in the evening,
was led to territorial squad. His influence of drink justified his sobering up cell placement for
custody. At dawn, the violent husband was found dead, hung on his calimbé row. Calimbé is
traditional clothes from Amerindians ethnical groups of Amazonia. Beyond creating quite a stir,
this case sets, first, the consequences problem of a death occured in the frame of freedom break.
It points out, as well, the State ability to reply back to a cyclical dualilty consisting of combining
Human Rights Respect Requirements (Rights of the Defence, Rights of a fair trial), notably the
scheduled trigger on Public Action ( In the case in point, aggravated volunteer violence). In
perspective, that is good the question of the State Responsability (and its services) plus
commitment conditions involved when accident shows up during sobering up. The judicial
function of the final criterion, patiently designed by Jurisprudence (.....) is the main thought'
core. In spite of missing status during this middle stage ( came after the arrest but previously to
the potential trial, analysis brings to a close conclusion, meaning judicial order ability or skills
and confirm again, the State responsability to Judicial Public Service User.
Le 7 janvier 2011, les gendarmes du village de Camopi (Guyane française) étaient requis par une
jeune femme se plaignant de violences conjugales. Le fauteur, M. A., finalement interpellé dans la
soirée, est conduit à la brigade territoriale. Son état d’ébriété manifeste justifiait qu’il soit placé
en cellule de dégrisement, dans l’attente d'une garde à vue. Au petit matin, l’époux violent est
retrouvé sans vie, pendu au cordon de son calimbé1. Au-delà du relatif retentissement
médiatique, cette affaire pose, d'abord, le problème des conséquences d'un décès survenu au
cours d'une privation de liberté. Il met aussi l'accent sur la capacité, pour l'Etat, de répondre à
une dualité conjoncturelle consistant à concilier les exigences du respect des droits de l'Homme
(droits de la défense, droit au procès équitable, notamment) d'une part, avec le déclenchement
programmé de l'action publique (en l'espèce, il s'agissait de violences volontaires aggravées),
d'autre part. En perspective, c'est bien la question de la responsabilité de l'Etat (et de ses
services) et des conditions d'engagement de celle-ci lorsqu'un accident survient au cours d'un
dégrisement qui en cause. Le critère finaliste de la fonction judiciaire, patiemment élaboré par la
jurisprudence (notamment: CE 11 mai 1951, consorts Baud; TC, 7 juin 1951 Dame Noualek, et Cass.
civ, .2ème, 23 novembre 1956 Giry) est l'élément central de la réflexion. Malgré l'absence de
statut durant cette phase intermédiaire (postérieurement à l'interpellation mais antérieurement
au jugement), l'analyse conclue à la compétence de l'ordre judiciaire pour en connaitre et
réaffirme la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de l'usager du service public judiciaire.
INDEX
Mots-clés: Infraction pénale – Dégrisement - Critère finaliste - Ordre judiciaires - Service public
de la justice judiciaire - Droits de la défense – Responsabilité - Indemnisation
Keywords: Penal offence - Sobering up - Final Criterion - Judicial order - Judicial Public Service -
Rights of the Defence – Responsibility - Indemnity
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
325
AUTHOR
THIERRY EDOUARD
Thierry EDOUARD, Docteur en droit public, est chercheur associé au Centre de
Recherche sur la Décentralisation Territoriale (CRDT) de l'Université de Reims. Ses
travaux portent actuellement sur le principe de libre administration des collectivités
territoriales. Il est également Maître de conférences associé à l'Université de la Guyane,
où il enseigne le droit depuis 2006. Avocat au barreau de la Guyane, il intervient
essentiellement dans le droit des étrangers et le contentieux administratif.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
326
Les fichiers d’empreintes
génétiques : les systèmes français et
espagnol à l’égard de la Convention
européenne des Droits de l’Homme
Francisco Ramírez Peinado
Introduction
1. L’identification par l’ADN et l’efficacité des fichiers d’empreintes
génétiques dans la recherche criminelle
1 Parmi les traces1 qu’il est possible de rassembler dans le lieu de commission d’un crime
ou d’un délit, sur la victime ou sur le coupable présumé (dans ces derniers cas, soit sur
leurs corps, soit sur les vêtements ou objets qu’ils portent) 2, on distingue les traces
biologiques humaines : tissus (peau, cheveux, ongles), liquides (sang, salive, sperme,
etc.). Ces traces, à l’instar d’autres de nature différente, une fois analysées, peuvent
fournir plusieurs indices précieux pour la recherche criminelle, et même constituer
finalement une véritable preuve judicaire. Au-delà de l’identification des suspects
éventuels, que nous aborderons tout de suite, la simple analyse des traces biologiques
peut fournir des éléments pertinents non seulement pour l’enquête, mais aussi pour
d’autres éléments purement procéduraux3.
2 L’analyse de l’ADN à des fins d’identification dans l’enquête criminelle est relativement
nouveau, à peine plus de vingt ans d'utilisation régulière légale en Espagne 4, et un peu
moins en France5. Malgré ce court délai, la méthode est devenue une des stratégies
principales pour la recherche policière et judiciaire des auteurs des crimes et délits 6.
« Parmi les preuves scientifiques et techniques, les empreintes génétiques occuperaient
une place de choix » affirme Coralie Ambroise-Casterot7. La comparaison entre
l’empreinte génétique issue des vestiges biologiques recueillis dans la sphère du crime
(traces) avec l’empreinte génétique de l’auteur présumé, issue d’un échantillon
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
327
biologique obtenu de son corps (prélèvement), permettra de l’inculper, s’il existe une
forte coïncidence entre les deux empreintes, ou de l’innocenter, si cette coïncidence
n’est pas présente8. Par conséquent, on pourrait conclure que l’analyse scientifique de
l’ADN des traces biologiques ne donnera lieu à une véritable preuve à charge ou à
décharge qu’après leur comparaison avec l’ADN extrait d’un prélèvement 9. Toutefois, il
faut aussi admettre la possibilité d’une erreur judiciaire provenant d’une identification
par l’ADN10.
3 L’efficacité de l’identification à partir de l’ADN, aux termes que nous venons d’exposer
(recherche criminelle et preuve pénale), a été considérablement renforcée avec la
création de fichiers ou bases d’empreintes génétiques, puisqu’ils ont permis le
rapprochement à grande échelle des profils génétiques obtenus à partir des
échantillons biologiques recueillis dans la sphère du crime ou délit, avec les profils
génétiques identifiés et classés dans le fichier11. La conséquence pratique est
l’identification plus aisée des coupables présumés, ainsi que la disculpation plus rapide
des personnes suspectées à tort12. C’est justement sur ce point que certains auteurs
mettent l’accent, la qualifiant d’ « outil fondamentalement à décharge » 13.
4 À vrai dire, l’utilisation des fichiers policiers a toujours été très étendue. Comme
l’exprime V. GAUTRON, « dès la fin des années 1960, plus de quatre cents fichiers ont
été recensés seulement aux services policiers de Paris, composés d’autour de 130
milliards de données ». En outre, ajoute l’auteur, « en facilitant le stockage et la
récupération des données, l'informatique a certainement révolutionné la matière, de
sorte que, après trente ans, nous avons assisté à une prolifération des fichiers de
police ».
5 Par ailleurs, dans la société actuelle, plongée dans le phénomène de la mondialisation,
la criminalité transfrontalière s’est répandue et généralisée, non seulement du point de
vue plus frappant des grands réseaux organisés, mais aussi par rapport à la délinquance
individuelle. Des réponses internationales s’imposent pour lutter contre la première, et
la collaboration, en tout cas, pour l'identification des délinquants 14.
2. Cadre législatif
6 Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a été créé en France
par la loi nº 98-468 du 17 Juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (Loi Guigou). Le fichier ne
devait répertorier que les données des condamnés pour viol ou agression sexuelle. Au
bout de trois ans, un élargissement est introduit par la loi nº 2001-1062 du 15 Novembre
2001 relative à la sécurité quotidienne (Loi Vaillant), pour inclure quelques autres
infractions. Cette loi a inséré la règlementation dans le titre vingtième du livre IV du
code de procédure pénale (CPP), relatif aux procédures particulières, articles 706-54 à
706-56-1. La loi nº 2003-239 pour la sécurité intérieure (loi Sarkozy II) opère une
nouvelle extension plus large du champ d’application du FNAEG, d’un côté pour
permettre l’inscription des données d’autres sujets (personnes mises en examen,
membres de la famille d’une personne disparue), et de l’autre pour élargir le fichier à
de nouveaux crimes et délits différents. En tout cas, d’après François-Bernard Huygue
(2008, p. 67), « le FNAEG ne surgit pas dans un désert juridique : la loi du 29 juillet 1994
stipulait déjà qu’une recherche par empreintes génétiques ne pouvait avoir lieu que «
dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
328
judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique » (article 16.11 du code
civil) ».
7 La loi organique 10/2007 du 8 octobre15 a créé en Espagne la « Base de datos policial sobre
identificadores obtenidos a partir del ADN ». Malgré le verbe employé, ce que fait la loi,
c’est « intégrer les fichiers ADN déjà existant aux mains des Forces et Corps de Sécurité
de l’État, tant pour l’enquête des délits, que pour les procédures d’identification des
restes humains ou de recherche des personnes disparues » (article 1). En effet, on
comptait déjà plusieurs fichiers établis dans ce but au sein des forces de sécurité de
l’État, ainsi que des Communautés autonomes du Pays Basque et de la Catalogne 16.
L’existence de tels fichiers était prévue par la loi organique de protection des données à
caractère personnel17. Toutefois, il n’existait aucune autre règlementation, même par
décret, ce que toute la doctrine regrettait au regard risque d’atteintes aux droits
fondamentaux, en particulier à l’intimité personnelle et la protection des données à
caractère personnel. En ce sens, l’exposé des motifs de la loi reconnaît les carences de la
tentative légale précédente d’aborder l’identification par l’ADN18.
8 La première chose qui attire l'attention dès qu’on lit le nom du fichier dans les deux
pays est la désignation différente de leur contenu. Le législateur français a choisi de
faire une assimilation entre l'identification par l'ADN et l'identification par empreinte
digitale ; il utilise donc le terme « empreinte génétique ». Cette désignation, par sa
simplicité et précision, s’avère à notre avis plus appropriée que la formule baroque
employée par le législateur espagnol, « identificateurs obtenus à partir de l’ADN », qui
semble avoir délibérément cherché à dissimuler la nature et le but de la nouvelle base
de données. D’ailleurs, la dénomination « empreinte génétique » jouit en France d’une
utilisation généralisée, tant dans le domaine juridique qu’à un niveau social. Quelque
chose de similaire se passe en Espagne avec les termes « profil génétique », « profil
d’ADN »19 et même celui d’« empreinte génétique ». Malgré cela, la loi 10/2007 a rejeté
ces expressions et les a remplacées par la sus-nommée, qui commence à être acceptée
par la doctrine20.
9 Quoi qu’il en soit, on l’appelle « empreinte génétique », « profil génétique » ou
« identificateur par l’ADN », nous sommes toujours devant un même concept : une
collection de fragments d’ADN, ordonnés en accord avec leur taille, qui sont
caractéristiques de chaque individu et qui constituent un code anonyme de
différentiation, tel qu’un code-barres ou un code chiffré21. Dans le cas des profils
obtenus d’un échantillon provenant d’une personne identifiée, c’est l’assignation à ce
code de l’identité de la personne concernée qui va permettre, désormais, d’effectuer
l’identification, ainsi que le rapprochement avec des autres profils ressortis des traces
biologiques collectées sur le lieu du crime.
10 A partir ces prémisses, ce texte vise à faire une approche comparative des deux
systèmes juridiques en France et en Espagne pour encadrer le stockage et le traitement
des profils ADN, destinés à l’identification des personnes lors de recherches policières
et de poursuites judiciaires. On comprend facilement la difficulté d’aborder, sous le
format d’un article, une analyse approfondie des nombreuses questions différentes que
ce sujet peut évoquer. Il faut alors mettre quelques limites. Tout d’abord, comme nous
sommes confrontés à deux systèmes légaux différents, il s’avère nécessaire de les
aborder à partir du seul système commun supérieur à tous les deux : la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Conv.
EDH). Par conséquent, l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
329
l’affaire S. et Marper contre Royaume-Uni, du 4 décembre 2008 (I), s’avère
incontournable en raison de son impact direct sur notre sujet. À partir de ce point de
vue, l’étude veut souligner quelques aspects directement liés au droit fondamental à la
vie privée, y compris le droit à la protection des données personnelles, puis qu’ils sont
les droits directement touchés par les activités nécessaires à la collecte et au stockage
de l'empreinte ADN et à son traitement dans la base de données. Cela étant dit, les
aspects suivants retiendront l’attention:
11 - Le caractère excessif de l’étendue du domaine objectif et, surtout subjectif des
fichiers, par rapport aux infractions permettant l’inscription et aux personnes devant
se soumettre à l’enregistrement de leurs empreintes génétiques (II).
12 - Les questions soulevées autour du prélèvement biologique sur les personnes soumises
à l'enregistrement obligatoire de leurs empreintes génétiques (III).
13 - Les risques pour le droit à la vie privée résultants des analyses d’ADN et de la
conservation des échantillons biologiques (IV).
14 - Les données à caractère personnel attachées à l’empreinte génétique et leur
traitement au fichier (V).
I. La doctrine de la CEDH : l’affaire S. et Marper contre
Royaume-Uni du 4 décembre 2008
15 À titre préliminaire, rappelons le texte de l’article 8 de la Conv. EDH relative au droit au
respect de la vie privée et familiale :
16 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
17 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui ».
A. Incidence de l’identification par l’ADN dans le droit à la vie privée
18 La Cour rappelle, au paragraphe 66 de l’arrêt S. et Marper, en citant de nombreuses
décisions, que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une
définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne. Elle
peut donc englober de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’un individu :
l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle, ainsi que
d’autres moyens d’identification personnelle et de rattachement à une famille. La Cour
estime en plus que les informations relatives à la santé et à l’identité ethnique d’un
individu doit aussi être considérée comme un élément important de sa vie privée.
L’article 8 de la Convention protège en outre le droit à l’épanouissement personnel et
celui de nouer et de développer des relations avec autrui et le monde extérieur. La
notion de vie privée comprend par ailleurs des éléments se rapportant au droit à
l’image.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
330
19 Après avoir défini le droit à la vie privée, tel que prévu dans l’article 8 de la Conv. EDH,
la Cour déclare que les trois catégories d’informations personnelles conservées par les
autorités au sujet des deux requérants, à savoir des empreintes digitales, des profils
ADN et des échantillons cellulaires, constituent toutes les trois des données à caractère
personnel au sens de la Convention sur la protection des données car elles concernent
des individus identifiés ou identifiables (§ 68). Elle ajoute encore que le simple fait de
mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence
au sens de l’article 8.
20 D’après la Cour, pour déterminer l’incidence de l’identification policière ou judiciaire
par l’ADN, il faut distinguer entre les échantillons biologiques et les profils ou
empreintes génétiques22, puisque leur contenu informationnel et leurs usages
potentiels sont sensiblement différents.
21 Pour ce qui est des échantillons cellulaires, la CEDH prend en considération :
22 a) Que les échantillons cellulaires renferment un code génétique unique qui revêt une
grande importance, tant pour la personne concernée que pour les membres de sa
famille. Ils contiennent beaucoup d’informations sensibles sur un individu, notamment
sur sa santé et l’origine ethnique des personnes.
23 b) Les usages futurs que l’on pourrait envisager pour les échantillons cellulaires.
Compte tenu du rythme élevé auquel se succèdent les innovations dans le domaine de
la génétique et des technologies de l’information, on ne peut pas exclure la possibilité
que les éléments de la vie privée liés aux informations génétiques fassent à l’avenir
l’objet d’atteintes par des voies nouvelles, que l’on ne peut pas prévoir aujourd’hui avec
précision.
24 Cela étant, la Cour conclut que « vu la nature et la quantité des informations
personnelles contenues dans les échantillons cellulaires, leur conservation doit passer
par constituer en soi une atteinte au droit au respect de la vie privée des individus
concernés. Peu importe que seule une petite partie de ces informations soit en réalité
extraite ou utilisée par les autorités pour les besoins de la création de profils ADN et
qu’aucun préjudice immédiat ne soit provoqué dans un cas particulier » (§§ 70 à 73).
25 Concernant les profils ADN, la Cour met en balance :
26 a) d’un côté, qu’ils contiennent moins d’informations personnelles que les échantillons,
et que ceux-là sont présentées sous la forme d’un code, une séquence de chiffres ou un
code-barres, contenant des informations purement objectives et irréfutables et que
l’identification d’une personne ne se produit qu’en cas de concordance avec un profil
contenu dans la base de données.
27 b) de l’autre, qu’il y a dans les profils une quantité importante de données à caractère
personnel, dont le traitement automatisé permet aux autorités d’aller bien au-delà
d’une identification neutre de la personne. La Cour attire l’attention sur deux
questions : la première, que les profils ADN peuvent être utilisés – et l’ont été dans
certains cas – pour effectuer des recherches familiales en vue de déceler un éventuel
lien génétique entre les individus ; la seconde, que le traitement des profils ADN permet
aux autorités de se faire une idée de l’origine ethnique probable du donneur et que
cette technique est effectivement utilisée dans le cadre des enquêtes policières. En
conséquence, la potentialité des empreintes génétiques pour fournir un moyen de
découvrir soit les relations génétiques pouvant exister entre des individus, soit
l’origine ethnique des individus23, suffit en soi pour conclure que leur conservation
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
331
constitue une atteinte au droit à la vie privée. De même, le fait que, l’information étant
codée, elle ne soit intelligible qu’à l’aide de l’informatique et ne puisse être interprétée
que par un nombre restreint de personnes ne change rien à cette conclusion (§§ 74 à
77).
B. Les conditions d’une ingérence conforme à la Convention
28 Classiquement, l’identification à partir de l’ADN peut devenir une ingérence
respectueuse de la Convention si :
29 1°) L’ingérence prévue par la loi. À ce sujet, après avoir mentionné les règles générales, la
Cour assimile la problématique de l’identification par empreintes digitales et
empreintes génétiques à celle des écoutes téléphoniques, de la surveillance secrète et
de la collecte secrète de renseignements. Dans tous ces cas, il est essentiel de fixer des
règles claires et détaillées régissant la portée et l’application des mesures et imposant
un minimum d’exigences concernant, notamment, la durée, le stockage, l’utilisation,
l’accès des tiers, les procédures destinées à préserver l’intégrité et la confidentialité des
données et les procédures de destruction de celles-ci, de manière à ce que les
justiciables disposent de garanties suffisantes contre les risques d’abus et d’arbitraire.
Pourtant, la Cour ne va pas plus loin à ce sujet ; elle résout cette question en se référant
aux exigences d’une société démocratique (§ 99).
30 2°) Le but poursuivie est légitime. La Cour admet que la conservation des données relatives
aux empreintes digitales et génétiques vise un but légitime : « la détection et, par voie
de conséquence, la prévention des infractions pénales ». Ces termes semblent quelque
peu imprécis. On pourrait parler plutôt de « détection des auteurs des infractions ».
Quant à la prévention, de l’existence du fichier ne découle aucun avantage particulier,
hormis que l’individu condamné à une peine privative de liberté, ne pourra pas
commettre de nouveaux crimes ou délits pendant l’exécution de la durée de la peine.
C’est peut-être pour cela que la Cour précise, toute suite, que « le prélèvement initial
est destiné à relier une personne donnée à l’infraction particulière qu’elle est
soupçonnée d’avoir commise, la conservation tend à un objectif plus large, à savoir,
contribuer à l’identification des futurs délinquants » (§ 100).
31 Le but légitime apparaît plus clair quand la Cour nous dit qu’ « il est hors de doute que
la lutte contre la criminalité, et notamment contre le crime organisé et le terrorisme,
qui constitue l’un des défis auxquels les sociétés européennes doivent faire face à
l’heure actuelle, dépend dans une large mesure de l’utilisation des techniques
scientifiques modernes d’enquête et d’identification »24 (§ 105).
32 3°) La nécessité de l’ingérence dans une société démocratique. Le principe découlant de la
Conv. EDH détermine qu’une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une
société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin
social impérieux » et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi
et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
« pertinents et suffisants » (§ 101)25. C’est en l’espèce sur ce point que la Cour va se
fonder.
33 Ainsi, après l’analyse de tous les points antérieurs, la Cour se réfère « à la question plus
large de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique ». Elle se concentre
sur le fait de savoir si la conservation des empreintes digitales et données ADN des
requérants, qui avaient été soupçonnés d’avoir commis certaines infractions pénales,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
332
mais n’avaient pas été condamnés, était justifiée sous l’angle de l’article 8.2 de la
Convention (§§ 99 et 106). Il est possible de tirer des règles générales à partir de la
décision particulière, compte tenu des analyses globales qui la précèdent.
34 Pour statuer, la Cour adopte trois lignes directrices:
35 1°) L’examen de la pratique en vigueur dans les autres Etats contractants. La plupart des États
n’autorisent le prélèvement dans le cadre de procédures pénales que sur les individus
soupçonnés d’avoir commis des infractions présentant un certain seuil de gravité.
D’ailleurs, les échantillons et les profils génétiques qui en sont tirés doivent être
respectivement détruits ou effacés soit immédiatement soit dans un certain délai après
un acquittement ou un non-lieu. Certains États autorisent un nombre restreint
d’exceptions à ce principe (§ 108).
36 2°) L’identification des instruments pertinents du Conseil de l’Europe. La Cour relève d’une
part, que la Recommandation no R (92) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
insiste sur la nécessité d’établir des distinctions entre les différents types de cas et
d’appliquer des durées précises de conservation des données, même dans les cas les
plus graves (§ 109). D’autre part, lorsqu’il s’agit de protéger des données à caractère
personnel soumises à un traitement automatique et utilisées à des fins policières, il faut
respecter les garanties spéciales prévues par la Convention du Conseil de l’Europe de
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, ainsi que par la Recommandation no R (87) 15 du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe visant à règlementer l’utilisation de données à
caractère personnel dans le secteur de la police (§ 103)
37 3°) L’appréciation de la proportionnalité entre le but poursuivi et le sacrifice imposé au droit à la
vie privée. La Cour remarque que la protection offerte par l’article 8 de la Convention
serait affaiblie de manière inacceptable si l’usage des techniques scientifiques
modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n’importe quel prix et
sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d’un large recours à
ces techniques, d’une part, et des intérêts essentiels s’attachant à la protection de la vie
privée, d’autre part. Elle admet que l’élargissement de la base de données a contribué à
la détection et à la prévention des infractions pénales. Il reste toutefois à déterminer si
une telle conservation est proportionnée et reflète un juste équilibre entre les intérêts
publics et privés qui se trouvent en concurrence (§§ 112, 117 et 118).
38 Avec ces prémisses, l’expression utilisée pour statuer sur les plaintes des requérants est
significative : « la Cour est frappée ». On peut la lire au paragraphe 119 à partir duquel
s’expriment les raisons pour condamner l’État défendeur:
39 a) Il était possible, en l’espèce, de prélever des empreintes digitales et échantillons
biologiques, puis de les conserver indéfiniment, ainsi que les données à caractère
personnel en tirés, chez toute personne, quel que soit son âge, arrêtée pour une
infraction emportant inscription dans les fichiers de la police, indépendamment de la
nature ou de la gravité de l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise.
40 b) La conservation ou la mémorisation des données à caractère personnel par les
autorités publiques, qu’elles les utilisent ou non par la suite, emporte des conséquences
directes sur la vie privée de l’individu. Il est particulièrement intrusif de conserver des
échantillons cellulaires, compte tenue de la profusion d’informations génétiques qu’ils
contiennent.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
333
41 c) Le législateur n’a pas prévu l’exercice d’un contrôle indépendant, hors des autorités
gouvernementales, pour décider de la conservation ou de la destruction des
échantillons et de l’inscription ou de l’effacement de données de la base nationale.
42 d) Puisque la conservation des données privées n’équivaut pas à l’expression de
soupçons contraires au droit à la présomption d’innocence, la Cour montre sa
préoccupation pour le risque de stigmatisation qui découle du fait de mettre les
personnes bénéficiant d’une décision d’acquittement ou de classement sans suite sur un
pied d’égalité avec les personnes condamnées pour un crime ou délit. En ce sens, la
Cour met l’accent sur le préjudice que cette situation peut provoquer chez les mineurs,
dès lors qu’on méconnaît l’importance que revêt leur développement et leur
intégration dans la société.
43 En conclusion, la Cour affirme qu’il n’existe pas un juste équilibre entre les intérêts
publics et privés concurrents en jeu. Elle estime que l’Etat défendeur a outrepassé toute
marge d’appréciation acceptable en la matière et, en conséquence, qu’il a donné lieu à
une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée qui
ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (§ 125).
II. L’étendue excessive du domaine d’application des
fichiers des empreintes génétiques
44 Pour bien comprendre ce point, il faut distinguer les infractions justifiant l’inscription
(A) et la qualité des personnes soumises à l’inscription, au regard des infractions
commises (B). Parler de soumission à l‘inscription implique que l’on nie la nécessité
d’un consentement à l’inscription. Toutefois, il existe aussi la possibilité d’un
enregistrement consenti. On remarquera que le champ d’application des fichiers
étudiés en étude dépasse le cadre délimité par la CEDH, tout particulièrement dans le
système espagnol.
A. Les infractions justifiant l’inscription
45 A ce sujet, la différence entre les systèmes français et espagnols est remarquable. En
France, pour déterminer le domaine infractionnel du FANEG, la loi a adopté un régime
fermé qui, après avoir mentionné les catégories délictuelles concernées, précise chaque
disposition particulière du code pénal dont l’infraction permettra l’inscription 26. La loi
espagnole est beaucoup plus ouverte. Elle utilise des critères absolument généraux 27 : la
gravité de l’infraction, d’un côté, et quelques catégories particulières, indépendamment
de leur gravité, d’un autre côté, combinées avec une modalité spéciale de commission
de l’infraction, à savoir la délinquance organisée. Si en France, on a bien mis en cause
l’élargissement progressif du fichier, en Espagne, la liste résultant de la loi 10/2007 est
plus large qu’en France, ce qui a fait l’objet de critiques.
46 Par rapport à la doctrine de la CEDH, il semble que le système espagnol réponde mieux
au test de proportionnalité (équilibre entre les moyens et la fin dans une société
démocratique), car il combine deux critères principaux, l'un relatif à la gravité de
l'infraction, et l'autre à la protection des biens juridiques personnels, avec la
dangerosité présumée du crime organisé. Malgré cela, le critère de la gravité de
l’infraction fait perdre au système espagnol le lien avec la finalité du fichier établi dans
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
334
la mesure où il permet l’inscription pour des délits où l’existence de traces biologiques
est improbable, voire inefficace pour la recherche. Ce lien manque aussi quelquefois
dans la loi française. Néanmoins, le système français, fondé sur l'exhaustivité, se
conforme mieux aux exigences du principe de légalité (ingérence prévue par la loi).
B. Personnes devant se soumettre à l’enregistrement de leurs
empreintes génétiques dans le fichier
47 En France, l’article 706-54 CPP, toujours en lien aux infractions mentionnées à l’article
706-55, définit les cas d’inscription obligatoire des profils ADN. Il s’agit : a) des
personnes déclarées coupables ; b) des personnes poursuivies ayant fait l'objet d'une
décision d'irresponsabilité pénale28 ; c) des personnes à l'encontre desquelles il existe
des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une
des infractions mentionnées par la loi29.
48 En Espagne, conformément à l’article 3 de la loi précitée, l’inscription dans le fichier les
empreintes génétiques de toute personne suspecte, en garde à vue, ou mise en examen
pour les infractions mentionnées dans cet article, sont de droit. Le système espagnol est
donc plus flexible que le système français. Il ne fait pas la différence entre les
personnes condamnées et les personnes suspectées, et parmi ces derniers, il n’existe
pas non plus de différence entre les personnes simplement suspectées et les personnes
largement suspectées30. La loi française ne permet pas d’inscrire le profil du simple
suspect, lequel ne pourra faire l’objet que d’un rapprochement entre son profil
génétique et les profils stockés dans le fichier31. Au contraire, le système espagnol
entraîne un grand risque d’inscriptions injustifiées, compte tenu du fait que, dans les
premiers moments de toute recherche criminelle, on peut trouver des raisons pour
soupçonner plusieurs personnes à l’encontre desquelles la police judiciaire a été tenue
d’obtenir le profil génétique, même lorsque les soupçons ont été tout de suite dissipés.
Il y a tant de controverses à ce sujet que la Comisión Nacional para el uso forense del ADN
(Commission nationale pour l’usage médico-légal de l’ADN - CNUFADN) a fini par
exclure le simple suspect du formulaire établi pour obtenir le consentement au
prélèvement32.
49 En ce sens aussi, il faut souligner une autre grande différence à propos des personnes
suspectées. En droit français, leurs empreintes sont effacées sur instruction du
procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé,
lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier (article 706-54 alinéa 2 CPP). Bien qu’on approfondira plus tard cette question,
on peut déjà affirmer qu’en Espagne les empreintes génétiques des personnes
suspectées demeureront dans le fichier pendant tout le temps nécessaire jusqu’à la
prescription du crime ou délit, sauf s’il y a eu une ordonnance définitive de non-lieu ou
un acquittement par jugement définitif. Mais, en pratique, presque toutes les décisions
de non-lieu adoptent un caractère provisoire. En conséquence, il est assez improbable
d’obtenir l’effacement du profil avant ledit délai.
50 En France, comme en Espagne, pour ces personnes que nous venons de qualifier de
« soumises aux fichiers », l’inscription d’un profil génétique dans le fichier n’exige pas
le consentement. Si cela n’est pas expressément affirmé dans le CPP français, on peut
toutefois conclure en ce sens car : 1°) le CPP ne contient aucune norme exigeant le
consentement des personnes déclarées coupables ou largement suspectées 33 ; 2°) il
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
335
prévoit que « les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des
personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le
fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés » (art.
706-54, alinéa 4 ; 2º). Il est alors entendu, a contrario, que le consentement des personnes
condamnées ou largement suspectées n’est pas nécessaire ; 3°) il existe une sanction en
cas de refus au prélèvement nécessaire pour obtenir l’empreinte génétique (infra).
51 En Espagne, l’article 3 de la LO 10/2007 essaie de mettre en évidence la distinction entre
inscription obligatoire et inscription librement consentie:
52 D’un côté, le consentement n’est pas nécessaire pour enregistrer les données
signalétiques fournies par l’ADN concernant les personnes soupçonnées, en garde vue
ou mises en examen, ni, non plus, pour les mêmes données obtenues dans les processus
d’identification de dépouilles ou pour la recherche des personnes disparues 34 (§ 1).
53 D’un autre côté, on permet l’inscription des données signalétiques obtenues à partir de
l’ADN quand la personne concernée prête son consentement exprès (§ 2).
54 Aux cas où le consentement de la personne concernée est nécessaire pour
l’enregistrement de son profil génétique, il faut remarquer que rien n’a été prévu sur le
contenu de l’information à fournir à cette personne. On ne peut estimer être devant un
consentement éclairé, si aucune précision n’est fournie sur la finalité du fichage, la
durée de celui-ci, les droits d’accès, la rectification, l’effacement, etc. En France, au
moins, la partie règlementaire du CPP impose l’accord de la personne intéressée pour
l’inscription, mais aussi pour le rapprochement de son empreinte génétique avec
l’ensemble des traces et des empreintes enregistrées35, tous les deux pouvant être
vérifiés au procès-verbal. De son côté, paradoxalement, la loi espagnole mentionne le
devoir d’information seulement pour les individus qui ne peuvent consentir au fichage
(article 3.1 in fine LO 10/2007)36 . On pourrait alors reformuler l’expression
« consentement éclairé », en « information sans accord ».
55 Compte tenu de ce qui précède, il est hors de doute que le droit espagnol ne respecte
pas la Conv. EDH car il ne fait pas de distinction entre les personnes condamnées 37 et
soupçonnées, comme il ne la fait pas non plus sur l’étendue du soupçon. Par
conséquent, le risque de stigmatisation relevé par la CEDH se révèle évident dans la loi
espagnole. Dans le cas des personnes simplement suspectées, le droit français permet,
uniquement, le rapprochement de leurs empreintes génétiques avec celles stockées
dans le fichier. Cependant, une question troublante se dégage de cette disposition de la
loi française: si le simple soupçon concerne un crime ou un délit particulier, ne serait-il
pas plus raisonnable de comparer l’empreinte génétique du suspect avec celles issues
des traces biologiques rencontrées sur la scène de l’infraction 38? Il semble plutôt que le
législateur utilise le soupçon comme une excuse pour faire un balayage général sur la
personne suspectée. A notre avis, cette prévision porte atteinte à la présomption
d’innocence, bien que la Cour n’ait pas approfondi la question. Ce reproche est encore
plus fort au sujet de la loi espagnole, puisqu’elle oblige à l’inscription du profil
génétique du simple suspect.
56 Il existe encore un autre point où les systèmes juridiques espagnol et français
contreviennent explicitement la jurisprudence de la CEDH. Il s’agit de celui du cas
particulier des mineurs, étant donné que le risque de stigmatisation est plus fort à leur
sujet. L’attention particulière exigée par la Cour est ignorée, même en France, où le
Conseil Constitutionnel39 a déjà tranché sur cette question. Or, me besoin d’un
traitement différent pour les mineurs se dégage de l’article 40 de la Convention des
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
336
Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui énonce que tout
enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale a le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés
fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de
faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au
sein de celle-ci.
57 Finalement, il manque dans les deux systèmes, mais surtout dans le système espagnol,
une définition plus précise de l’information à fournir à toutes les personnes concernées
par le fichage de leurs empreintes génétiques, afin qu’elles puissent exercer les droits
qui leur sont reconnus par les lois, en particulier l’accès aux fichiers, à la rectification
et à l’effacement des données à caractère personnel.
III. Les questions soulevées par le prélèvement
biologique
58 En France, comme en Espagne, l’inviolabilité du corps humain était très certainement
dans l’esprit initial des rédacteurs des textes législatifs 40, lorsqu’ils ont abordé la
question de l’identification par l'ADN puisqu’il était nécessaire d’effectuer une prise de
sang sur la personne concernée. Actuellement, en raison du progrès scientifique, on
identifie une certaine divergence dans l’interprétation de la question entre les deux
pays. En effet, l’utilisation de kits de prélèvements buccaux permet d’obtenir le
matériau biologique nécessaire pour l’expertise d’ADN avec une simple opération:
frotter un bâtonnet muni d’un embout en mousse humidifié de salive sur la paroi
interne de la bouche, opération que peuvent même faire les officiers de police
judiciaire. Cette méthode ne porte pas atteinte à l’intégrité physique, ni à la dignité de
la personne concernée. En tout état de cause, en France cette question reste
étroitement liée à l’intégrité du corps humain ; elle est fondée sur la protection
juridique des droits de la personnalité, entendue au sens des articles 16.1 et 16.11 41. En
Espagne, l'absence d’une telle approche générale liée à la personnalité, ainsi que
l’innocuité des techniques actuelles pour obtenir des échantillons biologiques, a
conduit à questionner les implications sur le droit à l'intégrité physique 42. Certains
auteurs estiment qu’il existe une ingérence à ce droit fondamental, mais par le biais du
principe général de liberté individuel dont découle le besoin du consentement de
l’intéressé43. Il reste que la virtualité d’une atteinte au droit fondamental à l'intégrité
physique reste présente en raison de l'utilisation de la force physique pour vaincre la
résistance de la personne qui refuserait de fournir un échantillon biologique.
A. Les différentes modalités de prélèvement biologique: intrusif,
externe et résiduel
59 Selon l’article 706-56 CPP, « L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire
procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au
deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique
destiné à permettre l'analyse d'identification de leurs empreintes génétiques ». Puis il
est ajouté : « Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur
une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
337
génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement
détaché du corps de l’intéressé ». Certains parlent ici de « procédure de l’ADN
résiduel »44. Le CPP prévoit, à l’article 55.1, une troisième modalité de prélèvement dit
« externe » à propos de la règlementation de l’enquête des crimes et des délits
flagrants45.
60 Il n’existe aucune difficulté pour caractériser le prélèvement résiduel : il ne faut pas
toucher le corps. Ce prélèvement ne nécessite pas la collaboration de la personne dont
l’empreinte génétique doit être enregistrée (ou rapprochée du) au fichier. Le problème
que ce système pose est d’assurer l’authenticité de l’échantillon et sa correspondance
avec la personne à laquelle il a été attribué. C’est le seul moyen d’assurer la
correspondance entre l’empreinte génétique résultant de l’analyse et l’identité qui lui a
été assignée. En ce sens, une personne qui a refusé le prélèvement devra finalement s’y
soumettre au moment de démontrer que l’empreinte génétique enregistrée ne lui
appartenait pas. Bien entendu, il s’agit toujours de personnes pleinement identifiées.
S’agissant du matériau biologique séparé naturellement du corps, mais dont on ne
connaît pas la provenance, il faudrait parler de traces. Dans ce cas, l’empreinte
génétique sera également inscrite, mais elle ne sera pas liée à l’identité d’une personne.
61 Il reste alors la question de différencier les adjectifs « biologique » et « externe »
attachés au concept de « prélèvement »46. La réponse est, à notre avis, que le premier
entraîne une notion plus large que le second, celui-ci étant donc compris dans celui-là.
On peut ainsi conclure dans le sens de la Décision du Conseil constitutionnel nº
2003-467 du 13 de mars 2003 dont le considérant 55 déclare « que l'expression
« prélèvement externe » fait référence à un prélèvement n'impliquant aucune
intervention corporelle interne; qu'il ne comportera donc aucun procédé douloureux,
intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés; que manque dès lors en fait le moyen
tiré de l'atteinte à l'inviolabilité du corps humain; que le prélèvement externe n'affecte
pas davantage la liberté individuelle de l'intéressé»47. Le prélèvement externe est aussi
un prélèvement biologique, mais ce dernier terme comprend également les méthodes
intrusives ou impliquant une intervention corporelle interne, telle qu’une prise de
sang.
62 La Loi espagnole 10/2007 emploie, à ce sujet, l’expression « prise d’échantillons »
(troisième disposition additionnelle). On pourrait en faire découler une référence
implicite aux méthodes « résiduelles »48, « externes » et « invasives » quand elle exige le
consentement de la personne concernée ou l’autorisation judiciaire pour les prises
consistant à une inspection, une reconnaissance ou une intervention corporelle. Pour
sa part, la jurisprudence espagnole est de l’avis que la prise d’échantillons par le biais
des kits buccaux ne comporte pas une ingérence au droit à l’intégrité de la personne ni,
non plus, à sa dignité49.
B. Le consentement au prélèvement biologique, le refus de s’y
soumettre et la question de la contrainte physique
63 En France, s’il est évident que cette matière fait l’objet d’une règlementation rigoureuse
à l’article 706-56 CPP, cela n’implique pas l’absence de tout problème 50. La loi française
ne trouve pas de correspondance avec la loi espagnole qui, comme nous allons le voir,
reste confuse.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
338
64 Ainsi, du cadre de l’article 706-56 du CPP français, on peut retenir les
conclusions suivantes:
65 1°) Le prélèvement biologique vise directement à obtenir l’empreinte génétique des
personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article
706-5451 ;
66 2°) Dès lors qu’il est probable que le profil de la personne concernée soit déjà
enregistré, la loi prévoit explicitement une vérification préalable pour éviter le
prélèvement 52 ;
67 3°) Le prélèvement (externe ou invasif) doit se faire avec le consentement de l’individu
concerné, c’est-à-dire, des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au
troisième alinéa de l’article 706-5453. Néanmoins, ce consentement n’est pas nécessaire
s'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni
de dix ans d'emprisonnement ou plus, même si cette personne a fait l’objet d’une
décision d’irresponsabilité pénale (art 706-120, 706.125, 706-129, 706-133 ou 706-134). À
propos de cette exception, une question essentielle se pose toute suite : l’utilisation de
la contrainte physique est-elle possible pour venir à bout de la résistance du sujet
insoumis? La réponse ne peut être que négative : l’emploi de la force n’est pas permis
en France au regard de l’article 16-1 du code civil54. C’est pour cela que la loi punit le
refus de se soumettre au prélèvement et qu’elle prévoit aussi le prélèvement résiduel.
En effet, le refus de se soumettre au prélèvement est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende ; la peine est plus forte lorsque ces faits sont commis par une
personne condamnée pour crime, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende55. Si, malgré cette contrainte pénale, la personne persiste dans son refus,
l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel
biologique qui se serait naturellement détaché de son corps. Une autre question peut
être alors posée : l’identification de l’empreinte génétique par le biais de ce procédé
empêche-t-elle la poursuite pour délit de refus de se soumettre au prélèvement? Il
semble que la loi veuille punir en tout état de cause le refus, puisqu’elle sépare dans
deux alinéas différents, la règlementation du prélèvement et les conséquences d’en
refuser la réalisation56.
68 4°) La prévention contre le risque de manipulation de la part de la personne faisant
l’objet d’un prélèvement est remarquable57, bien qu’une telle manipulation est très
difficile avec les techniques actuelles, se limitant à l’obtention de salive dans la cavité
buccale.
69 Pour sa part, la loi espagnole, LO 10/2007, fait une seule référence à la « prise des
échantillons » (troisième disposition additionnelle): « Pour la recherche des délits
énumérés à la lettre a) de l’alinéa 1 de l’article 3, la police judiciaire procédera à la
collecte des échantillons et fluides de l’individu suspecté, en garde vue ou mis en
examen ; ainsi que du lieu du délit ». À partir de ce libellé, la collecte des échantillons
biologiques ainsi que celles obtenues d’un prélèvement, sont liées, par la loi, à la
recherche de l’auteur de l’infraction, et non pas à l’inscription au fichier, de sorte que si
on n’avait pas besoin d’analyser l’ADN pour résoudre cette recherche, il n’est pas
nécessaire d’obtenir d’empreintes génétiques. À vrai dire, il n’y a dans la loi aucun lien
entre l’article 3, qui règlemente l’enregistrement, et la disposition additionnelle
troisième, prévue pour la collecte des échantillons. Les expressions employées dans
chaque disposition sont même différentes, à savoir, respectivement, « dans le cadre
d’une recherche criminelle » et « pour la recherche des délits ». En dépit de cette clarté,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
339
la pratique policière agit toujours comme si le but du prélèvement était le fichage et
non pas la recherche de l’auteur de l’infraction58.
70 Le prélèvement exige aussi, dans le système espagnol, le consentement de la personne
concernée. Si elle ne le prêtait pas, l’autorisation judiciaire serait nécessaire en cas
d’inspection, de reconnaissance ou d’intervention corporelle59. Pourtant, à l’exception
de quelques auteurs60, l’opinion doctrinale majoritaire et la jurisprudence ne
conçoivent pas que la loi rende possible l’emploi de la force physique, même si le sujet
concerné ne prête pas sa collaboration après l’autorisation judiciaire 61. Comme on
l’avait déjà annoncé, la loi espagnole manque d’une règlementation particulière sur le
refus de se soumettre au prélèvement62. Rien n’a été prévu non plus pour vérifier au
préalable si l'empreinte génétique de la personne concernée a déjà été enregistrée.
71 L’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni ne se prononce pas sur la problématique du
prélèvement qui ne faisait pas partie des plaintes des requérants. En tout état de cause,
le consentement est requis pour toute action de la nature analysée et, à défaut,
l’autorisation judiciaire ou la réquisition du Procureur de la République. Du point de
vue du droit à la vie privée, et compte tenu de ce que tout prélèvement vise à obtenir
une empreinte génétique destinée au fichier, pour considérer si le consentement est
valablement donné, il faudrait informer clairement de la finalité du prélèvement et des
conséquences juridiques qui en découlent. Or, rien de particulier n’a été prévu par les
lois des deux pays63. D’ailleurs, fait également défaut une loi permettant d’une manière
expresse et claire l’utilisation de la contrainte physique, dont l’emploi, au regard de la
règlementation en vigueur64, impliquerait une ingérence au droit à l’intégrité physique
reconnu à l’article 3 Conv. EDH65. Enfin, en France comme en Espagne, l’absence d’une
règle particulière sur le consentement au prélèvement chez les mineurs est très
critiquable : il faudrait pouvoir mesurer leur maturité et compléter ou substituer leur
décision avec l’assistance du représentant légal.
IV. Les analyses d’ADN et la conservation des
échantillons biologiques : leurs risques pour le droit à
la vie privée
72 « La question ‘Que doit-on savoir sur qui à travers les fichiers génétiques ?’ est
inséparable de ‘ Que peut-on savoir au stade actuel de la science ?’ et ‘Comment sait-on?
Quels outils, vecteurs et archives? Comment exploiter cette connaissance?’» 66.
73 L’obtention d’une empreinte génétique implique nécessairement une activité
scientifique et technique qui est projetée sur un échantillon biologique, dont l’ADN
devra être analysé par un expert. Deux risques principaux se dégagent de cette activité
médico-légale. D’une part, exploiter l’analyse pour extraire de l’ADN plus
d’informations que celles strictement utiles à déterminer le profil génétique. D’autre
part, allouer les échantillons biologiques à des fins illégitimes. Compte tenu du
développement vertigineux du génie génétique, il semble très raisonnable de mettre
l’accent sur la prévention et l’élimination de ces risques. La CEDH avait souligné les
risques exposés ressortissants de la conservation des échantillons et de la réalisation
des analyses de l’ADN, et surtout la possibilité de leur exploitation à mauvais escient.
Par conséquent, elle exigeait des États des mesures certaines et suffisantes pour éviter
ces risques et sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées. Il faut
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
340
mettre en évidence la possibilité d’atteintes au droit à l’intimité personnelle, en
particulier l’« intimité corporelle », qui comprend ce que l’on appelle l’« intimité
génétique »67, dans la mesure où il est possible d’avoir accès à toute l’information
personnelle contenue dans l’ADN avec les analyses (et la conservation des échantillons
biologiques permettra de le faire pendant toute la durée de conservation).
74 Pour ce qui est des analyses, la formule contenue à l’article 706-54 CPP est stricte : « les
empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir
de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment
correspondant au marqueur du sexe »68. L’article R53-13 CPP précise que « le nombre et
la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses
d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer
les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes
génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ». En outre du CPP, il faut aussi
prendre en compte le principe plus général, mais qui s’applique ici, contenu à l’article
16-12 du Code civil français : « sont seules habilitées à procéder à des identifications
par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans le cadre d'une procédure judiciaire,
ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires ». Le
décret nº 97-109 du 6 février 1997 développe ces prescriptions légales. Il a créé une
commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions
d’identification par empreintes génétiques, soit dans le cadre d’une procédure
judiciaire, soit en vue d’un enregistrement au FNAEG. Cette « Commission d’Agrément »
est présidée par un Magistrat. Sous réquisition du ou de la Garde des Sceaux, ministre
de la Justice, la Commission a pour mission de donner son avis sur les questions
relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses d’identification par l’ADN 69.
75 En ce qui concerne la conservation des échantillons biologiques, le décret n° 200-413,
du 18 mai 200070 crée le Service central de préservation des prélèvements biologiques
(SCPPB), géré par l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ce
service devait conserver les traces et les prélèvements biologiques pendant quarante
ans. Toutefois, des raisons économiques ont imposé la seule conservation des traces,
mais pas des prélèvements (modification introduite par le décret du 27 mai 2004) 71. On
remarquera par ailleurs que le SCPPB (comme le même FNAEG) est placé sous contrôle
d’un magistrat72.
76 Ces matières restent plus imprécises en Espagne dans la mesure où la LO 10/2007 se
limite à indiquer : « Les identificateurs obtenus à partir de l’ADN ne pourront s'inscrire
dans la base de données de la police règlementée par la présente loi que dans le cadre
d’une recherche criminelle, concernant exclusivement des informations génétiques
révélatrices de l’identité de la personne et de son sexe » (art. 4). À cet égard, il manque
une interdiction incontestable d’analyser l’ADN codant. Pris mot à mot, il en découle
une simple censure de l’information provenant des analyses, hors des indications
légales. Par rapport aux experts habilités, la loi espagnole prévoit simplement que « les
analyses de l’ADN pour l’identification génétique dans les cas prévus ne peuvent être
effectuées que par les laboratoires accrédités à ce but par la « Commission nationale
pour l’usage médico-légal de l’ADN » (article 5.2). Le décret du 11 décembre 2008 a créé
cette Commission, sous la présidence du Directeur général des rapports avec
l’Administration de la Justice. Il n’est pas prévu que l’on puisse demander l’avis de cette
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
341
Commission, bien qu’elle puisse formuler des propositions aux ministères de l’Intérieur
et de la Justice à propos de l’efficacité de la recherche criminelle et l’identification de
cadavres.
77 Sur la conservation des échantillons, la loi espagnole stipule que « l’autorité judiciaire a
pour tâche de se prononcer sur l’ultérieure conservation des échantillons ou vestiges
biologiques ». Cette disposition est placée juste après l’endroit où la loi prévoit que « les
échantillons et vestiges seront remis aux laboratoires dûment accrédités pour faire les
analyses » (article 5.1). Il en découle que ce sont ces mêmes laboratoires qui doivent
conserver le matériel biologique. Mais il manque toute autre précision à propos du
temps de conservation, de la procédure pour la décision judiciaire, des critères pour
ordonner la conservation ou destruction, des garanties ou mesures de sécurité, etc. 73.
78 Si l’on revient à la jurisprudence de la Cour EDH, il est vrai que le droit français et le
droit espagnol ont mis en place des mécanismes d'accréditation par des experts et de
contrôle afin de s'assurer, grâce à des tests de qualité, de l’adéquation de l'analyse à son
but et à sa fiabilité, ainsi que de la confidentialité des données extraites 74.
79 Cela étant, il faut reconnaître que la loi française s’avère plus large et précise, qu’elle
est précisée par des normes règlementaires et, surtout, qu’elle a placé sous contrôle des
magistrats aussi bien la « Commission d’agrément » que le SCPPB. Tous ces éléments
assurent une certaine objectivité et indépendance par rapport au pouvoir
gouvernemental et, par conséquence, un haut degré de protection du droit à la vie
privée. A titre de comparaison, la loi espagnole devrait suivre cet exemple, et au moins
s’engager dans la réglementation de la portée des analyses, de la durée et de la forme
de la conservation des échantillons ; il conviendrait notamment qu’elle définisse aussi
l'intervention judiciaire directe. En l’absence de telles précisions, un décret aurait dû
s’y atteler. Or, le décret du 11 décembre 2008 précité laisse toute liberté à la
Commission qu’il a créé pour régler les aspects techniques, la sécurité et la
confidentialité autour des analyses et des échantillons biologiques.
V. Les données à caractère personnel attachées à
l’empreinte génétique et leur traitement au fichier
80 Nous avons déjà vu qu’une empreinte génétique n’est qu’un code chiffré, un code-
barres qui trouve sa correspondance avec une personne identifiée si l’analyse a été
effectuée sur un prélèvement. Mais ce n’est pas si simple. L’inscription au FNAEG
contient aussi des noms, des prénoms, des dates et des lieux de naissance, et des
filiations des personnes nommément identifiées dont les empreintes génétiques sont
enregistrées. Si l’analyse avait été réalisée sur une trace biologique, on ne pourrait pas
connaître l’identité de la personne à qui elle appartient, seulement le sexe. D’autre
part, et selon les cas, ce ne sont pas les seules informations enregistrées. On en trouve
aussi d’autres concernant la procédure et son état, la nature de l’affaire et, le cas
échéant, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est
pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation, ainsi que les
personnes qui sont intervenus dans le processus d’analyse de l’ADN et d’enregistrement
au fichier75.
81 En Espagne, tout ce qui concerne le contenu, la structure et l'organisation du fichier a
été règlementé par simple ordre du ministère de l’Intérieur, el « Orden INT/1202/2011,
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
342
de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del
Ministerio del Interior »76. À proprement parler, l’ordre ne règlemente pas la Base de
données que la LO 10/2007 prétend créer, mais quatre fichiers policiers indépendants,
bien qu’ils soient expressément attachés aux dispositions de ladite loi. Pour ce qui est
des données à caractère personnel qui font l’objet d’enregistrement, leur quantité et
leur qualité attirent l’attention77. Il s’agit des a) « profils génétiques obtenus à partir
d'échantillons biologiques, qui fournissent des informations exclusivement génétique
révélant l'identité de la personne, le sexe, l'ascendance et les traits physiques externes,
sans que l’on puisse pour autant tirer de ces profils des informations relatives à la santé
des personnes » ; b) des « données signalétiques: description, traits physionomiques et
anthropologiques et données du profil génétique à valeur signalétique » ; c) des
« données concernant des caractéristiques personnelles et l'identité : DNI 78 / NIF 79 /
Passeport, nom et prénom, adresse postale, téléphone, données de filiation,
renseignements familiaux, date et lieu de naissance, âge, sexe, nationalité, lieu de
séjour habituel ».
82 Une spécificité finale de chaque système mérite d’être indiquée. En France, les
opérations de transmission des données au gestionnaire du fichier relève des
magistrats du parquet ou de l’instruction et des officiers de police judiciaire. Tous les
trois peuvent aussi demander de telles opérations aux personnes requises pour réaliser
les analyses de l’ADN (articles R53-18 alinéa 4 et 706-56 alinéa 3 du CPP). En Espagne, la
LO 10/2007 habilite exclusivement la police judiciaire pour la transmission des données
résultant de l’analyse de l’ADN (article 6). Aucune mention n’est faite au Juge
d’Instruction ou au Ministère Fiscal (l’équivalent du Procureur de la République).
83 En vue de la nature des données à caractère personnel pouvant être enregistrées, les
réflexions de la Cour EDH (supra) prennent tout leur sens: « il y a dans les profils une
quantité importante de données à caractère personnel, dont le traitement automatisé
permet aux autorités d’aller bien au-delà d’une identification neutre de la personne ».
Cette idée attire notre attention sur deux points particulièrement inquiétants : la durée
de séjour des données dans le fichier (A) et les moyens mis à disposition des citoyens
pour faire valoir leurs droits à l’encontre de l’enregistrement de leur profil génétique
(B).
A. La durée de conservation des données à caractère personnel
dans le fichier
84 En France, l’article 706-54 du CPP renvoie cette matière à un décret en Conseil d’État,
pris après avis de la CNIL. C’est le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000, modifié à diverses
reprises, qui a développé cette habilitation législative. Malgré le libellé confus de ses
articles R53-14, R53-14-1 et R53-14-2, on peut distinguer deux règles principales et
quelques précisions80.
85 La première règle n’opère pas de distinction entre traces et prélèvements, identifiés ou
non identifiés. Elle établit un délai de quarante ans pendant lequel les informations
enregistrées peuvent être conservées. Cette norme est valable aussi pour les cas où il a
eu une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des
dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Ce délai commence à
compter soit de la demande d'enregistrement, soit du jour où la condamnation est
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
343
devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour
de la condamnation.
86 La seconde règle prévoit un délai de vingt-cinq ans, à compter de la demande
d'enregistrement, pour les informations ressortant des prélèvements concernant les
personnes largement suspectées, si leur effacement n'a pas été ordonné
antérieurement.
87 Il est précisé que a) les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié
enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort sont
effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis l'informant de
l'identification définitive de la personne décédée ; b) que les empreintes génétiques
d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants sont effacées
dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis de découverte de cette
personne. Les parents mentionnés peuvent demander en tout temps l’effacement de
leurs empreintes génétiques, et le Procureur de la République doit faire droit à cette
demande (article R. 53-13-1).
88 Quant à elle, la loi espagnole 10/2007 encadre cette matière en son article 9. On peut en
dégager une règle générale et quelques exceptions pour la « conservation dans la base
de données des identificateurs obtenus à partir de l’ADN ». La règle générale est que la
conservation n’est permise que pendant le temps signalé par la loi pour la prescription
du délit81. Le texte souligne que cette disposition est également valable pour les simples
suspectés, c’est-à-dire, ceux qui n’ont pas été finalement accusés. La exception élargit le
fichage jusqu’à l’annulation des casiers judiciaires, s’il y a eu soit arrêt de
condamnation, soit arrêt d’acquittement pour absence d’imputabilité ou culpabilité,
sauf si le juge décide autrement dans ce dernier cas. La deuxième exception impose
l’annulation de l’inscription dans le cas d’une décision ferme d’acquittement ou de non-
lieu. On trouve aussi d’autres spécificités : a) s’il y a plusieurs enregistrements
concernant une même personne pour des délits différents, les données resteront
inscrites jusqu’à la fin du délai d’annulation le plus large ; b) les données des personnes
décédées sont effacées dès que le gestionnaire de la base connaît le décès ; c) les profils
génétiques provenant de procédures pour l’identification de dépouilles ou de recherche
de personnes disparues, ne sont pas effacés tant qu’ils soient nécessaires au but de la
recherche ; d) les profils provenant de traces resteront pour toujours dans la base, mais
une fois leur identification a été possible, les règles précédentes sont appliquées.
89 Dans ce contexte, la loi espagnole semble plus respectueuse du principe de
proportionnalité que la loi française, car la première relativise la durée de
l’enregistrement en fonction de la gravité des délits et des crimes. En revanche, le droit
français établit les mêmes périodes pour tous les délits et les crimes compris dans le
champ d’application du fichier82. Néanmoins, les deux systèmes se rapprochent quant à
la proportionnalité en prévoyant un délai du fichage plus court pour les personnes non
condamnées. Il reste que, puisque les empreintes génétiques des personnes simplement
suspectées sont exclues du fichier, le respect du principe de proportionnalité s’avère
plus fort en droit français qu’en Espagne. Il y a donc, dans les deux cadres législatifs,
des motifs pour estimer que la conformité à la Conv. EDH n’est pas totale, parce qu’elles
ne respectent pas toutes les indications données par la Cour européenne portant sur la
gravité de l’infraction, ainsi que sur la différenciation entre personnes condamnées et
personnes suspectées.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
344
90 Une fois encore, l’ingérence au droit à la vie privé s’avère plus forte dans la perspective
des mineurs. Si l’enregistrement de leurs empreintes génétiques dans ces fichiers, dans
les mêmes conditions que celles des adultes est déjà discutable, il est plus regrettable
encore, d’assimiler le traitement des données des uns et des autres 83, car cela augmente
le risque de stigmatisation dénoncé par la CEDH.
B. Les droits d’accès, de rectification et d’effacement
91 L’article R53-15 CPP français, sur ce point, opère un rappel de la loi nº 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en stipulant que le
droit d’accès prévu par l’article 34 de cette loi doit s’exercer auprès du directeur central
de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur. Néanmoins, comme nous l’avons déjà
cité, il contient des normes particulières concernant l’effacement: L’une est relative aux
empreintes des personnes largement suspectées, pouvant être effacées sur instruction
du Procureur de la République, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque
leur conservation n’est pas nécessaire au regard de la finalité du fichier. L’autre est liée
aux empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes
dont l'identification est recherchée, par rapport aux procédures de recherche des
causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition, qui doivent être
effacées de droit à la demande de l’intéressé.
92 Les articles R53-13-1 à R53-13-6 CPP prévoient une procédure très simple et très brève
pour statuer sur la demande d’effacement, avec l’intervention du Procureur de la
République, à défaut de réponse ou s’il n' ordonne pas l'effacement, du juge des libertés
et de la détention, et, le cas échéant, du président de la chambre de l'instruction, dont
l’ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle ne satisfait pas, en la
forme, aux exigences légales.
93 Enfin, il convient de souligner que le FNAEG est placé sous le contrôle d'un magistrat du
parquet hors hiérarchie, qui peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de
son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement des
enregistrements illicites. Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du
contrôle qui incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(articles R53-16 et R53-17 CPP).
94 De la même manière, la loi espagnole, à l’article 9, fait écho à la LO 15/1999, du 13
décembre 1999, de protection de données à caractère personnel, pour l’exercice des
droits d’accès, rectification et effacement84, mais, au contraire du droit français ¡ il
n'existe aucune autre disposition ! Pour sa part, l’ordre INT/1202/2011, susmentionné,
se limite à déterminer les gestionnaires des fichiers qui font partie de la base issue de la
loi : les fichiers INT-SAIP et INT-FÉNIX, à la charge de la Secretaría de Estado de Seguridad
(Secrétariat d’État de Sécurité) ; et les fichiers ADN-HUMANITAS et ADN-VERITAS,
gérés par la Comisaría General de Policía Científica (Commissariat général de la Police
scientifique)85.
95 Comme il arrivait à propos des échantillons biologique et analyses d’ADN, on ne peut
pas s’étonner que le droit espagnol ne réponde pas aux exigences découlant de la Conv.
EDH, dès lors que le législateur n’a non plus défini l’exercice d’un véritable contrôle
judiciaire indépendant, hors des autorités gouvernementales, pour décider de
l’inscription ou de l’effacement des données à caractère personnel de la base nationale,
la procédure administrative précédant à l’intervention du juge étant très lourde.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
345
Réflexion finale
96 Pour la Cour EDH il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la
portée et l’application des mesures emportant une ingérence au droit à la vie privée et
familiale. En conséquence, un minimum d’exigences s’impose à notre sujet, concernant
tout le procédé nécessaire pour obtenir et enregistrer une empreinte génétique dans le
fichier, ainsi que le traitement des données à caractère personnel qui en découlent,
notamment la durée, l’utilisation, l’accès des tiers, les procédures destinées à préserver
l’intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci,
de manière à ce que les justiciables disposent de garanties suffisantes contre les risques
d’abus et d’arbitraire (§ 99, S. S. et Marper).
97 À partir de l’analyse des systèmes espagnol et français de collecte et traitement de
données à caractère personnel, en ce qui concerne les échantillons biologiques, les
analyses d’ADN et les empreintes génétiques, le bilan par rapport à la Conv. EDH
penche quelques peu en faveur de la France. Les conclusions successives présentées
tout au long de ce texte permettent de caractériser le système espagnol comme un
système policier ou gouvernemental, sans intervention judiciaire claire et directe, soit
pour le contrôle du propre système, soit pour sauvegarder les droits fondamentaux des
personnes dont les profils génétiques font objet d’un enregistrement. Le système
français, étant placé sous contrôle juridictionnel des magistrats et avec une
réglementation plus précise et large, malgré les défauts soulignés, atteint un meilleur
équilibre entre le but légitime poursuivi avec le FNAEG et la sauvegarde des droits
fondamentaux des personnes concernées, au sein d’une société démocratique.
NOTES
1. « Le terme trace se réfère à ce qui subsiste de visible d’un événement passé et suggère qu’il
serait possible de reconstituer le passage physique de quelqu’un », HUYGUE F. B., ADN et enquêtes
criminelles, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 53.
L’enquête de tout fait délictuel exige de la police judiciaire une tâche fondamentale : la
recherche, la collecte et la préservation de toutes les traces ou indices provenant du délit.
2. On pourrait bien employer l’expression « sphère du crime », plutôt que l’expression « lieu du
crime » pour y inclure toutes les possibilités de trouver les indices matériels, y compris les
biologiques, liés à un délit.
3. En témoignage, l’information parue dans le journal Le Monde du 20 novembre 2013 : « Selon le
procureur de la République de Nanterre, Robert Gelli : « L'ADN mis en évidence sur les douilles
libérées à Libération et à la Société générale, ainsi que sur la portière passager du véhicule de l'otage, est le
même. L'hypothèse d'un auteur unique est donc confirmée. En conséquence, j'ai décidé de me dessaisir des
faits de la Défense et d'enlèvement au profit du procureur de Paris, saisi des faits les plus graves commis au
siège de Libération. » (http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/20/l-adn-confirme-l-
hypothese-d-une-tireur-unique-a-paris-et-a-la-defense_3516863_3224.html).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
346
On peut remarquer que l’analyse de l’ADN des traces recueillies sur les différents lieux révèle
qu’il s’agit d’un seul tireur, ce qui servira à orienter les enquêteurs. En plus, la connaissance de
cette donnée détermine également, du point de vue purement procédural, que le procureur de la
République de Nanterre perde la compétence pour mener l'enquête, qui incombe au procureur de
la République de Paris, où s’est produit le fait le plus grave.
4. Le premier cas où l’identification par l’ADN a été utilisée en Espagne a eu lieu en 1991, pour un
crime de viol. Son résultat permit d’innocenter le suspect, privé de liberté, qui avait été identifié
par la victime. Vid. ALONSO ALONSO A., « Una década de perfiles de ADN en la investigación
penal y civil en España: la necesidad de una regulación legal », Estudios de Derecho Judicial, nº 36,
CGPJ, 2001., 2001, p. 72.
5. En France, le premier procès pénal résolu grâce à l’identification par l’ADN fut l’affaire
Dickinson qui a eu lieu en 1996. Comme il était arrivé dans le cas espagnol, un premier suspect
emprisonné fut innocenté par la preuve par l’ADN ; le véritable meurtrier serait, par hasard,
arrêté cinq ans plus tard, aux États-Unis, puis extradé et jugé en France ; v. HEMON, Helene et
TANNEAU Michel, L’affaire Dickinson, une enquête hors du commun, Éditions Apogée, 2005.
6. Non seulement pour trouver les coupables, mais aussi pour innocenter des personnes
suspectées, comme il est arrivé précisément aux premiers cas résolus en Espagne et en France
par le biais de l’ADN.
7. AMBROISE-CASTEROT C., « Les empreintes génétiques en procédure pénale », in Les droits et le
Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Paris, Dalloz, 2007, pp. 22 et 23.
8. Le degré de conviction fourni par cette activité de comparaison dépendra du lien rationnel
entre l’événement affirmé à partir de l’analyse ADN et l’hypothèse de fait de la norme pénale,
compte tenue de la nature de la trace et des circonstances de leur découverte. Le résultat négatif
de l’activité de comparaison, pourtant, n’exige pas de porter un « jugement sur la gradation »
relatif à la conviction : il entraînerait directement l’acquittement, bien sûr, s’il n’y avait pas
d’autres indices de culpabilité. V. SOTELO MUÑOZ H., La identificación del imputado , Tirant lo
Blanch, 2009, p. 89.
9. En ce sens, DEMARCHI J.-M., Les preuves scientifiques et le procès pénal, LDGJ, Lextenso éditions,
2012, p. 188 ; DE HOYOS SANCH, M., « Archivo y conservación en ficheros policiales de muestras
biológicas y perfiles de ADN », Estudios de Derecho Judicial, nº 155, CGPJ, 2009, p. 2.
10. V. VALICOURT DE SÉRANVILLERS H., « La preuve par l’ADN et l’erreur judiciaire ;
L’Harmattan, 2009. L’auteur va jusqu’à qualifier la preuve par l’ADN d’ « ordalie » de notre temps.
Il s’agit d’un cas de condamnation, suivi quelques années plus tard d’un acquittement, tous les
deux à partir d’analyses ADN, Ch Crim 15 mai 2013 - n° de pourvoi: 12-84818.
11. « Plus un fichier est vaste, plus la probabilité d’un match dans le jargon des spécialistes est
forte, c’est-à-dire, d’un rapprochement entre trace inconnue et profil archivé », HUYGHE, F.B., op.
cit. p 54.
12. Il s’agit du même mécanisme qui est utilisé depuis un siècle avec des fichiers ou des bases de
données d'empreintes digitales, d'où l'utilisation du terme «empreinte génétique ». SOTELO
MUÑOZ, H., op. cit., p 89, insiste sur l’importance des bases de données pour la comparaison des
traces et des empreintes, parce que grâce à elles l’enquête ne doit pas partir d’un suspect
déterminé. En effet, on pourrait ajouter, c’est précisément le rapprochement entre les données
obtenues des traces et les données stockées dans le fichier qui fournira le suspect.
13. BAETA, M. et MARTÍNEZ-JARRETA, B., « Situación actual de las bases de datos de ADN en el
ámbito forense: Nuevos avances, nuevas necesidades », Revista Derecho y Genoma Humano, nº 31
julio-diciembre 2009, 161-183, p. 167 (http://bioderecho.wordpress.com/numero-31/).
14. Naturellement, le phénomène n'est pas nouveau, mais il a certainement augmenté en Europe
avec la suppression des frontières et l'élargissement progressif de l'Union. La France et l'Espagne
font partie du groupe des sept États membres de l'Union qui ont signé le Traité de Prüm du 27
mai 2005, relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
347
lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Les aspects
essentiels de ce traité ont été incorporés dans la législation générale de l'Union par la Décision
2008/615/JAI du Conseil, du 23 juin 2008. V. DE HOYOS SÁNCHO M., art. préc., p. 4.
15. Désormais LO 10/2007.
16. Les fichiers existant à la date de promulgation de la LO 10/2007 étaient les suivants :
- À la Police nationale, le fichier « ADN Humanitas », pour l’identification des restes humains, et
le fichier « ADN veritas » pour la comparaison des profils ADN obtenus des traces recueillies sur
le lieu du crime, avec ceux provenant des scellés qui sont déterminés par l’autorité judiciaire. Les
deux fichiers, placés sous la Direction générale de la Police, ont été créés par ordre ministériel du
21 septembre 2000, substitué par l’ordre ministériel du 20 juin 2002.
- Au sein de la Gendarmerie espagnole (Guardia Civil), selon le même schéma, il y avait un fichier
destiné à la recherche criminelle, « ADNIC », réglementé par l’ordre du 7 mars 2000, et un autre
pour l’identification des personnes disparues et des restes humains, « FENIX », réglé par l’ordre
du 18 mars 1998. Le régime de ces fichiers a été modifié par l’ordre du 11 novembre 2004.
- En ce qui concerne les Communautés autonomes, tant le Pays Basque, Ordre du 2 septembre de
2003 (modifié par l’Ordre du 2 avril 2007), que la Catalogne, Ordre du 7 octobre 2007, ont des
fichiers destinés à la recherche criminelle. L’assimilation de ces fichiers dans la Base de données
nationale serait possible si leur but est semblable à celui qui est établi par la LO 10/2007, selon la
disposition additionnelle première de cette loi. Voir ROMEO CASABONA C.Mª., et ROMEO
MALANDA S., « Los identificadores del ADN en el sistema de justicia penal », Aranzadi, 2010, pp.
179-181; DOUTREMEPUIG C. (dir.), Les fichiers des empreintes génétiques en pratique judiciaire, Paris,
La Documentation Française, Paris 2006, pp. 38-40.
17. Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos,
substituée par la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
18. Il s’agissait du nouveau libellé des articles 366 et 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECr), introduit par la LO 15/2003, du 25 novembre.
19. Il est possible de distinguer un concept plus large pour l’expression « profil ADN ou profil
génétique », comprenant toute l’information génétique de la personne concernée, et non
seulement son empreinte génétique ; v. ÁLVAREZ GONZÁLEZ S., « Derechos fundamentales y
protección de datos genéticos », Dykinson, 2007, p. 68 et p. 431.
20. ROMEO CASABONA C.Mª. et ROMEO MALANDA S. utilisent cette terminologie pour donner le
titre au livre susnommé.
21. Définition tirée de la caractérisation exprimée par ALONSO ALONSO A., art. préc.., p. 81.
22. Le troisième élément de comparaison était l’empreinte digitale dont l’étude a été exclue en
raison du sujet de cet article. Il suffit de souligner que la Cour constate que les empreintes
digitales ne contiennent pas autant d’informations que les échantillons cellulaires ou les profils
ADN (§ 78). Malgré cela, elle affirme que l’enregistrement de ces données en vue d’une analyse
ultérieure pour faciliter l’identification des personnes et le caractère systématique ou permanent
de l’enregistrement était susceptible de faire entrer en jeu le droit au respect de la vie privée,
même si les données concernées étaient dans le domaine public ou disponibles d’une autre
manière (§ 84). Par conséquent, elle estime que l’approche adoptée par les organes de la
Convention au sujet des photographies et échantillons de voix doit aussi être appliquée aux
empreintes digitales.
23. Voir notamment l’article 6 de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui fait
entrer les données à caractère personnel révélant l’origine raciale, avec d’autres informations
sensibles sur l’individu, parmi les catégories particulières de données ne pouvant être conservées
que moyennant des garanties appropriées.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
348
24. En ce sens, l’arrêt nous rappelle que le Conseil de l’Europe a reconnu il y a plus de quinze ans
que les techniques d’analyse de l’ADN présentaient des avantages pour le système de la justice
pénale (Recommandation no R (92) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, §§ 43-44 ci-
dessus).
25. Tel que fait noter le propre jugement, les autorités nationales bénéficient d’une certaine
marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de déterminer la nécessité de l’ingérence, compte tenu des
facteurs concourants, comme la nature du droit en cause, la nature et finalité de l’ingérence et le
niveau de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe (§ 102).
26. Article 706-55 CPP :
1º Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit
prévu par l'article 222-32 du code pénal;
2º Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la
personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux
personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres
humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus
par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4,
225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal;
3º Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de
détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à
312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal;
4º Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse
monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1
à 413-12,421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5, 450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal;
5º Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense;
6º Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux
1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
27. Selon l’article 3 LO 10/2007, l’inscription concerne :
- Les délits graves.
- En tous les cas, les infractions concernant la vie, la liberté, l’intégrité ou la liberté sexuelle,
l’intégrité des personnes, le patrimoine si elles ont été commises avec force sur les choses, ou
violence ou contrainte sur les personnes, ainsi que dans les cas de délinquance organisée, étant
entendu que l’on doit inclure, en tout cas, dans le terme délinquance organisée celle qui est
prévue à l’article 282 bis, § 4, de la loi espagnole de procédure pénale par rapport aux délits
énumérés.
28. En application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134 CPP.
29. DEMARCHI J.R., op. cit., p. 111, évoque à cet égard la Circulaire du Ministère de la Justice du 9
juillet 2008, qui restreint le concept d’« indices graves et concordants », puisqu’ils ne peuvent pas
s’ensuivre de la seule incrimination par la victime ou par un témoin si elle n’est pas
circonstanciée ou corroborée par d’autres éléments de la procédure. À notre avis, il faut
remarquer la finalité de la Circulaire, relative au refus du prélèvement biologique. En
conséquence, il serait difficile de déduire une vraie règle sur la preuve dans le procès pénal.
30. Terminologie employée par DEMARCHI J. R., op. cit., p. 103 et p. 109.
Il faut remarquer que le mot « sospechoso » (suspect) n’a pas été évoqué dans le code espagnol de
procédure pénale qu’après la modification de l’article 363 par la LO 15/2003, mais la définition du
terme est absente.
31. Après la réforme introduite par la loi du 14 mars 2011 (conséquence de la décision du Conseil
constitutionnel du 16 septembre 2010), le rapprochement n’est possible qu’à propos des
infractions énumérées à l’article 706-55.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
349
32. Mémoire d’activités CNUFADN 2012, à consulter sur le site internet : http://
institutodetoxicologia.justicia.es/wps/portal/intcf_internet/portada/utilidades_portal/
comision_ADN/
33. Bien sûr, le CPP français n’exige pas non plus le consentement des personnes simplement
suspectées pour procéder au rapprochement de leurs empreintes génétiques avec les autres déjà
stockées.
34. Il s’agirait ici des empreintes génétiques issues des échantillons biologiques d'un cadavre non
identifié, il n’y a donc personne d’apte à prêter le consentement. Dans l’éventualité des
personnes disparues, il faudra le consentement pour l’inscription du profil des parents, mais un
doute subsiste sur le fait de savoir si le consentement des parents sera aussi nécessaire pour
inscrire le profil génétique de la personne disparue, lorsqu’il a été possible de l’obtenir.
35. Article R53-10.I.5º CPP: « l’accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes
intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles
autorisent la comparaison entre leurs empreintes génétiques et l'ensemble des traces et
empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte
de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait
dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En
l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les
empreintes des cadavres non identifiés »
36. En Espagne, la CNUFADN a précisé par accord de l’année 2011 l’information que la police doit
fournir aux personnes qui font l’objet de poursuites, mais rien n’a été dit par rapport aux
personnes qui doivent consentir l’inscription. : http://institutodetoxicologia.justicia.es/wps/
portal/intcf_internet/portada/utilidades_portal/comision_ADN/
37. La condamnation n’emporte qu’un délai plus long de conservation du profil génétique une
fois il a été enregistré au fichier.
38. C’est justement ce que prévoient l’article 55.1 CCP français et l’article 363 du CCP espagnol.
39. Décision du 16 septembre 2010.
40. Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
41. BRANGER A. S., Le fichier national automatisé d'empreintes génétiques, Paris, Panthéon-Assas,
2003, dact., 173 f°, p. 27. TEYSSIÉ, B., Droit Civil. Les Personnes, Paris, Lexis Nexis 2012, 14 éd., pp.
39-41/
42. SOTELO MUÑOZ H., op. cit., p. 104 ; l’auteur exclut absolument qu’une prise de salive implique
une ingérence au droit à l’intégrité physique.
43. Romeo Casabona, C.Mª. et Romeo Malanda, S., op. cit., pp. 53-58.
44. HUYGHE F.B., op. cit., p. 73.
45. Art. 76-2 CPP pour l’enquête préliminaire.
46. DEMARCHI, J. R., op. cit., p. 156, regrette que le législateur n’ait pas défini rigoureusement les
notions de « prélèvement biologique » et « prélèvement externe ». Voir aussi AMBROISSE-
CASTÉRO, C., op. cit.., p. 25.
47. La décision du Conseil constitutionnel nº 2003-467 du 13 de mars 2003 déclare par la suite
« qu'enfin, le prélèvement étant effectué dans le cadre de l'enquête et en vue de la manifestation
de la vérité, il n'impose à la « personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction » aucune rigueur
qui ne serait pas nécessaire ». Le Considérant 56 ajoute « que les prélèvements externes ne
portent pas atteinte à la présomption d'innocence ; qu'ils pourront, au contraire, établir
l'innocence des personnes qui en sont l'objet ».
48. On parle en Espagne de « prise subreptice ou furtive des échantillons biologiques ». La
jurisprudence espagnole a déjà admis ce système pour obtenir l’empreinte génétique.
Premièrement, ce prélèvement fut accepté par la Sala Penal del Tribunal Supremo espagnol,
après quelques jugements contradictoires (SSTS nº 501/ 2005, du 19 avril, et nº 1311/2005, du 14
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
350
octobre), par décision non juridictionnelle du 31-01-2006. Récemment, le Tribunal Constitucional
espagnol a aussi statué la légalité constitutionnelle du prélèvement résiduel au sujet de la preuve
par l’ADN et le fichage du profil génétique, v. STC nº 199/2013, du 5 décembre.
49. Arrêt du Tribunal Suprême espagnol nº 803/2003, du 04 juin 2003.
50. En raison de nombre de plaintes faites pour le requérant, Ch Crim 19 mars 2013, n° de
pourvoi: 12-81533. Sur l’application de la peine ressortie de la condamnation par délit de refus de
prélèvement, les Tribunaux ont statué que l’alinéa III de l’article 706-56 est contraire à la Conv.
EDH, dès lors que le précepte établit le retrait automatique des réductions de peines (Ch Crim. 18
janvier 2012).
51. L’article 706-56 CPP ne s’occupe pas des prélèvements concernant les parents mentionnés au
quatrième alinéa de l’article 706-54. Leur consentement étant nécessaire pour l’enregistrement
de leurs empreintes génétiques, il s’ensuit que leur consentement est également nécessaire pour
le prélèvement.
52. Il s’agit d’économiser du temps et des moyens personnels et matériels.
53. Nous avons déjà vu que le fichage des empreintes génétiques des ascendants, descendants et
collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée exige leur consentement éclairé,
exprès et écrit. On peut bien en déduire que ce consentement comprend aussi l’accord au
prélèvement nécessaire pour obtenir le profil génétique.
54. « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses
éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Pourtant, on peut
trouver une référence au prélèvement de force au cours de l’enquête dans l’arrêt de la Cour de
Cassation, Ch Crim 5 janvier 2011, nº pourvoi 10-87325: «…d’autant qu’il convient de relever que
dans un premier temps, ce dernier avait tenté d’empêcher une expertise comparative d’ADN, en
refusant le prélèvement biologique sur sa personne, ne l’ayant finalement accepté que sur
l’indication qu’il allait être opéré de force ».
55. À propos du refus de se soumettre au prélèvement prévu à l’article 55.1 CPP, la décision du
Conseil constitutionnel nº 2003-467 du 13 mars établit (Considérant 57) « qu'en l'absence de voies
d'exécution d'office du prélèvement et compte tenu de la gravité des faits susceptibles d'avoir été
commis, le législateur n'a pas fixé un quantum disproportionné pour le refus de prélèvement;
qu'il appartiendra toutefois à la juridiction répressive, lors du prononcé de la peine sanctionnant
ce refus, de proportionner cette dernière à celle qui pourrait être infligée pour le crime ou le
délit à l'occasion duquel le prélèvement a été demandé; que, sous cette réserve, l'article 30 n'est
pas contraire à la Constitution ».
56. Voir, en ce sens, Ch Crim 19 mars 2013, nº de pourvoi : 12-81533.
57. Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de
commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel
biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
58. En témoigne la Circulaire de la Direction générale de la Police scientifique du 6 mai 2009.
59. La loi 10/2007 fait ici une rémission à l’article 363.2 du code espagnol de procédure pénale,
qui permet au juge d’instruction, par ordonnance raisonnée et à condition qu’il y ait des raisons
valables et accréditées, décider le prélèvement biologique du suspect s’avérant indispensable
pour obtenir son profil ADN. Dans ce but, le juge peut décider la pratique des actes d’inspection,
reconnaissance ou intervention corporelle revêtant un caractère proportionné et raisonnable.
60. SOTELO MUÑOZ H., op. cit., pp. 124-125, il s’agit de soumettre la contrainte physique au
respect du principe de proportionnalité, comme il peut arriver dans autres éventualités telles
que le placement en garde à vue d’un individu faisant résistance.
61. V. FERNÁNDEZ ACEBO M. D., La tutela de los derechos fundamentales a la intimidad e integridad
física frente a la actuación de los poderes públicos sobre el cuerpo humano: una perspectiva constitucional
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
351
sobre las intervenciones corporales y otras diligencias de investigación, UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA,
2013 : http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/11704/2/
Fernandez%20Acebo_Maria%20Dolores_TD_2013.pdf.
62. La seule possibilité de sanctionner une telle attitude est par la voie du délit commun de
désobéissance à l’autorité et à ses fonctionnaires, prévu par l’article 556 CP espagnol. Voir
Tribunal Constitucional, sec. 3ª, A 14-11-2006, nº 405/2006, rec. 7088/2004. En France, comme en
Espagne, le fait de refuser le prélèvement peut être considéré un indice de culpabilité, mais il ne
s’agit pas d’une sanction, mais d’une règle probatoire judiciaire. Voir S. Murray c. Royaume-Uni
du 8 février 1996.
63. En Espagne, la police doit assurer l’assistance d’avocat à toute personne placée en garde à vue
dont le consentement est exigé pour procéder au prélèvement biologique : Arrêt du Tribunal
Supremo nº 685/2010, du 7 juillet.
64. À ce sujet, il semble insuffisante l’expression « sans l’accord de l’intéressé » employée par
l’alinéa 5 de l’article 706-56 CPP.
65. Voir, à cet égard, S. Jalloh c. Allemagne 11 juillet 2006.
66. HUYGHE F.B., op. cit., p 62
67. Voir HENNETTE-VAUCHE, St. et ROMAN D., Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris,
Dalloz, 1re édition, 2013 ; pp. 459-460.
68. L’analyse de ce marqueur deviendra nécessaire pour assigner le masculin ou le féminin aux
empreintes génétiques provenant des traces.
69. DOUTREMEPUICH Ch. (dir.), op., cit., pp 69-85.
70. Il s’agit du décret prévu par l’article 706-54 « un décret en Conseil d'État pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du
présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées ». Voir le rapport adopté à l’occasion par la CNIL, nº 99-052, du 28 octobre 1999.
71. À partir du décret du 27 mai 2004.
72. Celui-ci est assisté d’un comité composé de trois membres : un magistrat du parquet, un
généticien et un informaticien. Voir article R 53-16 et suivants CPP.
73. DE HOYOS SÁNCHO M. de, op. Cit.., pp. 21-22; BAETA, M. et MARTÍNEZ-JARRETA B., op. cit,, p.
182.
74. À ce sujet, tous les pays de l’Union Européenne doivent suivre la Résolution du Conseil du 30
novembre 2009, relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN, qui a son origine à la
Décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées
dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
75. Articles R53-10 et R53-11 CPP.
76. « Ordre INT/1202/2011, du 4 mai, pour réglementer les fichiers de données à caractère
personnel du Ministère de l’Intérieur », BOE (journal officiel de l’État) du 13 mai 2011. Cet ordre
découle directement des exigences de la loi organique de protection des données à caractère
personnel 15/1999.
77. Du point de vue de la qualité de la norme régissant une ingérence au droit fondamental à la
vie privée, un simple ordre ministériel s’avère nettement insuffisant pour définir la portée des
données à caractère personnel inclus aux fichiers intégrés dans la Base de données policière
d’identificateurs obtenus à partir de l’ADN, compte tenu de la quantité et la qualité de ces
données.
78. Carte nationale d’identité.
79. Numéro d’identification fiscale.
80. Comme nous verrons par la suite, les droits d’effacement reconnus dans l’article 706-54 CPP
permettent de modifier les délais généraux.
81. L’article 131 CP espagnol stipule des délais de prescription de 5, 10, 15 et 20 ans, en fonction
de la gravité des peines attribuées à chaque délit.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
352
82. On a donc fait la sourde oreille à la décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2010
qui avait exigé que la durée de conservation des empreintes au fichier doit être proportionnée à
la nature ou à la gravité des infractions.
83. DEMARCHI J. R., op. cit., pp. 308-314; ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER S. « El consentimiento en
la toma de muestras de ADN. Especial referencia a los procesos de menores (Parte II)», Revista
Derecho y Genoma Humano, nº 35 agosto-diciembre 2011, pp. 41-65.
84. Loi organique développée par décret royal 1720/2007 du 21 décembre 2007.
85. Il est facile de découvrir la correspondance avec les fichiers existant avant la LO 10/2007
(Voir note 4 supra).
ABSTRACTS
This article provides a comparative analysis of the legal system that exists in France and Spain to
regulate the storage and treatment of genetic fingerprints, for the identification of the person in
police investigations and criminal proceedings. At the same time will prove the measure in which
each one of this legal system it conforms to the European convention on the protection of human
rights and fundamental freedoms. The study will permit to show the internal regulation of each
individual country leads to confrontations on the approximation of the European Court of human
rights, which guarantees respect of private and family life, in conformity with the parameters set
out in the sentence S. and Marper against United Kingdom, dedicated particularly to this matter.
Such confrontations are reflected in various aspects we will highlight:
- The excess objective and subjective scope of application of the files.
- The problems arising from the biological sampling.
- The risks to privacy derived from DNA analysis and from storage of biological samples.
- The treatment of the personal data linked to the genetic fingerprints.
Based on this, we can conclude that the French system, placed under judicial control, achieves a
high degree of compliance with the European convention than the Spanish system, totally
dependent on the police and governmental authorities.
Ce texte vise à faire une analyse comparative des systèmes juridiques existants en France et en
Espagne pour réglementer les fichiers d’empreintes génétiques, destinées à l’identification des
personnes dans les recherches policières et procédures pénales. En même temps, il met en
exergue la façon dont chaque système juridique se conforme à la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Les analyses suivantes
démontreront que la règlementation interne de chaque pays appelle de nombreuses
confrontations avec l’approche par la Cour européenne des droits de l’homme de droit à la vie
privée et familiale, selon les standards énoncés à l’arrêt S. et Marper versus le Royaume Uni, du 4
décembre 2008, particulièrement dédié à ce sujet. Ces confrontations concernent plusieurs
aspects qui mettent en évidence un intérêt particulier: l’étendue excessive du domaine objectif et
subjectif des fichiers; la problématique soulevée autour des prélèvements biologiques; les risques
pour le droit à la vie privée résultants des analyses d’ADN et de la conservation des échantillons
biologiques; et, enfin, le traitement des données à caractère personnel associées à l’empreinte
génétique. Nous pouvons conclure que le système français, placé sous contrôle direct de la
magistrature, atteint un plus haut degré de conformité avec la Convention européenne que le
système espagnol, entièrement soumis aux autorités policières et gouvernementales.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
353
Se realiza en este artículo un análisis comparativo de los sistemas jurídicos que existen en
Francia y en España para regular los ficheros de perfiles de ADN, destinados a la identificación de
personas en las investigaciones policiales y procedimientos penales. Al mismo tiempo, se pondrá
de relieve la medida en que cada uno de esos sistemas jurídicos se ajusta a la Convención Europea
para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales. Las reflexiones
que siguen permitirán demostrar que la regulación interna de cada uno de los países da lugar a
diversas confrontaciones con la aproximación del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre al
derecho a la vida privada y familiar, según los parámetros marcados en la Sentencia S. y Marper
contra Reino Unido, particularmente dedicada a esta materia. Tales confrontaciones se reflejan
en varios aspectos que interesará resaltar especialmente: el excesivo ámbito de aplicación
objetivo y subjetivo de los ficheros; los problemas derivados de la toma de muestras biológicas;
los riesgos para el derecho a la intimidad derivados de los análisis de ADN y de la conservación de
muestras biológicas; y, finalmente, el tratamiento de los datos de carácter personal ligados a la
huella genética. Con todo ello podremos concluir que el sistema francés, situado bajo el control
directo del poder judicial, alcanza un mayor grado de adecuación a la Convención que el sistema
español, totalmente dependiente de las autoridades policiales y gubernativas.
INDEX
Mots-clés: Fichiers d’empreintes génétiques - Systèmes français et espagnol - Analyse
comparative - Droits fondamentaux à la vie privée et à la protection de données à caractère
personnel - Convention européenne des Droits de l’Homme
Keywords: Storage and treatment of genetic fingerprints - French and Spanish legal system -
Comparative law - Fundamental rights of privacy ant of protection of personal data - European
Convention of Human rights
Palabras claves: Bases de datos de perfiles de ADN - Sistemas francés y español - Aproximación
comparativa - Derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal
- Convención Europea de Derechos del Hombre
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
354
Appréhender la cyberguerre en
droit international. Quelques
réflexions et mises au point
Clémentines Bories
1 « Une clef USB défaillante peut faire plus de dégâts qu’une bombe de 250 kg ». A en
croire le général Eric Bonnemaison, Directeur adjoint des Affaires stratégiques au
Ministère de la Défense, la menace informatique, non contente de bouleverser le visage
des conflits armés classiques, constituerait un risque fondamental pour les Etats ainsi
que les civils. La « cyberguerre » est un phénomène relativement neuf, dont
l’apparition se justifie par notre dépendance à l’outil informatique mais aussi par le
faible coût qu’il y a à faire d’un instrument de communication et de travail une arme
immatérielle dotée d’un fort potentiel offensif. Phénomène devenu d’ampleur dans les
relations internationales et impliquant au premier chef les Etats Unis d’Amérique, la
Chine et la Russie, la « cyberguerre » constitue à la fois une déclinaison nouvelle des
tensions internationales et un enjeu pour le droit. Ce n’est que depuis peu qu’elle
préoccupe les juristes1, et ce surtout en dehors de nos frontières. Les analyses se
concentrent alors avant tout sur les modifications du jus in bello et du jus ad bellum qui
pourraient s’avérer nécessaires. La question de l’opportunité d’un traité international
régissant les conflits informatiques est notamment discutée, mais ne paraît pas
susceptible de donner lieu à une réalisation véritable dans un délai raisonnable 2.
2 Il apparaît dès lors opportun d’interroger le droit positif afin de cerner comment les
règles en vigueur peuvent permettre d’envisager les actions informatiques offensives.
La présente étude se concentrera non sur les actes de piraterie informatique qui sont le
fait d’individus isolés mais sur celles des actions informatiques offensives qui
impliquent des Etats, en qualité de commanditaire ou bien de cible, ou encore parce
que leurs ressortissants sont les victimes. Apparaît alors une première difficulté,
d’ordre non seulement sémantique mais aussi conceptuel : ladite « cyberguerre »,
multifacettes, doit être définie afin que l’objet de l’analyse puisse être véritablement
déterminé (I). Suit une seconde difficulté, celle de l’identification de règles de droit
international permettant de répondre aux enjeux de telles attaques en protégeant les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
355
victimes civiles, tout en désignant les éventuels Etats commanditaires et/ou victimes de
tels agissements (II).
I – Des phénomènes nouveaux à appréhender
3 Parce que le terme de « cyberguerre » est utilisé à tort et à travers pour désigner des
faits avérés ou fantasmés, il s’avère que les phénomènes qu’il désigne, hétéroclites (A),
ne se prêtent pas à une appréhension aisée par le biais d’un concept juridique unique
(B).
A – L’hétérogénéité des situations de fait concernées
4 Alors pourtant qu’elle constituait l’objet même de son mandat, le General Keith B.
Alexander (USA), Director of the NSA and Commander of the US CyberCommand
(CYBERCOM) soulignait, dans un discours au Sénat prononcé en 2013, la totale
imprécision de la définition du terme de cyberguerre : « qu’est-ce qui constitue un acte
de guerre dans le cyberespace ? ». Il est vrai que le terme de « cyberguerre », sur-
employé sans doute à la fois par commodité et en raison de son caractère frappant,
renvoie à des réalités fort différenciées et difficilement saisissables. Dépourvu
d’acception juridique assurée, le néologisme devenu fréquent fait référence, dans son
acception courante, à des situations de fait dans lesquelles l’outil informatique est
utilisé aux fins de créer un dommage dans une sphère internationale, sans
nécessairement avoir recours à la violence. S’inscrivant dans un contexte conflictuel ou
simplement hostile voire suspicieux, tantôt dans le cadre des relations internationales,
tantôt au sein même du territoire d’un Etat, les actes de cyberguerre peuvent survenir
dans de multiples configurations.
5 Entendue stricto sensu, la cyberguerre devrait n’être que virtuelle, ne faire appel qu’à
des armes électroniques3, et n’être conduite que dans une sphère immatérielle. Au-delà
de ce cas d’école4 et de façon plus habituelle, un acte de cyberguerre peut consister
dans une opération menée dans le cadre d’un conflit armé avéré, qu’il soit international
ou interne ; c’est ainsi dans le contexte de la Guerre d’Ossétie du Sud que se sont
inscrites les attaques russes visant la Géorgie (2008). Plus fréquemment, l’acte dit de
cyberguerre intervient en dehors de tout conflit armé, ne correspond ni à la guerre ni à
la paix mais se trouve « somewhere between »5. Une attaque électronique commanditée
par des autorités étatiques soucieuses de porter atteinte aux intérêts d’une Puissance
étrangère peut être décrite comme un acte de « cyberguerre ». Il s’agit là de
l’hypothèse sans doute la plus communément référencée, qui concerna par exemple
l’Estonie, victime en avril 2007 d’opérations de grande ampleur qui ont, en plusieurs
étapes, touché les sites gouvernementaux, les banques, les media et les partis
politiques, jusqu’à paralyser le gouvernement. L’action informatique pourra s’inscrire
dans le cadre de relations internationales tendues et correspondre à des actions
hostiles dirigées contre un autre Etat, à l’instar des attaques pro-taiwanaises dirigées
contre les sites gouvernementaux chinois en 1999 ou des attaques commanditées la
même année par le Gouvernement chinois à l’encontre des Etats-Unis d’Amérique en
réponse au bombardement accidentel de l’Ambassade chinoise à Belgrade. Comme en
atteste les politiques américaine et israélienne à l’égard de l’Iran ainsi que
l’opération Stuxnet menée contre des installations nucléaires, il peut également
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
356
correspondre à une politique de dissuasion voire à une contre-mesure. Est également
désignée par le vocable « cyberguerre » toute action informatique hostile susceptible
de déclencher un conflit armé.
6 Plus largement, dans le langage courant, l’appellation « cyberguerre » peut désigner
une opération menée par un Etat à l’encontre d’une entité non étatique en dehors de
son territoire, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ou encore une
offensive terroriste menée à l’initiative d’un groupe non étatique mais destinée à
porter atteinte aux intérêts d’un Etat ou de sa population6. Une action entreprise à
l’initiative d’autorités étatiques à l’encontre d’un groupe hostile situé sur leur territoire
et ayant par exemple proclamé son indépendance pourra elle aussi être incluse parmi
les actes dits de « cyberguerre ». Enfin, et suivant une interprétation sans doute
démesurément extensive de l’expression de « cyberguerre », pourrait être concernée
une cyber-révolution impulsée par réseaux sociaux incitant à la violence ou au
changement de régime politique, telle la Révolution tunisienne de 2011 qui bénéficia de
l’aide apportée par les Anonymous.
B – Une qualification juridique introuvable ?
7 Une telle diversité de situations révèle les difficultés et, surtout, l’extrême limitation du
phénomène étudié à laquelle conduit habituellement la considération des seules
hypothèses susceptibles d’être appréhendées par le biais du droit international
humanitaire. Dès lors, toute piste pour un traitement global et adapté de la question
paraît opportune. Le terme de « cyberguerre » paraît bien souvent usurpé 7. Il renvoie
aux actes inamicaux visant un Etat et lui occasionnant un dommage directement ou
dans la personne de ses ressortissants. Une interrogation sémantique apparaît alors : le
juriste doit-il conserver le terme médiatique et courant de « cyberguerre » pour
désigner chacun de ces phénomènes, souvent isolés et fort variés ? En effet, le conflit
armé ne constitue nullement un contexte nécessaire à la survenance des faits étudiés.
Dans un tel contexte, il convient d’interroger le terme composé de « cyber-guerre »
pour jauger la capacité de sa composante belliqueuse à désigner, en droit, des réalités
somme toute peu classiques.
8 Comme chacun sait, la qualification juridique de « conflit armé » n’est pas sans soulever
nombre de difficultés d’interprétation. Pourtant, elle a d’ores et déjà été privilégiée afin
de faire primer une approche compréhensive de phénomènes trop étroitement
envisagés sous l’angle de la qualification de « guerre » 8. Présenté dans l’affaire Tadić
comme existant « à chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ou un
conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés
organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat »9, le conflit armé ainsi entendu
s’écarte manifestement de la réalité des phénomènes étudiés. Certes, le conflit armé
s’est par la suite présenté sous d’autres traits. Certes, face au phénomène terroriste et à
la criminalité organisée10, l’élasticité de la qualification de « guerre » a d’ores et déjà été
interrogée tant sous l’angle de la définition des limites du champ d’application du jus in
bello que de celles du jus ad bellum. Pourtant, rien n’est établi en droit positif qui
permette une acception suffisamment large pour inclure toutes les réalités des actions
informatiques. Pis, « [t]he use of terms of war in cyberspace operations obscures the reality
that cyberwar does not fit well into the legal frameworks on war and of use of force » 11.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
357
9 Si le terme de « guerre » permet de souligner la gravité des actes concernés et de leurs
conséquences, il ne saurait, dans son acception habituelle, désigner, dans la plupart des
cas, les situations d’espèce concernées par les cyber-offensives. Celles-ci se
caractérisent en effet par des cibles comme des dommages d’une gravité variable, et
déclinent leurs effets dans les domaines économiques, politiques, comme militaires et/
ou humains. De surcroît, l’observation des faits montre que les attaques informatiques
en question constituent bien souvent un moyen d’action isolé12. En présence de telles
difficultés apparaît donc l’opportunité du recours à un autre vocable de portée
générique, susceptible d’être moins controversé mais également plus neutre du point
de vue du droit applicable.
10 Suivant une démarche similaire, le Center for Security Studies (CSS) de Zurich distingue
d’ailleurs ces situations de celles de « cyberhacktivisme » ou « cybervandalisme »
(piratage des sites avec destruction de données informatiques), du cyberterrorisme, du
cybercrime et du cyberespionnage13. Le conflit armé seul paraît susceptible d’emporter
la qualification de cyberguerre, les autres termes étant destinés à couvrir d’autres
réalités.
11 C’est une autre grille de lecture que doit adopter quiconque recherche un terme
permettant de désigner ensemble tous les types d’agissements dommageables, via
internet, que ceux-ci soient dirigés contre un Etat ou portent atteinte à ses intérêts, et/
ou soient susceptibles d’être reliées à l’action d’un autre Etat. Le cybervandalisme, le
cyberterrorisme, le cyberespionnage voire, dans le cadre de la Convention sur la
cybercriminalité14 par exemple, le cybercrime, doivent pouvoir être inclus dans une
qualification unique. Le terme de « cyberattaque » s’avère alors pertinent. Il permet de
désigner l’une de ces pratiques, quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle survient
généralement de façon isolée et ne revêt pas toujours en elle-même la gravité suffisante
pour justifier que l’on parle de « conflit armé ». L’expression « cyberattaque » fait
référence à un événement plus ponctuel que celle de « cyberguerre », à un fait non
nécessairement susceptible d’être qualifié d’ « agression » au sens du droit
international15, et reflète dès lors plus fidèlement la palette des réalités concernées. Si
les cyberopérations « peuvent être décrites au sens large comme des opérations
dirigées contre un ordinateur ou un réseau informatique, ou par le biais de ceux-ci,
grâce à des flux de données »16, les cyberattaques en sont une déclinaison ; elles
surviennent dans l’hypothèse où un Etat est à l’origine d’un agissement délibérément
agressif à l’encontre d’intérêts politiques, militaires, économiques et commerciaux,
voire sociaux.
II. Des règles à identifier
12 Une fois perçue la diversité des événements susceptibles de survenir, le juriste se doit
de s’interroger sur le droit applicable à ces phénomènes tant nouveaux que disparates.
Force est alors de constater le caractère partiel du raisonnement qui consiste à analyser
ces événements sous l’angle classique du droit international humanitaire et du droit
international général (A) ; d’autres droits pourraient recéler des clefs pour une
régulation plus aisée de ces différentes situations, en particulier le droit international
des droits de l’homme (B).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
358
A – Le nécessaire dépassement des approches classiques
13 En soi, en raison de ses particularités mêmes, la cyberguerre défie les règles de droit.
L’apparition de l’outil internet et des mouvements dématérialisés qu’il génère a
immédiatement interrogé les juristes17. Si l’internet fait surgir des interrogations
nouvelles pour le droit, il appelle des règles particulières. Aussi les cyberattaques dans
leur diversité se caractérisent-elles par un besoin de normativité spécifique, propre à
une réalité aussi difficile à localiser qu’éphémère. Davantage que le recours à des règles
ponctuelles préexistantes, les cyberattaques appellent un traitement général adapté
aux singularités que constituent l’usage de l’outil internet, la dématéralisation qu’il
implique, l’immédiateté, ainsi que les difficultés de preuve et de localisation 18. Mais en
l’absence de telles règles spéciales, les normes susceptibles d’être applicables sont, pour
l’heure, tirées principalement des droits international humanitaire et général.
14 Face à ce qu’elle désigne sous le vocable de « cyberguerre », la doctrine, à l’instar des
commandements militaires, adopte habituellement un raisonnement par mimétisme
avec le cas des conflits armés classiques, qui conduit à rechercher principalement
l’application du droit international humanitaire. Un rapide recensement des
hypothèses concernées par ladite cyberguerre permet pourtant de souligner
l’insuffisance des approches qui consistent à n’analyser que l’application à ces
événements de règles du jus in bello.
15 Si une cyberattaque implique des autorités étatiques et est susceptible d’engager leur
responsabilité – ou concerne des dommages subis par elles -, les règles mobilisables
dépendent du contexte factuel précis de chaque espèce. Lorsque le conflit armé est
d’ores et déjà présent, le droit international humanitaire s’efforce d’appréhender la
cyberattaque par le biais de ses règles19. Mais puisque la guerre constitue le « fait-
condition » à l’applicabilité des droits de La Haye et de Genève 20, seule la
cyber-« guerre » peut être appréhendée par leur biais ; le droit humanitaire est donc
loin de couvrir toutes les situations de fait. De plus, lorsqu’il s’avère applicable, le jus in
bello se heurte à moult difficultés : inexistence de règles spécifiques, et plus largement
déterritorialisation de l’attaque, rareté de l’implication directe d’un Etat. Ainsi, quand
bien même ses règles pourraient être utiles pour appréhender les cyberattaques, elles
ne sauraient suffire à appréhender ces réalités.
16 Le droit international général, pour sa part, offre quelques pistes de solution, mais
soulève, à bien y regarder, autant de questions qu’il n’en résout. Lorsque la
cyberattaque constitue un recours à la force au sens du droit international, et plus
précisément de la Charte des Nations Unies, elle peut au moins partiellement être
appréhendée sur cette base, et qualifiée d’agression21. Lorsqu’enfin la cyberattaque
intervient à titre de rétorsion ou de contre-mesure, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit
soumise au régime juridique correspondant. Aussi la cyberattaque commanditée à titre
de rétorsion ne pourra-t-elle provoquer que des dommages limités, alors que celle qui
constitue une contre-mesure devra notamment répondre au critère de proportionnalité
et constituer, ce qui sera plus difficile à établir, le seul moyen d’action possible 22. Pour
les autres types de cyberattaques, en revanche, tant l’applicabilité que le sens des
règles habituelles du droit international ne font guère l’objet de consensus en cas de
cyberattaque. Pourtant, ils sont légion : le cas de figure le plus fréquent est bien celui
d’actes isolés ou du moins non-inscrits dans le cadre d’un conflit armé, et que l’on peine
à qualifier d’ « agressions » au sens de la Charte des Nations Unies 23.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
359
17 D’une manière plus générale, les principes de territorialité et le lien personnel, qui
permettent de fonder habituellement les compétences de l’Etat, sont fréquemment
invoqués pour appréhender internet par le biais du droit international 24. Peuvent
également s’avérer utiles les critères d’attribution de la responsabilité tels que
l’implication d’un « organe de l’Etat »25 dans la commission des actes de cyberguerre, en
ce qu’ils permettent d’engager la responsabilité internationale d’un Etat à raison des
agissements de ses agents publics dès lors qu’ils occasionnent un dommage. Mais les
individus à l’origine de cyberattaques, loin d’être des agents officiels de cet Etat, sont
bien plus souvent des ressortissants de l’Etat situés à l’étranger, voire des étrangers
agissant depuis un autre territoire étatique. Ces critères s’avèrent donc, en eux-mêmes,
insuffisants pour faire face à l’enjeu informatique.
18 Certes, le droit international comporte également des principes généraux qui
permettent d’attribuer la responsabilité en matière de dommages transfrontières. Mais
ceux-ci ne pourraient s’avérer utiles face aux cyberattaques que dans des circonstances
particulières seulement, ce qui limite la portée de cette solution partielle. En effet, la
responsabilité d’un Etat ne pourra être engagée sur le fondement de la jurisprudence
Fonderie de Trail qu’en l’absence de faute avérée de l’Etat, et si tant est que le fait
occasionnant le dommage ait pris pour point de départ le territoire de l’Etat 26. Ainsi, le
droit international général nous livre des clefs de lecture partielles et laisse des zones
grises à l’heure d’appréhender un phénomène nouveau qui soulève de plus des
difficultés de preuve sans précédent, se caractérise par sa dimension immatérielle, et
présente une instantanéité difficile à saisir, ou du moins un rapport au temps
particulier. Pour sa part, le droit international des droits de l’homme, grand oublié des
études concernant les cyberattaques27, s’avère de quelque utilité dans la recherche de
règles et de raisonnements pertinents.
B – Les possibles apports du droit international des droits de
l’homme
19 Puisque toutes les hypothèses ne sauraient être couvertes par le droit humanitaire et
que le droit international général n’est que d’un recours partiel, le recueil de sources
complémentaires dans le droit international des droits de l’homme s’avère opportun.
En raison de son caractère plus général que le droit international humanitaire, de sa
permanence28, mais aussi de son objet, le droit international des droits de l’homme peut
en effet s’avérer utile pour appréhender l’ensemble des phénomènes dits de
cyberguerre et leurs conséquences à l’égard des individus. Ses instances ne rechignent
guère à s’intéresser à des situations potentiellement régies par le droit humanitaire, ni
même, d’ailleurs, à faire directement application de ses règles spéciales 29. Elles
pourraient d’ailleurs être conduites à connaître de cyberattaques et des violations des
droits de l’homme consécutives. Les règles du droit international des droits de l’homme
s’avèrent précieuses pour proposer des solutions juridiques les plus complètes et
homogènes possibles, face à l’hétérogénéité réelle des situations de fait considérées ;
par ce biais, un traitement juridique d’ensemble et un raisonnement général sur ces
situations nouvelles peuvent être engagés. Ainsi, le droit international des droits de
l’homme offre une grille de lecture nouvelle qui aide à affronter deux des difficultés
juridiques principales auxquelles se heurte la cyberguerre : l’attribution de la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
360
cyberattaque à un Etat et l’identification de règles de droit susceptibles de régir ses
effets à l’égard des personnes physiques.
20 Le rattachement d’une cyberattaque à un Etat aux fins d’établissement de sa
responsabilité constitue une difficulté première au soutien de laquelle on trouve
quelques pistes de solution dans la protection internationale des droits de l’homme. En
effet, la problématique de l’instantanéité d’une action susceptible de causer des
dommages et, par conséquent, de générer la mise en cause de la responsabilité d’un
Etat a également été posée en protection internationale des droits de l’homme. Elle a,
devant les organes de protection régionale des droits de l’homme, donné lieu à des
raisonnements à même d’aider à l’appréhension du phénomène.
21 Dans l’affaire Banković dont a eu à connaître la Cour européenne des droits de l’homme,
le bombardement par les Forces alliées réunies sous l’égide de l’OTAN de la Radio-
Televizije Serbije (RTS) a donné lieu à des discussions autour de la possibilité d’une
juridiction extraterritoriale instantanée n’impliquant ni contact ni présence physique
sur le territoire étranger. L’article 1er de la Convention européenne des droits de
l’homme prévoit que « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I » 30 ; la disposition
s’interprète comme conjuguant une compétence principalement territoriale 31 et, par
exception, une compétence en dehors du territoire. Les requérants soutenaient que la
requête était « compatible ratione loci avec les dispositions de la Convention au motif
que les actes incriminés, qui soit ont été accomplis en RFY, soit l’ont été sur le territoire
des Etats défendeurs mais ont produit leurs effets en RFY, les ont fait entrer, eux et
leurs proches décédés, dans la sphère de juridiction desdits Etats » 32. Est ainsi invoquée,
de façon subsidiaire et en vue de couvrir l’hypothèse d’un événement aérien de très
brève durée, une conception extensive de la compétence territoriale. Elle permettait
d’établir la juridiction d’un Etat dès lors qu’une décision – c’est-à-dire un fait causal
immatériel – était adoptée depuis son territoire, et ce même si l’action consécutive
devait se dérouler ailleurs, et prenait appui sur le d’ores et déjà établi mécanisme de la
protection par ricochet33. Cet argument a été jugé peu convaincant par la Cour34, qui a
privilégié l’argumentation des Etats défendeurs. Ceux-ci rejetaient l’idée d’un contrôle
suffisant pour caractériser la juridiction de l’Etat35. Ils liaient la reconnaissance d’une
juridiction à l’existence d’une certaine durée de la relation, ainsi qu’à la mise en
évidence d’une certaine forme d’allégeance à l’Etat ; en somme, il n’y aurait juridiction
que lorsqu’ « une forme de relation structurée existant pendant un certain laps de
temps » pourrait être établie36. Les dangers d’une « théorie nouvelle de type causal »37
ont ici été mis en avant par le juge, qui a rejeté cette argumentation 38. La Cour souligne
la nécessité de bien distinguer entre les deux conditions de recevabilité d’une requête
que sont la question de savoir si l’intéressé peut être réputé victime d’une violation de
droits garantis par la Convention, et la question de savoir si un individu relève de la
juridiction d’un Etat partie au sens de la Convention. Elle nie la possibilité qu’une
juridiction soit temporaire et de brève durée, et considère que l’exercice de pouvoirs
publics sur le territoire étranger constitue une nécessité pour que la juridiction de
l’Etat puisse être caractérisée au sens de la Convention39. En matière de cyberattaque,
cet argument ne paraît pas dirimant : l’exercice ou l’obstruction à l’exercice normal des
fonctions étatiques de manière temporaire constitue bien souvent la méthode
employée par les cyberattaquants.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
361
22 Que les arguments des requérants dans l’affaire Banković aient reçu un mauvais écho du
côté de la Cour européenne des droits de l’homme à l’heure de proposer de nouveaux
critères permettant de déclarer une requête recevable, et par conséquent de
caractériser la responsabilité de l’Etat, est une chose. Qu’ils soient dépourvus de toute
potentialité en serait une autre. D’ailleurs, la Commission interaméricaine des droits de
l’homme a tenu un raisonnement similaire à celui du sieur Banković dans sa décision
du 21 octobre 201040 . L’Equateur demandait que soit reconnue la possible
responsabilité de la Colombie pour les préjudices causés à son ressortissant Franklin
Guillermo Aisalla Molina, victime d’une exécution extrajudiciaire conduite par les
forces de sécurité colombiennes dans le cadre de l’« Opération Phoenix » menée le 1 er
mars 2008 en territoire équatorien. La Commission a recherché l’existence d’un lien de
causalité entre l’atteinte aux droits de l’homme occasionnée et la conduite
extraterritoriale de l’Etat : « At the time of examining the scope of the American Convention’s
jurisdiction, it is necessary to determine whether there is a causal nexus between the
extraterritorial conduct of the State and the alleged violation of the rights and freedoms of an
individual »41.
23 Au-delà de cette dimension causale de l’engagement de la responsabilité, partiellement
admise en protection internationale des droits de l’homme, le caractère instantané du
contrôle requis aux fins d’engagement de la responsabilité d’un Etat paraît plus
facilement reconnu. En effet, l’on trouve des décisions d’organes de protection
internationale des droits de l’homme qui permettent, en l’absence d’une présence
matérielle s’étalant sur une longue durée, l’engagement de la responsabilité d’un Etat
contrôlant effectivement des événements se déroulant sur le territoire d’un autre Etat.
La théorie du « contrôle global » fait référence en des termes généraux à l’autorité et au
contrôle de l’Etat non territorial comme à autant de critères décisifs aux fins d’établir
sa juridiction et donc de pouvoir engager sa responsabilité 42. De façon plus spécifique,
dans l’affaire Stocké, ce sont l’« actual authority and responsibility » 43 qui sont considérés
comme décisifs. Le contrôle requis pourrait ainsi n’être qu’instantané, l’essentiel étant
que l’autorité exercée par l’Etat soit effective en un instant T44.
24 Ainsi, toute juridiction n’est pas territoriale, loin s’en faut. Comme l’a d’ailleurs précisé
le Comité des droits de l’homme, dans un raisonnement par la suite cité par la
Commission interaméricaine, « the qualification ‘subject to its jurisdiction’, contained in
article 29(1) of the Covenant, does not refer to the place where the violation occurs but to the
relationship between the individual and the State concerned » 45. Ainsi, suivant une logique
non territoriale, une approche mettant en avant un rattachement humain pourrait
s’avérer plus utile pour consacrer la responsabilité d’un Etat en raison d’une
cyberattaque affectant les civils et portant atteinte à leurs droits de l’homme 46.
25 L’idée qu’un exercice instantané de la souveraineté sur des individus serait susceptible
de déclencher la responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’homme s’avère
particulièrement intéressante pour traiter des cas de cyberattaques. L’instantanéité du
phénomène se conjugue en effet à son absence de véritable ancrage territorial pour
présenter d’importants points communs avec l’hypothèse de cyberattaques menées
contre un Etat et affectant fort probablement les individus se trouvant sur son
territoire et leurs droits de l’homme (pour exemple : droit à une vie privée, droits
sociaux, etc.).
26 Enfin, force est de constater que les droits de l’homme eux-mêmes, tels qu’ils sont
reconnus par les textes internationaux, peuvent être d’une grande utilité pour
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
362
appréhender les cyberattaques. Droit à la vie, droit à la vie privée, intégrité physique,
nombreux sont les droits auxquels une attaque informatique peut porter atteinte. Ces
droits bénéficiant d’une protection permanente sur le fondement de textes
internationaux, les victimes auront tout intérêt, en cas de dommage(s), à prendre appui
sur le droit international des droits de l’homme et ses organes plutôt qu’à attendre une
protection du droit humanitaire. Ce dernier est en effet applicable uniquement en
temps de conflit armé et n’est susceptible de n’engager la responsabilité des Etats que
dans ces seules situations, ou bien d’engager la responsabilité d’individus déterminés
lorsque les infractions commises par eux, d’une gravité suffisante, constitueront
également des crimes au sens du droit international pénal. Dans un tel contexte, les
organes de protection internationale des droits de l’homme ont tout intérêt à se saisir
de la problématique des cyberattaques et à affiner les techniques permettant de
faciliter l’accès à leur forum comme la reconnaissance de la responsabilité des Etats
commanditaires de tels agissements.
NOTES
1. On peut relever : B. Smith, « An Eye for an Eye, A Byte for a Byte », Federal Lawyer,
October 1995, pp. 12-13 ; M.N. Schmidt, « Computer Network Attack and the Use of
Force in International Law : Thoughts on a Normative Framework », Columbia Journal of
Transnational Law, 1999, pp. 885-937 ; Air Force Law Review, 2009, n°64 (n° spécial) ; L.
Swanson, « The Era of Cyber Warfare: Applying International Humanitarian Law to the
2008 Russian-Geogian Cyber Conflict », Loyola of Los Angeles International and Comparative
Law Review, 2010, pp. 303-333 ; XXXIVème Table ronde sur les sujets actuels du droit
international humanitaire, San Remo, 8-10 septembre 2011 ; XXXI ème Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, Suisse, 28 novembre –
1er décembre 2011, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés
contemporains. Rapport, CICR, 31IC/11/5.2, 2011, 61 p. ; H. Lin, « Operational Reality of
Cyber Warfare », IIHL 2011, pp. 137-143 ; D. J. Ryan et alii, « International Cyberlaw : A
Normative Framework », Georgetown Journal of International Law, 2011, pp. 1161-1197 ; M.
Baud, « La cyberguerre n’aura pas lieu, mais il faut s’y préparer », Politique étrangère,
vol. 77, été 2012, n°2, pp. 305-316 ; J.-M. Bockel, Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces Armées, Sénat, « La Cyberdéfense : un enjeu mondial, une
priorité nationale », Rapport d'information n°681 (2011-2012), 18 juillet 2012 ; M.
Hecker et T. Rid, « Les armées doivent-elles craindre les réseaux sociaux ? », Politique
étrangère, vol. 77, été 2012, n°2, pp. 317-328 ; H. Lin, « Cyber Conflict and International
Humanitarian Law », RICR, 2012, vol. 886, pp. 515-532 ; J. Richmond, « Evolving
Battlefields: Does Stuxnet Demonstrate a Need for Modifications to the Law of Armed
Conflict ? », Fordham International Law Journal, March, 2012, pp. 843-894 ; L. Simonet,
« L’usage de la force dans le cyberespace et le droit international », Revue de défense
nationale, 2012, pp. 51-55 ; M.N. Schmidt, « International Law in Cyberspace: The Koh
Speech and Tallinn Manual Juxtaposed », Harvard International Law Journal vol. 54, Dec.
2012, pp. 13-37 ; M.N. Schmidt (dir.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
363
Cyber Warfare. Prepared by the International Group of Experts at the Invitation of the NATO
Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence, Cambridge UP, 2013, 282 p. ; University of
Pensylvannia, Roundtable on Cyberwar and the Rule of Law, 2012, consultable sur :
https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/cyberwar/schedule.php ; K.
Ziolkowki, « Stuxnet : Legal Considerations », Humanitäres Völkerrecht, vol. 25, 2012, pp.
39-147 ; J. Goldsmith, « How Cyber Changes the Laws of War », EJIL 2013, vol. 24, n°1, pp.
129-138 ; Colloque de la S.F.D.I., Rouen, Internet et le droit international, Paris, Pedone,
2014, pp. 323 et s.
2. Sur ces questions, voir notamment : D. Brown, « A Proposal for an International Convention to
Regulate the Use of Information Systems in Armed Conflict », Harvard International Law Journal,
2006, pp. 179-221 ; Ch. Dodge, « United States Cyber Command : International Restrictions vs.
Manifest Destiny », North Carolina Journal of Law & Technology Online Edition, 2010, pp. 1-27.
3. L. Swanson recense trois catégories d’armes informatiques : 1) « Syntactic weapons, which
target a computer’s operating system, include malicious code, such as viruses, worms, Trojan
Horses, DdoS, and spyware » ; 2) « semantic weapons [which] consist of altering information that
enters the computer’s system » ; 3) « mixed or blended weapons [which] combine sysntactic and
semantic weapons to attack both information and the computer’s operating system, resulting in
a more sophisticated attack » (source : L. Swanson, « The Era of Cyber Warfare : Applying
International Humanitarian Law to the 2008 Russian-Georgian Cyber Conflict », Loyola of Los
Angeles International and Comparative Law Review, 2010, pp. 310-311).
4. Th. Rid, « Cyber War Will not Take Place », Journal of Strategic Studies, vol. 35, n°1, octobre 2011
; M. Baud, « La cyberguerre n’aura pas lieu, mais il faut s’y préparer », Politique étrangère, 2012,
vol. 2, pp. 305-316.
5. Voir CBS this Morning. 60 mn investigates cyberwarfare, Interview en date du 5 mars 2012, à propos
de Stuxnex.
6. Sur le rôle d’internet dans le Jihad, par exemple, voir : W. Adhami, « The Strategic Importance
of the Internet for Armed Insurgent Groups in Modern Warfare », RICR, vol. 89, n°868, 2007, p.
864.
7. Aussi le Lieutenant Colonel Joshua E. Kasterberg considère-t-il que les attaques menées contre
la Géorgie en 2008, usuellement présentées comme des actes de cyberguerre, seraient qualifiées
d’« infractions » sur le fondement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité
(E. Kastenberg, « Non-Intervention and Neutrality in Cyberspace, An Emerging Principle in the
National Practice of International Law », Air Force Law Review, 2009, vol. 64, p. 58.
8. Voir par exemple : M. Bettati, Droit humanitaire, Précis Dalloz, 2012, p. 29.
9. TPIY Procureur c. Tadić, IT-94-AR 72, 2 octobre 1995, § 10.
10. Sur ce dernier aspect : S Vité, « La lutte contre la criminalité organisée : peut-on parler de
conflit armé au sens où l’entend le droit international humanitaire ? », Conflits armés, parties aux
conflits armés et droit international humanitaire : les catégories juridiques face aux réalités
contemporaines, Actes du colloque de Bruges, 22-23 octobre 2009, Collegium, n°40, 2010, pp. 69-77.
11. V.M. Antolin-Jenkins, « Defining the Parameters of Cyberwar Operations : Looking for Law in
All the Wrong Places ? », Naval Law Review, 2005, p. 134.
12. V.M. Antolin-Jenkins, ibid., « The more critical question is whether it is reasonable to require
adherence to old concepts of what constitutes “use of force” when it is clear that the destructive
power of cyberspace operations can threaten the economic integrity of a state », p. 172.
13. M. Dunn Cavelty, « Cyberwar: Concept, Status Quo, and Limitations », CSS Analysis
in Security Policy, n° 71, avril 2010, <www.sta.ethz.ch/CSS-Analysis-in-Security-Policy/
CSS-Analysis-in-Security-Policy-Archive/No.-71-Cyberwar-Concept-Status-Quo-and-
Limitations-April-2010>, consulté le 1er juillet 2014.
14. Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23 juin 2001, STE n°185.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
364
15. La question du possible recours à la qualification d’agression pour désigner les actes de
cyberguerre a d’ores et déjà fait l’objet d’une littérature assez abondante ; voir par exemple : N.
Weisbord, « Conceptualizing Aggression », Duke Journal of Comparative & International Law, 2009,
pp. 1-68 ; J. Kulesza, « State Responsibility for Cyberattacks on International Peace and Security »,
Polish Yearbook of International Law, 2010, pp. 139-152 ; et, plus largement sur le recours à la force
et la cyberguerre : Max Planck UNYB, vol. 14, 2010, pp. 85-130.
16. Comité international de la Croix-Rouge, Le droit international humanitaire et les défis posés par les
conflits armés contemporains. Rapport, XXXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Genève, Suisse, 28 novembre-1er décembre 2011, 31IC/11/5.1.2, p. 42.
17. Voir par exemple : Le droit et l’immatériel, APD t. 43, 1999 ; A.-T. Norodom, « Propos
introductifs. Internet et le droit international : défi ou opportunité ? », dans : Colloque de la
S.F.D.I., Rouen, Internet et le droit international, Paris, Pedone, 2014, pp. 11 et s.
18. Voir : M.N. Schmidt (dir.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare.
Prepared by the International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defense
Centre of Excellence, Cambridge UP, 2013, spéc. pp. 15 et s.
19. Sur ces questions, voir par exemple : K. Dörmann, « Applicability of the Additional Protocols
to Computer Network Attacks », International Expert Conference on Computer Network Attacks
and the Applicability of International Humanitarian Law, Stockholm, 17-19 novembre 2004,
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/68lg92.htm ; V.M. Antolin-Jenkins,
« Defining the Parameters of Cyberwar Operations: Looking for Law in All the Wrong Places ? »,
Naval Law Review, 2005, pp. 132-173 ; L. Swanson, « The Era of Cyber Warfare Applying
Internaitonal Humanitarian Russian-Georgian Cyber Conflict », Loyola of Los Angeles International
and Comparative Law Review, Spring 2010, pp. 303-333 ; Interview de C. Droege, Conseillère
juridique du CICR, le 16-08-2011, « Pas de vide juridique dans le cyberespace », http://
www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2011/cyber-warfare-
interview-2011-08-16.htm ; H. Lin, « Cyber Conflict and International Humanitarian Law », RICR
vol. 94, n°886, 2012, pp. 515-531 ; J. Richmond, « Does Stuxnet Demonstrate a Need for
Modifications of the Law of Armed Conflict ? », dans : Cyber Attacks : International Cybersecurity in
the 21st Century, Fordham International Law Journal, March, 2012 ; J. Goldsmith, « How cyber changes
the laws of war », EJIL 2013, vol. 24-1, pp. 129-138 ; L. Baudin, Les cyberattaques dans les conflits
armés, Coll. Le droit aujourd’hui, L’Harmattan, 2014, 252 p.
20. E. David, Principes de droit des conflits armés, 5ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 78.
21. Sur ces questions, voir par exemple : M.N. Schmitt, « Computer Network Attack and the Use
of Force in International Law : Thoughts on a Normative Framework », Columbia Journal of
Transnational Law, 1999, pp. 885-936 ; M. Roscini, « World Wide Warfare – Jus ad bellum and the Use
of Cyber Force », Max Planck UNYB, 2010, pp. 85-130.
22. Tribunal arbitral germano-portugais, Affaire de Lysne (Responsabilité de l’Allemagne à raison des
actes commis postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne participât à la guerre), RSA II,
p. 1056.
23. Sur la question de la qualification d’agression pour les actes de cyberguerre, voir supra, note
n° 16.
24. Sur ces questions, voir : M.N. Schmidt (dir.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to
Cyber Warfare…, op. cit. : « RULE 2 – JURISDICTION. Without prejudice to applicable international
obligations, a State may exercise its jurisdiction : (a) over persons engaged in cyber activities on
its territory ; (b) over cyber infrastructure located on its territory, and (c) extraterritorially, in
accordance with international law ». Voir également : Ph. Lagrange, « Internet et l’évolution
normative du droit international : d’un droit international applicable à l’Internet à un droit
international du cyberespace ? », dans : Colloque de la S.F.D.I., Rouen, Internet et le droit
international, Paris, Pedone, 2014 ; A.-T. Norodom, « Propos introductifs… », ibid., pp. 28 et s.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
365
25. Les articles 4 et 5 du Projet d’articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité de l’Etat traitent ainsi de l’engagement de la responsabilité de l’Etat du
fait des actes de ses démembrements, c’est-à-dire de toute collectivité territoriale ou
entité « habilitée par le droit de cet Etat à exercer des prérogatives de la puissance
publique » (C.D.I., Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite, 2001, dans : Documents officiels de l’Assemblée générale, 56 ème session,
Supplément n° 10 (A/56/10).).
26. Sentence arbitrale, Fonderie de Trail, 11 mars 1941, R.S.A. III, p. 907.
27. La problématique de l’articulation entre droits de l’homme et cyber attaques ou cyberguerre
est habituellement exclue des études doctrinales ; pour exemple : M.N. Schmidt (dir.), Tallinn
Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare…, op. cit., p. 4.
28. AGNU, Déclaration sur les relations amicales entre les Etats, Résolution 2675 (XXV), 24 octobre
1970, § 1 : « les droits fondamentaux de l’homme (…) demeurent pleinement applicables en cas de
conflit armé » ; CIJ Avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires 1996 :
les droits de la personne s’appliquent ou doivent en tous cas être pris en compte dans la mise en
œuvre du droit des conflits armés.
29. Suite à l’intervention américaine à La Grenade (1983), la Commission interaméricaine des
droits de l’homme s’est par exemple déclarée compétente pour traiter d’une plainte introduite
suite au bombardement d’un asile d’aliénés dans lequel des pensionnaires avaient été tués ou
blessés (IACHR, Disabled People’s International et al. v. US, Decision of the Commission as to the
Adminssibility, OEA/Ser.L/V/II.71, Doc. 9 rev. 1, 22 September 1987, pp. 184-192). La Cour EDH
quant à elle considéré sous l’angle de la Convention des espèces relatives à la situation en
Tchétchénie (pour exemple : Cour EDH, Pitsayeva et autres c. Russie, 9 janvier 2014, n° 53036/08 et
autres).
30. Italiques ajoutés.
31. Cour EDH (Grande Chambre), Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, n° 55721/07, §
131 ; Cour EDH, (Grande Chambre), 19 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique et 16 autres Etats
membres, Décision d’irrecevabilité, 12 décembre 2001, n° 52207/99, § 59 ; Cour EDH, Al-Dulimi et
Montana Management Inc c. Suisse, n° 5809/08, 26 novembre 2013.
32. Cour EDH, (Grande Chambre), 19 décembre 2001, Banković…, ibid., § 30.
33. Ibid., § 53.
34. Ibidem, § 77.
35. Ibidem, § 44.
36. Ibidem, § 36.
37. Ibidem, § 43.
38. Dans le même sens, voir également : Cour EDH (Grande Ch.), Medvedyev c. France, 29 mars
2010, n° 3394/03, § 64 ; Cour EDH, Hirsi Jamaa et a. c. Italie, 23 février 2012, n° 27765/09, § 73.
39. Cour EDH, (Grande Chambre), 19 décembre 2001, Banković…, ibid., § 71.
40. Commission IADH,Inter-state petition IP-02, Admissibility, Franklin Guillermo Aisalla Molina,
Ecuador – Colombia, 21 octobre 2010.
41. Ibid., § 99.
42. Cour EDH, Loizidou c. Turquie, 23 mars 1995, n°15318/89, § 56 ; Cour EDH, Issa and others v.
Turquie, 30 mars 2005, n° 31821/96, § 71 ; CEDH, Andreas Manitaras and others v. Turkey, 3 June 2008
n° 54591/00, §§ 27-28 ; Cour EDH, Ilascu et a. c. Moldova et Russie, 8 juillet 2004, n° 48787/99, § 315.
43. Commission EDH, Stocké v. Germany, 12 October 1989, Series A, vol. 1999, 24, § 88.
44. Le caractère effectif du contrôle est décisif pour emporter juridiction extraterritoriale de
l’Etat : voir par exemple le raisonnement du Comité contre la torture concernant Israël dans :
GAOR, 64th sess, Suppl. No. 44. En faveur d’une interprétation contextuelle, pour chaque cas
d’espèce, du caractère effectif de ce contrôle, voir : M. Scheinin « Extraterritorial Effect of the
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
366
international Covenant on Civil and Political Rights », dans : F. Coomans, M.T. Kamminga (dir.),
Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, Oxford, Intersentia, 2004, pp. 73 et s., spéc.
p. 76.
45. Commission IADH, Affaire 10.675 c. Etats-Unis (Haitian Interdiction Case), 13 mars 1997, § 141.
46. Dans ce sens, voir notamment : R. Lawson, « Life After Banković : On the
Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights », dans : F.
Coomans, MT Kamminga (dir.), Extraterritorial Application of Human Rights Treaties,
Oxford, Intersentia, 2004, spéc. p. 98.
ABSTRACTS
The terminology “Cyberwar” lacks precision: the realities it covers, thus manifolds, are not
limited to armed conflict situations. “Cyberwar” raises many questions of international law that
cannot be all dealt with jus in bello rules, and thus needs further investigations in other fields of
international law such as international human rights law.
Qu’est-ce au juste que la cyberguerre, et quelles questions pose-t-elle au droit ? L’expression
« cyberguerre » est manifestement trop restrictive eu égard à la variété des contextes dans
lesquels s’inscrivent les attaques informatiques. Dès lors, les règles du jus in bello ne sauraient à
elles seules permettre d’appréhender un phénomène hétéroclite qui ne se limite pas aux
situations de conflit armé, et un recours à d’autres branches du droit, tel le droit international
des droits de l’homme, s’avère utile.
INDEX
Mots-clés: Cyberguerre – cyberattaque - droit international humanitaire - juridiction de l’Etat
Keywords: Cyberwar – cyberattack - humanitarian law - State jurisdiction
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
367
Los refugiados, umbral ético de un
nuevo derecho y una nueva política
Castor Bartolomé Ruiz
Introducción, los refugiados y exiliados, una otra globalización
1 1. El término refugiado está conexo con el de refugio, pero también con el verbo
fugarse, huir (del latín, fugam). El refugiado es el que tiene que fugarse y huir. La fuga
forzada le obliga a buscar refugio y le torna un refugiado. Los motivos que obligan al
refugiado a emprender la fuga pueden ser variados, pero en todos ellos habita una
violencia estructural, política, económica o cultural. El refugio se encuentra siempre en
los límites del Estado, en el umbral de las fronteras del derecho. El refugiado se ve
obligado a sobrevivir en los límites, en el umbral de las paradójicas contradicciones que
vinculan el derecho con la vida humana. Siendo habitante de los límites, el refugiado
sobrevive como un resto. Él representa aquello que resta de la condición humana
cuando la persona se ve obligada a vivir en los límites del derecho, en los espacios
fronterizos donde la excepción se tornó norma y el campo opera como dispositivo
biopolítico de control.
2 Los refugiados y exiliados invaden el mundo. Su presencia se globaliza sin que las
actuales instituciones puedan evitar esta condición humana forzada a existir. El
informe 2013 de la Agencia de la ONU para refugiados, ACNUR, contabilizaba 45,2
millones de personas desplazadas a lo largo del planeta 1. ACNUR tenía bajo su
responsabilidad de cuidado y protección a 35,8 millones de refugiados. Según sus
estimaciones, 23.000 personas se vieron obligadas a huir diariamente, abandonando sus
casas, ciudades y países debido a conflictos de todo tipo. Se calcula que la condición de
apátridas afecta a un total de, al menos, 10 millones de personas. Según el informe, más
de 893.700 personas solicitaron el estatuto de exiliado o refugiado en 2012 2. El propio
informe afirma que: “Que el año 2012 se caracterizó por crisis de refugiados que alcanzaron
niveles sin precedentes en las últimas décadas”3.
3 El informe de ACNUR traza un panorama escalofriante del siglo XXI, mostrando un
lado oculto de la globalización, del modelo económico y sus variados intereses políticos.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
368
Si como afirmaba Walter Benjamin, en su tesis VIII, Sobre el concepto de Historia, “No
hay un monumento de cultura que no sea también un monumento de barbarie”, la
invisibilización de los refugiados y exiliados es un intento de esconder la barbarie de
sus estructuras y las decisiones económico-políticas que los producen.
4 El panorama presentado por el informe de ACNUR, sin embargo, es incompleto. Este
informe no contempla en su estadística de refugiados y exiliados a las decenas de
millones de emigrantes económicos, legales o ilegales, que circundan el planeta,
obligados a abandonar sus casas, ciudades y países por la condición de pobreza extrema
y miseria en que viven. Tampoco considera en esta estadística las masas de refugiados
climáticos4 que debido a los cambios climáticos en curso y a los desastres ecológicos
permanentes que se comenten, son obligados a abandonar sus tierras, lares y países 5.
5 Esta breve e insuficiente fotografía de la coyuntura actual, muestra que la condición de
los refugiados y exiliados representa mucho más que pequeños traspiés del contexto
mundial, o meros errores puntuales de una globalización bien planificada. Su presencia
masiva, pero principalmente su condición humana, interpelan al modelo económico
que los causa, el capitalismo, a los actuales estatutos jurídicos y políticos del derecho
internacional vigente, al tipo de Estado imperante; igualmente ponen en jaque a las
organizaciones internacionales que existen. Los refugiados y exiliados emergen como
interpelación del orden nacional e internacional establecido en nuestro presente. Ellos
- parias, vencidos y víctimas de nuestra historia actual - son interpelación ética y
política de nuestro presente.
6 2. Los números de las estadísticas, por muy espeluznantes que nos parezcan, no
consiguen representar la crueldad a que se encuentra expuesta su condición humana.
Los números son fríos, cada dígito esconde el rostro de un ser humano, oculta el
semblante de un refugiado y exiliado cuya mirada nos interpela como alteridad
insoslayable. Ninguna palabra, estadística o informe puede suplantar la mirada dolorida
de un refugiado o exiliado. Las palabras, siendo parte de lo que somos, permanecen
inermes ante la realidad del sufrimiento humano.
7 La realidad de los refugiados y exiliados puede ser analizada desde diversas
perspectivas. La sociológica, con sus estadísticas y análisis empíricas; la jurídica,
analizando el entramado legal, o la política debatiendo las decisiones (im)pertinentes
de cada caso. Todas ellas son necesarias y complementares. Queremos contribuir para
este amplio y siempre inconcluso debate colectivo con una reflexión desde la
perspectiva filosófica del refugiado y exiliado. El refugiado y exiliado, lejos de ser mero
hecho marginal, una excepción dentro del sistema, se torna, en su condición de
excepción, un punto epistemológico y ético que revalúa la validez ético-política del
orden establecido. Los refugiados y exiliados, en cuantas víctimas de innumerables
injusticias, son el criterio de una nueva perspectiva de la justicia.
8 Este artículo presenta una reflexión sobre la condición límite y umbral fronterizo que
torna al refugiado un resto de humanidad pero también una categoría ético política. Al
habitar los límites, el refugiado muestra el umbral de una exterioridad que las
categorías habituales del orden establecido no perciben. El refugiado, en cuanto
habitante externo de un orden que no lo reconoce como ciudadano pleno, contiene la
potencialidad ética y política de cuestionar ese orden. Él es una víctima de la violencia
estructural que tuvo su alteridad negada y su dignidad herida. En esa condición de
víctima de la injusticia, el refugiado se establece como criterio ético que tiene
potencialidad para juzgar los dispositivos biopolíticos causantes de tal violencia.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
369
9 Dividiremos nuestra exposición en dos partes, primeramente presentaremos el
pensamiento de Maria Zambrano sobre los exiliados, a seguir la reflexión de Hannah
Arendt sobre los refugiados, en un tercer momento la reflexión que Giorgio Agamben
hizo sobre el texto de Arendt (I), y concluiremos con la exposición de cuatros aspectos
críticos que desde el límite de la condición de los refugiados se denuncia y se propone
(II).
I. Tres pensadores de la figura de los exiliados y
refugiados
A. María Zambrano, el exiliado, un límite de la existencia
10 3. Maria Zambrano es una filósofa española, 1904-1991, que vivió exiliada durante 45
años. Dejó su tierra natal huyendo del régimen fascista de Franco el 29 de enero de
1939, y sólo retornó en 1984. Durante décadas tuvo que peregrinar por muchos países
(México, Cuba, Puerto Rico, Italia, Francia, Suiza), cargando consigo la condición de una
exiliada sin refugio6. El exilio fue para ella, como para casi todos los que viven esta
experiencia, una marca indeleble en su vida. No hay estatuto jurídico o político que
pueda captar el efecto del exilio en la vida de los desterrados y refugiados. Cada lugar
de acogida era también una experiencia de desgarre, siempre extraña y extranjera en
lugares que la acogían pero que no colmaban la pérdida del exilio. El peregrinaje del
exiliado le arrancaba partes de sí que iba dejando por el camino. Maria Zambrano hizo
del exilio una categoría filosófica, una clave hermenéutica para aproximarse a la
existencia humana y, a partir de ella, posibilitar una crítica social 7. Maria Zambrano era
una filósofa poeta, una mística que filosofaba. Su mirada sobre el exilio tiene la marca
de la poetisa, la mirada de la mística, en ellas es posible encontrar una peculiar crítica
social.
11 Independientemente de los estatutos jurídicos y políticos, Zambrano hace una
distinción filosófica entre refugiado y exiliado. Para ella, estas categorías representan
experiencias diferentes, que no caben en las definiciones jurídicas que se hacen en los
estatutos del refugiado o en las leyes de los exiliados. Para la filósofa española, el exilio
es una experiencia de abandono real. “Comienza la iniciación al exilio cuando comienza el
abandono, el sentirse abandonado”8. La experiencia de abandono, aunque es concomitante
y se inicia con el destierro, con la salida forzada de la casa y la tierra, envuelve otra
dimensión mayor y más profunda. Para María Zambrano, el refugiado, por haber
encontrado un refugio que le confiere ese nombre, al menos tiene la experiencia de
verse acogido. Con mejor o peor voluntad, el refugiado, en esa condición, encuentra un
hueco para acomodarse. En el peor de los casos se siente tolerado.
12 Para Zambrano, el destierro tiene diversos pasos, en cada uno de los cuales se
desarrolla una determinada experiencia del mismo. El des-terrado es obligado a dejar
su tierra, aquella que hasta entonces le cobijaba y confería identidad a su existencia
cotidiana. Desterrado para otra tierra que le es extraña y en muchos casos hostil, se
torna huésped en tierra extranjera. En esa condición, es mirado frecuentemente como
un hostes, hostil y hostilizado, por ser un extraño, un extranjero. En cada tierra que
llega se ve obligado a peregrinar, viviendo una condición de vulnerabilidad que antes
desconocía. Para la pensadora, “encontrarse en el destierro no hace sentir el exilio, sino ante
todo la expulsión”9.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
370
13 4. El exilio se inicia como experiencia posterior, aunque la mayoría de las veces sea
concomitante, a la vivencia del destierro y la expulsión. El exilio comienza a sentirse
como experiencia del borde, del límite al que se siente arrojado el desterrado. La
expulsión para un límite externo de una tierra extraña trae consigo la experiencia de
salida para una exterioridad que es hostil. El límite es un umbral que el exiliado se ve
forzado a pasar. Ese umbral representa la salida de lo que era suyo, la pérdida de todo lo
que él era antes y el consecuente abandono para lo que no sabe qué será. El desterrado
vive la experiencia del límite, llega al umbral de lo que era suyo, de lo que él era, y es
obligado a traspasarlo, a salir para un afuera que le recibe amenazadoramente como un
extraño, un extranjero que siempre estará de paso.
14 El exilio comienza en el momento en que el destierro invade el alma, tornándola ajena a
toda tierra, incapaz de reconocer su casa en los lugares extraños en que se ve obligada a
refugiarse. El exilio penetra como abandono inexorable que lanza al desterrado a la
busca perenne de un refugio que compense la falta de su tierra, la ausencia de su casa.
El exilio se instala dentro del desterrado como experiencia de abandono e incapacidad
de soldar el abismo que surgió en su existencia desterrada. El exiliado, más que un
estatuto jurídico-político, es una condición existencial de abandono a la que están
sometidos los desterrados y refugiados que, tolerados en tierra extraña, no consiguen
hacer del extrañamiento su nueva casa.
15 El destierro lleva a la experiencia del exilio y ambas a la sequedad existencial. Una
sequedad que introduce el exiliado en un desierto sin fronteras y sin espejismos. Una
sequedad que produce en el exiliado la ausencia de sueños y expectativas, de ideales y
utopías. Ni siquiera le cabe el consuelo del espejismo, que es la antepuerta de los
sueños. Pero la sequedad ofrece al exiliado la posibilidad de estar despierto, atento a la
realidad concreta que le cerca. Según la autora, diferentemente del refugiado que
proyecta e idealiza una forma de rehacer su vida en un lugar diferente. El refugiado
crea expectativas y piensa en hacer una vida diferente, incluso una vida mejor. Para
este, las posibilidades están a su alrededor, posibilidades nuevas que no tenía en su
patria ni en su tierra y que ahora se le ofrecen como nuevas formas de rehacer la vida.
“Al propiamente refugiado, al únicamente refugiado, el destierro no le absorbe” 10.
16 5. Zambrano vislumbra en la condición existencial del exiliado, entre otras, la
potencialidad de un nuevo estatuto epistemológico, el de la revelación. Revelar es una
forma de conocimiento diferente del descubrir científico. Revelar supone acoger la
verdad que aparece, lo que implica una epifanía del otro. No es una verdad que yo
conquisto, es una verdad que el otro me ofrece11. La revelación excede al mero conocer
del objeto. Las cosas no revelan, se exponen para el desvelamiento conceptual y la
manipulación técnica. La revelación sólo puede provenir, como forma de conocer, de un
Otro.
17 La presencia del exiliado, por ser un umbral de exterioridad, revela, al que está en casa,
la intimidad de su cotidiano, que normalmente pasa desapercibida. La presencia
extraña del otro, el exiliado, contrasta con lo normal, revelándonos nuestra normalidad
como una diferencia. Él que anda sin tierra y sin casa revela el valor de la tierra y la
casa. “Al salir de ellas se quedó para siempre fuera, librado a la visión, proponiendo el ver para
verse; porque aquel que lo vea acaba viéndose,…”12. Pero la condición del exiliado también
revela una singular experiencia de la temporalidad. El exiliado espera que el Tiempo le
dé la razón, que con el pasar del tiempo su verdad sea reconocida y su injusticia
presentada. Pero el Tiempo, figura de Cronos, hijo de Urano, no tiene piedad con él. En
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
371
cuanto el exiliado confía en el tiempo para obtener justicia, el tiempo le devora. Las
razones y las verdades del exiliado son devoradas por el tiempo y con el tiempo. Cronos
es un dios inmisericorde e implacable. El tiempo lanza al exiliado entre los trastos que
se esconden, y lo oculta como algo y alguien que debe ser olvidado. Sin embargo, en los
sótanos del tiempo, el exiliado vive el desafío de reconocer que aquello que tiene es lo
primero que dejo de tener, el presente13. El presente de su presencia, es su posibilidad,
aunque no puede renunciar al porvenir. Esa tensión de un presente que debe ser vivido
como momento inexorable de una existencia fugaz, y un futuro que necesita ser mejor,
esa tensión revela el abismo de la experiencia del exiliado que fácilmente se entrega al
futuro como:” el dios desconocido, el trasfondo del Tiempo” 14 en el que deposita toda su
confianza.
18 6. El exiliado, en su experiencia de abandono, encarna la figura del desconocido. El
desconocido se caracteriza por no tener un lugar conocido en el mundo, es desconocido
geográfico, social, político, incluso ontológico. “No ser nadie, ni un mendigo. No ser nada” 15.
El exiliado representa, más que nadie, lo que no puede dejarse ni perderse, porque ha
dejado de ser todo para poder mantenerse sin ningún punto de apoyo. La historia se ha
tornado, para él, como agua que no lo sostiene, y por no poder sostenerse, la historia se
ha vuelto una amenaza para él. Un océano que puede tragarle a cualquier instante.
19 El exilio está marcado por el abandono, por la experiencia de estar abandonado. El
abandono, como experiencia, carga consigo el estigma del desamparo. Al principio no
nota para donde está siendo empujado el exiliado, en poco tiempo percibirá en sí la
sombra de la inmensidad. Sin el desamparo, la inmensidad no aparece ni se percibe
como experiencia. De igual forma, es la realidad del abandono que lanza al exiliado en
el desierto de la experiencia de la inmensidad. La inmensidad que deja desamparada la
existencia y que torna la vida desnuda: “desnuda ante los elementos, que entonces muestran
toda su fuerza”16. La inmensidad aparece cuando, después de la experiencia traumática
del destierro inicial, el desterrado tiene que luchar para no caer en la desesperación ni
en la exasperación y consigue aminorar la agonía del desamparo. En ese momento, la
esperanza también se ha oscurecido y la inmensidad se va haciendo presente. La
inmensidad de un horizonte fluido, de un desierto ilimitado sin esperanza definida.
Afirma Zambrano que: “La existencia del ser humano a quien esto acontece ha entrado ya en el
exilio”17.
20 El exiliado, en esa condición, para no perderse en el desierto y el abismo de la
desesperanza, “tiene que encerrar el desierto dentro de sí” 18. El refugiado, alimentado de
islas de esperanza que le mantienen a cobijo del desespero, camina entre escombros.
Son los escombros de la historia. Él forma parte de esos escombros. El escombro se
torna un límite que expone la barbarie de la historia. Entre los escombros en que se
encuentran arrojados, los refugiados y exiliados consiguen percibir otra perspectiva de
la realidad, otra historia. Construyen otra mirada, crean una nueva percepción, de
modo que hacen reaparecer aquello que: “apenas nacía o lo que ni pudo asomar
mínimamente su rostro, lo que no llegó al vacío…”19. El exilio es un lugar privilegiado para
que la propia sociedad se descubra, para que el concepto de Patria se cuestione y se re-
signifique. Lo paradójico, afirma Zambrano, es que la propia Patria tiene la virtud de
crear el exilio.”Es su signo inequívoco”20. Crea el exilio para todos los que no se adaptan a
sus nuevas exigencias de patriotas. Surge, entonces, otra historia, una historia apócrifa.
La Patria es un concepto inmisericorde que condena al exilio a los que expulsa, pero un
día expulsará como exiliados de la nueva historia a los que se quedaron. La Patria, en
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
372
cuanta construcción cultural y política, no deja opción, incluso a los que ganan y se
quedan: “o no se despiertan, o se despiertan en el exilio”21. La idea de Patria, a través de
producción masiva de exiliados y refugiados, revela lo apócrifo de la Historia. La idea de
patria verdadera, como la de sociedad perfecta, es siempre algo por nacer, algo por
hacer y sólo se realiza en pequeñas islas, en las que crea, también, el exilio.
B. Hannah Arendt, Nosotros refugiados
21 7. Hannah Arendt, 1906-1975, es otra filósofa que vivió la amarga experiencia del exilio.
Su condición de judía alemana le hizo participar, como víctima, de la terrible barbarie
nazi. Conoció el peregrinaje sin retorno del exilio. Huyendo del nazismo, tuvo que
abandonar su tierra, pasando por Ginebra, Praga, hasta llegar a París. El avance del
nazismo sobre Francia le hizo conocer la prisión y el campo de concentración, Gurs 22,
hasta 1941, cuando consiguió huir hacia Estados Unidos. Arendt conoció la experiencia
del exilio y de ser apátrida. En Estados Unidos permaneció como apátrida hasta 1951.
Después, aunque volvió en diversas oportunidades a Alemania, nunca más consiguió
regresar definitivamente a su tierra ni hacer la nueva tierra algo suyo. Peregrinó
existencial y políticamente como exiliada, semejante a la experiencia de María
Zambrano.
22 En 1943, escribe un artículo, We refugees, para una pequeña revista Menorah, en que
aborda de forma reflexiva la condición de los refugiados a partir de su propia
experiencia. Arendt inicia su reflexión con una afirmación contundente: “No nos gusta
que nos llamen de refugiados”23. Entre nosotros mismos, escribe Arendt, preferimos
llamarnos emigrantes o recién llegados. En este punto, Arendt traza la paradoja que
atraviesa a muchos de los refugiados con los que convive. Hasta ese momento, el
término refugiado es un nombre que daba a aquellos que tuvieron que procurar refugio
porque cometieron algún delito político de opinión u oposición. Con ellos, con los
refugiados judíos, cambia el sentido del término refugiados. Muchos de los que tuvieron
que huir y abandonar su tierra en Alemania, Francia, Italia no tenían una opinión
política ni una militancia social definida. Llegaron a la condición de refugiados al ser
perseguidos por su mera condición de judíos y porque fueron acogidos por “Comités de
refugiados”.
23 Antes de la guerra era común que los que tenían que salir se auto-convenciesen de que
lo hacían como emigrantes o nuevos pobladores, ocultando la condición judía que, en
muchos casos, les obligaba a salir. La condición de emigrantes parecía ofrecer un
horizonte de optimismo y nuevas posibilidades. Envueltos por este optimismo,
ocultaban la realidad de que fueron forzados a salir y con la salida dejaron para atrás
grandes pérdidas existenciales. Perdieron la casa, lo que significa perder la familiaridad
de la vida cotidiana; perdieron sus trabajos, que equivale a perder la confianza en el
saber hacer de este mundo; perdieron la lengua, lo que trae consigo perder la
familiaridad de los gestos, la espontaneidad de expresar los propios sentimientos;
perdieron familiares y amigos en los guetos y campos de concentración, lo que supuso
una ruptura abismal en sus vidas particulares.
24 Todas estas pérdidas son arrastradas silenciosamente en cada nueva adaptación,
exigida por las circunstancias de cada nueva tierra y nación. A cada lugar que llegaban,
intentaban adaptarse como su nueva casa, esforzándose por ser buenos franceses en
Francia, buenos americanos en Norte América, como fueron buenos alemanes en
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
373
Alemania. Incluso los más optimistas pretendían pensar que su antigua vida era un
exilio pasado y que la nueva vida es mucho mejor. Arendt presenta, irónicamente, el
ejemplo de Mr Cohn que en Berlín había sido 150% alemán, un alemán super-patriota.
En 1933, se encontró refugiado en Praga y muy rápidamente se volvió un patriota 150%
checo. En 1937, expulso de Praga por el gobierno Nazi, se refugia en Viena, donde
decide ser definitivamente un patriota 150º% austríaco, como era requerido. La
invasión alemana le obliga a ir para Paris, donde Mr. Cohn nunca recibió un permiso de
residencia regularizado. A pesar de estas pequeños inconvenientes administrativos,
decide de forma convicta que su vida futura está en Francia y que se debe preparar para
ser un buen francés, como "nuestro" antecesor Vercingetorix24.
25 En muchos casos, se evitaba hablar de las persecuciones y de los campos de
concentración, para que no se interpretase como pesimismo o desconfianza de la nueva
tierra. Aparentemente, nadie estaba interesado en conocer el horror del infierno tan
próximo, ni el tipo de seres humanos a que habíamos sido reducidos en los campos de
concentración25.
26 Quien es forzado a abandonar su tierra, deja para atrás lo que él era. En la nueva
situación, el tratamiento burocrático le rebaja la condición de persona ciudadana a la
de mero ser humano indiferente e potencialmente indigno. Todos los refugiados dejan
para atrás su historia y pasan a incorporar el vacio de un formulario; ellos son simples
datos formales rellenados por un funcionario. Un número abstracto que debe ser
recibido y encajado en procedimientos burocráticos. La gran paradoja es que los
refugiados son acogidos en los diversos países en nombre de los derechos humanos,
pero: “aprendemos rápidamente que en este mundo pervertido es más fácil ser aceptado como
un ‘gran hombre’ que como un mero ser humano”26. Arendt anota que hay leyes no escritas
que vigoran más eficientemente que las leyes formalmente establecidas. Esas leyes no
escritas, las del prejuicio cultural, las del desprecio social, aunque no son oficialmente
admitidas, son las que más directamente afectan a los refugiados. Esas leyes tienen la
fuerza de una opinión pública. Lo que lleva a concluir, a Arendt, que la silenciosa opinión
pública es más importante en sus vidas (la vida de los refugiados) que todas las
declaraciones oficiales de hospitalidad y bienvenida. Eso provocaba que: “´podíamos
fácilmente detectar el desespero enfermizo de la asimilación” 27.
27 8. Arendt, como hizo María Zambrano, reflexiona sobre la condición de los refugiados a
partir de su experiencia personal. Por ello, su reflexión está cargada de matices
existencialistas y de vivencias humanas con un tono crítico muy acentuado. Para
Arendt, una parte importante de la asimilación forzada proviene de otro problema
previo y mayor. Ellos se encontraban desposeídos de ciudadanía, en la condición de
apátridas, abandonados de todo derecho, eran meros judíos. Eso significaba que, en una
especie de insulto conceptual, eran, sólo, meros seres humanos.
28 Este es uno de los puntos críticos del pensamiento de Arendt sobre la relación entre el
derecho y la vida humana. A partir de la experiencia concreta ocurrida con el nazismo,
aquellos que perdieron la ciudadanía y se tornaron apátridas no están protegidos por el
derecho porque son meros seres humanos. En un efecto paradójico, ocurre que por
encontrarse en la condición de apátridas, sin un derecho nacional y una ciudadanía que
recubra su mera condición de seres humanos, incluso en los Estados de derecho, sus
vidas son, para el derecho, meras vidas naturales o biológicas abandonadas a su suerte.
El vacio del derecho, provocado por la ausencia de ciudadanía, es ocupado por el
prejuicio de aquellos que mantienen este estatuto, en cierta forma, privilegiado.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
374
Ciudadanos que no se sienten meros seres humanos, como los refugiados apátridas, y
que miran aquellos desterrados como extraños que llegan en la condición de intrusos.
El refugiado llega como extranjero y es acogido por un acto de benevolencia, pero su
condición de extraño permanece. El extrañamiento, su diferencia distante, es el caldo
de cultivo de la discriminación. Lo que lleva a concluir a Arendt que:“desde que la
sociedad ha descubierto que la discriminación es una poderosa arma social por la cual alguien
puede ser muerto sin derramar sangre […] ya no son necesarios papeles para materializar la
distinción social”28.
29 Arendt desarrolla más ampliamente la contradicción entre el derecho y la vida humana
de los refugiados apátridas en el capítulo 5, El declinio del Estado-nación y el fin de los
derechos del hombre, de la II parte, El Imperialismo, de su obra, Orígenes del Totalitarismo 29.
La actual formulación de los derechos humanos vincula, de forma inexorable la
vigencia efectiva de los derechos a la existencia del Estado nacional moderno, de tal
modo que la falta del Estado equivale a la usencia de derechos. Lo paradójico es que el
refugiado apátrida, figura que debería encarnar por excelencia los derechos de la vida
humana, muestra el vacio que aparece cuando su vida, que reclama por derechos
fundamentales, no encuentra medios efectivos que implementar esos derechos. La
declaración formal de derechos está muy lejos de ser una garantía real de los mismos.
El refugiado es un testigo palpable de que hay un abismo entre mera vida humana y el
derecho30. El concepto de derechos del hombre, según Arendt, basado en la mera
existencia del ser humano como tal, se ha arruinado a partir de todos los
acontecimientos que muestran que aquellos que han perdido todas las otras formas de
identidad política y sólo les resta el ser meros seres humanos, están en un total
abandono del derecho. La vida humana despojada de los derechos otorgados por el
Estado se encuentra totalmente desprotegida, por lo que esos derechos sólo pueden
denominarse de derechos de los ciudadanos de un Estado y difícilmente derechos de la
persona o de la vida humana.
30 Esta cisión ya está explícita en el propio título de la Declaración de 1789, Declaration des
droits de l'homme et du citoyen. El título de la declaración refleja la ambigüedad y el
dualismo que existe entre hombre y ciudadano. No deja claro si son dos realidades
diferentes e in-asimilables una en la otra, o una especie de dualismo en que el segundo
término (ciudadano) ya estaría contenido en el primero (hombre). En esta última
hipótesis, cabría preguntarse: ¿Por qué diferenciar dos tipos de derechos si los derechos
del hombre engloban los del ciudadano? La separación no es casual ni anodina, muestra
la cisión que separa el derecho de la vida humana, y que no hemos conseguido superar.
31 Arendt concluye la reflexión de su artículo, We refugees, afirmando una especie de tesis
política según la cual: “los refugiados que viajan de un país para otro representan la
vanguardia de sus pueblos”31. Esta afirmación no es desarrollada por la autora en otros
textos que sean de nuestro conocimiento, y aparentemente se pierde en el contexto de
su comentario anterior. Pero ella apunta para un nuevo significado político del
refugiado, más allá del estatuto de marginalidad y tolerancia benevolente que se le
otorga. Afirmar que los refugiados “son la vanguardia de su pueblo” los posiciona como
paradigma de una nueva conciencia histórica. En la condición de vanguardia del pueblo,
dejan aquella condición de deshecho social acogido por caridad, para a vigorar como
modelo de un nuevo estatus político.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
375
C. Giorgio Agamben, nosotros refugiados, la vanguardia del pueblo
32 9. Giorgio Agamben, en un simposio, 1995, retomó el ensayo de Hannah Arendt, We
refugees, en el punto donde la pensadora terminó, escribiendo un nuevo ensayo con el
mismo título, We refugees32. Agamben inicia su reflexión a partir de la tesis conclusiva de
Arendt de que los refugiados “son la vanguardia del pueblo”. Este autor propone pensar el
refugiado como una categoría política. Específicamente, como una categoría límite. Una
categoría que delimita los límites de las otras categorías clásicas del derecho y la
política occidentales que desde el siglo XVII han servido para validar las estructuras e
instituciones en que nos movemos. El refugiado es una categoría que, en la actual crisis
del Estado-nación en que vivimos, nos permite percibir algunos contornos posibles para
la comunidad política que vendrá33. Pero también es una categoría que nos ayuda a
pensar, en el límite, la insuficiencia de otras categorías comunes de nuestra política y
del derecho, como hombre, ciudadano con derechos, pueblo soberano. Específicamente,
el refugiado, en su límite, cuestiona los modelos de soberanía de las sociedades
modernas, los tipos de legitimación de la soberanía utilizados que le expulsan para el
umbral externo de ciudadanía como un mero ser viviente. El límite que Zambrano veía
en el exiliado como umbral existencial se convierte, para Agamben, en la categoría
política del refugiado.
33 Agamben indica que no podemos diferenciar fácilmente refugiados de apátridas, pues
en muchos casos los propios refugiados prefieren ser apátridas antes que retornar a su
país en las condiciones que se vieron obligados a salir. Es el caso de los españoles
republicanos que eran amenazados de ser devueltos a la España franquista, o de los
judíos alemanes de ser entregados al gobierno nazi. Pero actualmente es la situación de
innumerables emigrantes que prefieren permanecer apátridas para que no puedan ser
repatriados a la fuerza.
34 En cualquier caso, Agamben llama la atención, como anteriormente hizo Arendt, de que
la genealogía de los apátridas tiene sus orígenes en los Estados occidentales que desde
la I Guerra Mundial percibieron que la suspensión de los derechos de ciudadanía era un
dispositivo biopolítico eficiente para controlar las poblaciones de nacionales cuyo
origen étnico era problemático por algún motivo. Por ello, las leyes de Nuremberg,
1935, que retiraron la nacionalidad alemana a todos los judíos, no hicieron nada más
que repetir un dispositivo que ya había sido utilizado por Francia, Bélgica y Rusia, entre
otras naciones, durante y después de la I Guerra Mundial.
35 Agamben percibe en la figura del refugiado el límite en que se muestran las diversas
contradicciones que vinculan el derecho con la vida humana en los Estados modernos y
en la política occidental. En primer lugar, en el refugiado apátrida opera el dispositivo
de la excepción a través del cual el derecho amenaza la vida con su suspensión 34. La
excepción es un dispositivo que expulsa la vida fuera del derecho y la captura en una
zona de anomía, sin permitir su expulsión total35. El mismo derecho que protege la vida,
la amenaza con el abandono, especialmente en aquellos casos en que las personas no se
ajustan a las demandas del orden establecido. En este caso, cuando el derecho es
retirado de la vida humana, esta queda simplemente excluida, ella es incluida en una
zona de anomía en la cual está expuesta de forma vulnerable a cualquier violencia. La
excepción opera como dispositivo que incluye (en la anomia) a través de la exclusión
(del derecho), y excluye a través de la inclusión: una inclusión excluyente o una
exclusión inclusiva. Esa es la condición en que se encuentra la ancestral figura del Homo
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
376
sacer, en el derecho romano antiguo. Su vida no puede ser legalmente condenada, pero
cualquiera que la violente no comete delito. Es una vida cuya violación es inimputable 36.
36 La condición del homo sacer es la del abandono. Abandonado del derecho peregrina por
una zona de anomia en la cual vigora la inimputabilidad de cualquier violencia. El
abandono, que era para Zambrano la experiencia que definía al exiliado, es, para
Agamben, la consecuencia política del vacío jurídico en que la condición del refugiado y
apátrida se encuentran como nuevos homini sacri. El abandono traía consigo, para
Zambrano, la experiencia de la inmensidad y del desierto en que el exiliado era
obligado a vivir. Para Agamben, el abandono del derecho empuja a vivir en la condición
de bando37.
37 El refugiado también encarna el límite en que el derecho, al proclamarse como derecho
de los ciudadanos y derechos del hombre, defiende al ciudadano abandonando al ser
humano, que sin derecho ni ciudadanía no es nada más que una vida desnuda. La vida
desnuda es la mera vida biológica en que se encuentra reducido el ser humano
abandonado de cualquier derecho38. Para María Zambrano, la vida desnuda es lo que
aparece como resto último de la experiencia del abandono. Para Agamben, siguiendo en
esto a Benjamin, la vida desnuda es el resto de humanidad que queda, ahora reducida a
mero cuerpo biológico, cuando es abandonada por el derecho.
38 10. Para Agamben, así como para Arendt, Benjamin y Foucault, el motivo de esa
incapacidad del derecho en proteger, de hecho, la vida humana no proviene de la
insuficiencia de los mecanismos procedimentales, ni de la falta de voluntad efectiva de
los gobernantes, ni de algún otro factor puntual. La escisión que separa al derecho de la
vida humana, en los Estados modernos y en la política occidental, proviene del
paradigma biopolítico a través del cual la vida humana fue traída para dentro del
Estado nación como soporte biológico del propio Estado.
39 La mera vida desnuda en la Grecia era denominada de zoe y pertenecía al dominio de la
naturaleza, como la vida de todos los otros animales; la zoe, por ser vida natural estaba
fuera de la política clásica. La política, en Grecia, debería construir una verdadera vida
humana, bios, diferenciada cualitativamente de la mera vida natural, zoe. En las
sociedades pré-modernas del Medioevo la vida natural era sagrada y de dominio divino.
Esta percepción cambió en las sociedades modernas donde la vida desnuda, la pura vida
natural, se tornó el fundamento del propio Estado. Por ello se denominó de Estado-
nación, porque el soporte del Estado está en el hecho biológico de nacer. A través de la
vinculación del nacimiento con la ciudadanía, la vida humana es capturada como
soporte del Estado. De esta forma los nacidos son recubiertos jurídicamente como
ciudadanos y transformados en soporte de la soberanía nacional. La ficción jurídico
política moderna hace que el nacimiento se torne inmediatamente nación, y
concomitantemente expulsa para fuera de ese derecho y de esa nación a los no nacidos
en ella. Según Agamben, el punto crítico de esta cooptación biopolítica es que la vida se
torna un medio para el Estado y sus instituciones, aunque formalmente se afirme otra
cosa. La vida humana es insertada en la lógica del Estado de modo instrumental, en
cuanto medio eficiente para sustentar sus fines.
40 La figura del refugiado expone las contradicciones de este modelo biopolítico. Su
presencia marginal, en el margen de todo ordenamiento institucional, expone los
límites en que se sedimentan las instituciones modernas y que son insuficientes para
defender la vida cuando esta se encuentra fuera de un Estado o un derecho instituido.
La tensión que atraviesa la existencia límite del refugiado no proviene de los egoísmos
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
377
nacionales o de la inercia de las máquinas burocráticas de los Estados. Hay una serie de
mecanismos estructurales que el refugiado en cuanto límite desenmascara mostrando
sus contradicciones. Una de ellas es la ineficiencia de la estructura formal del derecho
en su relación de exterioridad instrumental con la vida humana. La condición del
refugiado muestra que hay una impotencia constitutiva del derecho en relación a la
vida humana. Las razones para esta impotencia no están apenas en el egoísmo o en la
ceguera de las burocracias, si no en las nociones básicas que regulan la inscripción de la
vida humana en el orden jurídico del Estado-nación.
41 Agamben, siguiendo la misma argumentación de Arendt, destaca que los tres primeros
artículos de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, expresan las
contradicciones anteriormente esbozadas. Ellos inscriben el elemento nativo (el nacer)
como núcleo de toda asociación política (art. 1 y 2), pudiendo concluir el art. 3 el
principio de soberanía de la nación con base en su étimo, natio, que originalmente
significaba simplemente “nacimiento”. La ficción aquí implícita es que el nacimiento se
torna inmediatamente nación, de tal forma que no puede haber distinción entre los dos
momentos: nacimiento y ciudadanía. Los derechos son atribuidos al hombre en cuanto
vida desnuda que sirve de soporte al ciudadano.
42 Esta tensión contradictoria entre la mera vida humana y la ciudadanía es inherente a la
formación del Estado moderno, y nunca fue plenamente resuelta. La condición de los
refugiados, en la medida que es una realidad que no cesó de aumentar, expone a lo vivo
esta contradicción. Ella se encuentra registrada en el empeño de la constitución
francesa de 1793 de distinguir y diferenciar los derechos afirmando que los derechos
del ciudadano no son los mismos que los derechos del hombre. Estos tienen un carácter
pasivo, en cuanto los del ciudadano son derechos activos de aquellos que contribuyen
económicamente con impuestos y propiedades39. La cisión entre el derecho y la vida
humana, lejos de ser coyuntural permaneció como una marca estructural del propio
derecho moderno que no fue resuelta de forma plena. En los Estados de derecho,
aunque se reconocen formalmente los derechos de la persona humana, el derecho no
defiende efectivamente la vida humana, sino al ciudadano. Incluso la noción de
ciudadano es defendida por el derecho en la medida que este se ajusta al orden
establecido, por ello, en última instancia, el derecho tiene por objeto la defensa del
orden.
43 11. Según Agamben, en el sistema Estado-nación, el refugiado representa un elemento
inquietante porque quiebra la identidad entre el hombre y el ciudadano, entre la
natividad y la nacionalidad. El refugiado pone en crisis la ficción original de la
soberanía moderna. Excepciones individuales a este principio hubo siempre, la novedad
de nuestros tiempos es que cada vez mayores parcelas de la humanidad no se sienten
representadas políticamente por el sistema de Estado-nación. Por este motivo, y en la
medida que el refugiado cuestiona la vieja trinidad del Estado-país-territorio, esta
figura aparentemente marginal del refugiado muestra los límites de esos márgenes en
que habita. Los márgenes, en la medida que son habitados cada vez más por mayorías
refugiadas en esos límites, tienden a colapsar la estructura que los produce.
44 En la actual estructura de Estado permanece abierta la fenda que separa la vida humana
de la ciudadanía. El refugiado sobrevive en esa fenda. El Estado limita la vigencia de su
derecho a sus ciudadanos, los otros no pasan de meros seres humanos que existen en
los límites de su derecho. Esos otros son dignos de respeto y tolerancia, pero no hay
ninguna responsabilidad con ellos porque se encuentran en el límite externo del
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
378
derecho, en una zona de anomia donde, de hecho, vigora la excepción como norma. En
ese límite, habita el refugiado. Esta paradoja hace que, a pesar de todas las
proclamaciones universales de la igualdad natural de derechos fundamentales, un
ciudadano perteneciente a un Estado fuerte se sentirá mucho más protegido en sus
derechos que el de un Estado débil.
45 Cuando se afirma que los derechos del hombre no son los mismos que los del ciudadano
se arquitecta una estructura política por la cual el mero hombre, cuando no sea más
reconocido como ciudadano, incorporará en si la figura del homo sacer del derecho
romano arcaico. El refugiado y apátrida es el nuevo homo sacer abandonado por el
derecho de la falta de ciudadanía y expuesto vulnerablemente a la violencia impune.
46 Cabe preguntarse, ¿Qué resta para aquellos que fueron expulsos de sus tierras y países,
que ni Estado tienen y (sobre)viven en el límite de todo derecho como resto
abandonado? Para estos refugiados del límite resta la “ayuda humanitaria”.
Reconociendo y alabando la buena intención de personas e instituciones que se dedican
a la ayuda humanitaria, esta no deja de ser un sucedáneo de la falta de derechos. La
ayuda humanitaria es lo que resta cuando no hay posibilidad de defender los derechos
fundamentales. La ayuda humanitaria acoge la vida humana pero no tiene el poder de
exigir o defender sus derechos. La propia acogida humanitaria tiene la marca de la
fragilidad vulnerable. En este contexto debe interpretarse la crítica de Hannah Arendt y
su afirmación de que una vida despojada del derecho es una vida sin derechos
fundamentales.
47 12. Agamben, en su ensayo, We refugees, presenta una tesis más contundente que la de
Arendt sobre el significado político del refugiado. El filósofo italiano afirma que es
necesario separar radicalmente el concepto de refugiado del de los “derechos del
hombre”, y parar de considerar el derecho de asilo como una categoría conceptual o
política para la que converge el destino de los refugiados. El asilo no es derecho que
resuelve el problema de los refugiados, ni la figura jurídica que permite comprender el
significado político de esta condición humana. El asilo no deja de ser una benevolencia,
cada vez más escasa y dificultada por los propios Estados de derecho, a través de la cual
se inserta la condición política del refugiado en una condición humanitaria provisional
y vulnerable, siempre dependiente de la benevolencia de las autoridades que tienen el
poder de otorgarla o retirarla. Para Agamben, el refugiado debe ser considerado por
aquello que realmente es, o sea, nada más y nada menos que un concepto radicalmente
fronterizo, un límite externo que pone en cuestión los propios principios del Estado-
nación. Desde su condición de límite, el refugiado interpela y ayuda a pensar y renovar
las categorías modernas que no sirven más para defender la vida humana como tal.
48 Retomando la tesis de Arendt, Agamben sugiere que los refugiados representan, de
hecho, “la vanguardia de su pueblo”. Pero eso no quiere decir que podrían ser el núcleo de
otro futuro Estado-nación. Para Agamben, solamente en una tierra donde los espacios
de los Estados hayan sido agujereados y topológicamente deformados, y el ciudadano
haya aprendido a reconocer en sí mismo la realidad del refugiado que existe en él,
solamente en y a partir de esas dos condiciones es posible pensar la sobrevivencia
política del mundo futuro.
49 En lugar del Estado-nación, tenemos que imaginar la posibilidad de construir
comunidades políticas en las que el principio político fundador sea la
extraterritorialidad recíproca, lo que obligaría a repensar nuevas relaciones
internacionales. El concepto político orientador de reconocimiento no sería más el ius
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
379
del ciudadano, en su lugar vigoraría el refugio del individuo. Eso significaría que en
lugar de Estados nacionales divididos por fronteras territoriales, habría que crear
comunidades políticas diversas y en movilidad permanente. El concepto de persona
podría volver a tener un sentido político importante, que ahora ha perdido porque ha
sido usurpado por el concepto de nacional. Desde la perspectiva que nos desafía a
pensar nuevas formas políticas, más allá del Estado-nación, los refugiados representan
una vanguardia. Ellos son el indicio que indica una orientación posible para donde
dirigir los esfuerzos y luchas políticas futuras.
II. La figura contemporánea del refugiado:
contradicción y perspectivas críticas
50 13. Las reflexiones diferenciadas, pero también conexas, de Maria Zambrano, Hannah
Arendt y Giorgio Agamben reconstruyen la dimensión de los refugiados desde nuevas
perspectivas. A su vez, los análisis entrecruzados de sus perspectivas nos permiten
esbozar algunas importantes contradicciones que la condición límite del refugiado
torna evidentes.
A. El derecho y la vida
51 La primera es que el derecho no puede proteger la vida a través de meras declaraciones
formales, de tratados o de principios universalmente aceptados. No obstante, fuera del
derecho, la vida entra en una zona de excepción donde queda expuesta a la violencia no
imputable. Aunque el derecho, por sí sólo, es incapaz de defender la vida humana, sin el
derecho la persona humana queda reducida a mera condición de animal viviente, y,
consecuentemente, bajo el arbitrio de la fuerza.
52 La tensión contradictoria entre el derecho y la vida queda evidente en la condición del
refugiado. Este, con todas las versiones posibles de apátrida, desterrado, emigrantes sin
papeles, o exiliado, se configura, en varios aspectos, como un límite, una frontera del
derecho, que juzga la validez del propio derecho. Él vive en los límites, pero,
concomitantemente, esa condición le confiere la potencia de ser una categoría límite
para el propio derecho. El refugiado vive en el límite, se refugia en los límites, pero
también desconstruye críticamente los límites; él es un límite a partir del cual son
cuestionadas las otras delimitaciones. Sobrevive en el umbral de la exclusión de los
derechos, subsiste en la frontera externa de las instituciones modernas como el Estado,
el derecho, la nación, la ciudadanía, a modo de elemento extraño, tolerado pero no
integrado.
53 La condición del refugiado es la de la lucha por la sobrevivencia, sin que su vida sea
reconocida con una dignidad de derechos igual a la de cualquier ciudadano. La recusa a
reconocerle los mismos derechos de un ciudadano expone la arbitrariedad excluyente
con que esas categorías operan. El refugiado existe en la frontera del derecho, un
espacio con un mayor o menor vacío del derecho que permite que la excepción se torne
la norma de su existencia. En esa condición límite, su vida se encuentra reducida a la
condición de mero ser viviente, una vida desnuda.
54 Existe otra cara pro-positiva en la condición límite del refugiado. En el límite, la vida se
rebela contra los límites que la excluyen proponiendo la propia vida humana como
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
380
nueva categoría ética que juzga la validez de las instituciones políticas. El refugiado se
torna, en el límite, una alteridad ética, una referencia sobre la (in)justicia de las
estructuras que lo limitan y excluyen. El refugiado se vuelve una exterioridad que juzga
la inadecuación del modelo económico y de las estructuras políticas que lo confinan a
una exclusión perenne. En este sentido, el refugiado se transforma en un límite ético de
las instituciones económicas y políticas modernas.
55 Esta primera paradoja del refugiado se contrapone a los discursos que pretenden
naturalizarlo como un efecto colateral inevitable de los modelos estructurales. El límite
fronterizo en que sobrevive se destaca como un espacio crítico de exterioridad que
posibilita juzgar críticamente la realidad del orden establecido y sus dispositivos de
naturalización. Lo que está en juego en el límite es la sobrevivencia del refugiado, es su
propia condición humana. El empeño en naturalizar su condición de refugiado como
algo normal e inevitable en el tablero de las relaciones internacionales o en la lógica
económica del mercado, ese discurso normalizador, es des-construido desde alteridad
negada del refugiado como siendo un artificio ideológico que encubre intereses
corporativos y otras estrategias de acción.
B. El refugiado y la seguridad
56 14. El límite fronterizo en el que sobrevive el refugiado desenmascara una otra
contradicción, la de los dispositivos de seguridad. El refugiado es el resultado de una
violencia estructural, del Estado y del mercado, legitimada, la mayoría de las veces, por
dinámicas que se dicen necesarias para preservar de otros males mayores. La violencia
Estatal o económica procura su legitimación en los llamados discursos de seguridad.
Para otorgar mayor seguridad a los ciudadanos de bien, se legitiman determinadas
intervenciones militares o económicas cuyos resultados ya contemplan la inevitable
expulsión, emigración o simplemente huída de sus territorios de personas y
poblaciones que se unirán al contingente mundial de refugiados ya existente. Las
políticas de seguridad forman parte del marco biopolítico que rige la lógica política e
económica moderna40. En ella, se legitima el uso de la violencia como una técnica de
gobierno necesaria para defender la vida: en nombre de la defensa de la vida se tolera
violentar otras vidas. Para defender a unos se ataca a otros, a sabiendas de que esa
intervención producirá efectos colaterales, que son los refugiados. Esta paradoja de la
biopolítica legitima el uso de la violencia para defenderse de amenazas posibles o de
otras violencias invocadas y provocadas. Se legitima la violencia de Estado para,
supuestamente, defender civiles, o derribar dictadores, o prevenir el terrorismo
internacional. De esta forma, se consolida la práctica de la guerra preventiva en el
marco de las relaciones internacionales. Es sabido que la mayoría de las intervenciones
militares o económicas que producen los refugiados se hacen en nombre de las
doctrinas de seguridad, pero ocultan otros objetivos, en general la apropiación de
riquezas económicas, el dominio estratégico de áreas políticas, el beneficio corporativo
de grandes empresas, el control de mercados estratégicos, etc. Los refugiados,
habitantes del límite del sistema, son los testigos que denuncian la perversidad de esta
lógica biopolítica.
57 En las últimas décadas, hubo incluso una sofisticada inversión en la utilización de la
condición de los refugiados por los propios agentes de la violencia. Estos
comprendieron que, en el marco de la lógica biopolítica, el sufrimiento de los
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
381
refugiados puede ser rentable políticamente. No es necesario esconderlos como un
mero subproducto o efecto colateral previsto, ni invisibilizarlos para evitar que
cuestionen la estrategia militar o económica. Actualmente, en lugar de invisibilizar los
refugiados, se les expone como arma ideológica contra el enemigo. La estrategia es
tener el dominio del discurso para hacer creer que los refugiados son causados, de una
o de otra forma, por el enemigo. Por este medio, se utiliza la condición trágica de los
refugiados como argumento político que exige una mayor y más intensa intervención
militar contra el enemigo. Se argumenta que es necesario defender los refugiados
incrementando la inversión en armamento o la ayudar militar contra el enemigo, al que
se le atribuye la responsabilidad de su existencia. Con ello, la lógica de la guerra
adquiere una nueva dinámica y un refuerzo ideológico para mantenerla o aumentarla.
El caso de la actual guerra de Siria refleja bien esta tesis.
C. Límites y contradicciones de la ayuda humanitaria
58 15. En la lógica biopolítica de los dispositivos de seguridad, el uso de la violencia es algo
rentable, los refugiados son un subproducto inevitable, y en muchos casos conveniente.
Una tercera paradoja se manifiesta en el papel otorgado a las ONGs en relación a los
refugiados. Salvando la incuestionable buena voluntad de las personas y de la mayoría
de ONGs que trabajan con refugiados, lo paradójico es que, en muchos casos, ellas
juegan un papel previsto en la estrategia de la violencia biopolítica. Su intervención es
humanitaria, lo que quiere decir que las ONGs están desposeídas de cualquier carácter
político, lo que les impide cuestionar la situación o tomar partido en cualquier
circunstancia. ONGs mundialmente conocidas como Médicos sin Fronteras, Cruz Roja,
entre otras, incluso el proprio ACNUR, son invitadas, y financiadas, para ayudar a
mitigar la situación dramática de los refugiados, con la condición de que se mantengan
neutrales, es decir, que no tengan ningún posicionamiento político y que se limiten a
ayudar humanitariamente a las necesidades vitales de las personas. Ellas son
financiadas para atender a meros seres humanos, así como otras ONGs atienden y
defienden animales o ecosistemas. Su intervención se atiene a la pura vida humana
desnuda, ellos tienen que cuidar de seres humanos como meros elementos biológicos.
Su forzada neutralidad las despojada de cualquier carácter político, y lo que
aparentemente es un acto de benevolencia neutral de un conflicto, converge para la
instrumentalización biopolítica más estricta.
59 En la lógica de esa estrategia, las ONGs son subvencionadas para que atenúen los efectos
previstos por la violencia. En el lugar de los Estados o corporaciones responsables por
los conflictos que provocaron los refugiados, y que deberían hacerse cargo de las
consecuencias de sus actos, se terceriza este servicio para entidades “neutras” que, en
su benevolencia “neutral”, muestran un carácter humanitario del conflicto. El carácter
filantrópico de las ONGs es instrumentalizado políticamente, incluso rentabilizado
económicamente, por una estrategia biopolítica que torna el humanitarismo una
ideología apolítica, y los refugiados se convierten, en la concepción humanitaria, en
meros seres vivientes que, fuera de los derechos de ciudadanía, sólo tienen derecho al
cuidado de la mera vida natural. Con ello, la misma dimensión humanitaria es
instrumentalizada como ideología biopolítica de la violencia.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
382
D. El campo como técnica biopolítica de control social.
60 16. El límite fronterizo del refugiado denuncia un cuarto aspecto: el uso del campo
como técnica biopolítica de control social. El campo, lejos de ser una invención nazi,
surge concomitante al Estado moderno que, desde sus orígenes, utilizó esta técnica para
controlar, vigilar y exterminar personas y poblaciones indeseadas 41. El campo se define
técnicamente como el espacio dentro del cual el derecho está suspenso, total o
parcialmente, y en su lugar impera la voluntad soberana. En el campo vigora la
excepción como norma42.
61 Técnicamente, el origen jurídico-político del campo se encuentra en las senzalas 43 o
espacios donde, desde el siglo XVI, era permitido cualquier arbitrariedad contra los
esclavos sin que se cometiese delito. Quien entraba en la senzala salía fuera del derecho,
penetraba en un campo de anomía en que la norma era la voluntad soberana del dueño
de esclavos. Las reservas indígenas, creadas por el primer estado moderno
independiente, Estados Unidos, son otro ejemplo de precedente histórico del uso
jurídico-político del campo para controlar poblaciones indeseadas que, en este caso,
consiguió exitosamente su exterminio44.
62 Los refugiados, en sus diversas versiones, son poblaciones indeseadas que deben ser
controladas, vigiladas, expulsadas, incluso en algunos casos queda clara la expectativa
política del exterminio. Los refugiados sufren su condición en el campo. Ellos viven en
campos. El campo es el espacio en que la ciudadanía no es reconocida y el derecho
existe como derecho humanitario, pero no como derecho político de los ciudadanos. El
vacio de ciudadanía que habita el campo expone a la vulnerabilidad a sus habitantes. El
vacío de derechos políticos inherente al campo es compensado por decisiones
administrativas que gobiernan el campo de forma soberana, del mismo modo como se
administra normativamente una empresa45. El campo de refugiados es un enclave
extrajurídico tolerado dentro del Estado que lo acoge. Los refugiados perdieron los
derechos de ciudadanía de su origen y el Estado en que se sitúa el campo no los
reconoce como ciudadanos. Cualquier delito que se cometa contra ellos está fuera del
derecho público. La ausencia de derecho público en el campo es compensada por
normativas internas, de frágil valor jurídico-político. Como consecuencia,
frecuentemente, hay una inimputabilidad o impunidad real de los delitos cometidos
contra los refugiados, pues ellos son meros seres humanos sin fuerza para defender sus
derechos políticos.
63 La perspectiva política del refugiado como límite fronterizo que desvenda las
contradicciones e insuficiencias del Estado, así como del proprio sistema económico
capitalista, se tornó más incisiva en las últimas décadas debido al masivo movimiento
de emigraciones globales que no censan de intentar atravesar las fronteras de los
Estados ricos para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. Los constantes flujos
migratorios son, actualmente, un hecho histórico que expone la urgencia de repensar
su condición jurídico-política, que los concibe como meros seres humanos sin
ciudadanía. Su condición fronteriza exige la creación de nuevas formas del derecho que
no dividan la vida y la instrumentalice como zoe biopolítica.
64 No es casual que los dispositivos de los Estados para controlar las masas de emigrantes
ilegales tengan como paradigma el campo46. La condición del campo es versátil, se
adapta a las diversas condiciones de los refugiados. Considerando la condición de los
emigrantes sin papeles, cuando son capturados por la policía, no se les puede
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
383
encarcelar en la prisión a través del derecho penal común porque no cometieron un
delito, sino una infracción administrativa. Si fuesen ciudadanos de pleno derecho, una
infracción se paga con una multa, sin la pérdida de libertad. Como no son ciudadanos,
son personas sin ciudadanía, el Estado decide de forma soberana y arbitraria privarlos
de libertad internándolos en “Centros de Retención”. Estos centros de retención son
espacios donde no se aplica el derecho penal, ni el derecho civil, ni el derecho
internacional. Son espacios fuera del derecho positivo donde vigora la voluntad
administrativa del gobernante que decide hasta cuando quedará retenido y donde será
extraditado. En el caso de los emigrantes ilegales, el “Centro de Retención” es una
nueva y refinada versión del campo, que cumple la misma función que históricamente
se le asignó: vigilar, controlar y, en este caso, expulsar poblaciones indeseadas. Hay
muchas versiones de campo para los emigrantes, entre ellas, por ejemplo, Francia llegó
a crear campos de retención en países extranjeros como Argelia, en los que concentraba
los emigrantes.
Conclusión
65 17. La condición límite del refugiado permite enumerar críticamente estas situaciones
contradictorias, entre otras. En el límite, la relación entre el derecho y los refugiados
reproduce el debate sobre la conexión del derecho con la vida humana. Por un lado, la
vida fuera del derecho es una vida abandonada y condenada a vivir en la condición de
bando, donde la excepción se torna la norma, ya que en el vacío dejado por la falta de
derecho se establece el arbitrio de una voluntad soberana. Pero el mero derecho no es
suficiente para defender la vida ni para darle plenitud. La proliferación de normas
legales, lejos de defender la vida, pueden servir para normatizarla, regularla y
administrarla como un recurso productivo. Una vida sometida al imperio de la norma
equivale a una vida controlada en sus mínimos detalles. Esta es otra versión del modelo
biopolítico del gobierno de la vida.
66 Esta tensión entre el derecho y la vida humana muestra que el derecho se torna más
necesario cuanto mayor es el vacio ético de las relaciones sociales. La vida se realiza
plenamente más allá del derecho, esa es la condición ética de la existencia humana. La
vigencia efectiva de los valores éticos torna dispensable el derecho, donde la ética
vigora el derecho es excusable. En la vivencia ética, el derecho es dispensable y la
norma desnecesaria porque se vive más allá de ella. La dimensión ética de la alteridad
humana excede cualquier derecho, ella no vive fuera del derecho, sino más allá del
mismo. Este debate muestra que el ideal de la vida es superar la normatización
biopolítica a través de una vivencia cualitativa de la vida, sin que eso signifique negar la
norma sino superarla. En cualquier caso, esta problemática límite del derecho con la
vida humana no es la que afecta directamente a la condición del refugiado. Este se
encuentra en una situación en que el derecho es negado y, como consecuencia, la vida
está expuesta a la violencia.
67 Desde el límite fronterizo en que habita el refugiado se muestra como un umbral desde
donde es necesario pensar un nuevo derecho y una nueva política en que se invierta la
instrumentalización biopolítica de la vida humana. La vida humana, desde el límite de
su exposición, adquiere la potencialidad política de cuestionar las estructuras que la
condenaron a ese límite. Desde el límite, enunciase la necesidad de una nueva política y
un nuevo derecho subsidiarios de la vida, de todas las condiciones humanas. En el
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
384
límite concreto del refugiado, la vida humana se revela como nuevo referente ético de
la acción política.
NOTES
1. ACNUR. Desplazamiento, el nuevo reto del siglo XXI. Tendencias globales 2012. p.2. Disponible en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2013/9180
2. Ibidem, p. 3.
3. Ibidem, p. 5.
4. CLARK, Anna. “The Coming Flood of Climate” In: GreenBiz:
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/reportagens_carbonobrasil/noticia=725824, ACNUR.
“Políticas de Adaptação no Contexto das Negociações da Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC)” In: http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/
envolva-se/eventos/acnur-na-rioplus20/mudancas-climaticas-documentos-de-referencia/
deslocamentos-induzidos-por-mudancas-climaticas/
5. Sobre refugiados climáticos, cf: CASTRO, Márica. “Os refugiados climáticos e o paradoxo da
imobilidade”. In:
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/500513-os-refugiados-climaticos-e-o-paradoxo-da-
imobilidade-entrevista-especial-com-marcia-castro
Cf. también el análisis do Alto Comisario de ACNUR, Antonio Gutierrez, sobre cambios climáticos
http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/envolva-se/eventos/acnur-na-rioplus20/
mudancas-climaticas-discursos-do-alto-comissario/discurso-do-alto-comissario-antonio-
guterres-ao-comite-executivo-do-acnur-em-outubro-de-2008/
6. ABELLÁN, José, María Zambrano, una pensadora de nuestro tiempo, Barcelona, Anthropos, 2006.
7. ZAMBRANO, Maria. Los bienaventurados, Madrid, Siruela, 2004.
8. Ibidem, p. 31
9. Ibidem, p. 32.
10. Ibidem, p.37
11. Destacamos el paralelismo, en este punto, con el pensamiento de Emmanuel Levinas. Cf.
LEVINAS, Emmanuel, Totalité et Infini, Paris, Nijhoff, 1980.
12. ZAMBRANO, Maria, Los bienaventurados, Madrid, Siruela, 2004. p. 33
13. Esta percepción del refugiado guarda una semejanza muy estrecha con la figura del “trapero
de la historia” elaborada por Walter Benjamin para presentar la historia de los vencidos como
desechos de la historia con potencialidad de crear una nueva historia. “Los poetas encuentran en la
basura de la sociedad, en las calles y en la propia basura su asunto heroico” BENJAMIN, Walter, Charles
Baudelaire. Um Lírico No Auge Do Capitalismo, São Paulo, Brasiliense, 1994, p. 78.
14. Ibidem, p. 35
15. Ibidem, p. 36
16. Ibidem, p. 38
17. Ibidem, p. 39.
18. Ibidem, p. 41
19. Ibidem. p. 42.
20. Ibidem, p. 43.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
385
21. Ibidem, p. 43.
22. Es pertinente recordar que el Campo de concentración de Gurs fue construido por el gobierno
francés, próximo de la frontera con España, para aprisionar los republicanos españoles que huían
masivamente del régimen fascista de Franco. Fue el mayor campo de concentración de toda
Francia. Posteriormente, con la invasión alemana, fue utilizado como campo de concentración
para judíos. Arendt fue presa en este campo en esta segunda condición. Cf. LAHARIE, Claude, Le
camp de Gurs, 1939–1945, un aspect méconnu de l´histoire de Vichy. [S.l.: s.n.], 1993. BERMEJO, Benito e
CHECA, Sandra, Libro Memorial, Españoles deportados a los campos nazis (1940–1945), Madrid,
Ministerio de Cultura, 2006.
El primer campo abierto en Francia para concentrar a los refugiados españoles fue Argelès-sur-
mere, 1 de febrero de 1939. Debido a la entrada masiva de refugiados se abrió, el día 8 del mismo
mes, el campo de Saint-Cyprien y Barcarès. Consecutivamente se abrieron otros campos como
Vallespir, y en la Cerdaña: Arles-sur-Tech y Prats de Molló.
23. ARENDT, Hannah, “We refugees”, in ROBINSON, Marc, Altogether Elsewhere. Writers on Exile.,
London, Faber&Faber, 1994, p. 110.
24. Ibidem, p. 116-117.
25. Ibidem, p. 111.
26. Ibidem, p. 115.
27. Ibidem, p. 117.
28. Ibidem, p. 118-119.
29. ARENDT, Hannah, Origens do totalitarismo, São Paulo, Cia das Letras, 2009, pp. 300-338
30. “Ninguna paradoja de la política contemporánea es tan dolorosamente irónica como la discrepancia
entre los esfuerzos idealistas bienintencionados, que insistían cabezonamente en considerar ‘inalienables’
los derechos disfrutados por los ciudadanos de los países civilizados, y la situación de seres humanos sin
ningún derecho”, ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo, p. 312
31. Ibidem, p. 119.
32. Giorgio Agamben, "We Refugees." Symposium. 1995, No. 49(2), Summer, Pages: 114-119.
Disponible en: http://www.egs.edu/faculty/giorgio-agamben/articles/we-refugees/
33. Agamben escribió, en 1990, una obra, La comunità que viene, Torino, Einaudi, 1990, donde,
siguiendo otras obras como las de Jean-Luc Nancy, explora las potencialidades políticas de la
comunidad.
34. AGAMBEN, Giorgio., Stato di Eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
35. “Lo que caracteriza propiamente a la excepción es aquello que es excluido no está por esa causa,
absolutamente fuera de la relación con la norma; al contrario, esta se mantiene en relación con aquella en
la forma de suspensión. La norma se aplica a la excepción des-aplicándose, retirándose de ella”: AGAMBEN,
Giorgio, Homo sacer. O poder soberano e a vida nua, Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 25.
36. AGAMBEN, Giorgio, op. cit.
37. “El bando es esencialmente el poder de remitir algo a sí mismo, o sea, el poder de mantenerse en
relación con un presupuesto no relatado. El que es puesto en bando está remitido a su propia separación y,
juntamente, entregado a merced de quien lo abandona, al mismo tiempo excluido e incluido, dispensado y
simultáneamente capturado”, AGAMBEN, Giorgio, Homo sacer. O poder soberano e a vida nua, op. cit.,.
116.
38. Agamben utiliza la categoría vida desnuda tomada de BENAJMIN, Walter, “ Zur Kritk der
Gewalt”, in G.S. II., pp. 179-203.
39. La condición económica, de clase, es un factor decisivo, en muchos casos, para determinar el
mayor o menor valor jurídico de la vida humana. El derecho formal tiene un valor más real en
virtud de la condición económica de quien lo reclama. Esta dimensión económica está ausente del
debate propuesto por Agamben.
40. FOUCAULT, Michel, Sécurité, Territoire, Population, Paris, Gallimard, 2004.
41. AGAMBEN, Giorgio, Stato di Eccezione., Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
386
42. “El campo es el espacio que se abre cuando la excepción comienza a tornarse regla”, AGAMBEN,
Giorgio, Homo sacer. O poder soberano e a vida nua, op. cit., p.175.
43. El origen toponímico del término senzala es africano, es el nombre habitualmente utilizado en
Brasil para el espacio donde se confinaba a los esclavos negros. La senzala era constituida, casi
siempre, de una casa fuertemente protegida por rejas, relativamente apartada de las residencias
de los propietarios. En frente de la casa de esclavos, como parte de la senzala, se construida una
especie de pilar o tronco llamado pelouriño en el cual se azotaba y se torturaba públicamente de
diversas formas a los esclavos y en último extremo se los ahorcaba. El conjunto de ese espacio de
confinamiento y tortura de esclavos era denominado de senzala. Era un espacio fuera del derecho,
no reglamentado ni reconocido jurídicamente, pero tolerado en toda su impunidad.
44. BROWN, D, Enterrem meu coração na curva do rio. A dramática história dos índios norte-
amerianos, Porto Alegre, LP&M, 2004.
45. H. Arendt, sin analizar las implicaciones biopolíticas del campo, percibe con
agudeza el modo como en el campo se impone una igualdad forzada, se fuerza ser
iguales como medio de control y gobierno biológico efectivo: “El dominio total, que
procura sistematizar la infinita pluralidad e indiferenciación de los seres humanos como si toda
la humanidad fuese apenas un individuo, sólo es posible cuando toda persona es reducida a la
misma identidad de reacciones”, ARENDT, Hannah, Origens do totalitarismo. Anti-semitismo,
imperialismo, totalitarismo, São Paulo, Cia das Letras, p. 448.
46. El modo arbitrario y cada vez más frecuente del uso de la excepción como instrumento de
gobierno, llevó Agamben defender la tesis de que: “el estado de excepción tiende cada vez más a
presentarse como paradigma de gobierno dominante de la política moderna”, AGAMBEN, Giorgio, Estado
de exceção, São Paulo, Boitempo, 2004, p. 13.
ABSTRACTS
The refugees are a reality that expands and challenges. This paper analyzes the status of refugees
from the philosophical perspective. Returning reflections of the three philosophers - M.
Zambrano, H. Arendt, G. Agamben - on the subject, the refugee status is presented as a threshold
or boundary condition of law and policy that, in the limit, questions modern institutions that
condemn to abroad abandonment, without citizenship, and subjected him to a permanent
vulnerability. In the threshold limit, the refugee is an unassimilable alterity by notions of the
established order. As external and border alterity, the refugees becomes an ethical category with
the potential to judge the validity of the political structures and institutions of our present.
Les réfugiés constituent une réalité en expansion qui ne peut laisser indifférent. Cet essai analyse
la condition des réfugiés depuis une perspective philosophique. En reprenant les réflexions de
trois philosophes -M. Zambrano, H. Arendt, G. Agamben – sur la question, il présente la condition
des réfugiés comme un seuil ou une condition limite du droit et de la politique qui, dans cette
limite, interroge les institutions modernes qui les condamnent à un abandon extérieur, sans
citoyenneté, et les soumettent à une vulnérabilité permanente. Au seuil de cette limite, le réfugié
représente une altérité inassimilable par les notions de l’ordre établi. En tant qu’altérité, il offre
une catégorie éthique qui a pour potentialité de permettre de juger la validité des structures et
des institutions politiques contemporaines.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
387
Los refugiados son una realidad que se expande e interpela. Este ensayo analiza la condición de
los refugiados desde la perspectiva filosófica. Retomando las reflexiones de tres filósofas/o – M.
Zambrano, H. Arendt, G. Agamben – sobre el tema, se presenta la condición del refugiado como
un umbral o una condición límite del derecho y de la política que, en el límite, cuestiona las
instituciones modernas que lo condenan al abandono exterior, sin ciudadanía, y lo someten a una
vulnerabilidad permanente. En el umbral del límite, el refugiado es una alteridad inasimilable
por las nociones del orden establecido. Como alteridad externa y fronteriza se torna una
categoría ética con potencialidad de juzgar la validez de las estructuras e instituciones políticas
de nuestro presente.
INDEX
Mots-clés: Réfugiés - Droits de l’homme – violence – éthique – altérité – Zambrano - H. Arendt -
G. Agamben
Keywords: Refugees - human rights – violence – ethics – otherness - M. Zambrano - H. Arendt -
G. Agamben
Palabras claves: Refugiados - derechos humanos – violencia – ética – alteridad - M. Zambrano -
H. Arendt - G. Agamben
AUTHOR
CASTOR BARTOLOMÉ RUIZ
Castor M.M. Bartolomé Ruiz est docteur en philosophie, chercheur dans le Programme de
l’Université UNISINOS, à Sao-Léopoldo du Brésil. Il est membre du Conseil scientifique de la
Chaire Unesco “Derechos Humanos y violencia, gobierno y gobernanza” (Droits de l’Homme et
violence : gouvernement, gouvernance).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
388
Les réfugiés, seuil éthique d’un
nouveau droit et d’une nouvelle
politique1 (version française)
Castor Bartolomé Ruiz
Introduction, les réfugiés et les exilés : une autre globalisation.
1 Le terme « réfugié » est lié à celui de « refuge », ainsi qu’au verbe « s’évader », « fuir »
(du latin, fugam). Le réfugié est celui qui doit s’évader, fuir. La fuite forcée oblige
l’individu à trouver refuge et le transforme donc ainsi en réfugié. Les motifs qui
obligent le réfugié à prendre la fuite peuvent être variés : mais tous ces motifs sont
emprunts de violence structurelle, politique, économique ou culturelle. Le refuge se
trouve toujours aux limites de l’Etat, au seuil des frontières du droit. Le réfugié se voit
obligé de survivre dans ces limites, au seuil des contradictions paradoxales qui lient le
droit et la vie humaine. Nouvel habitant des limites, le réfugié survit comme un reste :
il représente ce qui reste de la condition humaine quand la personne se voit obligée de
vivre dans les limites du droit, dans les espaces frontaliers où l’exception devient la
norme et où la campagne opère comme un dispositif biopolitique de contrôle.
2 Les réfugiés et les exilés envahissent le monde. Leur présence se globalise sans que nos
institutions puissent éviter cette condition humaine forcée d’exister. Le rapport de
2013 de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés, l’ACNUR, comptabilisait un déplacement de
45,2 millions personnes à travers la planète. L’ACNUR avait sous sa responsabilité 35,8
millions de réfugiés, pour les soins et leur protection. Selon ses estimations, 23000
personnes se sont vues obligées de fuir, chaque jour, abandonnant leurs maisons, leurs
villes et leurs pays suite à des conflits de tous types. On pense que la condition
d’apatrides concerne, au moins, 10 millions de personnes. Toujours selon le rapport,
plus de 893700 personnes ont demandé le statut d’exilé ou de réfugié en 2012. Ledit
rapport affirme « que l’année 2012 s’est caractérisée par la crise des réfugiés qui a atteint des
niveaux sans précédent dans les dernières décennies ».
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
389
3 Le rapport publié par l’ACNUR expose un panorama terrifiant du XXIème siècle qui
montre le côté obscur de la globalisation, du modèle économique et ses différents
intérêts politiques. Si comme l’affirme Walter Benjamin, dans sa thèse VIII, sur le
concept d’Histoire, « Il n’y a pas un monument de culture qui ne soit pas un monument de
barbarie », l’invisibilité des réfugiés et des exilés est une manière de cacher la barbarie
des structures et les décisions économiques et politiques qui les produisent.
4 Cependant, le panorama présenté par le rapport de l’ACNUR est incomplet car il ne
prend pas en compte, dans ses statistiques sur les réfugiés et les exilés, les dizaines de
millions d’émigrants économiques, légaux ou illégaux, qui parcourent la planète,
obligés d’abandonner maisons, villes et pays pour échapper à la pauvreté extrême et à
la misère dans lesquelles ils vivent. Il ne prend pas non plus en compte, dans ses
statistiques, les masses de réfugiés climatiques2 qui sont obligés d’abandonner leurs
terres, leurs foyers et leurs pays pour échapper aux changements climatiques en cours
et aux désastres écologiques permanents3.
5 Cette brève et insuffisante photographie de la conjoncture actuelle montre bien que la
condition des réfugiés et des exilés représente beaucoup plus que des petits « faux pas »
du contexte mondial, ou des simples erreurs ponctuelles d’une globalisation bien
planifiée. Leur présence massive, mais principalement leur condition humaine,
interpelle le modèle économique qui les engendre, le capitalisme, les statuts juridiques
et politiques actuels du droit international en vigueur, le type d’Etat dominant ; ils
mettent également en échec les organisations internationales existantes. Les réfugiés et
les exilés apparaissent comme une interpellation de l’ordre mondial et international
établi aujourd’hui. Ces derniers, parias, vaincus, et victimes de notre histoire actuelle,
sont une interpellation éthique et politique de notre monde.
6 La réalité des réfugiés et des exilés peut être analysée de différents points de vue : d’un
point de vue sociologique, avec ses statistiques et son analyse empiriques ; d’un point
de vue juridique, en analysant la trame légale, ou encore d’un point de vue politique en
s’intéressant aux décisions (im)pertientes de chaque cas. Tous ces points de vue sont
nécessaires et complémentaires. Nous voulons contribuer à ce vaste débat collectif,
encore inachevé, en établissant une réflexion d’un point de vue philosophique. Le
réfugié ou l’exilé, loin d’être un simple fait marginal, une exception dans le système,
devient, par sa condition d’exception, un point épistémologique et éthique qui réévalue
la validité éthique et politique de l’ordre établi. Les réfugiés et les exilés, en tant que
victimes des injustices innombrables, sont le critère d’une nouvelle perspective de la
justice.
7 Cet article présente une réflexion sur la condition du réfugié qui vit aux limites des
pays, ce qui lui rend une part d’humanité mais aussi le place dans une catégorie éthique
et politique à part. En habitant les limites des pays, le réfugié montre le seuil d’une
extériorité que les catégories habituelles de l’ordre établi ne perçoivent pas. Le réfugié,
en tant qu’habitant externe d’un ordre qui ne le reconnait pas comme un citoyen à part
entière, a le pouvoir éthique et politique de remettre en question cet ordre. Ce dernier
est une victime de la violence structurelle qui voit son altérité niée et sa dignité blessée.
Dans cette condition de victime de l’injustice, le réfugié perçoit, comme critère éthique,
la possibilité de juger les dispositifs biopolitiques à l’origine d’une telle violence.
8 Notre exposé sera divisé en deux parties : premièrement nous présenterons la pensée
de Maria Zambrano sur les exilés, puis la réflexion d’Hannah Arendt sur les réfugiés et
enfin la réflexion que fit Giorgio Agamben sur le texte d’Hanna Arendt (I). Nous
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
390
continuerons en exposant quatre aspects critiques sur la limite de la condition des
réfugiés (II).
I. Trois penseurs sur la figure des exilés et des
réfugiés
A. María Zambrano: l’exilé, une limite de l’existence
9 (…)
B. Hannah Arendt: Nous réfugiés
10 (…)
C. Giorgio Agamben: Nous réfugiés, l’avant-garde du peuple
11 (…)
II. La figure contemporaine du réfugié: contradiction et
perspectives critiques
12 Les réflexions différenciées, mais connexes, de Maria Zambrano, d’Hannah Arendt et de
Giorgio Agamben, reconstruisent la dimension des réfugiés depuis de nouvelles
perspectives. En même temps, les analyses entrecroisées de ces perspectives nous
permettent de déterminer quelques contradictions importantes que la condition limite
du réfugié rend évidentes.
A. Le droit et la vie
13 La première contradiction est que le droit ne peut pas protéger la vie à travers de
simples déclarations formelles, de traités ou de principes universellement acceptés.
Cependant, sans le droit, la vie entre dans une zone d’exception où elle est exposée à la
violence injustifiée. Bien que le droit, par lui-même, est incapable de défendre la vie
humaine, sans le droit toutefois, la personne humaine reste réduite à la simple
condition d’animal vivant et, par conséquence, sous l’arbitraire de la force.
14 La tension contradictoire entre le droit et la vie reste évidente dans la condition du
réfugié. Celui-ci, qu’il soit apatride, banni, émigrant sans papier ou exilé, apparait, sous
plusieurs aspects, à la frontière du droit, interrogeant la validité du droit lui-même. Il
vit dans les limites mais, concomitamment, cette condition lui confère le pouvoir d’être
une catégorie à la limite du droit lui-même. Le réfugié vit et se réfugie dans les limites,
mais les détruit également; il est lui-même une limite à partir de laquelle sont remises
en question les autres délimitations. Il survit au seuil de l’exclusion des droits, il
subsiste dans la frontière externe des institutions modernes comme l’Etat, le droit, la
nation, la citoyenneté, comme un élément étranger, toléré mais non intégré.
15 La condition du réfugié est celle de la lutte pour survivre, sans que sa vie soit reconnue
avec une dignité de droit égale à celle de tout autre citoyen. Le refus de lui reconnaitre
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
391
les mêmes droits qu’un autre citoyen manifeste l’arbitraire avec lequel ces catégories
opèrent. Le réfugié existe à la frontière du droit dans un espace où le vide juridique
permet que l’exception devienne la norme. Dans cette condition limite, sa vie se trouve
réduite à celle d’un simple être vivant, une vie dépouillée.
16 Il existe aussi un autre visage de la condition limite du réfugié. Dans cette condition, la
vie humaine se rebelle contre les limites qui l’excluent et se propose comme une
nouvelle catégorie éthique qui permet de juger la légitimité des institutions politiques.
Le réfugié devient, dans sa condition limite, une altérité éthique, une référence sur l’(a)
(in)justice des structures qui l’excluent. Le réfugié devient critère extérieur qui permet
de juger l’inadéquation du modèle économique et des structures politiques qui le
poussent dans une exclusion incessante. En ce sens, le réfugié se transforme en une
limite éthique des institutions économiques et politiques modernes.
17 Ce premier paradoxe du réfugié est confronté aux discours qui prétendent le
naturaliser comme un effet collatéral inévitable et structurel. La limite frontalière dans
laquelle il survit apparait comme un espace critique d’extériorité qui permet de juger la
réalité de l’ordre établi et ses dispositifs de naturalisation.
18 Ce qui est en jeu dans la condition limite, c’est la survie du réfugié, c’est sa propre
condition humaine. L’acharnement à naturaliser la condition de réfugié comme
quelque chose de normal et d’inévitable dans le cadre des relations internationales ou
dans la logique économique du marché, ce discours normalisateur, se construit comme
un artifice idéologique qui sous-tend les intérêts corporatifs et autres stratégies
d’action
B. Le réfugié et la sécurité
19 Les limites frontalières dans lesquelles le réfugié survit font apparaitre une autre
contradiction, celle des dispositifs de sécurité. Le réfugié est le résultat d’une violence
structurelle, de l’Etat et du marché, légitimée la plupart du temps par des dynamiques
qui se disent nécessaires à la préservation contre les plus grands maux. La violence de
l’Etat ou des acteurs économiques tient sa légitimité dans les discours de sécurité.
L’octroi d’une meilleure sécurité des biens aux citoyens légitime un certain nombre
d’interventions militaires ou économiques dont les résultats entrainent inévitablement
l’expulsion, l’émigration ou simplement la fuite des personnes et des populations qui
feront alors partie du contingent mondial des réfugiés déjà existant. Les politiques de
sécurité entrent dans le cadre biopolitique qui régit la logique politique et économique
moderne4. A travers cette logique, l’usage de la violence est légitimé comme une
technique de gouvernance nécessaire pour défendre la vie : au nom de la défense de la
vie, on tolère la violence sur d’autres vies. Pour défendre certains, on s’attaque à
d’autres, tout en sachant que cette intervention produira des effets collatéraux : les
réfugiés. Ce paradoxe de la biopolitique justifie l’usage de la violence pour défendre de
possibles menaces ou d’autres violences invoquées et provoquées. On légitime la
violence de l’Etat pour, je suppose, défendre les civils, renverser les dictateurs, ou
encore prévenir le terrorisme international. De cette manière, on consolide la pratique
de la guerre préventive dans le cadre des relations internationales. On sait que la
plupart des interventions militaires ou économiques, dont les réfugiés sont l’excuse, se
font au nom des doctrines de sécurité mais cachent d’autres objectifs, comme en
général l’appropriation des richesses économiques, la maitrise stratégique des aires
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
392
politiques, le bénéfice corporatif des grandes entreprises, le contrôle des marchés
stratégiques, etc. Les réfugiés, habitants des limites du système, sont les témoins qui
dénoncent la perversité de cette logique biopolitique.
20 Dans les dernières décennies, il y a même eu une inversion alambiquée dans
l’utilisation de la condition des réfugiés par les agents de la violence eux-mêmes. Ces
derniers ont compris que, dans le cadre de la logique biopolitique, la souffrance des
réfugiés peut être rentable politiquement.
21 Il n’est plus nécessaire de les cacher comme un simple sous-produit ou effet collatéral
prévu, ni de les rendre invisibles pour éviter qu’ils remettent en question la stratégie
militaire ou économique. La stratégie est d’obtenir le contrôle du discours pour faire
croire que la condition de réfugiés est causée, d’une manière ou d’une autre, par
l’ennemi. Par ce moyen, on utilise la condition tragique des réfugiés comme argument
politique qui exige une meilleure et une plus dure intervention militaire contre
l’ennemi. On argumente qu’il est nécessaire de défendre les réfugiés en augmentant
l’effort en armement ou l’aide militaire contre l’ennemi à qui on attribue la
responsabilité de leur existence. Avec cela, la logique de la guerre acquiert une nouvelle
dynamique et un renforcement idéologique pour la maintenir ou l’augmenter. Le cas de
la guerre actuelle en Syrie reflète bien cette thèse.
C. Les limites et les contradictions de l’aide humanitaire
22 Dans la logique biopolitique des dispositifs de sécurité, l’usage de la violence est
rentable ; les réfugiés sont un sous-produit inévitable et, dans beaucoup de cas,
opportun. Un troisième paradoxe se manifeste dans le rôle attribué aux ONG pour les
réfugiés. Sans parler de l’indiscutable bonne volonté des personnes et de la plupart des
ONG qui travaillent avec des réfugiés, ce qui est paradoxal c’est que, dans beaucoup de
cas, elles jouent un rôle prévu par la stratégie de la violence biopolitique. Leur
intervention est humanitaire, ce qui veut dire que les ONG sont dénuées de tout
caractère politique, les empêchant ainsi de remettre en question la situation ou de
prendre parti dans quelque circonstance que ce soit. Des ONG mondialement connues
comme Médecins sans Frontières, La Croix Rouge, entre autres, ainsi que l’ACNUR elle-
même, sont invitées et financées pour aider à tempérer la situation dramatique des
réfugiés, avec la condition qu’elles restent neutres, c’est-à-dire, qu’elles ne prennent
aucun positionnement politique et qu’elle se limitent à aider « humanitairement » les
nécessités vitales des personnes. Elles sont financées pour s’occuper de simples êtres
humains comme d’autres ONG s’occupent et défendent des animaux et des écosystèmes.
Leur intervention s’étend à la pure vie humaine dépouillée ; elles doivent s’occuper
d’êtres humains comme de simples éléments biologiques. Leur neutralité forcée les
dépouille de tout caractère politique, et ce qui apparait comme un acte bénévole neutre
à l’égard d’un conflit, entre, en réalité, dans une instrumentalisation biopolitique plus
générale.
23 Dans la logique de cette stratégie, les ONG sont subventionnées pour atténuer les effets
prévus par la violence. Les Etats et corporations responsables des conflits qui
accentuent le nombre de réfugiés, au lieu de prendre en charge les conséquences de
leurs actes, laissent des entités « neutres » qui, dans leur bienveillance « neutre »,
confère un caractère humanitaire au conflit. Le caractère philanthropique des ONG est
instrumentalisé politiquement, et même rentabilisé économiquement, par une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
393
stratégie biopolitique qui devient l’humanitarisme. De simples êtres vivants, loin
d’avoir accès aux droits du citoyen, ont seulement le droit au soin de la simple vie
naturelle. Cette dimension humanitaire se voit donc instrumentalisée par une idéologie
biopolitique de la violence.
D. Le camp : technique biopolitique de contrôle social
24 La condition limite du réfugié présente un quatrième aspect: l’usage du camp comme
technique biopolitique de contrôle social. Le camp, loin d’être une invention nazie,
existe concomitamment à l’Etat moderne qui, dans le temps, a utilisé cette technique
pour contrôler, surveiller et exterminer des personnes et des populations non désirées.
Le camp se définit techniquement comme l’espace dans lequel le droit est suspendu,
totalement ou partiellement, et à sa place, règle la volonté souveraine. Dans le camp,
l’exception est la norme5.
25 Techniquement, l’origine juridico-politique du camp se trouve dans les senzalas ou dans
les espaces où, depuis le XVIème siècle, l’arbitraire contre les esclaves était permis sans
qu’il soit considéré comme un délit. Qui entrait dans la senzala sortait du droit,
pénétrait dans un camp où la norme était la volonté souveraine du maitre des esclaves.
Les réserves indigènes, créées par le premier Etat moderne indépendant, les Etats Unis,
sont un autre exemple historique de l’usage juridico-historique du camp chargé de
contrôler des populations non désirées qui, dans ce cas, a conduit à la réussite de son
extermination6.
26 Les réfugiés, dans ses différentes versions, sont des populations non désirées qui
doivent être contrôlées, surveillées, expulsées et, dans certains cas, la perspective
politique de l’extermination demeure présente. Les réfugiés sont victimes de leur
condition dans les camps. Ils vivent en camps. Le camp est l’espace où la citoyenneté
n’est pas reconnue et où le droit existe comme un droit humanitaire et non comme un
droit politique octroyé aux citoyens. Le vide de citoyenneté qui habite le camp traduit
la vulnérabilité de ses habitants. Le vide des droits politiques inhérent au camp se
compense par des décisions administratives qui gouvernent souverainement le camp,
de la même façon qu’on administrerait une entreprise7. Le camp des réfugiés est une
enclave extra-juridique tolérée à l’intérieur de l’Etat qui l’accueille. Les réfugiés ont
perdu les droits de citoyenneté et l’Etat dans lequel se trouve le camp ne les reconnait
pas comme citoyens. Quel que soit le délit commis contre eux, il n’entre pas dans la
sphère publique du droit. L’absence de droit « public » se compense par des normes
internes, d’une très faible valeur juridico-politique. Par conséquent, il existe une
impunité des délits commis contre les réfugiés puisqu’ils sont de simples êtres humains
sans force pour défendre leurs droits politiques.
27 La perspective politique du réfugié comme limite frontalière qui révèle les
contradictions et les insuffisances de l’Etat, ainsi que du système économique
capitaliste lui-même, devient plus incisive depuis ces dernières décennies en raison du
mouvement massif des émigrations globales qui ne cessent d’essayer de traverser les
frontières des Etats riches pour survivre avec un minimum de dignité. Les flux
migratoires constants constituent, aujourd’hui, un fait historique qui montre l’urgence
de repenser leur condition juridico-politique qui conduit à les concevoir comme de
simples êtres humains sans citoyenneté. Leur condition frontalière exige la création de
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
394
nouvelles formes du droit qui ne divisent pas la vie ni ne l’instrumentalise comme la zoe
biopolitique.
28 Le fait que les dispositifs des Etats pour contrôler les masses des émigrants illégaux
prennent comme paradigme le camp8 n’est pas fortuit. La condition du camp est
versatile, elle s’adapte aux différentes conditions des réfugiés. Si on considère la
condition des émigrants sans papiers quand ils sont capturés par la police, on ne peut
les incarcérer dans une prison par le biais du droit pénal commun parce qu’ils n’ont pas
commis de délit, mais une infraction administrative. S’ils étaient des citoyens de plein
droit, ils paieraient l’infraction par une amende, sans perdre leur liberté. Comme ils ne
sont pas citoyens et sont donc sans citoyenneté, l’Etat décide souverainement et
arbitrairement de les priver de liberté en les internant dans des « Centres de
Rétention ». Ces Centres sont des espaces où le droit pénal, le droit civil et le droit
international ne s’appliquent pas. Ce sont des espaces sans droit positif où s’accomplit
la volonté administrative du gouvernant qui décide jusqu’à quel moment le réfugié doit
rester détenu et où il va être reconduit. Pour les émigrants illégaux, le « Centre de
Rétention » est une version nouvelle et raffinée du camp qui remplit la même fonction
qu’on lui assignait dans l’histoire : surveiller, contrôler, et dans certains cas expulser
des populations non désirées. Il y a beaucoup de versions du camp pour les émigrants :
par exemple, la France a réussi à créer des camps de rétention dans des pays étrangers
comme l’Algérie, où elle les concentrait.
Conclusion
29 La condition limite du réfugié permet, entre autres, de comprendre ces situations
contradictoires. Dans les limites, la relation entre le droit et les réfugiés reproduit le
débat sur la connexion entre le droit et la vie humaine. D’un côté, la vie sans le droit est
une vie abandonnée et condamnée à vivre dans la condition de faction, dont l’exception
devient la norme puisque, dans le vide créé par l’absence du droit, l’arbitraire d’une
volonté souveraine est reine. Mais le simple droit n’est pas suffisant pour défendre la
vie ni pour lui donner la plénitude. La prolifération des normes légales, loin de
défendre la vie, ne servent qu’à la normaliser, la réguler et l’administrer. Une vie
soumise à l’empire de la norme équivaut à une vie contrôlée dans ses moindres détails.
C’est une autre version du modèle biopolitique de la gouvernance de la vie.
30 Cette tension entre le droit et la vie humaine montre que plus le vide éthique des
relations sociales est grand, plus le droit devient nécessaire. L’ineffectivité des valeurs
éthiques en vigueur rend le droit indispensable, la prise en compte de l’éthique fortifie
donc le droit et le droit devient excusable. Dans l’expérience éthique, le droit est
dispensable et la norme non nécessaire parce qu’on y vit au-delà. La dimension éthique
de l’altérité humaine excède n’importe quel droit, elle ne vit pas en dehors du droit
mais au-dessus. Ce débat montre que l’idéal de la vie est de dépasser la normalisation
biopolitique à travers une expérience qualitative de la vie, sans que cela signifie nier la
norme mais plutôt la dépasser. Dans tous les cas, cette problématique limite du droit et
de la vie humaine n’affecte pas directement la condition du réfugié. Ce dernier se
trouve dans une situation où le droit est nié et, par conséquent, la vie est exposée à la
violence.
31 La condition limite dans laquelle habite le réfugié apparait comme un seuil depuis
lequel il est nécessaire de penser un nouveau droit et une nouvelle politique dans
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
395
lesquels l’instrumentalisation biopolitique de la vie humaine serait inversée. La vie
humaine acquiert le pouvoir politique de remettre en question les structures qui l’ont
condamné à se retrancher dans sa limite. Depuis cette limite, on avance la nécessité
d’une nouvelle politique et d’un nouveau droit subsidiaire de la vie, de toutes les
conditions humaines. Dans les limites concrètes du réfugié, la vie humaine se révèle
comme le nouveau référent éthique de l’action politique.
NOTES
1. Traduction : Alix Durand, Etudiante Master II droit franco-espagnol, 2013-3014.
2. CLARK, Anna. “The Coming Flood of Climate”, in GreenBiz, http://
www.institutocarbonobrasil.org.br/reportagens_carbonobrasil/noticia=725824, ACNUR.
“Políticas de Adaptação no Contexto das Negociações da Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC)” In: http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/
envolva-se/eventos/acnur-na-rioplus20/mudancas-climaticas-documentos-de-referencia/
deslocamentos-induzidos-por-mudancas-climaticas/
3. Sur les réfugiés climaiques, cf: CASTRO, Márica. “Os refugiados climáticos e o paradoxo da
imobilidade”:
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/500513-os-refugiados-climaticos-e-o-paradoxo-da-
imobilidade-entrevista-especial-com-marcia-castro ; Cf. Aussi l’analyse du Haut-Commissaire de
l’ACNUR, Antonio Gutierrez, sur les changements climatiques: http://www.acnur.org/t3/
portugues/o-acnur/envolva-se/eventos/acnur-na-rioplus20/mudancas-climaticas-discursos-do-
alto-comissario/discurso-do-alto-comissario-antonio-guterres-ao-comite-executivo-do-acnur-
em-outubro-de-2008/
4. FOUCAULT, Michel. Sécurité, Territoire, Population, Paris, Gallimard, 2004.
5. “Le camp est l’espace qui s’ouvre quand l’exception commence à devenir la règle”, AGAMBEN, Giorgio.,
Homo sacer. O poder soberano e a vida nua, Belo Horizonte, UFMG, 2002, p.175.
6. BROWN, D., Enterrem meu coração na curva do rio. A dramática história dos índios norte-
amerianos, Porto Alegre, LP&M., 2004.
7. H. Arendt, sans analyser les implications biopolitques du camp, perçoit avec
intelligence l’inégalité extrême qui existe au sein de ce camp; voir ARENDT, Hannah,
Origens do totalitarismo. Anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. São Paulo: Cia das
Letras, p. 448.
8. Le mode arbitraire et chaque fois plus souvent l’usage de l’exception comme instrument du
gouvernement, a conduit Agamben à défendre la thèse suivante: “l’état d’exception tend chaque fois
plus à se présenter comme un paradigme du gouvernement dominant de la politique moderne” AGAMBEN,
Giorgio, Estado de exceção, São Paulo, Boitempo, 2004, p. 13.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
396
ABSTRACTS
Les réfugiés constituent une réalité en expansion qui ne peut laisser indifférent. Cet essai analyse
la condition des réfugiés depuis une perspective philosophique. En reprenant les réflexions de
trois philosophes -M. Zambrano, H. Arendt, G. Agamben – sur la question, il présente la condition
des réfugiés comme un seuil ou une condition limite du droit et de la politique qui, dans cette
limite, interroge les institutions modernes qui les condamnent à un abandon extérieur, sans
citoyenneté, et les soumettent à une vulnérabilité permanente. Au seuil de cette limite, le réfugié
représente une altérité inassimilable par les notions de l’ordre établi. En tant qu’altérité, il offre
une catégorie éthique qui a pour potentialité de permettre de juger la validité des structures et
des institutions politiques contemporaines.
INDEX
Mots-clés: Réfugiés - droits de l’homme – violence – éthique – altérité - M. Zambrano - H.
Arrendt -G. Agamben
AUTHOR
CASTOR BARTOLOMÉ RUIZ
Castor M.M. Bartolomé Ruiz est docteur en philosophie, chercheur à l’Université UNISINOS, à
Sao-Léopoldo du Brésil. Il est membre du Conseil scientifique de la Chaire Unesco “Derechos
Humanos y violencia, gobierno y gobernanza” (Droits de l’Homme et violence : gouvernement,
gouvernance).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
397
Mémoires
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
398
L’impact sur le procès pénal de
l’absence des accusés dotés d’une
qualité officielle
Les nouvelles règles 134bis, ter et quater du RPP de la CPI et les
« personnes en charge de fonctions publiques extraordinaires »
Rebecca Mignot-Mahdavi
ABSTRACTS
The 12th session of the International Criminal Court’s assembly of state parties took place from
the 20th to the 28th of November 2013, at the Hague. This session followed the lastest evolutions
in the kenyan cases, The Prosecutor v. Uhuru Kenyatta and The Prosecutor v. William Ruto, prosecuted
for having participated to the perpetration of war crimes and crimes against humanity. They
asked for the Court to excuse them from their presence at trial. The Rome Statute’s State parties
had to pronounce themselves on the amendment proposals submitted by the African Union, and
more precisely on the adoption proposal of rules 134 bis, ter and quater. The new rules concern,
respectively, « presence through the use of video technology », « excusal from presence at trial » and «
excusal from presence at trial due to extraordinary public duties ».
Under certain circumstances, theses rules authorise the virtual presence of the accused or their
« total absence ». Yet, the Rome Statute itself requires the accused presence at trial in article 27.
It was necessary, before an amendment proposal of article 27 is submitted, to legally analyse the
impact of new rules, applicable to ongoing trial and authorizing the absence of the accused
having extraordinary public duties, on the International criminal court’s trial.
L’assemblée des Etats parties de la Cour pénale internationale s’est réunie pour sa douzième
session, à la Haye, du 20 au 28 novembre 2013. Cette session a succédé aux derniers
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
399
développements dans les affaires kényanes des président et vice-président du Kenya,
respectivement Uhuru Kenyatta et William Ruto, poursuivis pour crimes contre l’humanité et
sollicitant de la Cour des excuses leur permettant de ne pas se rendre à certaines phases de leur
procès. Les États parties au Statut de Rome avaient, entre autres, à se prononcer sur les trois
propositions d’amendements au règlement de procédure et de preuve soumises par l’Union
africaine, visant les règles 134 bis, 134 ter et 134 quater. La majorité des deux tiers exigée pour que
des amendements au règlement de procédure et de preuve soient adoptés ayant été atteinte, ces
propositions ont abouti. Les nouvelles règles 134 bis, ter et quater concernent respectivement « la
comparution au moyen d’une liaison vidéo », « la dispense de comparution au procès », et « la dispense de
comparution au procès en raison de fonctions publiques extraordinaires ». Sous certaines conditions, ces
règles autorisent donc la présence virtuelle de l’accusé, voire sa simple représentation par un
avocat. La réception de ces propositions a été justifiée par la volonté d’améliorer l’efficacité des
procédures. Pourtant, le Statut de Rome exige la présence de l’accusé à son procès, en son article
27.
Il importait d’effectuer une analyse juridique de ces nouvelles règles avant que ne soit analysée
une proposition d’amendement de l’article 27 du Statut de Rome lui-même, d’étudier l’impact,
non pas politique mais judiciaire de règles procédurales nouvelles, applicables à des procédures
en cours et autorisant l’absence des accusés en charge fonctions publiques extraordinaires, sur le
procès pénal de la Cour pénale internationale.
INDEX
Mots-clés: Cour pénale internationale – Assemblée des États parties – Statut de Rome – Kenya –
Union africaine – Droits de la défense – Principe de légalité – principe d’égalité – procédure
pénale – règles procédurales – juge pénal international – droit internationa, ter et quater
Keywords: International Criminal Court – Assembly of state parties – Rome Statute – Kenya –
Africain union – rights of the defense – principle of legality – principle of equality – criminal
procedure – procedural rules – international criminal judge – international, ter and quater
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
400
Les lanceurs d’alerte
Etude comparée France-Etats-Unis
Jean-Philippe Foegle
ABSTRACTS
The whistle-blower is defined by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
(Resolution 1729 (2010),§1) as “a concerned individual who sound an alarm in order to stop wrongdoings
that place fellow human beings at risk”.The present study, which compares the legal framework for
whistleblowing in the United States and France, aims at better understading key issues
concerning the notion of « whistleblowing ». The first outlined characteristic of the notion is its
duality. According to a dominant vision, a « whistleblower » could be basically described as a
denunciator of risks and unethical behaviors, and could only benefit from protection as long as
its action contributes to some specific law-enforcement policies. But there is also another view of
the concept, which is based on a broad understanding of the right to free speech. In this case, any
concerned citizen could be described as a “whistleblower”, including people -like “Ed” Snowden-
who consciously disobey to the law when they blow the whistle. This uncertainty on the even
meaning of “whistleblowing” is coupled with an uncertainty on the scope of protection which is
granted to the whistleblowers. Indeed, those protections are largely ineffective in both the
United States and France, though for different reasons. In any case, the very phenomenon of
whistleblowing is at the heart of a tension between the common good on the one hand, and state
secrets in the other hand.
Le lanceur ou « donneur » d'alerte, ou, en langue anglaise, whistleblower est défini par l'assemblée
parlementaire du conseil de l'Europe (Résolution 1729 (2010), §1) comme « toute personne soucieuse
qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui
». Le présent mémoire vise, en menant une étude comparée France-Etats-Unis du droit encadrant
le phénomène du « lancement d'alerte », à cerner les éléments principaux de la notion. Le
premier trait caractéristique relevé tient à l'existence de deux conceptions du « lanceur d'alerte.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
401
La première conception, dominante, consiste à faire de celui-ci un « dénonciateur légal » : celui-ci
n'est alors reconnu comme légitime que dès lors qu'il dénonce des faits que les pouvoirs publics
entendent réprimer, ou des risques auxquels ceux-ci souhaitent mettre fin. La seconde
conception du lanceur d'alerte est quand à elle fondée sur une acception large du droit à la
liberté d'expression. Dans cette dernière seconde hypothèse, la dénomination de « lanceur
d'alerte » peut potentiellement bénéficier à tout citoyen et peut, dans sa variante la plus radicale,
se rapprocher de la désobéissance civile. L'incertitude sur la nature même du la notion se double
d'une incertitude concernant les protections qui leurs sont accordées, qui apparaissent, pour des
raisons différentes en France et aux Etats-Unis, largement ineffectives. Le « lanceur d'alerte » se
trouve placé, dans tous les cas, au centre d'une dialectique permanente entre intérêt général et
secret.
INDEX
Mots-clés: Lanceur d'alerte - Fuiteur - Environnement - Secret d'Etat - Transparence -
Corruption - Discriminations - Charge de la preuve - Libertés économiques - Droits sociaux -
Risques - Illégalités - Ethique - Liberté d'expression - Droit du public à l'informati
Keywords: Whistleblower - Leaker - Environment - State Secret - Transparency - Corruption -
Discriminations - Burden of proof - Economic freedoms - Social rights - Risks - Violation of law -
Ethics - Free speech - Right to be informed - Public servants - Betrayal -
AUTHOR
JEAN-PHILIPPE FOEGLE
Jean-Philippe Foegle est doctorant contractuel en droit public à l’Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense. Il réalise une thèse sur la protection des lanceurs d'alerte en droit
international et comparé sous la direction de Véronique Champeil-Desplats, au sein du Centre de
recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF).
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
402
Conférence
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
403
Le droit au patrimoine culturel face
aux révolutions
Zeynep Turhalli
AUTHOR'S NOTE
(intervention orale assurée dans le cadre de la journée d’étude doctorale du 6 février
2014, Révolution et droits de l’homme, CREDOF, Université Paris Ouest-La Défense)
1 La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel sont longtemps restées des
prérogatives des Etats. Mais avec les nouveaux enjeux des politiques culturelles et
juridiques, la question du rôle des communautés tend à devenir centrale et commence à
peser dans la prise des décisions. En droit international, à partir des années 1990 1, une
démocratisation s'est ouverte à différents acteurs tels que les peuples autochtones et
les ONG2. Toutefois, en droit interne, la gestion du patrimoine culturel reste encore une
compétence exclusive de l’État, découlant du principe que l’État protège l’intérêt
général3.
2 Pourtant, la notion de patrimoine culturel ne renvoie pas exclusivement à l’intérêt
général. Ce type de patrimoine apparaît comme un bien commun à une population, à
une nation, et dans de nombreux cas, à toute l’humanité4. En ce sens, l’existence d’un
monopole d’État en matière de patrimoine culturel suscite un problème pour d'autres
entités qui revendiquent des intérêts collectifs en matière de patrimoine culturel.
3 Depuis les années 2000, le débat s'est beaucoup élaboré sur ce point au sein de
l’UNESCO. L’organisation privilégie les références anthropologiques plutôt que les
définitions politiques ou les statuts juridiques, comme les nations, les minorités où le
peuple. On utilise plutôt la notion de communauté culturelle pour expliquer le
caractère de groupes culturels, qui correspond non seulement aux peuples autochtones
aux minorités ethniques ou religieuses, mais aussi à tous les autres groupes culturels 5.
4 Or, les patrimoines culturels sont plus souvent définis autrement que par les usages
anthropologiques. On peut donner l’exemple du patrimoine de l’Europe pour une
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
404
appréhension géographique, celui du patrimoine commun de l’humanité pour une
appréhension de l'universel. Parfois aussi ce sont simplement les groupes d'amateurs
eux-mêmes qui créent le patrimoine culturel de leur choix.
5 De plus, depuis les années 1980, nous utilisons le mot patrimoine culturel dans un
contexte militant analogue à celle de l’environnement6. C’est un contexte qui
rapproche le militantisme de l’environnement et des droits de l’homme. Le paysage
culturel est certes aussi important que paysage naturel pour l’homme. Mais le
patrimoine culturel est aussi lié à la dignité et l’identité de la personne. Appartenir à
une communauté et être un citoyen signifie avoir un intérêt pour le patrimoine
culturel digne d'être protégé par les droits de l’homme.
6 Les usagers des services publics acquièrent parfois assez de légitimité pour s’imposer
comme des acteurs porteurs d’un intérêt collectif. En faisant référence à une
conception renouvelée du bien commun, ils réclament un droit d’intervention 7. Cela
engendre des conflits, parfois même des révolutions. Les événements qui se sont
déroulés en juin 2013 à Istanbul sont très emblématiques à cet égard. Des manifestants
se sont regroupés pour s’opposer au projet de réimplantation d’un monument
historique, une caserne ottomane détruite en 1908. L’événement de 2013 a été qualifié
de première révolte contre un projet de patrimonialisation dans l’histoire de
l’humanité. Loin de se limiter à un acte consensuel de conservation, la protection du
patrimoine révèle donc des enjeux conflictuels8.
7 Pourtant, dans ce champ, il n’existe que peu d'outils juridiques pour concrétiser les
revendications des acteurs. Le droit du patrimoine culturel révèle une défaillance
démocratique, dévoilant un déficit de légitimité. Dans un premier temps, ce déficit sera
analysé depuis l’essor des États nations (I). Dans un second temps, nous verrons que le
développement récent d'un droit de l’homme au patrimoine culturel dissimule le
déficit de son intégration dans le système des droits (II).
I. La crise de légitimité dans le droit du patrimoine
culturel
8 Le mot patrimoine vient du mot latin patrimonium, de pater : père qui signifie l’héritage
du père succédé par les enfants. Mais dans son acceptation de bien collectif, on le
définit comme l’ensemble des pratiques et des biens culturels matériels et immatériels
appartenant à une communauté. Cela peut être l’héritage du passé et la mémoire
collective d’un groupe représenté dans les œuvres de ses artistes ainsi que dans les
créations anonymes.
9 En droit, dans son acceptation de bien collectif, le patrimoine culturel est également
défini par l’intérêt culturel qu’il présente pour une communauté donnée 9. Pour
souligner son caractère collectif et pour le différencier des intérêts privés, il est défini
comme l'« intérêt culturel public »10. La doctrine s’accorde le plus souvent pour
considérer que la notion d'«intérêt public » ne renvoie pas exclusivement à l’intérêt de
l’État. Elle insiste ainsi sur le caractère non-lucratif d’un intérêt également rattachable
à une collectivité donnée11.
10 En ce sens, l’existence d’un monopole d’intérêt public en matière de patrimoine
culturel suscite un problème de légitimité. Au cours de l’histoire, ce déficit a longtemps
été masqué par différentes stratégies : le nationalisme et les valeurs de l’identité
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
405
nationale, en droit interne, l'expertise et l’élitisme, en droit international. Ces
stratégies ont donné naissance aux deux concepts de culture que nous utilisons
aujourd’hui. L'un, d'inspiration élitiste gouverne la production des arts, de la
littérature et des autres représentations historiques, l'autre anthropologique,
considère ces derniers comme un mode de vie résultant des traditions partagées par un
groupe humain et constituent la base de leur identité culturelle 12.
11 Dans les lignes qui suivent, nous nous penchons sur ces différentes stratégies de
légitimation, celle qui se déploie au niveau national, d'abord (A), celle qui se déploie au
niveau international, ensuite (B).
A. La légitimation à l’échelle nationale
12 La protection du patrimoine culturel en droit interne a toujours été confondue avec la
fierté d’être une nation et la protection de cette valeur. Et de fait, le patrimoine culturel
est un des moyens les plus importants pour la construction d’une identité commune sur
le territoire d’un État13. Si la souveraineté sur la population et sur le territoire est la
condition sine qua non de la reconnaissance d’un État, le patrimoine culturel donne une
temporalité et met en récit la coexistence de ces éléments sur le territoire 14. Le
patrimoine culturel est un élément primordial de la continuité d'un État-Nation.
Émerge ainsi la nécessité de protéger le patrimoine culturel en Occident (1) et d’une
légitimation de celui-ci, notamment, par le sentiment d’appartenance à une nation (2)
1. La nécessité de protéger le patrimoine culturel
13 La protection du patrimoine culturel est une idée caractéristique de la modernité
occidentale. La culture en tant que telle n’est pas une préoccupation des sociétés avant
l’ère moderne industrielle15. Cette conception spécifique à la culture et étrangère aux
cultures non-occidentales, mais elle l’est aussi aux autres cultures juridiques
considérées historiquement. Le droit romain, par exemple, n'attache pas une valeur
culturelle à la transmission des objets hérités.
14 À l’époque de sa genèse, au XVIe siècle, le patrimoine est défini comme lieu de
mémoire, comme la mémoire du temps. Les monuments témoignent du passage du
temps à la postérité16. Mais à l'époque, la perception du lieu de mémoire était différente
d'aujourd’hui, n’étaient considérés comme des témoignages que la compréhension des
écritures et l’ouverture vers l’antiquité et les Classiques17.
« Pour les humanistes du XVe et de la première moitié du XVIe siècle, les monuments antiques et leurs vestiges confirmaient ou
15
illustraient le témoignage des auteurs grecs et romains18 ».
16 Dès le XVIIIe siècle, on cherche à faire dialoguer les sources littéraires et les sources
figurées. C'est le moment où la valeur interprétative des monuments se détache de sa
source écrite. Selon Dominique Poulot19, ce détachement constitue la découverte de
l’authenticité de l’œuvre. Pourtant, l’interprétation de l’authenticité n’est pas chose
facile et nécessite des étapes intermédiaires. Une société de savants, cosmopolite et
moderne, émerge comme intermédiaire et protecteur d'une culture élitiste
universelle20. Françoise Choay explique les caractéristiques de cette communauté :
17 « Pendant plus de deux siècles, l’enquête fut menée par un réseau d’érudits
appartenant à toutes les nations de l’Europe. Étonnamment divers par leurs naissances
(de la moyenne bourgeoise à la haute aristocratie), leur état (religieux et laïcs, oisifs et
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
406
hommes de profession, hommes des lettres et hommes de science) et leur fortune, ils
(cette communauté des savants), étaient unis par la même passion [...] 21. »
18 Dans cet ordre d’idée, pour Dominique Poulot, l’émergence de ce groupe d’intérêt
spécifique signifie déjà une première vision politique de la patrimonialité au début du
XVIIIe siècle. Cette société des élites et des savants fournit le cadre d’interprétation de
tout objet du passé22. Bien que l’auteur évoque une politique de patrimonialité dès cette
époque, elle ne constitue pas encore un phénomène public. Poulot envisage sous la
dénomination de « patrimoinalité » une modalité sensible d’appréhension du passé
articulée à une organisation du savoir23. Cela correspond, selon Françoise Choay, au
rôle d'instaurateur que l’on rencontre en l’Italie à l’époque humaniste, lors de la
redécouverte de l’héritage gréco-romain. Puis à l’époque classique, ce sont les
antiquaires qui ont donné leur unité aux études européennes sur les antiquités 24.
19 En France, c’est après la Révolution que la conservation d’un patrimoine a été promue
et est devenue affaire d’État. La « nation » devient l’enjeu de patrimonialité. Les
nouvelles élites, animées par un sentiment nationaliste, fournissent alors un nouveau
cadre d’interprétation, dans lequel comme le souligne, Françoise Choay, le rôle
d'instaurateur est joué par l’État. La politique de conservation élaborée à Paris, sous la
responsabilité du ministre de l’Intérieur, et l’administration, dispose d’instruments
juridiques pénaux pour la conservation de la succession nationale 25. D’après Dominique
Poulot, la patrimonialisation engagée à partir de la Révolution, est aussi un élément du
débat entre contractualistes et essentialistes. La patrimonialisation officielle s’est jouée
sur le mode d’une négociation entre les valeurs de la nation nouvellement définies par
la forme contractuelle et des valeurs « culturelles » abstraites 26 . En France, « c’est ce
compromis laborieux entre nationalité du contrat et nationalité de culture qui a permis
le triomphe d’une nation-patrimoine27». A titre de comparaison, en Allemagne, en
revanche, la nationalisation de la politique de patrimonialité est conçue comme un
retour aux racines : la découverte d’une culture populaire et d'un folklore. Ce retour
aux racines a donné lieu au romantisme allemand28.
20 Dans ce nouvel ordre, l’État ne s’inscrit pas seulement comme le protecteur du peuple,
mais aussi comme le protecteur de l’histoire commune et de la mémoire collective,
représentées dans le patrimoine, c’est-à-dire son passé et son avenir. Il ne s’agit pas
seulement d’une protection horizontale limitée aux frontières du territoire, mais aussi
d’une protection temporelle et historique. Ainsi, la protection du patrimoine culturel se
rationalise à travers la nécessité de protéger l'identité culturelle et historique au nom
du peuple.
2. La légitimation par les sentiments d’appartenance à une nation
21 Au milieu du XIXe siècle, la protection du patrimoine culturel est devenue une
préoccupation juridique de l’État-nation, alors qu'elle relevait initialement d'une élite
politique qui se posait en protectrice de la haute culture universelle. Cet intérêt de
l’État pour la culture fut l'objet, au milieu de XIXe siècle, de plusieurs études sur l’État-
nation et le nationalisme.
22 À cet égard, Miroslav Hroch a repéré trois phases en comparant des groupes
patriotiques dans plusieurs nations en Europe. Selon lui, une première phase qui court
de 1789 à 1815 ; une intelligentsia inspirée par le nationalisme issu de la Révolution
française commence à s’investir dans la conservation du patrimoine culturel. Cela
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
407
s'illustre notamment par la compilation de chants, contes populaires, musiques, danses,
et par la codification et la diffusion de la langue. Une deuxième époque (1815-1848) voit
la diffusion de cette idée auprès de la bourgeoisie, et mène à une transcription politique
de cette entreprise culturelle. Enfin, 1848 inaugure la dernière période qui se
poursuivra jusqu’à la fin de première Guerre Mondiale. C’est une période qui connait la
création des États-nations ; le nationalisme reçoit alors progressivement un vaste
soutien populaire29.
23 Ainsi, selon Ernest Gellner et Eric Hobsbawm, l’idée est que l’État préexiste à la nation
qu'il construit en véhiculant une idéologie nationaliste30. Selon Eric Hobsbawm, quelles
que soient leurs idéologies, les historiens ont contribué à la conception de cette
« communauté imaginaire » (concept emprunté à Benedict Anderson) appelée
« nation » et à ses historicismes. Or ; comme Gellner, cet auteur critique l’idée selon
laquelle les unités culturelles (les nations) et les unités politiques (les États) doivent
être congruentes, et les frontières politiques correspondre aux frontières culturelles : «
le nationalisme est une théorie de la légitimité politique qui exige que les limites
ethniques coïncident avec les limites politiques et en particulier, que les limites
ethniques au sein d’un état donné ne séparent pas les détenteurs du pouvoir du reste
du peuple31».
24 Bien que les nouvelles élites des sociétés industrialisées se tournent vers la culture
locale des peuples dans un moment donné de l’histoire, Gellner affirme que le principe
nationaliste a un esprit éthique « universaliste ». C'est justement là que réside la
grande contradiction du nationalisme32. Il n’en demeure pas moins que l'homogénéité
culturelle devient une préoccupation des modernes à travers l’idéologie nationaliste 33.
Selon Gellener, la culture devient un facteur du progrès après l’industrialisation. A
partir de la fin de XVIIIe siècle, les liens entre culture et politique commencent à être
posés. L’école devient un instrument de réalisation d'une pédagogie conçue comme
universelle.
25 Tout ceci va être réalisé dans la langue du peuple que les spécialistes vont standardiser.
Les élites intellectuelles et artistiques inventent aussi les grandes mythologies
nationales pour exprimer un esprit éternel propre à un peuple donné. Les intellectuels
idéalistes se tournent vers la campagne et la paysannerie pensées comme les
dépositaires de l’authenticité nationale. Ils s'efforcent de trouver dans le folklore, la
littérature populaire, la poésie et la musique une continuité de la tradition qui abrite
l’âme collective du Peuple, le Volksgeist (l’âme du peuple)34. Selon Alain Babadzan et la
thèse de Gellner, ce que les élites intellectuelles et artistiques trouvent comme
tradition chez le peuple, est une illustration de la culture d'élite : la littérature et la
poésie populaire deviennent le reflet de la littérature d'élite, comme la musique
folklorique, la danse populaire, la peinture populaire et la sculpture. La tradition
populaire est imitée et intègre la définition bourgeoise de la « culture » comme Beaux-
Arts35.
26 Selon Hobsbawm, en passant de l’époque où le pouvoir se légitime à travers la divinité
vers l’époque laïque, le nationalisme est devenu une force de légitimation du pouvoir.
Cette logique caractérise les États Européens du milieu du XIXème siècle jusque dans les
années 1940. La liaison du patrimoine culturel et de l’État s’établit juridiquement. Le
patrimoine au sens « légal » apparaît dans les législations nationales du XIXe siècle. Le
patrimoine culturel se rationalise à travers la nécessité de sa protection au nom de
peuple.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
408
27 Au niveau international, cette stratégie nationaliste est inopérante ; c’est donc une
stratégie universaliste et élitiste qui va être privilégiée.
B. La réponse internationale a la crise de légitimité
28 Tandis qu’au niveau étatique, le manque de légitimité de la politique de patrimonialité
a conduit des élites à la recherche de moyens alternatifs pour valoriser le patrimoine
culturel et renforcer sa protection par le droit, au contraire, à l’échelle internationale,
le patrimoine culturel a toujours été considéré sous un angle cosmopolite 36. Le
patrimoine culturel trouve sa signification dans la haute culture, notamment la
peinture, la haute littérature, l’architecture, les ruines et les monuments
archéologiques et culturels37.
29 L’approche internationale de la protection du patrimoine culturel est héritée d’une
conception du patrimoine issue du Siècle des lumières. Elle correspond à une vision
cosmopolite qui aspire à l’universel. L’élite a l’ambition de dégager des règles de vie
applicables à tous les hommes qui ont atteint le niveau de développement nécessaire 38.
C’est donc à travers l’idée de protection de valeurs universellement partagées que le
déficit de légitimité a été dissimulé au niveau international (1) sans parvenir cependant
à résister à une nouvelle crise de l’authenticité (2).
1. La protection du patrimoine culturel comme les valeurs universellement
partagées
30 La protection du patrimoine culturel en droit international s’est développée à partir
d’une vision universaliste portée par le droit de la guerre au début du XXe siècle 39. A
l’époque, l’expression « patrimoine culturel » n’est pas utilisée mais ce à quoi il renvoie
aujourd’hui est déjà reconnu comme devant être protégé en cas de conflits armés 40.
C’est peut-être à cause de cette particularité du droit de la guerre que la protection
internationale du patrimoine culturel a, jusqu’à récemment, été limitée à la
conservation des édifices et des manifestations physiques et matérielles de la création
humaine alors qu’il était davantage attaché à l’identité culturelle et à la mémoire
collective des nations dans les droits internes.
31 En droit international, le point de focalisation reste toujours l’existence matérielle
d’objets de patrimoine culturel. Cette théorie dite théorie traditionnelle de la
conservation a longtemps délimité la politique du patrimoine uniquement à la
conservation et à la préservation du statut matériel des monuments. Cette approche a
été perpétuée par les régimes de protection du patrimoine culturel après la Seconde
Guerre mondiale et ensuite par la Convention du patrimoine mondial 41.
32 Dans le système de l’ONU, la protection du patrimoine culturel est octroyée à l’UNESCO
et son régime est divisé selon les périodes de guerre et de paix. La première Convention
sur la protection du patrimoine culturel est celle de La Haye en 1954 42. Dans cette
convention, on utilise pour la première fois l’expression « bien culturel » pour désigner
les éléments du patrimoine culturel43. Mais la régularisation du mot patrimoine culturel
et sa popularisation sont survenues en grande partie après la Convention mondiale de
la protection du patrimoine culturel en 197244. Cette convention est aujourd’hui
acceptée par 190 pays membres de l’ONU45. Le régime de protection de la Convention
constitue un modèle dans la majorité des pays du monde. Cette convention introduit les
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
409
notions d’authenticité et de valeurs universelles exceptionnelles46. Elle institue par
ailleurs une liste du patrimoine mondial qui doit recenser les éléments du patrimoine
culturel porteurs de valeurs universelles exceptionnelles du point de vue des arts, des
sciences, de l’architecture ou de l’histoire47.
2. La nouvelle crise de l’authenticité
33 Dans les années 1970, ce système de valorisation du patrimoine culturel a été critiqué
par les pays non occidentaux aux motifs qu’il portait des valeurs de beauté et d’arts
développées à un moment donné en Europe48. Ce système échouerait donc dans sa
prétention à l’universalité. Les valeurs protégées ne seraient pas partagées par le
monde entier ni par toutes les civilisations49. Du point de vue des pays non occidentaux,
cela s’analyse comme une approche matérialiste marquée par les valeurs euro-
centristes50. Ces pays ont alors revendiqué l’inclusion des patrimoines vivants et
immatériels. Ainsi, des États d’Amérique latine ont affirmé qu’il fallait trouver un
moyen pour protéger les aspects immatériels du patrimoine comme les folklores, les
cultures traditionnelles et populaires, qui risquent une exploitation, une
dégénérescence et une disparition, menaçant la diversité culturelle mondiale dans son
ensemble51.
34 Parmi les patrimoines non représentés, on comptait aussi les patrimoines des peuples
et des communautés non représentées par un État52. Le patrimoine culturel des
minorités et des peuples autochtones, leur musique, leurs savoirs traditionnels et leurs
modes de vie sont aussi devenus un point de déficit dans la protection internationale
du patrimoine culturel53. La Convention de la protection du patrimoine culturel
immatériel de 2003 a cherché à combler ce déficit54. Cette ouverture a d’ailleurs montré
l’importance des communautés et le rôle qu’elles jouent dans la transmission du
patrimoine culturel. La prise en considération des droits culturels des minorités et la
protection de leurs patrimoines culturels est ainsi devenue indispensable.
II. Le développement du droit au patrimoine culturel
35 Au niveau international, la valorisation et la protection du patrimoine culturel à
travers son rattachement à l’identité culturelle d’un peuple sont récentes. Dans la
mesure où niveau international la protection du patrimoine culturel a longtemps été
limitée à la coopération interétatique et à une approche étroite de la protection 55, la
question des identités culturelles et des droits était donc hors sujet . Toutefois, bien que
la règle soit au cosmopolitisme, le rattachement du patrimoine culturel à une identité
culturelle étatique a toujours été pris en compte en droit international. Ceci apparaît
clairement dans plusieurs conventions56 : la Convention de La Haye de 1954 et les
Conventions sur la prévention de trafic illicite des biens culturels de 1970 s’appuient
sur l’identité culturelle du patrimoine. Toutefois elles ne visent que les peuples
représentés par un État57
36 Au fil des années, la protection du patrimoine a connu un changement considérable.
Dans les années 1990, le système a pu intégrer des revendications démocratiques.
L’UNESCO a adopté de nouveaux discours. Elle a initié des actions normatives en
s’appuyant davantage sur les valeurs démocratiques, le respect de la diversité
culturelle, et les droits fondamentaux. De ce fait, les groupes et les personnes
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
410
défavorisés du système de protection du patrimoine culturel y ont été progressivement
intégrés.
37 Ces changements fondamentaux dans la politique internationale du patrimoine culturel
ont suivi deux voies qui ont trouvé leur légitimité en s’appuyant sur le discours des
droits et des valeurs démocratiques. La première est celle du respect de la diversité
culturelle et de la reconnaissance de l’identité culturelle des groupes et de leur
patrimoine culturel. La seconde est celle des droits culturels en général et de la
possibilité d’une interprétation plus large des cultures et des droits culturels de
l’individu en particulier. Ces changements dans la manière de concevoir le patrimoine
culturel ont permis d’y intégrer les exclus de l’humanité (A) et la prise en considération
par le droit des intérêts culturels individuels, notamment à travers le droit au
patrimoine culturel (B).
A. L’intégration des défavorisés au système
38 Le patrimoine culturel de l’humanité intègre tous les produits de l’humanité y compris
les cultures anciennes et présentes58 . Mais jusqu’à récemment, l’humanité n’était
comprise que comme une communauté d’États59. C’est justement au cours des
années 1990 que la protection du patrimoine culturel commence à s’appuyer sur un
discours relatif à la protection de la diversité culturelle et du respect des droits de
l’homme. Cette dynamique débute avec la prise en compte de l’intérêt collectif des
groupes minoritaires en matière du patrimoine culturel60 (1) comme prélude à la
déclaration sur la diversité culturelle comme patrimoine commun de l'humanité (2).
1. La prise en compte de l’intérêt collectif des groupes minoritaires en matière du
patrimoine culturel
39 La prise en compte de l’intérêt collectif des minorités a débuté avec les luttes engagées
par des minorités et des peuples autochtones devant les organes onusiens. Ceci a été
permis par l’interprétation large conférée à l’article 27 du Pacte international des
droits civils et politiques relatifs aux droits des minorités, par le Comité des droits de
l’homme dans ses décisions sur les peuples autochtones 61. Selon l'article 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
40 « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les
personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en
commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue » 62.
41 Les peuples autochtones ont notamment attiré l’attention sur le fait que leurs cultures
étaient de plus en plus vulnérables. Leurs modes de vie et de subsistance économique
ont été gravement menacés63. Jusque dans les années 1970, les peuples autochtones ont
été considérés comme les minorités au sens général. Le rapport de la Sous-Commission
des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités de 1971 montre pour la première fois que les peuples autochtones ont des
particularités différentes.
42 « Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui,
liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les
sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se jugent distinctes
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
411
des autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties
de ces territoires. Ce sont des éléments non dominants de la société et elles sont
déterminées à conserver, développer et transmettre aux générations futures les
territoires de leurs ancêtres et leur identité ethnique qui constituent la base de la
continuité de leur existence en tant que peuples, conformément à leurs propres
modèles culturels, à leurs instituons sociales et à leurs systèmes juridiques » 64.
43 Le rapport a aussi pour la première fois mentionné la particularité du patrimoine
culturel, et son risque de disparation et d’exploitation par les tiers. Il a par ailleurs
insisté sur le fait que les autochtones ont un rôle important pour protéger la diversité
culturelle mondiale.
44 L’initiative des autochtones a conduit à la création d’un forum de discussions avec les
représentants des populations autochtones. Ensuite, les études spéciales sur les peuples
autochtones ont continué au sein de l’ONU et l’UNESCO.
45 Le débat sur le patrimoine culturel des peuples autochtones et leurs droits collectifs a
aussi avancé. En tant que collectivités infra étatiques, on peut comparer le statut
juridique de leur patrimoine culturel avec les minorités en droit international. Mais en
raison de leur particularité historique, de leurs modes de vie et de la spécificité de leurs
cultures, ainsi que leurs droits collectifs, le statut juridique des peuples autochtones est
souvent mieux défini que celui des minorités. On le considère souvent comme un droit
sui generis : droit des peuples autochtones sur leur territoire, leurs ressources
naturelles, économiques et culturelles.
46 La doctrine considère parfois les peuples autochtones comme des peuples qui ont
échappé au processus de décolonisation des années 1960 65. Depuis l’adaptation de la
Déclaration des droits des peuples autochtones, en septembre 2007, ces derniers sont
reconnus par le droit international, comme une catégorie bénéficiaire des droits des
peuples, notamment le droit à l’autodétermination interne. Cela est aussi affirmé par
l’article 1(3) de Convention 169 de l’Organisation international du travail relative aux
peuples autochtones et tribaux (1989) et par les articles 3 et 4 de Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochthones. Le comité des droits de l’homme
a aussi reconnu les peuples autochtones, et considère ces derniers comme bénéficiaires
du droit à l’autodétermination en vertu de l’article 1 commun de PIDCP et le PIDESC.
Dans ce contexte, le patrimoine culturel est interprété comme un droit aux ressources
économiques et culturelles.
47 Par ailleurs, dans le champ des droits des peuples autochtones, la notion de propriété
est de plus en plus utilisée pour rendre effectifs les droits économiques, sociaux et
culturels des peuples autochtones. La notion de propriété collective est souvent utilisée
comme un moyen de protection des ressources essentielles, telles que la terre, les
ressources naturelles, les moyens de subsistance économique, mais également les
ressources culturelles.
48 La notion de propriété collective est également utilisée, d’une part, pour protéger le
patrimoine culturel immatériel des peuples autochtones, notamment leurs savoirs
traditionnels et pharmaceutiques, leur folklore et leur musique et, d’autre part, pour
empêcher l’exploitation de leur patrimoine culturel. Depuis les années 2000, la Cour
Interaméricaine des droits de l’homme a notamment développé une jurisprudence
considérable à l’égard des communautés autochtones66. En particulier, dans certaines
décisions concernant directement le sujet de la propriété collective, la Cour a
développé le contenu du droit des autochtones aux ressources naturelles et à leur
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
412
territoire ancestral67. En revanche, le CEDH n’a pas encore prononcé une décision sur la
propriété collective et le patrimoine culturel avec un renvoi au droit à l’identité
culturelle.
49 Pourtant le statut juridique du patrimoine culturel de ces minorités reste toujours
délicat. Celles-ci ne bénéficient pas de droits collectifs. Certains auteurs proposent alors
d'envisager le sujet des droits culturels des minorités comme étant individuels, mais
avec un objet collectif. Ils proposent ainsi d'interpréter la communauté, la culture et le
patrimoine culturel comme des objets de droits culturels68, en tant que ressources et
conditions nécessaires pour le libre exercice de ces droits 69. Les organes juridictionnels
et les instruments relatifs à la protection des droits de l’homme n’ont pas franchi le
pas, ce qui empêche une protection efficace du patrimoine culturel des minorités.
50 Pour les minorités, le risque de la disparation culturelle et la pérennité de la culture
sont dès lors grands. À cet égard, la politique de la construction des barrages et
centrales hydroélectriques comme le Projet de GAP en Turquie fournit un bon exemple.
Pendant la construction de barrage « Ataturk », plusieurs sites archéologiques ont été
inondés, de même pendant le projet de construction du barrage « Ilisu » qui prévoyait
l’inondation entière de la ville historique de Hasankeyf au sud-est de la Turquie.
Pourtant, la ville est importante pour l’histoire des minorités kurdes et elle est
également un lieu de culte de la minorité syriaque.
2. La diversité culturelle comme patrimoine commun
51 La protection de la diversité culturelle était traditionnellement séparée de la protection
du patrimoine culturel au sein de l’UNESCO70. Initialement, la diversité culturelle était
appréhendée comme un élément de protection de la paix71. Désormais, le respect de
l’égale dignité de toutes les cultures et du droit de chaque culture à subsister fait
consensus72.
52 En 1989, l’UNESCO a adopté une recommandation sur le savoir traditionnel. L’UNESCO a
lancé en 1993 le programme des « Trésors humains vivants » pour la protection des
cultures et traditions menacées et, en 1998, le programme de « Proclamation de chefs-
d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité». Dans les années 2000,
l’UNESCO s'est plutôt concentré sur l’intolérance dans les sociétés multiculturelles et la
disparation des ressources culturelles à l’échelle mondiale. Cette attitude devait
contrer la menace de mondialisation et celle d'appauvrissement de la diversité
culturelle et linguistique. Dans une Déclaration de l’UNESCO de 2001, il est précisé que
la diversité culturelle comprend l’ensemble des identités culturelles qui constitue
l’humanité. La diversité culturelle a été reconnue dans cette même déclaration comme
un élément du patrimoine commun de l’humanité73.
A. Le droit au patrimoine culturel
53 Le droit de l’individu au patrimoine culturel a longtemps été restreint. En effet, les
droits culturels en général, associés aux droits économiques et sociaux, ont été
longtemps considérés comme les parents les plus pauvres de ces droits 74, et parmi ces
droits, le droit au patrimoine culturel a été longtemps interprété comme l’un des plus
fragiles75.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
413
54 Depuis les années 1990, le contenu des droits culturels a été élargi et il comprend
désormais la culture dans un sens large, c’est-à-dire combinant à la fois l’idée élitiste et
cosmopolite de culture et l’idée anthropologique de culture qui intègre les droits des
minorités76. Le patrimoine culturel est donc devenu un objet de droits culturels (1). On
peut alors envisager un droit de l’homme au patrimoine culturel (2).
1. Le patrimoine culturel comme objet des droits culturels
55 Le lien du patrimoine culturel avec les droits culturels est établi par l’article 27 de la
Déclaration universelle de droits de l’homme et par l’article 15 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pourtant, le droit de l’individu au
patrimoine culturel prescrit dans ces textes a été longtemps considéré comme
restreint. L’article 15 visait le droit à « participer à la vie culturelle de la
communauté », et à bénéficier du progrès scientifique et culturel. La culture est ainsi
conçue comme un bénéfice. Il n’est fait référence ni au droit au patrimoine culturel
propre à chacun, ni au patrimoine culturel comme un élément de l’identité culturelle
d’un groupe et d’une personne.
56 Mais désormais, la notion de culture a été élargie. Dans son observation générale sur les
droits culturels en 2009, le Comité des droits économiques sociaux et culturels
reconnaissait le caractère à la fois collectif et individuel de ces droits. Les droits des
minorités et des peuples autochtones à l’identité culturelle et au patrimoine culturel
ont aussi été reconnus dans le cadre des droits culturels. Les obligations des États en
matière de droits culturels ont été également précisées77. Les États ont des obligations à
la fois positives et négatives et doivent respecter, protéger et donner effet à ces droits 78.
Enfin, en 2011, l’expert international des Nations Unies dans le domaine des droits
culturels a publié un rapport sur le droit au patrimoine culturel qui démontre lui aussi
l’importance de ce droit parmi les droits culturels79 .
2. Un droit de l’homme au patrimoine culturel
57 Le droit subjectif au patrimoine culturel est un droit récent apparu en 2005 dans la
Convention de Faro du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la
société80 même s’il avait déjà été mentionné en 1998 par la Déclaration d’ICOMOS 81. Par
la suite, ce droit a été développé par le groupe de Fribourg puis dans le cadre de
Déclaration des droits culturels en 200782. Il était aussi, quoique dans un cadre plus
particulier, l’un des leitmotivs de la Déclaration des peuples autochtones 83. Enfin, il a été
rangé parmi les droits culturels par le Comité des droits économiques sociaux et
culturels dans son Observation générale n°21 de 200984.
58 Le droit au patrimoine culturel comprend le droit à l’identité culturelle, mais aussi le
droit de choisir son patrimoine culturel. Il permet non seulement de s’opposer à des
violations mais aussi de construire l’identité et le patrimoine de son choix. Il reste que
ces choix ne sont pas applicables sans droits procéduraux tels que le droit de
participation aux prises de décisions ou le droit au consentement préalable, c’est-à-dire
le droit d'être consulté par les autorités avant la mise en œuvre d’un projet qui va avoir
des conséquences sur la vie des communautés et des personnes concernées. Pourtant,
ce type de droits procéduraux est reconnu aux peuples autochtones en vertu du droit à
l'auto-détermination85. Les autres collectivités, comme les minorités, les communautés
et les groupes ne sont pas reconnues comme sujet d’un tel droit.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
414
59 ***
60 En conclusion, nous pouvons dire que depuis leur émergence dans le droit, les notions
de patrimoine culturel et d'authenticité ont beaucoup changé. Celles-ci ne révèlent pas
seulement la nécessité de protection et de conservation de l’objet du patrimoine, mais
permettent aussi de revendiquer les droits et de saisir une possibilité de changement
qui est liée à l’identité culturelle et à la dignité de la personne humaine.
61 La protection et la gestion du patrimoine culturel se trouvent aujourd’hui devant une
crise importante de légitimité. D’un côté, les valeurs nationales et l’identité culturelle
nationale ne suffisent pas pour représenter les sentiments de l’individu moderne. Les
individus ont désormais une autre conception de l’identité culturelle qui est plus
cosmopolite et complexe86. Les appartenances exclusives, à la nation, aux classes ou à la
religion, impliquant des fidélités à long terme, ont tendance à diminuer. Dans une
société de masse, les individus tendent à développer des appartenances et des identités
culturelles multiples et flexibles87.
62 D’un autre côté, l’authenticité de l’œuvre d’art et les valeurs esthétiques
universellement partagées deviennent aussi un mythe au niveau international. Il y a
des années que le cosmopolitisme prétendu est mis en question par le débat sur le
relativisme culturel88. Autrement dit, l’authenticité définie par les valeurs esthétiques
occidentales est mise en question. Le patrimoine culturel se trouve donc devant une
vraie crise de légitimité à toutes les échelles. Tant les individus que les groupes, tels que
les minorités culturelles et les peuples autochtones, sont mécontents de cette situation
et revendiquent une nouvelle forme de légitimité à travers le discours des droits.
63 En effet, au cours des années, les acteurs sociaux, comme les usagers de services publics
et les minorités culturelles et les peuples autochtones ont acquis assez de légitimité
pour réclamer un droit d’intervention. Pourtant, ces revendications révèlent encore un
paradoxe important en droit. Le système juridique peut ne pas reconnaître ceux qui les
revendiquent si ces revendications ne sont pas exprimées en termes de droits
subjectifs89. D’ailleurs, ces acteurs sociaux sont parfaitement conscients de cette
situation, puisque ce sont, de fait, leurs besoins et libres choix qu’ils veulent exprimer
en termes de droits90.
NOTES
1. SYMONIDES JANUSZ, «The History of the paradox of cultural rights and the state of the discussion
within UNESCO», in M EYER-BISCH PATRICE, Les droits culturels. Une catégorie sous-développée des droits
de l’homme, coll. « Interdisciplinaire: droits de l’homme », Fribourg, Éditions universitaires, 1993,
pp. 47-72.
2. La Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, Actes de la
Conférence générale de l’UNESCO, 25e session, Paris du 17 octobre au 16 novembre
1989, Vol. I ; Annexe I.B, Voir aussi BLAKE JANET, Élaboration d’un nouvel instrument
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
415
normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Éléments de réflexion (édition
révisée, 2002), UNESCO, Paris, 2001, p. V.
3. CHEVALLIER JACQUES [...] Le mythe de l’ « intérêt général » sur lequel l'Etat a construit sa
légitimité a perdu de sa force [...] l’intérêt générale ne apparaît pas plus comme étant le
monopole de l’État qu'il n'est le signe distinctif [...] L’État post-moderne, « L'Etat démythifié »,
Maison de Sciences de l'Homme, La collection droit et société, Paris, 2003, p.65, Voir aussi REMY
JEAN, « Transformation de la relation entre usagers et services publics : nouveau mode d’accès à la
citoyenneté ? » in Droit et intérêt, sous la direction de GÉRARD PHILIPPE, OST FRANÇOIS, VAN DE KERCHOVE
MICHEL volume 1: approche interdisciplinaire, Publications des Facultés universitaires Saint-Luis,
Bruxelles,1990, pp.131-132.
4. Voir, Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, Ouvrage coordonné par C ORNU MARIE,
FROMAGEAU JERÔME, WALLAERT CATHERINE, CNRS éditions, Paris, 2012, p.740 ; Voir aussi C ORNU MARIE,
Le droit culturel des biens. L’intérêt culturel juridiquement protégé, Bruxelles, Bruylant, 1996,
pp. 14-17.
5. L’étude préliminaire, présentée à la réunion d’experts organisée par l’UNESCO à
Turin en 2001, Rapport relatif à l’étude préliminaire sur l'opportunité de règlementer a
l'échelon international, par un nouvel instrument normatif, la protection de la culture
traditionnelle et populaire, Doc. 161 EX/15 Annexe, Paris, le 16 mai 2001.
6. HAFSTEIN, VALDIMAR. T., « Cultural Heritage », in Companion To Folklore, BENDIX R. F. and G.
HASAN-ROKEM (dir.), John Wiley & Sons, ltd, Chichester, 2012, p. 502.
7. REMY JEAN, op. cit., p.119.
8. DOLFF-BONEKAMPER GABI, (2010), « Patrimoine culturel et conflit : le regard de l’Europe » Museum
international (française), mai 2010, Volume 62, issue 1-2, pp. 15.
9. Selon Le dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, « […] il peut être définit au sens
large comme l’ensemble des traces des activités humaines, matérielles ou immatérielles, qui
revêtent une valeur pour une communauté donnée et dont la sauvegarde et la protection doivent
partant être assurées [...] », CORNU MARIE, FROMAGEAU JÉRÔME, WALLAERT CATHERINE, op. cit., p. 740.
10. CORNU MARIE op. cit., p.29.
11. CORNU MARIE, FROMAGEAU JÉRÔME, WALLAERT CATHERINE, ibid, et CORNU MARIE, op. cit., 1996, pp. 14-17.
Voir aussi CHEVALIER JACQUES, « [...] Le mythe de « l'intérêt général » sur lequel l’État a construit sa
légitimité a perdu de sa force [...]: l’intérêt général n'apparaît plus comme étant le monopole de
l’État [...] », « L’État démythifié », L’État post-moderne, Maison de Sciences de l'Homme, La
collection droit et société, Paris, 2003, p. 65.
12. CHATELAIN JEAN, CHATELAIN FRANÇOISE, Oeuvres d’art et objets de collection en droit français, Berger-
Levrault, Paris, 1990 p. 10-15 ; Voir aussi WIEVIORKA MICHEL, La Differance, Les Éditions Balland,
Collection : Voix et regards, Paris, 2001, p. 32.
13. GELLNER ERNEST, Nations et Nationalisme, traduit d’Anglais par Bénédicte Pineau, Editions Payot,
Paris, 1989; HOBSBAWM ERIC, Nations et nationalisme since1780: Programme, Mythe, Reality. , Cambridge
University Press, Cambridge, (First published 1990) Canto edition, 1995 ; A NDERSON B ENEDICT,
Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (First published by Verso
1983) Revised Edition, Verso, London-New York, 2006.
14. ANDERSON BENEDICT, op.cit. p. 26.
15. GELLNER ERNEST, op.cit., pp. 25-28.
16. POULOT DOMINIQUE, op.cit., p. 12.
17. Ibid.
18. CHOAY FRANÇOISE, L’allégorie du Patrimoine, Paris Seuil, 1992, édition actualisée en 2007, p. 50.
19. POULOT DOMINIQUE, op.cit., p. 12. Voir aussi l’article de Walter Benjamin en ce sens, « Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodusierbarkeit ». Paru pour la première fois en
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
416
1936 en France sous le titre «L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée», voir également in
internet, http://www.arteclab.uni-bremen.de/~robben/KunstwerkBenjamin.pdf, date de la dernière
consultation 18 novembre, 2014, pp. 6-7.
20. POULOT DOMINIQUE, op.cit., p. 12.
21. CHOAY FRANÇOISE, op.cit., p. 51.
22. POULOT DOMINIQUE, op.cit., p.12.
23. POULOT DOMINIQUE, op.cit., p.16.
24. CHOAY FRANÇOISE, L’allégorie du Patrimoine, Paris Seuil, 1992, p. 93.
25. CHOAY FRANÇOISE, op.cit., p. 93.
26. POULOT DOMINIQUE, op.cit., p. 17.
27. Ibidem.
28. En Allemagne, Johann Gottfried Herder fut l’idéologue du mouvement. Il a mis en avant la
poésie populaire et il a recueilli des chansons populaires de différents pays dans Stimmen der
Völkers in Liederns ( Les Voix des peuples dans leurs chants), voir également in internet, http://
gutenberg.spiegel.de/autor/johann-gottfried-herder-264
29. HROCH MIROSLAV, « De l’ethnicité à la nation. Un chemin oublié vers la modernité »,
Anthropologie et Société, Volume 19-3, 1995, p.71-86 cité par POULOT DOMINIQUE, op. cit., p. 18 et Social
Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge, 1985 cité aussi par H OBSBAWM ERIC, op. cit., p.
12.
30. GELLNER ERNEST, op. cit., p. 166.
31. GELLNER ERNEST, op. cit., pp .12-13.
32. GELLNER ERNEST, op. cit. pp. 86.
33. GELLNER ERNEST, op. cit., pp. 26-28.
34. BABADZAN ALAIN, 1999, « l’invention des traditions et le nationalisme », in les politiques de la
tradition : identités culturelles et identités nationales dans le pacifique, N° spécial du Journal de la
Société des Océanistes, 109(2), p. 18.
35. Ibidem.
36. MERRYMAN JOHN HENRY, « Two Ways of Thinking About Cultural Property », The American Journal
of International Law, Vol. 80, n° 4.(Oct. 1986), p. 831.
37. ZIEGLER KATJA, in GIUFFRÈ MILANO (ed), Alberico Gentili: La Salvaguardia Dei Beni Culturali Nel Diritto
Internazionale (2007), La Version anglais , University of Oxford Faculty of Law Legal Studies
Research Paper Series, Working Paper n° 26/2007 September 2007, p. 4.
38. BORIES CLEMENTINE, Le patrimoine culturel en droit international. Les compétences des États à l’égard
des éléments du patrimoine culturel, Pedone, Paris, 2011, p. 47.
39. Conventions et Règlements de La Haye de 1899 et 1907 ; le Pacte Roerich, Washington 1935,
Convention de Genève N. IV de 1949 et Protocoles additionnels I et II de 1977 ; Convention de
l’UNESCO pour la Protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954), et ses deux
Protocoles de 1954 et 1999.
40. L’article 1 de la Convention de l’UNESCO pour la Protection des biens culturels en cas de
conflit armé (La Haye, 1954), et ses deux Protocoles de 1954 et 1999.
41. YAHAYA AHMAD « The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible »,
International Journal of eritage Studies,Volume. 12, N° 3, Mai 2006, pp. 292-300.
42. Convention de l’UNESCO pour la Protection des biens culturels en cas de conflit armé (La
Haye, 1954).
43. L’article premier, Definition des biens culturels, Convention de l’UNESCO pour la Protection des
biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954).
44. Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,
Paris, le 16 novembre 1972.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
417
45. États-parties : Situation de la Ratification : 190 Pays à la Convention au 19 sept. 2012, http://
whc.unesco.org/fr/etatsparties/
46. Voir l’art. 1 et 2, Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel, Paris, le 16 novembre 1972.
47. Voir l’art. 11, ibid..
48. HODDER, IAN, «Cultural Heritage Rights, From Ownership and Descent to Justice and Well-
being», Anthropological Quarterly, Volume 83, n °4, automne 2010 , pp. 862-863.
49. HAFSTEIN VALDEMAR T., The making of intangible cultural héritage| Tradition and authenticity,
community and humanity, these de doctorat, Université de California, Berkeley, 2004 p.20 et p. vii.
50. Ibid.
51. HAFSTEIN VALDEMAR T., op. cit., p. 20.
52. BLAKE Janet« Elaboration d’un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériels Éléments de réflexion » (édition révisée, 2002), publié par l’UNESCO, Paris, 2001,
p. 5.
53. HAFSTEIN, op. cit., p. 61.
54. BLAKE JANET, op. cit.
55. ZIEGLER KATJA, op. cit., p. 4.
56. Convention de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Lahey,
14 mai 1954), Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
(Paris, 14 novembre 1970).
57. ZIEGLER KATJA, op. cit., p. 5.
58. Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Paris, Résolution adoptée sur
le rapport de la Commission IV à la 20iem séance plénière, le 2 novembre 2001, l’article premier.
59. S COVAZZI TULLIO, « La notion de patrimoine culturel de l’humanité dans les instruments
internationaux », le patrimoine culturel de l’humanité/Académie de Droit international de La Haye = The
Cultural Heritage of Mankind /Hague Academy of international Law, sous la dir. de James A.R. Nafziger,
Tullio Scovazzi, Martinus Nijhof, Leiden, 2008, p. 3.
60. BLAKE JANET op. cit., p. 5.
61. Voir aussi Comité des droits de l’homme : Yvan Kitok c. Suède, communication n° 197/1985 ;
Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubicon c. Canada, communication n° 167/1984 ; ilmari
Länsman et consorts c. Finlande, communication N° 511/1992 ; Jouni E. Länsman et consorts c. Finlande,
communication N° 671/1995 ; Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande, communication n° 547/1993 ;
Angela Poma Poma c. Pérou, communication n°1457/2006.
62. Pacte adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966,
entrée en vigueur : le 23 mars 1976.
63. Voir aussi Comité des droits de l’homme : Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubicon c.
Canada, communication n° 167/1984.
64. COBO Martinez J. R. , Étude du problème de la discrimination à l’encontre des populations
autochtones(Nations unies, New York, 1987) [Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4]. La Sous-
Commission de lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, UCHCR,
Genève aux §§ 379 et 380.
65. SCHULTE TENCKHOFF ISABELLE, « Droits collectifs et autochtonie. Que penser des « traites
modernes » au Canada ? » in BERNS THOMAS (dir), Les droits saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant,
2004, pp. 133-164.
66. Pour un analyse plus détaillée, voir RINALDI KARINE « Le droit des populations autochtones et
tribales a la propriété dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme » in Le
particularisme interaméricain des droits de l’homme, En l’honneur du 40e anniversaire de la
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
418
Convention américaine des droits de l’homme, Sous la direction de HENNEBEL LUDOVIC et TIGROUDJA
HÉLÈNE, Pedone, Paris, 2009, pp. 215-250.
67. L’arrêt du 17 juin 2005, Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, Série C no125 § 131, l’arrêt
du 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua; arrêt du 15 juin 2005,
Comunidad Moiwana v. Surinam; arrêt du 17 juin 2005, Comunidad indígena Yakye Axa v. Paraguay;
arrêt du 29 mars 2006, Comunidad indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay; arrêt du 28 novembre 2007,
Pueblo Saramaka v. Surinam. L’arrêt du 29 avril 2004, Masacre Plan de Sánchez v. Guatemala. Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Communauty c. Nicaragua, Série C no.66 et arrêt du 31 août 2001 sur les
réparations, Série C n°79, § 148.
68. MEYER-BISCH PATRICE, « Analayse des droits culturels » Droits fondamentaux, n° 7, janvier 2008 –
décembre 2009 ; voir également en internet http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/
df7dfdcpmb.pdf, date de la dernière consultation 18 novembre, 2014, p. 1.
69. BIDAULT MYLÈNE, La Protection des droits culturels en droit international, Bruylant, Bruxelles, 2009,
pp. 431-517.
70. TENORIO DE AMORIM FERNANDO SÉRGIO, « La diversité des cultures et l’unité du marché : les défis de
la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles. », le patrimoine culturel de l’humanité/Académie de Droit international de La Haye=The
Cultural Heritage of Mankind /Hague Academy of international Law, sous la dir. de JAMES A.R. NAFZIGER,
TULLIO SCOVAZZI, Martinus Nijhof, Leiden, 2008, pp. 355-358.
71. SCOVAZZI TULLIO, « La notion de patrimoine culturel de l’humanité dans les instruments
internationaux », le patrimoine culturel de l’humanité/Académie de Droit international de La Haye = The
Cultural Heritage of Mankind /Hague Academy of international Law, sous la dir. de James A.R. Nafziger,
Tullio Scovazzi, Martinus Nijhof, Leiden, 2008, p. 3.
72. Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale L’Article 1.
73. Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Paris, Résolution adoptée sur
le rapport de la Commission IV à la 20e séance plénière, le 2 novembre 2001, l’article premier.
74. MEYER-BISCH PATRICE, Les droits culturels, une catégorie sous-développée des droits de l’homme. Actes
du VIIIe Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme à l’Université de Fribourg, 1993.
75. B IDAULT MYLÈNE, « Ce que déclarer des droits culturels veut dire », Droits Fondamentaux, n°7,
janvier 2008 – décembre 2009, pp. 14-15.
76. BIDAULT MYLÈNE, La Protection des droits culturels en droit international, Bruylant, Bruxelles, 2010 ,
p. 434
77. Observation générale N°21 (2009) relative au droit de chacun de participer à la vie culturelle (par. 1 a)
de l'article15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), E/C.12/
GC/21, par. 49 d) et 50
78. Idem.
79. Rapport de l’Experte indépendante dans le domaine des droits culturels, Mme Farida
SHAHEED, Conseil des droits de l’homme dix-septième session (A/HRC/17/38), 21 mars 2011.
80. Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société
(2005).
81. Le Déclaration de Stockholm, ibidem.
82. La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 7-8 mai 2007 (le texte proposé est parrainé
par une cinquantaine de personnalités reconnues dans le domaine des droits de l’homme, ainsi
que par la plate-forme d’ONG).
83. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 3 septembre 2007,
Résolution adoptée par l’Assemblée générale (A/6/L.67 et Add.) 61/295.
84. Observation générale n°21 (2009), par. 50 .
85. DOYLE CATHAL, CARINO JILL, Making free prior and informed consent a reality, indigenous People and the
extractive sector, Middelesex University School of Law, mai 2013, pp. 7-16.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
419
86. Voir un exemple de « Place making » ([littéralement « fabrication d’espace » en anglais] et la
construction « d’identités culturelles cosmopolites » par l’initiative d’un groupe d'individus dans
une ville en République tchèque en ancien Sudetenland, le « Pays des Sudètes » connu par sa
Crise de Sudètes avant la II.ieme Guerre mondiale. Film documentaire réalisé par AIANO ZOE,
GUTOWSKA MARIA, TURHALLI ZEYNEP dans le cadre de "Summer school of ethnographic film making"
organisé par Departement d' Anthropologie, L'Université de l'Ouest Bohemia, juillet 15-27 2013,
Zlutice, publication de Visegrad Fund, 2013, également en internet :http://
www.antropologie.org/en/node/86
87. REMY JEAN, op. cit., p. 120.
88. DONNELLY JACK, «Cultural Relativism and Universal Human Rights », in Human Rights Quarterly,
Volume 4, 6, 1984, p. 402.
89. CHEVALLIER JACQUES, « Le concept d'ineteret en science administrative», in Droit et intérêt, sous
la direction de GÉRARD PHILIPPE, OST FRANÇOIS, VAN DE KERCHOVE MICHEL , volume 1: approche
interdisciplinaire, Publications des Facultés universitaires Saint-Luis, Bruxelles,1990, p. 135.
90. H OLSTON JAMES, Insurgent Citizenship, Disjunction of democracy and Modernityin Brazil, Princeton
University Press, New Jersey, 2008, pp. 247-250 : “Reinventing Public Space”, p. 253 : “New
foundations of rights” , p. 255.
ABSTRACTS
The notions of cultural heritage and authenticity have evolved greatly since their very first
emergence. This dual paradigm shift within the law of the protection of the cultural heritage not
only reveals the need for the protection and conservation of a wide variety of cultural objects,
but its reference to the cultural rights provides the opportunity to claim the legal change for
historically disadvantaged groups and the persons.
The objective of this paper is to demonstrate the lack of legitimacy within the public
administration of cultural policies and the cultural heritage law. In our opinion, that deficit is
tending to be filled through a strong human rights discourse nowadays. In the past, this deficit
was concealed in two ways. First, at a national level, cultural heritage is used to excite a feeling of
belonging to a nation and its cultural identity. At the international level, where cultural heritage
is linked to the cosmopolitan values, including the authenticity of a work of art and universal
aesthetic values defined by a cultural elite. But today the individuals as well as the disgruntled
minority groups tend to develop different affiliations and multiple and flexible cultural
identities. In the end, these persons and groups need some sort of legal autonomy in order to
make choices. In this context a new form of legitimacy spreads out through a right to cultural
heritage.
Depuis leur émergence en droit, les notions de patrimoine culturel et d'authenticité ont
beaucoup évolué. Cette double révolution conceptuelle ne révèle pas seulement la nécessité de
protection et de conservation d'une grande variété des objets. Elle permet aussi de saisir une
possibilité de changement en faisant référence aux droits culturels.
L’objectif de cet article est de démontrer qu’il existe un déficit de légitimité en matière de gestion
du patrimoine culturel et que celui-ci tend à être rempli à travers les droits de l'homme. Ce
déficit de légitimité a été dissimulé de deux manières. D’abord au niveau national où le
patrimoine culturel est utilisé pour exalter un sentiment d’appartenance à une nation et à son
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
420
identité culturelle. Ensuite, au niveau international où le patrimoine culturel est rattaché aux
valeurs cosmopolites, notamment à l’authenticité de l’œuvre d’art et aux valeurs universelles
esthétiques qui sont décidées par une élite. Mais dans la société contemporaine les individus
tendent à développer des appartenances et des identités culturelles multiples et flexibles. Dans ce
cadre les individus ainsi que les groupes mécontents revendiquent une nouvelle forme de
légitimité à travers un droit au patrimoine culturel de leur choix.
Las nociones de patrimonio cultural y autenticidad han experimentado una gran evolución desde
su aparición en el ámbito jurídico. Así, se ha producido una doble revolución conceptual que
pone de manifiesto no sólo la necesidad de protección y conservación de una gran variedad de
objetos culturales, sino que, a través de la referencia a los derechos culturales, reclama un
cambio de paradigma.
El presente artículo tiene por objeto demostrar la existencia de un déficit de legitimidad en
materia de gestión del patrimonio cultural, que debe ser suplido a través de los derechos
humanos. Este déficit de legitimidad ha tratado de ocultarse de dos maneras: en primer lugar, a
nivel nacional, el patrimonio cultural es utilizado para exaltar un sentimiento de pertenencia a
una nación y a su identidad cultural; a nivel internacional, el patrimonio cultural aparece ligado a
valores cosmopolitas, principalmente a la autenticidad de la obra de arte y a los valores estéticos
universales decididos por una élite. Sin embargo, en la sociedad contemporánea los individuos
tienden a desarrollar identidades culturales múltiples y flexibles. En este contexto, tanto los
individuos como los grupos reivindican una nueva forma de legitimidad, a través de un nuevo
derecho al patrimonio cultural.
INDEX
Mots-clés: Droits culturels - patrimoine culturel - droit au patrimoine culturel – légitimité –
authenticité - minorités
Keywords: Cultural rights - cultural heritage - the right to cultural heritage – legitimacy –
authenticity - minorities
Palabras claves: Derechos culturales - patrimonio cultural - derecho al patrimonio cultural –
autenticidad - identidad cultural – legitimidad – nacionalismo - minorías
AUTHOR
ZEYNEP TURHALLI
Zeynep Turhalli est doctorante en droit public au CREDOF
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
421
Bibliographie
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
422
Bibliographie
Ouvrages en français
1 ANSELME Isabelle, L’invocation de la déclaration des droits de l’homme et de la constitution
dans les débats de l’Assemblée législative (1791-1792), Paris, LGDJ, 2014, 342p.
2 BALLOT Elodie, Les insuffisances de la notion des droits fondamentaux, Paris, Mare et
Martin, 2014, 554p.
3 BERNARD Diane, Juger et juger encore les crimes internationaux; étude du principe non bis in
idem, Bruxelles, Bruylant, 2014, 312p.
4 BICKENBACH Jerome E. , FELDER Franziska, SCHMITZ Barbara (dir.), Disability and the
Good Human Life, Cambridge, Cambridge University Press, Mars 2014, 337 p.
5 BIOY, Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, collections Cours, 2014, 813 p.
6 BLANCK Peter, eQuality : The Struggle for Web Acessibility by Persons with Cognitive
Disabilities, Cambridge, Cambridge University Press, Octobre 2014, 501 p.
7 BREMS Eva, The Experience of Face Veil Wearers in Europe and the Law, Cambridge,
Cambridge University Press, Septembre 2014, 321 p.
8 CHAMPEIL-DESPLATS Véronique, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris,
Dalloz, 2014, 432p.
9 DE BECO Gauthier, MURRAY Rachel, A Commentary on the Paris Principles on National
Human Rights Institutions, Cambridge, Cambridge University Press, Novembre 2014, 208
p.
10 DJABAKATE Mohamed Madi, Le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique, Paris,
L’Harmattan, 2014, 124p.
11 DRACHE Daniel, JACOBS Lesley A. (dir.), Linking Global Trade and Human Rights : New Policy
Space in Hard Economic Times, Cambridge, Cambridge University Press, Mars 2014, 328 p.
12 DUWELL Marcus, BRAARVIG Jens, BROWNSWORD Roger, MIETH Dietmar (dir.), The
Cambridge Handbook of Human Dignity : Interdisciplinary Perspectives, Cambridge,
Cambridge University Press, Avril 2014, 629 p.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
423
13 ERGEC Rusen, VELU Jacques, Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles,
Larcier, 2ème édition, 2014
14 ERGEC Rusen, HAPPOLD Matthew, Protection européenne et internationale des droits de
l’homme, Bruxelles, Larcier, 2014, 333p.
15 ERNAL Paul, Internet Privacy Rights : Right to Protect Autonomy, Cambridge, Cambridge
University Press, Mars 2014, 328 p.
16 FALLON Damien, L’abstention de la puissance publique et la garantie des droits fondamentaux,
Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1, Capitole, 2014, 546 p.
17 FIERESN Jacques, Droit humanitaire pénal, Bruxelles, Larcier, 2014, 372p.
18 FLOOD Colleen M., GROSS Aeyal, The Right to Health at the Public/Private Divide : A Global
Comparative Study, Cambridge, Cambridge University Press , Juillet 2014, 506 p.
19 GENSER Jared, STAGNO UGARTE Bruno, The United Nations Security Council in the Age of
Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, Juin 2014, 544 p.
20 HAMA Kadidiatou, Le statut et les fonctions du juge pénal international, Paris, L’Harmattan,
2014, 355p.
21 HOPFNER Florent, L’évolution de la notion de réfugiés, Paris, Pedone, 2014, 505p.
22 GATSING Hermine Kembo Takam, Le système africain de protection des droits de l’homme,
Paris, L’Harmattan, 2014, 196p.
23 GERVIER Pauline, La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l'ordre public,
Paris, L.G.D.J., Collection Thèses, 2014
24 GRAU EROS Roberto, Pourquoi j’ai peur des juges. L’interprétation du droit et les principes
juridiques, Paris, 2014 (traduction Antoine Jeammaud, Paris, Ediction Kimé, 198 p.
25 GUEMATCHA Emmanuel, Les commissions vérité et les violations des droits de l’homme et du
droit international humanitaire, Paris, Pedone, 2014, 628p.
26 HENNEBEL Ludovic, TIGROUDJA Hélène, dir., Humanisme et droit. En hommage au
professeur Jean DHOMMEAUX, Paris, Pedone, 2014, 464p.
27 HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, PICHARD Marc, ROMAN Diane (dir.), La loi et le genre.
Etudes critiques de droit français, Paris, 2014, CNRS éditions 797 p.
28 HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, VALENTIN Vincent, L'affaire Baby Loup, Lextenso ed.,
2014
29 IVORY Radha, Corruption, Asset Recovery and the Protection of Property in Public
International Law : The Human Rights of Bad Guys, Cambridge, Cambridge University Press,
Août 2014, 403 p.
30 LANGER Lorenz, Religious Offences in Human Rights : The Implications of Defamations of
Religions, Cambridge, Cambridge University Press, Juillet 2014, 462 p.
31 LEITER Brian, Pourquoi tolérer la religion?, (trad. française L. Mulkens, Ed. Markus Haller),
Genève, 2014, 233 p.
32 ICARD Philippe, Les minorités au sein de l’Union européenne, Paris, Eska, 2014, 147p.
33 MARANLOU Sahar, Access to Justice in Iran : Women, Perceptions, and Reality, Cambridge,
Cambridge University Press, Novembre 2014, 273 p.
34 MARMIN Sébastien, Le nettoyage ethnique: aspects de droit international, Paris, L’Harmattan
, 2014, 505p.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
424
35 MELIN-SOUCRAMAMIEN, Libertés fondamentales, Paris, Dalloz, collection Les mémentos,
p. 232
36 NEIRINCK Claire, BRUGGEMAN Maryline, dir., La convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE), une Convention particulière, Paris, Dalloz, 2014, 278p.
37 NOLAN Aoife, Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis, Cambridge,
Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge University Press, Octobre 2014, 410
p.
38 PREUSS-LAUSSINOTTE Sylvia, La liberté d’expression, Paris, Ellipses, 2014, 162 p.
39 ROMAN Diane (dir.), La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes,
Paris, Pedone, 2014
40 SCHABAS William A., The Universal Declaration of Human Rights : 3 Volume Hardback Set,
The Travaux Préparatoires, Cambridge, Cambridge University Press, Avril 2013, 3376 p.
41 SCHAHMANECHE Aurélia, La motivation des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme, Paris, Pedone, 2014, 794p.
42 DE SCHUTTER Olivier, TULKENS Françoise, VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, Code de
droit international des droits de l'homme, Bruxelles, Larcier, 4ème édition, 2014
43 SUDRE Frédéric, dir., Les conflits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, Bruxelles, Anthemis, 2014, 326p.
44 TAKELE Soboka Bulto, The Extraterritorial Application of the Human Right to Water in Africa,
Cambridge, Cambridge University Press, Décembre 2013, 326 p.
45 TERASSON Antonin, La France et le procès de Nuremberg : inventer le droit international,
Paris, Les Prairies ordinaires, 2014, 399p.
46 THIAKA Thiaw, La protection internationale des droits de l’homme dans les situations de crise
en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2014, 441p.
47 TCHIKAYA Blaise, Le droit de l’Union africaine : Principes, institutions et jurisprudence, Paris,
Berger-Levrault, 2014, 247p.
48 TURGIS Noémie, La justice transitionnelle en droit international, Bruxelles, Bruylant, 2014,
627p.
49 VAN DROOGHENBROECK Sébastien, Le droit international et européen des droits de l'homme
devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014
50
Ouvrages en langues etrangeres
51 Alettaz Fernando, Religión, libertades y Estado. Un estudio a la luz del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, Barcelona, Icaria, 2014.
52 Callewaert Johan, The accession of the European Union to the European Convention on Human
Rights, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2014, 107 p.
Dossiers revues
53 « Histoire, mémoire, justice. De l’Espagne à l’Amérique Latine », Matériaux, n° 111-112,
2013.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
425
54 « Conseil constitutionnel et le droit social », numéro 45 des Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, avec les contributions de Olivier Dutheillet de Lamothe, Jean- Emmanuel
Ray, Laurence Gayr, Alain Lacabarats, Diane Roman
55 « Les droits des citoyens et des citoyennes de l’Union européenne et leur famille », Les
cahiers juridiques du GISTI, 5ème edition, 2014
56 « La prison comme laboratoire des usages sociaux du droit », Droit et société n°87, 2014-2
57 « Les mandats électifs : du cumul à l’exclusivité », LPA, Numéro spécial, n°152, 31 juillet
2014.
58 « Droit au respect de la vie et droits du patient - La question de l'interruption d'un
traitement : la réponse », RFDA, n° 4, juillet-août 2014, p. 657.
59 « Les lanceurs d’alertes en droit public », AJDA, 2014, n° 39, pp. 228-2252
60 « Le business de la migration », Plein Droit, 2014, n°101, 56 p.
61 « Mineurs isolés, l’enfance déniée », Plein Droit, 2014, n°102, 60 p.
62 BAILLEUX Antoine (Dir.), « Dossier : Les droits de l’homme en réseau », Journal Européen
des Droits de l’Homme, n°2014/3, pp. 289 à 354.
63 BREMS Eva et OOMEN Barbara (Dir.), « Dossier : Intégration du droit des droits de
l’homme : approches théoriques d’un droit des droits de l’homme à niveaux multiples
(suite) », Journal Européen des Droits de l’Homme, n°2014/4, pp. 447 à 495.
64 The Age of Human Rights n° 2, juin 2014 http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/
TAHRJ : ( avec les contributions de Rafael DE ASÍS ROIG, “Ethics and Robotics. A First
Approach” ; Sandro STAIAN, “ The Crisis of State Sovereignty and Social Rights” ; Javier
DE LUCAS, “Borders, Violence, Law” Antonio CABANILLAS SÁNCHEZ Y JORGE ZAVALA,
“ Ethics and Legal Keys to Biomedical Research in Spain”, Óscar CELADOR ANGÓN,
“Legal Aspects of the Financing of Religious Groups in Spain”, Matheus DE CARVALHO
HERNANDEZ, “The Rise of Human Rights Issue in the Post-Cold War World: The Vienna
Conference (1993)”; Maria JOSÉ AÑÓN, “The Antidiscrimination Principle and the
Determination of Disadvantage” ; Pedro CARBALLO ARMAS, “Human Rights and Forced
Displacement of the Population (a Note about the Difficulties in the Case of Colombia)”
65
Articles en français
66
67 ABONDO Marlène, BOUVET Renaud et LE GUEUT Mariannick, « Mission et statut du
médecin coordonateur dans l'injonction de soins. Bilan et perspectives quinze ans
après la loi du 17 juin 1998 », Dalloz, AJ Pénal, juin 2014, n° 6, page 275.
68 ALIX Julie, « Le dispositif français de protection des victimes de violences conjugales »,
Dalloz, AJ Pénal, mai 2014, n° 5, page 208.
69 AKANDJI-KOMBE Jean-François (Dir.), « Travail et protection sociale », Journal Européen
des Droits de l’Homme, n°2014/3, pp. 388 à 419.
70 AMALRIC Valérie, « La reconnaissance du vote blanc par la loi du 21 février 2014 : une
avancée limitée », Revue française de droit constitutionnel 3/ 2014 (n° 99), p. 741-759
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
426
71 ANDRIANTSIMBAZOUINA Joel, “La régulation de l’audiovisuel dans la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme”, LPA, n°187-188, 18-19 septembre 2014, p. 4.
72 AUBIN Emmanuel, « Le refus de délivrance d'un visa, le mariage pour tous et la liberté
fondamentale de se marier », AJDA, 2014, p.2141
73 AUBIN Emmanuel, « Roms : être ou ne pas être gens du voyage ? », AJDA, 2014, p.1280
74 ANANE S., « Défense et sécurité nationale (Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) », RSC, N°2, Août, 2014, pp.
409-410
75 AZIRIA Soumia, « La dignité du salarié : un droit à saisir », LPA, n°119, 16 juin2014, p.7
76 BARANGER Denis, « Retour sur Dieudonné », in RFDA, n°3, mai-juin 2014, p. 525.
77 BEAUD Olivier, « Une question négligée dans le droit de la nationalité : la question de la
nationalité dans une Fédération », Jus Politicum, n° 12, 2014.
78 BEAUSSONIE Guillaume, « La nouvelle garde à vue est-elle plus contradictoire ? »,
Gazette du Palais, n° 227 à 233, vendredi 15, jeudi 21 août, pp. 13-15.
79 BENA Sébastien, « Précision sur la portée de la protection accordée à une salariée
enceinte contre une mesure de licenciement », Gazette du Palais, n° 274 à 275, mercredi
1er, jeudi 2 octobre 2014, pp. 5-7.
80 BEN ACHOUR Yadh, “Au service du droit démocratique et du droit constitutionnel
international” in RDP, n°2, 2014, pp. 420-443.
81 BENETTI Julie, “La réforme du cumul des mandats devant le Conseil constitutionnel”,
Constitutions, 2014, n° 1, p. 47
82 BENICHOU Michel, “L’accès à la justice, un droit menacé”, Gazette du Palais, n° 255 à 256,
vendredi 12, samedi 13 septembre 2014, pp. 9-22
83 BERGOIGNAN ESPER Claudine, “GPA et reconnaissance de la filiation, sous l’arrêt CEDH
du 26 juin 2014”, RDSS, n°5, septembre-octobre 2014, p. 887.
84 BERNABE Boris, « Liberté et déontologie universitaires : « l'air pénétrant de la critique
publique » sur « la corruption innocente », AJDA, 2014, p.1904
85 BERNARD Frédéric, «La définition du champ d’application de l’article 5 de la
Convention européenne des droits de l’homme (Cour eur. dr. h., décision Gahramanov
c. Azerbaïdjan, 15 octobre 2013) », RTDH, n° 2014/100, pp. 959 à 976.
86 BESSON Samantha et GRAF-BRUGÈRE Anne-Laurence, « Le droit de vote des expatriés,
le consensus européen et la marge d’appréciation des États (Cour eur. dr. h., arrêt
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce, 15 mars 2012) », RTDH, n° 2014/100, pp. 937 à
958.
87 BIOY Xavier, “Accès aux services de santé et libertés économiques”, Constitutions, 2014,
n° 1, p. 87
88 BLAY-GRABARCZYK Katarzyna, AFROUKH Mustapha, SCHAHMANECHE Aurélia, « Le
contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
Aspects européens : acteurs politiques et acteurs juridictionnels », in RFDA, n° 5,
septembre-octobre 2014, p. 935.
89 BOISSY Laurent, « Les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 :
nouvelles découvertes », AJDA, p.1541
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
427
90 BROYELLE Camille, « Retour sur Dieudonné », in RFDA, n°3, mai-juin 2014, p. 521.
91 BURGORGUE-LARSEN Laurence, « Actualités de la Convention européenne des droits de
l'homme (janvier – juillet 2014) », AJDA, p.1763
92 CALLEWAERT Johan, « Adhérer ou ne pas adhérer : la protection européenne des droits
fondamentaux à la croisée des chemins », Journal Européen des Droits de l’Homme,
n°2014/4, pp. 496 à 513.
93 CANTONI Silvia, « L’apport de la Cour européenne des droits de l’homme à l’élaboration
de la nouvelle Convention contre la violence à l’égard des femmes », RTDH, n° 2014/100,
pp. 865 à 888.
94 CARRILLO Marc, “La réforme de l’amparo en Espagne : un nouveau certiorari ?”,
Constitutions, 2014, n° 1, p. 60.
95 CASSIA Paul, « Arrêt de traitement médical : un bien étranger référé-liberté », AJDA,
2014, p.1225
96 CASTAING Cécile, “Fin de vie : que disent les avis?”, RDSS, n°4, juillet-août 2014, p. 684.
97 CATELAN N., « Lutte contre la délinquance économique (Loi n° 2013-1117 du 6
décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière ; Loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au
procureur de la République financier) », RSC, N°2, Août, 2014, pp.393- 398
98 CAVANIOL Aude, RIHAL Hervé, “le juge du référé liberté et les mineurs isolés
étrangers”, RDSS n°3, mai-juin 2014, p. 531.
99 CERF-HOLLENDER A., « Travail dissimulé et détachement de salariés : ne pas confondre
salarié détaché et salarié dissimulé !(Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, D. 2014. 671) »,
RSC, N°2, Août, 2014, pp.355-360
100 CLOAREC Charlotte, « Le SPIP : seul maître d'oeuvre de l'exécution des peines ? »,
Dalloz, AJ Pénal, juin 2014, n° 6, page 268.
101 CHABROT Christophe, “Démocratie, droits de l’homme et droit local”, Politeia, n°25, juin
2014, p. 327
102 COURNIL Christel et al., « Environnement et droits de l’homme », Journal Européen des
Droits de l’Homme, n°2014/4, pp. 535 à 566.
103 COUTURIER Mathias, “La contrainte et le consentement dans les soins ordonnés par
l’autorité publique : vers une aporie juridique?”, RDSS n°1, janvier-février 2014, p. 120.
104 COQ Véronique, “L’article premier de la charte de l’environnement : portée, contrôle (à
propos de l’arrêt du Conseil d’état du 26 février 2014)”, LPA, n°203, 10 octobre 2014, p.
10.
105 CREPEY Edouard, « Office de la CNDA pour déterminer la nationalité d'un demandeur
d'asile », AJDA, 2014, p.1611
106 CUISOL Danièle, “Dernier état des débats sur la temporalité et les règles de fond du
dispositif anti-perruche”, RDSS n°3, mai-juin 2014, p. 542.
107 DAMON Julien, “La lutte contre la mendicité des enfants”, RDSS, n°3, mai-juin 2014, p.
553.
108 DANET J., « Le mineur « auditionné » sans notification de ses droits et le « faisceau
d'indices de la conscience qu'il avait de ses droits » ou du mauvais usage du « complexe
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
428
du homard » en procédure pénale (Crim., 6 novembre 2013, n° 13-84.320, à paraître au
bulletin, D. 2013. 2646) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.138-138
109 DANIS-FATÔME Anne, « Le droit des couples à un “engagement“ », RTDH, n° 2014/99,
pp. 737 à 758.
110 DANLOS Benjamin, « De quelques contre-vérités sur la jurisprudence de la CEDH en
matière pénale », Dalloz, AJ Pénal, septembre 2014, n° 9, page 404.
111 DAOUD Emmanuel et GHRÉNASSIA César, « Santé publique et défense pénale », Dalloz,
AJ Pénal, septembre 2014, n° 9, page 398.
112 DAOUD Emmanuel et BOUCHE Bluette, « L'intérêt social, vecteur de la décision de prise
en charge des frais de défense pénale du dirigeant ou du salarié », Dalloz, AJ Pénal,
juillet-août, 2014, n° 7-8, page 348.
113 DE BELLESCIZE Diane, “L’offense au chef de l’Etat : suite et fin ?”, Constitutions, 2014, n°
1, p. 83
114 DE BELLESCIZE Diane, “Loi de 1881 et harmonisation des délais de prescription”,
Constitutions, 2014, n° 2, p. 229.
115 DE CLIPPELE Marie-Sophie, « Quand l’équilibre devient art - Le Conseil de l’Europe et la
balance des intérêts des propriétaires et de la collectivité en matière de patrimoine
culturel », RTDH, n° 2014/100, pp. 913 à 936.
116 DE COMBLES DE NAYVES Pierre, Crim. 15 janvier 2014, « Droit international et obstacle
aux poursuites », Dalloz, AJ Pénal, mai 2014, n° 5, page 243.
117 DE CONINCK G., « Sandra Lehalle, La prison sous l'oeil de la société ? Contrôle du
respect de l'état de droit en détention en France et au Canada, Paris, L'Harmattan, 2013,
369 pages », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.261-263
118 DE GOUTTES Régis, « La réforme du fonctionnement des organes des traités des droits
de l’homme des Nations Unies : l’approche du Comité des Nations Unies pour
l’élimination de la discrimination raciale (CERD) », RTDH, n° 2014/100, pp. 835 à 844.
119 DEHARBE David, « Contentieux de la réglementation à l'exposition à l'amiante : la «
gestion » juridictionnelle du risque sanitaire », AJDA, 2014, p.1566
120 DELGRANGE Xavier et EL BERHOUMI Mathias, « Pour vivre ensemble, vivons dévisagés
: le voile intégral sous le regard des juges constitutionnels belge et français », RTDH, n°
2014/99, pp. 639 à 666.
121 DELVOLVE Pierre, « Entreprise privée, laïcité, liberté religieuse. L'affaire Baby-Loup.
Note sous Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 juin 2014, n° 13-28.369 », in RFDA,
n° 5, septembre-octobre 2014, p. 954.
122 DERCLERCQ Jean Baptiste, “Le pouvoir du législateur de l’Union européenne en matière
de protection des données à caractère personnel : une compétence fixée (à propos de
l’arrêt CJUE du 8 avril 2014), LPA, n0197, 2 octobre 2014, p. 16.
123 DE RUE Maïté, « Les peines de perpétuité réelle sont contraires à la dignité humaine : la
Cour européenne des droits de l’homme consacre un droit à l’espoir pour tous les
condamnés », RTDH, n° 2014/99, pp. 667 à 688.
124 DIEU Frédéric, “Le Conseil d’Etat, gardien des valeurs essentielles de la société
française”, Constitutions, 2014, n° 2, p. 175
125 DOMINO Xavier, « La France peut exiger des Syriens un visa de transit aéroportuaire »,
AJDA, 2014, p.1714
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
429
126 DOMINO Xavier, « Un motif exceptionnel peut obliger la CNDA à reporter une audience
», AJDA, 2014, p.1615
127 DOMINO Xavier, « Droit d'être entendu et OQTF ; un exemple de dialogues entre les
jurisprudence », AJDA, 2014, p.1501
128 DOMINO Xavier, « Droit au recours et équité du procès devant la justice administrative
aujourd'hui », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 3/ 2014 (N° 44), p. 35-47
129 DOUVRELEUR Agnès, « La mise en place d'une politique pénale régionale de lutte
contre les violences familiales : l'exemple de la région parisienne », Dalloz, AJ Pénal, mai
2014, n° 5, page 212.
130 DUBOUT Edouard, “Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne”, RTDEur, n°2, 8/2014, p. 409
131 DUBUISSON François (Dir.), « Société de l’information, médias et liberté d’expression »,
Journal Européen des Droits de l’Homme, n°2014/3, pp. 355 à 387.
132 DUFOUR Anne-Claire, « L'expulsion d'urgence des habitants d'un bidonville installés
sur le domaine public », AJDA, 2014, p.2103
133 DUMOULIN L., « Lutte contre la traite des êtres humains : l'approche financière en
question », RSC, N°2, Août, 2014, pp.311-330
134 FABRE-MAGNAN Muriel, “Le statut du principe de dignité” in Droits, n°58, 2014, pp.
167-196.
135 FORTAS A.-C., « La Cour de cassation et les conventions internationales relatives à la
lutte contre la corruption », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.25-48
136 FRAISSE Régis, « L'article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés », Les
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 3/ 2014 (N° 44), p. 9-21.
137 FRANCILLON J., « Liberté de communication. Pouvoir de sanction des autorités
administratives indépendantes », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.122-124
138 FRANCILLON J., « Liberté d'expression et atteinte à la dignité humaine. Pénalisation de
la négation du génocide des arméniens », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.125-137
139 FRANCIS WANDJI K Jérôme, « La Déclaration française des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 et l'État en Afrique », Revue française de droit constitutionnel 3/
2014 (n° 99), p. e1-e28
140 FULCHIRON Hugues, « La lutte contre le tourisme procréatif: vers un instrument de
coopération internationale?», JDI, 2014, n°2, pp.563-588.
141 GAY Laurence, « Droit de grève et liberté syndicale dans la jurisprudence
constitutionnelle : des libertés « particulières » ? », Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel 4/ 2014 (N° 45), p. 35-49.
142 GERVIER Pauline, « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l'ordre
public », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 4/ 2014 (N° 45), p. 105-112
143 GERVIER Pauline, « L'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public »,
AJDA, 2014, p.1866
144 GIACOPELLI Muriel, « La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines en
renforçant l'efficacité des sanctions pénales : un rendez-vous manqué », Dalloz, AJ
Pénal, octobre 2014, n° 10, page 448.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
430
145 GIUDICELLI A., « La réparation présentée comme intégrale ne suffit pas nécessairement
à constituer une « satisfaction équitable » », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.139-162
146 GONZALEZ Gérard, « L’autonomie ecclésiale au risque relatif des droits de l’homme »,
RTDH, n° 2014/100, pp. 803 à 818.
147 GOSEWINKEL Dieter, « Naturaliser ou exclure ? La nationalité en France et en
Allemagne aux XIXe et XX e siècles. Une comparaison historique », Jus Politicum, n° 12,
2014
148 GOURDOU Jean, « Sanctions disciplinaires : les questions de la légalité des infractions et
de l'opportunité des poursuites. Note sous Conseil d'État, Assemblée, 6 juin 2014,
Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) et autre, n° 351582 », in
RFDA, n° 4, juillet-août 2014, p. 764.
149 GUYOMAR Mattias “Chronique de jurisprudence du Conseil d’Etat : contentieux
administratif et Convention européenne des droits de l’homme”, Gazette du Palais, n°
267 à 268, mercredi 24, jeudi 25 septembre 2014, pp. 19-23
150 HENNION-JACQUET Patricia, “Les gardes à vue dérogatoires, dix ans après la loi du 9
mars 2004 : entre conservatisme national et tourmente réformatrice européenne”,
Gazette du Palais, n° 227 à 233, vendredi 15, jeudi 21 août, pp. 23-26
151 HENNION-JACQUET Patricia, “La consécration légale du statut du suspect libre”, Gazette
du Palais, n° 208 à 210, dimanche 27, mardi 29 juillet 2014, pp. 9-12
152 HERVIEU Nicolas et SLAMA Serge, « Lacunes et infortunes de l'Etat de droit(s) à
Mayotte », AJDA, 2014, p.1849
153 HERZOG-EVANS Martine, Cass. 25 juin 2014, n° 14-81.793, « Périodes de sûreté : retour à
la raison », Dalloz, AJ Pénal, septembre 2014, n° 9, page 436.
154 HERZOG-EVANS Martine, Reims, 8 avril 2014, n° 14/00068, « Une libération
conditionnelle rejetée pour cause d'exécution dans « un secteur socialement défavorisé
» », Dalloz, AJ Pénal, septembre 2014, n° 9, page 438.
155 HERZOG-EVANS Martine, « Violence dite « domestique » : une responsabilité sociétale
et peu de perspectives de traitement », Dalloz, AJ Pénal, mai 2014, n° 5, page 217.
156 JACQUE Jean-Paul, « Protection des données personnelles, Internet et conflits entre
droits fondamentaux devant la CJUE », RTDEur, n°2, 8/2014, p. 283
157 JEAN-BAPTISTE Walter, « “L’ex-épouse devint, un jour, belle-maman et acquit le droit
de le rester“ », RTDH, n° 2014/99, pp. 759 et s.
158 KELLER Rémi, « Sanctions disciplinaires : les questions de la légalité des infractions et
de l'opportunité des poursuites, Conclusion sur Conseil d'État, Assemblée, 6 juin 2014,
Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) et autre, n° 351582 », in
RFDA, n° 4, juillet-août 2014, p. 753.
159 KIMMEL ALCOVER Anne, “Restauration scolaire et laïcité : quand la religion de l’élève
s’invite à la table de la cantine”, RDSS, n°1, janvier-février 2014, p. 146
160 KNECHTLE John C., “La Cour suprême des États-Unis et la non-discrimination. D’hier à
aujourd’hui”, Politeia, n°25, juin 2014, p. 431
161 KOUDÉ Roger Koussetogue, « La liberté de religion et les garanties de protection dans le
système africain des droits de l’homme et des peuples », RTDH, n° 2014/100, pp. 819 à
834.
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
431
162 LABAYLE Henri, SUDRE Frédéric, DUPRE DE BOULOIS Xavier, MILANO Laure, « Droit
administratif et Convention européenne des droits de l'homme », in RFDA, n°3, mai-juin
2014, p. 538.
163 LACABARATS Alain, « L'influence de la question prioritaire de constitutionnalité sur le
droit social », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 4/ 2014 (N° 45), p. 51-61
164 LAHMER Marc, « Le Moment 1789 et la séparation des pouvoirs », in Jus Politicum,
revue de droit politique (juin 2014), n° 12 : http://www.juspoliticum.com/Le-
Moment-1789-et-la-separation.html
165 LAMARCHE Thierry, MOUTON Stéphane, “Principe de laïcité : affaire Baby Loup : levons
le voile sur une entreprise de conviction peu convaincante, pour mieux observer le
principe de laïcité”, Constitutions, 2014, n° 2, p. 211
166 LAMARCHE Thierry, MOUTON Stéphane, « Affaire Baby Loup ; suite et fin ? », AJDA,2014,
p.1842
167 LAMBERT ABDELGAWAD Elisabeth, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme par le Comité des ministres (2013) : bilan et perspectives d’avenir »,
RTDH, n° 2014/99, pp. 595 à 610.
168 LASSALLE Stéphanie, « La réforme pénale peut-elle se passer d'une complémentarité
entre le secteur public et le secteur associatif socio-judiciaire ? », Dalloz, AJ Pénal, juin
2014, n° 6, page 272.
169 LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Cass. 25 février 2014, n° 13-80.914, « Retour de
l'appréciation stricte de l'exception au secret des sources des journalistes », Dalloz, AJ
Pénal, septembre 2014, n° 9, page 432.
170 LATASTE Stéphane, “Le lanceur d’alerte en entreprise après les lois des 16 avril et 6
décembre 2013: mouchard ou vigie ?”, Gazette du Palais, n° 206 à 207, vendredi 25,
samedi 26 juillet 2014, pp. 5-6
171 LAUVERGNAT Ludovic, “Loi ALUR : l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle
rédaction est-il applicable aux contrats en cours ?”, Gazette du Palais, n° 190 à 191,
mercredi 9, jeudi 10 juillet 2014, pp. 5-6
172 LE BOT Olivier, « Le juge des référés au secours d'un agent victime de harcèlement
moral », AJDA, 2014, p.2079
173 LE BOT Olivier, « Référé-liberté et prise en charge d'un mineur étranger isolé », AJDA,
2014, p.1284
174 LEMAIRE Elina, « Baby Loup au Parlement : un autre aspect de l' « affaire », AJDA, 2014,
p.1457
175 LHERNOULT Jean Pierre, “Du régme des aides financières et des conditions matérielles
d’accueil des demandeurs d’asile”, RDSS, mai-juin 2014, n°3, p. 471.
176 MANIATIS A., « Organisations des crimes culturels et environnementaux », RSC, N°1,
Juin, 2014, pp.249-252
177 MARGUÉNAUD Jean-Pierre, « L’éloignement des étrangers malades du sida : la Cour
européenne des droits de l’homme sur “les sentiers de la gloire“ (Cour. eur. dr. h., arrêt
S.J. c. Belgique, 27 février 2014) », RTDH, n° 2014/100, pp. 977 à 958.
178 MARGUÉNAUD J.-P., « L'obligation positive de protéger les enfants, scolarisés dans des
écoles sous administration religieuse, contre les abus sexuels (CEDH, 28 janvier 2014, n°
35810/09, O'Keeffe c/ Irlande, D. 2014. 372, et les obs.) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.166-168
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
432
179 MARGUÉNAUD J.-P., « L'incrimination hasardeuse de la négation du génocide arménien
(CEDH, 2e section, 17 décembre 2013, n° 27510/08, Perinçek c/ Suisse, AJDA 2014. 147,
chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2014. 144, obs. G. Poissonnier) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.
179-184
180 MARKUS Jean Pierre, “Le conseil de l’Europe et l’effetivité d’égalité d’accès au soin”,
RDSS n°1, janvier-février 2014, p. 63.
181 MARTIN-CHENUT K., « Droit international des droits de l'homme et droit pénal :
obligation de poursuivre des actes de torture et exclusion de la preuve obtenue sous
contrainte dans la jurisprudence interaméricaine », RSC, N°2, Août, 2014, pp.411-422
182 MASSE M., « Actualité juridique de l'esclavage (Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit
de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France) », RSC, N°1,
Juin, 2014, pp.185-206
183 MASTOR Wanda, « Les juges et la culpabilité collective », in Mélanges en l’honneur de
Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, pp. 375-39.
184 MATTATIA F., « L'usurpation d'identité sur internet dans tous ses états », RSC, N°2,
Août, 2014, pp.331-338
185 MATH Antoine, « Le RSA et les étrangers : origine et fortune de la condition
d’antériorité de résidence », RDSS n°3, mai-juin 2014, p. 564.
186 MAUBERNARD Christophe et SURREL Hélène, « Les juridictions de l’Union européenne
et les droits fondamentaux – Chronique de jurisprudence (2013) », RTDH, n° 2014/99,
pp. 611 à 638.
187 MAYAUD Y., « Pour une juste lecture de la qualification de harcèlement moral (Crim.,
14 janvier 2014, n° 11-81.362, publié au Bulletin) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.66-105
188 MBONGO Pascal, « Procès équitable et Due Process of Law », Les Nouveaux Cahiers du
Conseil constitutionnel 3/ 2014 (N° 44), p. 49-59
189 MEGRET Frédéric et SCALIA Damien, « Droit pénal et pénitentiaire », Journal Européen
des Droits de l’Homme, n°2014/4, pp. 514 à 534.
190 MESA Rodolphe, “Le renforcement relatif des droits procéduraux du suspect pendant la
phase d’enquête”, Gazette du Palais, n° 262 à 263, vendredi 29, samedi 20 septembre 2014,
pp. 17-21
191 MICHALSKI Cédric, “La défense censitaire du suspect libre”, Gazette du Palais, n° 227 à
233, vendredi 15, jeudi 21 août, pp. 16-18
192 MONTERO E., « Les orientations de la politique criminelle actuelle en matière
d'atteintes à l'environnement », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.49-65
193 MOREGER Françoise, GPA, congé de maternité et Handicap (à propos de l’arrêt de la
CJUE du 18 mars 2014), RDSS, n°3, mai- juin 2014, p. 478.
194 MOUCHETTE Julien, « L'« autonomie budgétaire » du Défenseur des droits :
complément ou obstacle à son indépendance ? », Revue française de droit constitutionnel
3/ 2014 (n° 99), p. 557-580.
195 MUCCHIELI L., « Les comparutions immédiates au TGI de Nice, ou la prison comme
unique réponse à une délinquance de misère », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.207-248
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
433
196 NASCIMBENE Bruno, «Le droit de la nationalité et le droit des organisations
d’intégration régionales. Vers de nouveaux statuts de résidents?», RCADI 2014, vol.367,
pp.253-414.
197 NICOLAS M., « La victime dans le procès pénal après la Directive 2012/29/EU du 25
octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la
protection des victimes de la criminalité. Comparaison des systèmes français, espagnol
et italien. Colloque du 27 mars 2014 sous l'égide de l'Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne », RSC, N°2, Août, 2014, pp.459-462
198 NORMANDEAU A., « Jean-Claude Bernheim, L'escadron de la mort au Québec, Montréal,
Les Éditions Accent Grave, 2014, 241 pages », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.264-265
199 PASTORAL Jean-Paul, « Intégration des contractuels dans la fonction publique et égal
accès aux emplois publics », AJDA, 2014, p.1953
200 PATAUT Etienne, “Chronique de citoyenneté de l’Union européenne”, RTDEur, n°3,
11/2014, p. 781
201 PECHILLON Eric, TA Rennes 23 avril 2014, « Confidentialité des communications
téléphoniques en détention : le juge enjoint à l'administration de faire des travaux »,
Dalloz, AJ Pénal, juin 2014, n° 6, page 311.
202 PELTIER Marc, “le droit à un procès équitable au secour de l’assuré social”, RDSS, n°2,
mars-avril 2014, p. 326.
203 PERRAY Romain, « Données personnelles : l'éducation nationale et l'enseignement
supérieur commencent à retenir la leçon », AJDA, 2014, p.2197
204 POISSONNIER Ghislain, « Condamnation de deux anciens hauts dirigeants Khmers
rouges pour crimes contre l'humanité », Dalloz, AJ Pénal, octobre 2014, n° 10, page 474.
205 POISSONNIER Ghislain, CPI, 7 mars 2014, « Cour pénale internationale : condamnation
de Germain Katanga à 12 ans d'emprisonnement pour complicité de crimes de guerre et
d'un crime contre l'humanité. », Dalloz, AJ Pénal, juillet-août, 2014, n° 7-8, page 357.
206 POLLET-PANOUSSIS Delphine, « Précisions sur le régime des décisions de transfert et de
refus de transfert des détenus. Note sous Conseil d'État, 13 novembre 2013, M.
Agamemnon, n° 338720, Lebon ; AJDA 2013. 2287 et M. Puci et Garde des Sceaux, ministre de
la justice, n° 355742, Lebon », in RFDA, n° 5, septembre-octobre 2014, p. 965.
207 POURZAND P., « Nature de l'élément moral et stratégie judiciaire de la Cour pénale
international », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.1-24
208 PREVEL Philippe, « La Charte de l'environnement, l'administration et le Conseil d'État :
applicabilité ou invocabilité de la Charte ? », in RFDA, n° 4, juillet-août 2014, p. 773.
209 RACINE Jean-Baptiste, Remarques sur la distinction entre les droits et les liberté,LPA,
n°190, 23 septembre 2014, p. 7.
210 RAMBAUD Romain, « La loi du 10 janvier 1936 à la croisée des chemins », AJDA, 2014, p.
2167
211 RAMBIER Marion, “Insémination post-mortem : de la mise à mal à la mise à mort de
l’autonomie de la volonté du donneur”, LPA, n0206, 15 octobre 2014, p. 6.
212 RICHARD Jacky, DE SAINT-PULGENT Maryvonne, « Numérique : les rapports de droit
sont des rapports de force », AJDA, 2014, p.1625
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
434
213 ROBET J.-H., « Preuve et éléments constitutifs du délit de pollution de la mer par
hydrocarbures (Crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, D. 2014. 781 ; Crim., 13 mai 2014, n°
13-83.910, D. 2014. 1153 », RSC, N°2, Août, 2014, pp.349-350
214 ROBERT Anne-Gaëlle, “Les conditions de détention s’invitent au débat sur la détention
provisoire”, Gazette du Palais, n° 194 à 198, dimanche 13, jeudi 17 juillet 2014, pp. 7-9
215 ROETS D., « De la prohibition des opérations policières inutilement « musclées » (CEDH,
4e section, 15 octobre 2013, n° 34529/10, Gutsanovi c/ Bulgarie) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.
163-165
216 ROETS D., « Quel « aussitôt » pour l'habeas corpus européen ? (CEDH, 4 e section, 15
octobre 2013, n° 34529/10, Gutsanovi c/ Bulgarie) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.169-171
217 ROETS D., « L'article 410 du Code de procédure pénale dans le champ d'attraction de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH, 5 e section, 25
juillet 2013, n° 46460/10, Henri Rivière et autres c/ France) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.
172-173
218 ROETS D., « Double extension du champ d'application de l'article 7 § 1 : la Cour
européenne des droits de l'Homme, en Grande Chambre, persiste et signe (CEDH, 21
octobre 2013, n° 42750/09, Del Rio Prada c/ Espagne, D. 2013. 2775, obs. J. Falxa) », RSC,
N°1, Juin, 2014, pp.174-178
219 ROMAN Diane, « La jurisprudence sociale des Cours constitutionnelles en Europe : vers
une jurisprudence de crise ? », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 4/ 2014 (N°
45), p. 63-75
220 ROSENBERG Dominique, « Vers un droit des peuples à la sécurité alimentaire », RTDH,
n° 2014/100, pp. 845 à 864.
221 ROUX Jérôme, “La liberté de conscience emmurée dans le for intérieur”, Constitutions,
2014, n° 2, p. 196.
222 ROUSSEAU Dominique, “Chronique de jurisprudence de question prioritaire de
constitutionnalité”, Gazette du Palais, n° 192 à 193, vendredi 11, samedi 12 juillet 2014,
pp. 11-22
223 SAMSON-DYE Aline, « La circulaire du 28 novembre 2012 ne fixe pas de lignes
directrices », AJDA, 2014, p.2112
224 SAMSON-DYE Aline, « Refus de titre de séjour à un étranger malade après avis favorable
du médecin de l'ARS, AJDA, 2014, p.1544.
225 SAYOUS Benjamin et CARIO Robert, « La justice restaurative dans la réforme pénale : de
nouveaux droits pour les victimes et les auteurs d'infractions pénales », Dalloz, AJ Pénal,
octobre 2014, n° 10, page 461.
226 SCALIA Damien, « L’application du principe de légalité des peines aux crimes (les plus)
graves : l’orthodoxie retrouvée », RTDH, n° 2014/99, pp. 689 à 716.
227 SCHMITZ Julia, « Le juge du référé-liberté à la croisée des contentieux de l'urgence et
du fond », in RFDA, n°3, mai-juin 2014, p. 502.
228
229 SCHMITZ Julia, « Le principe du contradictoire à la lumière du droit de l’Union
européenne : illustration en matière d’éloignement des étrangers », in Revue Droit
Administratif, n° 8-9, Août 2014, étude 14
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
435
230 SEILLER Bertrand, BROYELLE Camille, BARANGER Denis, « L’affaire Dieudonné et les
libertés », in Jus Politicum, revue de droit politique (juin 2014), n° 12 : http://
www.juspoliticum.com/L-affaire-Dieudonne-et-les.html
231 SENNA Eric, « L'application des droits fondamentaux en captivité : la recherche d'un
nouvel équilibre entre évaluation et résolution des atteintes », Dalloz, AJ Pénal,
septembre 2014, n° 9, page 408.
232 SIMON Anne, “Convention européenne et droits de l’homme et dispositions
transitoires”, RTDEur, n°3, 11/2014, p. 581
233 SLAMA Serge, « L'invocabilité des lignes directrices dans les procédures de
régularisation de sans-papiers », AJDA, 2014, p.1773
234 SOMA Abdoulaye, “Le peuple comme contre-pouvoir en Afrique” in RDP, n°4, 2014, pp.
1019-1049.
235 SPINOSI Patrice, « Quel regard sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le
procès équitable ? », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 3/ 2014 (N° 44), p.
23-34
236 STASIAK F., « Une conception du juge pénal français difficilement conciliable avec elle
de la Cour européenne des droits de l'homme (1/2) (Crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579,
D. 2014. 274 ; ibid. 600, entretien N. Rontchevsky ; JCP 2014, n° 5, 131 ; D. act., 6 févr.
2014, obs. S. Fucini) », RSC, N°1, Juin, 2014, pp.106-109
237 STASIAK F., « Une conception du juge pénal français difficilement conciliable avec elle
de la Cour européenne des droits de l'homme (2/2) (CEDH, 2 e sect. , 4 mars 2014, n°
18640/10, 18647/10, 18662/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et autres c/ Italie) »,
RSC, N°1, Juin, 2014, pp.110-121
238 STROWEL Alain, « Pondération entre liberté d’expression et droit d’auteur sur internet
: de la réserve des juges de Strasbourg à une concordance pratique par les juges de
Luxembourg », RTDH, n° 2014/100, pp. 889 à 912.
239 SUREAU François, « Égypte : une Constitution entre deux mondes ? », Pouvoirs n°149,
2014-2.
240 SZYMCZAK David, « Le préjudice important… Un critère inquiétant ? - Retour sur les
premières années d’application de la nouvelle condition de recevabilité par la Cour de
Strasbourg », RTDH, n° 2014/99, pp. 555 à 570.
241 TAILLEFAIT Antoine, « Militaires : restez groupés ! », AJDA, 2014, p.1969
242 TAVERNIER Julie, « L’application du principe de légalité des peines aux crimes (les plus)
graves : l’orthodoxie retrouvée », RTDH, n° 2014/99, pp. 717 à 736.
243 THARAUD Delphine, « Une convention collective réservant des avantages aux s euls
salariés mariés constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle »,
LPA, n°201, 8 octobre 2014, p. 4.
244 THOUVENIN Dominique, « L’arrêt de traitement mettant fin à a vie d’un patient hors
d’état de s’exprimer (à propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 2014 Mme
Lambert et autres », RDSS, n°3, mai- juin 2014, p. 506.
245 THOUVENIN Dominique, « La recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires - interdiction avec dérogation ou autorisation ou condition », RDSS, n°2,
mars-avril 2014, p. 283.
246 TRUCHET Didier, « L'affaire Lambert », AJDA, 2014, p.1669
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
436
247 TURGES Sandrine, « Le guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet » du
comité des ministres du conseil de l’Europe : vademecum du droit européen d’internet”,
n°172-173, 28-29 août 2014, p14.
248 VIGANOTTI Elisa, « Les enfants issus de mères porteuses étrangères ne doivent pas être
privés d’état civil français : les arrêts Mennesson et Labassee de la CEDH », Gazette du
Palais, n° 204 à 205, mercredi 23, jeudi 24 juillet 2014, pp. 12-14
Articles en langues étrangères
249 AMBORT Matilde Laura, “Asignacion universal por hijo para la proteccion social:
alcances y limitaciones en la garantia de derechos sociales” in Revista Latinoamericana de
Derechos Humanos, n°2, 2014, pp. 169-191.
250 BARRANTES MONTERO Luis, “Pensamiento critico y derechos humanos: Componentes
esenciales en la educacion superior del siglo XXI” in Revista Latinoamericana de Derechos
Humanos, n°2, 2014, pp. 93-105.
251 DE BUSSER Els, « European initiatives concerning the use of it in criminal procedure
and data protection » in Jacques Buisson (Dir.), ERES, Revue internationale de droit pénal,
Vol. 85, 2014/1-2, page 213.
252 GAJA Giorgio, « The Protection of General Interests in the International Community»,
RCADI 2014, vol.364, pp.9-185
253 GIL RUIZ Juana María, “Introducción de la perspectiva de género en las titulaciones
jurídicas: hacia una formación reglada”, Revista de Educación y Derecho, 2014, n° 10.
254 Gil Ruiz Juana María, “Introducción de la perspectiva de género en las titulaciones
jurídicas: hacia una formación reglada”, Revista de Educación y Derecho, 2014, n° 10
255 HERRERA Juan Carlos, Guerrero Prado Yazmin, Sánchez Rosas Lourdes, “Teoría Queer en
la enseñanza del Derecho”, Revista de Educación y Derecho, 2014, n° 10.
256 ISA Felipe Gomez, « Cultural Diversity, Legal pluralism, and Human Rights from an
Indigenous Perspective: The Approach by the Columbian Constitutionnal Court and the
Inter-American Court», Human Rights Quarterly, 2014, vol.36, n°4, pp.691-721.
257 KERI Ellis, FERIS Loretta, « The Right to Sanitation: Time to Delink the Right to the
Water», Human Rights Quarterly, 2014, vol.36, n°3, pp.607-629.
258 OCHOA JIMENEZ Maria Julia, “La proteccion de los derechos humanos en Venezuela
frente a la denuncia de la Convencion Americana sobre Derechops Humanos” in Revista
Latinoamericana de Derechos Humanos, n°1, 2014, pp. 195-211.
259 RIOFRIO Juan Carlos “La cuarta ola de derechos humanos: les derechos digitales” in
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, n°1, 2014, pp. 15-45.
260 RUYS Tom, « The Meaning of “force” and the boundaries of the Jus ad Bellum: Are
“Minimal” Uses of Force Excluded from UN Charter Article 2(4)? », AJIL, 2014, vol.108,
n°2, pp.159-210.
261 SIMONATO Michele, YP Special Report, « Defence rights and the use of information
technology in criminal procédure », in Jacques Buisson (Dir.), ERES, Revue internationale
de droit pénal, Vol. 85, 2014/1-2, page 261.
262 ZIMMERMANN Andreas, SENER Meltem, « Chemical Weapons and the International
Criminal Court», AJIL, 2014, vol.108, n°3, pp.436-448;
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
437
Actes de colloques
263 Actes du colloque du 6 février 2014, “Grand handicap et actualités du dommage
corporel”, Gazette du Palais, n° 215 à 219, dimanche 3, jeudi 7 août 2014
264 Actes du colloque du 10 juin 2014, “Victime et handicap”, Gazette du Palais, n° 285-287,
dimanche 12, mardi 14 octobre 2014
Rapports institutionnels, institutions, ONG
265 Défenseur des droits: Rapport annuel d’activité 2013, Bibliothèque des rapports publics,
Paris, -La Documentation française.fr
266 Conseil d’Etat, Le numérique et les droits fondamentaux, Paris, La Documentation
Française, Septembre 2014
Conseil de l’Europe
267 Right to Remember - A Handbook for Education with Young People on the Roma
Genocide, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2014
268 Signposts - Policy and practice for teaching about religions and non-religious world
views in intercultural education, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2014, 128 p.
269
Autres
270 ATD-Quartmonde : « Discrimination et pauvreté », publié en octobre 2013: http://
www.atd-quartmonde.fr/livreblanc/
La Revue des droits de l’homme, 6 | 2014
Vous aimerez peut-être aussi
- Géopolitique Et Géoéconomie Du Monde Contemporain 2021Document534 pagesGéopolitique Et Géoéconomie Du Monde Contemporain 2021Abdelhamid Karraky100% (10)
- La GéopolitiqueDocument67 pagesLa GéopolitiqueBoris EyebePas encore d'évaluation
- Dissert Finale DroitDocument10 pagesDissert Finale DroitZoPas encore d'évaluation
- aux-origines-de-la-question-prioritaire-de-constitutionnaliteDocument6 pagesaux-origines-de-la-question-prioritaire-de-constitutionnaliteh.daghmi28Pas encore d'évaluation
- Les Caractéristiques Des Démocraties 4Document4 pagesLes Caractéristiques Des Démocraties 4linaaktaou037Pas encore d'évaluation
- Fiche 1 et 2 La règle de droit (1)Document19 pagesFiche 1 et 2 La règle de droit (1)costabr2006Pas encore d'évaluation
- Etat de Droit - 000Document6 pagesEtat de Droit - 000snhcdtanaPas encore d'évaluation
- Démocratie Et Débat Public, Versus Système Représentatif Et Expression PopulaireDocument11 pagesDémocratie Et Débat Public, Versus Système Représentatif Et Expression PopulairesignoPas encore d'évaluation
- Fiches TD 2024-4Document14 pagesFiches TD 2024-4aureguillermePas encore d'évaluation
- La Protection Judiciaire de La Liberte de Manifestation en Republique Democratique Du CongoDocument13 pagesLa Protection Judiciaire de La Liberte de Manifestation en Republique Democratique Du CongoOmega TabasengePas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel Chambon 07 L1CDocument20 pagesDroit Constitutionnel Chambon 07 L1Cste evenPas encore d'évaluation
- TD RéférendumDocument4 pagesTD RéférendumHéloïsePas encore d'évaluation
- Le Droit À La Justice Au CamerounDocument90 pagesLe Droit À La Justice Au CamerounNDF93 OfficialPas encore d'évaluation
- 3 - La Démocratie Et Le CitoyenDocument9 pages3 - La Démocratie Et Le CitoyenOualid AnarghiPas encore d'évaluation
- DANS QUELS CAS LA CONSTITUTION PREVOIT-ELLE DES REFERENDUMS ? Michel de VilliersDocument3 pagesDANS QUELS CAS LA CONSTITUTION PREVOIT-ELLE DES REFERENDUMS ? Michel de VilliersHélénaPas encore d'évaluation
- Droits de L'hommeDocument17 pagesDroits de L'hommeAbba DiallPas encore d'évaluation
- Thème 5 - Pouvoir Juridictionnel Et Justice ConstitutionnelleDocument15 pagesThème 5 - Pouvoir Juridictionnel Et Justice ConstitutionnelleMomo BenhamPas encore d'évaluation
- Pierre Avril & Jean Gicquel - Lexique de Droit ConstitutionnelDocument136 pagesPierre Avril & Jean Gicquel - Lexique de Droit ConstitutionnelJuju Studio SarahPas encore d'évaluation
- Fiche 5 - Conseil ConstitutionnelDocument17 pagesFiche 5 - Conseil Constitutionnellouhane77Pas encore d'évaluation
- Thème 3 - La Présidentialisation de La Ve RépubliqueDocument8 pagesThème 3 - La Présidentialisation de La Ve RépubliqueMomo BenhamPas encore d'évaluation
- Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge nationalD'EverandLe droit international et européen des droits de l'homme devant le juge nationalPas encore d'évaluation
- Quest Ce Que La ConstitutionDocument5 pagesQuest Ce Que La ConstitutionVirginie DiaconoPas encore d'évaluation
- CoursDocument6 pagesCoursflora.htz68Pas encore d'évaluation
- Cours de Libertés PubliquesDocument17 pagesCours de Libertés PubliquesMariko Dasse100% (1)
- Droit - Des - Manif Henoc Kondjo 2023Document18 pagesDroit - Des - Manif Henoc Kondjo 2023Yamba Djene Pecari NoblePas encore d'évaluation
- Analyse Critique de La Loi Portant Institution de La Commission Nationale Des Droits de LDocument22 pagesAnalyse Critique de La Loi Portant Institution de La Commission Nationale Des Droits de LSteve KanyaPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel EconomiqueDocument21 pagesDroit Constitutionnel EconomiqueharrisrabemananjaraPas encore d'évaluation
- Plaquette_6 (1)Document21 pagesPlaquette_6 (1)fatiaiririPas encore d'évaluation
- Droits HumainsDocument6 pagesDroits Humainswtxkqcqtb8Pas encore d'évaluation
- Seance 11 DR Const Ij L1-1Document8 pagesSeance 11 DR Const Ij L1-1RAHIM FallPas encore d'évaluation
- Article 3 - L'exercice de Droit de Manifestation Sur Les Voies PubliquesDocument20 pagesArticle 3 - L'exercice de Droit de Manifestation Sur Les Voies Publiquestonylbk28Pas encore d'évaluation
- Le Droit À Un Procés ÉquitableDocument7 pagesLe Droit À Un Procés Équitableutilisateur vPas encore d'évaluation
- TD 5 Libertés Publiques PDFDocument6 pagesTD 5 Libertés Publiques PDFEnia LilkassPas encore d'évaluation
- Cours CEDHDocument19 pagesCours CEDHMarlly JosephPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel (2019-2020)Document105 pagesDroit Constitutionnel (2019-2020)Ekomo FabricePas encore d'évaluation
- TD4 Igd 24-25Document7 pagesTD4 Igd 24-25rakibou212Pas encore d'évaluation
- Droits Civiques - WikipédiaDocument4 pagesDroits Civiques - WikipédiaHermann RoméoPas encore d'évaluation
- Le Conseil Constitutionnel Aujourd'Hui Et DemainDocument16 pagesLe Conseil Constitutionnel Aujourd'Hui Et DemainleacaborasPas encore d'évaluation
- Cours DLF GarantieDocument15 pagesCours DLF GarantieouattaralatufatPas encore d'évaluation
- CDHD Introduction Aux Droits de L HommeDocument5 pagesCDHD Introduction Aux Droits de L HommeObed KongoloPas encore d'évaluation
- 6291Document22 pages6291Mohand BakirPas encore d'évaluation
- Introduction VraiDocument4 pagesIntroduction VraiZboa centroPas encore d'évaluation
- 01 Travail DDHCDocument2 pages01 Travail DDHCFerdinand BarthesPas encore d'évaluation
- Droits Fondamentaux (Complet)Document28 pagesDroits Fondamentaux (Complet)kajit100% (1)
- La Déclaration Des Droits de L'homme Et Du Citoyen ÉlyséeDocument1 pageLa Déclaration Des Droits de L'homme Et Du Citoyen Élyséemanon66701Pas encore d'évaluation
- Rapport final de stage_Kouassi Tilder Djaha (1)Document10 pagesRapport final de stage_Kouassi Tilder Djaha (1)goudiabyousmaneworkPas encore d'évaluation
- Vers La Creation Dune Cour Constitutionnelle Au Senegal Contribution Au Debat 1Document21 pagesVers La Creation Dune Cour Constitutionnelle Au Senegal Contribution Au Debat 1NgomPas encore d'évaluation
- Cours CedhDocument12 pagesCours Cedh2nzzj4mzrnPas encore d'évaluation
- Droit ProcessuelDocument57 pagesDroit ProcessueldescampslindsayPas encore d'évaluation
- Fiches ÉPISTÉMOLOGIEDocument35 pagesFiches ÉPISTÉMOLOGIEgabriellaudePas encore d'évaluation
- 4GH41TEWB0323U06 CoursEMC-U06Document7 pages4GH41TEWB0323U06 CoursEMC-U06sunshineneko3Pas encore d'évaluation
- Cour Droit de L'homme Au MarocDocument23 pagesCour Droit de L'homme Au Marocmike aliPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel S1Document62 pagesDroit Constitutionnel S1dawndabbroanddabPas encore d'évaluation
- 6 7149 842a14db PDFDocument30 pages6 7149 842a14db PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- Ensayo Ddhh. 2Document5 pagesEnsayo Ddhh. 2eliomambellPas encore d'évaluation
- Les Mécanismes de Protection Des Droits de LDocument4 pagesLes Mécanismes de Protection Des Droits de Lrabiaaimane1998Pas encore d'évaluation
- 1 - Rafaa BEN ACHOUR - REV PDFDocument41 pages1 - Rafaa BEN ACHOUR - REV PDFTay SsirPas encore d'évaluation
- Une Definition de La ConstitutionDocument3 pagesUne Definition de La ConstitutionAbdullah SadioPas encore d'évaluation
- Exposé CEDH - Plan DétailléDocument4 pagesExposé CEDH - Plan DétailléGaliPas encore d'évaluation
- Chapitre 4_ Les LoisDocument9 pagesChapitre 4_ Les LoisywpyyqwnnbPas encore d'évaluation
- Quelles Lois Essentiellespour La Rpublique Dmocratique Du CongoDocument9 pagesQuelles Lois Essentiellespour La Rpublique Dmocratique Du Congometa9003Pas encore d'évaluation
- Le Troisième Reich (Bolaño, Roberto)Document289 pagesLe Troisième Reich (Bolaño, Roberto)Abdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- La Déconstruction Structurelle Du Droit InternationalDocument17 pagesLa Déconstruction Structurelle Du Droit InternationalAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Résumé Les Droits de L'homme Au MarocDocument5 pagesRésumé Les Droits de L'homme Au MarocAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- La Procédure ConsultativeDocument3 pagesLa Procédure ConsultativeAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Responsabilité Du Transporteur Routier (Texte2016)Document8 pagesResponsabilité Du Transporteur Routier (Texte2016)Abdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- RUE03 636 KairouaniDocument4 pagesRUE03 636 KairouaniAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Armes ChimiqueDocument4 pagesArmes ChimiqueAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Battistella D. - Théories Des Relations Internationales. 3e ÉditionDocument431 pagesBattistella D. - Théories Des Relations Internationales. 3e ÉditionAbdelhamid Karraky100% (1)
- 8 - Géopolitique Du Phénomène Migratoire en MéditerranéeDocument17 pages8 - Géopolitique Du Phénomène Migratoire en MéditerranéeAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Conflit Algero-MarocainDocument11 pagesConflit Algero-MarocainAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- LJI - Le Realisme Offensif - Theorie Et Pratique - Dylan MOTIN - 112020Document9 pagesLJI - Le Realisme Offensif - Theorie Et Pratique - Dylan MOTIN - 112020Abdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Liste Projets Tri-GeoDocument3 pagesListe Projets Tri-GeoAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- Liste Projets Tri-GeoDocument3 pagesListe Projets Tri-GeoAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- FOR - Demande - Validation - Offre - Emploi - Permanent - A-0700-EF 3Document9 pagesFOR - Demande - Validation - Offre - Emploi - Permanent - A-0700-EF 3chifatrabelsiPas encore d'évaluation
- Les Sources Du DroitDocument4 pagesLes Sources Du DroitLaazouzi DRIDPas encore d'évaluation
- Revue Jurisprudence CDPPOC 2015Document312 pagesRevue Jurisprudence CDPPOC 2015محمد الموسويPas encore d'évaluation
- 000 Oraganisation Politique, Juridique, AdministrativeDocument16 pages000 Oraganisation Politique, Juridique, AdministrativeSolofaly RAKOTOARINDRIAKAPas encore d'évaluation
- Rapport Du HCJP Sur Les Résolutions Climatiques Say On ClimateDocument52 pagesRapport Du HCJP Sur Les Résolutions Climatiques Say On ClimateArnaud DumourierPas encore d'évaluation
- La Procédure Pénale de La RDCDocument48 pagesLa Procédure Pénale de La RDCKANYUKAPas encore d'évaluation
- ChroniqueAM DameCachetDocument4 pagesChroniqueAM DameCachettechnic repairPas encore d'évaluation
- DRT 1010 Cours 1Document8 pagesDRT 1010 Cours 1kissoperlaPas encore d'évaluation
- La Production de Lurbain en AlgérieDocument85 pagesLa Production de Lurbain en AlgérieFa HimaPas encore d'évaluation
- Règle de DroitDocument20 pagesRègle de DroitsouirtidikraPas encore d'évaluation
- Cours de Droit International Public 1ère PartieDocument97 pagesCours de Droit International Public 1ère Partiedidi.gagaPas encore d'évaluation
- Cog 113547Document25 pagesCog 113547Jeffrey GatsePas encore d'évaluation
- Recueil Des Obligations Déontologiques Du MagistratDocument63 pagesRecueil Des Obligations Déontologiques Du MagistratDUPONTPas encore d'évaluation
- Devoir DC4-2 Du 4 Juin - EmmaDocument3 pagesDevoir DC4-2 Du 4 Juin - Emmagasilove777Pas encore d'évaluation
- NormalisationDocument7 pagesNormalisationBachir HouzaifahPas encore d'évaluation
- Décret - Charte VFDocument84 pagesDécret - Charte VFMohammed FRIKELPas encore d'évaluation
- Gouvernance Decentralisee Et DevLocDocument65 pagesGouvernance Decentralisee Et DevLoctalaini100% (1)
- A. Batbie - Traité Théorique Et Pratique de Droit Public Et Administratif PDFDocument552 pagesA. Batbie - Traité Théorique Et Pratique de Droit Public Et Administratif PDFFrancisco J. EscajadilloPas encore d'évaluation
- Manifeste TOHDocument1 pageManifeste TOHFred AliPas encore d'évaluation
- Droit de La FamilleDocument23 pagesDroit de La FamilleAmbre BlotPas encore d'évaluation
- Accord de IonDocument1 pageAccord de IonYounès CharroudPas encore d'évaluation
- Comment Organiser La Succession Testamentaire Et La Succession Sans TestamenDocument22 pagesComment Organiser La Succession Testamentaire Et La Succession Sans TestamenMahama KaborePas encore d'évaluation
- De La Supériorité Du Contrat de Travail Sur Le Pouvoir de L'employeurDocument10 pagesDe La Supériorité Du Contrat de Travail Sur Le Pouvoir de L'employeurexed-kPas encore d'évaluation
- Synthèse ch1 - Le Droit Et Ses Fonctions Dans La SociétéDocument4 pagesSynthèse ch1 - Le Droit Et Ses Fonctions Dans La SociétéMeyssanPas encore d'évaluation
- Droit International PrivéDocument97 pagesDroit International PrivéInet InetPas encore d'évaluation
- Guide Pcop Arrete 6458-2005 Du 08 Juin 2005 Guide Pcop CTDDocument257 pagesGuide Pcop Arrete 6458-2005 Du 08 Juin 2005 Guide Pcop CTDAndriantsoa RamanantsialoninaPas encore d'évaluation
- RJCE - Vol 2 - Numéro 2 - 2024 - publié en août 2024 (2024_10_29 07_17_33 UTC)Document256 pagesRJCE - Vol 2 - Numéro 2 - 2024 - publié en août 2024 (2024_10_29 07_17_33 UTC)jnbakuluPas encore d'évaluation
- Mémoire de Projet de Fin D'étudesDocument44 pagesMémoire de Projet de Fin D'étudesMohamed Houyam ÂtmaniPas encore d'évaluation
- 051m Fédération Des Producteurs D Oeufs Du QuébecDocument25 pages051m Fédération Des Producteurs D Oeufs Du QuébecLeemanPas encore d'évaluation
- DroitDocument567 pagesDroitMahdi ZaghdoudPas encore d'évaluation