1
Pascal et la foi humaine
Antony McKenna
Université de Saint-Etienne et CNRS IHRIM (UMR 5317)
mckenna@univ-st-etienne.fr
1. Introduction
Le point de départ dans ma lecture des Pensées de Pascal1 est de les considérer
comme l'ébauche d'une apologie, d'une tentative de convaincre l'interlocuteur
“libertin” à adopter la foi chrétienne. Il faut donc qu'il y ait quelques principes
communs à l'apologiste et à son interlocuteur, qui puissent servir de point de
départ de leur échange. En effet, la foi visée par Pascal n'est pas celle de la grâce
ni un “saut” dans l'inconnu, mais l'aboutissement d'un raisonnement sur la
vraisemblance des preuves historiques attestant l'authenticité de l'Écriture. Son
apologie se fonde donc sur une philosophie de la foi dont la cohérence rationnelle
doit être mise en évidence, puisqu'il s'agit de faire comprendre à l'interlocuteur
incroyant la nature de la “foi humaine” (ses rapports avec la raison, le sentiment,
le cœur, le corps) et de le convaincre de faire les pas nécessaires pour acquérir
cette foi. Toute objection rationnelle, toute incohérence pèserait donc de tout son
poids et rendrait l'argument inefficace.
Cette perspective n'exclut pas, bien entendu, l'influence de la doctrine
augustinienne, qui a tant marqué Pascal, mais je suis frappé que les études
pascaliennes donnent souvent un portrait de l'auteur comme un bibliophile assis
devant une vaste bibliothèque patristique où il puise indéfiniment, se souciant peu
d'argumentation, concentré sur l'aboutissement de la vie chrétienne : la grâce. Or,
je prends au sérieux les témoignages sur l'ambition de Pascal de composer une
1
Toutes nos références aux Pensées se rapportent à l'édition suivante: Blaise Pascal, Pensées, opuscules et lettres, éd.
Philippe Sellier, Paris: Classiques Garnier, 2011.
�2
apologie, une argumentation qui vise à convaincre l'incroyant de la vérité de la
foi. Il est donc intéressant d'envisager les Pensées sous cet angle pour examiner
chaque étape de l'argumentation afin d'en saisir la cohérence logique – puisqu'il
s'agit de convaincre – et de saisir la nature de la foi “humaine” à laquelle Pascal
espère que son interlocuteur finira par adhérer.
Je me permets d'insister sur ce point: il ne s’agit pas d’opposer la philosophie
à la théologie, mais de démontrer que Pascal interprète la doctrine augustinienne
au moyen des instruments d’analyse philosophique – psychologique,
épistémologique et politique – fournis par les philosophes contemporains:
Descartes, Gassendi et Hobbes, en particulier. Du même coup, nous entrevoyons
la nature de l’incroyance à laquelle il s’attaque dans les Pensées.
A mon sens – pour nous donner une perspective comme point de départ – Pascal
fonde son interprétation de la doctrine augustinienne de la corruption de la nature
humaine sur une philosophie de la foi héritée de Montaigne : “nous sommes
chrétiens au même titre que nous sommes périgourdins ou allemands” (Essais, II,
12) : cette conception de la “foi humaine” – de la foi à laquelle les hommes
adhèrent sans la grâce – est analysée, à son tour, au moyen des concepts
philosophiques fournis par Descartes et par Gassendi. Il aboutit ainsi à une
conception très moderne de la “foi humaine” – sans la grâce – comme le produit
d'un raisonnement sur la vraisemblance, raisonnement confirmé par l'éducation et
par l'habitude. A nous de saisir la nature de ce “sentiment” qui caractérise la foi
chez l'homme corrompu, chez l'homme de la “seconde nature”.
2. Vanité et misère de l'homme sans Dieu
C’est sur le constat – commun à l'apologiste et au libertin – de la Vanité et de
la Misère que Pascal fonde son dialogue avec le libertin : un jugement sur la
condition humaine. La “vanité” qui provoque l'étonnement, le rire et l'indignation
de Pascal est celle d'une rationalité défaillante. Il observe le monde, il constate la
“faiblesse” de l'homme et il en décortique les symptômes sur le plan de la logique.
�3
Il constate que les hommes se comportent de telle ou telle façon et que la raison
apparente de ce comportement est futile: le fait absurde et dérisoire s'impose là où
nous attendrions, espérerions, exigerions une raison.
Un bout de capuchon arme 25 000 moines. (S.52)
La puissance des mouches [...] (S.56)
[Certains] aiment mieux la mort que la paix, les autres aiment mieux la mort
que la guerre [...] (S.63)
Deux visages semblables, dont aucun ne fait rire en particulier, font rire
ensemble par leur ressemblance. (S.47)
Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des
choses dont on n'admire pas les originaux. (S.74)
La Vanité que Pascal dénonce est un dysfonctionnement logique, car il décrit
un monde où le corps, l'arbitraire, le hasard tient lieu de raison, et où les hommes
font comme si ils y trouvaient une véritable raison, une logique, une cohérence,
de véritables valeurs.
Il a quatre laquais. (S.53)
Il demeure au-delà de l'eau. (S.54)
Et il conclut:
Ce qui m’étonne le plus est de voir que tout le monde n’est pas étonné de sa
faiblesse. On agit sérieusement et chacun suit sa condition, non pas parce
qu’il est bon en effet de la suivre puisque la mode en est, mais comme si
chacun savait certainement où est la raison et la justice. [...] (S.67)
Le dossier Vanité constitue ainsi une désignation des paradoxes qui sont les
symptômes cocasses de l'absence de sens de la vie et du monde tel que nous le
vivons. Nous l'appellerions aujourd'hui l'absurde. La vanité choque Pascal et
l'indigne: elle lui est insupportable par l'ennui (au sens fort) qu'elle lui inspire: un
sentiment d'angoisse et de dégoût existentiel.
La Misère, c'est “le fait pour l'homme de vivre dans un univers en proie à la
vanité” (L. Thirouin): c'est l'expérience douloureuse de l'absurde, de l'absence de
�4
sens. Le sentiment de la misère de l'incroyant (“l'homme sans Dieu”) s'inspire
donc d'une nostalgie du sens, d'une conception rationnelle de l'ordre légitime des
raisons, de la raison, et du constat d'un désordre, d'un renversement de l'ordre
dans la nature humaine.
Ainsi, Pascal envisage l'absurde comme un désordre, comme un scandale qui
doit être justifié, qui doit s'expliquer. La souffrance vient précisément de ce que
“[je ne sais] pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi
ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’en un
autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit” (S.681); “il
n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre” (S.227):
Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité
précédente et suivante [...] le petit espace que je remplis et même que je vois,
abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je
m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison
pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m'y a mis
? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ?»
(S.102: je souligne).
L'homme ne saisit pas le sens de sa vie et n'a pas les moyens de saisir le principe
et la finalité du monde. Il est perdu dans l'univers, “un milieu entre rien et tout,
infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe
sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable” (S.230):
Ne cherchons donc point d'assurance et de fermeté. Notre raison est toujours
déçue par l'inconstance des apparences, rien ne peut fixer le fini entre les
deux infinis qui l'enferment et le fuient. (S.230)
L’homme ne pourra apercevoir que quelque “apparence du milieu des choses”
(ibid.).
3. La «seconde nature»
Il n'y a pas de raison. Le corps s'impose dans la nature humaine. En effet, la
“nature” humaine est “aujourd'hui pareille à celle des animaux” (S.149):
�5
“l'homme est devenu semblable aux bêtes” (S.182). Comment Pascal envisage-til la nature animale ? Il ne fait aucun doute pour Pascal que les animaux sont des
machines (S.137, 139, 143, 617), mais il insiste ici sur le fait que la nature
humaine fonctionne maintenant comme une machine: l'homme est “automate
autant qu'esprit” : le corps s'impose dans la nature humaine et dicte sa loi à l'esprit.
Nous verrons plus loin de quelle manière le corps s'impose. Pour l'instant, qu'il
suffise de reconnaître que l'absence de raison, l'absence de sens et la domination
mécanique du corps est ce qui définit la misère de l'homme : “ce qui est nature
aux animaux nous l'appelons misère en l'homme” (S.149). La “nature” actuelle
de l'homme est animale, dominée par le corps. C'est ce qui constitue cet “étrange
renversement” dans la nature humaine (S.681). Certes, dans cette misère, l'homme
se distingue des animaux par une grandeur, mais celle-ci reste à définir.
Corps et esprit
Le corps de l'homme est perdu dans l'univers infini des corps. Cependant, une
réflexion sur le corps lui permet de découvrir un autre principe de sa vie
psychologique: “Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? Est-ce la main, est-ce le
bras, est-ce la chair, est-ce le sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose
d'immatériel” (S.140). L'homme n'est donc pas entièrement corps: il y a en lui un
principe immatériel que Pascal appelle pensée (S.143), ou raison (S.144), ou âme
(S.147). Plus loin, il reprend le vocabulaire cartésien: le moi consiste dans ma
pensée (S.167), et il dénonce l'obscurité des philosophies matérialistes (S.193).
L'homme échappe à l'écrasement : sa “dignité” consiste dans le règlement de sa
pensée; il “dépasse” pour ainsi dire, par la conscience qu'il prend de sa condition,
l'univers matériel qui l'engloutit (S.145). Sans la pensée, il serait une pierre ou une
brute – un animal dont la nature est purement mécanique. À vrai dire, l'animal se
distingue de la machine arithmétique par sa volonté (S.617), mais Pascal s'attache
d'abord à distinguer la nature humaine de la nature animale: “Instinct et raison:
marques de deux natures” (S.144).
�6
Il n'empêche : cette “nature” humaine est “aujourd'hui pareille à celle des
animaux” (S.149). En quoi donc consiste la “grandeur” de l'homme? Elle consiste
à reconnaître sa misère (S.146) – ce que l'animal ne saurait faire. La conscience
que l'homme prend de sa misère est la preuve, aux yeux de Pascal, qu'il existe en
lui un principe immatériel qui constitue sa “dignité”. En ce sens “la grandeur est
si visible qu'elle se tire même de sa misère” (S.149): “La grandeur de l'homme est
grande en ce qu'il se connaît misérable” (S.146). Encore une fois, nostalgique du
sens, Pascal juge de notre nature selon un concept de l'ordre qui établit la dignité
de l'esprit par rapport au corps: c'est cette conception hiérarchique de l'ordre qui
lui permet de dénoncer un désordre, un étrange renversement là où le corps
s'impose à l'esprit. Ce désordre caractérise notre nature et définit notre misère,
puisque nous en prenons conscience, ce que les animaux ne sauraient faire.
Il est donc misérable, puisqu'il l'est. Mais il est bien grand, puisqu'il le
connaît. (S.155)
J'insiste sur ce point, qui peut sembler élémentaire, pour souligner le fait que la
raison, qui distingue l'homme de l’animal, ne lui permet pas d'échapper à la misère
précédemment décrite. La “grandeur” caractérisée par l'existence en lui d'un
principe immatériel désigne une vocation de l'homme, et non pas sa nature
actuelle, qui est une “seconde nature” “semblable à celle des animaux”. La raison
est actuellement faible ; elle est dominée par l'imagination, par le corps ; elle ne
permet pas à l'homme d'atteindre quelque certitude que ce soit.
Ce triomphe de l'incertitude est confirmé par un fragment curieusement intitulé
“Contre le pyrrhonisme” (S.141) mais qui conclut “à la gloire de la cabale
pyrrhonienne”: l'homme ne saurait échapper à cette “ambiguïté ambiguë”, à cette
“obscurité douteuse” qui caractérise l'exercice de la raison dans la seconde nature.
Origine et statut du sentiment
�7
Nous ne saurions même démontrer que les hommes conçoivent de la même
façon les premiers principes tels que le mouvement. Le fragment suivant est alors
d'une importance capitale.
Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le
cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers
principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaie
de les combattre. (S.142)
Il est donc admis que nous ne saurions démontrer que tous les hommes conçoivent
de la même manière les premiers principes ; et en même temps, il est admis que
les hommes ne sauraient mettre en doute les premiers principes d'espace, de
temps, de mouvement, de nombre. Dans cette “impuissance” (S.142), les hommes
doivent se contenter de raisonner sur des principes dont ils savent que leur
conformité d’un homme à un autre n’est qu’une supposition; ils ne sauraient
rejeter ces principes, tout simplement parce qu’ils n’en ont pas d’autres. Ils
doivent s’en contenter tout en sachant qu’ils sont indémontrables. Ce sont les
données de notre “nature” corporelle.
La raison et le cœur sont donc deux facultés psychologiques distinctes qui ont
un statut épistémologique différent : la raison contrôle la cohérence des
propositions et des conséquences tirées des prémisses ; le cœur sent l'évidence des
principes trouvés dans le corps (S.680). La raison exige la certitude selon ses
propres critères de cohérence; le cœur sent les principes et ne peut pas en douter.
La raison est impuissante à fonder les principes en raison et à douter de ces
principes, puisqu'elle n'en a pas d'autres : autrement dit, elle ne peut pas en
mesurer la certitude selon ses propres critères, car elle se heurte à l'“évidence” du
cœur. Il serait ridicule que la raison demande des comptes au cœur quant à la
certitude des principes, puisque le cœur ne juge pas les principes selon ce critère :
il les trouve et les sent tout simplement selon sa nature. On se rend compte qu'on
est au cœur de la réflexion pascalienne sur la nature de l'évidence cartésienne –
et, comme nous le verrons, Pascal a lu de près les Objections de Gassendi et de
Hobbes.
�8
Retenons d'abord les fragments où Pascal déclare que nos “principes naturels”
sont des “principes accoutumés” :
Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos principes accoutumés?
[...] Une différente coutume en donnera d'autres principes naturels. (S.158)
La coutume est une seconde nature qui détruit la première. (S.159).
Regardons ensuite le fragment qui oppose pyrrhoniens et dogmatistes : le débat
porte manifestement sur la question qui nous préoccupe. Pascal prolonge ici sa
réflexion:
Que fera l'homme en cet état? Doutera-t-il de tout? Doutera-t-il s'il veille, si
on le pince, si on le brûle? Doutera-t-il s'il doute? Doutera-t-il s'il est? On
n'en peut venir là, et je mets en fait qu'il n'y a jamais eu de pyrrhonien effectif
parfait. La nature soutient la raison impuissante et l'empêche d'extravaguer
jusqu'à ce point… (S.164)
Quelle est cette “nature” qui “soutient la raison impuissante”? Pascal parle ici de
la nature de l'homme qui fait l'objet des débats philosophiques entre dogmatistes
et pyrrhoniens: il s'agit donc nécessairement de sa nature actuelle, de la seconde
nature caractérisée par l'emprise du corps – la nature identifiée avec la coutume.
Avant de tirer les conséquences de ce constat, regardons un autre texte: nous
savons que le cœur sent les principes (S.142). Dans le fragment de “La Machine”,
il est dit; “Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps,
dimension. Elle raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne peut
croire autre chose” (S.680). Plus loin dans le même fragment, Pascal indique les
rites corporels qui plieront la machine: “…c'est en faisant tout comme s'ils
croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement
même cela vous fera croire et vous abêtira”. Ici, remarquons surtout le fait que
l'action de la coutume (de dire la messe, etc.) qui nous fait croire – c'est-à-dire,
qui suscite en nous le sentiment de la foi – est décrite comme naturelle, c'est-à-
�9
dire (j'interprète) conforme à notre nature corporelle, conforme à notre seconde
nature. Plus loin encore, toujours dans le même dossier, la même formule revient :
La coutume est notre nature. Qui s'accoutume à la foi la croit… Qui
s'accoutume à croire que le roi est terrible, etc. Qui doute donc que notre
âme, étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croie cela et
rien que cela? (S.680: je souligne)
Il ne fait aucun doute, à mes yeux, qu'il s'agit ici des mêmes principes que ceux
que Pascal désignait dans le fragment S.142 comme étant sentis par le cœur.
Or – comme on vient de le voir dans le fragment S. 680 – l'action mécanique
par laquelle le peuple croit que “le roi est terrible” est la même que celle par
laquelle les rites feront croire et “abêtiront” l'interlocuteur selon la logique des
animaux-machines; de même, c'est le corps (dans lequel l'âme “trouve” les
principes), qui fonde la “fermeté” des principes nombre, temps, dimension que
nous appelons “nature” et “nécessité”. Comment concilier ces textes avec la
fameuse “certitude” des principes dans le fragment S.142 ? À mon sens, la nature
qui soutient la raison impuissante (S.164) est la coutume qui nous fait apparaître
les principes comme “nature, nécessité” (S.680). Ces principes sont les principes
de notre nature corporelle : l'âme “trouve” ces principes dans le corps: l'homme
n'a pas les moyens de les mettre en doute; ils fondent tous ses raisonnements et
fondent la certitude même qu'il a d'exister, de douter, de raisonner… Est-ce à dire
qu'ils sont certains, absolument, métaphysiquement certains ? L'incapacité où
nous sommes de les mettre en doute ne prouve que la faiblesse de la raison. La
nature corporelle de l'homme – qui définissait précisément la “misère” de notre
nature – nous fournirait-elle une certitude ?
Non : notre incapacité à mettre en doute ces principes ne démontre que
l'emprise du corps : notre raison la plus forte d'admettre la vérité de ces principes
est que nous ne pouvons penser sans eux. Ces principes ne sauraient donc fonder
la définition d'une quelconque grandeur de la nature humaine ; ils permettent de
�10
préciser, au contraire, la définition de sa misère, et de réaffirmer que la seule
grandeur est la conscience de cette misère. La définition du statut des principes
permet de préciser que la seule connaissance dont l'homme soit capable est une
connaissance fondée sur la Machine, sur la coutume, sur le corps.
Un roi dépossédé
C'est précisément cette seconde nature qui est “semblable à celle des animaux”
et que Pascal dénonce comme une “misère”. Or, argue-t-il, “Ce sont misères de
grand seigneur, misères d'un roi dépossédé.” (S.148); “Car qui se trouve
malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé ?” (S.149): le sentiment
même de la misère de notre condition actuelle est la preuve – rationnelle, profane,
sans recours à l'Écriture – que l'homme “est déchu d'une meilleure nature qui lui
était propre autrefois” (S.149). La contradiction entre la première nature (perdue)
et la seconde nature (actuelle) de l'homme se déduit donc du sentiment actuel de
la misère : elle conduit à un paradoxe, à un mystère (S.164).
J'insiste sur ce point: la grandeur de l'homme ne consiste pas en une quelconque
certitude des principes qu'il sent, mais précisément dans la conscience qu'il prend
qu'il est un sujet de misère, incapable de vérité, livré à l'arbitraire du corps. “Ce
n’est point ici le pays de la vérité; elle erre inconnue parmi les hommes” (S.425).
Or, toujours selon la conception de l'ordre véritable (ordre cartésien), selon lequel
l'esprit devrait triompher du corps, étant plus digne que lui, Pascal déduit de notre
misère – ou plus précisément de notre conviction ou sentiment que le règne du
corps est une misère, un désordre – que nous sommes déchus d'une première
nature où l'esprit était indépendant du corps. L'argument du roi dépossédé est ici
un argument clé: il est une «raison des effets», en ce sens qu'il est proposé comme
explication logique de notre refus de l'absurde, de notre nostalgie de sens.
Qui souffre de l'absence de vérité sinon celui qui a connu la vérité ? Qui souffre
de l'incertitude sinon celui qui a connu la certitude ? Qui souffre de l'absurde, de
l'absence de sens, sinon celui qui a connu un sens ? L'homme souffre de la vanité
�11
et l'éprouve comme misère : il est donc un “roi dépossédé”. C'est une réponse à
une question qui est à ses yeux parfaitement logique que Pascal va chercher dans
l'Écriture : le récit de la Chute, conçue comme la cause de cette “dépossession”,
de ce “renversement” de la première nature.
Le sentiment : une passion cartésienne
Le statut de la raison ne peut être pleinement saisi que dans son rapport au
sentiment du cœur. C'est un des problèmes les plus complexes dans l'interprétation
des Pensées. En particulier, on comprend mal comment le cœur peut être le siège
de sentiments tels que l'amour et la foi, et aussi l'instrument par lequel l'homme
appréhende les idées primitives (ou principes) telles que l'espace, le temps, le
mouvement et le nombre. Le sentiment, chez Pascal, semble être à la fois émotion
et perception. J'envisagerai ici d'abord l'exemple de l'amour, exemple privilégié
de “sentiment du cœur” chez Pascal. Ensuite, j'essayerai de comparer l'amour avec
d'autres sentiments dans le mécanisme de la psychologie pascalienne.
Prenons l'exemple de l'amour sous la forme de l'amour-propre. On sait que
l'analyse pascalienne de l'amour-propre se fonde sur la doctrine augustinienne des
deux amours. Cependant, Pascal apporte une analyse proprement philosophique
de ce qui constitue la dépravation du “moi haïssable”, qui se fait “centre de tout”
(S.494): en cela il est déraisonnable et injuste:
...Si nous naissions raisonnables et indifférents, et connaissant nous et les
autres nous ne donnerions point cette inclination à notre volonté. (S.680)
En effet, l'amour-propre se heurte à ce que Pascal appelle ici l'“ordre”:
Car tout tend à soi: cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général...
(S.680).
Il existe donc un “ordre” raisonnable et juste de l'amour. Quel est-il ? Pascal
donne à la doctrine des deux amours une expression profane, philosophique :
�12
Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même
naturellement, selon qu'il s'y adonne, et il se durcit contre l'un ou l'autre à son
choix... (S.680)
Ici Pascal oppose l'être individuel du moi à l'être universel: l'être universel est le
tout dont l'être individuel fait partie: le “choix” de la volonté injuste est donc de
s'aimer soi-même au mépris de l'amour qu'elle doit – selon l'“ordre” – à l'être
universel. Ce choix n'est pas raisonnable :
Vous avez rejeté l'un [l'amour de l'être universel] et conservé l'autre [l'amour
de soi-même]; est-ce par raison que vous vous aimez ? (S.680).
L'“ordre” consiste donc à aimer le tout dont on fait partie, et cet ordre règne
dans tous les domaines de l'activité humaine. Le “désordre” consiste à préférer la
partie au tout et à concevoir les intérêts de cette partie comme contraires à ceux
du tout. Le désordre est une déraison, symptôme d'une dépravation de la volonté.
Le rapport du moi individuel à l'être universel fait l'objet aussi de ce
“ressouvenir” cartésien:
Je sens que je puis n'avoir point été, car le moi consiste dans ma pensée ;
donc moi qui pense n'aurais point été, si ma mère eût été tuée avant que
j'eusse été animé, donc je ne suis point un être nécessaire. Je ne suis pas
aussi éternel, ni infini, mais je vois bien qu'il y a dans la nature un être
nécessaire, éternel et infini. (S.167: je souligne).
Dans ce fragment, l'être du moi est opposé à l'être universel qui est un “être
nécessaire, éternel et infini”: c'est-à-dire mon être intelligent est opposé à l'Être
intelligent pris sans limitation. Or, on sait que par cet Être intelligent pris sans
limitation – Être nécessaire, éternel et infini – Descartes entendait l'Être de Dieu.
Pascal reprend cette terminologie ailleurs :
La vraie et unique vertu est donc de se haïr, car on est haïssable par sa
concupiscence, et de chercher un être véritablement aimable pour l'aimer.
Mais comme nous ne pouvons aimer que ce qui est hors de nous, il faut aimer
un être qui soit en nous et qui ne soit pas nous. Et cela est vrai d'un chacun
�13
de tous les hommes. Or, il n'y a que l'être universel qui soit tel. Le royaume
de Dieu est en nous. Le bien universel est en nous, est nous-mêmes et n'est
pas nous. (S.471: je souligne)
Dans ces fragments, le rapport du moi individuel à l'Être universel n'est pas
seulement un rapport intellectuel fondé sur l'ordre cartésien des raisons, mais un
rapport fondé sur l'“ordre” raisonnable (et cartésien) de l'amour.
En effet, la définition de l'ordre de l'amour – l'analyse du moi haïssable et de
l'Être aimable de Dieu – est fondée très précisément sur la définition cartésienne
(1650) des passions ou sentiments de l'âme de l'amour et de la haine:
L'Amour est une émotion de l'âme, causée par le mouvement des esprits, qui
l'incite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables.
Et la Haine est une émotion, causée par les esprits, qui incite l'âme à vouloir
être séparée des objets qui se présentent à elle comme nuisibles. (Passions,
art. 79).
Descartes précise alors “ce que c'est que se joindre ou séparer de volonté”: il
entend parler du
consentement par lequel on se considère dès à présent comme joint avec ce
qu'on aime: en sorte qu'on imagine un tout, duquel on pense être seulement
une partie, et que la chose aimée en est une autre. (art. 80).
Cette définition fonde l'ordre pascalien de l'amour : l'ordre qui porte le moi à
aimer l'Être universel est conforme à la définition cartésienne de l'amour qui porte
la volonté à se joindre au tout dont elle fait partie. De même, le moi “haïssable”
est celui qui ne se considère pas comme la partie d'un tout, mais comme un tout
séparé :
...en la Haine on se considère seul comme un tout, entièrement séparé de la
chose pour laquelle on a de l'aversion. (art. 80).
Il existe donc dans les Pensées la conception d'un “ordre” fondamental
– raisonnable et juste – qui permet de dénoncer le désordre du moi haïssable
comme une déraison symptomatique de la corruption, comme une “chose
monstrueuse, [...] un enchantement incompréhensible et un assoupissement
surnaturel, qui marque une force toute-puissante qui le cause” (S.681), – et cette
�14
conception de l'“ordre” se fonde sur les termes mêmes de la définition cartésienne
de l'amour.
Cette même définition cartésienne de l'amour permet à Pascal de reprendre
ensuite une métaphore paulinienne : d'abord, Pascal définit le tout: “Pour régler
l'amour qu'on doit à soi-même, il faut s'imaginer un corps plein de membres
pensants, car nous sommes membres du tout, et voir comment chaque membre
devrait s'aimer…” (S.401). Ensuite, le bonheur du membre individuel est défini
en fonction de son appartenance au tout: “Pour faire que les membres soient
heureux, il faut qu'ils aient une volonté et qu'ils la conforment au corps” (S.402).
Être membre du corps de membres pensants – image paulinienne de l'Eglise
invisible de la communauté des fidèles – implique en ce sens une conversion de
la volonté égoïste. La métaphore nous fournit ainsi une règle de l'amour juste,
amour qui ne se réalise qu'en la foi par laquelle le moi se fond dans l'être universel.
Le corps aime la main, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer
de la même sorte que l'âme l'aime. Tout amour qui va au-delà est injuste…
On s'aime parce qu'on est membre de Jésus-Christ. On aime Jésus-Christ
parce qu'il est le corps dont on est membre. Tout est un. L'un est en l'autre
[...] (S.404).
Tel est le sens de cette formule très forte: “Il faut n'aimer que Dieu et ne haïr que
soi” (S.405).
Voyons maintenant s'il y a un rapport entre la définition du sentiment de
l'amour et celle d'autres sentiments évoqués dans les Pensées.
L'amour est un sentiment, cela va de soi : et son siège est, non pas l'intelligence,
l'esprit, mais le “cœur”. Mais la mémoire est aussi un sentiment (S.531) et elle est
“nécessaire pour toutes les opérations de la raison” (S.536). De plus, c'est sur les
“connaissances du cœur et de l'instinct” qu'il faut que la raison “s'appuie” : c'est
le cœur qui “sent” les principes “comme qu'il y a espace, temps, mouvement,
nombres” (S.142), et c'est en ce sens que “tout notre raisonnement se réduit à
�15
céder au sentiment” (S.455). Les instruments initiaux, les concepts élémentaires,
les premiers principes de tous nos raisonnements nous sont fournis par le cœur.
D'où vient ce sentiment des principes ? Voyons comment est créé un sentiment
chez Pascal.
Car il ne faut pas se méconnaître : nous sommes automates autant qu'esprit
[... la coutume incline] l'automate qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense.
(S.661)
L'automate, la Machine, l'habitude du corps crée le sentiment. Et, “une fois que
l'esprit a vu où est la vérité”, Pascal a recours à ce mécanisme pour ancrer dans le
sentiment une conviction qui risquerait de rester trop fragile, trop abstraite, pour
ainsi dire, sans l'appui du sentiment. L'automate, l'habitude du corps, nous permet
d'acquérir “une créance plus facile” – “car d'en avoir les preuves toujours
présentes, c'est trop d'affaire” : “l'habitude […] sans violence, sans art, sans
argument, nous fait croire les choses et incline toutes nos puissances à cette
croyance, en sorte que notre âme y tombe naturellement” (S.661). Et ce
mécanisme nous est familier dans le vocabulaire qui caractérise l'argument du
“pari” sous la forme d'“abêtissement”: “naturellement même cela vous fera croire
et vous abêtira” (S.680). Par ce mécanisme – celui de notre nature “pareille à
celle des animaux”, de notre “seconde nature” dominée par le corps – les
habitudes du corps plient la Machine, matent les passions rebelles et ancrent dans
le sentiment du cœur une conviction de l'esprit. “Qui s'accoutume à la foi la
croit…” (S.680). C'est la loi de toutes nos opinions, de toutes nos convictions, de
tous nos sentiments : “La coutume est notre nature” (S.680). Le corps joue donc
un rôle primordial dans la naissance des sentiments et le sentiment de la foi
n'échappe pas à cette loi de notre “seconde nature”.
Se pose alors un problème de cohérence. Dans le fragment S.142, nous l'avons
vu, le cœur sent les principes et c'est sur les connaissances du cœur et de l'instinct
que la raison doit s'appuyer. Quel rapport entre ce sentiment des principes et
�16
l'automate qui crée les sentiments dans les fragments que je viens de citer (S.661,
680)? Un premier indice nous est fourni par le début même du “pari” :
L'âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimensions. Elle
raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne peut croire autre
chose. (S.680).
Cette formule confirme le rôle du corps dans la naissance du sentiment – rôle
exprimé d'ailleurs sans équivoque dans les fragments cités ci-dessus. Mais qu'estce à dire : “l'âme trouve dans le corps” ? Le fragment des “Deux Infinis” fournit
une clef. Pascal y propose une sorte de cheminement épistémologique par lequel
nous aboutissons à la définition des principes :
toutes les sciences sont infinies en l'étendue de leurs recherches. Car qui
doute que la géométrie, par exemple, a une infinité d'infinité de propositions
à exposer ? Elles sont aussi infinies dans la multitude et l'infinité de leurs
principes. Car qui ne voit que ceux qu'on propose pour les derniers ne se
soutiennent pas d'eux-mêmes et qu'ils sont appuyés sur d'autres qui, en
ayant d'autres pour appui, ne souffrent jamais de dernier ? Mais nous
faisons des derniers qui paraissent à la raison comme on fait dans les choses
matérielles, où nous appelons un point indivisible celui au-delà duquel nos
sens n'aperçoivent plus rien, quoique divisible infiniment et par sa nature.
(S.230)
Ainsi “les sciences sont infinies dans la multitude et la délicatesse de leurs
principes”; notre esprit est incapable de saisir ces principes infiniment délicats;
les principes que nous fournit le cœur ou le corps – nombre, temps, dimension –
correspondent donc à ce que nous appelons “un point indivisible” dans les choses
matérielles. En d'autres termes, l'évidence des principes est un effet de la
limitation de la vue claire de l'esprit, et cette limitation est imposée par le corps.
“Trouver dans le corps” signifie donc ici que ces principes sont ceux qui nous
apparaissent comme “premiers” (ou “derniers” auxquels nous puissions remonter)
parce que le corps obscurcit la vue claire de l'esprit. En ce sens, les principes sont
ceux qui apparaissent à un esprit uni à un corps. Le corps détermine ainsi notre
vision des choses : nous analysons le monde selon nos “principes”, nous appelons
�17
cela “nature”, “nécessité”, mais cette “nécessité” n'est que celle de notre nature
corporelle et non pas du monde que nous percevons. Ce n'est que parce qu'elle se
trouve unie à un corps que l'âme pense en termes de nombre, temps, dimensions.
Ces concepts sont issus de l'union de l'âme et du corps: le sentiment est donc le
mode de connaissance qui caractérise un être constitué d'une âme et d'un corps.
Ce fragment confirme à mes yeux le rapport de dépendance qui lie les sentiments
au corps et confirme du même coup que nous n'avons pas affaire à une “intuition
intellectuelle”: jamais, chez Pascal, l'esprit ne fonctionne indépendamment du
corps. L'âme n'a pas, comme chez Descartes, ses “espèces à part”. Au contraire,
les premiers principes sont “trouvés” dans le corps et “sentis” par le cœur. Cette
perspective me semble confirmer la dimension anti-cartésienne du sentiment
pascalien.
Le désordre de l'amour est une déraison, disions-nous. De même, la saisie des
principes “trouvés” dans le corps est une déraison imposée par notre nature
actuelle, dominée par le corps, “pareille à celle des animaux” (S.149). Le
sentiment pascalien de l'amour est conforme à la définition de la passion
cartésienne. De même, sur le plan de la connaissance, le sentiment pascalien est
conforme à la définition cartésienne des “sentiments ou passions de l’âme” qui
sont “certaines façons confuses de penser qui proviennent et dépendent de l'union
et comme du mélange de l'esprit et du corps”2. En effet, il ne s'agit, selon les
termes de Pascal, que du “ballet des esprits [animaux]” (S.565). Chez Pascal,
comme chez Descartes, les “passions de l'âme” (ou “sentiments de l'âme”) ont
leur source dans les “esprits animaux”, c'est-à-dire dans le sang, dans le corps.
Or, l'évidence et la certitude des intuitions intellectuelles dépendent, dans
la philosophie cartésienne, de la liberté de la volonté, qui peut toujours suspendre
le jugement et ne pas embrasser les idées obscures ou confuses. Les perceptions
des passions sont obscures et confuses : devant une telle obscurité et une telle
2
René Descartes, Œuvres complètes, éd. Charles Adam et Paul Tannery, Paris: Vrin, 1897-1909, et Paris: Vrin/CNRS, 19641974, 11 vol., ix.64; éd. Ferdinand Alquié, Paris: Garnier, 1963-1973, 3 vol., ii.492.
�18
confusion, le libre arbitre peut toujours et doit toujours suspendre le jugement,
car il est toujours et absolument en notre pouvoir. Au contraire, de l'analyse
pascalienne du rôle du sentiment, il s'ensuit que nous n'avons que des idées
obscures ou confuses, en ce sens qu'elles ne sont pas engendrées par une pure
intelligence, mais par l'union de l'âme et du corps : elles sont toutes fondées sur
le sentiment. Devant de telles perceptions obscures et confuses, Descartes
s'impose la suspension du jugement. Dans la perspective pascalienne, cette
suspension est impossible :
L'esprit croit naturellement et la volonté aime naturellement de sorte qu'à
faute de vrais objets il faut qu'ils s'attachent aux faux. (S.544: je souligne).
La psychologie cartésienne est décapitée : dans le domaine de la connaissance,
comme dans celui de l'amour, l'homme est livré à ses sentiments. Or,
la fantaisie est semblable et contraire au sentiment, de sorte qu'on ne peut
distinguer entre ces contraires… Il faudrait avoir une règle. La raison
s'offre, mais elle est ployable à tous sens. Et ainsi il n'y en a point. (S.455)
Le lien entre le sentiment et le corps est ainsi confirmé, car la fantaisie est fruit de
l'imagination, de la faculté qui transforme les données des sens en images pour
les livrer au travail de l'esprit. C'est, en effet, l'imagination qui a créé en l'homme
une “seconde nature” (S.78), et c'est dans cette “nature” dominée par la coutume,
par le corps, que le sentiment joue un rôle primordial, non seulement dans le
domaine des affections, mais aussi dans celui des connaissances.
Dès lors le sentiment est dépourvu de garantie métaphysique. Tandis que
Descartes fondait sur la véracité divine la garantie que l'évidence ne pouvait le
tromper (car Dieu est auteur de ma nature et c'est Lui qui me tromperait s'Il m'avait
créé de telle sorte que je sois obligé par ma nature d'acquiescer, sous la force de
l'évidence, à des choses qui se révéleraient fausses), l'épistémologie pascalienne
est privée de garantie divine: “Dieu tente mais il n'induit pas en erreur” (S.431),
c'est-à-dire Dieu ne nous oblige pas à prendre nos certitudes pour des vérités
absolues qui s'imposeraient à Dieu-même. L'homme peut reconnaître ainsi son
�19
incapacité à atteindre par ses propres forces la vérité, sans que Dieu le trompe,
sans que Sa véracité soit mise en cause. L'homme reconnaît sa misère: il reconnaît
qu'en perdant sa première nature il a perdu sa capacité initiale de se détacher de
l'emprise du corps et de l'incertitude qui en découle.
Sentiment v. grandeur
Si on doutait du statut du sentiment, si on était tenté de lui attribuer une
quelconque grandeur d'après le titre de la liasse (ou dossier) VII “Grandeur”, il
suffirait, pour dissiper cette illusion, de nous tourner vers un sentiment que Pascal
désigne lui-même expressément comme erroné.
Il est utile d'abord de distinguer, non pas entre deux espèces de sentiment – qui
naît toujours du corps – mais entre deux chemins d'élaboration des sentiments.
D'une part, nous “trouvons” les principes nombre, temps, dimension, dans le
corps: ces principes sont ceux de la vie du corps; nous ne saurions les mettre en
doute car nous ne saurions renoncer à notre nature corporelle. D'autre part,
d'autres sentiments sont suscités par la Machine, par l'action mécanique des
habitudes qui impriment dans le cœur une conviction de l'esprit au moyen de
l'action de l'automate: le sentiment de la foi est suscité par les habitudes adoptées
par celui qui, convaincu par les arguments apologétiques (ou, en l'occurrence, par
le “pari”), aspire à la foi et adopte les habitudes appropriées (“prendre de l'eau
bénite, faire dire des messes”). Or, cet abêtissement désigne le même processus
psychologique par lequel le peuple se persuade que “le roi est terrible”. En effet,
Pascal évoque trois sentiments déterminés par la coutume :
La coutume est notre nature, qui s’accoutume à la foi la croit et ne peut
plus ne pas craindre l’enfer. Et ne croit autre chose.
Qui s’accoutume à croire que le roi est terrible, etc.
Qui doute donc que notre âme étant accoutumée à voir nombre, espace,
mouvement, croie cela et rien que cela[?] (S.680)
Le sentiment populaire “que le roi est terrible” naît de la “coutume de voir les rois
accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers et de toutes les choses qui ploient
�20
la machine vers le respect et la terreur”, qui entraîne une association d'images
dans l'esprit du peuple: de là vient que le visage du roi “quand il est quelquefois
seul et sans ces accompagnements, imprime dans [ses] sujets le respect et la
terreur parce qu’on ne sépare point dans la pensée leur personne d’avec leur suite
qu’on y voit d’ordinaire jointe. Et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de
cette coutume croit qu’il vient d’une force naturelle” (S.59). Ce sentiment est donc
une illusion imposée par la coutume au moyen d'une association d'images
trompeuse, effet de l'imagination. En effet, on sait que la légitimité de l'autorité
souveraine est fondée, selon Pascal (et selon Hobbes / Sorbière3), en premier lieu
sur la Force: “ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est
fort fût juste” (S.135). Le sentiment “que le roi est terrible” est une “corde de
l'imagination” (S.668): imposé par l'imagination et par la coutume, il fonde une
“opinion du peuple” qui est “saine” mais qui ne l'est pas “dans sa tête” [dans la
tête du peuple], “car il pense que la vérité est où elle n'est pas” (S. 126). On
comprend que le “positivisme juridique” de Hobbes définit la justice dans le
monde de la “seconde nature”.
Une objection possible à cette lecture du sentiment faillible: dans le fragment
même (S. 142) où Pascal affirme: “Nous connaissons la vérité non seulement par
la raison, mais encore par le cœur”, il s'exclame: “Plût à Dieu que nous n'en
eussions au contraire jamais besoin [de la raison] et que nous connaissions toutes
choses par instinct et par sentiment !” Comment concilier cette exclamation avec
le constat que le sentiment est la marque de notre “seconde nature” dominée par
le corps, de notre seconde nature ? A mes yeux, c'est que, si nous n'étions pas
capables d'analyser la source de nos sentiments et de découvrir, par l'analyse
rationnelle, qu'ils sont fondés sur l'imagination et donc sur le corps, nous ne
serions pas conscients de leur incertitude et partant nous ne serions pas conscients
Dans le Traité du pouvoir absolu des souverains (1685) du théologien réformé Élie Merlat, on trouve cette
même doctrine explicitement référée à l'alliance entre Augustin et Hobbes.
3
�21
de notre misère – que notre nature est “pareille à celle des animaux”, qu'elle est
une “seconde nature” et que le “roi est dépossédé”. Cela me paraît confirmé par
la conclusion de ce même fragment:
Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du
cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Mais à ceux qui
ne l'ont pas, nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant
que Dieu la leur donne par sentiment du cœur. Sans quoi la foi n'est
qu'humaine et inutile pour le salut.
Ceux qui croient spontanément par sentiment – tout comme ceux qui croient que
“le roi est terrible” – ne se doutent pas que ce sentiment est fondé sur l'éducation
et sur la coutume. Ils le tiennent pour absolument vrai. Ce n'est que par l'analyse
rationnelle qu'on découvre la véritable nature (corporelle et incertaine) du
sentiment. A ceux qui sont conscients de la véritable nature du sentiment et de
son statut, nous donnons des arguments en faveur de la foi, mais ce ne sont que
des arguments vraisemblables, incertains, qui n'inspirent qu'une foi humaine.
Dieu, par la grâce, peut transformer ce sentiment humain – qui peut n'être qu'une
fantaisie – en connaissance certaine. Sans la grâce, nous devons nous débrouiller
avec les sentiments de la “seconde nature”.
Sentiment et fantaisie
La “Machine” désigne des actes extérieurs qui entraînent une conviction
intérieure: c'est le processus d'enracinement en nous du sentiment de la foi
humaine. L'“abêtissement” constitué par le sentiment populaire erroné que “le
roi est terrible” constitue le modèle de la naissance d'une foi humaine: en
l'occurrence, cette foi politique populaire exprime par des actes extérieurs de
soumission une conviction intérieure; elle est humble, sincère, intense, fervente;
elle suscite l'amour et même l'adoration dans le cœur des courtisans de Louis
XIV: néanmoins, elle reste illusoire. Par une analyse raisonnée de ce sentiment
�22
populaire, Pascal révèle qu'il naît d'une confusion des images fournies par
l'imagination, confusion confirmée par l'habitude d'associer le visage du roi avec
les soldats qui l'entourent. L'analyse rationnelle découvre ainsi que ce sentiment
n'est qu'une fantaisie: l'“abêtissement” a fonctionné au service d'une erreur. Il
n'y a là aucune transcendance. De même, dans le domaine de la foi religieuse,
l'abêtissement suscite en nous une foi humaine, une foi coutumière – sans grâce
divine. Cette foi humaine est utile – si une apologie peut être utile – puisqu'elle
incite l'interlocuteur à “s'offrir par les humiliations aux inspirations [de la
grâce]” qui “seules peuvent faire le salutaire effet” (S.655). L'homme n'accède
donc pas à la foi salvatrice par l'adoption volontaire de la “Machine” des
habitudes. Il n'a pas la capacité à se hisser “au-dessus” de sa seconde nature:
dominé par le corps, l'homme de la seconde nature ne perçoit le monde qu'au
moyen de l'imagination – qui traduit les sensations en images qui sont à l'origine
de toutes nos idées. C'est en ce sens que l'imagination
cette partie dominante dans l’homme [...] cette superbe puissance ennemie
de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer
combien elle peut en toutes choses, a établi dans l’homme une seconde
nature (S.78)
Encore une fois, le corps s'impose là où on attendait une raison. En ceci, la
psychologie pascalienne est parfaitement conforme à l'empirisme gassendiste.
Cela ne signifie évidemment pas que Pascal désigne la foi comme un sentiment
erroné, mais que la foi suit la loi de notre nature: c'est une foi humaine qui se
fonde, comme tous nos sentiments, sur les lois de notre “seconde nature”. “Une
fois que l'esprit a vu où est la vérité”, on choisit ses habitudes4 et, naturellement
(selon le mécanisme de la “seconde nature”), la coutume suscite les sentiments
qui correspondent à cette conviction. Ce n'est pas là une conception dégradée de
la foi: la foi a le même statut que toutes les autres convictions de l'homme selon
sa nature actuelle. Mais la foi humaine – la seule que puisse nous inspirer
4
Voir Pascal, Pensées, n° 680, p.507, n.2.
�23
l'apologiste, puisqu'il n'a que des arguments et ne dispose pas de la grâce – n'a pas
de statut privilégié par rapport à nos autres sentiments : tous nos sentiments
découlent de la domination de notre nature par le corps, c'est-à-dire de notre
misère. L'homme doit chercher la vérité avec les moyens qui sont les siens – ceux
de la seconde nature.
Le sentiment de la foi qui naît des habitudes – motivées par une conviction –
n'est pas en soi la grâce. Le sentiment de la foi est suscité par les habitudes de
celui qui s'est convaincu de la vraisemblance des témoignages bibliques. Il a
“ouvert son esprit aux preuves”, il s'y est “confirmé par la coutume”, et il “s'offre
par les humiliations aux inspirations [de la grâce]”, qui “seules peuvent faire le
vrai et salutaire effet” (S.655).
L'imagination
Cette analyse du sentiment est confirmée par le statut accordé à l’imagination
dans la psychologie pascalienne de la “seconde nature” :
Imagination. C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse
d’erreur et de fausseté, et d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours,
car elle serait règle infaillible de vérité si elle l’était infaillible du mensonge.
Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité,
marquant du meme caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je
parle des plus sages et c’est parmi eux que l’imagination a le grand droit de
persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux
choses. (S. 78).
L’incertitude de nos connaissances découle du statut “dominant” qui est attribué
à l’imagination, car elle préside à l’élaboration de nos idées:
Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à
la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi en
l’homme une seconde nature. […] L’imagination dispose de tout… (S.78)
�24
L’imagination est “cette partie dominante de l’homme”, car c’est elle qui fournit
à l’esprit, à partir des sensations du corps, les images sur lesquelles il travaille. En
ce sens, toutes nos idées ou plutôt images sont marquées par le caractère “fourbe”
de l’imagination dont le pouvoir est le symptôme de la domination du corps. En
effet, il y a “piperie” réciproque entre les sens et la raison:
Les sens abusent la raison par de fausses apparences, et cette même piperie
qu'ils apportent à l'âme ils la reçoivent d'elle à leur tour. (S.78)
Dans la “seconde nature”, l’imagination domine la raison; cette “maîtresse
d’erreur et de fausseté” impose ses images; nous n’avons plus d’idées qui ne
portent pas la marque de cette faculté corporelle. Cette domination du corps fonde
l’incertitude qui frappe toutes nos idées. Le statut privilégié du corps dans la
“seconde nature” se reflète dans le statut central de l’imagination dans la
psychologie et donc dans l'épistémologie pascaliennes.
Ainsi, les principes
fournis par le cœur, mode de connaissance de l'union de l'âme et du corps,
déterminent les catégories – nombre, temps, dimension – au moyen desquelles
nous analysons notre vision du monde ; ensuite, les informations sur le monde,
les images que nous en saisissons, proviennent de l'imagination qui traduit en
images les sensations. Nous raisonnons donc sur des images du monde dérivées
des sensations du corps et nous les analysons selon les catégories déterminées par
les principes qui sont ceux de notre nature corporelle.
Cette psychologie et cette épistémologie empiristes sont celles de Gassendi, de
sorte qu'on peut résumer la position de Pascal en une formule simple mais qui
n'est pas simpliste : la première nature de l'homme est celle d'un esprit qui peut se
détacher du corps, qui a ses “espèces à part” : elle est cartésienne ; après la Chute,
la seconde nature de l'homme, dominée par le corps, est gassendiste.
En effet, pour Gassendi (dans ses Objections aux Méditations métaphysiques
de Descartes), nous n'avons aucun critère qui nous permette de distinguer, d'une
part, l'idée dans l'intuition cartésienne et, d'autre part, l'image fournie par la
“Phantaisie” (imagination). Il insiste longuement auprès de Descartes “pour que
�25
vous me donniez un signe grâce auquel je puisse reconnaître que je me sers tantôt
d'un intellect qui ne soit pas imagination, tantôt d'une imagination qui ne soit pas
intellection”5. De même, pour Pascal, nous n'avons pas de critère qui permette de
distinguer entre le sentiment et la fantaisie:
Mais la fantaisie est semblable et contraire au sentiment, de sorte qu'on ne
peut distinguer entre ces contraires. L'un dit que mon sentiment est fantaisie,
l'autre que sa fantaisie est sentiment. (S.455)
Certes, Gassendi réduit le mode de l'union de l'âme au corps à la seule faculté de
la Phantaisie, tandis que Pascal oppose la fausse fantaisie au sentiment vrai, mais
cette distinction pascalienne reste théorique : en réalité, nous n'avons aucun critère
pour les distinguer :
Il faudrait avoir une règle. La raison s'offre mais elle est ployable à tous sens.
Et ainsi il n'y en a point. (S.455)
La psychologie cartésienne est ainsi décapitée et privée du “point fixe” de la
certitude métaphysique. Selon le commentaire de Gassendi et de Pascal, ces
perceptions, qui sont, en effet, “une suite et dépendance de ma nature”, ne sont
pas des intuitions de l'intelligence indépendante du corps: ce sont, au contraire,
des perceptions confuses dépendant de l'union de l'âme avec le corps.
4. “L'Écriture et le reste”
Après cette lecture de l'anthropologie pascalienne, nous devons nous interroger
sur la nature de la foi à laquelle Pascal cherche à conduire son libertin. En effet,
comment distinguer la foi de la superstition ? Ici encore nous ferons comme dans
la vie de tous les jours : nous raisonnons constamment sur les vraisemblances et
sur notre intérêt, nous engageons tous les jours notre vie sur de tels raisonnements.
Ce n'est pas parce que nous sommes incapables d'une certitude parfaite que nous
devons renoncer à tout raisonnement. Nos raisonnements aboutissent à la
vraisemblance. De même, la soumission et usage de la raison répond à cette
5
Pierre Gassendi, Disquisitio metaphysica, éd. Bernard Rochot, Paris: Vrin, 1962, p. 242, 156.
�26
double contrainte : ne pas renoncer à la raison, mais aussi constater notre
incapacité à fournir des preuves démonstratives, “absolument certaines”. Nous
éviterons la superstition selon la même logique qui nous permet d'éviter la folie
dans la vie de tous les jours. Nous exigerons de l'apologiste qu'il nous fournisse
des preuves comparables à celles qui nous suffisent dans la vie de tous les jours.
Selon la formule de Filleau de La Chaise: “M. Pascal entreprit donc de faire
voir que la Religion Chrétienne était en aussi forts termes que ce qu'on reçoit le
plus indubitablement parmi les hommes” – et lorsqu'il approfondit cette remarque,
il affirme que Pascal propose “des preuves morales et historiques, et de certains
sentiments qui viennent de la nature et de l'expérience” … “et il fit voir que ce
n'est que sur des preuves de cette sorte que sont fondées les choses qui sont
reconnues dans le monde pour les plus certaines”6. Il donne les exemples qui ne
sont pas ceux de Pascal, mais qui illustrent ces “preuves morales et historiques” :
l'existence de Mahomet, celle de la ville de Rome, “l'embrasement” de Londres
en 1666. Tous ces exemples se fondent sur des témoignages.
En effet, Pascal refuse la “voie royale” de Gassendi (S.644) :
J'admire avec quelle hardiesse ces personnes entreprennent de parler de
Dieu. En adressant leurs discours aux impies, leur premier chapitre est de
prouver la divinité par les ouvrages de la nature. Je ne m'étonnerais pas de
leur entreprise s'ils adressaient leurs discours aux fidèles [...]. Mais pour ceux
en qui cette lumière [de la foi] est éteinte et dans lesquels on a dessein de la
faire revivre, ces personnes destituées de foi et de grâce, qui, recherchant de
toute leur lumière tout ce qu'ils voient dans la nature qui peut les mener à
cette connaissance, ne trouvent qu'obscurité et ténèbres; dire à ceux-là qu'ils
n'ont qu'à voir la moindre des choses qui les environnent et qu'il y verront
Dieu à découvert, et leur donner pour toute preuve de ce grand et important
sujet le cours de la lune et des planètes, et prétendre avoir achevé sa preuve
avec un tel discours, c'est leur donner sujet de croire que les preuves de notre
religion sont bien faibles. Et je vois par raison et par expérience que rien n'est
plus propre à leur en faire naître le mépris. Ce n'est pas de cette sorte que
l'Écriture, qui connaît mieux les choses qui sont de Dieu, en parle... (S. 644).
6
Nicolas Filleau de La Chaise, Discours sur les «Pensées» de M. Pascal, Paris: Guillaume Desprez, 1672, p.15-16: le même
texte est inclus – avec la même pagination – en annexe des éditions des Pensées parues chez Desprez à partir de 1678.
�27
Il sait que, aux yeux de l'incroyant, l'ordre de la nature ne démontre pas l'existence
d'un Créateur intelligent. Il refuse aussi les preuves métaphysiques cartésiennes
(S.222) :
Les preuves de Dieu métaphysiques sont si éloignées du raisonnement des
hommes et si impliquées, qu’elles frappent peu et quand cela servirait à
quelques-uns, cela ne servirait que pendant l’instant qu’ils voient cette
démonstration, mais une heure après ils craignent de s’être trompés. (S.222)
Mais il ne s'agit pas seulement d'efficacité : l'argument rationnel,
métaphysique – même s'il était efficace – ne démontrerait pas l'existence du Dieu
chrétien mais celle du “Dieu des philosophes”, du Dieu des déistes. Pascal rejette
explicitement la preuve métaphysique de l'existence d'un Dieu auteur des vérités
géométriques et celle du Dieu principe intelligent créateur de l'ordre de la nature,
car il ne s'agit pas là du Dieu chrétien :
Et c'est pourquoi je n'entreprendrai pas ici de prouver par des raisons
naturelles, ou l'existence de Dieu, ou la Trinité, ou l'immortalité de l'âme, ni
aucune des choses de cette nature ; non seulement parce que je ne me
sentirais pas assez fort pour trouver dans la nature de quoi convaincre des
athées endurcis, mais encore parce que cette connaissance sans Jésus-Christ
est inutile et stérile. Quand un homme serait persuadé que les proportions
des nombres sont des vérités immatérielles, éternelles et dépendantes d'une
première vérité en qui elles subsistent et qu'on appelle Dieu, je ne le
trouverais pas beaucoup avancé pour son salut.
Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des
vérités géométriques et de l'ordre des éléments : c'est la part des païens et
des épicuriens [...] Tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ et qui
s'arrêtent dans la nature, ou ils ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse,
ou ils arrivent à se former un moyen de connaître Dieu et de le servir sans
médiateur. Et par là, ils tombent ou dans l'athéisme ou dans le déisme, qui
sont deux choses que la religion chrétienne abhorre presque également. [...]
(S. 690)
Toutes les preuves que Pascal souhaite exposer visent à prouver la divinité de
Jésus-Christ, Dieu fait homme :
�28
Dieu par Jésus-Christ. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans
ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu, par Jésus-Christ nous
connaissons Dieu. Tous ceux qui ont prétendu connaître Dieu et le prouver
sans Jésus-Christ n'avaient que des preuves impuissantes… (S.221)
Il s'agit bien de preuves historiques qui serviront à prouver l'authenticité,
l'autorité de l'Écriture :
Mais pour prouver Jésus-Christ nous avons les prophéties, qui sont des
preuves solides et palpables. Et ces prophéties étant accomplies et prouvées
véritables par l'événement marquent la certitude de ces vérités et partant la
preuve de la divinité de Jésus-Christ. En lui et par lui nous connaissons donc
Dieu. (S.221)
Ces réflexions de Pascal me semblent bien correspondre à la formule de Filleau
de La Chaise: il ne s'agira, pour des raisons à la fois épistémologiques et
doctrinales, que de preuves historiques, de témoignages, car il s'agit de persuader
l'incroyant de la vérité de la Révélation: le christianisme consiste d'abord à croire
que le Christ est le Messie, Dieu incarné.
La portée des preuves historiques ne peut pas être d'établir une certitude
absolue. Elles se fondent sur des témoignages qui sont plus ou moins
vraisemblables. “Les preuves que Jésus-Christ et les apôtres tirent de l'Écriture ne
sont pas démonstratives…” (S.425). La nature de la foi que l'apologiste peut
souhaiter communiquer à son interlocuteur est nécessairement humaine : elle
dépend de la nature humaine. La foi qui se fonde sur des arguments humains est
nécessairement une foi humaine, caractérisée par cette incertitude qui marque
toutes les connaissances et toutes les convictions humaines.
Encore une fois, ce n'est pas là réduire la foi à une persuasion banale ou
subalterne, car les hommes n'ont pas d'alternative: toutes leurs convictions, tous
leurs “sentiments” se fondent sur la coutume. Ils sont incapables de saisir une
vérité absolument vraie : toutes les vérités qu'ils saisissent portent la marque de
leur nature, – la foi, conviction religieuse, comme toute autre conviction. Certes,
�29
la religion chrétienne n'est pas fondée sur des preuves démonstratives, mais il
serait illégitime d'exiger de la part de l'apologiste des preuves d'une autre nature
que celles qui nous servent dans notre vie “ordinaire”, que celles sur lesquelles
nous engageons notre vie et celle de nos proches. L'argument pascalien est sur ce
point d'une parfaite cohérence : c'est un argument ad hominem rétorqué au libertin
qui méprise les preuves historiques, les preuves fondées sur le vraisemblable. Il
n'y a pas là réduction, mais cohérence parfaite de l'analyse.
Il répond également à l'exhortation de Blaise et de Jacqueline Pascal à leur
sœur Gilberte Périer:
Il faut que nous nous servions du lieu même où nous sommes tombés, pour
nous relever de notre chute.7
Une découverte récente donne une pertinence accrue à cette argumentation
apologétique. En effet, Gianluca Mori a récemment démontré – à mes yeux, de
façon irréfutable – que Guy Patin est le rédacteur, en collaboration avec Gabriel
Naudé et Gassendi, du premier traité athée composé en France: le Theophrastus
Redivivus (1659)8. Rappelons que les petits-enfants de Guy Patin, les enfants de
son fils Charles, sont pensionnaires à Port-Royal au cours des années 1650. Patin
lui-même a fréquenté – avec de nombreux amis de Port-Royal – le salon des
Liancourt, où certains de ses propos ont été rapportés dans le Journal Jean
Deslyons et ensuite dans le Recueil de choses diverses9. Pascal a fréquenté
Gassendi et il choisit comme interlocuteur dans les Pensées un incroyant
gassendiste, tout en rejetant la “voie royale” proposée – par dissimulation – par
Gassendi pour démontrer l'existence de Dieu par l'ordre de la nature. Lors de son
séjour à Paris, Hobbes fréquente Gassendi (et sans doute Pascal également) à
l'académie de Habert de Montmor. Guy Patin connaît et même soigne Hobbes
7
Pascal, Pensées, p.657; Blaise Pascal, Œuvres complètes, éd. Jean Mesnard, Paris: Desclée de Brouwer, 1964-1992, 4 vol.,
II, p.582.
8
G. Mori, Athéisme et dissimulation au XVIIe siècle. Guy Patin et le “Théophrastus redivivus”, Paris, Honoré Champion,
2022.
9
J. Lesaulnier, Port-Royal insolite. Recueil de choses diverses, 1670-1671, Paris, Klincksieck, 1992.
�30
pendant son séjour à Paris. Quelques années plus tard, Molière a l'audace de
représenter le libertinage gassendiste sur la scène théâtrale: malgré le caractère
indirect de ces voisinages, c'est dire la pertinence de l'anthropologie des Pensées
pour les libertins de son époque. Rappelons également la formule du
Theophrastus Redivivus:
«Or, j'estime qu’aucun siècle n’a jamais été – même les siècles des
persécutions – plus remarquable par l’incrédulité et le mépris de la foi que
ce siècle où nous vivons» (traité III, chap. 5, §3, éd. G. Canziani et G.
Paganini, p.483).
L'instrument principal de la lecture de l'Écriture est la “figure” –
l'interprétation métaphorique ou allégorique du récit biblique, qui fait de l'Ancien
Testament l'annonce du Nouveau Testament et de la leçon du Christ. Les
«figuristes» refusent le sens littéral du texte biblique et mettent en avant
l’interprétation allégorique des prophéties. Pour Pascal, l’Ancien Testament est
un « chiffre » qui a été réalisé par le Christ : « On n’entend rien aux ouvrages de
Dieu, si on ne prend pour principe qu’il aveugle les uns et éclaire les autres» (PR,
XVIII, 24). Les « figures » allégoriques sont bien comprises de ceux qui ne se
contentent pas des promesses matérielles et du sens littéral (avec ses
contradictions), mais cherchent une vérité spirituelle et morale, celle de la
doctrine chrétienne ; les autres sont condamnés et méritent de l’être: “tout ce qui
ne va point à la charité est figure” (S. 301).
Il peut être utile de se rappeler que la lecture figuriste subit une crise quelques
années après la mort de Pascal, lors de la publication du Traité théologicopolitique de Spinoza et des travaux de Richard Simon: son Histoire critique du
Vieux Testament (Paris, s.n., 1680) et son Histoire critique du texte du Nouveau
Testament, où l’on établit la vérité des actes sur lesquels la Religion chrétienne
est fondée, Rotterdam, Reinier Leers, 1689. La crise du « figurisme » est
déclenchée par la censure des travaux de Richard Simon à l’initiative de Bossuet
en 1679. L’apologétique de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle se partage sur cette
�31
question. Aux figuristes catholiques (Pascal, Le Maistre de Sacy, Bossuet, Huet,
Quesnel, Jacques-Joseph Du Guet, d’Étemare32), et aux figuristes réformés
(surtout Louis Cappel et Jacob des Bergeries), s’opposent les exégètes «
historicistes » catholiques (Richard Simon d’abord et Étienne Fourmont par la
suite), et arminiens (Grotius et Le Clerc), qui dénoncent l’arbitraire – la
“mystagogie”10 – des sens « spirituels » prêtés aux prophéties et à différents
passages de l’Ancien Testament: par ignorance des langues anciennes: les
exégètes et les théologiens figuristes négligeraient le sens propres des termes pour
mieux les plier au sens allégorique, qui seul les intéresse. Or, dans la mesure où
les « historicistes » fondent sur la philologie et sur une herméneutique historique
leur refus des « mystagogies » figuristes, ils sont dénoncés comme des « sociniens
» qui refusent toute dimension spirituelle à l’Ancien Testament et qui réduisent le
Nouveau Testament à une leçon de morale : en somme, ils désacralisent la Bible
et versent dans le socinianisme. L’accusation est inexacte, certes – surtout en ce
qui concerne l’Histoire critique du Vieux Testament de Richard Simon (1678,
1680, 1685), comme le démontre sa querelle avec Jean Le Clerc33 – mais elle
donne une idée de la fièvre des esprits pris dans les polémiques de l’époque,
d’autant que la réédition de Richard Simon chez Elzevier en 1680 comporte une
préface du socinien Aubert de Versé. Simon est explicitement accusé par Bossuet
et par ses censeurs de la Sorbonne de tirer son interprétation de l’inspiration
biblique des « maximes de Grotius et des sociniens »34 et cette accusation est
renouvelée à l’égard de sa traduction du Nouveau Testament, où «il fait des
traditions constantes des conjectures de quelques Pères »35. Le caractère
superficiel de cette accusation est dénoncée par Simon lui-même, mais sa
réfutation – limpide – n’est pas écoutée et il est obligé de se retirer dans le silence
10
Le terme « mystagogue » deviendra courant chez Étienne Fourmont, qui reprend le flambeau de Richard Simon dans ses
ouvrages Lettre de R. Ismaël Ben Abraham, juif converti, à m. l’abbé Houteville, sur son livre intitulé: “La Religion chrétienne
prouvée par les faits” (Paris, 1722), et Mouââcah: ceinture de douleur, ou réfutation des Règles pour l’intelli- gence des
Saintes Écritures, composée par rabbi Ismael ben-Abraham, juif converti (Paris, 1723), où sont exposés les principes et les
griefs contre l’ignorance et la « mystagogie » des théologiens figuristes.
�32
à Bolleville avec une dernière prière : « A furore theologorum, libera nos
Domine ». Cette querelle aura des conséquences terribles au sein des
congrégations religieuses partagées entre “figuristes” et “historicistes” (l'Oratoire,
la Congrégation de Saint-Geneviève), dont témoigne la littérature philosophique
clandestine de l'époque11.
5. Conclusion
La foi humaine – fondée sur la vraisemblance des preuves historiques de
l'authenticité de l'Écriture Sainte – dont Pascal cherche à convaincre son
interlocuteur ne constitue pas le remède à la misère, car cette foi-là ne suffit pas à
transformer sa nature, à convertir sa volonté égoïste : la foi sans la grâce divine
n'est qu'humaine et elle obéit aux lois qui gouvernent toutes les passions de la
seconde nature : elle est une passion parmi d'autres.
La foi de la seconde nature étant coutume, elle est soumise à la loi du
tempérament, qui résume les effets des habitudes. C'est ce qui fait que les effets
de la grâce ne se distinguent pas – aux yeux des hommes, y compris du sujet luimême – de ceux du sentiment imprimé en notre cœur par la “Machine”. Ce que
l'on pense faire sous l'effet de la grâce – qui n'est d'ailleurs pas inamissible –
s'accomplit peut-être sous l'effet des habitudes et du tempérament. “Dieu seul
sonde les reins et les cœurs”12.
La cohérence de l'anthropologie et du projet apologétique de Pascal exigeait
cette nouvelle définition de la foi comme un sentiment suscité par les habitudes
de la vie, qui sont à leur tour motivées par la conviction que l'Écriture comporte
des témoignages convaincants, que le premier homme a péché, que le
“renversement” de la nature de l'homme est une punition de sa Chute, que Jésus11
Voir Yves de Vallone, La Religion du chrétien guidé par la raison universelle, éd. A. McKenna et Gianluca Mori, Paris,
Honoré Champion, 2023).
12
Psaumes 7,10; Jérémie 11,20. Voir Blaise PASCAL, Écrits sur la grâce, in Œuvres complètes, éd. Jean Mesnard, III, p.789
[je souligne]: «Que tous les hommes sont obligés [...] de croire qu'ils sont de ce petit nombre d'élus pour le salut desquels
Jésus-Christ est mort, et d'avoir la même pensée de chacun des hommes qui vivent sur la terre, quelque méchants et impies
qu'ils soient, tant qu'il leur reste un moment de vie, laissant dans le secret impénétrable de Dieu le discernement des élus
d'avec les réprouvés.»
�33
Christ est le fils de Dieu et que sa leçon est celle de la charité, de l'amour du
prochain, que les hommes qui croient en ces valeurs spirituelles peuvent être
sauvés au moyen de la grâce divine et que les élus jouiront d'une vie infiniment
heureuse après la mort. Cette foi humaine là – cette conviction, ce sentiment, cette
passion de l'âme – est, en effet, conforme à la seconde nature humaine.
Antony McKenna
Université de Saint-Etienne
et IHRIM (CNRS UMR 5317)
�
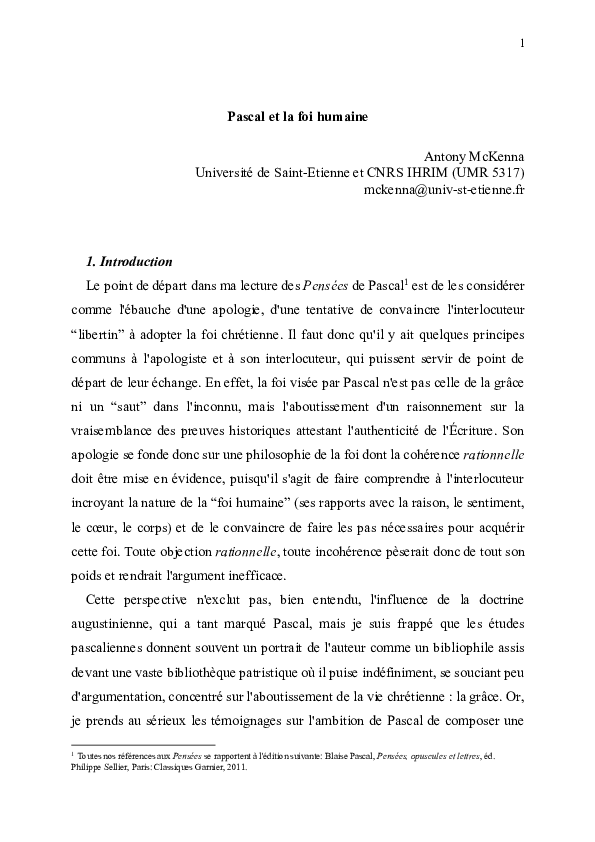
 McKenna Antony
McKenna Antony