ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
THÈSE
POUR OBTENIR LE GRADE DE
DOCTEUR DE
L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ DE BUENOS AIRES
ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET ETHNOLOGIE
PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT
PAR
ALFONSO OTAEGUI
LE 8 JANVIER 2014
LES CHANTS DE NOSTALGIE ET DE TRISTESSE DES AYOREO
DU CHACO BORÉAL PARAGUAYEN
(UNE ETHNOGRAPHIE DES LIENS COUPÉS)
DIRECTEURS DE THÈSE : M. PHILIPPE DESCOLA
MME FLORENCIA TOLA
JURY :
M. PHILIPPE DESCOLA
M. PHILIPPE ERIKSON
M. DIMITRI KARADIMAS
MME FLORENCIA TOLA
MME VALENTINA VAPNARSKY
�Sie singt von Lieb’ und Liebesweh,
Von Tränen und von Lacheln,
Sie jubelt so traurig, sie schluchzet so froh,
Vergessene Träume erwachen. *
Heinrich Heine : Buch der Lieder (1839)
* Elle chante l'amour et ses peines,
et les larmes et les sourires ;
elle s'agite si tristement, elle se lamente si gaiment,
que mes rêves oubliés se réveillent
2
�in memoriam Ijaoi Dosapei,
qui m’a ouvert les portes de Jesudi
in memoriam Uguri Dosapei et Toto Etacori,
qui chantaient avant le lever du soleil
à ceux qui me manquent.
3
�TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS
11
INTRODUCTION
13
Chapitre I. Présentation des Ayoreo et de Jesudi
18
I.1. L’environnement
18
I.2. La langue et la population
22
I.3. L’ethnohistoire des Zamucos
24
I.4. La vie dans le monte
31
I.5. Le XXe siècle : le contact définitif
32
I.6. Histoire de Jesudi
36
I.7. Les gens de Jesudi
37
I.8. Les mennonites
40
I.9. À Jesudi
42
I.10. Les Ayoreo dans la littérature ethnographique
45
PREMIÈRE PARTIE
LE PRIVILÈGE DE LA PAROLE
49
Introduction de la première partie
50
Chapitre II. La parole puissante
51
Introduction
51
II. 1. Les genres de la parole puissante
52
II.1.1 Sarode
55
II.1.2 Chubuchu
56
II.1.3 Paragapidi
57
II.1.4 Aguyade
60
II.1.5 Erái
61
II.1.6 Uhñaune
61
4
�II.1.7 Les traits de la parole puissante
II. 2. La mise en pratique de la parole puissante
62
63
II.2.1 La parole dangereuse
63
II.2.2 La parole dite par quelqu’un
67
II.2.3 Conclusion
73
II. 3. Les histoires des origines : le passé dans le présent
73
II.3.1 Les histoires des origines
73
II.3.2 La réification des mythes
77
II.3.3 Les histoires du passé dans le présent
79
II.3.4 Conclusion
85
II. 4. Les chamans retraités, les sarode et les pilules de l’homme blanc
86
II.4.1 Introduction
86
II.4.2 Les sarode et les chamans du temps de Sebag et de Lind
88
II.4.3 Les sarode et les pilules
94
II.4.4 Les chamans retraités
99
II.4.5 Les paroles de Dupade
104
II.4.6 Conclusion de II.4
109
Conclusion du chapitre II
110
Chapitre III. La parole humaine
112
Introduction
112
III. 1. Les chants humains
113
III.1.1 Introduction à la musique des Ayoreo
113
III.1.2 Les genres du chant
118
III.1.2.1 Enominoi, la vision du chaman
120
III.1.2.2 Pinangoningai « j’ai tué une fois » (et je le ferai à nouveau)
122
III.1.2.3 Chingojnangai, la joie par l’abattage d’une victime
126
III.1.2.4 Irade, une histoire de nostalgie et d’amour
128
5
�III.1.2.5 Uñacai, l’expression spontanée et structurée de la tristesse
131
III.1.2.6 Yasitigai, « je suis ravie »
132
III.1.2.7 Versículo, un irade-sarui en code chrétien
135
III.1.3 Conclusion de III.1
136
III. 2. Les récits guerriers
137
III. 3. Les histoires et le mots
144
III.3.1 Les remerciements
144
III.3.2 Les histoires sur cassettes
145
III.3.3 Les noms-anecdotes
146
Conclusion du chapitre III
149
Conclusion de la première partie
150
DEUXIÈME PARTIE
LES MOTS ET LES GENS
152
Introduction de la deuxième partie
153
Chapitre IV. Les clans des Ayoreo au quotidien
155
Introduction : les clans perdus
155
IV. 1. Janet Carsten : une vision locale des rapports humains
157
IV. 2. La parenté des Ayoreo dans la littérature anthropologique
160
IV. 3. Les clans dans la vie quotidienne des Ayoreo
163
IV. 3. 1. Une affaire délicate
163
IV. 3. 2. L’affectivité entre parents claniques
167
IV. 3. 3. Les igiosode d’ici
171
IV. 4. Les propriétés claniques : le rapport avec les non-humains du clan
173
6
�IV. 4. 1. Cet edopasai est à moi
175
IV. 4. 2. Parents de l’univers ?
178
IV. 5. Le rapport avec les ogasuode : ceux qui sont près
mais qui ne sont pas de mon clan
180
Conclusion du chapitre IV
182
Chapitre V. Ceux qui nous manquent.
Les disputes, la migration et la nostalgie à Jesudi
185
Introduction
185
V. 1. Les gens qui sont restés à Jesudi
186
V. 2. Les gens qui ont quitté Jesudi
190
V. 3. Les communautés issues de Jesudi
195
V. 3. 1. La dispute pour Jesudi
195
V. 3. 2. 15 de Septiembre
199
V. 4. Les pôles de pouvoir à Jesudi
201
V. 4. 1. Les Dosapei vs l’olería
201
V. 4. 2. La femme du chef
205
V. 4. 3. Autour des couples
212
V. 5. Ceux qui nous manquent : la nostalgie et la pensée qui ronronne
214
V. 6. Ijnoninguei, la joie de vivre
221
Conclusion du chapitre V
226
7
�Chapitre VI. Les chants au quotidien
230
Introduction : le prisme des chants
230
VI. 1. Les irade, des histoires d’amour
231
VI. 2. Les irade, la belle-mère et les deux belles-filles
238
VI.2.1. L’histoire
238
VI.2.2. Les chants
239
VI.2.3. Les deux femmes et la mère de Tamocoi
245
VI.2 4 Le chant dans le rêve et les pleurs matinaux
248
VI.2.5 Conclusion de VI.2
252
VI. 3. Les chants de tristesse uñacai
254
VI.3.1 Pleurer avec des mots
255
VI.3.1.1 Conclusion de VI.3.1
VI.3.2 Les paroles des chants de tristesse
261
261
VI.3.2.1 Le passé heureux et le triste présent
263
VI.3.2.2 Le bel-arc-en-ciel et la belle plume de cigogne
266
VI.3.2.3 La tristesse intense et brève
271
VI.3.3 Conclusion de VI.3
274
VI. 4. Les chants, quand on les entend de loin
275
VI.4.1 L’uñacai le plus beau
276
VI.4.2 La notion de paaque
278
VI.4.3. Le chant d’un moment et l’accumulation d’anecdotes
282
VI.4.3.1 Les gendres bien-aimés et les conjoints abandonnés
VI.4.4. Conclusion de VI.4
284
289
Conclusion du chapitre VI
293
Conclusion de la deuxième partie
296
8
�TROISIÈME PARTIE
LES MOTS QUI VOYAGENT
299
Introduction de la troisième partie
300
Chapitre VII. Le fait, le chant et la mémoire du chant
302
Introduction
302
VII. 1. Le fait et le chant
303
VII. 1. 1. L’observateur qui n’est pas là
303
VII. 1. 2. Commencer à chanter
306
VII. 1. 3. Écouter et répéter, l’enregistrement de la vie conjugale
309
VII. 2. Les émotions, les chants et la mémoire
VII. 2. 1. Les signes de l’affectivité
313
313
Conclusion du chapitre VII
318
Chapitre VIII. Love is in the air. Les messages sur cassettes et la radio HF
319
Introduction
319
VIII. 1. Les messages dans la forêt et les voix dans l’air
320
VIII. 1. 1. Les marques dans les arbres
et les marques dans les magnétophones
320
VIII. 1. 2. Les formules de guérison d’autrefois,
les voix d’aujourd’hui
326
VIII. 2. Les cassettes de Jesudi
329
Conclusion du chapitre VIII
337
Conclusion de la troisième partie
339
9
�CONCLUSION
342
BIBLIOGRAPHIE
351
ANNEXES
I. CHANTS
I.1 Enominoi, la vision du chaman
367
367
I.2 Pinangoningai « j’ai tué une fois » (et je le ferai à nouveau)
371
I.3 Chingojnangai, la joie par l’abattage d’une victime
373
I.4 Irade, une histoire de nostalgie et d’amour
374
I.5 Uñacai, l’expression spontanée et structurée de la tristesse
405
I.6 Yasitigai, « je suis ravie »
420
I.7 Versículo, un irade-sarui en code chrétien
422
II. ESPÈCES ANIMALES RECONNUES PAR LES AYOREO
III. PLANTES DES AYOREO
IV. TERMINOLOGIE DE PARENTÉ
V. LES FAMILLES DE JESUDI
424
439
441
443
10
�REMERCIEMENTS
« Cojñoi deitiiii ! Chi base, jirei uguchade, chi chacai degüi… ! » (« Un
Blanc là-bas… ! On dit qu'il descend, il a beaucoup de bagages, on dit qu'il veut
rester dans la communauté... ! »), criaient les enfants ayoreo quand je suis descendu
de la camionnette d'un bon samaritain mennonite qui m'avait emmené là. Le
message qui prévenait les Ayoreo de mon arrivée à Jesudi — et demandait la
permission d'y rester — s'était perdu dans l'air. La camionnette est partie toute de
suite — les mennonites conduisent toujours très vite. J'étais tout seul avec mes sacs
à dos à l'entrée de Jesudi. Je me sentais — et j'étais — un envahisseur. Une
vingtaine d'enfants sont venus chercher mes affaires, j'ai marché jusqu'au centre de
la communauté, devant la maison du chef, Ebedu Dosapei. Les Ayoreo étaient tous
là, ils buvaient du tereré. Je me suis assis, j'ai bu du tereré, « tu veux rester dans la
communauté ? — oui, euh... j'aimerais apprendre… — Ok, pas de problème ». Il est
difficile d'exprimer le sentiment de gratitude que j'éprouve envers les Ayoreo de
Jesudi. J'espère au moins que cette recherche sera une mise en valeur juste de leur
littérature orale. J'aimerais remercier spécialement la famille Dosapei : Ebedu et
Jnumi, Tamocoi, Puchiejna et Pojnangue, qui m'ont si chaleureusement accueilli et
nourri lors de mon séjour à Jesudi.
J'aimerais remercier ma famille — ma mère Celia, ma sœur Maru et mon
frère Luis — pour leur soutien constant au long de ces années. Mes amis Juan, Lito,
Marcio, Gabriela et Leo ont été un point d'appui très fort à La Plata et à Paris. Ana
a accepté mes longues absences sur le terrain et m'a toujours encouragé pour
continuer mes recherches et finir ma thèse : elle m'a accompagné lors du dernier
séjour à Jesudi et lors de la rédaction de la thèse à Paris. Elle est yacotepise.
L’ambiance idéale du Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS) a été des
plus propices pour le développement de ma recherche. J'aimerais exprimer ma
gratitude envers les chercheurs qui m'ont accordé le privilège de la conversation :
Pierre Déléage, Alexandre Surrallés, Jean-Luc Jamard, Margarita Xanthakou, Klaus
Hamberger, Araceli González Vázquez, Cedric Yvinec et Nicolas Adde, entre
autres. J'aimerais spécialement remercier Tiziana Manicone, qui a toujours eu
11
�l'intelligence de trouver des solutions immédiates aux innombrables problèmes
bureaucratiques et pragmatiques qui font partie de la vie académique.
Mon terrain n'aurait pas été possible sans l’immense soutien au Paraguay de
la famille Maldonado — Olga, Ricardo et Gabriela — et de l'artiste, Ysanne Gayet.
Je leur serai à tout jamais reconnaissant. Au Centro de Estudios Antropológicos de
la Universidad Católica, José Zanardini et Daisy Amarilla m'ont généreusement
aidé à rassembler la diverse bibliographie sur les Ayoreo disponible dans leurs
bibliothèques. À Filadelfia, les ONG Iniciativa Amotocodie et GAT m'ont
généreusement accueilli lors de mes premiers pas dans le Chaco.
Je souhaiterais exprimer ma gratitude envers l'École des Hautes Études en
Sciences Sociales pour leur formation doctorale ainsi que pour l'aide financière que
l'EHESS m'a accordée en 2011. Ma profonde reconnaissance s'adresse aussi au
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) qui m'a
attribué une bourse doctorale entre 2006 et 2011. Je remercie également le
Ministère de l’Éducation en Argentine et l'Ambassade de France en Argentine, qui
ont financé un séjour de deux mois au Laboratoire d'anthropologie sociale en 2011
pour consulter le fonds Lucien Sebag. J'aimerais aussi exprimer ma profonde
gratitude et reconnaissance envers Marion Abélès et Sophie Assal, directrices de la
bibliothèque Claude Lévi-Strauss (LAS - Collège de France), qui m'ont engagé
dans le travail passionnant des archives des ethnologues. Les vacations accordées
par le Collège de France et le CNRS pour organiser les archives du LAS m'ont
apporté un soutien économique pendant la rédaction de ma thèse tout au long de
2012 et 2013.
Enfin, last but not least, j'adresse ma reconnaissance à mes directeurs de
thèse, Philippe Descola et Florencia Tola. Florencia Tola a su combiner la critique
attentive avec la liberté d'action, ce qui m'a permis de trouver mon propre chemin
en tant que chercheur en formation. Elle m'a également montré que le terrain est un
lieu où l’on aime rester. Philippe Descola m'a ouvert les portes du laboratoire et de
l'intense ambiance intellectuelle qui l'anime. Il m'a donné des conseils puissants aux
moments précis, avec le timing d'un storyteller africain. Lors de moments
d'angoisse intellectuelle sur le terrain, les conseils de Philippe Descola m'ont
rassuré : je savais que les réponses étaient là, sur le terrain, quelque part.
12
�INTRODUCTION
Les Ayoreo1 de la communauté de Jesudi chantent, et ils chantent beaucoup.
La vie quotidienne des Ayoreo ne semble pas différente de celles des paysans
paraguayens qui travaillent dans les fermes, du moins pour l'ethnographe qui vient
d’arriver et ne parle pas leur langue. La monotonie se fait sentir au fil des jours : ils
travaillent avec le tracteur, ils écoutent la radio, parlent d’argent, jouent au football
et font des paris. Mais le chant semblait se détacher de tout cela aux yeux de
l’ethnographe avide de quelque chose d’étrange.
La pratique quotidienne du chant est remarquable chez les Ayoreo du Chaco
boréal paraguayen. Les Ayoreo chantent surtout le soir autour du feu. Pendant que
les femmes filent le caraguatá (Bromelia hieronymi), elles aiment écouter les
hommes chanter, car cela les anime, elles ne s’endorment pas. Si un homme est
content, il peut chanter plus de deux heures d'affilée et prendre juste des pauses
pour boire de l’eau. Excepté certains genres associés à la guerre et à l’utilisation du
hochet, rien ne distingue les chants des femmes de ceux des hommes. Avant le lever
du soleil, vers quatre heures du matin, on peut parfois entendre un vieil homme
avec son hochet en train de chanter ; sa famille habituée continue à dormir. On
entend les chants de loin car les voix voyagent bien dans l’espace ouvert de la
communauté.
Notre question est simple : pourquoi chantent-ils ? La réponse qu’ils
donnent est aussi simple : « tẽráchu, irasique gu2 » (« il chante parce qu’il est
content »). La simplicité frappante de cette réponse nous met face à un territoire
inexploré, laissé de côté par la plupart des travaux ethnologiques portant sur le
Chaco : celui des chants « profanes ». Ces chants ne convoquent pas de pouvoirs
1
Nous utiliserons la dénomination « Ayoreo » en majuscule pour les noms et en minuscule pour les
adjectifs sans inflexion de genre ou de nombre. Dans leur langue on dit : « ayorei » (masc. sing.),
« ayore » (fem. sing.), « ayoreode » (masc. pl.) et « ayoredie » (fem. pl.). « Ayoreo » est un hispanisme
que les Ayoreo utilisent dans leurs communications avec ceux qui ne parlent pas leur langue.
2
Pour la transcription de mots et d'expressions en langue ayoreo, nous utilisons les caractères suivants :
/jn/ (nasale sourde dentale), /r/ (roulée dentale), /y/ (spirante palatale), /ng/ (nasale vélaire). Cf.
BERTINETTO (2009) et HIGHAM et al. (2000). Le reste des caractères correspondent à l'espagnol. Dans les
cas de citations, nous respectons la graphie utilisée par chaque auteur.
13
�invisibles et ne sont pas secrets, mais — comme la lettre de Poe — ils étaient
cachés à la vue de tous.
Pourquoi chantent-ils ? La réponse à cette question est, comme Anthony
Seeger nous le montre, une cause et non une finalité : « The Suya sang because they
were happy ; singing made them happy » (1987 : xvii). Le moment consacré au
chant provoque la même chose chez les Ayoreo. Pourtant sa composition évoque
divers états affectifs selon le genre du chant. Il est source d'une multitude de
sentiments pour son auteur et l'auditoire présent. Cette simple déclaration décrit
néanmoins le mieux la situation.
Seeger l’avait déjà dit dans les années 1980 : le chant n’est pas une simple
illustration de la vie sociale, il en fait partie. Il nous semble que la manière dont les
chants influencent la vie sociale n'est pas explicitée dans la pensée ayoreo, en
revanche, les traits narratifs de chaque genre de chant, le sont. En nous appuyant
sur nos données de terrain, nous pouvons affirmer que l’influence des chants sur la
vie des Ayoreo n’est pas arbitraire. À partir du moment où les effets de ces chants
deviennent récurrents, il est alors possible de commencer à parler de l'existence
d'un « modèle social » et du chant comme un dispositif.
Les interprétations des chants sont assez homogènes, amenant l'oreille
étrangère à se méprendre. Un an après mon arrivée, j'ai pu commencer à aller audelà de la simplicité trompeuse de cette homogénéité. Il fut nécessaire d’apprendre
à bien écouter, ce qui impliquait d’abord l’étude de la langue pour pouvoir
déchiffrer les modulations de la voix lors des chants. En ce qui concerne le contenu
de ces chants, une certaine difficulté m'attendait. En effet, si le chanteur et le public
semblaient ressentir une certaine joie — se conformant ainsi à l'idée que le chant
est une source de contentement —, les chants pouvaient raconter des histoires
douloureuses : la tristesse d’un homme pour son frère décédé, la promesse d’une
vengeance guerrière ou la solitude d’une femme abandonnée par son mari.
Comment concilier cette ambivalence apparente, entre la tristesse de certains chants
et la joie attendue de la récitation de ces mêmes chants ? Il y a des genres définis
qui présentent des régularités narratives et stylistiques : des histoires d’amour triste,
14
�des expressions de joie, des déclarations de tristesse et de deuil, des visions
chamaniques, des rêves de rêveurs presque chamans, des provocations guerrières,
des jactances après la bataille et même des passages de la vie de Jésus.
La présence des chants dans la vie des Ayoreo est centrale, ils se réfèrent
constamment à ces répertoires. Après avoir passé un mois à Jesudi, communauté
située à 80 km au nord de Filadelfia, j’avais décidé de me rendre à la communauté
de Chaidi, située à environ 150 km. La première réaction des habitants de Jesudi a
été de me demander d’enregistrer leurs chants. Ils espéraient ainsi pouvoir recevoir
des échanges avec des compositions de Chaidi. Je suis devenu ainsi l'intermédiaire
entre ces deux communautés. À cette époque, je ne maîtrisais pas encore la langue,
mais j'avais déjà pu remarquer que les trois quarts des messages étaient des chants.
Avant le contact avec les Blancs, lorsque des sous-groupes de différentes bandes se
rencontraient en forêt, ils avaient l'habitude d'interpréter leur répertoire et
d'apprendre ainsi les compositions des uns et des autres. Le fait que ces chants
n’appartiennent pas au domaine de la parole puissante et interdite — celle qui peut
guérir mais aussi provoquer des maladies3 — contribue à cette libre circulation et à
leur perpétuation dans la mémoire. Un des points les plus importants est qu'aucun
de ces chants n'est de l'ordre de la fiction, ils se fondent tous sur des événements
vécus par les Ayoreo d'autrefois et d'aujourd'hui. Les chants, par leur statut
«
profane », permettent une certaine liberté d'interprétation et les Ayoreo continuent à
composer de nouveaux chants. C'est une mémoire orale qui est déployée tous les
soirs, autour du feu et avant le lever du soleil. Les différentes caractéristiques des
chants (la diversité des thèmes abordés, la « libre » circulation entre différentes
communautés, les phénomènes de création et de transmission des chants, leur
caractère véridique, etc.) nous amènent à penser qu'ils constituent un facteur
sociologique actif dans la reproduction de la société ayoreo.
Notre thèse fondamentale est que le chant joue un rôle sociologique dans
cette société. Nous montrerons que le chant constitue un dispositif lyrique qui
instaure une esthétique de la générosité et de l'apaisement des tensions inhérentes à
3
Ce sujet a été largement étudié par BÓRMIDA (1984), IDOYAGA-MOLINA (1979-1980), MASHNSHNEK
(1986-1987) et FISCHERMANN (1988), entre autres.
15
�toute société, autrement dit, une éthique sociale de la vie en commun. Nous
montrerons que cette esthétique se trouve à la base même de l’affectivité : en fait,
elle est médiatisée par celle-ci. La beauté des mots dépendra de l’intensité de l’état
affectif que les Ayoreo définissent comme identitaire : sentir l’absence de
quelqu’un — il s’agit toujours d’un individu spécifique. Les traits qui caractérisent
ceux dont l'absence mérite d'être remarquée, constituent le premier maillon d’une
chaîne allant de la beauté de certains mots jusqu’aux comportements renforcés,
dans le but de construire une vie sociale quotidienne.
Dans la première partie de la thèse, nous allons examiner la complexité de la
parole puissante — celle qui peut guérir ou nuire — à travers la bibliographie et
nos observations sur le terrain. Ensuite, nous nous concentrerons sur la parole
humaine — des histoires et des chants qui n'ont pas d'agence4 sur le monde, qui ne
produisent pas d’effets sur la réalité. Dans cette partie, nous verrons la parole en
elle-même et l’importance que les Ayoreo lui attribuent.
La deuxième partie s'attarde sur le rôle que les chants jouent dans la vie
sociale de Jesudi. Nous décrirons d’abord les rapports sociaux des Ayoreo à partir
de notre enquête entre 2008 et 20115. Nous allons les décrire minutieusement, dans
le but de mettre en évidence des « régularités variables » de la vie quotidienne.
Autrement dit, nous ne pourrons trouver ni dans leurs pratiques ni dans leur
discours des règles strictes de comportements, au sens abstrait d’une grammaire
sociale. Nous ne trouverons pas non plus d’histoires uniques ni de comportements
isolés — qui relèveraient plutôt de l’ordre anecdotique. Nous ne pouvons pas nous
permettre d'affirmer que certaines régularités tiennent exclusivement de notre
observation, ce sont les chants qui nous ont permis de mettre en relation les
données hétérogènes de la vie des individus constituant la communauté de Jesudi.
Nous verrons que les chants accomplissent une fonction similaire pour les Ayoreo.
De plus, nous analyserons la vie sociale de Jesudi et ses effets sur la distribution de
4 Au
sens de l'anglais « agency ».
5
Nous avons fait un terrain chez les Ayoreo d'environ un an et demi au total. Nous sommes resté cinq
mois en 2008, huit mois en 2009 (deux séjours de trois mois et un séjour de deux), deux mois en 2010 et
trois mois en 2011.
16
�ses habitants sur le territoire. Depuis sa fondation à la fin des années 1980 et
jusqu’en 2011, trois communautés se sont formées à partir de Jesudi. Nous verrons
que tout ce qui empêche, permet ou même encourage la migration, se joue dans la
vie quotidienne. C’est tout cela qui contribue à l’établissement d’une convivialité
(au sens de « conviviality » selon Overing et Passes 2000).
Dans la troisième partie, nous examinerons la transmission des chants entre
Ayoreo de diverses communautés par le biais de cassettes. Ainsi, cela nous
permettra de voir la manière dont les Ayoreo parlent entre eux malgré la distance
qui les sépare — des centaines de kilomètres parfois —, et de percevoir comment
ils traitent ces chants comme objets 6. Il nous faudra analyser le rapport entre le
chant et l’événement qu’il raconte, pour élucider la valeur que le chant possède en
tant qu’objet immatériel, objet envoyé aux parents et aux amis des communautés
éloignées. Nous verrons comment les chants pris comme cadeaux servent à tisser et
à renforcer des rapports économiques et affectifs — autrement dit, des rapports
sociaux.
Finalement, les Ayoreo insistent toujours sur la beauté des chants, mais il
s’agit d’une beauté qui ne répond pas nécessairement à l’idée d’une esthétique
abstraite. Il s’agit d’une esthétique liée à une pragmatique du vivre-ensemble qui
traverse tout le répertoire des chants. Des histoires personnelles, des émotions, des
mots, l’esthétique et l’économie sont imbriquées dans les chants profanes des
Ayoreo du Chaco boréal.
6
J'ai appris la langue sur le terrain avec l'aide des Ayoreo et du dictionnaire des New Tribes Mission
(HIGHAM et al. 2000). Grâce à l'immense patience et insistance des gens de Jesudi, j'ai pu maîtriser la
langue au point de mener des conversations quotidiennes avec fluidité. Après avoir passé dix mois dans
cette communauté, j'ai commencé à comprendre les paroles de quelques chants. Ce fut le moment où j'ai
pu voir à travers la « simplicité trompeuse » des Ayoreo et j'ai compris qu'une profonde complexité
m'était cachée. La plupart des chants — irade, uñacai, yasitigai et versículo — ont été transcrits et
traduits avec l'aide de Jnumi Posijñoro. Sidi Posorajãi, Poro Posijñoro et Toto Étacori nous ont aidé avec
les chants de guerre et les visions de chaman. Aucun de ces connaisseurs de chants ne parle bien
l'espagnol, juste assez pour des transactions économiques. Ceux qui parlent un peu mieux l'espagnol à
Jesudi ne connaissent pas le signifié des mots ou ignorent les histoires qui sont à l'origine des chants. J'ai
voulu et dû travailler avec ceux qui s'intéressaient le plus aux chants anciens et actuels. Nous avons
toujours travaillé en langue ayoreo : avec des explications dans la même langue, des expressions
similaires et des exemplifications, j'ai pu comprendre le signifié des mots et des expressions. Quand cela
était possible, on cherchait des expressions équivalentes dans les chants que l'on avait déjà analysés.
17
�CHAPITRE I
PRÉSENTATION DES AYOREO ET DE JESUDI
I.1. L’environnement
(http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco)
Le Gran Chaco7 est une large plaine, située géographiquement au centre de
l’Amérique du Sud, qui s’étend sur les territoires de la Bolivie, du Paraguay et de
l’Argentine. Les limites de cette grande aire de 1 000 000 km2 sont constituées au
nord par les élévations qui se détachent du plateau du Matto Grosso, au sud par le
bassin du fleuve Salado, à l’ouest par les débuts des montagnes subandines et à
l’est par les fleuves Paraguay et Paraná. Le Chaco est divisé en trois sous-régions :
le Chaco boréal au nord du fleuve Pilcomayo, le Chaco central entre les fleuves
7
Selon l’œuvre de Pedro LOZANO, Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba (1733),
l’étymologie du nom Chaco est la suivante : « La etimología de este nombre, Chaco, indica la
multitud de las naciones que pueblan esta región. Cuando salen a cazar los indios y juntan de varias
partes vicuñas y guanacos, aquella muchedumbre junta se llama Chacu, en lengua quichua que es la
general del Perú, y por ser multitud de naciones las que habitan las tierras referidas, les llamaron a
semejanza de aquella junta, Chacu, que los Españoles han corrompido en Chaco » (1941 [1733] :
17).
18
�Pilcomayo et Bermejo, le Chaco austral au sud du fleuve Bermejo8. Le Gran Chaco
peut être aussi divisé suivant la pluviométrie, en trois sous-régions : le Chaco
humide dans la partie orientale, le Chaco central et le Chaco sec dans la partie
occidentale.
Le territoire des Ayoreo se trouve dans la partie boréale et sèche du Gran
Chaco. L’extension attribuée au territoire ayoreo varie sensiblement selon les
auteurs. D’après Bórmida et Califano, leur territoire s’étendrait entre les parallèles
de 16º et 22º de latitude sud et les méridiens de 58º et 63º de longitude ouest,
délimitant ainsi une surface de 333 000 km2. Selon Bugos, l’extension serait
d’environ 250 000 km2, délimitée par les fleuves Grande à l’ouest et Paraguay à
l’est, la mission Ascension de Guarayos en Bolivie au nord et la colonie mennonite
Filadelfia au sud.
Du point de vue géographique, le pays des Ayoreo est un cas typique
d’arrière-pays ou hinterland : on ne trouve pas de voies naturelles de
communication, telles que des fleuves ou des chaînes de lacs. Les grands fleuves de
la région se trouvent en effet aux confins du territoire ayoreo. Les fleuves Parapetí
et Grande de Santa Cruz à Bolivia — limites occidentales du territoire — sont
rarement fréquentés par les Ayoreo et ne sont presque jamais traversés. Le fleuve
Paraguay était traditionnellement inconnu des Ayoreo septentrionaux, mais il est
possible que des groupes se soient rapprochés de temps en temps de la rive
occidentale (Bórmida et Califano 1978 : 13).
Les fleuves les plus importants du Chaco, le Pilcomayo et le Bermejo, se
trouvent bien au sud, en dehors du territoire ayoreo. Ils naissent dans les Andes et
se jettent dans les fleuves Paraguay et Paraná après avoir traversé le Chaco. En
définitive, il s’agit d’un pays sans eau où la survie n’est possible que grâce à
l’existence temporaire de quelques marécages et réservoirs d’eau pendant la saison
des pluies. Dans la région aux alentours de Filadelfia, il est habituel de faire
8
Les informations sur la description de la géographie et l’environnement du Chaco ont été
empruntées à MÉTRAUX (1963), BÓRMIDA et CALIFANO (1978), FISCHERMANN (1988), BUGOS
(1985) et TOLA et al. (2013).
19
�construire des tajamares. Un tajamar est un grand réservoir creusé avec une
excavatrice sur chenilles, de dimensions variables (celui de Jesudi mesure 15 m sur
40 m) qui sert à recueillir l’eau de pluie. S’il ne reste plus d’eau à cause de la
sécheresse, le gouvernement de Filadelfia envoie des camions citernes qui
remplissent des réservoirs en briques bâtis à Jesudi.
Le Chaco constitue une immense plaine qui descend légèrement depuis les
élévations du nord vers le sud et vers l’est, jusqu’au fleuve Paraguay. Il y a très peu
de chaînes de montagnes comme celle du Cerro León et, généralement, les
élévations sont des unités isolées comme celle du Cerro San Ramón (780 m). Il n’y
a pas de pierres dans la plupart de son extension. Le sol est un loess, généralement
sableux et salin. Aux abords de la frontière entre le Paraguay et la Bolivie se
trouvent les salines de Santiago, San José et San Miguel, qui étaient, selon
Fischermann (1988 : 66)9 , le centre du territoire pour les Ayoreo. Le sol est
composé d'un grain tellement fin que des marais secs — talcales — se forment sur
les chemins qui relient les fermes. Parfois, les camionnettes ne peuvent pas en
sortir. Quand il pleut, aucun véhicule ne peut circuler dans la boue, à l'exception
des tracteurs à quatre roues motrices.
Le climat du Gran Chaco est tropical, avec une saison sèche. Les
précipitations moyennes annuelles s’élèvent à 600 mm à l’ouest et 1 200 mm à
l’est. La température moyenne varie entre 27 ºC et 30 ºC, mais elle s’élève jusqu’à
45 ºC pendant les mois d’été. La moyenne de la température minimale varie entre
12 ºC et 16 ºC. Le Chaco boréal a une moyenne annuelle de précipitations très
basse et une température très élevée, accentuée par les caractéristiques
continentales de la région. Il faut souligner que la zone, aux alentours de la
frontière entre le Paraguay et la Bolivie, est celle qui a la moyenne la plus élevée de
température et le minimum de précipitations du continent sud-américain (Bórmida
et Califano 1978 : 15). Le contraste entre les deux saisons est très marqué dans le
Chaco boréal. La saison sèche s’étend de mai à novembre et la saison des pluies va
de décembre à avril. Pendant cette période, les pluies sont abondantes et tombent
9
Nous n’avons pas la thèse originelle mais la version inédite en espagnol que son auteur nous a
envoyée. Les numéros de page correspondent à cette version.
20
�sous forme d’averses. Lors de la saison sèche, le vent chaud du nord et le vent froid
du sud s’alternent. Quand c’est le vent froid du sud qui souffle, la température peut
brutalement tomber à quelques degrés à peine au-dessus de 0 °C, ou même moins.
Le Gran Chaco est constitué de steppes halophytes, de végétation
hydrophyte dans les zones inondables, de palmaires et de savanes édaphiques ou
bien produites par déforestation (cf. Cabrera et Wilink 1980 ; Ginzburg et Adámoli
2006). Les principales communautés végétales d'arbres sont les quebrachales
(constitués de Schinopsis lorentzii, S. balansae et Aspidosperma, quebracho
blanco), les algarrobales (constitués de diverses espèces du genre Prosopis), les
chañarales (constitués de Geoffroea decorticans), les mistolares (constitués de
Ziziphus mistol) et les duraznillares (constitués de Ruprechtia triflora). Il y a plus
de 3 400 espèces de plantes, dont 400 endémiques.
La végétation du Chaco boréal est typique d’une région sèche. La « forêt »
du Chaco n'est pas une forêt, du moins selon la définition de la forêt amazonienne.
Il s'agit d'un monte, terme en espagnol qui désigne une aire de forêts xérophiles et
de brousse impénétrable. Les espèces principales sont des broméliacées et des
arbustes avec beaucoup d’épines. La forêt est constituée d’espèces comme le
Schinopsis cornuta (quebracho), Astronium urundeva, Bulnesia Sarmientoi (palo
santo), Chorisia ventricosa (samu’u ou palo borracho) et d’une grande quantité de
cactées. Il est difficile de marcher dans le monte à la vitesse des Ayoreo. Je reste
derrière, retenu par les arbustes et les épines, tandis qu’ils s’éloignent à travers la
brousse. La forêt est basse mais très dense, parfois il n’est pas aisé de savoir où est
le soleil ou dans quelle direction se trouve l'est. Les Ayoreo savent s'orienter et
leurs chiens ont la capacité de trouver les tanières où les tatous et les tortues se
cachent et de détecter des pécaris ou d'autres proies.
La faune du Gran Chaco présente une grande diversité : des félins, tels que
le chat de Geoffroy (Oncifelis geoffroyii), le jaguar (Panthera onca) et le puma
(Puma concolor) ; des édentés, tels que le tamanoir (Myrmecophaga tridactyla) et
diverses espèces de tatous (Chaetophractus villosus, Dasypus sp., entre autres) ;
trois types de suidés (Pecari tajacu, Tayassu pecari et Catagounus wagneri) ;
21
�diverses espèces d'oiseaux tels que le nandou d'Amérique (Rhea americana), la
grande aigrette (Egretta alba), la cigogne maguari (Ciconia maguari), parmi
beaucoup d'autres. Quelques reptiles caractéristiques de la région sont : le serpent
yarará (Bothrops sp.), le serpent corail (Micrurus corallinus), le crotale cascabelle
(Crotalus durissus), le yacaré ou caïman (Caiman latirostris chacoensis et le
Caiman crocodilus yacare) et le tégu commun (Tupinambis teguixin). Il y a aussi de
nombreuses espèces d'amphibiens et d’invertébrés (cf. Canevari et Balboa 2003 ; Di
Giacomo et Krapovickas 2005 ; Canevari et Vaccaro 2007 ; Medrano et al. 2011).
I.2. La langue et la population
Les indiens du Gran Chaco, dont la population compte près de 250 000
individus, parlent dix-huit langues classées en six familles linguistiques : 1.
guaycurú (toba, pilagá et mocovi) ; 2. mataco-mataguaya (wichí, nivaklé/chulupí,
chorote et maká) ; 3. tupi-guaraní (chiriguano, tapiete et mbya) ; 4. lengua-maskoy
(enxet/lengua, sanapaná, enenxet/toba maskoy, angaité et kashika) ; 5. zamuco
(chamacoco et ayoreo) ; et, 6. lule-vilela (vilela/chunupi) (Messineo et al. 2010).
La langue ayoreo appartient à la famille linguistique zamuco (Klein et Stark
1977, Susnik 1963). Cette famille comprend deux langues : l’ayoreo et le
chamacoco. Or, selon Bertinetto, Ciucci et Pia (2007-2008), le lien génétique entre
l’ayoreo et le chamacoco ne peut pas encore être confirmé, en raison du manque de
données sur la deuxième langue. Ces auteurs remarquent les particularités de cette
langue à la différence de celles des régions situées aux bords du Chaco, comme
celles de l’Amazonie et les langues tupies. Du point de vue typologique, la langue
ayoreo n’a pas les traits typiques des langues amazoniennes décrites par Dixon et
Aikhenvald (1999) et elle ne rappelle pas non plus les langues agglutinantes, telles
que le guarani ou les langues tupies en général (Bertinetto, Ciucci et Pia
2007-2008 : 13).
Selon Klein et Stark (1977), le diagnostic de survie de la langue était
excellent au moment de leur enquête. Il restait beaucoup de groupes habitant la
22
�forêt — donc monolingues — et ceux qui étaient à Faro Moro (mission des New
Tribes Mission) et à María Auxiliadora (mission salésienne) avaient appris très peu
de mots en espagnol — en raison du contact avec les mennonites. Lors de notre
terrain, plus de 30 ans après, nous pouvons dire que, heureusement, la situation de
la langue n’a pas beaucoup changé au Paraguay. Il ne reste que deux ou trois
groupes isolés dans la forêt, le reste habite dans des communautés rurales ayoreo.
D’après Pier Marco Bertinetto (2009), tous les Ayoreo parlent leur langue avec
fluidité, mais ce chercheur remarque que des mots anciens de leur culture
traditionnelle commencent à ne plus être utilisés et à se perdre. Même si ce n’est
pas notre spécialité et que nous n’avons pas mené d’enquête systématique, notre
impression à Jesudi est que — selon les indicateurs habituels — le degré de vitalité
de leur langue est très élevé : les enfants et la plupart des adultes sont monolingues.
Cependant, la plupart peut parler un peu d’espagnol pour des transactions
économiques. Quelques-uns, généralement ceux qui travaillent dans des fermes,
parlent un espagnol compréhensible mais pas vraiment maîtrisé. En ce qui concerne
l’éducation formelle au Paraguay, les écoles des communautés ont des enseignants
ayoreo mais il est difficile de dire si elles resteront ainsi ou si elles incluront
progressivement des professeurs non ayoreophones10.
Actuellement, la population des Ayoreo compte environ 5 000 individus,
dont la moitié se trouve en Bolivie et l’autre moitié au Paraguay 11. De nos jours,
quelques familles d’Ayoreo habitent dans la brousse, sans contact avec la société
nationale, bien que leur territoire rétrécisse à cause de la déforestation et de
l’établissement de fermes. Plusieurs ONG du Paraguay (Iniciativa Amotocodie,
UNAP, GAT, OPIT), de Bolivie (APCOB) et internationales (Survival
10
On nous a parlé en 2010 du projet d’une école secondaire dans la communauté ayoreo de Campo
Loro avec des professeurs paraguayens où les cours seraient donnés en espagnol, mais nous ignorons
l’état actuel de ce projet.
11
D’après le Censo Nacional Indígena de 2002, il y avait au Paraguay 2 007 Ayoreo. D’après
FISCHERMANN (1988, addendum 2000), il y avait 2 000 Ayoreo en Bolivie en 2000.
23
�International)12 luttent intensément pour l’autonomie des Ayoreo et la restitution de
leur territoire.
I.3. L’ethnohistoire des Zamucos
L’ethnohistoire des Zamucos, les ancêtres des Ayoreo, avait occupé à vrai
dire — à l’exception de José Perasso (1987) et Lussagnet (1961, 1962) — la place
de chapitre préliminaire des œuvres anthropologiques qui portaient sur les Ayoreo
ou sur les Chamacoco. Il y a bien eu des articles consacrés à des questions très
spécifiques (ex. : Kelm 1962 sur les ancêtres des Ayoreo) mais il a fallu attendre
jusqu'à ces dernières années pour qu’une recherche soit menée par un spécialiste en
la matière.
Dans son œuvre Zamucos (2009) de parution récente, l’ethno-historienne
Isabelle Combès se consacre à une étude minutieuse des sources écrites du Chaco
bolivien et paraguayen du XVIe au XXe siècle. L’auteure pose le problème des
origines des ancêtres des actuels Indiens ayoreo et yshir d’une manière beaucoup
plus stricte que ses prédécesseurs : Combès tire ses informations de nombreuses
sources inexplorées13 tout en restant prudente dans ses interprétations.
Une difficulté majeure se présente en ce qui concerne les sources. Une
quinzaine de dénominations différentes sont dispersées au cours de quatre siècles :
« le lecteur [des sources] est accablé par une avalanche de zatienos, cucutades,
ugaroños (…) » (ibid. : 10). Combès résiste à la tentation de ranger toutes ces
12
Au Paraguay : Gente, Ambiente y Territorio (GAT, avant Grupo de Apoyo a los Totobiegosode)
www.gat.org.py, Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) http://www.gat.org.py/gat/
opit.html, Iniciativa Amotocodie http://www.iniciativa-amotocodie.org/, Unión Nativos Ayoreos del
Paraguay (UNAP) http://www.iniciativa-amotocodie.org/unap/. En Bolivie : Apoyo Para el
Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) http://www.apcob.org.bo. Au niveau
international : Survival International www.survivalinternational.org/tribes/ayoreo
13
Dès le début, COMBÈS se différencie des autres chercheurs au sujet de la constitution de la base de
données. Elle souligne que les documents « dispersos entre Roma, Sucre, Buenos Aires, Río de
Janeiro, Madrid y unos cuantos lugares más (…) fueron muy poco consultadas por quienes se
interesaron a la historia de los grupos zamucos » (2009 : 11). Notre trad. : « [les documents]
dispersés à Rome, Sucre, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Madrid et d’autres endroits (…) ont été très
peu consultés par ceux qui se sont intéressés à l’histoire des groupes zamucos ».
24
�dénominations dans les catégories d’« ancêtre d’Ayoreo » ou d’« ancêtre d’Yshir »
et se consacre à la tâche minutieuse de suivre le parcours de chaque nom tout en
évitant de lui assigner la catégorie d’« ethnie ».
Un autre facteur a contribué, selon notre ethno-historienne, à ce manque
d’intérêt pour les origines des Ayoreo. Les Ayoreo, nous rappelle Combès, ont fait
leur apparition sur la scène publique dans les années 1940, ce qui a mené à leur
attribuer un isolement « séculaire, sinon millénaire » (ibid. : 11) qui ferait de la
quête de sources une tâche dépourvue de sens. La courte durée de la mission de San
Ignacio de Zamucos renforce l’idée de l’isolement. La seule mission qui a pu être
placée au cœur du Chaco boréal a dû être abandonnée par les Jésuites moins de 30
ans après sa fondation. C’est le mystère de sa localisation exacte et de « son brutal
abandon » (ibid. : 11), souligne Combès, qui a attiré l’attention des anthropologues
spécialisés dans les Ayoreo et leur a fait négliger le fait qu’il y avait plus de
Zamucos dans d’autres réductions qu’à San Ignacio. En effet, les données
recueillies dans les missions de Chiquitos permettent à Combès d’esquisser un
panorama régional des mouvements des anciens Zamucos.
La division chronologique du livre de Combès coïncide avec celle dégagée
par Villar, Combès et Lowrey (2009) de la lecture des classiques sur le Chaco.
D’après ces auteurs (2009 : 71-72), la bibliographie historique de la région permet
d’organiser l’histoire du contact du Chaco avec les sociétés coloniales en quatre
périodes : 1. la première phase, comprenant l’exploration du XVIe siècle et le début
du suivant ; 2. la phase des Jésuites, qui comprend la fin du XVIIe et le XVIIIe
siècle ; 3. la phase de colonisation, du XIXe siècle jusqu’à la Guerre du Chaco ; 4.
la phase moderne, de la Guerre du Chaco à aujourd’hui. Ces trois auteurs signalent
aussi que le Chaco, en ce qui concerne la richesse des sources ethno-historiques, se
situe à mi-chemin entre l’Amazonie — où l’on en trouve très peu — et les Andes —
où il est possible de reconstruire la vie avant l’arrivée des colonisateurs.
Le Chaco se présente déjà dans les chroniques du XVIe siècle comme un
territoire sauvage et hostile. L’intérêt, comme le remarque Métraux, était toujours
au-delà :
25
�Le Chaco n’était pas important en lui-même ; son rôle historique était dû au
fait qu’il était l’entrée vers les terres fabuleuses de l’ouest, d’où les Guaranis
recevaient des objets en or et en argent (Métraux 1946 : 199)14 .
Mapa 1. El Chaco boreal. Ubicación de los principales lugares mencionados
(Elaboración Nicolás
(Combès 2006 : 30)
Cette région n’était pas alors une destination mais un obstacle entre le
Paraguay et les montagnes d’argent des Andes. Après quelques échecs, l’expédition
de Domingo de Irala traverse le Chaco en 1548. Quand ils arrivent de l’autre côté
— en Bolivie —, ils éprouvent une grande déception : les Indiens leur parlent en
espagnol. En fait, la « sierra de plata » (« montagne d’argent ») est déjà exploitée
par les Espagnols venus de Lima. À partir de là, l’intérêt économique les fera se
14
« The Chaco in itself was unimportant; its historical role was due to the fact that it was the
gateway to the fabulous lands of the west from which the Guaraní received the silver and gold
objects (…) ».
26
�concentrer sur les histoires de Mojos ou le Grand Paititi, laissant de côté le Gran
Chaco. Ñuflo de Chavez fonde Santa Cruz de la Sierra en 1561, mais toute
l’information qui vient de cette ville porte plutôt sur l’Amazonie bolivienne que sur
le Chaco. Après ces essais du XVIe siècle, personne ne se risquera à l’intérieur du
Chaco. Les autorités de la région — les Jésuites de Chiquitos, l’administration de
Charcas et d’Asunción, et par la suite, les gouvernements du Paraguay et de la
Bolivie — resteront établies en marge de cette région. Les seules incursions ou
tentatives de s’y établir n’ont pas eu de succès : la mission de San Ignacio de
Zamucos (1724-1745) n’a duré que 21 ans ; au moment où le voyage de Sánchez
Labrador en 1766-1767 peut finalement établir un contact entre les missions du
Paraguay et de Chiquitos, les Jésuites sont expulsés de l’Amérique ; au XIXe siècle,
Cristian Suárez Arana — après de nombreux échecs du gouvernement bolivien —
ouvre un chemin entre Carumbei et Puerto Pacheco en 1887, mais la végétation du
Chaco le referme en cinq ans (Combès 2009 : 34-35). C’est pendant la troisième
décennie du XXe siècle que les militaires boliviens et paraguayens s’aventurent
finalement au cœur de l’enfer vert.
Le Chaco est resté alors ignoré et méprisé au long des siècles : sans légendes
lui attribuant de l’or ou de l’argent, il ne représentait pas une source d’intérêt pour
les gouvernements. Sa nature hostile a interdit aux colonisateurs d’entrer dans cet
enfer sans eau et plein d’épines. Or, il serait erroné d’attribuer un isolement éternel
aux Indiens qui y habitaient. Malgré les difficultés dans les sources, les ethnohistoriens Richard (2008) et Combès (2009) ont pu établir quelques faits
intéressants pour notre recherche. Notamment, le rapport entre les Indiens de
l’intérieur du Chaco et les sociétés indigènes de la périphérie, et le rôle décisif joué
par les missions dans l’histoire des Zamucos.
Le Chaco conformait, en quelque sorte, une barrière mais aussi, pour les
Indiens qui habitaient là et aux alentours, une voie de communication. Pour mieux
décrire cette double nature, Combès reprend la métaphore de Lowrey (2006) qui
définit le Chaco comme une mer intérieure sans eau (2006 : 29) : les Indiens
nomades du « Chaco adentro » seraient des pirates de la haute mer, et les
27
�agriculteurs sédentaires de la périphérie, des pêcheurs qui préfèrent la vie de la
côte, organisée et pleine de ressources 15. Le Chaco relie alors les Andes à
l’Amazonie en même temps qu’il les sépare : « Le Chaco est, et a toujours été, une
région d’échanges, d’influences réciproques et de mélanges » (2006 : 29)16.
Les Zamucos, selon Combès, sont restés isolés des Espagnols mais ont eu
des contacts fréquents avec d’autres groupes de la périphérie du Chaco. Ils
entretenaient avec ces derniers, affirme cette chercheuse, un type de rapport
hiérarchique appelé « dépendance socio-périphérique17 » : ils étaient la force de
travail occasionnelle des groupes d’agriculteurs de la périphérie. Cela expliquerait
la peur des Zamucos à l’égard des Chiquitos au XVIIIe siècle et aussi la probable
étymologie chiquitana du mot zamuco qui signifierait « chien ». Dans la pensée du
Chaco, le chien fait partie du social mais en même temps en reste écarté (Villar
2005, Richard 2008). Les missionnaires ont profité de ce type de rapports et les ont
accentués : ils profitaient de la bonne disposition des Chiquitos pour aller chercher
des Zamucos.
Contrairement aux mythes académiques qui soulignent l’isolement des
Ayoreo, Combès nous montre que les missions des Jésuites au XVIIIe siècle ont
profondément affecté l’histoire des groupes zamucos. L’espace des missions a
15
Cette métaphore a été reprise et développée par VILLAR, COMBÈS et LOWREY (2009). Elle est
proposée en double contraste avec les métaphores des autres régions des basses terres sudaméricaines : « La métaphore socio-écologique pour les Andes est ‘l’archipel vertical’ : les systèmes
de relations qui relient l’altiplano froid avec ses lamas et ses pommes de terre aux piémonts humides
et chauds avec son maïs et son fruit (MURRA 1975). La métaphore socio-écologique pour le bassin
amazonien est ‘le fleuve fractal’ : les systèmes de relations qui récursivement conçoivent l’aval
comme blanc et plein de biens manufacturés et l’amont comme indien et plein de la magie de la forêt
(GOW 1994). Une métaphore aquatique similaire pourrait être pensée pour le Chaco, même s’il
constitue une étendue plate et aride qui s’étend du piémont des Andes au bouclier brésilien. On
pourrait imaginer que la plaine est une mer intérieure sans eau, en même temps une barrière et un
moyen de communication. Les cultivateurs guaranis sur les marges seraient les peuples décents qui
habitent sur la côte, et les divers nomades de l’intérieur — spécialement une fois qu’ils ont adopté le
cheval — seraient les pirates imprévisibles de la haute mer. Cette voie d’eau sans eau a longtemps
relié les archipels des Andes aux fleuves fractaux amazoniens d’une certaine manière, et elle a aussi
agi comme un obstacle entre les deux d’une autre manière. (LOWREY 2006) » (VILLAR, COMBÈS et
LOWREY 2009 : 78)
16
« El Chaco es y siempre fue una región de intercambio, de influencias recíprocas y de
mezcla » (LOWREY 2006 : 29).
17
Cf. les travaux de SUSNIK (1969) et de RICHARD (2008).
28
�réorganisé le paysage ethnographique du Chaco boréal. L’histoire des missions du
Chaco boréal consiste en une série d’allers et retours de conflits entre les divers
groupes zamucos. C’est dans ce contexte que des alliances se sont formées et que
des hostilités se sont intensifiées. L’espace géographique et politique du Chaco
boréal fut alors largement modifié. La mission a servi de point de rassemblement à
des groupes divers qui parlaient des langues semblables. Ainsi, deux grands blocs
zamucos se sont formés : le « proto-Ayoreo » et le « proto-Chamacoco ». Le
premier a subi le plus l’influence des missionnaires. L’autre, par contre, comprend
les groupes zamucos qui sont restés à l’écart des missions, vers l’est. Cette
hypothèse de Combès nous explique les causes des continuités et discontinuités
entre les anciens Zamucos et les actuels Ayoreo et Yshir.
Combès ne limite pas ses recherches à la mission de San Ignacio de
Zamucos. Elle prend aussi en compte les missions des Chiquitos, situées plus au
nord. Pour les divers groupes zamucos, le temps passé en contact avec les Chiquitos
a eu sans doute un effet sociologique très important car c’est là, dans l’espace des
missions, qu’ils ont commencé à se percevoir en tant qu’unité ethnique :
C’est au creuset des missions, grâce à la vie commune et aux mariages, par
le biais de la comparaison entre les langues et les habitudes diverses des
groupes chiquitos, otuquis, et autres, que cette conscience a pu commencer à
surgir et à fleurir. Conscience d’une « nation » ayorea ou ishir, peut-être pas
encore, mais sûrement celle d’une « nation zamuca » […] (2009 : 89-90)18 .
Après l’expulsion des Jésuites, commence une période appelée « le long
XIXe siècle » — de 1768 à 1932 — par les historiens du Chaco et pendant laquelle
de nouvelles dénominations pour les groupes zamucos viennent s’ajouter. Vers la
fin de cette période, une tension croissante commence à se faire sentir entre la
18
« Es en el crisol de las misiones, mediante convivencia y matrimonios, mediante comparación
también con los idiomas y costumbres diferentes de los grupos chiquitos, otuquis y otros, que esta
consciencia pudo empezar a surgir y a florecer. Consciencia de una 'nación' ayorea o ishir, tal vez
todavía no, pero sí de una 'nación zamuca' ».
29
�Bolivie et le Paraguay. Ces deux pays se disputeront un territoire énorme : le Chaco
boréal.
D’autres auteurs (Perasso 1987 ; Susnik 1961, 1978 ; Lussagnet 1961, 1962 ;
Bernand-Muñoz, 1977 ; Fischermann 1988 ; Bartolomé 2000) ont bien évidemment
traité la question des contacts des Ayoreo avec les Espagnols et les Jésuites.
Cependant, il faut souligner que l’œuvre de Combès doit être mise à part. C’est la
première œuvre consacrée entièrement à l’analyse du devenir des groupes zamucos
dans toute la profondeur de la temporalité. Combès nous met face à la complexité
des groupes, de leurs alliances et leurs conflits, et nous oblige ainsi à penser les
Zamucos avec le dynamisme qui leur avait été refusé. Bref, elle leur restitue leur
historicité.
La chercheuse française rend à l’ethnohistoire des Zamucos toute sa
véritable complexité. Elle le fait à partir d’indispensables et claires précautions
méthodologiques. Elle n’attribue pas aux peuples zamucos une continuité immuable
de traditions, ce qui cadrerait très bien avec leur prétendu isolement. Elle nous
oblige de cette manière à nous écarter de l’image de peuples figés au long des
siècles. Bien au contraire, elle part de la prémisse — et Edgardo Cordeu, spécialiste
des Chamacocos, le signale aussi dans la préface — que tous les peuples ont une
dynamique constante causée par des changements internes ou externes. Bref, que
tous les peuples ont une historicité. Par ailleurs, Combès fait beaucoup plus que
prendre les sources pour en tirer une description des Ayoreo au XVIIIe siècle19 . Elle
les interroge, les lit entre les lignes et nous indique ce que l’on peut déduire à partir
des données, mais aussi — et, différence capitale par rapport à ses prédécesseurs —
ce que l’on ne peut pas en déduire. Trop souvent les chercheurs ont attribué une
identité « simplement à partir d’une homonymie » (Combès 2009 : 24).
19
Voyons par exemple l'utilisation des sources par Miguel BARTOLOMÉ : « Si me he permitido
reproducir este texto con la extensión que merece [après avoir cité J. FERNÁNDEZ, 1726 : 90-92], es
porque se trata de la primera descripción etnográfica del pueblo ayoreo. » (BARTOLOMÉ 2000 : 76)
30
�I.4. La vie dans le monte
L'année avait deux saisons : la saison sèche esoi, de mai à septembre, et la
saison des pluies siquere, de septembre à avril. Pendant la saison sèche, les Ayoreo,
avant le contact, étaient dispersés tout au long du territoire en bandes conformées
par une famille étendue. À cette époque, ils pratiquaient surtout la chasse et la
cueillette. Ce style de vie ne leur permettait pas d’avoir beaucoup d'enfants, raison
pour laquelle ils pratiquaient l'infanticide et n’avaient en moyenne que deux
enfants. Le changement de saisons était marqué par la « Fête de l'oiseau », chugupe
poringai, dédiée à l'engoulevent (Caprimulgus parvulus) dont l’arrivée entraînait le
début de la saison des pluies. Asojna — l'engoulevent — était dans leur mythologie
une femme chamane très puissante qui était devenue un oiseau. Il s'agissait d'un
être très redouté par les Ayoreo. Une fois qu'Asojna déclenchait la saison des pluies,
le monde « s'ouvrait », selon la métaphore de Sebag (Bernand-Muñoz 1978 : 71),
c’est-à-dire que « la saison des interdictions » avait pris fin. On pouvait, pendant
cette période de permissions, raconter des histoires des origines, ce qui était interdit
pendant esoi. Rencontrer un engoulevent ou un lézard dans la forêt n'était pas
dangereux, alors que pendant la saison sèche, cela entraînait la mort de l'individu.
Siquere, la saison des pluies pendant laquelle ils pratiquaient l'horticulture était
aussi une époque de grande effervescence sociale. Les unités dispersées se
réunissaient dans un guidai — campement stable — et formaient une gague, ou
groupe local. La gague, pour Califano et Braunstein, n'était proprement pas une
unité politique, mais un rassemblement instable qui dépendait des alliances entre
les chefs des diverses sous-unités (1978-1979 : 94). La taille des gague était assez
variable (parfois, elles rassemblaient quelques familles étendues, voire même
beaucoup plus). Les gague étaient nommées à partir d'une caractéristique du
territoire : Garaigosode — « ceux du champ ouvert » —, Tiegosode — « ceux du
fleuve » — ; ou bien d'une anecdote : Totobiegosode — « ceux par où les pécaris
sont passés ». Parfois, il pouvait arriver que plusieurs gague s’unissent pour former
l'unité politique la plus grande des Ayoreo, le dukunire unehak, expression qui
aurait un sens géographique (Califano et Braunstein 1978-1979 : 95). Bugos décrit
aussi cette unité — il l'appelle « population block » — et établit qu'il s'agit de
31
�bandes dont les territoires sont contigus et qui sont liées par mariage (1985 : 134).
Les Ayoreo de Jesudi, avec lesquels nous avons travaillé, identifiaient deux de ces
grandes unités en rapport étroit avec le territoire : les Direquedejnaigosode
constitueraient un rassemblement de bandes du côté de la Bolivie et les
Guidaigosode seraient une union de plusieurs bandes du côté paraguayen, avec la
notable exception des Totobiegosode. Ces alliances étaient surtout d'ordre
stratégique et permettaient aux Ayoreo de mieux défendre leur territoire. Les
attaques entre bandes étaient fréquentes. Il y avait une grande valeur accordée au
courage : seuls ceux qui avaient tué un jaguar ou un être humain avaient le droit de
porter le chapeau de peau de jaguar, certains bijoux de plumes et d'avoir le titre
d'asuté. L'asuté le plus célèbre était sans aucun doute Uejai Picanerai. Plusieurs
Ayoreo de Jesudi parlaient de lui avec beaucoup d'admiration. La polygamie était
très rare chez les Ayoreo, car il fallait pouvoir subvenir aux besoins de deux
femmes. Uejai avait quatre épouses, c’était un grand guerrier qui, de plus, était
chaman. La guerre se présente comme une toile de fonds de la vie des Ayoreo avant
le contact. Quand ces Indiens parlent de la vie dans le monte, la menace d'une
attaque — généralement d'autres bandes ayoreo — semble être une circonstance
constante. En fait, nous verrons que les chants les plus anciens que nous avons
enregistrés gardent toujours une référence à des anecdotes de guerre.
I.5. Le XXe siècle : le contact définitif
Vers la troisième décennie du XXe siècle, un événement bouleverse toute la
région : la Guerre du Chaco (1932-1935). Ce conflit éclata entre la Bolivie et le
Paraguay après des années de tension. La présence indigène dans ce conflit armé a
été laissée de côté — à vrai dire, rendue invisible — tant dans le récit historique
que dans le domaine anthropologique. Cette négation correspondait aux intérêts
d’occupation du territoire : elle a servi à cacher « la dimension colonisatrice de
cette guerre » (Richard 2008 : 9).
32
�L’espace et la culture des Ayoreo ont été logiquement affectés. En ce qui
concerne leur territoire, même si les batailles principales n’ont pas eu lieu
exactement là, la présence des troupes aux points d’eau et le tracé de voies de
communication et de chemins à travers la forêt ont provoqué des changements dans
leur mobilité habituelle qui fut alors drastiquement réduite (Von Bremen 2008 :
344). Quant à leur culture matérielle, cette guerre a laissé du fer sous la forme de
restes de voitures et d’armement. Cette matière — qu’ils connaissaient depuis le
temps des Jésuites — a été employée pour faire des outils et des armes dans une
telle proportion que la confection des instruments traditionnels a été presque
abandonnée (Fischermann 1988 : 91-92). Ce conflit a ouvert les portes du Chaco à
ceux qui ne cherchaient pas de l’argent, mais du pétrole, des terres et des âmes
infidèles.
Après la Guerre du Chaco, de nouvelles présences étrangères et des tensions
internes ont contribué, au fil des ans, à exercer une pression sur les groupes seminomades ayoreo. La combinaison de divers facteurs a précipité leur sortie de la
forêt et le contact avec les Occidentaux dans les décennies suivantes : les
prospections de pétrole dans la région du Cerro León, les tentatives répétées de
contact de la part des mennonites — qui s’étaient établis plus au sud dans les
années 1920 — et les hostilités entre les groupes ayoreo. Ces hostilités sont allées
jusqu’à provoquer une réorganisation politique : le grand leader Uejai Picanerai
rassemble les groupes du sud (du côté du Paraguay) contre les groupes du nord (du
côté de la Bolivie). Les premières tentatives de contact ont eu des résultats
tragiques pour les missionnaires américains en Bolivie (Dye Johnson 1969) et les
mennonites au Paraguay (Hein 1988).
Le premier contact pacifique a eu lieu en Bolivie en 1947 avec les
missionnaires de la New Tribes Mission. En 1950, ils ont établi la mission de
Tobité. Au Paraguay, il y a eu deux axes de pénétration des missionnaires. Les
Salésiens et les New Tribes Mission menaient une sorte de compétition pour la
conversion des âmes (Perasso 1987). D’un côté, les Salésiens ont fait sortir de la
forêt un groupe local ayoreo de Garaigosode en 1962, et ils ont fondé l’année
33
�suivante la Misión María Auxiliadora sur la côte du fleuve Paraguay, au-delà du
territoire traditionnel des Ayoreo. De l’autre côté, les New Tribes Mission ont pu
rassembler en 1966 des Ayoreo du groupe local de Guidaigosode aux alentours du
Cerro León20. Après quelques déplacements, ces derniers se sont définitivement
installés à Campo Loro, à 50 km au nord de Filadelfia. Comme l’ont déjà remarqué
Miguel Bartolomé (2000) et Bernd Fischermann (1988), les Ayoreo ont subi un
déclin démographique dramatique lors des premiers contacts. Ils n’avaient, en effet,
aucune défense contre les maladies de l’homme blanc, notamment la grippe et la
rougeole.
En 1956, Bajai Posorajãi21 , un Ayoreo d’une dizaine d’années, fut capturé
par deux paysans paraguayens. Littéralement, il fut attrapé avec une corde comme
un animal. La réputation de férocité des Indiens moro — nom utilisé par les
Paraguayens pour désigner les Ayoreo — était déjà bien établie. L’enfant sauvage
fut emmené à Asunción où il fut exhibé comme un animal (Perasso 1987). Le
Salésien Pietro Dotto a demandé à en avoir la garde et l’a emmené à la Misión
María Auxiliadora. À partir de ce moment-là, il a commencé à accompagner toutes
les expéditions à la recherche d’Ayoreo pour les convaincre de sortir de la forêt et
de s’installer dans les missions salésiennes. Son rôle, dans ce chapitre de l’histoire
des contacts, a été fondamental (Bartolomé 2000 : 187) et, en guise de
remerciement, le gouvernement paraguayen a commencé, depuis quelques années, à
lui verser une retraite mensuelle.
Entre les années 1960 et 1980 les sorties n’étaient pas définitives. Parfois,
les Ayoreo, mécontents de la vie dans les missions, retournaient dans la forêt et
reprenaient leur vie comme avant le contact. Quelques mois ou quelques années
après, ils en ressortaient, poussés par les circonstances déjà décrites. Peu à peu, ils
20
Après avoir subi les attaques des Ayoreo et vainement essayé un contact pacifique qui a eu des
conséquences mortelles, les mennonites ont appelé les New Tribes Mission pour faire sortir les
Ayoreo de la forêt (HEIN 1988).
21
Tous les noms des Ayoreo ont été remplacés par des pseudonymes — même dans les paroles des
chants — pour protéger leur intimité.
34
�sont restés davantage dans les missions et moins dans la forêt. Malgré tout,
quelques groupes isolés habitent encore aujourd’hui au Chaco boréal.
En 1986, un épisode tragique a eu lieu. Une avionnette des New Tribes
Mission a aperçu un campement d’Ayoreo non contactés à une trentaine de
kilomètres au nord de Campo Loro, la communauté ayoreo régie par les
missionnaires américains. Après avoir écouté les observations du pilote, les Ayoreo
convertis au christianisme ont décidé de partir tout de suite pour leur apporter la
parole de Dupade (Dieu). Les « missionnaires ayoreo » étaient Guidaigosode, et les
« infidèles » Totobiegosode, deux bandes ennemies depuis longtemps. Cinq
Guidaigosode sont morts avant que les Totobiegosode ne fassent confiance à leur
promesse de paix. Cet événement a suscité de nombreuses réactions et
questionnements sur les méthodes agressives et fanatiques des missions des New
Tribes Mission, mais finalement rien n’a changé. Une partie des Totobiegosode est
sortie et est restée à Campo Loro, l’autre s’est enfuie dans la brousse.
En 1996 et 2004, deux groupes de Totobiegosode sont sortis de la forêt. Une
famille de deux adultes avec ses cinq enfants 22 est sortie en 1996. En 2004, c’est un
groupe plus nombreux : dix-sept personnes, dont la plupart faisaient partie de ceux
qui, en 1986, avaient regagné la forêt. Selon les déclarations de ces derniers,
installés à Chaidi, au moins neuf personnes restent en isolement dans la forêt. De
temps en temps, quelques indices font penser aux habitants de Jesudi que les
Totobiegosode — nus, féroces mais pas anthropophages — ne sont pas loin et une
sorte de paranoïa se répand dans la communauté. Les Ayoreo de Jesudi ont peur de
ces « sauvages ».
À partir de la vie dans les missions depuis 1960, les Ayoreo ont expérimenté
un processus de sédentarisation progressive. Cependant, ce processus n’a pas fait
disparaître la mobilité. Fischermann (1988 : 23) met en relief que ce trait de la vie
ayoreo persiste dans la pratique habituelle de déplacements de familles d’une
communauté à l’autre. C’est aussi un mécanisme pour alléger les tensions sociales
22
Le couple était composé d’un frère et une sœur qui, isolés des autres groupes, avaient dû se marier.
35
�et résoudre des conflits. Si la personne qui part avec sa famille étendue a une bonne
capacité de gestion, elle peut même fonder une nouvelle communauté.
I.6. Histoire de Jesudi
Les Ayoreo avec lesquels nous avons travaillé appartiennent à la bande
garaigosode qui habitait dans la zone de Chovoreca, dans le nord du Chaco
paraguayen. La génération la plus âgée de Jesudi appartient au groupe des Ayoreo
qui sont sortis de la forêt au cours des années 1960 et qui sont entrés en contact
avec les missionnaires salésiens par l’intermédiaire de Bajai Posorajãi.
Ils ont vécu dans la Misión María Auxiliadora jusqu'en 1980, moment où les
inondations répétées du fleuve Paraguay les ont fait partir et se disperser : « yote
quedejnai chayo ñoque aja quenejane » « le fleuve nous a fait courir dans diverses
directions »23 , disent Sijnai Chiquenoi et Ebedu Dosapei, entre autres (Maldonado
1997). Ils ont alors dû chercher du travail dans les colonies mennonites comme
Loma Plata et Filadelfia, où ils furent employés pour des tâches temporaires :
couper du bois pour l’usine électrique, arracher des arbres et des arbustes dans les
fermes, préparer des chemins, etc. Il n’était pas facile de trouver du travail en
raison de l’influence des missionnaires New Tribes Mission, qui rejetaient ces
Ayoreo catholiques (Rehnfeldt et Maldonado 1993 : 30 ; Bremen 1988 : 17).
En 1989, deux Ayoreo, Ebedu Dosapei et Usigai Chiquenoi, ont effectué des
démarches bureaucratiques à l’Instituto Del Indígena Paraguayo (INDI) pour
obtenir un lieu où s’établir. Il est important de souligner qu’aucune ONG n’a fait
ces démarches pour eux24 . L’organisme a trouvé un espace disponible à 70 km au
nord de Filadelfia. Ce terrain de 5 000 hectares a été donné aux Ayoreo en
23
D’autres versions considèrent aussi les conflits internes comme un facteur important de cette
migration, ce qui ne nous étonne pas du tout.
24
Ayant subi de tortueuses expériences dans les labyrinthes kafkaïens de la bureaucratie
paraguayenne et connaissant le peu d’importance que les Ayoreo accordent aux papiers écrits ou
signés, nous savons combien cette démarche menée par Usigai et Ebedu témoigne de leur fort désir
d’autonomie.
36
�septembre 198925. Quelques familles s’y sont installées — un total de 25 personnes
selon Ebedu (Maldonado 1997) — et ont décidé de le nommer « Jesudi », comme le
nom d’un village des Garaigosode établi avant le contact (Rehnfeldt et Maldonado
1993 : 31).
Nous sommes arrivés presque vingt ans après. Quelques familles installées
au moment de la fondation étaient parties et d’autres étaient arrivées. Quelques
années auparavant, Usigai était parti avec sa famille et avait fondé une autre
communauté à dix kilomètres au nord. Le chef de Jesudi était Ebedu Dosapei et il y
avait une certaine tension entre lui, Sijnai Chiquenoi et Bajai Posorajãi.
I.7 Les gens de Jesudi
Les lieux de naissance des diverses générations de Jesudi constituent une
synthèse des derniers chapitres de l’histoire de ce groupe. Jesudi est une
communauté composée d’une génération de personnes âgées et d’adultes nés dans
la forêt et contactés par les Blancs quand ils avaient entre 7 et 25 ans ; de leurs fils
et filles, nés dans les missions, à María Auxiliadora ou à Fortín Batista ; et,
finalement, des enfants et adolescents — petits-fils et petites-filles de la première
génération — nés à Jesudi.
Les membres de la deuxième génération étaient des enfants quand ils se sont
installés à Jesudi. La plupart d’entre eux se sont mariés à l’intérieur de cette
communauté. Étant donné que la résidence est uxorilocale, cette manière de se
marier a permis aux hommes de rester à Jesudi, tout en changeant de maison.
Quand nous sommes arrivé en 2008, les membres les plus âgés de la troisième
génération commençaient à former des couples.
Nous avons essayé de reconstituer les généalogies de la première génération
mais malheureusement nous n’avons pas pu aller plus loin que le nom des parents 26.
25
Selon Usigai, la date est le 18 septembre, selon Puchiejna Dosapei et d’autres, la fondation de
Jesudi a eu lieu le 15 septembre.
26
BUGOS signale aussi que la mémoire généalogique des Ayoreo est limitée : « It seems that lowland
South Americans are not avid genealogists. This is also generally true of the Ayoreo » (1985 : 221).
37
�Nous ne savons donc pas s’il existe des liens généalogiques entre les conjoints de
cette génération. Nous pouvons ajouter que, d’après Bugos (1985 : 207), le mariage
entre personnes liées généalogiquement est rare : sur 312 unions enregistrées — où
sont connus les quatre grands-parents de chaque conjoint —, il n’y a que 47 cas de
couples reliés à un certain degré.
La terminologie de parenté
La terminologie de parenté pour la génération d’ego est de type hawaïen. Il
existe, quand même, une distinction relative selon l’âge d’ego. Un ego masculin
appelle itigat27 son frère aîné, yisabi son frère cadet et inna toutes ses sœurs. Un
ego féminin, pour sa part, appelle itate sa sœur aînée et inna sa sœur cadette alors
qu’elle appelle yisabi tous ses frères. Selon Bugos (1985 : 155), ego appelle itigat
ou isabi ses cousins non selon leur âge relatif — ce qui était le cas dans notre
terrain à Jesudi —, mais selon l’âge relatif du père d’ego et de celui du cousin. On
peut signaler que, malgré la terminologie hawaïenne, les Ayoreo peuvent distinguer,
dans certains cas, les siblings des cousins en ajoutant le suffixe « –pise » qui est un
intensificateur (e.g. nennapise) 28.
Selon Bugos (1985 : 155-158), dans la première génération ascendante, le
père (F) est associé à son frère (FB), et la mère (M) à sa sœur (MZ), alors que la FZ
et le MB sont distingués des parents d’ego. On trouve la même chose dans la
première génération descendante : les enfants d’ego sont associés aux enfants de
siblings et cousins du même sexe qu’ego, alors qu’ils sont distingués des enfants de
siblings et cousins de sexe différent d’ego.
En ce qui concerne les unions matrimoniales, pour la plupart des auteurs, il
ne semble pas y avoir de mariages préférentiels (Bernand-Muñoz 1970 : 204) ou
bien il y aurait une seule norme, celle de l’exogamie clanique (Braunstein 1983 :
70). Ils n’épousent pas les cousins ni parallèles ni croisés, comportement auquel
Bugos (1985) consacre toute sa thèse et qu’il explique dans une perspective
27
Tous les termes sont présentés, sauf indication contraire, avec le préfixe possessif de 1re personne
du singulier.
28
N-enna-pise (poss-sœur-intens) « sa sœur (beaucoup) »
38
�évolutionniste et écologiste. Il y avait très peu cas de polygamie : il s’agissait
généralement d’hommes exerçant une influence notable. Actuellement, un seul cas
se présente à Jesudi, celui de José Bajai, le premier Ayoreo capturé par les Blancs à
l’âge de dix ans et élevé par les Salésiens.
La terminologie d’affinité est un reflet, nous dit Bugos (1985 : 160), de celle
de consanguinité. Un homme associe son épouse (W) avec la sœur de celle-ci (WZ)
et l’épouse de son frère (BW). Une femme associe son mari (H) avec le frère de
celui-ci (HB) et le mari de sa sœur (ZH). Bugos en déduit que cette terminologie est
cohérente avec un système d’échange entre frères et sœurs qui, selon lui, serait le
type préféré de mariage chez les Ayoreo (cf. annexe IV).
Les clans des Ayoreo et des Chamacoco représentent une exception dans la
région du Chaco et les rapprochent des tribus de la région du Matto Grosso. Ces
clans patrilinéaires ne sont pas localisés et la seule fonction claire sur laquelle tous
les auteurs sont d’accord est celle de l’exogamie. Les Ayoreo utilisent les termes
igiosi (possessif-parent clanique masc. sing.) et igioto (possessif-parent clanique
fém. sing.) pour s’adresser aux parents claniques. Bugos (1985 : 146) est le seul
auteur signalant que les termes de consanguinité sont également employés avec les
parents claniques, ce qui correspond à nos données à Jesudi. Nous discuterons les
implications de cette terminologie dans la deuxième partie.
Il faut seulement ajouter deux détails. Premièrement, les Ayoreo n’ont pas,
comme la plupart des ethnies du Chaco, une terminologie de deuil (Braunstein
1983). Deuxièmement, ils emploient des teknonymes. Selon les auteurs consultés
(Fischermann 1988 ; Bernand-Muñoz 1977 ; Bórmida et Califano 1978),
l’attribution du teknonyme se fait à la naissance du premier enfant et du premier
petit-fils29 et on utilise exclusivement son nom. Or, nous avons trouvé à Jesudi des
exemples qui diffèrent légèrement : il y a des personnes portant des teknonymes qui
ne sont pas toujours issus à partir du même fils ou du même petit-fils.
29
On ajoute les suffixes –de (« père »), -date (« mère »), -daquide (« grand-père »), -dacode
(« grand- mère ») au nom de l’enfant.
39
�I.8. Les mennonites
Il est nécessaire, pour comprendre le paysage ethnographique du Chaco
paraguayen, de présenter un groupe établi dans l'enfer vert depuis les années 1920 :
les mennonites. Les mennonites constituent une branche religieuse des protestants,
fondée au XVIe siècle par Menno Simons. Ils sont très éparpillés dans le monde —
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Paraguay, au Brésil, etc. — à cause des
diverses persécutions dont ils ont souffert tout au long de leur histoire. La première
vague d'immigration au Paraguay a eu lieu en 192730 , dans le contexte de tensions
entre le Paraguay et la Bolivie pour la possession du Chaco. Les mennonites ont été
les colonisateurs du Chaco paraguayen. Ils ont installé des fermes et des
coopératives et leur présence se fait sentir dans la région. Les mennonites ont
essayé à plusieurs reprises d’établir des contacts pacifiques avec les Ayoreo, sans
aucun succès. Après le tragique décès de Kornelius Isaak en 1958 lors d'un premier
contact avec des Guidaigosode, les mennonites ont demandé l'aide des
missionnaires des New Tribes Mission qui avaient déjà pu établir des rapports avec
les Ayoreo en Bolivie.
Les mennonites accomplissent actuellement un rôle assez particulier dans la
vie des Indiens ou, plus particulièrement, dans la vie des Ayoreo. Ils occupent
parfois la place de l'État paraguayen qui est presque toujours absent. Par exemple,
ils ont proposé aux Ayoreo de produire du charbon de bois sur leur territoire. Ils
leur ont enseigné la technique et ont mis en place une sorte de couverture
médicale : un pourcentage du paiement est prélevé aux Ayoreo, ce qui leur donne le
droit de recevoir des soins médicaux à la clinique « indigène » des mennonites à
Filadelfia. Cette production a été une source importante de revenus lors de notre
terrain en 2008 et 2009. Comme le charbon était payé au poids, cela leur permettait
d'avoir des résultats tangibles qui étaient en plus proportionnels au travail effectué.
Certains Ayoreo, visiblement enthousiasmés à l'idée d'augmenter la production,
30
Plusieurs vagues d'immigration mennonite ont eu lieu dans les décennies qui suivirent, issues surtout de
Russie, du Canada et du Mexique. Actuellement, la population de mennonites au Paraguay est de plus de
80 000 individus, dont la plupart habite au Chaco. La composition de la population du Chaco paraguayen
est la suivante : 52 % d’indigènes, 32 % de mennonites, 11 % de Paraguayens, 5 % d’Argentins et de
descendants de Brésiliens (Asociación de Servicios de Cooperación Indígena-Mennonita 2013).
40
�avaient acheté des tronçonneuses31. La plupart des propriétaires de fermes dans les
régions de Jesudi et de Filadelfia sont mennonites. Filadelfia est un point de repère
pour les Ayoreo : ils peuvent recevoir des services de santé, trouver du travail, faire
les courses au grand supermarché de la coopérative mennonite, contacter des ONG
(les sièges de quatre organisations qui travaillent avec les Ayoreo y sont présentes)
et faire des demandes à la mairie. Cette petite ville de 9 000 habitants est le cœur
administratif et économique du Chaco. L'architecture des maisons et le dessin
ouvert et orthogonal des rues sont celles d'une ville mennonite. Même les publicités
dans la rue sont rédigées en allemand, guarani et espagnol.
Famille de Kornelius Isaak et Jonoine, l'Ayoreo qui l'avait tué en 1958
(Hein 1988 : 199)
31
En 2008, presque toutes les communautés du département de Boquerón produisaient du charbon.
À la suite de conflits de la coopérative mennonite avec certaines ONG, la production s’est arrêtée en
2010. Vers la fin 2011, quelques communautés avaient recommencé la production.
41
�I.9. À Jesudi
Nous présenterons ici un bref aperçu de Jesudi et de « 15 de Septiembre »,
les deux communautés où nous avons mené la totalité de notre terrain.
La communauté ayoreo de Jesudi se trouve à environ 70 km au nord de la
colonie mennonite de Filadelfia, dans le département de Boquerón au Chaco
paraguayen.
(Bartolomé 2000 : 206)
42
�Le chemin de terre qui passe devant Jesudi est la route qui délimite la
frontière entre les départements de Boquerón et d’Alto Paraguay. Tous les jours, des
camions transportant du bétail passent, pleins ou vides, ainsi que des mennonites
dans leurs camionnettes allant à leur ferme ou en revenant. La terre de ces chemins
est tellement fine que des talcales se forment (une sorte de marais sec de talc) et si
les précipitations sont abondantes, il est impossible de circuler, sauf pour des
tracteurs à quatre roues motrices. La communauté de 15 de Septiembre, établie en
mars 2010, se trouve à 6 km au nord de Jesudi et sa population est de 15 personnes.
C’est une sorte de satellite de Jesudi qui permet à ces deux communautés d’obtenir
plus de ressources et de se les partager.
Le territoire de Jesudi mesure 5 000 hectares et est entouré de fermes des
mennonites. « Km 17 » est un point d’arrêt des camions et des fermiers qui se
trouve à 5 km au sud de Jesudi. Il y a là trois magasins ruraux où les Ayoreo
achètent, à un prix plus élevé qu’à Filaldelfia, des provisions comme du riz, des
pâtes et, bien sûr, le délice du Chaco : du Coca-cola avec des biscuits. Les fruits et
légumes qui ne poussent pas sur place — ou bien seulement pendant la saison sèche
— sont achetés dans les magasins ambulants, macateros, des camionnettes remplies
de légumes qui parcourent le Chaco.
Au sud de Jesudi se trouvent les communautés d’Angaite de San Martin et
de Santo Domingo. Les Angaite ne parlent presque plus leur langue qu’ils ont
abandonnée pour le guarani. Avec les Ayoreo, ils parlent naturellement en espagnol.
Les Ayoreo les appellent docojo — « flèche » — pour se moquer de leur minceur.
Les Ayoreo échangent avec eux des tatous contre des jupes de couleurs vives,
typiques des indigènes dans cette région.
Les Angaite, les Ayoreo, les Paraguayens et les Brésiliens qui travaillent
dans des fermes, constituent une sorte de communauté non localisée. Leurs
membres se voient surtout lors des week-ends, pendant des matchs de volley et de
football. Des visiteurs arrivent à Jesudi de temps en temps, ou bien les gens se
43
�retrouvent éventuellement à Km 17. Des transactions économiques, des services,
des commérages tissent des liens entre ces individus d’origines diverses.
À Jesudi, à Santo Domingo, à Km 17, dans des fermes ou d’autres
communautés ayoreo plus éloignées, tous les week-ends des matchs de volleyball et
de football sont organisés. Qu’il s’agisse d’un tournoi ou d’un match amical, il faut
toujours parier. En fait, chez les Ayoreo, il n’y a pas de jeu — volleyball, football,
cartes — qui soit joué sans parier : même les enfants jouent à cache-cache pour des
pièces de monnaie. Regarder n’est pas gratuit non plus, et si on a parié pour un
match, il faut aussi le faire pour la revanche. L’organisation du travail par les
mennonites affecte la vie des Ayoreo : la semaine a cinq jours. De lundi à vendredi
on oublie parfois quel jour on est, mais le samedi et le dimanche sont marqués par
les matchs de football et de volleyball : soit on accueille des visiteurs, soit on va
jouer ailleurs.
Femmes ayoreo jouant au football (crédit : Alfonso Otaegui)
Aujourd’hui, l’activité économique principale des Ayoreo est le travail dans
les fermes. Les hommes déménagent à la ferme avec leur famille nucléaire pour des
périodes de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans un certain nombre de cas,
ils restent pratiquement toute l’année dans la ferme qui constitue ainsi une forme
44
�particulière de communauté dans le Chaco32 . La base alimentaire consiste à
consommer surtout des glucides (du riz et des pâtes) car la chasse est occasionnelle.
Ils vendent aux Paraguayens des sacs de caraguatá et différentes espèces
d’animaux — des araignées, des serpents, des grenouilles, etc. — que les
Paraguayens leur demandent à des fins diverses. De temps en temps, et surtout au
moment des élections, des dons de provisions arrivent de la part de l’État ou d’un
politicien.
À Jesudi, le moyen de locomotion est le tracteur, sauf, bien sûr, lors des
déplacements en forêt. C’est l’une des possessions les plus valorisées dans la
communauté. Plus de 40 personnes peuvent monter dans la remorque ouverte et
l’engin ne peut rouler qu’à une vitesse maximale de 40 km/h. Le tracteur accomplit
plusieurs fonctions. Il leur permet de voyager jusqu’à Km 1733 , des communautés
voisines et même jusqu’à Filadelfia. Étant donné que dans la forêt autour de Jesudi,
il reste peu d’animaux, de caraguatá et de poivre sauvage, ce véhicule est un
moyen pour se rendre dans des lieux disposant de ces ressources. Ils l’utilisent
aussi pour transporter du bois et du charbon qu’ils vendent aux mennonites. Comme
il n’y a pas beaucoup de communautés Ayoreo qui aient un tracteur, les gens de
Jesudi le louent.
I.10. Les Ayoreo dans la littérature ethnographique
Nous pouvons distinguer dans la littérature ethnographique au sujet de ce
groupe, au moins trois lignes principales de perspectives théoriques qui ont
documenté ses divers aspects. Cela ne comprend pas, bien sûr, la totalité de la
bibliographie34.
32
C’est le cas, par exemple, des estancias (fermes) « Helvetia » et « Boreal ».
33
C’est presque ironique : ils peuvent se promener pendant des heures dans la forêt aussi épaisse
qu’épineuse mais ils détestent marcher cinq ou six kilomètres sur le chemin ouvert pour aller à Km
17 ou à 15 de Septiembre.
34
Pour une liste exhaustive des œuvres concernant les Zamucos, les Ayoreo et les Chamacoco, cf.
FABRE (2012).
45
�Nous avons identifié trois approches de recherche qui correspondent à trois
perspectives théoriques venues de trois pays différents. La première est la
phénoménologie de Marcelo Bórmida et de ses élèves en Argentine ; la deuxième,
le structuralisme français de Lucien Sebag ; la troisième, une ethnographie
descriptive d’anthropologues allemands issus de l’Université de Bonn.
Marcelo Bórmida, ethnologue d’origine italienne, fut une figure dominante
dans l’anthropologie argentine des années 1970, et son influence s’est étendue
jusqu’au début des années 1990. Il a été le créateur d’un courant théorique, une
variante de la phénoménologie inspirée par une lecture très personnelle de Husserl.
Selon Bórmida (1976), la documentation d’une culture ne consistait pas à décrire
ses traits formels mais à la comprendre et à rendre compte de cette
herméneutique35 . Du point de vue méthodologique, cela impliquait que
l’observateur devait s’abstraire de toute conception théorique préalable et percevoir
directement les « contenus de conscience » de la culture en question.
Bórmida a fondé le Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA) où
ont été publiées les revues Scripta Ethnologica. Archivo para una fenomenología de
la cultura et Mitológicas. Ce centre abritait les élèves de Bórmida : leur production
ethnographique est énorme. Plus de cinquante articles de ces revues ont été
consacrés aux Ayoreo. Dans toutes les publications de ses élèves, aucune
reformulation théorique des idées de Bórmida n’apparaît, puisqu’elles consistent
généralement à ajouter des exemples ethnographiques à ce qui avait été développé
par l’auteur dans ses deux œuvres principales consacrées aux Ayoreo (la série
d’« Ergon y mito » entre 1973 et 1979, et « Cómo una cultura arcaica concibe su
propio mundo », en 1984).
Cette vaste production se caractérise par le fait de présenter la culture ayoreo
comme celle de gens terrifiés : « ce ne serait pas une question de rhétorique de
définir la culture des Ayoreo comme une culture de la peur et de la mort » (Bórmida
35
« […] lo dado inmediatamente como hecho cultural es el mismo hecho tal como es percibido, pensado,
actuado, es decir, vivido, por el hombre en el que se concreta en acción, creencia, actitud o lo que fuere
[…]. El objeto general de la investigación etnográfica debe ser, entonces, una cultura vivida y el hecho
etnográfico la vivencia de este hecho por parte de los hombres que participan de esta cultura. » (1976b :
16-17)
46
�et Califano 1978 : 31)36 . Cette description a été très critiquée par d’autres auteurs,
notamment Fischermann (1988) et Bartolomé (2000). Nous pensons qu’une partie
importante de cette conception vient du fait que Bórmida a travaillé presque
entièrement à partir d’entretiens 37
avec quatre ou cinq personnes — des
intellectuels au sens de Radin (1956) — et qu’il a surdimensionné le rôle effectif
des interdictions puyac dans la vie des Ayoreo (Otaegui 2011).
Un trait distinctif de cette école est l’exposition directe d’une grande
quantité de matériaux de terrain : presque trois quarts de tous leurs travaux
consistent en citations textuelles d’informateurs. Il s’agit de récits des Premiers
Hommes (les origines de tous les animaux, plantes, objets, phénomènes
atmosphériques, etc.), de formules de guérison, d’anecdotes des chamans, de rêves,
et parfois de réponses aux questions concernant le corps et la personne. Comme
toute cette information est publiée à l’état presque brut —malheureusement
seulement en espagnol —, on peut certainement l’utiliser sans adhérer pour autant
au point de vue théorique particulier qui guide l’analyse des auteurs. La valeur
documentaire de cette production est, il faut l’avouer, extraordinaire.
Dans les années 1960, un jeune élève de Lévi-Strauss, Lucien Sebag, est
parti sur le terrain, chez les Ayoreo. Il est tragiquement décédé à l’âge de 31
ans. Deux de ses articles intéressants sur le chamanisme ont été publiés à titre
posthume dans L’Homme. Quelques années plus tard, Carmen Bernand-Muñoz a
mené — à la demande de Lévi-Strauss — une étude critique des notes de
l’ethnologue disparu. C’est grâce à sa thèse — publiée aussi sous forme de livre —
que l’on a pu connaître la totalité de l’information recueillie par Sebag, durant
quatre mois de terrain au Paraguay et en Bolivie. D’inspiration structuraliste, Sebag
a le mérite de trouver des ressemblances profondes entre plusieurs aspects de la vie
ayoreo, de chercher un ordre dans l’hétérogénéité des données de terrain38. Parfois,
36
« No pecaríamos de retórica definiendo a la cultura ayoreo como una cultura de temor y de
muerte. » (BÓRMIDA et CALIFANO, 1978 : 31)
37
BARTOLOMÉ, qui avait travaillé avec Bórmida dans ses débuts, raconte que ce dernier ne résidait
pas avec les Indiens mais avec les missionnaires New Tribes Mission et qu’il travaillait seulement
avec quelques informateurs payés (BARTOLOMÉ 2000 : 239).
38
En 2003, S. D’ONOFRIO publie une analyse des récits de guerre de forte inspiration structuraliste
qui a été, signale l’auteur, le résultat de plusieurs rencontres avec C. LÉVI-STRAUSS.
47
�les interprétations sont forcées pour faire cadrer les données dans des schémas
logiques, mais ses intuitions ont été, pour nous, une source d’inspiration (Otaegui
2011). Malgré quelques particularités — des oppositions injustifiées entre formes
de guérison —, son analyse sur le chamanisme ayoreo reste parmi les plus
intelligentes sur le sujet dans la littérature concernant ce groupe. Il y a aussi des
informations manquantes, dues probablement à la courte durée de son terrain : dans
ses articles et notes, on ne trouve qu’une seule mention au concept de puyac
(« interdit / sacré / tabou » Higham et al. 2000), qui est certainement le premier mot
que l’on entend en ayoreo quand on demande des histoires au sujet des origines ou
des formules de guérison. Il faut aussi souligner le regard ethnologique que Sebag
et Bernand-Muñoz nous offrent : ils essaient toujours de remettre les pratiques et
concepts ayoreo dans le contexte des basses terres sud-américaines39.
Du côté des chercheurs allemands, on trouve une production consacrée aux
Ayoreo notamment dans les années 1960 et 1970. Parmi ces œuvres, ethnographies
assez classiques et très sérieuses, apparaissent les articles pionniers de Heinz Kelm
(1960, 1962) — qui est le seul à avoir été témoin de la fête du changement de
saison (1971) —, l’étude détaillée de la médecine des Ayoreo de Ulf Lind (1974) et
les vastes travaux de Bernd Fischermann (1976, 1988, 2005), l’un des meilleurs
spécialistes des Ayoreo (Combès 2009 : 11). Il s’agit en général d’ethnographies
descriptives mais très précises, même si, quelquefois, nous aimerions un peu plus
de profondeur dans certaines questions 40. On peut mentionner également les travaux
de Volker Von Bremen (1987, 1991) destinés à documenter les expériences subies
par les Ayoreo depuis le contact et à les soutenir dans leurs revendications quant
aux droits et à la restitution des terres.
39
Il y a, à Jesudi, deux hommes âgés qui ont fait la connaissance de Lucien SEBAG, « Luciano ». Ils
disaient qu’il était grand et très mince : on l’appelait « Aeguesaja » (« ventre plat »). Ils étaient au
courant de son destin tragique, mais ils avaient une autre interprétation : il serait rentré en France,
désespéré de ne pas avoir pu apprendre la langue ayoreo et se serait suicidé).
40
C’est le cas notamment de la thèse de FISCHERMANN (1988). Il n’y a presque pas de données
trouvées à Jesudi qui ne soient pas documentées aussi dans ce travail (à l’exception des particularités
des chants non sacrés), mais en raison du style général — monographie classique — beaucoup de
questions n’y sont pas développées.
48
�PREMIÈRE PARTIE
LE PRIVILÈGE DE LA PAROLE
49
�Introduction
L’objectif de notre thèse est de dégager le rôle — s’ils en ont un — des
chants dans la vie quotidienne des Ayoreo. Nous voulons savoir si ces compositions
contribuent à la formation ou transformation de leur vie sociale. Avant d’entrer dans
le cœur de notre recherche, il faut nous attarder sur les deux éléments à la base de
notre question : la société et la parole. Il est nécessaire, d’un côté, de décrire le
déroulement de la vie en société dans ce groupe et de l’autre, de nous rapprocher du
domaine de la parole ayoreo. Dans cette partie, nous nous consacrerons à la parole
de ces Amérindiens. Dans la deuxième partie, nous nous concentrerons sur les
individus qui produisent cette parole et sur les enjeux sociaux de ces compositions.
Comme nous l’avons mis en évidence dans l’introduction de la thèse,
l’enthousiasme des Ayoreo concernant les chants quotidiens nous a étonnés dès
notre arrivée sur le terrain. Nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur
l’importance accordée par les Ayoreo à la parole en général et sous toutes ses
formes. Nous voulons savoir si la parole est quelque chose de « marqué » chez les
Ayoreo, si elle est un de leurs sujets de conversation. Nous voulons savoir, non
seulement ce que l’on peut dire avec des mots, mais aussi ce que l’on peut en faire.
Nous verrons qu’il existe deux domaines de la parole clairement définis :
celui de la parole puissante et celui de la parole humaine. Le premier domaine
concerne la parole en rapport étroit avec les temps des origines, dont la simple
énonciation produit des effets visibles, ayant un pouvoir que les Ayoreo ne cessent
de souligner. Nous analyserons cette action des mots puissants et la façon dont une
effectivité pragmatique leur est attribuée. Le deuxième domaine de la parole est
rapporté plutôt aux gens d’aujourd’hui : il s’agit d’histoires d’humains et dont les
auteurs sont aussi des humains. Nous verrons que toute une série de catégories
permettent de codifier l’expérience et constituent un dispositif pour transformer les
événements en histoires.
50
�CHAPITRE II
LA PAROLE PUISSANTE
Introduction
« Allons-y, vite ! Dépêchez-vous ! », disais-je, aux jeunes Ayoreo qui se préparaient
pour le match de football. Après une semaine assez monotone, j’étais impatient de
jouer au football. Les visiteurs, des Enxet, des Angaite et des Paraguayens qui
venaient habituellement pour jouer, étaient arrivés un peu tard. Les jeunes
mettaient leurs chaussures de sport très lentement. Il fallait encore attendre qu’ils
se mettent d’accord sur les paris, ce qui leur demandait beaucoup de négociations
et de temps. J’ai insisté à plusieurs reprises pour que le match commence. On a
joué : notre équipe, celle de Tamocoi Dosapei — « Cerro Porteño » —, a perdu.
Après la fin du match, Tamocoi m’a dit que la défaite était de ma faute : « c’était
moche tes mots quand tu nous disais de nous dépêcher ! Mon épouse Lucía m’a dit
que nous allions perdre à cause de ce que tu avais dit, de jouer tout de suite. Nos
chers grands-parents disaient qu’il ne fallait pas dire comme ça, et ils en savaient
beaucoup ». « Oui, oui, ai-je pensé, ce n’est pas de ta faute ni celle des autres qui
n’avez pas réussi à mettre un seul but, ce n’est pas non plus que vous m’ayez laissé
— comme d’habitude — tout seul en défense. C’est bien sûr de ma faute : j’ai dit
quelque chose qu’on ne devait pas dire et tes chers grands-parents en savaient
beaucoup. Voilà pourquoi j’ai perdu 10 000 guaranis aujourd’hui… ! »
Chez les Ayoreo, on ne peut pas prononcer de mots sans produire de
conséquences. Le monde fut créé par des dizaines de Premiers Hommes et de
Premières Femmes qui ont décidé de se transformer en plante ou animal, non sans
avoir auparavant prononcé une formule de guérison ou indiqué les effets que le fait
de raconter son histoire produirait. Énoncer certaines phrases permet de guérir,
d’attirer les proies ou de purifier les armes tachées de sang ennemi. De plus, même
des phrases « innocentes » — prononcées sans intention de nuire à quelqu’un —
peuvent avoir des conséquences dans la vie de tous les jours.
51
�Nous analyserons comment, selon les Ayoreo, cette parole dangereuse
provoque un effet. Nous verrons que cet effet se produit plutôt de façon
rétrospective : quand quelque chose de mauvais se présente, c’est parce que l’on a
fait ou dit quelque chose auparavant que l’on n’aurait pas dû faire ou dire. Nous
verrons que les discours sur les mots sont parfois bien plus importants que les mots
mêmes, tellement dangereux que les Ayoreo n’osent pas les répéter. Même si cette
affirmation semble contradictoire, nous en avons appris plus sur ces paroles dans
les discussions qui ont eu lieu avant et après leur énonciation, que dans le contexte
même de leur énonciation.
Nous présenterons d’abord les divers genres de parole puissante, ce qui nous
permettra de voir la diversité de phénomènes sur lesquels l’énonciation de quelques
phrases précises est censée influer. Ensuite, nous développerons ce que la parole
interdite peut provoquer dans des situations concrètes observées sur le terrain :
nous verrons l’importance du discours des Ayoreo sur la parole. Enfin, nous nous
concentrerons sur la question des formules de guérison et du chamanisme en
interaction avec la médecine de l’homme blanc et les paroles miraculeuses de
Jésus-Christ : parfois, expliquer est aussi important que guérir.
II.1 Les genres de la parole puissante41
Le discours ayoreo peut être organisé à un niveau général à partir d’un
critère dichotomique : d’un côté, les récits qui ont une agence42 et de l’autre, les
récits qui — d’après les Ayoreo — ne produisent aucun changement dans le monde.
À partir de cette distinction principale, d’autres traits secondaires peuvent être mis
en relief. Cette organisation est présentée par les Ayoreo quand ils signalent si un
41
Nous avons choisi le terme « puissante » pour mettre en relief un aspect du domaine puyac de la parole
ayoreo. Le signifié de puyac, selon le dictionnaire des New Tribes Mission (HIGHAM et al. 2000 :
729), serait au sens strict « interdit » ou bien « sacré ». IDOYAGA–MOLINA parle d'une « palabra
potente » (1979-1980 : 21), ce qui est en rapport avec le concept de « potencia » utilisé par
BÓRMIDA (1975). Nous ne l'utilisons pas dans ce sens, qui est encadré dans la particulière
perspective théorique de BÓRMIDA (1976b). Par « puissante » nous voulons souligner, tout
simplement, que cette parole peut produire un changement dans le monde susceptible d’intervenir : il
s'agit d'une parole qui a une « agence » (« agency »).
42
Nous utilisons « agence » comme traduction du mot anglais « agency ».
52
�récit est puyac (« interdit, dangereux ») ou non. Celia Mashnshnek (1991) suit aussi
ce critère. Du côté de la parole puissante, Mashnshnek met des récits inclus sous la
catégorie de kuchade kique uhaidie43 , concept sur lequel Bórmida a beaucoup
travaillé (1973-1979). En outre, on trouve les gosniade, récits situés à l’époque
contemporaine, qui consistent généralement en anecdotes de guerre ou en aventures
de chamans (Mashnshnek 1991 : 22).
Bórmida et ses disciples se sont concentrés sur le premier grand domaine du
discours ayoreo, les récits de la parole puissante (Idoyaga Molina 1989, 1998b,
Dasso 2001, Mashnshnek et Gonzalo, 1988, Mashnshnek 1986b, 1991 et 1992,
Nuñez 1978-1979 et 1981). Le domaine des récits qui appartiennent à la catégorie
de gosniade n’a pas été approfondi par ce groupe (à la notable exception de
Braunstein 1976-1977). Les gosniade sont décrits par Mashnshnek d’une manière
assez générale et superficielle. Elle signale qu’il s’agit de récits qui portent sur la
réalité contemporaine (c’est-à-dire dépourvus de contenu sacré), mais elle ne fait
aucune distinction à l’intérieur de ce domaine. Dans les gosniade, on peut trouver
des histoires contemporaines — non mythiques — : des anecdotes de guerre et des
aventures de chamans. Comme ces récits n’ont pas d’effet direct sur le monde — ce
n’est pas une parole puissante —, il n’y a pas de précautions ou d’interdiction
concernant leur énonciation. C’est justement dans ce domaine inexploré que nous
mènerons notre recherche. Il faut auparavant expliciter le domaine des récits sacrés
pour dégager le rôle de la parole dans le discours ayoreo.
Les kuchade kique uhaidie constituent le domaine de prédilection, non
seulement de Bórmida et des chercheurs du centre qu'il dirigeait, mais aussi des
autres spécialistes des Ayoreo44 . Cette locution désigne l’ensemble formé par une
histoire du temps des origines et les formules prononcées dans cette histoire. Son
étymologie est la suivante : « les traces du retour de toutes les choses » (litt. :
43
« Kuchade kique uhaidie » signifie « les traces du retour de toutes les choses » (littéralement :
kique : trace ; kuchade : choses et uhaidie : retour) (BÓRMIDA 1975). C'est une catégorie ayoreo qui
inclut tous les récits des origines, autrement dit, les histoires des temps premiers.
44
Jean Pierre ESTIVAL (2005 et 2006) et Jürgen RIESTER sont les seuls à avoir recueilli des chants
non sacrés (RIESTER et ZOLEZZI 1999). Daisy AMARILLA et José ZANARDINI (AMARILLA–STANLEY
2001 et 2011, ZANARDINI et AMARILLA 2007, ZANARDINI 1981 et 2003) ont aussi recueilli des
histoires diverses, dont la plupart ne font pas partie du domaine puyac.
53
�kique : trace ; kuchade : choses et uhaidie : retour). Cela implique, selon
Mashnshnek, que l’énonciation d’une histoire de ce type produise une
réactualisation d’un événement des temps premiers dans le présent. De l’événement
évoqué dépendront le signe — négatif ou positif — et la gravité des effets de
l’énonciation :
Quand ces faits ou événements sont néfastes, cette négativité est
« métatemporalisée », elle devient présente ici et maintenant et elle
contamine tous ceux qui se mettent en contact avec elle, c’est-à-dire, tous
ceux qui écoutent le récit. La même chose arrive, mais en sens inverse,
quand les événements sont fastes ou bien quand la puissance positive des
prédications que le nanibahai a transmises à la postérité est
métatemporalisée. (Mashnshnek 1991: 24, italiques dans l’original) 45
L’une des études les plus détaillées de Bórmida, « Ergon y mito », porte sur
les objets des Ayoreo et leurs rapports avec les mythes (Bórmida 1973, 1974, 1975,
1976, 1978/1979). Ce chercheur a montré qu’à tous les objets, tous les animaux et
toutes les plantes — en définitive, à tous les composants du monde —
correspondait un récit spécifique dans les histoires des origines. Chaque élément du
monde devrait avoir un récit d’origine, et chacun de ces récits devrait produire un
effet sur le monde. Les récits ont souvent la même structure : l’histoire d’une
métamorphose. Le protagoniste est un Premier Homme ou une Première Femme
dont le nom et certains traits ou habitudes préfigurent l’animal ou la plante en
laquelle il ou elle se transformera. Cet existant — soit poussé par son propre désir,
soit obligé par Dupade46
— décide de se transformer, mais avant cette
métamorphose il laisse une formule aux hommes avec les instructions d’utilisation :
« si vous avez tel problème, dites ceci et de cette manière, et tout ira bien ». Nous
45
« Cuando estos hechos o acontecimientos son nefastos, esta negatividad se « metatemporaliza »,
se hace presente aquí y ahora contaminando a los que se ponen en contacto con ella, es decir, a
quienes escuchan el relato. Lo mismo ocurre, pero en sentido contrario, cuando los acontecimientos
son fastos o bien cuando se metatemporaliza la potencia positiva de las predicaciones que el
nanibahái legó a la posteridad » (MASHNSHNEK 1991: 24).
46
Traduction en ayoreo du dieu chrétien. D’après COMBÈS, le mot vient du guarani Tupan, terme
introduit par les Jésuites dans les missions de Chiquitos pour désigner le dieu chrétien (2009 : 14).
54
�verrons maintenant la variété de ces formules et tous les aspects de la vie ayoreo
qu’elles permettent d’influencer.
II.1.1. Sarode
Les sarode (sing. sarui, pl. sarode) sont des formules de guérison tirées des
récits mythiques. En ce qui concerne la manière de les énoncer, les Ayoreo ne
considèrent pas les sarode comme un chant, mais comme une sorte de formule dont
l’énonciation présente une structuration du son, voire un rythme. D’après nos
données, les verbes utilisés pour définir cette action sont iqueta (« guérir ») ou
ubuchu (« souffler »). D’après Rosadé (informateur de Mashnshnek), quelqu’un qui
récite un sarui ne chante pas, il parle. Ces mots doivent être prononcés avec
prudence : ils peuvent provoquer un effet contraire si on ne les prononce pas dans
un contexte adéquat. Sarui est traduit en espagnol par remedio (« médicament »)
selon les Ayoreo avec lesquels Mashnshnek a travaillé.
Le sarui est une formule héritée des Premiers Hommes qui sert à guérir une
maladie ou une blessure. Un récit des origines constitue le contexte de la création
d’une ou plusieurs formules sarui. Généralement, il suffit de souffler le sarui pour
guérir un malade, il n’est pas nécessaire de raconter le mythe. La présence des
onomatopées est un trait distinctif des sarode. On trouve généralement
l’onomatopée de la douleur ou de la maladie et aussi, quelques lignes plus loin,
l’onomatopée du corps en bonne santé. Le processus de guérison qui se produit
dans le récit se transmet au patient.
Voici un exemple de Samane (informateur de Mashnshnek), le sarui
d’Ahamei47 , le tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus). Ahamei avait instauré
l’obligation de se laver les mains après avoir mangé de la viande de tatou. Ne pas le
47
MASHNSHNEK utilise la graphie « ahamei », alors que FISCHERMANN (1988) celle d'« ajaramei ».
55
�faire est puyac (« interdit ») et celui qui a commis cette infraction tombe dans la
folie. Ce sarui sert justement à éviter ces conséquences désastreuses48 :
Je suis le grand triomphateur dans tout le monde
Et je suis très puissant avec mes malédictions et mes bénédictions
C’est pour cela que rien ne peut résister à mes malédictions
Yo sísí sísí (onomatopée du son de l’eau qui purifie)
Yo ni, ni, ni
Yo sísí, sísí49
II.1.2. Chubuchu
Mashnshnek nous présente le chubuchu comme une technique particulière de
raconter un sarui. Chubuchu signifie au sens littéral « il souffle » (-ubuchu avec le
préfixe de 3e pers. sing. ch-). Selon Mashnshnek (1991 : 27), il y a deux manières
de souffler. L’une consiste à souffler en récitant un sarui et en mettant la bouche
contre la partie affectée du corps du malade. L’autre implique de « tirer » les
formules en l’air, en direction d’une zone particulière, un campement ou une
communauté par exemple. Mashnshnek — même si elle ne le fait pas
48
Cette histoire n’était pas mentionnée couramment à Jesudi. Là, l’hygiène personnelle ne nous est
pas apparue comme une préoccupation particulière : les adultes — et surtout les enfants — ne se
lavaient pas les mains après avoir mangé des fruits, des saucissons, des sucettes ou quoi que ce soit.
Les douches ne sont pas non plus très fréquentes chez eux. En revanche, le contraste avec leurs
voisins paraguayens est notable puisqu’ils prennent une douche au moins une fois par jour, bien
qu’ils aient des conditions matérielles quasi identiques. C’est pourquoi, ce comportement a attiré
notre attention : aussitôt qu’ils ont fini de manger du aruco (tatou), ils prennent un peu d’eau et se
lavent soigneusement les mains et la bouche. Après quelques mois de terrain, Jnumi Posijñoro m’a
raconté qu’elle enseignait cette habitude à ses petits-enfants parce qu’elle se souvenait de cette
histoire. Cependant, je ne pourrais pas affirmer que le reste des gens — et surtout les jeunes — la
connaissent aussi. C’est une pratique qui perdure, même si la base idéologique qui la justifiait n’est
plus aussi présente.
49
Malheureusement tous les récits recueillis par les membres du Centro Argentino de Etnología
Americana (CAEA) — à l’exception déjà citée de BRAUNSTEIN 1976-1977 — ont été publiés
seulement en version espagnole. Tous les récits que nous retiendrons parmi cette vaste production
seront donc présentés dans notre traduction en français de l’original en espagnol.
56
�explicitement — distingue sarui de chubuchu comme deux types différents de
compositions. Voici l’exemple de la tortue :
Chubuchu de Yokai (Tortue)
Je suis tortue femelle
Je suis tortue femelle
Je cachais ma maladie dans mon corps
Je cachais ma maladie dans mon corps
et personne ne peut la voir
Je guérissais n’importe quelle maladie (répété quatre fois)
D’après notre enquête ethnographique¸ ces paroles sont toujours nommées
sarode, qu’elles soient récitées ou soufflées (chubuchu). Même quand les Ayoreo
mentionnent l’activité de souffler, les formules ne sont pas confondues avec la
technique : « Toto chubuchu ome saude » (« Toto souffle avec des saude »), c’est-àdire, chubuchu est un verbe, une action (souffler), pas le complément d’objet direct
(dans ce cas la formule). Selon Mashnshnek (1991 : 27), c’est aussi un nom.
Soulignons que Mashnshnek et les membres du Centro Argentino de Etnología
Americana (CAEA) ont travaillé plus de 25 ans avant notre enquête ethnographique
et possèdent un corpus très vaste de récits, recueillis surtout en Bolivie. Cela nous
fait penser que cette différence par rapport au sens de chubuchu est peut être une
question, non pas d’interprétation, mais tout simplement de corpus différents.
II.1.3. Paragapidi
Le paragapidi est une formule qui a une fonction préventive. Contrairement
aux formules de guérison sarui destinées à restituer un état précédent, le paragapidi
protège d’un danger éventuel. Cette formule se présente sous quatre variantes
d’utilisation : la protection du campement face aux malheurs attendus, la prévention
des maladies individuelles, l’aragapi et, finalement, la cérémonie de purification
57
�des armes contaminées par le sang de l’ennemi (Idoyaga Molina et Mashnshnek
1988).
La première variante sert à protéger toute la communauté contre des
phénomènes climatiques (sécheresses, tempêtes, inondations — très fréquentes à la
Mission María Auxiliadora —, etc.) et aussi contre des maladies épidémiques.
L’énonciation délimite une aire géographique : le paragapidi est récité autour du
campement, ou bien dans la direction d’où le danger est censé venir (par exemple
vers le sud quand on veut éviter le vent froid Umusoi). Voici l’exemple du
paragapidi de la courge amère, prononcé à l’entrée du village pour empêcher
qu’une maladie n’arrive.
C’est moi la viande amère
C’est moi la prudente
Selon l’informateur Rosadé, il faut réciter cette formule avant l’arrivée de la
maladie. Courge Amère avait dit : « Si on entend qu’une maladie est en train
d’arriver et qu’elle est près, il faut raconter [sic] ces mots que j’ai racontés
[sic] » (Mashnshnek 1991 : 28).
La deuxième variante sert à un individu à se protéger des maladies. Les
formules du paragapidi sont récitées au-dessus d’un récipient contenant un liquide
avec lequel la personne en question sera ensuite aspergée. Les principes généraux
restent les mêmes, mais l’objectif est plus ciblé et limité à une personne.
La troisième variante, appelée aragapi, est à mi-chemin entre la première et
la deuxième. En fait, selon Idoyaga Molina et Mashnshnek (1988), il s’agit de
chants — et non de formules prononcées — qui sont interprétés au-dessus d’une
cruche remplie d’eau. On crache dans l’eau et le bénéficiaire boit ce liquide,
recevant ainsi la salive et les chants. Une fois la tâche accomplie, il faut laver le
récipient pour éviter qu’il ne soit contaminé par le paragapidi. Ce liquide peut en
fait être utilisé — comme les sarode — pour guérir, mais cela n’empêche pas que
58
�les Ayoreo — selon les auteurs — conçoivent toujours l’aragapi comme une autre
variante du paragapidi.
La quatrième variante est une cérémonie pratiquée par les guerriers après la
bataille, pour se purifier du sang des victimes. Il est nécessaire de faire le rituel
immédiatement, dans un campement temporaire près du lieu de la confrontation. La
cérémonie consiste à délimiter une superficie dans le sol, un carré d’environ trois
mètres de côté. Une extrémité est appelée « tête » et l’autre, « pieds ». Le dessin
suit généralement l’axe est-ouest. Les armes souillées par le sang — la lance et la
massue — sont enfoncées dans la terre par les pointes. S’il y a un nombre pair
d’armes, on les met par paires enfoncées obliquement, de façon à ce que les
manches se touchent deux par deux. S’il y a un nombre impair d’armes, la dernière
est brisée en deux. La pointe et le manche sont enfoncés dans la terre et les bouts
fracturés se touchent. Après avoir mis ces éléments à l’intérieur de la superficie
délimitée, les guerriers marchent autour du carré en frappant la terre de leurs pas et
en prononçant des mélodies sans paroles, héritées des Premiers Hommes —
particulièrement de ceux devenus des oiseaux puissants et dangereux. Les guerriers
sautent par-dessus les armes sans les toucher. Il ne faut jamais entrer dans l’aire
dessinée : si quelqu’un le faisait, il mourrait. Une fois la cérémonie accomplie, cet
endroit est abandonné et ne sera plus jamais fréquenté. Le but du paragapidi est
d’établir une zone (appelée paragapidi) où la souillure du sang versé reste
enfermée. Selon l’informateur Rosadé (Bórmida 1975 : 106), les pas marqués
frappent l’oregate — principe animique — de la victime.
Nous avons consulté les Ayoreo de Jesudi au sujet du paragapidi, étant
donné que le fait d’abandonner les armes nous semblait peu pratique (surtout si on
pense aux fusils qu’ils ont commencé à utiliser dans les années 1960). Selon Bajai
Posorajãi, il n’était pas nécessaire de laisser les armes là. Mais si quelqu’un ne
faisait pas la cérémonie, un accident lui arriverait. Un homme, nous a raconté Bajai,
n’avait pas fait le paragapidi avec son fusil. Quelque temps après, l’arme s’est
activée toute seule en le blessant à la jambe. Le simulacre du paragapidi que Bajai
59
�nous a présenté était un peu différent des descriptions de Mashnshnek et Bórmida,
mais le sens général était le même. Bajai a dessiné quatre lignes sur le sol :
I I pieds
I
I
tête
Il y avait environ un mètre de séparation entre les pieds et la tête. Il a frappé
avec les pieds six ou sept fois sur une extrémité, et il a sauté sur l’autre extrémité
pour faire la même chose. Bajai a remarqué qu’après le paragapidi, ceux qui étaient
allés ensemble à la bataille échangeaient du miel — ce qui faisait partie du rituel
taboi50 .
II.1.4. Aguyade
Dans le cas des aguyade, il ne s’agit pas de formules, mais de récits interdits
ou sacrés (puyac) destinés à protéger les jardins contre les insectes et les animaux
qui attaquent les produits de l’horticulture. Ces récits peuvent, eux aussi, avoir des
conséquences négatives s’ils ne sont pas prononcés dans les bonnes circonstances.
Par exemple, la narration de l’histoire des fourmis Gahno et Odóboiódie peut
impliquer que quelqu’un quitte la communauté et oublie ses parents51 .
Malheureusement Mashnshnek ne transcrit aucun aguyai, mais elle signale que rien
ne les distingue du reste des récits des origines, sauf le but spécifique d’éliminer les
insectes des jardins.
50
Le rituel taboi, réalisé dans la communauté au retour d'une bataille, consistait à échanger du miel
entre les guerriers et à l’ingérer. Le miel représentait le sang de l’ennemi (cf. MASHNSHNEK
1983-1984).
51
Selon nos données de terrain, l’histoire de Gahno est utilisée pour faire retrouver l’appétit à
quelqu’un qui est affaibli parce qu’il ne mange pas assez.
60
�II.1.5. Erái52
Les erai sont des chants utilisés lors de la chasse, la cueillette du miel
sauvage et même l’accouchement. Ils sont aussi interprétés lors de la cérémonie la
plus importante : la fête du changement de saison. Les erai ont généralement un
rapport avec les outils employés dans ces activités. Selon Samane (Mashnshnek
1991 : 30) pour trouver des tortues, il faut dessiner sur le sol les traces de cet
animal comme s’il se dirigeait vers le sac de cueillette. Puis, l’erai de la tortue doit
être interprété autour du sac :
Je suis la Tortue qui peut être trouvée facilement
Qu’on me cherche tout le temps, toute la journée
Cherchez-moi et vous me trouverez facilement
Cela fera venir ces animaux à la rencontre du chasseur. Selon Bajai, quand il
était jeune et habitait dans la forêt, les Ayoreo employaient des techniques
similaires pour faire venir les pécaris.
II.1.6. Uhñaune
La catégorie uhñáune53 rassemble des formules tirées de la série des mythes
d’Asojna — l’engoulevent (Caprimulgus parvulus), l’être le plus redouté par les
52
Dans ce texte de 1991, MASHNSHNEK inclut les aragapi sous la catégorie d’erai. Cependant, dans
le texte de 1988 en collaboration avec IDOYAGA MOLINA, l'aragapi est considérée comme une
variante du paragapidi. La description de l’aragapi est exactement la même. Si l’on prend en
compte certaines caractéristiques — ses qualités curatives et préventives et l’étymologie partagée —,
on peut dire que la catégorie aragapi est plus proche du concept de paragapidi.
53
Les anthropologues utilisent diverses graphies pour le même concept : uhñaúne et ujnarone (sing.
ujnari). Pour certains auteurs, ujnarone et sarode sont des concepts équivalents (par exemple
BESSIRE 2011). LIND, pour sa part, signale que sari est la formule alors que ujnari est le principe
animique de l’être originel auquel la formule appartient (1974 : 149).
61
�Ayoreo54 . Ces formules dangereuses ne peuvent être prononcées qu’à la saison des
pluies, quand il n’y a pas de tabous concernant cet oiseau. Elles ont été laissées par
Asojna ou par d’autres Premiers Hommes et Premières Femmes qui apparaissent
dans les histoires de l’engoulevent. Les uhñáune sont destinées à guérir des
souffrances spécifiques : celles provoquées par la violation du tabou d’Asojna. La
technique d’application consiste à énoncer la formule, à la souffler sur la partie du
corps affectée, et après à la souffler à nouveau en direction contraire. Voici
l’uhñáune de la croix (des croix en bois font partie de la cérémonie du changement
de saison) interprétée par Samane :
Je suis la Croix très puissante
parce que je suis puyac
parce que je suis aussi d’Asojna
je peux guérir n’importe quelle maladie
et je suis destructeur
je suis très puyac parce qu’on m’a utilisée pour frapper
ceux qui sont revenus après avoir bu de l’eau
ohhhhhhhhhhhh.
Asojna était tellement redoutée que le registre des histoires et des formules
que cette Première Femme a laissées est encore très fragmentaire (cf. Mashnshnek
1986-1987, Fischermann 1988).
II.1.7. Les traits de la parole puissante
Mashnshnek oppose les kuchade kique uhaidie et les gosniade selon une
série de critères : temps du récit, présence ou absence du pouvoir, actualisation dans
le présent et type d’influence sur la vie des hommes. Les récits qui appartiennent à
la première catégorie sont situés dans les temps des origines — les personnages
sont des Premiers Hommes ou Premières Femmes —, ils ont du pouvoir et sont
actualisés — rendus au présent — au moment de l’énonciation, et affectent
54
Les histoires d'Asojna sont les plus difficiles à recueillir, car elles peuvent provoquer des maladies. Il
s'agit d'une Première Femme très puissante qui ressuscite après avoir été assassinée. L’apparition de cet
oiseau en août marque le début de la saison des pluies.
62
�directement la vie des hommes d’une manière positive ou négative. Les gosniade,
au contraire, ont lieu dans les temps historiques — les protagonistes sont des
hommes —, ils n’ont aucun pouvoir, ils restent toujours dans le passé et n’affectent
pas la vie des hommes (Mashnshnek 1991 : 33).
Toute cette liste de formules diverses avec des fins différentes nous montre
la variété des phénomènes sur lesquels les Ayoreo pensent qu’il est possible
d’intervenir par le biais de la parole : la chasse, le jardinage, les maladies, les
inclémences climatiques, entre autres. La connaissance des Ayoreo en matière de
plantes médicinales n’était pas très développée. En fait, selon l’ethnobotaniste
Schmeda-Hirschmann (1993 : 107) — qui a fait une partie de son enquête à
Jesudi —, les Ayoreo n’utilisaient pas plus d’une vingtaine de plantes médicinales.
Il n’est donc pas étonnant qu’une grande partie de leur médecine soit confiée au
pouvoir de la parole. Désormais, il faut préciser la manière dont cette parole agit,
comment elle est mise en action.
II.2. La mise en pratique de la parole puissante
II.2.1. La parole dangereuse
Nous avons présenté les formules et récits puyac dans la section précédente
d’une manière un peu abstraite, dépourvus de contextes particuliers et de situations
concrètes, dans le but de mettre en relief les mots, leurs structures et leurs fonctions
primaires. À présent, nous nous concentrerons sur la manière dont ces formules
dangereuses produisent des effets.
Tous ces récits font preuve d’une certaine ambivalence. Le résultat n’est pas
toujours bénéfique. Cela dépend en effet des circonstances de l’énonciation. Ces
formules entraînent alors le risque de produire des effets nocifs (par exemple, si on
prononce le sarui du serpent alors que personne n'a été mordu, cela provoquera
qu'un serpent vienne attaquer quelqu'un). Elles peuvent aussi être utilisées dans ce
but précis, pour nuire à des personnes ou même à des populations entières. D’après
Idoyaga Molina (1979-1980), ce type d’attaque « magique » constitue la forme la
63
�plus répandue, étant donné que quiconque peut les utiliser soit pour guérir, soit
pour attaquer. Il suffit de connaître les mots à prononcer.
L’usage des formules pour faire du mal à un individu n’a rien à voir avec
une attaque chamanique. D’abord, en ce qui concerne l’agresseur, aucune initiation
n’est requise. Il n’est pas non plus nécessaire de recevoir des visites des Premiers
Hommes dans les rêves — comme c’est le cas des uritai, rêveurs et presque
chamans. En fait, l’agresseur est un individu quelconque qui connaît les formules
nécessaires. De plus, le dommage infligé en lui-même est d’une nature différente de
l’action chamanique. Dans le cas d’attaques chamaniques, le malfaiteur envoie
l’esprit de la maladie qui entrera dans le corps de la victime. Dans le cas des
formules, au contraire, il n’y a pas de personnalité qui agisse, ou — dans le cas de
la guérison — d’entité qui puisse être enlevée par succion. Les protagonistes, à vrai
dire, sont les mots.
Idoyaga Molina soutient que la narration implique une réactualisation des
temps mythiques. Si l’événement raconté relève de la violence et de la tragédie, il
provoquera des circonstances identiques dans le temps présent 55. L’apparition de
l’effet n’est pas automatique mais fortement possible (1979 -1980 : 22). Ces mots
dangereux peuvent provoquer le décès de quelqu’un qui les aurait écoutés. Cela
aurait été le cas de Lucien Sebag (1979-1980 : 23)56 , d'après ce que raconte
Samane, chaman qui fut informateur de l'anthropologue français. La personne qui
55
En fait, l’auteure souligne fortement les aspects négatifs ou violents des mythes : « La
negatividad, o el carácter puyák de la kíkie uháide posee como fundamento una mitología de terror,
concretada en lo cruento, la muerte, la envidia, los celos, la enfermedad y el daño » (IDOYAGA
MOLINA 1979-1980 : 22). Nous y reviendrons plus loin, quand nous discuterons la notion de puyac
selon BÓRMIDA.
56
Voici ce que Ecarai, l’interprète, raconte à l’auteure : « Dice el informante que no quiere contar
los cuentos prohibidos porque si los cuenta usted muere, o yo muero, o muere él. Puede ser que el
que cuenta muera y si el que cuenta no muere tiene que morir uno de los que escucha. Él tiene
miedo porque él ya trabajó con Luciano, y Luciano se murió porque oyó los cuentos puyák, y
Samáne (el informante) se quedó medio loco, por eso él tiene miedo. Luciano no tenía fe o confianza
en lo que Samáne decía. Así que no le importaba oír sáude puyák. Luciano oía cosas que no
convenía oír. Samáne le avisó pero Luciano no quiso hacerle caso por eso se terminó la vida de
Luciano. Samáne le contó cosas prohibidas que hacían morir, le contó la historia de Asohná, no le
importó a Luciano que era erámi puyák (tiempo prohibido) por eso tuvo un accidente en su vida »
(IDOYAGA MOLINA 1979-1980 : 23).
64
�les prononce devrait être affectée en premier lieu, mais des techniques sont
employées pour minimiser cette possibilité.
Les récits dangereux peuvent être racontés dans le but d'attaquer une cible
spécifique, telle une personne, ou bien générale, comme un groupe. Il suffit, dans le
premier cas, de raconter une histoire où le protagoniste est du même clan que la
victime. Par exemple, si l’histoire du jaguar est racontée, c’est un Dosapei qui
mourra (Idoyaga Molina 1979-1980 : 26). Dans le deuxième cas, il faut raconter
autant d’histoires que possible et surtout les plus puyac. C’est ce qu’a fait un
homme très attristé après que ses fils ont péri à la guerre : il a raconté toutes les
histoires interdites aux alentours des salines, provoquant la mort de tous les Ayoreo
et même des animaux qui étaient dans la région.
Divers indices nous montrent que la parole elle-même est plus importante
que l’entité protagoniste qui a laissé des formules. En fait, même s’il y a une
réactualisation dans le présent « méta-temporellement » des temps mythiques, il
serait inexact de dire qu’une entité a été invoquée, que sa présence est requise. En
réalité, il faut seulement suivre les règles d’utilisation instaurées dans le mythe par
cette entité. On peut certainement avoir l’impression que le Premier Homme en
question est invoqué, mais cette entité n’agit pas à vrai dire volontairement, elle
répond de façon un peu mécanique :
L’oregate (âme, ombre) du nanibaháde maudit maintenant quand il entend
que quelqu’un raconte son histoire puyák. Quand le nanibaháde entend
l’histoire, il maudit la personne et il attaque, il envoie la promesse qu’il
avait faite. Chacun des nanibaháde a fait sa promesse au moment de son
changement, alors s’il entend qu’on raconte son histoire, il envoie tout de
suite la maladie. (informateur Degui dans Idoyaga Molina 1979-1980 : 29)57
57
« El oregate (alma sombra) del nanibaháde maldice ahora cuando se entera que alguien cuenta
su historia puyák. Cuando el nanibaháde oye la historia maldice a la persona y ataca, manda la
promesa que había hecho. Cada uno de los nanibaháde hizo su promesa en el momento en que se
cambió, así que si oye que cuentan su historia manda en seguida la enfermedad » (transcription de
la réponse de l'informateur DEGUI dans IDOYAGA MOLINA 1979-1980 : 29).
65
�Par ailleurs, l’effectivité de l’action qui nuit ne dépend pas du malfaiteur —
en dehors de la responsabilité de la répétition précise. L’agresseur n’a pas besoin de
se mettre dans un état de conscience altéré ou de se concentrer sur des sentiments
obscurs dont les formules seraient un véhicule. Les détenteurs du pouvoir de nuire
ne sont ni le Premier Homme qui a laissé la formule, ni celui qui l’énonce. Ce sont
les mots eux-mêmes. D’après Idoyaga Molina, la question est là : « la négativité de
la puissance ne dépend pas de l’intention de nuire [à quelqu’un] mais au contraire,
elle est immanente au pouvoir de la parole » (1979-1980 : 23). Ce caractère nocif se
présente conceptualisé comme une sorte de contamination. Cette parole, selon la
description d’Idoyaga Molina (1979-1980) et Bórmida (1975), se répand comme la
fumée. Bórmida distingue trois caractéristiques principales de la parole puissante.
Premièrement, elle a une sorte de matérialité. Deuxièmement, elle se déploie,
comme une émanation, depuis l’endroit où elle a été prononcée vers l’extérieur, et
elle contamine toute cette région. Enfin, elle reste dans ce lieu où son influence agit
négativement pendant un temps indéterminé — mais assez long. De plus, elle peut
aussi être destinée à une région tout entière et reste imprégnée dans celle qu’elle
endommage. Ces paroles dangereuses qui se répandent dans l’espace ont été
prononcées avec l’intention de nuire à quelqu’un de spécifique, et son énonciation
implique le choix d’un récit mythique en particulier. L’intention est de nuire, mais
cet état d’esprit ne se trouve pas dans les mots eux-mêmes.
Une intentionnalité est impliquée, en revanche, dans le cas de chamacare qui
pourrait être traduit par « maudire ». Selon Idoyaga Molina, cela consiste en
l’expression d’un individu envers un autre avec lequel il est fâché : il lui souhaite
des malheurs. Selon cette auteure, cette malédiction reproduit les histoires typiques
des mythes ayoreo : un grand nombre de Premiers Hommes étaient maudits ou bien
maudissaient avant la métamorphose habituelle. Idoyaga Molina oppose le
chamacare à l’emploi agressif des sarode parce que, dans ce dernier cas, la
récitation précise requiert une volonté claire, il s’agit de l’action calculée et
méditée d’attaquer une autre personne. Cependant, d’après notre enquête
ethnographique, ce n’est pas exclusivement d’un individu vers un autre que le
chamacare est mis en pratique. Raúl Jnurumini, à Jesudi, nous a raconté que quand
66
�il travaillait à l’usine de charbon, il est tombé gravement malade : ses poumons
étaient brûlés. À l’hôpital, il s’est souvenu que deux mois auparavant il avait
chamacare pour lui-même, en disant qu’il allait mourir (« yamacare yu58 » « je me
maudis »). Son père lui a dit de « ne pas faire comme ça avec la parole59 ». Les
autres fois où j’ai entendu ce mot, le contexte était toujours le même : quand
j’exprimais ma peur envers un événement qui aurait pu arriver — un orage ou un
mauvais résultat à un match de football —, ils me disaient « mamacare ua ! » (« tu
maudis ! » ou bien « tu te maudis ! »). Même si, comme Idoyaga Molina le signale,
le chamacare n’a pas la systématisation et la complexité des sarode, c’est un
exemple clair pour illustrer à quel point la simple verbalisation d’un désir ou d’une
crainte particulière peut être liée aux événements postérieurs. Autrement dit, cela
nous montre combien les mots sont dangereux.
II.2.2. La parole dite par quelqu’un
Lors de notre enquête ethnographique à Jesudi, nous avons été témoin, à
deux reprises seulement, de l’utilisation d’un sarui contre un orage par un homme
âgé, Toto Étacori. Une autre fois, Tamocoi Dosapei nous a raconté comment il avait
été guéri avec des formules. Tamocoi travaillait dans une ferme mennonite et il
avait mal à la jambe. Comme il n’y avait pas de médicaments, il a demandé à Toto
de le souffler (chubúchu). Enfin, Bajai Posorajãi nous a montré une fois comment
un rituel de décontamination des armes était réalisé, ce qui lui a pris moins d’une
minute. Comment mener alors une discussion qui ne soit pas fondée seulement sur
nos lectures ou sur la reconstruction des temps passés d’après les déclarations des
hommes âgés — voie que nous avions décidé de laisser de côté ? Une réflexion sur
58
yamacare
yu
Prefix 1º sing – maudire – pron Obj 1º sing. (cf. HIGHAM et al. 2000 : 50)
59
Toujours selon Raúl Jnurumini, dormir où un malade avait dormi (à l’infirmerie de Jesudi) ou
dormir directement sur la terre, étaient aussi des chamacare qui pouvaient provoquer la mort. Le
reste des personnes consultées a limité le signifié de chamacare à celui de malédiction. En tout cas,
on voit, dans le cas de Raúl, une association qui n’est pas illogique entre des actions (dormir sur la
terre est interdit aussi selon BÓRMIDA et CALIFANO 1978) et des mots, tous deux entraînant des
conséquences fatales.
67
�une pratique doit forcément comporter, parmi ses éléments, au moins quelques
traces d’observation. Il faut trouver un élément commun entre les descriptions de
Bórmida et ses élèves dans les années 1970 et les nôtres. Il y a certainement un
élément présent ici et là, un concept sous-jacent à tous les genres décrits dans la
section précédente, et dont la saillance était évidente tout au long de notre enquête
ethnographique : le concept de puyac. Puyac (« interdit ») est la condition
commune à tout le domaine de la parole qui a du pouvoir.
La notion de puyac est à la base de la description que Bórmida fait des
Ayoreo. Puyac, selon le dictionnaire des New Tribes Mission, est la « definite
form » de puyai : « forbidden, sacred, taboo, holy, consequential if misused ; fem. :
puyé » (Highham et al. 2000 : 729). Les Ayoreo traduisent ce mot en espagnol par
« es prohibido » (« c’est interdit »). De nombreux comportements sont interdits et
ne pas respecter ces interdictions peut entraîner des conséquences variables, mais
généralement fatales. Par exemple, faire la lessive le soir provoquerait le décès
d’un parent ; si quelqu’un mange de la viande de jaguar, des jaguars viendraient le
chercher ; réciter une formule au mauvais moment provoquerait la maladie qu’elle
est censée guérir.
Bórmida a analysé cette notion avec un enthousiasme particulier. Il apporte,
comme d’habitude, une énorme quantité de déclarations textuelles de ses
informateurs. À vrai dire, la définition du concept ne varie pas entre les divers
chercheurs du Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA), dirigé par
Bórmida. Bórmida, Lind et Fischermann présentent le puyac comme une
interdiction de certains comportements. Ce que Bórmida et Califano mettent en
lumière, c’est la présence écrasante avec laquelle, selon lui, cette idée conditionne
la vie quotidienne des Ayoreo :
[…] la peur constante des maladies, qui peuvent être occasionnées par
l’infraction d’innombrables tabous qui assiègent, pour ainsi dire, tout
l’habitat naturel et culturel. Ce ne serait pas de la rhétorique, de définir la
68
�culture ayoreo comme une culture de la peur et de la mort (Bórmida et
Califano 1978 : 31)60
Ayant lu toute cette bibliographie avant de nous rendre dans le Chaco
paraguayen, nos premières impressions à Jesudi ont présenté un fort contraste avec
la description de Bórmida. Cette perplexité ne s’est pas dissipée au fil des mois,
même si le déroulement normal de notre ethnographie nous permettait de saisir
progressivement des aspects plus cachés de leur vie. Une réponse possible au
problème de ce contraste serait d’affirmer que le temps passé en interaction avec la
société néo-américaine aurait affaibli leur croyance en la gravité des puyac.
Bórmida avait effectué son enquête la plus importante entre 1970 et 1971, alors que
la nôtre s’est déroulée entre 2008 et 2011. Cependant, d’autres travaux de la même
époque — Sebag (1965), Fischermann (1988) qui a commencé son enquête en 1969
— nous montrent une image plus proche de ce que nous avons observé dans notre
recherche. Même si l’hypothèse de l’affaiblissement ne peut être laissée de côté —
nous y reviendrons —, nous pensons que l’image présentée par Bórmida est
inexacte. Analyser les contributions de cet auteur en contraste avec nos données
nous permettra de mieux saisir ce concept fondamental qui est à la base de la parole
puissante.
La première série de critiques concerne sa méthodologie. Le travail de
Bórmida chez les Ayoreo présentait un gros déséquilibre : il consistait presque
entièrement en entretiens et ne faisait quasiment pas d’observation61 . Cela
conditionne sévèrement ses conclusions concernant ce concept. Après avoir
recueilli des centaines d’exemples variés d’interdictions puyac dont la violation est
60
« […] el constante temor a las enfermedades, que pueden ser ocasionadas por la infracción de
innumerables tabúes y que asedian, por así decir, en todo el hábitat natural y cultural. No pecaríamos de
retórica definiendo a la cultura ayoreo como una cultura de temor y de muerte » (BÓRMIDA et CALIFANO
1978: 31).
61
C’est lui-même qui signale l’importance accordée à cette technique : il déclare avoir recueilli plus
de 200 heures d’enregistrements avec cinq informateurs (2006a : 9-12). Selon la vision de ses
critiques (FISCHERMANN 1988, BARTOLOMÉ 2000), c’était la seule technique employée : il ne faisait
pas d’observation participante et il n’habitait pas non plus chez les Ayoreo, mais avec les New Tribes
Mission.
69
�fatale, il est presque inévitable d’aboutir à la conclusion suivante : l’individu
ayoreo est soumis et asphyxié par ces interdictions, il est toujours à deux pas de la
mort. Selon les descriptions de Bórmida, tout Ayoreo craindrait en permanence de
violer l’un des innombrables puyac. L’auteur suppose que tous les individus ont,
sans aucun doute, toutes les prohibitions en tête. Cependant, on sait depuis
longtemps en anthropologie que la distribution de la connaissance n’est pas
homogène dans une société. Paul Radin (1960) est peut-être le plus clair à ce sujet.
Dans toutes les cultures, nous explique cet auteur, on peut trouver des intellectuels
— les individus qui savent le plus et qui réfléchissent beaucoup — et des hommes
communs — le reste des gens, dont la croyance est plus faible et plutôt
occasionnelle. Bórmida a interviewé cinq informateurs reconnus comme les plus
grands connaisseurs de leur culture, ce qui n’est pas un détail négligeable. Cet
anthropologue signale quand même que la gravité des puyac varie selon la personne
consultée — à la notable exception de l’engoulevent Asojna et du lézard Poji, les
deux figures les plus redoutées parmi les êtres du temps des origines —, et que
l’effectuation des conséquences dans la réalité n’est pas automatique, bien qu’elle
soit quelque chose de fort probable. Or, quand Bórmida décrit le monde des Ayoreo,
il semble ignorer ces deux observations. Il nous transmet l’idée que tous les
hommes ordinaires connaîtraient les puyac avec la même profondeur de détails que
les cinq intellectuels interviewés. Bórmida fait, à partir d’un discours, la description
d’une vie qu’il n’a pas observée.
Nous ne nions pas que le concept de puyac joue un rôle dans la vie actuelle
— ou passée — des Ayoreo. Cependant, nous ne l’avons pas appréhendé avec
l’obsession minutieuse présentée par Bórmida. Il y a une distance entre le discours
et la pratique — qui ne se réduit pas, bien sûr, à déterminer si une déclaration est
vraie ou fausse. Cette distance vient du fait évident qu’une considération menée
dans le contexte artificiel d’une interview — particulièrement artificiel dans le cas
de Bórmida — n’est pas de même nature que certaines idées appliquées à un
comportement concret. Certes, il s’agit d’une évidence, mais cette distinction nous
permet de comprendre le contraste important entre la description de Bórmida et les
résultats de notre enquête ethnographique. Gastón Gordillo (2006) signale que
70
�Bórmida a identifié la culture ayoreo avec le devoir-être des mythes. Pour Bórmida,
il n’y a pas de contradiction entre la peur omniprésente face aux puyac et la
connaissance limitée des gens ordinaires à propos des infinies circonstances et
endroits où ces interdictions se cacheraient.
La plupart des Ayoreo ne connaissent pas l’immense quantité de puyac que
les cinq informateurs ont racontée. De plus, ils ne semblent pas avoir peur de briser
des tabous qu’ils ne connaissent pas. Il est donc difficile de penser que les Ayoreo
habitent dans un monde aussi asphyxiant que celui décrit par Bórmida. Cependant,
après avoir consulté plusieurs personnes — non seulement à Jesudi, mais aussi dans
d’autres communautés —, nous avons pu trouver des récits de beaucoup de puyac
recueillis par Bórmida. Nous ne doutons pas de la fiabilité de ses données. La
question centrale, en tout cas, n’est pas la connaissance elle-même, mais sa
distribution et la manière dont elle affecte la vie quotidienne. Il faut donc observer
comment cette idée de comportement interdit affecte réellement les pratiques,
étudier ce que les individus font dans leur vie quotidienne.
Bórmida met l’accent sur l’aspect préventif des puyac. L’Ayoreo est
constamment terrifié, nous dit-il, à l’idée de déclencher une tragédie. Il s’agit alors
d’une peur pre facto, avant même de violer une interdiction. À partir de
circonstances concrètes observées à Jesudi, nous trouvons que — en ce qui
concerne le rapport entre le puyac, sa violation et les conséquences attendues — la
dimension explicative du puyac est aussi — voire plus — importante que sa
dimension d’interdiction. Le puyac constitue un mécanisme explicatif utilisé
généralement post facto (cf. Fischermann 1988). Cela implique qu’à partir d’une
conséquence évidente, il faut inférer la cause, c'est-à-dire l’interdiction violée.
La cause n’est pas obligatoirement attribuée tout de suite. Voyons un
exemple. Un cancer du cerveau fut diagnostiqué en mars 2009 à Ebedu Dosapei, le
chef de Jesudi, alors âgé d’une cinquantaine d’années. Les médecins ne pouvaient
donner aux Ayoreo aucune explication sur la cause de cette maladie. Les habitants
de Jesudi ont alors commencé à faire des hypothèses sur les causes probables. Il
71
�s’agissait de faits antérieurs aux premiers symptômes (maux de tête, amnésies) qui
n’étaient pas puyac, comme par exemple le fait d’avoir soulevé un tronc énorme62 .
Aucune cause ne fut établie avec certitude. Six mois après le diagnostic fatal, nous
étions à Jesudi en train de manger. Jnumi Posijñoro, la femme d’Ebedu Dosapei, me
passa l’assiette remplie de l’habituel pot au feu. J’étais allongé sur le sol et j’ai
commencé à manger sans changer de position. Jnumi m’a alors dit avec un air
sérieux que les Premiers Hommes disaient que c’était puyac de manger comme ça,
que si je continuais à le faire, je mourrais. Elle ajouta que l’année précédente,
Ebedu avait mangé ainsi et que c’était à cause de cela qu’il était tombé malade.
Cette explication fut attribuée six mois après le diagnostic et, même si Jnumi le
croyait, elle ne le disait pas avec la fatalité que l’effectivité attribuée mériterait.
Cela nous montre que, même si beaucoup de temps s’était écoulé, la quête d’une
explication continuait.
Le puyac — en tant qu’outil explicatif — est socialement situé. C'est-à-dire
que l’interdiction invoquée dépendra aussi des circonstances personnelles de
l’individu qui propose l’explication. Il est nécessaire de rendre compte du contexte
particulier de l’attribution d’un puyac violé. Un exemple le montrera plus
clairement. En 2009, un Ayoreo d’une autre communauté — qui avait des amis à
Jesudi — est gravement tombé malade. Comme il était marié avec une femme de
son même clan, la première explication entendue était celle de la violation du puyac
de l’exogamie clanique. Or, un couple de Jesudi — formé par deux conjoints du
même clan — soutenait que la cause de cette maladie était ailleurs. Selon eux,
l’épouse du malade avait violé un autre puyac quand elle était jeune, et cette
violation avait provoqué les graves conséquences dont son mari actuel souffrait.
Ces deux explications étaient cohérentes avec la notion de puyac et ses terribles
conséquences. Ce qui faisait la différence était le fait auquel on attribuait la cause,
qui variait en fonction des personnes qui élaboraient l’explication. Ce caractère
protéiforme et opportuniste des croyances a déjà été signalé par Evans-Pritchard
62
Ebedu fut opéré à l'Hôpital National d'Itaugua, situé à 29 km d'Asunción, et il effectua une partie
de son traitement à la petite ville de Capiatá, à 16 km de la capitale (ces deux villes se trouvent dans
l’humide région orientale du Paraguay, vraiment éloignées du Chaco). Après cinq mois de soins, il
put retourner à Jesudi.
72
�(1993 : 492) pour les Azande, mais il faut le souligner face à l’image que nous
donne Bórmida.
II.2.3. Conclusion
Nous voyons alors que dans le cas de l’utilisation de récits et de formules
avec des buts spécifiques — qu’ils soient employés pour guérir, se défendre ou
attaquer quelqu’un —, les phrases ont une importance supérieure à la personne qui
les prononce ou au Premier Homme impliqué.
Le trait commun à tous ces exemples est le caractère puyac, dont la gravité a
peut-être été survalorisée par Bórmida. Or, si on ne prend en compte que les
histoires sur des individus qui ont violé des tabous, on risque d’avoir une
perspective déséquilibrée. Il est nécessaire d'observer des situations concrètes et
d’analyser des contextes particuliers. À partir de cela, on peut dire que puyac a un
rôle important comme outil interprétatif : quand un malheur arrive à quelqu’un, on
essaie de reconnaître dans les faits précédents des signes d’une règle qui n’a pas été
respectée. Cette attribution de causes n’est pas univoque, en raison de l’énorme
quantité de puyac — quelquefois contradictoires — et elle varie selon la
connaissance et — surtout — selon les intérêts de chaque individu. Il ne s’agit pas
d’une pensée dans le vide, mais toujours d’une causalité pensée par quelqu’un.
II.3. Les histoires des origines : le passé dans le présent
II.3.1. Les histoires des origines
Dans cette section, nous parlerons des mythes des Ayoreo. Nous
présenterons très brièvement leur mythologie, nous montrerons la forme générale
des mythes et leurs récurrences thématiques. Nous n’analyserons pas le contenu des
mythes, nous nous concentrerons plutôt sur la narration de ces histoires à Jesudi.
Nous verrons que raconter des histoires des origines produit aussi des effets, mais
d’une manière différente des formules spécifiques vues dans la section I.1.
73
�Lévi-Strauss disait — à propos des Amérindiens en général — que le temps
des mythes était celui où les humains et les animaux n’étaient pas différents. Cela
est vrai aussi pour les Ayoreo. Aux temps des origines, presque toutes les plantes et
tous les animaux actuels étaient des personnes qui ont décidé — ou ont été forcées
—, à un certain moment, d’abandonner leur forme humaine et de prendre la forme
qu’elles ont aujourd’hui. Ces entités étaient les jnanibajade et les chequebajedie,
dont la traduction littérale est respectivement « Premiers Hommes » et « Premières
Femmes ».
Les histoires des origines ont généralement la même structure. C’est
l’histoire d’un homme ou d’une femme dont quelques traits physiques ou
comportementaux préfigurent l’être dans lequel il ou elle se convertira. Quelque
chose lui arrive, généralement quelque chose de mauvais — un accident, une
attaque — et cette entité première décide de se métamorphoser, non sans laisser,
auparavant, des instructions : soit il chante une formule et explique les conditions
d’utilisation et les résultats, soit il annonce explicitement ce qui arrivera à celui qui
racontera son histoire. Voici un exemple classique tiré de Sebag :
Histoire de Gedo Karate
À l’origine, cette étoile était une femme ayorea à la peau blanche. Un jeune
homme la désirait, mais elle ne voulait pas de lui. Alors qu’ils étaient en
train de bavarder, elle regarda soudain de l’autre côté ; lorsqu’elle se
retourna, son interlocuteur lui mit, par inadvertance, le doigt dans l’œil qui
devint tout rouge. La jeune femme sut cependant se guérir elle-même, en
prononçant certaines paroles et en posant ses mains sur son œil. Lasse de
l’existence humaine, elle monta au ciel. Avant de quitter les Ayoreo elle leur
dit que tous ceux qui souffriraient d’un mal semblable au sien pourraient
utiliser son uhnari. (Bernand-Muñoz 1977 : mythe 2 de l’appendice)
Gedo Karate est une étoile rouge. Sidi Posorajãi à Jesudi a signalé une étoile
de Scorpio (probablement Antarès — Alpha Scorpii —) mais selon Fischermann
74
�(1988), il s’agit d’Arcturus. Voyons un exemple de notre enquête ethnographique. Il
s’agit de l’histoire de l’Enfant pluie, racontée par Chicori Dosapei :
Guei adode
Chicori Dosapei : que beque ga jnanione ore chatata, ore chiraja, ga e
beque. A chi baque ga chi chojninga, ga anire, a yicadigui uque que disi i tu,
e ausa to ique udo ?
Alfonso : cama yisa
Chicori Dosapei : disiode chi ore timitingare mu torajni, chi ore pesu
daguijnane, que pimo jeti Noe u nanique,
Alfonso : oique ?
Chicori Dosapei : Jnanibajai Noe, je pimo mu yocaiode chiraja nanique, chi
ore timingare disi udo, cucarane, pidode, chi chosi « ta ta », ga beque, chi
beque ga chi chejna ore, ayoreode, jnanibajai, mu chi ureca ute ayorei, que
toi to, chi mucho yodi itiii, ore toi, jnanibajade, que beque ga ore chatata.
Histoire de l’Enfant pluie
Chicori Dosapei : il ne pleuvait pas et les hommes racontaient cela, ils
savaient, alors il pleuvait. On dit qu’il allait à la forêt et on dit, euh…, j’ai
oublié le nom de l’enfant, tu l’as écrit déjà avant ?
Alfonso : Je ne l’ai pas encore enregistré.
Chicori Dosapei : Les enfants, on dit qu'ils jettent [des pierres] à cet enfant,
on dit qu’ils ont fait leur maison, je ne sais pas si c’était Noé autrefois
Alfonso : Pardon ?
Chicori Dosapei : Le Premier Homme Noé, je ne sais pas mais nos pères
savaient autrefois, on dit que les enfants ont jeté à cet enfant des pierres et
des petits bâtons, et il a fait comme ça « ta ta » et il a plu, on dit qu’il a plu
et ils ont été inondés, les Ayoreo, [du temps du] Premier Homme, mais cet
Ayoreo [est resté] vivant, il n’est pas mort, on dit que beaucoup d’eau
75
�« itiiii » (« jusqu’à là… ! »), ils sont morts. Les Premiers Hommes, [quand]
il ne pleuvait pas, alors ils racontaient cela63 .
La mythologie ayoreo est en fait comme Sebag l’a remarqué, « une
multiplicité de décisions individuelles » (1965b : 117, italiques dans l'original) : les
diverses transformations des êtres ne suivent en général aucune organisation sousjacente, ce qui pour l’auteur est en lien avec le constat de l’importance accordée à
l’individu dans cette société. Cependant, les histoires peuvent être rassemblées dans
des ensembles thématiques, appelés « cycles » par Bórmida et ses élèves (Bórmida
et Califano 1978 : 148, Mashnshnek et Gonzalo, 1988 : 7). Même si certaines
histoires ne pourraient être insérées dans aucun de ces cycles, ils nous permettent
d’avoir une vue d’ensemble du répertoire mythologique.
Le « cycle de Dupade » (divinité solaire assimilée au dieu chrétien) réunit
des mythes concernant la transformation des Premiers Hommes grâce à
l’intervention de cette entité. Le récit parmi les plus cités dans la littérature est
celui où Dupade peint les animaux — généralement des oiseaux — et leur donne
leurs traits caractéristiques. Un corpus rassemble les histoires des Premiers
Hommes, c’est le « cycle des Jnanibajade ». Il correspond le plus à la considération
de Sebag concernant la multiplicité des actes isolés qui ont été à l’origine de
diverses plantes et animaux. C’est là que la forme classique est la plus habituelle :
une entité première subit un événement inattendu, elle décide de se transformer et
de laisser quelques formules magiques à ceux qui restent. Ces deux premiers cycles
rassemblent la plupart des histoires des origines.
63
L’histoire, selon d’autres versions, est un peu plus étendue. D’après le récit de Gayode de la
communauté d’Ebetogue, au Paraguay (AMARILLA–STANLEY 2001 : 113), un Ayoreo se promène dans la
forêt et trouve un enfant, Guei (« Pluie »). L’enfant lui donne de l’eau mais l’homme ne voit pas d’où il a
pu la prendre, alors il lui en demande encore un peu. L’homme, caché, observe que cet enfant fait sortir de
l’eau en tordant ses cheveux. L’homme décide de l’emmener à son campement. Quelques enfants lui
jettent des pierres. Il bâtit une maison et tout de suite un orage avec de la foudre éclate. La pluie provoque
une inondation. Les enfants agresseurs — qu’il a laissés en dehors de la maison — deviennent des
grenouilles et des crapauds.
76
�Le troisième répertoire est celui du « Gedequesnasongi » (« le déluge ») et il
comprend des récits concernant l’histoire de l’Enfant pluie que nous avons
transcrite ci-dessus : maltraité par quelques enfants, il produit une inondation et ses
agresseurs deviennent des crapauds et des grenouilles. Le quatrième corpus, celui
du « Dyotedidequesnasongi » (« l’inondation ») — est aussi rapporté à l’eau et aux
animaux associés, comme dans le répertoire précédent mais avec quelques
variations. Dans ce cas le personnage principal est Diesna, le grillon, il ne s’agit
pas d’un châtiment et les animaux qui en résultent sont les poissons et les oiseaux
aquatiques.
Le cycle de Susmaningai, personnification du courage, rassemble des récits
qui portent sur le grand feu que cette entité première avait fait pour tester le
courage des autres. Ceux qui avaient la bravoure suffisante se jetaient dans le feu,
ce qui leur a donné quelques traits caractéristiques. Les histoires d’Asojna
— l’engoulevent — sont les plus redoutées et logiquement ce dernier est le
répertoire le plus fragmentaire. Il s’agit de l’histoire d’un personnage terrible et
puissant qui ressuscite après son assassinat. L’apparition de cet oiseau en août
marque le début de la saison des pluies.
Finalement, le cycle du fer nous montre que cet élément est parfaitement
intégré à la vie des Ayoreo depuis longtemps. Dans ces récits, il y a un possesseur
du fer — une étoile ou bien le héron — qui est tué pour obtenir le métal en
l’arrachant directement de son corps.
II.3.2. La réification des mythes
Quel est le rôle des mythes dans la vie des Ayoreo ? La question est
complexe et dépasse largement le traitement que nous lui donnerons dans cette
section 64. Nous essaierons cependant, à partir de nos expériences à Jesudi, de
64
Ugo CASALEGNO a consacré une thèse au sujet de leur classification (1985) et BÓRMIDA une série
d’articles sur les rapports entre mythes et ergologie (1973, 1974, 1975, 1976a, 1978-1979a,
1978-1979b).
77
�réfléchir sur le rôle que les mythes ont joué pendant notre séjour. De temps en
temps, les Ayoreo nous racontaient des mythes, c'est-à-dire une sélection d’histoires
qui pouvaient intéresser un anthropologue — et ils savaient pertinemment quelles
histoires étaient susceptibles de susciter mon intérêt. Il s’agissait d’histoires qui
portaient sur les jnanibajade, leurs aventures et leurs métamorphoses. Quelquefois,
ils racontaient aussi des anecdotes de chamans, que Sebag inclut dans le recueil des
mythes mais que Casalegno et Idoyaga Molina laissent en dehors 65. En tout cas,
indépendamment du contenu, il s’agissait, dans ces circonstances, d’histoires qui
étaient réifiées d’une certaine manière.
Nous parlons de réification parce que ces histoires — dans ces circonstances
spécifiques — sont devenues des textes que les Ayoreo pouvaient donner à
l’anthropologue intéressé. Certes, on pourrait dire qu’elles étaient déjà des textes
avant l’arrivée de l’anthropologue. C’est ce contexte d’interactions avec quelqu’un
d’intéressé par la culture ayoreo — qui vient, reste un moment et part — qui fait
que les mythes deviennent des unités fermées et détachées du contexte quotidien.
Ces histoires sont en effet des objets que l’on peut vendre. Quelques personnes
intéressées par le patrimoine des Ayoreo visitaient de temps en temps la
communauté. Elles laissaient un magnétophone ou un enregistreur numérique à
Jesudi et elles enseignaient à un Ayoreo de confiance à s’en servir. Les personnes
âgées devaient remplir les cassettes avec des histoires ou des chants. Quelques
semaines plus tard, ces appareils étaient repris par les chercheurs en question et les
cassettes payées à l’unité ou à l’heure.
Notre collecte était gratuite, néanmoins elle restait quelque peu artificielle.
On pourrait dire — non sans une certaine fierté ethnographique — que c’était plutôt
des Ayoreo que naissait l’impulsion de nous raconter une histoire66. Cela arrivait
parce que les hommes âgés aimaient les raconter, mais aussi parce que leurs enfants
65
À l’exception des histoires à l’origine du chamanisme. (CASALEGNO 1985)
66
Les demandes ou les questions directes n’aboutissaient jamais. Le laconisme des Ayoreo a été
remarqué autant par SEBAG (1969) que par BÓRMIDA et CALIFANO (1978). Avec le temps, nous nous
sommes rendu compte qu’il valait mieux susciter un sujet de conversation en laissant échapper
quelques commentaires « innocents ».
78
�et petits-enfants aimaient les écouter (il reste cependant une troisième possibilité :
ils voulaient nous aider). Mais en dépit de leur pulsion narrative, tout cela nous
donnait l’impression de ne pas faire partie du présent ayoreo, mais d’être quelque
chose d’autrefois, qui était raconté avec nostalgie. L’image du sauvetage du
patrimoine était complète : les sourires des anciens qui parlaient avec des mots
archaïques, la curiosité momentanée des jeunes pour une vie qu’ils n’ont pas eue ni
n’auront jamais, l’anthropologue — gardien de l’intangible — qui enregistrait
« avant qu’ils n’oublient ». Quoi qu’il en soit, même s’ils n’étaient pas payés et que
l’on pouvait apprécier leur envie de raconter, la même logique et le même
détachement du contexte étaient mis en pratique. Il s’agissait de textes enfermés et
isolés de leur vie quotidienne. Ces histoires de « antiguos » — même racontées
spontanément dans les contextes de feux de camp nocturnes — n’étaient autre
chose que des souvenirs du passé.
II.3.3. Les histoires du passé dans le présent
Dans quelle mesure une histoire du passé agit-elle dans le présent ayoreo ?
Ce que nous avons observé à Jesudi concernant trois mythes ne portait pas sur le
passé que ces histoires décrivaient. En fait, le contenu n’était pas indispensable
dans leurs discussions sur ces mythes. L’essentiel était plutôt au-delà des mythes,
dans les conséquences que son énonciation avait produites. L’histoire qui méritait
les commentaires les plus graves était celle du renard, erapujnangue adode.
Un enregistrement de cette histoire fut transmis à la radio. Dans une
émission hebdomadaire d’une demi-heure à Radio Pa’i Puku67 , un Ayoreo qui
travaille depuis longtemps avec des ONG (UNAP et Iniciativa Amotocodie)68
reproduit des chants et des histoires qu’il a enregistrés. L’histoire du renard compte
quelques sous-trames qui sont racontées aussi comme des histoires indépendantes.
Naturellement, les graves conséquences de la narration de ce mythe nous ont posé
67
Cette station est écoutée dans tout le Chaco paraguayen, elle constitue un moyen de
communication. Nous parlerons plus en détail de Radio Pa’i Puku dans la troisième partie.
68
Unión Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) http://www.iniciativa-amotocodie.org/unap/;
Iniciativa Amotocodie http://www.iniciativa-amotocodie.org/
79
�des problèmes pour en enregistrer une version à Jesudi. La seule version nous a été
racontée par Chicori Dosapei, mais elle est très fragmentaire69 . Voici un résumé de
l’histoire, d’après une version donnée par Irodi de la communauté d’Ebetogue et
recueillie par Amarilla-Stanley :
Quand les oiseaux étaient des personnes, ils sont allés chercher du poisson
dans une lagune. Ils en trouvèrent beaucoup et décidèrent d’en laisser
quelques-uns dans un puits. Erapujnangue, une femme, était avec eux. Les
pêcheurs sont rentrés au campement mais cette femme est restée en arrière,
sous prétexte d’arracher une épine de son pied. Elle y retourna et ouvrit le
puits mais tous les poissons s’échappèrent. Les pêcheurs de la communauté
la soupçonnèrent. Les pêcheurs revinrent, trouvèrent le puits ouvert et
décidèrent de tuer Erapujnangue, qui était cachée sous une écorce d’arbre.
Kiraquirai, chaman et inventeur de la pipe, la trouva. Ils décidèrent de
l’amener sur un arbre et d’avoir des rapports sexuels avec elle là-haut, où ils
la laissèrent. Elle se lamenta de ne pas pouvoir descendre et le lézard
entendit ses soupirs. Le lézard lui dit de prendre sa salive et de descendre.
Après quelques hésitations, Erapujnague descendit sans problème. Elle avait
faim et prit une cigogne qui finalement s’échappa. Après tout cela elle
commença à sentir l’odeur d’une pipe. Elle la trouva et la prit. Kiraquirai, le
chaman, voulait fumer mais il ne pouvait pas trouver sa pipe. On lui a dit
que le renard avait dû la prendre. Kiraquirai la trouva dans un puits. Il
appela ses amis et tous ensemble ils la tuèrent. Ils prirent sa peau et la
jetèrent dans les arbres. (2001 : 10-14).
69
Chicori Dosapei avait en fait seulement imité (le verbe en ayoreo est –irate et nous le verrons
après) ce qu’il avait entendu dans un enregistrement fait à Maria Auxiliadora par John RENSHAW
dans les années 1970. Un Ayoreo avait une cassette avec les enregistrements de RENSHAW, dont nous
avons fait la copie. À la demande des Ayoreo, nous l’avons reproduite avec notre enregistreur et un
haut-parleur. Ils aimaient ces histoires racontées par Acui ou Lazaro, un grand chaman, père adoptif
de Toto Étacori (et qui est le protagoniste de la guérison chamanique décrite par SEBAG 1965a : 7).
Étant donné que nous n’avions pas demandé la permission à RENSHAW, nous avons décidé de le
jouer autant de fois que les Ayoreo le voulaient à Jesudi (vraiment beaucoup de fois), mais de ne pas
utiliser le matériel contenu dans notre analyse. Les effets que ces histoires ont produits se sont
passés, par contre, dans le cadre de notre terrain.
80
�La dernière partie, l’épisode avec la pipe de Quiraquirai, se trouve aussi
dans la série d’histoires qui racontent l’invention de la pipe et du chamanisme
(Bernand-Muñoz 1977 : mythes 35 à 38).
Une version plus ou moins raccourcie est celle transmise par la radio. Nous
ne l’avons pas entendue lors de notre enquête ethnographique, mais nous avons été
témoins de ses effets. D’après leurs explications, une fois que Sobode — le
conducteur du programme — eut passé l’enregistrement, les couples Ayoreo ont
commencé à se séparer. Ou bien la femme quittait son mari et partait avec
quelqu’un d’autre, ou bien c’était l’homme qui tombait dans l’infidélité. Tamocoi
Dosapei, âgé de 31 ans en 2008, était marié avec Lucía Posijñoro depuis longtemps.
Ils avaient quatre enfants. Tout au long de 2009, ils ont eu des disputes à cause des
infidélités de Tamocoi à l’intérieur et à l’extérieur de Jesudi. Selon Tamocoi, avant
l’émission il n’avait jamais eu de problèmes avec Lucía. Selon les Ayoreo, une fois
l’histoire racontée, ces disputes ont commencé à apparaître partout. Ils n’ont jamais
expliqué la façon dont le récit avait provoqué ces faits.
Une dispute entre mari et femme n’est pas une affaire isolée qui affecterait
seulement les deux personnes concernées. Dans une communauté aussi petite que
Jesudi, où les liens sont très étroits et où presque tout le monde est littéralement à
portée de vue, ces tensions nées au sein d’un couple se répercutent sur tout le reste
du réseau social. Cette sorte de dispute affecte les rapports entre les ogadode70 , les
unités résidentielles. Quand tout allait bien, Lucía et Tamocoi ne suivaient pas la
règle d’uxorilocalité, ils habitaient dans l’ogadi de Dosapei. Dans ce contexte
conflictuel, Lucía a dû retourner à l’unité résidentielle de ses parents, Bajai et Daju,
ce qu’elle n’aimait pas du tout 71. Lucía est partie à l’ogadi de Bajai avec ses enfants
et menaçait de déménager définitivement à Maria Auxiliadora, où son père adoptif
habitait. Cette possibilité de ne plus voir Tu, sa petite-fille, rendait Jnumi — mère
70
Sing. ogadi, pl. ogadode.
71
Fille aînée de Bajai Posorajãi et Daju Étacõro, ses parents n’ont pas voulu l’élever pendant ses
premières années. Un autre homme l’avait élevée pendant son enfance. Lucía s’est toujours montrée
distante avec ses géniteurs biologiques, surtout avec Bajai.
81
�de Tamocoi — très triste. Jnumi, nous le verrons plus en détail dans la deuxième
partie, est très importante dans la vie sociale et politique de Jesudi. Elle exerce
consciemment une influence sur les décisions des chefs et sur les affaires
familiales. Cela veut dire qu’elle rejetait les occasionnelles nouvelles épouses de
Tamocoi, ou bien influençait les décisions des enfants d’accompagner ou non leur
père. Si Tamocoi partait, cela affecterait aussi les rapports politiques de Jesudi.
Tamocoi est quelqu’un de charismatique qui a de bons rapports avec les patrons
mennonites de la zone et sait organiser des projets économiques, alors que le reste
des hommes se limite à collaborer avec leur force de travail. Cela dit, même si le
couple affecté n’est pas celui de Tamocoi et Lucía — issus des ogadi des Dosapei et
de Bajai —, des conséquences similaires se produisent, surtout si on rappelle que la
migration est une réponse possible et assez pratiquée pour faire face aux tensions
sociales.
Le mécanisme de fonctionnement des mythes n’a jamais été explicité par les
Ayoreo. Tamocoi, Jnumi, Pojnangue, tous indiquaient le lien étroit entre la
narration des adode (« histoires ») du renard et les disputes et infidélités qui
suivirent. Cependant, ils ne doutaient jamais de l’efficacité de ces énonciations,
mise en relief par l’énorme degré de responsabilité qu’ils attribuaient à Sobode
dans ces conséquences sur les couples de Jesudi et ailleurs. Chaque fois que les
nouvelles d’une séparation arrivaient à Jesudi, l’expression — presque
obligatoire — était « Erapujnague adode ! » (« C'est [à cause de] l'histoire du
renard ! »).
Nous pouvons essayer de dégager quelques traits particuliers des mythes qui
s’opposent aux formules vues dans les sections précédentes. Les effets de ces
formules étaient ciblés : il y a des formules pour guérir des maux spécifiques qui
sont clairement nommés dans les phrases. Dans le cas des mythes, les effets qu’ils
produisent ont certainement un rapport avec l’histoire racontée, mais il n'y a pas
d’allusion directe et précise — comme dans les cas des formules de guérison —
cela reste dans la référence thématique. Raconter l’histoire de l’Enfant pluie fait
pleuvoir mais cet évènement n’est qu’un épisode de l’histoire parmi d’autres. Dans
82
�l’histoire du renard, qui provoque des infidélités et des séparations, on trouve un
épisode de promiscuité : la femme a des rapports sexuels avec beaucoup d’hommes.
L’histoire de burhote72 raconte qu’elle était une femme qui connaissait bien les
techniques artisanales et qui s’est transformée en oiseau. Cette histoire fait que les
femmes peuvent tisser des sacs en fibre végétale sans se fatiguer. Les effets que ces
histoires produisent sont un écho des quelques événements racontés, mais il n’y a
dans le récit aucune énonciation directe de ces conséquences ou d’une
intentionnalité qui puisse les provoquer.
L’énonciation est clairement différente dans le cas des formules ciblées et
dans celui des mythes, ce qui explique justement les rapports différents de ces
narrations avec les conséquences qu’elles peuvent entraîner. Dans le cas de
formules de guérison, l’énonciateur parle à la première personne du singulier :
Formule du serpent73
Je suis très puissant… !
Les autres animaux ne m'attaquent pas
J'ai des crocs très blancs... ! […]
Selon l’interprétation d’Idoyaga Molina, Mashnshnek et Bórmida, il y a, au
moment de l’énonciation, une réactualisation méta-temporelle du passé mythique,
où la puissance du Premier Homme agit à nouveau. Même si nous ne sommes pas
d’accord avec tous les détails de l’explication donnée par les membres du CAEA,
on peut constater que dans la plupart des formules de guérison, il y a une claire
mise en relief de la maladie, du processus de guérison et du résultat final, ainsi
qu’une identification de celui qui souffle avec l’entité première : au moment de la
récitation, les mots du souffleur sont les mots du jnanibajai (Premier Homme). Il
n’y a aucun détachement, aucune indication de discours rapporté du style « c’est
cela que tel jnanibajai disait dans telle circonstance ». Cette distance, par contre,
est la marque distinctive de la narration de mythes.
72
73
Cacique solitaire, Cacicus solitarius.
Formule du serpent, utilisée pour guérir les morsures du serpent (RIESTER et ZOLEZZI 1999 : 36).
83
�Dans le récit que nous avons transcrit de Chicori, on peut le voir clairement.
C’est la particule « chi » qui est traduite par « on dit que » :
A chi baque ga chi chojninga, ga anire, [...] disiode chi ore timitingare mu
torajni, chi ore pesu daguijnane [...]
On dit qu’il allait à la forêt et on dit qu'il a dit, euh… [...] Les enfants, on dit
qu'ils jettent [des pierres] à cet enfant, on dit qu'ils ont fait leur maison [...]
Elle est utilisée pour introduire le discours rapporté. Selon le dictionnaire
des New Tribes Mission chi signifie « it is said ; he/she/it says ; they say that…[…]
Note : used when quoted indirectly. » (Higham et al. 2000 : 205). Nous pouvons
voir dans la première et la dernière ligne du récit que Chicori ne l’utilise pas. C’est
quand il parle du contexte de la narration — contexte dont il a été témoin — : les
hommes racontaient cette histoire quand il ne pleuvait pas. Une fois que l’histoire
commence, il s’agit de quelque chose qu’il n’a pas vu, ce sont des événements dont
il a entendu parler, mais dont il n’a jamais été témoin. Le rapport avec les
évènements racontés est alors plus vague. Il faut rappeler que les adode et les
formules — puisqu’elles en font partie — appartiennent au temps des Premiers
Hommes, d’autrefois (« nanique... ! »), que les Ayoreo n’ont jamais vécu.
La différence la plus nette entre ces deux types de récits est la manière
d’établir le rapport avec les événements qu’ils racontent. Ce rapport est mis en
pratique par l’énonciation, ce qui à son tour produit des effets plus ciblés et clairs
ou bien des conséquences floues en ce qui concerne son explicitation dans les
histoires citées.
84
�Formules de guérison sarode
Histoires des temps premiers adode
Discours direct
Discours rapporté
1ère pers sg. : … uyu eeee ! (« je
suis… ! »)
3ème pers. sg. : chi « on dit que… »
Actualisation dans le présent
Action dans le passé : nanique
(« autrefois »)
Effet direct, ciblé et énoncé clairement
dans la formule ; intentionnalité
exprimée
Effet rapporté à l’histoire ; allusion
Cette marque de discours rapporté, chi, signale aussi une autre
caractéristique des histoires des origines : elles n’ont pas d’auteur. Bien que Chicori
Dosapei ou Toto Étacori les racontent, personne n’est jamais censé en être l’auteur.
Cela n’empêche pas que du prestige soit accordé à ceux qui les racontent le mieux,
autrement dit, ceux dont la narration entraîne le plus de conséquences. Chicori avait
l’intention de provoquer la pluie quand il nous a narré les Guei adode. Cela faisait
quelques jours qu’il ne pleuvait pas, pourtant rien n’est arrivé après sa narration.
Quelques semaines plus tard, c’est Toto qui nous a raconté sa version. Cette fois-là,
il a plu et Toto insistait sur le fait que cela prouvait qu’il en savait beaucoup,
contrairement à Chicori. Nous avons constaté, en tout cas, que certains individus
sont censés connaître les histoires des origines mieux que d’autres74. En revanche,
les formules de guérison ont un auteur : le Premier Homme qui a laissé ces
formules aux hommes.
II.3.4. Conclusion
En parcourant l’histoire des formules et des mythes racontés à Jesudi, naît la
conviction que toute parole provenant du temps des origines produit des effets. Le
maigre répertoire que nous avons pu recueillir pourrait transmettre l’idée simple
d’une dégradation culturelle (Sebag 1965b : 93), l’idée selon laquelle le silence des
74
Dans le cas de Jesudi ce sont des hommes et femmes âgés : Chicori Dosapei, Toto Étacori, Sidi et
Bajai Pososorajnai, et Caitabia Picanerai.
85
�mythes est indicateur de leur absence. Bien au contraire, nous avons mieux pu
comprendre le rôle des mythes dans la vie des Ayoreo quand ils ne voulaient pas les
raconter. Comment ne pas arriver à la conclusion, même si elle paraît
contradictoire, que les conséquences du fait d’avoir prononcé certaines phrases sont
plus importantes pour notre recherche que les phrases elles-mêmes ? Quand nous
avons recueilli des mythes de façon classique, nous étions à vrai dire en train
d’enregistrer des réminiscences : « on dit que cette histoire faisait que les tapirs
venaient à la rencontre du chasseur ». Non, ces histoires anciennes ne font pas
partie de la vie des Ayoreo de 2008. Mais nous avons vu qu’il y a d’autres histoires
— au moins trois — qui ont des conséquences, qui jouent un rôle dans leur vie
actuelle. La plus importante de ces histoires est celle du renard, en raison des effets
puissants qu’elle suscite. Erapujnangue adode bouleverse les rapports d’amour
entre hommes et femmes : sa narration inspire des infidélités et produit des
séparations. Curieusement, c’est de ces questions dont parlent la plupart de la
centaine de chants profanes qu’il m’a été possible d’enregistrer à Jesudi,
compositions qui constituent le cœur de cette thèse.
II.4. Les chamans retraités, les sarode et les pilules de l’homme blanc
II.4.1. Introduction
Les Ayoreo n’avaient pas une ethnopharmacologie très développée. Selon le
travail pionnier de Schmeda-Hirschmann (1993 : 107), ils connaissaient une
vingtaine de plantes avec des utilisations médicinales. Lind, pour sa part, qui
consacre une thèse doctorale à la médecine des Indiens ayoreo, ne mentionne que le
tabac en ce qui concerne les plantes utilisées à des fins thérapeutiques ou rituelles.
Dans notre enquête ethnographique, nous avons été témoin seulement de
86
�l’utilisation de Palo azul (Cyclolepis genistoides)75 dans l’eau du tereré76 , pratique
qui leur a été apprise par les Paraguayens. Par ailleurs, quand nous évoquons les
difficultés actuelles d’accès aux soins de santé des Ayoreo, ils rappellent que, dans
le monte (mot qu’ils ont pris pour désigner la vie — un peu idéalisée — dans la
forêt avant le contact avec l’homme blanc), soit ils ne tombaient pas malades, soit
les gens d’avant connaissaient beaucoup de sarode, les formules de guérison.
Les formules sarode sont des phrases laissées par les Premiers Hommes et
dont la simple énonciation permet de guérir une maladie ou de faire disparaître une
douleur. Chaque formule a son origine — son instauration — dans un mythe : c’est
un jnanibajai, un Premier Homme, qui l’octroie aux humains avant de quitter son
apparence humaine. Il prononce les mots et indique les circonstances exactes dans
lesquelles cette formule pourra être utilisée. Énoncer les sarode au mauvais
moment peut provoquer la maladie ou les blessures qu’ils sont censés guérir. Ces
formules de guérison sarode ne sont pas exclusives du chaman. En fait, elles
peuvent être utilisées par celui qui connaît les mots et les circonstances appropriées
pour son utilisation. Comme nous l’avons montré dans la section II.2.1, le pouvoir
appartient aux mots, non à la personne qui les énonce occasionnellement.
Les descriptions par Sebag (1965b) et Lind (1975) de la guérison avec des
formules sont très semblables. Le guérisseur fume la pipe mais retient la fumée. Il
souffle la fumée sur la partie affectée du malade tout en prononçant le sarui. Or, en
ce qui concerne le mécanisme de la guérison, Sebag et Lind nous offrent des
interprétations légèrement différentes. Selon Sebag, la maladie s’évanouit, ce n’est
pas une entité mais quelque chose d’impersonnel qui disparaît du corps. Selon
Lind, au contraire, c’est l’esprit de la maladie qui est chassé hors du corps affecté.
Malgré cette interprétation de Lind, nous pensons que dans le cas de la guérison
avec des sarode, la maladie n’est pas conceptualisée comme une entité. Du moins,
ce n’est pas une entité qui pourrait décider de ne pas sortir du corps, elle agit
75
ZULOAGA et al. 2008.
76
Infusion des feuilles de Ilex paraguariensis. Cette infusion est bue dans un récipient — guampa —
rempli de feuilles, sur lequel on verse de l'eau froide. On aspire l'infusion par le biais d'un petit tube —
bombilla. Les Paraguayens ont l'habitude de mettre des plantes médicinales pilées — dont le Palo azul —
dans la bouteille isotherme d'eau froide.
87
�presque automatiquement, elle répond à des influences externes : soit elle est attirée
par un tabou violé et s’introduit dans le corps de la personne, soit elle est chassée
par une formule magique. Ce qui s’oppose à la maladie n’est pas une entité non
plus, c’est la formule — quelques phrases — laissée par un Premier Homme. C’est
comme si maladie et guérison faisaient preuve d’un faible degré d’intentionnalité.
C’est la formule qui agit presque mécaniquement —indépendamment de la
personne qui la prononce —, et c’est de cette manière que la maladie répond. Dans
le cas de l’attaque chamanique, c’est totalement différent.
II.4.2. Les sarode et les chamans du temps de Sebag et Lind
Nous verrons maintenant le chamanisme ayoreo décrit par Sebag en 1965.
En fait, le chamanisme en tant que tel n’est pas le sujet de nos réflexions, nous ne
nous intéressons pas à tous les aspects du métier, mais seulement à ceux qui sont en
rapport avec la guérison de maladies. Plus précisément, nous nous intéressons à la
manière dont une maladie est conceptualisée lorsqu’un chaman entre en scène.
Sebag a observé deux guérisons chamaniques et il nous a laissé dans ses
publications posthumes une description de l’une de ces séances. Nous la
reproduisons ici presque entièrement :
[…] Cette nuit […] revêt une importance particulière : un homme est
gravement malade et il a demandé les soins du chaman. Celui-ci est assis au
milieu du cercle des hommes ; il parle peu et ne trahit nulle impatience. […]
Soudain le chaman tire sa pipe du sac qui est à côté de lui et commence à
fumer, aspirant à pleins poumons de grandes bouffées qu’il ne rejette pas.
Entre chacune d’elles s’écoule un long intervalle au cours duquel, bouche
fermée, joues dilatées, il semble chercher à faire pénétrer la fumée en son
corps le plus profondément possible. C’est un moment très délicat : les
lèvres sont serrées, tous les muscles sont bandés, rien ne sort par le nez ; il
est couvert de sueur. Lorsque la fumée a pénétré jusqu’aux moindres recoins
88
�de son corps et « imbibé ses os », il porte de nouveau la pipe à ses lèvres.
Progressivement il commence à trembler : lorsqu’il est tout entier la proie de
ce tremblement il amorce son chant. Celui-ci commence très bas et ne dure
au début que quelques secondes ; à plusieurs reprises le chaman l’interrompt
pour tirer une nouvelle bouffée. Il est encore assis mais le tremblement s’est
accentué, ses gestes sont devenus mécaniques comme si l’homme n’obéissait
plus qu’à une injonction étrangère. Le chant se fait plus fort et les
interruptions s’espacent. L’homme commence à se redresser et à mouvoir
son corps. Tout s’accélère : il chante, s’arrête pour fumer puis donne sa pipe
à l’un des assistants pour qu’il la recharge, sans jamais cesser de trembler ; il
appuie sa main droite sur sa cuisse, imprimant à tout son corps un
balancement d’avant en arrière, orienté dans les diverses directions de
l’espace ; subitement il se dirige vers le malade qu’il n’a jusqu’alors pas
même regardé, s’accroupit et, d’un geste sauvage, avec violence, sous le
coup d’une impulsion irrésistible, porte à ses lèvres la partie atteinte et
commence à la sucer. Puis, sans lui prêter attention, il s’éloigne du patient de
la même démarche automatique. Il recommence alors à chanter, mais des
spasmes l’interrompent. Il est aux prises avec l’objet porteur de maladie
qu’il a extrait du corps du malade et avalé ; les bruits de gorge se
multiplient, car l’effort qui lui est demandé pour vomir est grand. Puis dans
un ultime sursaut il rejette le mauvais objet, épine, caillou, morceau de
caoutchouc, cheveu, petit animal, etc. Il le montre alors à tous les assistants,
mais son regard figé porte bien au-delà des spectateurs et il ne prononce pas
un mot. Enfin, toujours de cette allure scandée, il s’éloigne du groupe et va
enterrer la maladie à l’extérieur du village, derrière les maisons. Ceci fait, il
revient vers le cercle des hommes, reprend sa place et progressivement
retrouve son calme ; les femmes que la cérémonie a attirées rejoignent leur
groupe et les conversations recommencent tandis que le malade, aidé par son
épouse ou un ami, reprend le chemin de sa maison (1965a : 7-8)
L’initiation chamanique des Ayoreo étonnait Sebag par sa simplicité. En fait,
marquant un contraste important avec d’autres cultures des basses terres sud89
�américaines, l’initiation est très brève et il n’y a aucune condition préalable pour
l’aspirant. L’initiation consiste tout simplement à boire un litre de jus de tabac. Si la
personne ne vomit pas, elle tombe dans le coma pendant un ou deux jours. Dans ce
rêve, le futur chaman communique pour la première fois avec le monde des esprits.
Son oregate — le principe animique qui peut sortir du corps — voyage à la
rencontre des esprits qui lui donnent du pouvoir et des informations. Le puopie —le
pouvoir contenu dans le tabac — pénètre en lui s’il ne vomit pas et permet à son
oregate d’en sortir. Lors de chaque nouvelle séance, il suffira de fumer et d’avaler
la fumée pour, en quelque sorte, réactiver cette capacité acquise. Par ailleurs,
aucune condition n’est requise pour celui qui veut essayer de devenir chaman. Il
n’est pas nécessaire d’être fils de chaman, ni d’être visité par une entité quelconque
au cours d’un rêve. Il suffit tout simplement de se soumettre à cette initiation brève
mais violente : l’ingestion du jus de tabac.
La séance chamanique implique un fonctionnement de la guérison tout à fait
différent du sarode. Selon Sebag (1965a : 15), l’oregate du chaman rend visite à
l’esprit animal, qui lui donnera — ou non — le droit et le pouvoir de guérir le
malade. Une fois cette visite réalisée, le chaman sucera du patient l’oregate de la
maladie. Cette succion aura pour résultat une manifestation physique de la maladie
— un caillou, une pointe de flèche, etc. —, que le praticien montrera au public.
Sebag oppose la guérison accomplie par les chamans à l’utilisation des
formules sarode, qu’il appelle « la seconde technique de guérison » (1965b : 92).
Même si l’auteur met en relief toute une série de traits permettant d’établir cette
opposition, il souligne l’antithèse principale entre sucer et souffler. C’est à partir de
là que le reste des traits sera organisé.
D’après Sebag, le rapport avec la fumée et le puopie (la puissance contenue
dans le tabac) est différent dans le cas du sarode. Quand on va souffler, il faut
fumer et avaler la fumée avant de commencer. Même si cela est nécessaire, le
pouvoir puopie n’est pas impliqué ici (il ne pénètre dans le corps que si l’on a bu du
jus de tabac). Par ailleurs, l’entraînement des praticiens est inexistant dans le cas
90
�des formules. Celui qui souffle n’a pas appris son art des entités — comme dans le
cas de l’expérience chamanique —, mais de ses aînés qui les lui ont transmises
depuis des générations. En ce qui concerne le pouvoir de la parole, Sebag souligne
d’un côté, l’absence totale de mots dans le cas de la succion et, de l’autre,
l’importance primordiale des phrases dans la technique des formules soufflées.
Selon lui, le chaman extrait la maladie qui est rendue visible par le biais d’un
morceau de bois, tandis que le souffleur entraîne la dissolution de l’agent nocif.
Le lien étroit avec les jnanibajade (les Premiers Hommes) est renforcé dans
les deux cas de manières différentes. Dans le cas du chaman, il consulte ces entités
qui lui octroient la permission et le pouvoir de guérir. Dans le cas du souffleur, il
prononce une phrase qui a été créée par un Premier Homme lors de sa
métamorphose en plante ou en animal. Sur ce point, Sebag signale une autre
différence entre les deux techniques : il y a une formule spécifique pour chaque
maladie, alors que dans le cas du chaman les esprits consultés sont censés guérir
toutes les maladies.
John Renshaw (2006 : 401) a signalé que cette opposition est une donnée qui
correspond davantage à l’inspiration structuraliste de Sebag qu’à la pratique des
Indiens. L’auteur a été témoin des cas où les formules de guérison étaient
combinées avec la succion. Ces exemples n’invalident pas cependant la grande
opposition proposée par Sebag, mais ils nous aident à percevoir son caractère
excessivement tranchant.
Même s’il existe des cas comme ceux signalés par Renshaw, il n’est pas
inexact de dire qu’il y a deux domaines de guérison. Deux tendances opposées pour
concevoir la maladie coexistent, bien qu’elles ne soient pas complètement séparées
dans la pratique, comme le voudrait le cadre d’oppositions de Sebag.
Deux techniques de guérison impliquent deux dynamiques différentes de la
maladie. Dans un cas, c’est le chaman, quelqu’un de spécialisé, qui envoie son
oregate consulter une entité pour revenir ensuite et guérir le patient. Dans l’autre,
91
�c’est une formule qui agit quand elle est prononcée par quelqu’un — qui que ce
soit — connaissant les mots.
Dans le cas des formules de guérison, nous voyons l’utilisation de
techniques qui présentent une certaine tendance à l’automatisme, à l’indépendance
des individus concernés dans un cas particulier. Il s’agit de techniques centrées sur
le symptôme et sur l’élément qui guérit : le mal au ventre et le sarui pour le ventre.
Il y a bien sûr des entités impliquées, en effet ce n’est pas un monde mécanique
comme le Pleroma de Gregory Bateson (1979). Mais il s’agit en fait d’un
fonctionnement mécanique dans un monde animiste. Ces entités ne sont pas
vraiment invoquées, elles ne sont pas appelées et on ne mène pas un dialogue avec
elles à la fin duquel elles pourraient refuser d’agir. C’est plutôt leur pouvoir qui est
mis en action par le biais des phrases qu’elles ont laissées. Ce sont les mots qui
produisent un effet (ou le contraire) en fonction des circonstances, indépendamment
de l’individu qui les énonce. L’exemple de Sebag est clair : une formule qui guérit
la morsure d’un serpent provoquera ce malheur si elle est chantée quand personne
n’a été attaqué par un ophidien. Dans ce cas, que la maladie s’évanouisse (Sebag)
ou que son esprit soit chassé (Lind), il n’y a aucune manifestation physique de la
guérison, à part la disparition des symptômes.
Les cas de guérison où le chaman intervient présentent de nombreuses
différences. Contrairement au cas précédent, on voit mieux la présence des
individus en action. La maladie, quels qu’en soient les symptômes, est une oregate
qui s’est introduite dans le corps de la personne. Le chaman — quelqu’un de
spécialisé — doit l’extraire, après avoir interagi avec une entité et lui avoir
demandé le droit et le pouvoir de guérir. C’est le chaman qui agit — pas quelques
phrases anciennes — et c’est son prestige qui augmentera ou diminuera après la
séance, selon la qualité des résultats. Il peut arriver que la maladie ait été induite
par un chaman ennemi, ce qui fait du corps du patient un champ de bataille entre
deux individus. De plus, une fois la succion accomplie, le chaman montrera un
morceau de bois, une pierre, des clous, un serpent, comme résultat de sa réussite.
Cet élément enlevé par le chaman est quelque chose de visible et de tangible, une
92
�évidence concrète de la maladie. Cette démarche est quelque chose
d’impressionnant qui a un fort impact sur le public.
Une différence générale entre ces deux techniques — néanmoins très
importante pour notre recherche — est la gravité des cas auxquels elles
s’appliquent. Les sarode, d’après Renshaw (2006), s’appliquent à des maux
mineurs 77, tandis que les traits de la guérison chamanique suggèrent une gravité
majeure. D’abord, les sarode sont récités et s’ils n’ont pas d’effet, il faut faire appel
à un chaman, un spécialiste qui se consacrera à ce cas particulier. Cela veut dire que
la puissance des formules laissées par un Premier Homme dans le passé n’a pas
suffi. Le chaman doit alors rencontrer un jnanibajai dans le présent, qui lui
transmet la capacité de guérir dans ce cas spécifique. L’aboutissement de la
technique, avec l’enlèvement spectaculaire d’un objet du corps du patient, est bien
plus frappante que l’évanouissement progressif des symptômes.
À partir des ethnographies des années 1960 et 1970, nous pouvons relever
deux catégories de techniques de guérison qui s’opposent selon plusieurs aspects.
Ces techniques étaient clairement présentes pendant qu’il y avait encore des
chamans en activité et des personnes qui connaissaient des formules. Quarante ans
après, les chamans sont « à la retraite » — ce qui ne veut pas dire que le chaman est
décédé, mais qu'il parle de ce qu'il faisait comme quelque chose du passé, quelque
chose qui ne le caractérise plus —, d’autre part, très de peu de formules sont encore
connues et employées par les Ayoreo. La médecine des Blancs a pris une grande
place dans le Chaco, malgré les difficultés d’accès à la santé publique. Il faut
explorer les pratiques des Ayoreo dans un contexte où l’accès aux sarode est
presque aussi limité que l’accès aux médicaments.
77
« O sopro geralmente é usado para curar doenças menores, enquanto a sucção é usada para
curar doenças mais séries ou crônicas e pode envolver a remoção de objetos grandes » (2006 : 401)
93
�II.4.3. Les sarode et les pilules
Quelle est aujourd’hui l’importance des sarode dans la vie quotidienne des
Ayoreo ? De nos jours, ils ont accès aux médicaments des Blancs, ils vont à
l’hôpital, leurs fluides sont analysés, ils suivent — pas toujours strictement — les
traitements prescrits, et finalement ils sont plus ou moins guéris. On pourrait penser
que tout cela minerait la croyance en l’effectivité des sarode ou des chamans, vu
que très peu de personnes connaissent et emploient ces formules magiques et
qu’aucun des anciens chamans ne pratique encore cette profession. Lind (1975:
295) signalait déjà en 1970 un affaiblissement des méthodes traditionnelles de
guérison, dû à une combinaison de l’efficacité de la médecine des Blancs avec
l’association — établie par les missionnaires — entre des éléments de la culture
ayoreo et des puissances diaboliques78. Or, la situation aujourd’hui est bien plus
complexe. D’un côté, la médecine des Blancs n’est pas tellement efficace et ne peut
expliquer tous les symptômes. De l’autre, bien que les jeunes ne connaissent pas les
formules magiques et que les anciens ne se souviennent que de quelques-unes
d’entre elles, leur effectivité n’est pas mise en cause. Ces traditions médicales
issues de cultures différentes coexistent chez les Ayoreo de Jesudi et il faut préciser
de quelle manière.
Renshaw (2006) consacre un article à la réflexion sur l’efficacité symbolique
des formules de guérison des Ayoreo. À partir du célèbre article de Lévi-Strauss sur
le chamanisme des Cuna (1949a), Renshaw analyse les sarode. Son but est de
comparer les visions ayoreo et occidentale des expériences de la maladie et de la
santé (Renshaw 2006 : 394). L’auteur n’adhère pas aux idées soutenues par LéviStrauss dans La pensée sauvage (1966), mais plus particulièrement aux idées
fondamentales de l’œuvre : la distinction entre un mode de pensée mythique et un
autre scientifique — et les concepts de bricoleur et d’ingénieur. Renshaw ne
considère pas que les modes de pensée occidentale et non occidentale soient
différents. Il ajoute que les Ayoreo n’auraient pas pu survivre aux dures conditions
78
« Die europäischen Medikamente werden für fähig gehalten, den Krankenheitsgeist oder den
Fremdkörper zu vertreiben und zu zerstören. Durch die Gleichsetzung mancher Wesen, die dem
Schamanen und Spruchkundigen Hilfestellung leisten sollen, mit teuflischen Mächten ist die autochthone
Medizin zum Teil im Misskredit geraten » (LIND 1975: 295).
94
�du Chaco, s’ils n’avaient pas eu une connaissance précise —voire scientifique —
de leur environnement.
Dans le cas particulier des sarode, Renshaw rejette, comme nous l’avons vu
précédemment, l’opposition établie par Sebag entre succion et souffle. Ce qui nous
intéresse dans sa contribution est la manière dont il aborde la question de
l’efficacité de ces formules. Renshaw se concentre sur l’interprétation que l’on peut
en déduire une fois que le sarui a été employé : si la maladie ou le mal a disparu,
on peut penser que la formule a accompli sa tâche. C’est la même chose — signale
l’auteur — quand nous, les Occidentaux, prenons des antibiotiques : après avoir
surmonté la maladie, on ne se demande pas si on aurait pu guérir sans prendre de
médicaments, en laissant le corps agir tout seul. C’est le même processus en cas
d’échec : on utilise un autre sarui dans le cas des Ayoreo, on prend un autre
médicament dans le nôtre. En aucun cas on ne met en doute l’effectivité des
formules magiques ou de la pharmacologie. En d’autres termes, du point de vue de
l’effectivité — et n’oublions pas que les sarode sont utilisés pour des maux mineurs
—, Renshaw propose une équivalence entre médicaments et formules magiques. En
définitive, dans les deux cas, l’effectivité, c’est-à-dire le principe qui guérit, est
attribuée à l’objet — que ce soit une formule ou une pilule — employé pour la
guérison. La préparation de celui qui chante n’est pas pertinente, de la même
manière que les pilules agissent indépendamment de la personne qui les a
prescrites.
Avant de continuer, il est nécessaire de présenter, au moins très brièvement,
la situation actuelle des Ayoreo en ce qui concerne leur accès aux services de santé
et surtout l’importance qu’ils leur attribuent. Le contraste entre la vie d’autrefois et
la vie après le contact trouve son expression aussi dans le domaine de la santé. À
Jesudi, les personnes âgées issues de la première génération insistaient fortement
sur le fait que, pendant la vie dans le monte, il n’y avait pas de maladies. Même si
cela pourrait être en fait une idéalisation de cette vie, il est important de rappeler
que dans les temps immédiatement postérieurs au premier contact avec les Blancs
dans les années 1960 et 1970, des épidémies de rougeole et de grippe sont
apparues, réduisant drastiquement leur population. Ce fut un moment terrible. Selon
95
�Caitabia Picanere qui était à Fortin Batista (de la New Tribes Mission), les gens
étaient tellement affaiblis qu’ils ne pouvaient même pas chanter pour les nombreux
morts. La situation actuelle, bien que les campagnes de vaccination des années
1970 aient favorisé leur développement démographique (Renshaw 2006 : 396), ne
donne pas beaucoup d’espoir.
L’accès aux services de santé publique est recherché. Il n’est pas facile : il
n’y a pas de médecins dans les communautés ni de cliniques ambulatoires avec des
jours de passage fixes. Un centre de santé a été bâti à Jesudi quelques années avant
notre arrivée en 2008. Ce bâtiment avec deux chambres, des toilettes, un lit et un
bureau, n’a jamais fonctionné comme cabinet de consultation : aucun médecin n’a
été nommé pour mener de visites régulières et il n’y a ni médicaments ni
instruments nécessaires. L’inauguration d’un tel bâtiment aurait été réalisée dans le
cadre d’une cérémonie politique à laquelle Ebedu Dosapei — le cacique — aurait
dû participer, mais comme il a vu que le centre manquait des ressources
indispensables, il a refusé de l’inaugurer79 .
Les médecins au Paraguay s’établissent généralement à Asunción et ses
alentours. Les gens des zones éloignées du Chaco doivent se rendre dans des
villages tels que Mariscal Estigarribia, Filadelfia, Loma Plata, ou bien attendre les
consultations itinérantes des médecins de l’État. Nous n’avons été témoin à Jesudi
que de deux visites pendant toute la durée de notre enquête. Elles sont arrivées le
même jour, avec deux heures de différence, de manière totalement indépendante.
Après une brève visite des médecins de la Croix Rouge du Paraguay qui étaient
venus « jeter un coup d’œil », des médecins de l’armée paraguayenne ont effectué,
à leur tour, leur brève visite. Ces derniers médecins, bien intentionnés, ne sont
restés que deux heures pendant lesquelles ils ont établi des diagnostics, prescrit et
donné des médicaments à plus de 70 personnes. Ils sont repartis vers midi car ils
devaient encore se rendre dans dix autres communautés.
79
En effet, des photographies de la « nouvelle clinique de santé de Jesudi » ont été publiées dans un
tract d’un parti politique en 2009. Il s’agissait de photographies prises de loin.
96
�À cette occasion, la participation des Ayoreo fut remarquable : absolument
tous sont venus parler avec les médecins80. La communication était un peu difficile,
étant donné que les Ayoreo ne parlent pas guarani — la langue identitaire du
Paraguay — et que leur espagnol est assez limité. Ils répondaient affirmativement à
toutes les questions du style « ça vous fait mal ici ? », stratégie qui leur permettait
de recevoir beaucoup de médicaments81.
Les médicaments, bien sûr, sont importants pour traiter les maladies
éventuelles, mais leur importance ne se limite pas à cela. C’était plutôt parce que
l’on n’avait pas de médicaments que la douleur se présentait. Il y a une sorte de
mise en relief sélective dans la chaîne causale. On dirait que le lien entre maladie et
médicament est plus étroit que celui entre prévention et maladie. Si une douleur ou
une condition de maladie persistait, ils signalaient toujours que « ijnoque semenie,
gu » (« c’est parce qu’on n’a pas de médicaments »). Les cas qui nous font penser
que les Ayoreo mettent l’accent sur le rapport maladie-médicaments sont toujours
des maux mineurs tels que les douleurs dentaires, l’irritation des yeux ou des
rhumes — qui ne sont pas déclenchés par la violation d’un tabou. Dans ces cas, les
causes de ces maux étaient assez claires : la forte consommation de sucre, la fumée
des maisons sans cheminée et les vêtements mouillés. En définitive, ces maux
pouvaient être évités. Quand on leur a conseillé quelques mesures préventives, ils
ne nous ont pas écouté : ils voyaient clairement le rapport tangible dans la séquence
présence de symptômes-prise de médicaments-absence de symptômes, mais ne
voyaient pas le rapport entre mesure préventive et absence de symptômes. Un
exemple l’illustrera plus clairement. Les médecins de l’armée nous ont dit que la
plupart des Ayoreo de Jesudi montraient des signes d’insolation. C’était logique, en
effet. À cette époque, la production de charbon devenait plus intense. Leur travail
de toute la journée consistait à couper des arbres pour les brûler, enlever l’ombre de
la forêt. Naturellement, les médecins leur ont conseillé de porter des chapeaux et de
80
Les visites des ONG ou d’individus divers sont fréquentes et les Ayoreo de Jesudi montrent un
enthousiasme sélectif.
81
Au début de mon enquête ethnographique, moment où les rapports se négocient et finalement
s’établissent, les Ayoreo me demandaient assez souvent si j’avais des médicaments à leur donner,
après nous avoir montré qu’ils avaient mal aux dents ou aux yeux.
97
�rester à l’ombre pendant les heures d’expositions solaires les plus nocives. Une fois
les médecins repartis, les Ayoreo ont décidé d’aller tout de suite — il était deux
heures de l’après-midi et il n’y avait aucun nuage dans le ciel — jouer au volleyball
chez les Angaite. Je leur ai rappelé alors les indications des médecins : « si vous
restez au soleil, vous aurez à nouveau le corps chaud [fièvre] et mal à la tête … ! »
Lucía Posijñoro m'a donné une réponse simple : elle a haussé les épaules en disant
« yajo semenie... ! » (« nous prendrons [alors] des médicaments… ! »).
Les Ayoreo de Jesudi ont des priorités dans leurs requêtes auprès de l’État
paraguayen. L’attention médicale occupe toujours l’une des places les plus
importantes. Ils manifestent qu’ils aimeraient recevoir des visites hebdomadaires ou
au moins mensuelles de médecins blancs. Ils soulignent que les hôpitaux sont trop
éloignés et qu’ils n’ont pas de médicaments. Et c’est justement là qu’ils
mentionnent les sarode pour marquer — encore une fois — le contraste entre la vie
dans le monte et la vie chez les Blancs :
Nous disons « allons à l’hôpital, prenons des médicaments… ! », « allons à
Filadelfia, à Asunción … ! ». Mais nous, les vieux, nous savons — n’est-ce
pas ? — ma grand-mère m’avait enseigné : « Gatuai, apprends médecin82 ,
quand tu seras vieux, souffle avec la formule du jaguar, si tu sais beaucoup
ça, c’est très bien, souffle et guéris ». Moi, je sais ça, mes grands-parents
m’ont appris. (Gatuai « Toto » Étacori)
Les Ayoreo de Jesudi établissent une équivalence entre l’utilisation de
sarode et l’utilisation des médicaments. Ils signalent à plusieurs reprises qu’avant
le contact ils n’avaient pas de maladies ou bien qu’ils connaissaient des sarode, des
mots puissants qui pouvaient les guérir. Ils soulignent, comme Toto, qu’au lieu de
médicaments, ils avaient des formules magiques qui étaient aussi efficaces. Mais
aujourd’hui, ils ne connaissent presque plus de sarode et sont obligés de se rendre à
l’hôpital pour se faire prescrire des médicaments. À partir de ces déclarations, on
peut bien voir que les sarode et les médicaments sont équivalents au moins en ce
82
« araja
–
doctor ».
savoir 2º pers du sing. impératif – médecin (en espagnol).
98
�qui concerne leur efficacité. En revanche, ils soulignent le contraste entre
l’accessibilité d’une technique et la grande difficulté d’accès à l’autre.
Renshaw signale que les formules sont employées pour des cas très bénins
— par exemple, les maux de ventre — et que, si les symptômes persistent, ils se
rendent aux cliniques de Filadelfia ou Puerto Murtinho. Présentées de cette
manière, ces deux techniques constitueraient deux instances non équivalentes : si
les sarode ne marchent pas, on essaie avec quelque chose de plus fort, les pilules de
l’homme blanc. Même si cela ne correspond pas avec nos données, cela apporte de
nouveaux arguments pour dire que les formules magiques et les médicaments sont
équivalents. D’après Renshaw, il y a une différence du degré de gravité des
maladies auxquelles ces deux techniques s’appliquent. Cependant, puisque selon lui
le même raisonnement est tenu sur l’efficacité des formules et des médicaments,
cela n’affecte pas notre argument principal : les sarode et les pilules restent dans le
même domaine de maladies, opposé au domaine des situations où l’intervention du
chaman est nécessaire — soit pour guérir, soit pour en expliquer la cause.
II.4.4. Les chamans retraités
Malgré quelques réserves de notre part, nous avons vu que l’opposition de
Sebag entre souffle et succion — entre formules magiques et intervention de
chamans — n’était pas inexacte. Il y a un domaine d’application plus ou moins
simple et disponible à tous, celui des sarode, et un autre qui entraînait
l’intervention de quelqu’un de spécialisé, le chaman. Nous avons établi, grâce à
Renshaw, une certaine équivalence — au moins en ce qui concerne leur
fonctionnement et l’efficacité attribuée — entre formules de guérison et
médicaments. Il nous reste donc à savoir ce qui se passe avec l’autre domaine, celui
des chamans, après plus de quarante ans d’action missionnaire et d’accès — bien
qu’il soit assez limité — à la médecine des Blancs.
99
�Il serait juste de dire que les chamans sont retraités. Il y a des individus très
âgés qui étaient des chamans — naijnane — auparavant. Nous avons rendu une
visite à deux d’entre eux. L’un parlait de sa profession comme quelque chose
appartenant définitivement au passé. L’autre envoyait des paroles de Dupade quand
nous avons eu l’occasion d’enregistrer des messages entre Jesudi et d’autres
communautés. Pour les gens de Jesudi, les naijnane étaient toujours éloignés, soit
dans le temps — ils appartenaient au passé —, soit dans l’espace — la plupart se
trouvaient en Bolivie.
Sebag avait indiqué que le mythe de l’origine du chamanisme était lié à celui
de l’origine du tabac. En effet, c’est Quiraquirai (caracara, Polyborus plancus),
l’un des chamans les plus puissants de ces histoires, qui a inventé la pipe. C’est
justement cet objet qui nous a permis de susciter des discussions autour du
chamanisme. Sidi Posorajãi nous avait fait cadeau, quelques mois après notre
arrivée, d’une pipe en bois de palo santo (Bulnesia sarmientoi) de forme tubulaire.
Pour fumer on met d’abord un peu de fibre caraguatá — sorte de filtre —, puis
quelques morceaux de tabac, et finalement une petite braise qui allume le contenu.
On doit fumer avec la pipe en la tenant quasi à la verticale pour empêcher que la
braise ne tombe. J’ai fait la préparation et j’ai commencé à fumer. Les Ayoreo — la
première fois Puchiejna Dosapei et Toto Étacori — m’ont averti que je ne devais
pas avaler la fumée, sinon je deviendrais chaman83 . Ils ont commencé à raconter des
anecdotes des naijnane, partagés entre la peur et le respect.
L’image du chaman s’élaborait à partir des anecdotes du passé, racontées
surtout par Toto Étacori, Sidi et Bajai Posorajãi. Les chamans pouvaient faire jaillir
de l’eau de la terre — voire produire des lagunes —, ils avalaient des braises sans
se brûler et avaient des visions prémonitoires, parmi d’autres capacités hors du
commun. Même si quelques chamans étaient évoqués avec nostalgie, comme Acui
83
Tout type de fumée ne peut pas forcément produire de pouvoirs chamaniques. À Jesudi, ils fument
des cigarettes, personne ne fume la pipe. Ugui Dosapei fumait naturellement toujours des cigarettes,
mais c’est seulement quand il fumait la pipe — il n’en avait pas, il nous la demandait toujours quand
nous fumions — qu’il avalait la fumée et les autres commentaient « pota naijnaque, gu » (« il veut
[devenir] chaman, c’est pour ça »).
100
�par Toto ou Uejai par Bajai84, ils étaient toujours présentés avec cette ambivalence
typique des sarode ou des histoires des origines. Quoi qu’il en soit, ils étaient
dangereux, nous assurait Puchiejna. C’est pour cela aussi qu’il était compliqué
d’aller en Bolivie, parce qu’il y en avait beaucoup.
Il était également intéressant de voir quels traits présents dans des situations
actuelles étaient reconnus comme dignes d’un chaman. Un soir, nous étions assis
autour du feu et les Ayoreo jouaient aux cartes — jeu dont je n’ai jamais pu
comprendre les règles. Je voulais les divertir un peu et j’ai fait un tour de magie :
j’ai fait disparaître une carte. Elle est réapparue quelques instants après, incrustée
dans un arbre à vingt mètres de distance. Cela a fait son impression : certains ont
vraiment eu peur — au point de crier —, tandis que d’autres manifestaient une
grande curiosité à mon égard. Je ne voulais pas sentir que la crainte faisait partie de
nos rapports et j’ai tout de suite expliqué les procédés de ma performance. Je l’ai
fait à plusieurs reprises et très lentement. Une discussion s’est déclenchée autour de
la question de savoir si j’avais ou non des pouvoirs, si j’étais ou non chaman. Il n’a
pas été facile, au début, de les convaincre que j’étais totalement dépourvu de
pouvoir. Au fil du temps, il est devenu habituel que les enfants me demandent un
tour de cartes, à la suite duquel quelqu’un me disait « naijnai ua… ! » (« t’es un
chaman… ! »). Occasionnellement, on voit des films au magasin rural de Km 17 ou
bien à Jesudi, quand il y a de l’essence pour faire marcher le générateur
d’électricité. Il y a des personnages dans ces histoires qui sont reconnus comme des
chamans, tel un enfant qui, lui seul, pouvait voir des fantômes, disi naijnai,
« l’enfant chaman ». En outre, c’est généralement dans les films de fantaisie épique
— comme « Le Seigneur des anneaux » — qu’ils signalent les personnages
chamaniques qui peuvent voler ou influencer la vie des autres à distance. Il s’agit
toujours d’êtres humains. Si l’un de ces personnages a une apparence monstrueuse
— ou seulement une caractéristique : les oreilles, le nez —, le terme employé n’est
84
Acui — de la bande Garaigosode — avait adopté Gatuai — de la bande Totobiegosode —, d’où
son alias « Toto » à Jesudi — après qu’Uejai Picanerai avait tué toute sa famille sous ses yeux quand
il avait environ huit ans. Acui est le protagoniste de la guérison racontée par Sebag. Uejai Picanerai
était non seulement chaman mais aussi asute, chef guerrier. C’était lui le Guidaigosi qui avait
rassemblé toutes les bandes du Sud — sauf les Totobiegosode — pour former une alliance contre les
bandes du nord, du côté de la Bolivie.
101
�pas naijnai mais dicore, une sorte d’esprit nocturne dangereux. Ce que les Ayoreo
reconnaissent comme chamanique, c’est toujours quelque chose hors du commun
— même pour nous —, qui ne cadre pas avec les expériences quotidiennes. Ce sont
des capacités ou des situations qui ne s’expliquent pas, sauf par l’attribution ou
l’intervention d’un pouvoir.
C’est ce caractère d’inexplicabilité, selon les canons habituels, qui est la
marque distinctive des maladies où l’on nécessite l’intervention d’un chaman. Ce
sont justement des cas ou même la médecine des Blancs n’offre aucune explication.
Voyons un exemple.
Puchiejna Dosapei est le fils cadet d’Ebedu Dosapei et Jnumi Posijñoro.
Quelques années avant notre arrivée, Puchiejna est tombé malade. Il ne pouvait plus
marcher. Il sentait une douleur dans la poitrine et avait l’impression qu’il allait
mourir. Tout le monde était consterné à Jesudi, surtout sa mère, son épouse — avec
qui il avait deux enfants — et ses beaux-parents, Sidi et Poro Posorajãi. Ils sont
partis à Asunción pour faire des examens cliniques et demander de l’aide à Nito
Rocha. Nito Rocha est un voyageur photographe qui a parcouru tous les villages
des Indiens du Paraguay. Depuis le début des années 1990, il s’est lié d’amitié avec
les gens de Jesudi : il leur rend régulièrement visite et les aide à résoudre leurs
problèmes, quels qu’ils soient. Pour leurs problèmes de santé, Nito réussit à obtenir
des dons de médicaments pour eux ou bien il fait le nécessaire : logistique, analyse,
consultations dans des hôpitaux publics ou des cliniques privées. Quand Puchiejna
et sa famille sont arrivés chez lui à Capiatá (à 30 km d’Asunción), Nito a financé
tous les examens que les médecins jugeaient nécessaires : analyses de sang,
radiographies et tomographies, entre autres (Nito Rocha, comm. pers.). Aucun
problème n’a été diagnostiqué par les médecins (ses symptômes seraient donc
d’origine psychosomatique). Déçus et sans explication de la part des médecins
blancs, les Ayoreo sont retournés au Chaco.
Le mal de Puchiejna persistait et ses parents et amis étaient accablés par la
tristesse (on verra dans la deuxième partie, deux chants de deuil composés pour
102
�Puchiejna). Ils étaient à Filadelfia quand une Paraguayenne a recommandé à Jnumi
Posijñoro, sa mère, d’aller consulter un chaman qui habitait là. C’est un chaman
nivakle qui a traité Puchiejna avec la technique de succion : le Nivakle a enlevé du
poumon de l’Ayoreo une poignée de clous. Il a aussi indiqué la cause de la
maladie : c’était un chaman provenant de la communauté de Santo Domingo qui
l’avait attaqué. Par conséquent, l’agresseur était un Angaité.
Il y a eu deux cas d’attaque chamanique à Jesudi et, dans ces deux cas, les
agresseurs et les guérisseurs n’étaient pas Ayoreo. Cela nous montre que le manque
de chamans n’est pas nécessairement un indicateur du manque de chamanisme. Or,
il faut nuancer cette affirmation. Les attaques chamaniques sont beaucoup moins
fréquentes qu’avant : le nombre élevé d’anecdotes du passé contraste fortement
avec la faible quantité des dernières années. Par ailleurs, il y a un facteur décisif : il
faut que les Blancs ne puissent pas trouver de solution pour qu’une intervention
chamanique soit jugée nécessaire. Le cas de Puchiejna est emblématique :
absolument toutes les possibilités d’explication avaient été épuisées grâce à l’aide
de Nito. C’est le traitement du chaman nivakle qui, non seulement l’a guéri et, de
surcroît, lui a donné une explication.
Pour penser le chamanisme de nos jours, on peut reprendre les réflexions de
Renshaw sur les formules magiques. L’action des missionnaires contre les
jnanibajade a certainement affecté le chamanisme : ceux qui étaient naijnane ne
pratiquent plus leur métier. Comme dans le cas des sarode, on pourrait affirmer que
les Ayoreo ne doutent pas de leur efficacité — de leur pouvoir —, mais qu’il y a
plus de valeurs négatives associées à cette pratique. De plus, le chaman était, non
seulement quelqu’un qui entrait en contact avec des puissances invisibles, mais
aussi un diagnosticien et un guérisseur. De plus en plus, ces dernières fonctions ont
été confiées à la médecine des Blancs. Cela n’implique pas nécessairement un
remplacement des connaissances traditionnelles par d’autres occidentales,
concernant la physiologie. C’est une question pragmatique, qui va du diagnostic à
la guérison en passant par des pilules. C'est-à-dire qu’il y a une coexistence sans
superposition du domaine chamanique et du domaine médical. Cependant, il faut
103
�reconnaître que dans le domaine de la médecine des Blancs, des maladies peuvent
être diagnostiquées mais non guéries, ce qui laisse la question à mi-chemin (étant
donné que le chaman pouvait accomplir les deux tâches). Que se passe-t-il alors ?
C’est dans ce type de cas qu’une figure devient encore plus importante : celle de
Jésus.
II.4.5. Les paroles de Dupade
En mars 2009, Ebedu Dosapei, le cacique de Jesudi, est tombé malade. Il
avait des épisodes de vertige et d’amnésie temporaire. Au début, les Ayoreo
pensaient que cela pouvait être causé par une attaque chamanique. Après tout, les
deux cas précédents de maladies inexplicables finalement guéries par un chaman
nivakle avaient été ceux de la femme d’Ebedu, Jnumi Posijñoro, et de son fils
cadet, Puchiejna Dosapei. Il semblait que la famille Dosapei était la cible constante
d’attaques répétées. Les symptômes persistaient alors qu’ils s’étaient rendus à
Asunción avec beaucoup d’autres Indiens du Chaco pour demander un changement
d’autorités au sein de l’Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Une fois de plus,
grâce à l’aide de leur ami blanc, Nito Rocha, une tumeur au cerveau est détectée
après avoir réalisé une tomographie à Ebedu Dosapei. Les médecins pouvaient la
décrire aux Ayoreo mais ils ne pouvaient pas leur en indiquer la cause.85
Le nom de cette maladie terrible ne leur était pas inconnu : au moins deux
Ayoreo de Jesudi étaient décédés à cause de cancers, lors des années précédentes.
Ebedu a d’abord subi une intervention chirurgicale agressive. Dans les mois qui
suivirent, il fut soumis à une radiothérapie et à une chimiothérapie orale. Pendant
tout ce temps, les Ayoreo du Paraguay — pas seulement de Jesudi, mais aussi des
autres communautés — ont suivi avec intensité le processus de récupération
d’Ebedu. C’était un leader très respecté et apprécié.
85
Ebedu avait un glioblastome multiforme. D'après les médecins, il n’y avait pas de causes connues,
seulement des considérations statistiques.
104
�Nous ne voulons pas trop détailler son long parcours depuis le diagnostic en
mars 2009 jusqu’à son décès en janvier 2011. Or, nous avons remarqué, d’une part,
qu’une fois l’explication donnée par les médecins, l’hypothèse de l’attaque
chamanique a été abandonnée et, d’autre part, que tout au long de son parcours —
la souffrance des effets nocifs des traitements, la peur et la dépression face à la
mort, etc. — les figures de Jésus et de Dupade se sont vues renforcées.
Dupade, serait en fait la version ayoreo du dieu chrétien. D’après Combès,
le mot vient du guarani Tupan, terme introduit par les Jésuites dans les missions de
Chiquitos pour désigner le dieu chrétien (2009 : 14). Dupade et Jésus sont deux
personnages différents mais invoqués à peu près de la même manière, comme des
entités toutes-puissantes, bien au-delà de l’être humain, à un niveau supérieur.
Voyons trois exemples pour mieux saisir la complexité de ces deux figures. Notre
premier exemple est celui d’un dialogue entre Jésus et Ebedu, qui a eu lieu dans un
rêve de ce dernier. Au début de son traitement, la souffrance était tellement intense
qu’Ebedu voulait mourir, ce qui naturellement décevait son épouse et l’enfonçait
dans la tristesse. Selon Ebedu, Jésus lui a parlé dans un rêve et lui a demandé s’il
voulait vraiment mourir. Ebedu a répondu négativement et Jésus a souri, plein de
joie. Jnumi était ravie quand elle a entendu ces nouvelles de son mari.
Notre deuxième exemple concerne une voie de guérison qui associe la figure
de Jésus avec des techniques ayoreo, contre lesquelles les missionnaires ont lutté.
Ebedu a dû passer plusieurs mois à Capiatá où il suivait son traitement et où on lui
faisait des contrôles. Un week-end, il en a profité pour se rendre à Jesudi. Il n’était
pas en forme et la gravité de son état produisit une énorme tristesse, sentiment qui
était exprimé parfois à travers la performance de chansons de deuil uñacai. Quand
il était là, allongé par terre, les gens venaient voir comment il allait. Daju Étacõro,
de l’ogadi de Bajai Posorajãi, est venue chanter. Elle interpréta une composition
particulière qu’on analysera plus en détail : un versículo. Un versículo est un type
de chanson qui rassemble des traits typiques ayoreo et quelques détails hors du
commun. Ce qui nous semble pertinent dans cette section, c’est que cette chanson
raconte un épisode de la Bible où une femme est guérie par le simple toucher des
vêtements de Jésus. Cette chanson fut interprétée au-dessus la tête d’Ebedu. Elle
105
�était censée guérir le malade mais d’une manière différente de celle des formules
sarode. Jnumi nous a raconté qu’elle l’avait chantée aussi à l’hôpital. Quelques
mois après, alors que les symptômes d’Ebedu avaient presque disparu, Jnumi
soulignait le pouvoir de ce chant.
Finalement, nous devons ajouter que quand la guérison définitive semblait
être accomplie — la récupération d’Ebedu était très surprenante, même pour les
médecins —, Jnumi attribuait cette bonne nouvelle au pouvoir de Jésus-Christ.
Ebedu semblait, en effet, être guéri quelques mois après le diagnostic fatal. Une
fois la radiothérapie finie et avec la médication disponible, ses symptômes étaient
beaucoup moins perceptibles. Jnumi composa une chanson de bonheur, yasitigai,
dans laquelle elle racontait qu’Ebedu était guéri et disait aux Ayoreo de toutes les
autres communautés : « c’est très vrai, notre Seigneur Jésus-Christ a guéri le grandpère des petits-enfants pour nous ».
Ces trois exemples nous montrent que Jésus est une entité qui décide du
destin individuel des Ayoreo. C’est lui qui pose la question à Ebedu sur la fin ou la
continuation de sa vie. Seule la mention de sa présence dans le versículo a permis la
guérison du malade. Finalement, c’est lui que Jnumi remercie de l’avoir guéri. Ce
n’est pas que les médicaments ou les traitements n’aient pas eu d’effets. D’ailleurs,
ils nous ont subtilement dit en 2011 que la cause du décès aurait pu être attribuée au
manque de médicaments. Cependant, les espoirs étaient mis dans l’action de Jésus
ou de Dupade. Les Ayoreo des autres communautés priaient pour Ebedu, et c’était
vers eux que le chant de bonheur était dirigé. Les Blancs s’étaient conduits
étrangement : ils avaient donné une explication sans la certitude d’une guérison.
Expliquer et guérir étaient devenus deux idées complètement distinctes. Les clous
que le chaman nivakle avait sucés du dos de Puchiejna étaient à la fois l’évidence
de l’attaque chamanique et la preuve de la guérison du patient. La maladie d’Ebedu
était quelque chose qui était dans sa tête et qui — même si on l’avait extrait lors de
l’opération — ne cessait de grandir. C’était aussi quelque chose de difficile à
conceptualiser : en général, comme on l’a vu auparavant, l’association très forte
entre médicaments et absence de symptômes implique qu’il n’est pas nécessaire de
106
�comprendre le déroulement d’une maladie pour guérir (de la même manière que
nous ne comprenons pas le mécanisme de la plupart des maladies habituelles).
Jésus et Dupade sont des entités qui protègent et qui aident, mais ce type de figures
n’est pas complètement nouveau pour les Ayoreo.
Nous avons demandé comment était la vie avant de sortir, avant d’aller dans
les missions, concrètement, s’il y avait Dupade dans le monte. Bajai Posorajãi et
Jnumi Posijñoro nous ont dit que quand ils se levaient très tôt le matin, avant de
partir à la chasse et à la cueillette, ils se dirigeaient vers le soleil — parfois audessus d’un arbre — et ils criaient « Yoquimamito, ataja yoqueee … !!! » (« Yoquimamito86 aide-nous… !!! »). Selon Casalegno (1985 : 206), il y a eu dans les
missions jésuites une assimilation entre le dieu chrétien et un personnage ayoreo
associé au soleil. Cette association n’était pas innocente, nous dit Casalegno, car les
prêtes jésuites auraient choisi une figure qui correspondait assez bien avec la
divinité catholique.
Quelle est alors la relation entre Dupade et Jésus ? C’est difficile à dire.
Nous voyons bien que Jésus est quelqu’un à qui on demande des faveurs et Dupade
répondrait également à cette description. Dans les cultes du dimanche — que l’on
célèbre à Jesudi très occasionnellement —, les Ayoreo de Jesudi demandent à
Dupade de les aider et surtout de leur donner la force d’être en bonne santé. Une
fois ces oraciones accomplies, celui qui catecai Dupade uruode (« parle les mots
de Dupade ») lit un passage du Nouveau Testament 87, fait quelques commentaires
qui soulignent les vertus de Jésus et la séance est terminée. C'est-à-dire que l’on
86
Nous n’avons pas trouvé de traduction pour ce mot, mais on peut souligner que yoc- ou yoquicorrespondent au préfixe possessif de la première personne du pluriel.
87
Le Nouveau Testament a été traduit dans la langue ayoreo par la South American Indian Mission.
Malheureusement, l’Ancien Testament — dans lequel on peut lire des épisodes, comme celui de
Moïse traversant la Mer rouge, qui ressemblent aux histoires de chamans ayoreo — n’a pas été
traduit. Cependant, ils connaissent quelques histoires comme celle de Noé.
107
�demande simultanément l’aide de Dupade et on parle de Jésus 88. Ce que nous
pouvons affirmer, c’est que, malgré l’image de toute puissance et de bienveillance
de ces deux personnages, ils ne sont pas dépourvus d’une certaine ambivalence.
Le monde ayoreo était présenté par Sebag et aussi par Bórmida comme un
monde dichotomique. Aux deux saisons de l’année — l’époque sèche et l’époque
des pluies — correspondaient aussi des qualités symboliques telles que le monde
clos (interdiction de raconter des histoires, interdiction de déranger le lézard Poji
ou l’engoulevent Asojna) et le monde ouvert (les histoires peuvent être racontées,
les lézards et les engoulevents se promènent librement sans entraîner la mort de
ceux qui les rencontrent). Nous trouvons une dichotomie similaire par rapport à
Dupade : c’est paaque vs castigado. Paaque89 veut dire « bon » ou « pacifique »90
opposé à méchant ou à celui qui se fâche avec ses parents. « Castigado » est un mot
espagnol qui veut dire « puni », et il a clairement son origine dans l’expérience
avec les missionnaires. D’après Poro et Sidi Posorajãi, Dupade avait également
sauvé Sidi d’un accident. Il était parti à la chasse dans le monte, comme à son
habitude. Alors qu’il retournait vers Jesudi, un gros arbre tomba sur sa tête, le
blessant gravement. Il se sentait très mal et il a parlé à Dupade : il lui a demandé de
lui sauver la vie. Comme Sidi était paaque (bon, gentil), Dupade l’a sauvé, mais
s’il avait été sijnaque (méchant), Dieu l’aurait laissé mourir : jeti sijnaque, ga
castigado ! (« s’il est méchant, alors [il sera] puni ! ». Il n’y avait pas de point à
mi-chemin : c’était l’un ou l’autre. Il y a une composante morale qui sera rendue
plus clairement par un autre exemple. Quand quelques Ayoreo étaient à Capiatá
pour accompagner Ebedu dans son traitement, ils regardaient la télévision tous les
88
Une dynamique similaire est transmise à travers les cassettes. Nous avons rendu visite à la
communauté de Chaidi à deux reprises et nous avons rapporté aux uns et aux autres des messages
enregistrés. Celui dont l’enregistrement était le plus long, était un homme âgé de Chaidi — chaman
retraité — qui — à la demande de gens de Jesudi — envoyait des mots de Dupade. Ses messages
correspondaient aux allocutions de la fermeture des cultes : des réflexions à partir des passages de la
Bible.
89
« Paaque » est la forme énonciative pour le masculin singulier. Le féminin est « paague ».
90 Quand dans les promenades au monte on percevait la présence d’autres Ayoreo — toujours
considérés comme ennemis potentiels — il fallait crier « paaque uyu eee… !!! », « je viens en signe
de paix » (littéralement, « je suis pacifique… !! »).
108
�jours. Dans un journal télévisé, ces Ayoreo ont vu qu’il y avait eu des inondations
importantes au Brésil et que beaucoup de personnes avaient dû évacuer leurs
maisons. Ces Ayoreo ont affirmé alors que les Brésiliens étaient méchants et que
c’était pour cela que Dupade les avait punis : les Brésiliens avaient été castigado.
Aucune empathie n’était inspirée par cette tragédie. De même que la simple
rencontre avec Asojna pouvait être mortelle en hiver ou complètement inoffensive
au printemps, Dupade est une figure qui sauve un malade du cancer ou induit la
mort à travers un arbre qui tombe ou un fleuve qui déborde.
II.4.6. Conclusion de II.4
Nous voyons qu’avant, il y avait une opposition entre les formules de
guérison et les séances chamaniques, et qu’elle correspondait à deux
fonctionnements différents de la maladie. Actuellement, les pilules de l’homme
blanc et les formules magiques sont — d’une certaine manière — équivalentes, du
point de vue de l’efficacité attribuée et du mécanisme impersonnel du déroulement
de la maladie. Ce deux pratiques s’opposent, à leur tour, aux cas d’attaques
chamaniques qui — même s’ils sont exceptionnels — ne sont pas guéris par les
sarode et ne sont pas diagnostiqués par la médecine occidentale. La croyance en
Dupade et en Jésus est toujours présente mais elle s’accentue dans les cas très rares
où ni la médecine des Blancs ni les chamans ne peuvent trouver de solution — ni
même donner une explication. Pour nous, la figure de Dupade ou celle de Jésus ne
sont pas vraiment claires. Ce serait une conclusion hâtive de dire qu’il s’agit
simplement de la figure chrétienne implantée chez les Ayoreo.
109
�Conclusion du chapitre II
Tout au long de ce chapitre, nous avons vu la diversité des situations sur
lesquelles la parole peut produire un effet : les maladies, la chasse, la guerre.
Ensuite, nous avons montré que la notion de puyac (« interdit ») — qui décrit ce
caractère dangereux de la parole — dépend plutôt de l’interprétation que l’on en
fait. En effet, la notion de puyac est un dispositif pour comprendre ce qui se passe,
plutôt qu’une liste de prescriptions de comportements. Les exemples des mythes
nous montrent par ailleurs que toute parole rapportée aux temps premiers entraîne
des conséquences, y compris de manière différente à celle des formules de
guérison. Autrement dit, plutôt qu’une parole qui agit, c’est un discours sur cette
parole active : un lien est établi entre un événement qui a déjà eu lieu et les mots
qui auraient pu l’avoir produit. Ce caractère explicatif des paroles dangereuses est
très important, comme le cas de l’interaction entre sarode, chamanisme, médecine
des Blancs et Dupade nous permet de le voir.
Il y a cependant de nombreuses occasions où la parole produit un effet mais
ne prend pas les formes que nous avons montrées. Le cas concernant le football de
l’épigraphe du chapitre semble anecdotique mais il est très fréquent : ce sont des
occasions habituelles dans la vie quotidienne. Par ailleurs, d’autres exemples sont
difficiles à classer. Par exemple, on attribue aux femmes du clan Dosapei le pouvoir
de produire certains événements. Si une femme Dosapé n’a pas mangé et est
contrariée, alors uruode tocade (« les mots apparaissent ») : elle prononce des mots
qui deviennent réalité. Ces derniers cas constituent un domaine de paroles qui
produisent des effets, mais qui ne sont ni des formules sarode (ou un autre exemple
de la première section) ni des histoires adode. Généralement, tout cela est compris
dans la catégorie un peu vague de chamacare (maudire). Ces mots relèvent du
caractère puyac : ils produisent des effets ou des effets leur seront attribués.
Sans doute peut-on dire que la parole dangereuse — qu’elle soit catégorisée
comme sarode ou adode, ou vague comme le chamacare — produit des
conséquences depuis les temps des origines. Les Premiers Hommes et les Premières
110
�Femmes ont laissé des paroles au moment de leur métamorphose, et le fait même de
raconter ces histoires produit des effets. La parole est une caractéristique marquée,
non seulement au moment même où l’on parle de ces histoires, mais aussi à
l’intérieur même de ces histoires. C’est une parole qui (re)produit un effet. Mais
cette mise en relief de la parole est-elle limitée à la parole dangereuse ? La parole
dangereuse — celle que l’on ne doit pas prononcer — est-elle la seule parole
importante ? Voici le sujet que nous développerons dans le prochain chapitre.
111
�CHAPITRE III
LA PAROLE HUMAINE
Introduction
Les gosniade — c'est-à-dire, les histoires profanes — avaient très peu
suscité l’attention des analyses de Mashnshnek et des autres membres du courant
phénoménologique argentin des années 1970 et 1980. Le reste de la bibliographie
du groupe n’apportait pas davantage de lumière sur le sujet (à la notable exception
d’Estival 2005, et Riester et Zolezzi 1999). Il semblait que le discours ayoreo fût
aussi déséquilibré que la contribution de Mashnshnek : un paragraphe sur les
gosniade et plus de dix pages consacrées à la parole puissante.
La question se pose alors de savoir si le domaine de la parole non sacrée est
aussi développé que celui de la parole puissante. Nous ne pouvons nous empêcher
de nous demander si, plus précisément, ce domaine méprisé dans la littérature
ethnographique du groupe relève d’une certaine complexité interne — s’il est
organisé en catégories et s’il présente des régularités stylistiques — et si les Ayoreo
lui donnent de l’importance dans leur vie quotidienne. Nous voulons analyser tout
ce qui fait partie de la parole non puyac, depuis ce qui relève de catégories claires
et explicites pour les Ayoreo jusqu’à des exemples de formes que l’on pourrait
considérer mineures, mais qui présentent cependant des régularités, soit dans leur
intonation, soit dans leur contenu.
Nous présenterons d’abord les chants que nous appelons « humains ». Ces
chants n’ont pas été composés par les Premiers Hommes ou Premières Femmes et
ne portent sur aucune métamorphose du temps des origines. Ensuite, nous décrirons
les récits guerriers, sorte de performance théâtrale qui recrée les aléas d’une
bataille. Finalement, nous nous consacrerons aux domaines de la parole non sacrée
qui ont un caractère parfois moins évident mais assez structuré cependant, tels que
les remerciements chantés, les messages sur cassettes et la création de surnoms.
112
�III.1. Les chants humains
III.1.1. Introduction à la musique des Ayoreo
Notre expérience à Jesudi a présenté dès le début de forts contrastes avec le
monde des paroles dangereuses que nous venons de décrire ci-dessus. Une partie
considérable de la bibliographie sur les Ayoreo est consacrée à ces récits mythiques
et aux formules de guérison, néanmoins les habitants de Jesudi ne voulaient pas en
parler ou les connaissaient peu — ou, en tout cas, d’après eux, beaucoup moins
qu’autrefois, à l’époque où ils vivaient dans le monte. Nous avons remarqué par
contre qu’ils chantaient très souvent et dans des occasions diverses. De ces chants,
qui n’étaient pas du tout puyac et pas censés non plus entraîner de conséquence
dans le monde, ils aimaient en parler avec moi et en discuter entre eux. Cependant,
ce genre de compositions n’a pas été analysé en profondeur dans la littérature
ethnographique du groupe (à l’exception des travaux de J-P. Estival qui est
ethnomusicologue). Le contraste entre lectures et terrain, ainsi que l’enthousiasme
manifesté par les Ayoreo en chantant, en écoutant ou en parlant des chants, ont
vivement suscité mon intérêt pour ce sujet.
La quotidienneté des chants
Les Ayoreo chantent avant le lever du soleil ou le soir. Il est vrai que, dès la
première nuit j’ai entendu la voix d’un homme âgé qui chantait accompagné de son
hochet. Il était quatre heures du matin environ, mais personne ne s’était levé et tout
le monde continuait à dormir paisiblement. Cela arrivait quatre ou cinq fois par
semaine et il s’agissait toujours d’hommes qui chantaient à l’aurore. Une fois leurs
chants finis, ils se recouchaient la plupart du temps, mais parfois ils restaient
éveillés. Le soir était aussi un moment privilégié pour le chant. Dans ce cas, le
scénario était différent. Autour du feu, les femmes filaient le caraguatá, les enfants
dormaient ou jouaient, et un homme ou une femme chantait. C’est de préférence le
soir aussi que j’ai pu enregistrer des messages pour les Ayoreo de Chaidi91 . La
plupart de ces messages contenaient des chants envoyés comme cadeaux.
91
Communauté de Totobiegosode qui se trouve à 100 km à l’est (environ 150 km par les chemins).
113
�Les chanteurs et la manière de chanter
Ceux qui chantaient à Jesudi appartenaient tous à la génération des plus
âgés : les femmes, Daju Étacõro et Caitabia Picanere (les deux épouses de Bajai
Posorajãi), Ajnocate, Jnumi et Poro (toutes les trois Posijñoro), et les hommes, Sidi
Posorajãi, Toto Étacori et Uguri Dosapei. En ce qui concerne le reste des personnes
du troisième âge, quelques-uns déclaraient ne pas savoir chanter, tandis que
d’autres avouaient ne plus chanter, mais l’avoir fait auparavant. Les jeunes ne
chantaient pas, mais ils aimaient en général écouter — quand ils n’avaient pas
honte, étant donné que quelques chants racontaient leurs problèmes conjugaux.
Hormis la position du corps et l’utilisation du hochet exclusivement
masculine, il n’y a pas de différence entre la manière de chanter des hommes et des
femmes. La femme chante pendant qu’elle file le caraguatá, assise sur le sol, les
jambes de côté, lui permettant ainsi de rouler les fibres sur sa cuisse, ou bien
pendant qu’elle se balance dans un hamac. L’homme chante debout ou assis sur un
tronc ou un seau, avec le bras gauche étendu tenant la lance — ou un balai — posée
sur le sol, le visage tourné vers le bas et la gauche, en mettant sa bouche contre le
biceps. La main droite fait sonner le hochet contre l’avant-bras gauche. Le corps se
balance en avant et en arrière. Les phrases sont longues et finissent par une
exhalation forte. Le vibrato est un trait caractéristique. Généralement, les deux
premières lignes consistent en vocalisations sans mots. En ce qui concerne la
manière de vocaliser, il n’y a pas de différences entre hommes et femmes, ce qui est
une caractéristique très particulière en Amérique du Sud (Estival 2006 : 24).
Cette manière de chanter a été décrite par Kelm (1963 :82), ethnographe
pionnier chez les Ayoreo, en 196392 . Une description similaire est parue dans le
92
« Wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet –und das ist praktisch jeden Abend der Fall-,
greifen die Ayoré zur Kürbisrassel, um einer nach dem anderen beim flackernden Schein des
Lagerfeuers einem groβen Zuhörerkreis den ' júudi ' genannten Gesang vorzutragen. Bemerkenswert
ist die vom Sänger geübte Technik. Auf einen Speer gestützt, beugt sich dieser abwechselnd vor und
richtet sich auf, wobei die Phase einer Beuge stets eine Zeile oder Atemläge entspricht und der
tiefste Punkt der Beugehaltung mit dem höchsten Diskant der Stimme und der schnellsten Bewegung
der Rassel zusammenfällt. Der Inhalt dieser Gesänge nimmt zumeist auf bestimmte auβereheliche
Liebensabenteuer gerade abwesender Gruppenmitglieder Bezug und ist häufig ausgesprochen derb.
Es kann sich dabei um Improvisationen, das heiβt Uraufführungen handeln, zumeist aber sind es
vom Vortragenden mehr oder weniger modifizierte Gesangestücke, die ihrem Autor und Inhalt nach
bekannt sind und zum Repertoir der Sänger bzw. zum Liedergut der betreffenden Gruppe gehören ».
(KELM 1963 :82)
114
�Mennoblatt, le journal des colonies mennonites en 1962 (Hein 1988 : 65). Estival
(2006 : 32 ), pour sa part, signale la ressemblance entre les compositions qu’il a
recueillies tout au long des années 1990 et celles dont Sebag avait noté les paroles
en 1965. À partir de ces constats, nous voyons qu’il s’agit d’une pratique très
ancienne et dont quelques traits persistent de manière particulière. Il faudra les
analyser en détail pour voir si nous avons affaire à une simple réminiscence
folklorique de forme, ou bien s’il s’agit d’une pratique ayant un sens aujourd’hui.
La musique
En ce qui concerne les aspects musicaux, nous ne donnerons que quelques
données générales. Les sources sur l’ethnomusicologie des Ayoreo ne sont pas
nombreuses. On peut mentionner en Bolivie le travail de Graciela Zolezzi et Jürgen
Riester (1999) et au Paraguay, ceux d'Estival (2005, 2006a). Des travaux de ce
dernier nous tirons quelques informations importantes pour mettre en contexte les
productions sonores des Ayoreo.
En ce qui concerne l’organologie de ce groupe, Estival indique que les
instruments sont limités au hochet paca et au sifflet pota. Le paca est fait avec une
courge de la taille d’un poing, remplie de graines — voire même de vis — et un
manche en bois d’environ 10 cm. Le sifflet est un rectangle de palo santo, de 10 cm
sur 15 cm, et d’un centimètre d’épaisseur. Sur une des longueurs, un trou de 1,5 cm
est creusé : pour produire du son, il faut souffler dedans avec une technique
similaire à celle de la flute traversière. Chez les Ayoreo, on ne trouve aucun
exemple de cordophones ou de membranophones (Estival 2005 : 455), ce qui les
différencie des autres groupes du Chaco — Nivaklé, Manjui, Guaraní-Ñandeva,
Enthlet — ayant des violons, des flûtes ou des tambours. Le sifflet était utilisé
principalement lors de la cérémonie du changement de saison, la « Fête
d’Asojna » (l’engoulevent)93 . On utilisait aussi le hochet paka et un autre
idiophone, l’orokoro, une carapace de tortue remplie de graines. Actuellement, le
paka continue à être utilisé pour chanter — et il est d’ailleurs fabriqué par chaque
93
D’après BÓRMIDA, nous rappelle ESTIVAL, les Ayoreo avait un code de communication à travers la
combinaison des sons du pota qui variait selon les clans.
115
�chanteur — alors que le pota est vendu comme objet artisanal (et même en
miniature, comme bijou).
Du point de vue de l’ethnomusicologie, Estival met en relief le caractère
exceptionnel des Ayoreo dans la région du Chaco :
[…] du point de vue musical, les Ayoreo ne se situent pas dans le complexe
musical chaqueño le plus répandu : entre les Nivakle, Manjui, Enthlet ou
Guaraní Ñandeva au contraire, il y a clairement un air de famille dans les
danses collectives chantées. Les Ayoreo restent musicalement écartés de ces
univers94. (2005 : 452)
Les sources ethnohistoriques
Les sources historiques ne donnent pas beaucoup d’informations. Aucune
description ni aucun vocabulaire associé aux chants ne peut être trouvé dans le
manuscrit du prêtre jésuite Chomé (datant de 1745, publié par Lussagnet en 1958),
mis à part le mot eratego « musique » (Lussagnet, cité par Estival 2005 : 453).
Dans le vocabulaire morotoca d’Alcide d’Orbigny (1831), on peut trouver quelques
mots appartenant à ce domaine, en particulier le mot eracu qui — Estival le
signale — ressemble au mot -erachu, « chanter avec paca ». Cet ethnomusicologue
a analysé un manuscrit très intéressant qui se trouve à la bibliothèque du Musée
National d’Histoire Naturelle de Paris. Il s’agit de la transcription de la musique et
des paroles de onze chants des Morotocas, qui seraient des ancêtres des Ayoreo et
des Chamacoco. Selon Estival, « même si les paroles pourraient être considérées
comme zamucas, les mélodies ont peu à voir avec les chants actuels des Ayoreo ou
des Chamacoco 95 » (2005 : 453). Après ces références de la première moitié du
94
« […] desde un punto de vista musical, los Ayoreo no se sitúan dentro del complejo musical
chaqueño más difundido: sí, entre los Nivaclé, Manjui, Enthlet o Guaraní Ñandéva hay claramente
un aire de familia en los bailes colectivos cantados. Los Ayoreo quedan musicalmente alejados de
estos universos » (ESTIVAL 2005 : 452).
95
« […] si las letras podrían ser consideradas como zamucas, las melodías tienen poco que ver con
los cantos actuales de los Ayoreo o Chamacoco » (ESTIVAL 2005 : 453).
116
�XIXe siècle, il faut attendre les années 1960 pour trouver les descriptions déjà
mentionnées de Kelm, du journal Mennoblatt et de Sebag.
Les chants individuels
J’ai été frappé sur le terrain à Jesudi par la mise en relief de l’expression de
l’individualité et des désirs personnels, même des comportements décrits comme
capricieux étaient particulièrement respectés96 . Tout cela se reflétait dans les
chants : toutes les chansons que nous avons écoutées étaient composées par une
personne et interprétées individuellement (soit par l’auteur, soit par quelqu’un qui
avait aimé le chant en question). Cependant, selon l’informateur d’Estival, il
semble qu’autrefois il y ait eu des danses et des chants collectifs : les Ayoreo
pratiquaient, avant le contact, une danse en rond, appelée jobedei. Cette ronde était
formée d’hommes et de femmes. Au centre se tenait un homme avec son hochet.
Dans le dictionnaire édité par le prêtre Zanardini (Barrios et al. 1995) on trouve
l’entrée « Eidai », qui aurait été une sorte de danse pour fêter un événement,
formée par deux rondes. Selon l’information un peu confuse de ce dictionnaire,
cette danse serait en rapport avec l’initiation, cérémonie qui selon tous les
ethnographes des Ayoreo (sauf Susnik) n’existait cependant pas dans ce groupe.
Selon Bartolomé (2000 : 49), lors du rituel du changement de saison, la fête
d’Asojna, une sorte de danse collective entre les hommes avait lieu. La description
rapportée par Bartolomé est identique à celle du rituel chuguji qui consistait à
animer le sentiment de rage avant de partir à la guerre. Nous y reviendrons bien
qu’il nous semble difficile d’accorder à cette manifestation le statut d’une danse.
Estival ajoute finalement qu’il y avait des chants collectifs lors du rituel guerrier
namacade, interprétés avant de partir au combat. Malheureusement, il ne reste rien
de ces chants ni de ces danses collectives. Les chants individuels présentent une
96
En 2011, Lucía Posijñoro et Tamocoi Dosapei se sont séparés. Lucía avait trouvé un nouveau mari
à Filadelfia et elle voulait y rester avec sa fille cadette Tu, âgée de sept ans. À Jesudi, une voiture
était sur le point de partir pour Filadelfia avec Lucía, mais Tu ne voulait pas partir. Ils lui ont
beaucoup parlé pour essayer de la convaincre de monter dans la voiture et de partir avec sa mère à
Filadelfia. La petite fille ne voulait pas et sa décision a été respectée.
117
�remarquable continuité en ce qui concerne la manière de chanter et le contenu des
chants, même après 40 ans de contact avec l’homme blanc.
III.1.2. Les genres du chant
Estival présente les genres du discours ayoreo en opposant — comme nous
l’avons fait dans le chapitre précédent à partir de l’observation de Mashnshnek
(1991) — les formules de guérison sarode aux chants quotidiens. Selon cet auteur,
le nom générique de ces derniers est irade, mais il signale que le terme ignecai est
aussi utilisé en Bolivie. Les Ayoreo distingueraient trois types de chants à
l’intérieur de cette catégorie. Premièrement les jnusietigade, dénomination qui
vient du mot jnusietac, jnusiete : « mélancolique, triste » (Barrios et al. 1995 : 75),
traduite par les Ayoreo comme chants romantiques (Estival 2005 : 472). Ces chants
racontent des épisodes de la vie amoureuse quotidienne. Estival présente ensuite les
pocaningane (pocaningai : « guerre », Barrios et al. : 1995 : 75), des récits de
guerre qui portent sur les combats entre Ayoreo ou contre les Blancs, et qui mettent
en avant le courage des chefs dacasute. Finalement, la catégorie des ore enominone,
les visions du chaman, genre qui rassemble des chants sur le monde chamanique,
mais sans pouvoir de guérison ou de propitiation.
Nous trouvons des catégories différentes dans nos données de terrain
recueillies à Jesudi. Premièrement, même si dans certains cas les Ayoreo ont utilisé
le mot irade comme dénomination générique, le terme préféré était celui d’ijnecai
(pl. ijnecade) qui signifie « chant », sans spécification de contenu. Comme Estival
l’avait signalé, les chants ne peuvent être distingués que par les paroles, étant
donné que hommes et femmes chantent de la même manière. Les Ayoreo de Jesudi
distinguent les catégories suivantes : irade, pinangoningai, chingojnangai,
118
�enominoi, yasitigai, uñacai et versículo, parmi d’autres que nous laisserons de côté
à défaut d’avoir pu les approfondir 97.
La définition donnée par Estival de jnusietigade correspond à ce que nous
appelons irade. Le terme pocaningane veut dire, littéralement, « guerre », pourtant
ce mot n’a jamais été utilisé pour nommer une chanson à Jesudi. Les deux
catégories rapportées directement à la guerre sont celle de pinangoningai, une sorte
de glorification personnelle interprétée avant d’aller à la guerre, et celle de
chingojnangai, qui consiste à fêter le succès obtenu dans un raid guerrier. Les
exemples de pocaningane reproduits dans son article de 2005 correspondent à ce
que les Ayoreo de Jesudi appellent pinagoningai. Ore enominone et enominoi se
rangent sous la même catégorie, à la différence qu’Estival la met au pluriel et avec
l’adjectif possessif de la troisième personne du pluriel. Estival fait référence aux
chants de deuil mentionnés par Bórmida. Il a d’ailleurs assisté à un enterrement
dans la communauté d’Isla Alta lors duquel, par contre, personne n’a chanté. La
description de Bórmida correspond à la catégorie d’uñacai, que nous présenterons
brièvement ici et qui sera l’objet d’une étude approfondie dans la deuxième partie.
Le yasitigai et le versículo ne correspondent à aucune des catégories décrites par
Estival.
Voyons maintenant les caractéristiques les plus typiques de ces catégories de
chants. Les Ayoreo définissent chaque catégorie en soulignant le sujet du chant et
l’action principale que l’énonciateur exprime dans cette composition. Ainsi, dans
les irade, « abai jnusi dacote poga acote jnusi dabai » (« à un homme sa femme lui
manque, ou bien à une femme c’est son mari qui lui manque »). Il y a aussi d’autres
traits secondaires de la parole, néanmoins récurrents, qui permettent d’identifier la
catégorie à laquelle le chant appartient.
97
Il s’agit de perane, tarajnane et jnucaminie. Les perane semblent être des vocalisations sans
paroles que le chanteur produit en jouant avec sa gorge (« unejna ubusugui », littéralement :
« délicieuse sa gorge »). Les jnucaminie seraient une sorte de sifflement, sans paroles et chargé d'une
forte tristesse. Personne à Jesudi n'a su (ou n'a voulu) les interpréter, car leur caractère dangereux
— ils font mourir le conjoint de celui qui les interprète — a empêché leur transmission. Les
tarajane, quant à eux, étaient mentionnés lors de conversations sur les perane, mais aucune
caractéristique n'a été décrite.
119
�III.1.2.1. Enominoi, la vision du chaman
Vision de Pojnanguene Étacori, interprétée par Sidi Posorajãi
Ajnito ga angai ñurusorone quigode gajine gusu ca atodo yu jne
yigaidode uacaniri arode gusu bacacugue erueode iji uacanirone udojo.
Emi chosite ga chingomeñuque Jnoede chi ore tora yoquiquigade udo
ga chi ore jno yocudi dayode coñoque.
« Lève-toi et écoute le sens de mes mots maintenant. N’aie pas peur de moi,
il n’y a que des restes dans votre territoire, seulement des restes de bûches
dans votre territoire ».
Le vent a fait comme ça, il m’a dit que Jnoede apparaîtrait derrière nous et
qu’ils nous amèneraient chez les Blancs.
Dans un rêve, le vent a parlé à Pojnanguene et lui a montré que dans le
territoire Ayoreo, le monte, il ne restait que quelques feux en train de s’éteindre.
Les Ayoreo avaient quitté la forêt et ils avaient rejoint les Blancs. Il était habituel
qu’un Ayoreo déjà contacté — dans ce cas Jnoede — aille chercher ses parents et
amis pour les convaincre des avantages de sortir de la forêt et d’habiter dans les
missions.
Cette catégorie comprend les visions du chaman. Dans ces récits,
l’énonciateur raconte les images qu’il a vues ou les conseils qu’un Premier Homme
lui a donnés concernant le futur immédiat. Même si ces visions ne se présentent
qu’au chaman et qu’il y a généralement des jnanibajade impliqués, rien n’indique
que ces chants aient un pouvoir. Comme il arrive avec le reste des chants non
sacrés, aucune précaution n’est à prendre avant de les chanter et toute circonstance
est bonne pour le faire — les mêmes circonstances que pour le reste des
compositions décrites ici. La performance d’un enominoi n’est censée produire
aucun effet dans la réalité et il peut être interprété par tout le monde.
120
�Nous avons enregistré trois enominone au cours de notre terrain. Les
répertoires des personnes qui chantent sont difficiles à saisir. D’une part, ce
répertoire semble assez limité : une personne aime chanter généralement les six ou
sept mêmes chansons98 et le soir les autres Ayoreo lui demandent assez souvent
d’interpréter les mêmes compositions. D’autre part, quand nous parlions des
événements du passé, il était habituel qu’ils se souviennent d’un chant décrivant les
faits en question. Ils pouvaient l’interpréter sans problèmes, bien que dix années ou
plus se soient écoulées. Sidi avait un répertoire assez vaste mais il préférait
interpréter certains chants en particulier. Parmi eux, c’était l’enominoi qu’il chantait
le plus souvent.
Il s’agit d’une vision d’Oji Étacori, plus connu sous le teknonyme
Pojnanguene (père de Pojnangue99 ), résidant à Ijnapui, à 35 km au nord de Jesudi.
Même si nous avons rendu visite à Pojnanguene à deux reprises, c’est une
interprétation de Sidi Posorajãi, de Jesudi, que nous transcrivons ici. Sidi ne l’avait
pas entendue directement de son auteur, mais de Gaacai Chiquenoi (décédé) qui
appartenait à la première population de Jesudi.
À partir des trois exemples que nous avons enregistrés et transcrits, et
d’autres dont on nous a raconté la vision qui les avait inspirés et les faits qui
suivirent, nous pouvons signaler certaines régularités. Premièrement, il s’agit de
prémonitions qui arrivent dans un rêve, comme dans le cas de Pojnaguene (voir par
exemple les visions de la femme chaman Bajo dans Amarilla-Stanley 2001 : 63). Le
rêve semble conformer un état privilégié pour la rencontre avec des êtres des
premiers temps 100. Ce genre de rencontre est aussi un trait caractéristique des
98
Cela a été évident quand nous avons enregistré trois fois au cours d’un mois des messages pour
d’autres communautés. Les chansons choisies étaient pour la plupart les mêmes dans les trois
occasions.
99
Il ne s'agit pas de la fille de Jnumi, c'est une autre femme.
100
Le rêveur, uritai, occupait une place qui le différenciait de l’homme commun (BÓRMIDA 1984 ;
CALIFANO 1990). Il s’agit d’individus qui n’avaient pas subi l’initiation chamanique et qui ne
pouvaient logiquement pas guérir par succion, mais qui avaient certainement une sorte de pouvoir
acquis involontairement. Ces individus voyaient des événements du futur dans leurs rêves. D’après
l’expression à Jesudi, ils étaient casi naijnaque (« presque chamans »).
121
�enominone : c’est un jnanibajai qui, dans le rêve, raconte au chaman ce qui
arrivera. Rencontrer ce genre d’entité et parler avec elle est une caractéristique du
chaman 101. Dans ces visions, c’est généralement le jnanibajai qui parle et qui
raconte, sous la forme d’un avertissement, ce qui se passera. Deuxièmement, il
s’agit de faits néfastes, soit une attaque d’ennemis et ses conséquences tragiques,
soit le fait que les Ayoreo quitteront le monte pour aller habiter chez les Blancs. Ce
qui est remarquable, finalement, c’est le fatalisme avec lequel ces prédictions
négatives sont acceptées et racontées. Dans plusieurs cas (voir l’enominoi
d’Ajeyide, interprété par Toto), c’est la mort du chaman qui est prédite, sans que
rien ne puisse changer le cours des événements. Ce même sentiment de fatalité est
renforcé par les commentaires qui sont faits lors de la performance d’un chant de ce
type : qu’ils viennent du chanteur ou du public, ils garantissent la véracité des
visions confirmées par les événements postérieurs.
III.1.2.2. Pinangoningai, « j’ai tué une fois » (et je le ferai à nouveau)
Pinangoningai de Manene Dosapei, interprété par Sidi Posorajãi
Que ñiñanguena ñaqueamai Ingoine ore yuite.
Ñimopie jne ñajne yayode ore icomejna ga chi ca ayore susmaningai
gajneique
ga chi ca ore tujnuna dacañoacha datei ude ca chi yigaudo udo umaiga.
Yichietigai yadode udo umaiga ca aquesuyo uyu a jnumi yayode icaite
Uguide cachodi.
Ñacañujna ite ore ujnatarojna disigajade ore tayipie tigaite.
Je suis fâché avec mon oncle Ingoine.
Je suis content parce que l’icobidie de mes parents m’appartient
101
Il semble que chez les Ayoreo le chaman rencontre les jnanibajade au cours de la transe
d’initiation — ou lors d’une guérison — ou encore dans ses rêves. Nous n’avons recueilli aucune
histoire ou le naijnai rencontre un Premier Homme en plein jour dans la forêt, comme c’est le cas
dans d’autres groupes du Chaco (notamment chez les Qom du Chaco argentin, cf. TOLA 2004).
122
�et eux, ils ne portent pas le grand icobidie.
Quand j’étais un enfant ils m’ont attaqué lors du meurtre du père d’Ugui.
Je suis comme l’edopasai de ma mère, les jumeaux et leur ayipie.
Manene exprime sa fureur contre Ingoine, asute — « chef guerrier » — qui
avait conduit une attaque contre les Garaigosode et dont l’une des victimes était le
père d’Ugui Dosapei. Manene n’était qu’un enfant lors de cette attaque et il a dû
prendre la fuite. Il souligne qu’il est un homme maintenant et qu’il a le droit de
porter le collier de plumes icobidie (celui-ci, tout comme le chapeau de peau de
jaguar ayoi, est réservé aux guerriers qui ont tué un homme ou un jaguar). Ses
ennemis, par contre, nous dit Manene, ne méritent pas de porter ces ornements. Il
rappelle au destinataire du chant qu’il n’oublie pas le meurtre d’Uguide, qui a eu
lieu quand il était enfant. Finalement, il cite (nous préciserons ce point plus loin)
les appartenances claniques de sa mère, qui feraient peur à ses ennemis.
Que signifie pinangoningai ? Il n’y a pas de traduction exacte de ce mot
dans le dictionnaire des New Tribes Missions (Higham et al. 2000). Cependant,
nous avons trouvé l’entrée « ingoningai » (« gloire ») (Higham et al. 2000 : 439),
qui est rapportée étymologiquement. Avec le préfixe possessif de 3e pers. sing. elle
devient dangoningai (« sa gloire »). Il faut rappeler que le dictionnaire de Higham
et al. a été élaboré à partir de la variante bolivienne de la langue ayorea, où le son
[d] en début de mot a son équivalent en [n] dans la variante paraguayenne (e.g. «
daijnai » — chaman — en Bolivie est « naijnai » au Paraguay). Autrement dit,
dangoningai serait nangoningai. En ce qui concerne le préfixe « pi-», nous n’avons
rien trouvé dans les grammaires de Pier Marco Bertinetto (2009) et de Maxine
Morarie (1980), mais on peut supposer qu’il s’agit d’un élément de nominalisation.
Pinangoningai pourrait donc signifier « glorification ».
Le pinangoningai est un chant de glorification personnelle qui est interprété
avant d’aller au combat. Il ne faut pas confondre ce chant individuel et personnel
avec le rituel chuguji. Ce rituel était un exercice collectif dont le but était de
générer le sentiment de la colère envers les ennemis. Les hommes mettaient leurs
123
�ornements de plumes — les icobidie et les potayedie — sur les épaules et le cou,
leur chapeau de peau de jaguar — l’ayoi — sur le front et ils formaient un cercle.
Avec tout le corps tendu, un bras plié dans le dos et l’autre sur la cuisse, ils
frappaient violemment le sol avec leurs pieds tout en prononçant des mots en
serrant les dents : « to…! ». Ils continuaient jusqu’à déclencher un état de rage qui
faisait couler la salive de leur bouche102. Remplis par ce sentiment de rage, ils
partaient à la rencontre de leurs ennemis.
Le pinangoningai, en revanche, est un chant individuel composé par un
individu qui raconte un ou plusieurs épisodes guerriers de sa vie. « Yuje ica » (« j’ai
tué une fois ») est le sujet de ces compositions selon Bajai. Ils étaient interprétés
avant d’aller au combat. D’après ce qu’on nous a dit à Jesudi, les pinangoningane
étaient interprétés après le chuguji. Cette information devra être confirmée dans une
recherche postérieure qui se concentrera sur ces genres guerriers de la parole
puisqu’il nous semble difficile que dans un tel état de rage (avec des expressions si
saccadées et des corps si tendus) un individu puisse se mettre à chanter. Les Ayoreo
ont marqué un contraste entre cette composition et le rituel : c’est un chant qui peut
être imité comme les iradedie. Ce rituel par contre — et logiquement —, n’était
jamais mis en pratique dans des rencontres pacifiques entre bandes.
« Yuje ica » « j’ai tué une fois » en est le message principal. Dans ces chants,
l’auteur se glorifie en parlant des personnes qu’il a tuées par le passé.
Généralement, ces chants ont un destinataire spécifique. Sidi Posorajãi utilisait un
verbe dérivé de ce nom : « Manene nango Ingoine yui », qui pourrait se traduire par
« Manene dédie un pinangoningai à Ingoine ». Il s’agit de mettre en avant son
propre courage en rappelant que l’on a tué auparavant — ce qui manque dans cet
exemple, mais pas dans le reste —, et en soulignant les motifs pour lesquels
l’énonciateur est fâché contre le destinataire.
102
Hormis la dernière partie — la salive qui coule à cause de la colère —, cette description
correspond à ce que Bajai nous a montré à Jesudi. Elle est cohérente avec celle de BARTOLOMÉ
(2000 : 49).
124
�Un moyen particulièrement efficace de mettre en relief les qualités
guerrières est de « citer » une appartenance clanique. Les Ayoreo de Jesudi mettent
en évidence deux traits des pinangoningane. Premièrement, la glorification par une
victime, dont nous avons parlé ci-dessus. Deuxièmement, le fait de chacajna
edopasade. Selon le dictionnaire des New Tribes Mission, « –acãra aja » veut dire
« compare to (to) ; liquen one thing to another (to) » (Higham et al. 2000 : 9). Les
Ayoreo, à leur tour, traduisent « chacãra » par « ejemplo » (« exemple »). Dans ces
chants destinés à menacer ou à faire peur aux ennemis, le compositeur fait une
comparaison entre lui et ses appartenances claniques ou — dans de très rares cas
comme ce pinangoningai — celles de sa mère.103
Dans quelques cas, la comparaison établit clairement que l’énonciateur
possède une qualité de son appartenance clanique : par exemple, un membre du
clan Dosapei dit « toto choqui yedopasai » (« le cochon sauvage mâle est mon
appartenance clanique »). Le cochon sauvage (Tayassu tajacu) est très réputé pour
la férocité avec laquelle il fait face au chasseur dans la forêt. Dans d’autres cas, la
relation est moins claire : le chanteur énonce des choses très puyac — interdites ou
puissantes. Cette technique lui permet de montrer deux choses : d’un côté, il n’a pas
peur — comme le reste des Ayoreo — de mentionner ces êtres puissants ; de l’autre,
il inspire la peur de la même manière que ces existants redoutés.
Dans notre exemple, Manene indique que les jumeaux et leur ayipie sont les
edopasade de sa mère. Les Ayoreo craignaient beaucoup les bébés jumeaux et les
enterraient tout de suite après leur naissance104. L’ayipie est l’un des deux principes
animiques de la personne Ayoreo. Il se rapporte à la pensée et aux sentiments, alors
que l’oregate est une sorte de double qui sort du corps du chaman pendant ses
103
Comme nous le verrons pour d’autres compositions où les edopasade — les appartenances
claniques — interviennent, le nombre d’exemples utilisés est limité. Il s’agit toujours des trois ou
quatre mêmes edopasade qui sont cités. Même si chaque élément de l’univers appartient à un clan
déterminé, dans la pratique — même dans des circonstances très diverses — seuls cinq ou six
edopasade par clan sont impliqués.
104 En 1982, la naissance des jumeaux « acceptés » à Campo Loro, mission de New Tribes Mission, a
été décrite par le journal mennonite Mennoblatt comme un succès contre
les croyances
traditionnelles (HEIN 1988 : 163).
125
�voyages. Le mot ayipie fait partie des verbes inhérents aux processus cognitifs et
affectifs, et des phrases qui font référence au comportement social ou antisocial des
individus — suivant une éthique que nous explorerons plus loin. Généralement, les
comportements antisociaux et les diverses actions qui pourraient être décrites
comme dépourvues de sens, sont attribués au manque d’ayipie : « garosi ayipie,
gu… ! » (« [il a] peu d’ayipie, c’est pour cela... ! »). Selon les Ayoreo, dans le cas
de jumeaux il y aurait un seul ayipie qui serait divisé en deux, ce qui signifie que
ces deux individus feront des choses insensées dès leur naissance.
Les pinangoningane étaient interprétés exclusivement par des hommes, ce
qui est rare parmi ces chants non sacrés. En général, tout individu peut interpréter
des chants qu’il a entendus, même s’il n’en est pas l’auteur. Les visions de chaman
enominone pouvaient être chantées par des femmes, mais seulement par des
femmes chamanes. Ces chants, comme les chingojnagai et les enominone, sont les
moins nombreux que nous ayons recueillis dans notre travail de terrain. En fait,
sauf un cas de chingojnangai, tous les chants de ces genres appartiennent au passé
et leurs auteurs sont décédés depuis longtemps. Ces trois genres ont en commun la
référence à la guerre qui, depuis le début de la vie dans les missions — à
l’exception d’un épisode à la fin des années 1980105
—, est devenue
progressivement de moins en moins présente dans la vie des Ayoreo.
III.1.2.3. Chingojnangai, la joie par la mise à mort d’une victime ou l’obtention
d’un butin
Chingojnangai de Paojnaine, interprété par Sidi Posorajãi
Yurugaisone ayore uaque ga angacho yujumenatei coñone cuchabia.
« ñajnaingo ñiquijnora cámejnai ga a yico Paojnaine gotique i siñeque, a
chayo i siñeque yiquiPaojnai, mecarane »
ga ñejna dogue jeti ore utigo degode coñone
105
La dernière confrontation entre les bandes Totobiegosode et Guidaigosode a eu lieu en décembre
1986 (cf. PERASSO 1987, VON BREMEN 1987). Voir section I.4 du chapitre I.
126
�ga yisapie yurugasone ayore eramone ga ore tangai yatedateique.
Putugutoi po iji ore puruque achutigo disidacabode yequejoigo, que yiraja
maqueñingueique bate gotique, gusu baradie iji babai.
Mes ennemis ayoreo, écoutez ma grande nouvelle sur les Blancs puissants.
[Les Blancs ont dit :] « Allons chez Paojnai, [qui est] ailleurs, il fuira, il
s’en ira »
et j’ai pris ma massue et je les ai frappés dans tout le corps les Blancs
et je pense à mes ennemis ayoreo [qui sont] ailleurs, qu’ils connaissent ma
grande tuerie !
Le jaguar rugit aux alentours des enfants et je n’ai pas peur de toi, ce ne
sont que des taches sur ta peau.
Le chingojnangai se rapporte à la guerre comme le pinangoningai, mais
différemment. En réalité, il est censé être chanté au retour de la bataille. Il ne
consiste pas à énoncer une menace précédant la guerre, mais plutôt à fêter la
victoire obtenue. Bajai nous a raconté qu’Uejai Picanerai, le grand chef guerrier et
chaman, avait l’habitude de chanter des chingojnangane au retour de ses raids :
« yase Eroi uje chuje, yasé Mimie uje chuje » (« Eroi est heureux parce qu’il a
tué »). C’était une sorte d'auto-congratulation. Ingójna –gai est un verbe qui
signifie selon le dictionnaire des New Tribes Mission « sing a victory chant (to) ;
chant victoriously about (to) » (Higham et al. : 440). D’après les exemples que
nous avons recueillis à Jesudi, le chingojnagai ne se limite pas à une victoire
guerrière. L’accent est mis sur la victime ou sur le butin obtenu. Ainsi, nous avons
enregistré un exemple composé pour fêter l’obtention du sel et un autre pour avoir
tué un jaguar (annexe Chants, section III, chants 2 et 3 respectivement). Le premier
appartient clairement au domaine guerrier : les salines étaient au centre du territoire
des Ayoreo et c’est là que plusieurs batailles ont eu lieu. Le motif principal de cet
exemple est de célébrer l’obtention du sel, alors que le fait d’avoir rencontré
quelqu’un et de l’avoir tué est mentionné accessoirement. Tuer un jaguar, dans le
deuxième cas, se rapporte symboliquement à la guerre, même si dans cet exemple
127
�c’est Puua Dosapei, une femme, qui célèbre le décès du félin qui avait tué son
chien.
Les exemples de ce genre que nous avons enregistrés appartiennent d’une
certaine manière au passé : il s’agit d’anecdotes d’une autre époque. Le contexte
actuel ne fournit pas d’opportunités satisfaisantes pour composer des
chingojnangane. La seule exception est le chant de Puua, une femme très âgée
décédée quelques années avant notre arrivée à Jesudi. Même dans ce cas, il ne
s’agit pas d’une bataille contre des Ayoreo ou des Blancs. Comme pour les
enominone et les pinangoningane, nous n’avons pas été témoin du contexte de la
création de ces chants.
III.1.2.4. Irade, une histoire de nostalgie et d’amour
Colère d'Umajno contre Guiejna, par Jnumi Posijñoro
Uengate que, Guiejna yedogabia Guiejna.
Guiejna uneagajnamio Guiejna maneangajnamio uje majnose Ale
uaqueñaque.
Guiejna que yiya maneatique ga uengate Guiejna.
Guiejna tagusupusu ñajenique.
Guiejna maneanguejnamio ome Laino, ñujnusietigai garañi.
Guiejna majnose Ale uaqueñaque.
Guiejna que yiya maneatique gajine bagupusu yajei ga uengate
yayipiedopusu Laino, Laino ategoningai ome ñoque.
Laino suque uñatic. Laino suque disape mu uengate.
Laino suque chejnapise picanigatiguei ga uengate pujnusietigaique
ujuyapise yu ome Laino ucode uñatic.
Guiejna bagusupusu ñajenique ome uñatic.
Guiejna uengate yasiguepise Laino gu uje que doi Ale uñaque.
Yasitigai garañi Laino uje que doi Ale ga Laino sucode ga Laino sucode
uñatic pujnusietigaique ujuya ga Laino suque uñatic chejnapise yuchade.
128
�Que ayoreique cho Laino.
Laino suque chejnapise cuchade ga uengate.
Guiejna tagusupusu ñajenique uengate ga Guiejna que yiya maneatique.
Yico mu yajíe yiquei mu ñimo Laino daye iji yiquenique ga uengate ore
iotopatiguei di ore platadie udi
uengate Guiejna tagusupusu ñajenique
Guiejna mejnasi guidaiode uje bacuegode bape catejamia abaiode.
Je pense à Guiejna avec intensité
Guiejna je suis fâchée avec toi parce que tu as volé un mari qui était pour
Ale
Je serai fâchée tous les jours avec toi et avec intensité, Guiejna
Guiejna, je suis fâchée avec toi
Guiejna je suis fâchée avec toi à cause de Laino, ma tristesse apparaît
Guiejna, tu as volé un mari qui était pour Ale
Guiejna, je n’arrêterai pas d’être fâchée avec toi, je suis tellement fâchée
que j’ai mal au ventre, je pense beaucoup à Laino, Laino était très généreux
avec nous
Laino, Laino était jeune mais très fort
Laino était très généreux et je suis accablée par la tristesse pour Laino
Guiejna, je suis très fâchée avec toi
Guiejna, je suis heureuse parce que Laino ne couche pas avec Ale.
Guiejna je trouve le bonheur parce que Laino ne couche pas avec Ale. Je
suis accablée par la tristesse et je la ressens dans mon ventre
Il n’y a pas d’Ayoreo comme Laino
Laino donne beaucoup de nourriture à la belle-mère
Guiejna je suis très fâchée avec toi et je n’arrêterai pas d’être fâchée
On y va, je regarde devant moi et je vois le père de Laino, leur patron leur a
donné de l’argent
Guiejna je suis très fâchée avec toi
Tu déménages tout le temps d’une communauté à l’autre parce que tu
cherches des maris pour ta jeune fille.
129
�Ce chant composé par Jnumi Posijñoro est construit à partir des mots qu’une
femme, Umajno, a prononcés contre une autre femme, Guiejna. Umajno Jurunime
voulait que sa fille épouse Laino Posorajãi, un jeune homme qui avait la réputation
d’être généreux. Laino a finalement choisi la fille de Guiejna. Du point de vue
d'Umajno, c’est la faute de Guiejna qui lui a volé le gendre désiré.
Les iradedie sont les chants que nous avons enregistrés en plus grand
nombre. Ils racontent des anecdotes sur des couples. Les sujets sont variés : des
disputes entre un homme et sa femme, une femme qui est triste parce que son mari
n’est pas revenu, une fille qui rejette les pressions de sa mère pour épouser un chef
guerrier, etc. Ici, il s’agit de la colère d’une femme contre la belle-mère du jeune
homme qu’elle aurait voulu comme gendre.
Du point de vue du contenu, il s’agit de phrases reprises textuellement
— dialogues ou déclarations individuelles — transformées en chant par quelqu’un
qui les a entendues. Le critère de sélection et la manière dont ces phrases sont
« entextualisées » (Briggs et Bauman 1990) seront discutés dans la deuxième et la
troisième partie.
D’après les Ayoreo, les iradedie sont toujours des expressions de nostalgie
pour quelqu’un de vivant, ce qui les différencie des uñacade. Les Ayoreo décrivent
ce que fait le sujet énonciateur dans les iradedie avec le verbe jnusi « lui
manquer 106 ». Ils signalent que dans une irade « abai jnusi dacote poga acote jnusi
dabai » (« à un mari lui manque sa femme ou bien à une femme lui manque son
mari ». Même si nous avons recueilli des exemples — comme ici — où les
personnages ne sont pas le mari et/ou la femme, ce rapport homme-femme est
toujours au cœur de ce genre.
106
Les équivalents espagnols « extrañar » ou anglais « to miss » faciliteraient la traduction.
130
�Le répertoire des iradedie ne pourrait pas être saisi dans sa totalité. En fait,
il s’agit d’un répertoire mouvant : de nouveaux chants sont créés constamment,
pendant que d’autres tombent dans l’oubli. Nous avons constaté en 2010 que les
femmes de Jesudi avaient oublié quelques chants que nous avions enregistrés en
2008. Cependant, au fur et à mesure que l’on parlait de ce sujet, elles
commençaient à se souvenir des chants composés une dizaine d’années auparavant.
Il y avait des chants préférés par les interprètes et par l’assistance qui survivaient
plus que d’autres. Nous pourrions dire de manière provisoire que le mécanisme de
création des chants est constant, mais que seuls quelques-uns d’entre eux persistent
dans la mémoire du groupe.
III.1.2.5. Uñacai, l’expression spontanée et structurée de la tristesse
Uñacai pour Puchiejna Dosapei, par Sidi Posorajãi
Oyopacho ga ñunguamu putugutaroi nequenojnangue.
Amate cho cuchachungunique ga je piquetac.
Oguiyabape dutue penojnangue ñajnami iji jnani uecaique ujnaigo.
Oguiyabape chuguperenatei ama poro yuo,
Oguiyabape uñaque namanique quiganingo.
Taisez-vous… ! Je pleure pour la belle peau du jaguar
Sa maladie est très forte et il n’y a pas de remède
Je pleure pour mon petit-fils, la belle courge, qui restera entre les hommes
vivants.
Je pleure pour la plume blanche de la cigogne, ma fille.
Je pleure pour celle qui est restée derrière son mari.
Sidi pleure ici pour son gendre Puchiejna Dosapei, qui est tombé malade
sans que les médecins à Asunción puissent justifier la gravité de son état. Il pense à
son petit-fils et à sa fille, qui resteront tout seuls une fois le malade décédé.
131
�L’uñacai est un chant de tristesse. Il pourrait entrer dans la définition de
« chant de deuil » puisqu’il est interprété après le décès de quelqu’un, mais nous
pensons que la catégorie plus ample et plus vague de « tristesse » lui convient
mieux. Nous n’avons été témoin d’aucune cérémonie de décès lors de notre terrain,
mais nous avons assisté à des uñacade au moment de leur composition. C’étaient
des moments d’angoisse où l’on craignait la mort de quelqu’un.
Il faut différencier deux instances de performance. Dans la première, la
personne pleure en chantant et c’est à ce moment qu’elle compose le chant. La
deuxième instance arrive quand quelqu’un — même l’auteur — répète l’uñacai
pour le plaisir de chanter. Dans ce cas, on ne peut pas le distinguer des autres
chants sauf par les paroles.
Les Ayoreo mettent en avant deux aspects des uñacade. Premièrement, le fait
qu’il consiste à pleurer : chungu « il pleure » est la définition donnée de ce genre
par l’énonciateur. Deuxièmement, celui qui pleure chise edopasade « trouve des
appartenances claniques ». Au lieu de nommer la personne pour laquelle il est
triste, le chanteur — strictement parlant, il ne chante pas, il pleure — mentionne
une appartenance clanique de celui-ci. Le même processus de substitution est
accompli avec les autres personnes mentionnées dans l’uñacai, dans ce cas Galeano
Dosapei et Chugupenatei Posijñoro, le fils et l’épouse de Puchiejna Dosapei.
Les uñacade, des chants qui continuent à être composés — du moins à
Jesudi —, présentent une série de régularités poétiques et des implications
sociologiques qui seront analysées dans la deuxième partie de cette thèse.
III.1.2.6. Yasitigai, « je suis ravie »
Chanson de joie par Poro Posijñoro
Chimojnoque yasitigai,
yisape yasitigai ome Chaguadaye uñeque uje Chaguadaye uñeque gajneque
yasitigai tude uje chimate najnorane ome dagaidode Dupade uruode dojode
ayore ore.
132
�Cuchiyiode uñai tu Juan uqueñatic. Juan suque gajneque yasitigai ome
Jesucristo iroqueode ore chimate dagaidode.
Cuchiyi tuqué Disiejoi chimojnoque Disiejoi ore itamajnaningai etoque ome
Jesucristo.
Ñujnacari gatode gajneque yasitigai Jesus yoquiroqueode i erami uje ore
chimate datatagode Jesus.
Je suis ravie,
Chuguadaye me rend joyeuse, c’est à lui que mon chant de joie est dédié,
il exalte la parole de Dupade auprès de ses amis et de tous les Ayoreo.
Juan est fort avec la parole de Dupade, et mon chant est dédié à lui, les
apôtres de Jésus-Christ. Ils exaltent la parole [de Dupade]
Disiejoi est fort avec la parole de Dupade, Disiejoi et eux, ils travaillent
pour Jésus-Christ.
Mon chant de joie est dédié à mon jeune fils, nos apôtres de Jésus vont
partout, ils exaltent la parole de Jésus.
Poro est très contente parce que trois jeunes hommes de Jesudi ont
commencé à prêcher la parole de Dupade. Quand elle a interprété pour nous ce
yasitigai, elle a souligné cependant que la situation n’était plus comme ça : « ore
coa... ! » (« ils sont tombés »). Ces jeunes hommes n’étaient plus ceux qui
méritaient cette composition, mais Poro continuait à envoyer ce chant dans des
messages à d’autres communautés.
Le yasitigai est un chant composé pour exprimer la joie à propos d’un
événement particulier. La structure, dans les deux exemples (celui de Poro et un
autre de Jnumi) que nous avons recueillis, est assez simple : ils consistent à
exprimer l’état de joie et à en signaler les raisons. Dans ces deux cas, la figure de
Dupade ou celle de Jésus est très importante. Cela ne veut pas dire que ce genre de
chant ait été introduit chez les Ayoreo par les missionnaires des New Tribes
Mission et les Salésiens. Premièrement, parce que les chants des New Tribes
Mission ont des musiques et des paroles qui n’ont rien à voir avec les chants
133
�ayoreo. Les chants des New Tribes Mission ne sont que des traductions des chants
chrétiens en anglais (avec leur musique originale). Un exemple du livre Dupade
iradedie (« chansons de Dupade ») le montrera plus clairement :
Piagoi tu yu
Jesus chojninga, // Piagoi tu yu. // Jeta ayoréode pota, // Abagui yu.
Jesus chojninga, // Urepise yu. // Jeta ayoréode pota, // Abagui yu.
Jesus chojninga, // Etoguipise yu. // Jeta ayoréode pota, // Abagui yu.
Jesus chojninga, // Caniraque yu. // Jeta ayoréode pota, // Abagui yu.
Je suis la porte
Jésus a dit // Je suis la porte. // Si les Ayoreo veulent, // Venez à moi
Jésus a dit // Je suis très vrai. // Si les Ayoreo veulent, // Venez à moi
Jésus a dit // Je suis très fort. // Si les Ayoreo veulent, // Venez à moi
Jésus a dit // Je suis généreux. // Si les Ayoreo veulent, // Venez à moi
Dans les cas de yasitigade, nous voyons qu’il s’agit, contrairement aux
chants de New Tribes Mission, d’une parole personnalisée. Ce yasitigai a été
composé par Poro à cause de et pour Puchiejna, Juan et Disiejoi. Nous pensons que,
malgré la présence des figures de Dupade et de Jésus dans les exemples enregistrés,
cet aspect chrétien n’est pas une condition nécessaire à ces chants. Echoi Picanerai,
une femme d’une quarantaine d’années, disait dans un message enregistré pour les
Ayoreo de la communauté de Chaidi qu’elle était très contente des mots reçus, mais
qu’elle ne savait pas chanter : « Si je savais chanter, je ferais un yasitigai pour
toi ». Elle était censée composer un chant pour exprimer sa joie et en même temps
remercier (le chant est — nous le verrons dans la troisième partie — une sorte de
cadeau que l’on peut envoyer).
Le nombre limité d’exemples de yasitigade représente une énigme. Pour
l’instant, nous pouvons dire qu’un état de joie est souvent exprimé par le biais du
chant, mais pas nécessairement à travers l’expression directe de cet état d’esprit.
Par exemple, Bajai avait dit que les chingojnangane d’Uejai étaient une sorte de
134
�yasitigade de guerre, bien qu’il s’agisse de deux types distincts de chant. Sidi, à son
tour, s’il était content d’un événement particulier, se mettait à chanter des
pinangoningane ou des uñacade, mais pas nécessairement un chant spécifique pour
la situation qui le rendait heureux. Comme Seeger le disait à propos des Suya,
« singing made them happy. They sang because they were happy » (1985 : xvii).
III.1.2.7. Versículo, un irade-sarui en code chrétien
Versículo pour que le ciel s’éclaircisse, de Chacasi, interprété par Jnumi
Posijñoro
« Yocacanisori ajnito uñujna cuchabe a chejna ñoque jne... ! »
mu yocacanisori chicha namane gatade yui
ga jeaque uñujna cuchabe jeaque chonaque
mu yocacanisori nae ga « ome yajeode ga ijnoque panguretigai uaque
uje bacatodoyo uñujna cuchabe bisideque, ijnoque bacanguretigade »
« Notre Maître viens, le grand orage nous exterminera... ! »
mais notre Maître a levé le bras
et tout de suite l’orage a disparu.
Notre Maître a dit : « il me semble que vous n’avez pas la foi,
vu que vous craignez l’orage pour rien, vous n’avez pas la foi. »
Le versículo est une catégorie très particulière qui rassemble des traits de
discours divers dans leur performance et dans leur contenu. Premièrement, le nom
espagnol — qui veut dire « verset de la Bible » — marque l’influence chrétienne.
Chacasi, l’auteur des versículos que nous avons enregistrés, est un individu reconnu
pour savoir « parler les mots de Dupade ».
Quant à la manière de les chanter — la voix, la mélodie, le vibrato —, rien
ne peut les distinguer du reste des chants profanes ayoreo. Un trait les rapproche
135
�des formules de guérison : ils sont censés produire un effet direct sur la réalité
(dans ce cas, ouvrir le ciel). Cependant, les versículo — contrairement aux
sarode — ne produisent pas l’effet inverse s’ils sont interprétés dans la mauvaise
circonstance. Ce manque d’ambivalence explique qu’ils puissent être envoyés dans
des messages entre communautés enregistrés sur cassettes (sans produire de
conséquences néfastes). Cette hétérogénéité des composants les met à la croisée
d’agentivités diverses exprimées aussi dans le contenu.
En ce qui concerne le texte, ces chants présentent des particularités qui les
éloignent des autres chants non sacrés. Contrairement à la norme, il n’y a aucun
individu nommé dans les versículos, à l’exception de Jésus. De plus, les
circonstances décrites sont très limitées du point de vue de la description. Dans le
cas du versículo de la femme guérie après avoir touché la tunique de Jésus (annexe
Chants, section VII, chant 1), nous remarquons la présence de la particule chi « on
dit », qui est une marque distinctive des récits mythiques. Cependant, nous voyons
que le texte raconte une anecdote, un événement avec des personnages, une
situation et une résolution — ce qui le rapproche des iradedie ayoreo en même
temps qu’il le distingue des Dupade iradedie présentés auparavant, dans la section
des yasitgade. Il faut souligner qu’à aucun moment l’identification — à la manière
des sarode —, entre l’énonciateur et le jnanibajai — dans ce cas Jésus —, n’est
réalisée par le biais de la première personne du singulier. Le versículo agit mais il
consisterait en l’invocation d’un pouvoir plutôt qu’en son intervention directe. Tant
par sa performance que par ses paroles, le versículo présente une complexité qu’il
faudra dégager en reprenant l’analyse de la figure de Dupade, les modes discursifs
des formules de guérison et le rôle sociologique des chants non sacrés, ce qui
constituera l’objet d’analyse de la deuxième partie.
III.1.3. Conclusion de III.1
Des exemples de ces genres peuvent être entendus tous les jours. Le
versículo, en revanche, est plutôt interprété en cas de maladie ou bien
136
�d’enregistrement de messages — où l’on peut trouver des références aux paroles de
Dieu. Ces genres nous donnent une première impression du domaine de la parole
non dangereuse chez les Ayoreo. Ce premier répertoire des genres nous permet de
voir qu’il est aussi développé et complexe que celui du domaine de la parole
dangereuse. Nous verrons dans la section suivante un genre que les régularités
narratives ne suffisent pas à définir car il relève aussi de la gestualité, d’un vrai
langage corporel. Il s’agit d’une performance dramatique.
III.2. Les récits guerriers
La guerre occupait une place très importante dans la vie des Ayoreo
d’autrefois. Nous avons vu dans la section précédente qu’au moins deux genres de
chansons se rapportent directement à la guerre, le pinangoningai et le
chingojnangai. De plus, les visions de chaman enominone et les chants de deuil
uñacade sont aussi liés à ce domaine. Généralement, les chamans prévoyaient une
attaque des ennemis et les chants de deuil étaient composés occasionnellement pour
quelqu’un tombé sur le champ de bataille. Il existe aussi un autre genre de parole
profane consacrée aux événements guerriers : la performance dramatique des
anecdotes de guerre.
Il s’agit d’une sorte de pièce de théâtre qui est désignée par les Ayoreo de
Jesudi par chatata oijnane (« il raconte des événements »). Le moment choisi est
toujours le soir, quand ils se réunissent autour du feu. Dans cette performance
individuelle, c’est la même personne qui joue les différents rôles : lui-même, ses
amis et les victimes ou les animaux chassés. C’est l’histoire d’un aller, d’une
bataille et d’un retour. Cette mise en scène consiste vraiment en la performance
d’un acteur : avec son corps, il imite l’attaque des ennemis, la manière dont ils ont
essayé de se défendre, et la mort infligée par la massue ou la lance. Un code
mimique lui permet de raconter toutes les péripéties du voyage à l’intérieur du
cercle formé par le public. Par exemple, piétiner le sol — avec le poids du corps
reposant sur la jambe arrière — équivaut à courir. Ces oijane sont toujours joués par
137
�leur protagoniste qui se prépare pour le spectacle de la même façon que pour la
guerre : en se noircissant le corps avec du charbon et en mettant ses ornements de
plumes.
Ces performances avaient été déjà décrites en 1977 par Braunstein (1977).
Ce chercheur argentin s’était rendu à María Auxiliadora en 1974, peu après la sortie
des Ayoreo de la forêt. C’était une époque où certains continuaient à pratiquer des
raids guerriers contres leurs ennemis et où d’autres en avaient des souvenirs encore
très vivants. Il fournit une transcription complète en langue ayorea et en espagnol
avec quelques commentaires sur des aspects paralinguistiques — les pauses,
l’intonation, etc. D’Onofrio (2003), à son tour, publie une analyse où il tisse des
rapports entre ces récits et divers aspects de leur culture traditionnelle, tels que les
récits mythiques, le maquillage des jeunes femmes, les visions du chaman et les
rituels associés à la guerre. La performance des guerriers qui racontent leurs
aventures est bien décrite dans ces deux contributions.
Je n’ai assisté à ce genre de pièce de théâtre qu’une seule fois. C’était au
début de mon terrain, à la fin du premier mois, et je ne maîtrisais évidemment pas
encore la langue. La gestualité corporelle correspondait clairement à ce que
Braunstein et D’Onofrio avaient déjà décrit. D’après ce que Jnumi m’a raconté au
moment même et le lendemain, les anecdotes concernaient les sujets plus ou moins
typiques — une attaque guerrière entre Ayoreo, une autre attaque de la part des
Blancs. Rien de nouveau par rapport aux lectures mentionnées ci-dessus, rien qui
ne puisse susciter ma curiosité. La performance en tant que telle ne semblait pas
avoir changé, pourtant tout autour était différent.
Ce soir-là n’était pas un soir habituel, l’ambiance était bien plus animée.
C’était la fin du mois de mai, le vent froid du Sud — umusoi — avait commencé
soudainement à souffler ce jour-là et tout le monde se rapprochait donc autour du
grand feu. Au cours des deux semaines précédentes, ils avaient reçu des provisions
en cadeau et deux maisons abîmées par une tempête avaient été reconstruites. Il y
avait plus de monde que d’habitude dans l’ogadi des Dosapei. La performance de
138
�Sidi était vraiment un spectacle. Un moment avant qu’il ne commence — quand il
avait déjà dit qu’il allait le faire mais je n’avais pas compris ses paroles — les
Ayoreo m’ont suggéré d’une manière impérative d’enregistrer les oijnane : « hay
que grabar ! » (« il faut enregistrer ! »). Ils étaient habitués à accueillir des abuja107
— anthropologues — et ils connaissaient leurs centres d’intérêt. Notons cependant
que Roberto Posorajãi — fils de Bajai — était aussi en train d’enregistrer108 . Le
public était vraiment enthousiasmé : tous avaient les yeux rivés sur l’artiste qui se
trouvait au centre. Ce n’était pas comme tous les autres soirs, où chacun semblait se
concentrer sur sa propre tâche — filer le caraguatá, finir un sifflet en bois, écouter
la radio — et où occasionnellement une conversation s’engageait entre cinq ou six
personnes. Ce soir-là, les gens ajoutaient des commentaires et des exclamations à
l’histoire de Sidi : choooo…! (expression de surprise ou d’admiration),
puricitóoo… ! (« le pauvre ! », mot emprunté de l’espagnol pour exprimer la pitié
pour quelqu’un — dans ces histoires, les victimes). Ces expressions constituaient
une sorte de retour pour le narrateur, qui lui donnait de l’énergie et lui confirmait
qu’il captait l’attention de son public.
Le plus remarquable, c’était l’attention des adolescents et des enfants. Ils
n’avaient pas vécu cette époque d’attaques imminentes et d’expéditions pendant
toute la saison sèche, où tuer était courant, voire nécessaire. Nous pensons que ces
jeunes regardaient ce spectacle d’une manière différente à celle des adultes, dans
les souvenirs d’enfance desquels il y avait probablement des images d’hommes se
préparant pour aller à la guerre. Pour les nouvelles générations, assister aux oijnane
serait peut-être comme regarder un film : une histoire intéressante mais qui ne fait
pas partie de la vie quotidienne. Mais en même temps cette histoire était racontée
par son protagoniste, qui rappelait au public sa présence lors des événements, à
travers l’utilisation de la première personne du singulier, la répétition des dialogues
107
Au sens littéral « barbe », au sens figuré « anthropologue », mais en fait c’est un terme générique
qui désigne des ethnographes, des linguistes, des ethnobotanistes, des curieux et des étrangers en
général, qui restent pendant une certaine période parmi eux.
108
Il ne faut pas laisser de côté une autre explication : il pouvait vendre l’enregistrement à d’autres
spécialistes. Nous avons mentionné dans le chapitre précédent la pratique de quelques chercheurs qui
laissent un magnétophone et quelques semaines après reviennent pour payer et chercher les cassettes.
139
�et surtout la forte dimension testimoniale de son récit. L’enthousiasme du public
motivait Sidi à tel point qu’il n’a pas seulement raconté une histoire, comme il avait
pensé le faire. Il s’est levé une deuxième fois, puis une troisième, pour jouer deux
autres pièces à partir des confrontations auxquelles il avait participé. Ces oijnane
n’étaient joués que dans des occasions où une effervescence sociale
particulièrement intense se manifestait. Faute de caméra, j’ai enregistré seulement
le son de la performance de Sidi. Heureusement, nous avons l’enregistrement
audiovisuel d’une autre occasion, lors d’une expédition des gens de Jesudi en quête
de tortues (Gayet 2010 film). En 2000, ils ont fait un voyage de dix jours jusqu’à
leur ancien territoire de Chovoreca, situé à environ 300 km au nord. Quand je suis
arrivé en 2008 ils étaient en train de planifier une autre expédition. L’enthousiasme
était remarquable, ils décrivaient Chovoreca comme un paradis : des arbres
énormes, des fruits partout, de l’eau pure et surtout une quantité infinie de tortues
— leur plat favori. D’après le journal de la peintre Ysanne Gayet (Gayet 2010),
l’ambiance en 2000 ressemblait beaucoup à celle que nous avons décrite lors des
performances de Sidi. Ce que nous remarquons surtout dans le film produit par
cette artiste, c’est l’enthousiasme du public lors de la performance de Bajai
Posorajãi : ils crient, ils rient, ils sont visiblement heureux.
Nous transcrivons ici un oijnai que Bajai Posorajãi a raconté un soir en 2000
à Chovoreca. Il s’agit d’une attaque lancée contre les Totobiegosode, bande qui
était ennemie des Guidaigosode. Eroi, asute Garaigosi est mentionné dans le récit
comme le chef de l’expédition. Nous pouvons voir aussi que c’est aussitôt après
avoir tué une victime que Bajai met le chapeau de peau de jaguar ayoi. La
structuration du récit — qui suit le cours des événements — permet aussi de
maintenir l’attention constante des spectateurs109.
109
« La pièce de résistance [en français et en italique dans l’original], sans doute, a été la
performance de Bajai. Sa pièce a duré entre vingt minutes et une demi-heure. Pendant tout ce temps
nous sommes restés accrochés à chacun de ses mouvements et de ses mots. Bajai s’était peint le
torse nu avec quatre carrés noirs et des croix blanches au milieu (deux en haut et deux en bas). Dans
sa performance dramatique, il nous a raconté des choses de son passé. Bajai est un acteur majeur : il
sait toucher son public, par ailleurs il a une voix excellente, qui a résonné jusqu’au dernier coin du
campement. […] » (GAYET 2010 : 92)
140
�L’attaque contre les Totobiegosode, par Bajai Posorajãi110
Nous avons vu la maison des Totobiegosode et leurs outils. J’ai vu les
Totobiegosode ; j’ai vu que l’un d’eux était dans la maison, avec ses outils,
mais quand il m’a vu et notre groupe, alors il a couru. J’avais peur, mais
quand même j’y suis allé. Je suis resté parce que j’ai vu que mes camarades
sont allés à l’avant ; je ne pouvais me mettre plus en avant (nous étions vingt
personnes). J’ai dit « où est l’arme qu’Eroi a apportée, avec laquelle il a tiré
mais il a manqué ? » (j’avais une massue et une hache). Nous sommes
Guidaigosode. Les Totobiegosode sont sortis par la porte de leur maison et
ils ont couru parce qu’ils avaient peur de notre groupe. Nous avons vu un
vieil homme sortir de sa maison. Le vieil homme a dit : « Je suis ici, je suis
ici ! »
L’un de notre groupe a pris un bâton et il a tué le vieil homme. Il a été frappé
dans le bras, mais il n’est pas tombé mort. Un autre de notre groupe est venu
et lui a tiré une lance et le vieil homme est tombé là. Je ne suis pas resté
pour les aider à tuer le vieil homme, parce que j’étais en train de poursuivre
les autres Totobiegosode.
J’ai vu un cacique totobiegosode. Je suis resté pour le tuer, mais je ne
pouvais pas avec une lance. Le cacique a vu que notre groupe arrivait.
C’était le cacique Ugaguedé, le grand cacique des Totobiegosode, mais il a
eu peur et il a couru. Il voulait entrer dans sa maison, je suis resté, j’ai
regardé, mais il n’y avait personne… tous ont couru.
J’ai vu une femme totobiegoto et j’ai dit : je tuerai quand même la femme
parce qu’il n’y a pas d’hommes, les maris ont déjà couru, et je l’ai suivie, et
de là, un peu plus loin, j’ai jeté une lance. J’avais peur que mon camarade
vienne la tuer le premier ; c’est pour cela que, même si j’étais un peu loin,
110
Ysanne GAYET a fait traduire l’original ayoreo en espagnol avec l’aide des Ayoreo bilingues
Inocencio Chiquenoi et Ebedu Dosapei. À notre avis, cette traduction — même si les critères ne sont
pas explicités — reproduit assez bien la manière de parler des Ayoreo (surtout l’enchaînement des
phrases par la conjonction « ga » qui peut se traduire par « et », « alors » ou bien elle peut être
considérée comme un « spoken comma »). Nous avons traduit de l’espagnol au français de la façon
la plus littérale possible.
141
�j’ai jeté la lance et elle est tombé là-bas. J’avais une hache et je l’ai coupée
avec la hache. Elle est tombée avec sa fille. J’ai tué les deux.
Où sont les hommes ? Où sont les maris ? Quand j’ai regardé en arrière, j’ai
vu une femme qui traversait. Je l’ai suivie pour la tuer ; alors j’ai jeté une
autre fois la lance et je l’ai coupée avec la hache. Quand j’étais en train de la
tuer, un camarade est venu et m’a demandé si j’avais déjà tué quelqu’un.
Moi aussi, je lui ai posé la même question. Comme j’avais déjà tué, j’ai
laissé la femme à mon camarade pour qu’il la tue.
J’ai fait un tour au campement et j’ai vu là un enfant totobiegosi. Il s’est
approché de moi et moi et mes camarades, nous ne voulions pas le tuer. Il est
pris prisonnier seulement.
Quand je suis arrivé au campement des Totobiegosode, un vieil homme est
venu, et les jeunes du groupe l’ont poursuivi pour le tuer. Je voulais aider à
le tuer. Eroi a dit : il faut aider. Je l’ai frappé avec une hache et il est tombé
là. Un jeune m’a dit : celui-ci sera pour moi. Je te le donne, j’ai dit, je suis
venu juste pour aider à le tuer.
J’ai trouvé deux enfants qui ont été faits prisonniers. Un vieil homme de
notre groupe est arrivé et s’est fâché beaucoup. Il m’a dit : vous devez me le
donner pour les tuer, mais nous lui avons dit que non. Nous ne voulons pas
qu’ils soient tués, parce que la bataille est déjà passée, c’est déjà fini. (…)
La guerre était finie et il fallait rentrer. Le cacique Eroi a rassemblé son
groupe et il a demandé : qui va rester à l’arrière-garde ? J’ai été choisi, et
trois autres aussi. Eroi m’a donné l’arme à feu parce que j’étais le seul à
comprendre l’arme. J’ai pris un ayoi111 et je l’ai mis. Si nous rencontrions
les maris des femmes, c’était sûr qu’ils voudraient nous tuer. Nous savions
qu’ils étaient beaucoup parce qu’il y avait sept maisons.
Quand nous étions sur le point de sortir deux hommes totobiegosode sont
arrivés et j’ai entendu une voix très forte. Les Totobiegosode ne pensaient
pas que notre groupe était Ayoreo, ils croyaient que nous étions blancs. Nous
avons entendu une voix qui disait « Nous sommes ici ! ». Alors notre groupe
111
Chapeau de peau de jaguar.
142
�a dit « Ils sont déjà arrivés ! » Nous croyions qu’ils étaient beaucoup. « Ce
sont eux ! ». Je suis allé à l’avant avec l’arme à feu. Je suis resté et j’ai
regardé pour savoir s’ils étaient beaucoup, mais ils n’étaient pas beaucoup,
ils semblaient être beaucoup. J’ai dit : « nous devons rester et je vais tirer ».
Je me suis agenouillé et j’ai tiré. J’ai cassé la cuisse à un Totobiegosode et il
ne pouvait plus courir. « Je l’ai atteint, il est déjà tombé ! », j’ai dit à mon
groupe. Je l’ai atteint et mes camarades ont couru pour le tuer. Un vieil
homme de notre groupe est venu et lui a coupé le ventre au Totobiegosode.
Mon groupe, fâché, lui a demandé : « pourquoi es-tu venu ici ? Nous
sommes dans une guerre. Tu viens juste pour mourir ? ». J’ai oublié que,
moi aussi, j’étais allé le premier, mais j’ai vu un Totobiegosode et j’ai eu
peur. (2010 : 93-95)
Ces récits sont interprétés dans des occasions très spéciales où il y a une
effervescence sociale inhabituelle et où le public est particulièrement attentif. Le
rôle du public est fondamental. Un jour, j’étais assis avec Jnumi un après-midi,
pendant qu’elle filait le caraguatá. À quinze mètres de nous se trouvait Toto
Étacori, qui avait allumé un feu. Toto était tout seul et racontait — avec le style
théâtral des récits guerriers — comment il avait tué un tapir que tout le monde
craignait. Toto ne nous regardait pas mais il entendait les questions que Jnumi lui
posait — avec le même style de retour que lors des performances de Sidi et de
Bajai — : « tout le monde avait peur ? », « et tu l’as frappé comme ça ? ». Jnumi
riait et Toto continuait sa performance112 . Elle accomplissait toute seule la fonction
du public. Nous voyons bien que la performance de ces récits n’implique pas
seulement l’acteur principal : il faut absolument qu’il y ait des spectateurs.
112
Toto Étacori est quelqu’un de particulier et les Ayoreo de Jesudi le remarquent aussi. Il a
quelquefois des comportements inhabituels, telle que cette performance solitaire — ou presque — le
montre. Néanmoins, il est réputé et respecté pour sa connaissance des formules de guérison.
143
�III.3. Les histoires et les mots
III.3.1. Les remerciements
Le public est très important dans la mise en scène des oijnane. L’acteur parle
avec son public mais il ne s’adresse pas à des individus en particulier. Cependant,
d’autres genres ont des destinataires plus spécifiques, mais leur performance est
beaucoup moins spectaculaire que celle des récits guerriers. Nous nous référons au
genre de récits de remerciements.
D’après ce que les Ayoreo m’ont raconté des temps d’autrefois, quand ils
recevaient des cadeaux — généralement de la nourriture — de la part de quelqu’un,
il y avait une façon verbale et structurée de le remercier. Il s’agissait d’une série de
phrases dont l’intonation et le contenu étaient structurés. À partir des exemples que
Bajai Posorajãi nous a montrés, nous pouvons dire que ces phrases ne ressemblent
pas à une chanson : ce sont plutôt quelques mots — tous accentués — dont le
dernier est prononcé jusqu’à épuiser la respiration. En ce qui concerne le contenu,
c’est un éloge des propriétés claniques de la personne qui a donné les cadeaux.
Voici un exemple pour remercier quelqu’un du clan Étacori113 :
Daju poro penojnaeeee…! (« le caraguatá blanc est très beau…! »)
Ces phrases rendaient très heureux quelqu’un de ce clan. Il y avait deux ou
trois phrases par cucherai : même si toutes les entités du monde appartiennent à
l’un des sept clans, ce sont toujours les deux ou trois mêmes propriétés de chaque
clan qui sont mises en relief (généralement, les plus utilisées dans la vie
quotidienne) 114. Même pour des choses insignifiantes comme un éternuement, il y a
113
Dans la conception du monde des Ayoreo chaque personne, plante, animal, objet ou accident
géographique appartient à l’un des sept clans ou cucherane depuis le temps des Premiers Hommes.
Nous examinerons ce sujet dans le chapitre IV.
114
Par exemple, les courges, le pécari et les chemins dans le cas du clan Dosapei ; l'eau, le lait et le savon
dans le cas du clan Posorajãi ; le feu, le jour et le caraguatá dans le cas du clan Étacori.
144
�des phrases que l’on doit prononcer selon le cucherai auquel la personne appartient.
Les clans, nous le verrons dans la deuxième partie, sont en fait présents partout.
Ce que nous avons vu sur le terrain, qui pourrait ressembler à ce contexte de
réception d’un cadeau et de remerciement, était des chants interprétés pour un ami
paraguayen de Jesudi. Celui-ci leur avait donné de la nourriture et avait aidé à la
reconstruction de deux maisons détruites par un orage. Sidi Posorajãi a alors chanté
pour le remercier. D’après les Ayoreo — car c’était tout au début et je ne maîtrisais
pas encore la langue —, Sidi disait dans son chant qu’il était content parce qu’on
lui avait donné beaucoup de cadeaux115 . Cet exemple nous montre qu’en tout cas,
même si Sidi n’a pas prononcé les formules habituelles — car le destinataire n’était
pas un Ayoreo —, il a utilisé une manière structurée pour exprimer sa gratitude.
III.3.2. Les histoires sur cassettes
Une autre variante de la parole non sacrée qui relève d’une structuration est
constituée par les messages enregistrés sur cassettes, moyen de communication
utilisé depuis quelques décennies déjà (Von Bremen 1986, Escobar 1989). L’envoi
de cassettes permet aux parents et amis des communautés éloignées de rester en
contact. Au début de mon terrain, j’étais en fait une sorte de facteur entre les
communautés de Jesudi, Chaidi et Arocojnadi. Les Ayoreo communiquent aussi par
d’autres moyens comme la radio UHF, les messages par la radio AM « Pa’i puku »
et le téléphone portable, dont la couverture réseau est arrivée fin 2008. Tous ces
moyens privilégient l’utilisation de la parole. Nous parlerons plus en détail de ces
moyens de communication dans la troisième partie de notre thèse.
À travers les messages enregistrés sur cassettes, les Ayoreo des
communautés éloignées se tiennent au courant. Les sujets principaux de ces
communications sont le travail, la santé, la faim et la situation de leurs familles —
115
Il faut souligner que le destinataire de ce remerciement était quelqu’un qui leur rendait souvent
visite et aimait enregistrer des chants ayoreo. Sidi était au courant.
145
�parfois éparpillées dans des fermes, parfois concentrées dans un seul endroit. Ces
enregistrements nous permettent de voir non seulement que les Ayoreo donnent un
certain privilège à la parole, mais aussi qu’ils ont une préférence pour les histoires.
La plupart des messages incluent des chants qui sont des histoires d’hommes et de
femmes de Jesudi et d’ailleurs. Il s’agit généralement d’iradedie — chansons de
nostalgie d’amour — et d’uñacade — chants de tristesse — qui racontent des
épisodes de la vie des gens de Jesudi. Ils aiment écouter les histoires — qui ne sont
jamais des histoires de fiction — et les répéter à leur tour. Nous pourrions dire aussi
que les Ayoreo sont particulièrement attentifs à tout événement du quotidien qui est
susceptible de faire partie d’une histoire. Parfois ces événements sont à l’origine
d’une chanson, parfois ce sont des anecdotes qui donnent naissance tout
simplement à un mot.
III.3.3. Les noms-anecdotes
Tout au long de mon terrain, j’ai dû transporter un petit cahier pour prendre
des notes, disons linguistiques. Chaque fois que je faisais une erreur dans leur
langue ou quand les Ayoreo voulaient m’expliquer une nuance d’une phrase en
particulier, ils me disaient tout simplement « aúsa… ! » (« prends note… ! ») et ils
mettaient en relief qu’il y avait beaucoup de mots en ayoreo et qu’il me restait
encore beaucoup à apprendre. Généralement, pour m’expliquer le sens d’un mot, ils
me donnaient un exemple, un contexte où ce mot avait du sens. Par exemple, si je
demandais le signifié du mot caniepe que je venais d’entendre pour la première
fois, je recevais la réponse suivante : « Tu chisiome pamai omua, ga
caniepe » (« Tu — nom d’une fille — t’a donné un peu de pain, alors elle est
généreuse »).
J’ai découvert par la suite que certains mots, dans le vocabulaire très
hétérogène que j’ai recueilli, étaient en fait des noms propres. Une fois, nous étions
en train de nous préparer pour aller dans une autre communauté et je leur ai dit de
se dépêcher116 , les Ayoreo m’ont dit que j’étais « acarani ». Naturellement, j’ai
116
Ce n’était pas le cas de l’épigraphe du premier chapitre, mais je dois avouer que la situation où
j’insistais pour qu’ils se dépêchent, alors qu’ils prenaient tout leur temps, arrivait assez souvent et
toujours avec le même résultat.
146
�noté : « acarani = pressé ». Or, le signifié n’était pas aussi simple. Quelque temps
après, dans une autre occasion où ils ont utilisé ce mot, ils m’ont expliqué qu’en
fait c’était le nom d’un homme âgé, Acarani, de la communauté d’Ebetogué, située
à 35 km de Jesudi. Cet homme s’était arrangé avec une autre famille pour se marier
avec une fille très jeune. La famille de la fille lui avait dit que le mois suivant cette
jeune femme irait habiter chez lui, ce qui en fait signalerait le début du mariage (les
Ayoreo n’ont pas de cérémonie). Acarani a refusé et a insisté pour que sa future
épouse aille habiter chez lui tout de suite. À partir de cet événement — disent les
Ayoreo —, on a appelé « acarani » celui qui insiste pour que les autres se
dépêchent, ou bien celui qui est pressé.
Ayant appris cela, j’ai été obligé de réviser mes notes et d’utiliser les mots
qui — à mon avis — pouvaient cacher une anecdote. En effet, j’avais
involontairement recueilli de nombreuses entrées qui renfermaient des histoires.
Ainsi, « toto » désigne quelqu’un qui coupe la parole à quelqu’un d’autre, ou bien,
quelqu’un qui passe le récipient du tereré en le tenant dans toute sa longueur — ce
qui fait que les mains des deux personnes se touchent lors de l’échange, au lieu de
le tenir par la base et de laisser le destinataire le prendre par la partie supérieure.
« Poi » signifie que quelqu’un a des restes de riz ou de nourriture autour de la
bouche. Dans ces deux cas, il s’agissait de références à deux personnes de Jesudi,
Toto Étacori et Poi Étacõro, ce qui implique que ces références étaient
compréhensibles pour quelqu’un de la communauté, car il faut bien sûr connaître
l’histoire particulière de l’anecdote pour pouvoir comprendre le signifié. Or, le cas
d’Acarani de la communauté d’Ebetogue nous montre que ces anecdotes enfermées
dans des mots peuvent aussi voyager en dehors de leur lieu d’origine.
J’ai participé involontairement à la création d’un de ces mots. J’étais resté à
la communauté de Chaidi pendant un mois, avant de retourner définitivement à
Jesudi. Un Ayoreo bilingue de la communauté de Chaidi maîtrisait très bien
l’espagnol. Je lui parlais dans mon ayoreo de débutant, mais lui, Beruide, me
répondait toujours en espagnol. J’ai raconté cette histoire — parmi d’autres choses
qui m’avaient gêné à Chaidi — à Jnumi Posijñoro et aux autres membres de l’ogadi
147
�des Dosapei. Cette anecdote est devenue un mot. Si, suite à une question qui m’était
posée en ayoreo, je répondais en espagnol, les Ayoreo m’appelaient tout de suite
« Beruide ua ia ! » (litt. « tu es Beruide ! »). Cette appellation était également
dirigée à des Ayoreo qui répondaient en espagnol. Une fois, quelques femmes de la
communauté de « 10 de Febrero », située dix kilomètres au nord de Jesudi, sont
venues rendre visite à la communauté de Jesudi. Le mot « tagüide » fut utilisé pour
réprimander quelqu’un, ensuite Jnumi a expliqué aux femmes ce que ce mot voulait
dire et pourquoi. Nous pensons que la transmission de « acarani » a dû se passer de
la même façon. Après qu’une anecdote est racontée, ou qu’un événement est mis en
relief, il suffit qu’une personne l’utilise une fois —elle le nomme — et que les
autres l’acceptent — généralement avec humour — pour que ce terme commence
un développement qui va de la référence explicite de l’histoire à son utilisation en
tant que mot. En fait, même si au début l’expression « Beruide ua ! » pouvait être
traduite par « tu es [comme] Beruide », au fil du temps le nom devient une synthèse
de l’anecdote originelle : cette phrase signifie en fait « tu me parles en espagnol
alors que je te parle en ayoreo ».
Ces noms-anecdotes sont pour la plupart utilisés au vocatif : « toi, tu es
comme ça… ! » et pour mettre en relief un comportement de l’autre considéré
comme hors du commun — voire étrange. De plus, les premières fois, quand la
référence à l’anecdote originale était explicite, j’ai pu voir que l’humour était un
élément très important : ils riaient quand ils utilisaient ces noms-anecdotes. Au fil
du temps, ces mots sont plus utilisés comme un terme courant et moins comme une
façon amusante de dire quelque chose. Il est difficile de dire quels comportements
sont ainsi critiqués. Je les ai entendus utiliser à la première personne mais aussi
avec ce caractère en quelque sorte accusatoire : « acarani uyu... ! » (« je me suis
[trop] pressé…! »). Ce n’est pas qu’on invente ces mots à partir de certaines règles
explicites du comportement. C’est, au contraire, à partir d’un événement particulier
qui présente un caractère saillant que ce mot sera créé. Un nom propre devient un
nom commun. Une anecdote devient une référence.
148
�Conclusion du chapitre III
Nous avons vu que dans la vie de tous les jours les divers genres de parole
non sacrée ont une présence indéniable. Tous les soirs, des voix qui chantent se font
entendre dans la petite communauté de Jesudi. Le son voyage bien dans l’espace
ouvert entre les maisons. Ces chants voyagent aussi entre communautés distantes
par le biais des cassettes. Ils présentent une complexité équivalente à celle des
formules sacrées : il y en a qui racontent des histoires d’amour et de nostalgie, des
compositions qui décrivent les aléas de la guerre, des expressions de sentiments tels
que la joie ou la tristesse, et même des chants non sacrés qui peuvent guérir. En
dehors des chants — qui constituent le sous-domaine le plus complexe —, nous
avons présenté les performances théâtrales guerrières en mettant l’accent sur le
public : il s’agit d’un vrai spectacle, de la mise en scène d’une histoire. Ce sont
justement des histoires racontées dans les chants et qui peuvent même être
contenues dans un mot.
Nous avons constaté alors que le domaine de la parole « profane » présente
une complexité aussi grande que la parole puissante. La parole — sacrée ou
profane — est une caractéristique marquée : elle est le moyen privilégié pour
produire des événements — la parole puyac —, ou bien pour partager ces
événements — chants humains et récits guerriers117.
117
Nous avons pris des photos de la collection de Heinz KELM (effectuée dans les années 1960) à
l’Institut für Altamerikanistik à l’Université de Bonn. Nous avons photographié des morceaux de
bois avec des signes peints en rouge et en noir. Nous avons montré ces photos aux Ayoreo de Jesudi
en 2011. Ils n’avaient aucune idée de ces signes et n’ont pas montré d’intérêt spécial. Ils se sont
montrés, par contre, très enthousiasmés en entendant les chants du grand chef Uejai Picanerai. Nous
leur avons apporté un enregistrement que LIND avait fait en 1969 et qu’il avait très généreusement
partagé avec nous.
149
�Conclusion de la première partie
Dans le premier chapitre, nous avons montré la variété des circonstances où
les Ayoreo estiment possible d’exercer une influence par le biais de certaines
phrases précises. Au moment d’effectuer une guérison, la phrase prononcée était
bien plus importante que l’entité qui avait créé et laissé cette formule au temps des
origines. Les récits mythiques, eux aussi, produisent des effets, même si de manière
plus indirecte. Le pouvoir des Premiers Hommes circule à travers la parole et
entraîne des changements. Le monde créé est un monde qui a été une fois prononcé.
Tout cela nous amène à la conclusion qu’il n’y a pas de mots des anciens qui ne
produisent d’effets sur le monde.
La parole occupe, sans aucun doute, une place privilégiée dans la culture des
Ayoreo. Ainsi, il n’est pas nécessaire, pour aller à la chasse, d’obtenir la permission
d’un maître des animaux, il suffit de raconter un mythe — prononcer des mots —
pour que des tortues ou des pécaris viennent à la rencontre du chasseur. Il n’y a pas
un esprit-maître qui vienne sauver le malade ou le blessé, mais une phrase que l’un
des Premiers Hommes a laissée au temps des origines et qui force les faits actuels à
ressembler aux mots du passé. Ces phrases sont si liées aux événements qu’elles
peuvent les changer et les produire. Les formules de guérison présentent, en
premier lieu, une onomatopée de la maladie et ensuite une onomatopée de la
guérison. C’est un index (au sens de Peirce) qui opère dans le sens inverse. Or, le
rapport sémiotique entre un événement et des mots qui auraient pu l’avoir produit
est toujours établi par un individu qui se trouve à un point spécifique du réseau
social.
En ce qui concerne la parole non dangereuse, nous avons adopté un autre
point de vue. Au lieu d’analyser le rapport entre mot prononcé et conséquences
déclenchées, nous nous concentrons sur la diversité de catégories de récits qui
permettent de construire une histoire à partir d’un événement. La parole est le
moyen choisi pour garder des enregistrements de ce qui arrive de particulier dans la
vie quotidienne. La composition constante des chants — qui consistent, dans le cas
150
�d’iradedie, en la répétition textuelle de phrases entendues — nous montre bien le
rapport avec la mémoire. Cet exercice de composition est un processus actif qui
n’est pas détaché du moment historique des Ayoreo : alors que les chants de
nostalgie d’amour (irade) et de tristesse (uñacai) sont très nombreux actuellement,
le nombre de chants de guerre (pinangoningai et ingojnagai) et de visions
chamaniques (enominoi) est très limité — et il s’agit toujours de chants très
anciens. Cet immense répertoire changeant constitue une source orale
d’informations, une mémoire mouvante de la vie des Ayoreo.
Dans l’univers ayoreo, la parole — puyac ou profane — organise
l’expérience et le temps. Raconter un mythe ou souffler une formule sarode fait
agir le temps des origines, le rend actif dans le présent (cela implique l’intégration
du passé et du présent). De même, tout événement de la vie d’un individu peut
entrer dans un circuit d’informations s’il est mis en texte. Il faut voir maintenant si
ces paroles humaines sur les événements des humains peuvent produire des effets.
Nous nous demanderons si ces chants jouent un rôle autre que celui d'illustrer, s’il
est même possible que ces mots des temps actuels soient en fait une partie
fondamentale de la structure sociale de Jesudi.
151
�DEUXIÈME PARTIE
LES MOTS ET LES GENS
152
�Introduction
Dans la première partie, nous avons montré que la parole occupe une place
très importante dans la culture des Ayoreo. Nous nous sommes concentré d’abord
sur la parole puyac et ses effets dans la vie des gens de Jesudi pour ensuite
présenter la parole non puyac¸ la parole humaine. Cette parole s’est montrée aussi
diverse et riche que sa contrepartie dangereuse et nous avons fini par nous
demander s’il était possible que ces mots qui ne convoquent la puissance d’aucun
ancêtre pouvaient avoir des effets dans la vie des Ayoreo de Jesudi. C’est justement
le sujet que nous développerons tout au long de cette deuxième partie.
Quel est le rapport entre la vie sociale et cette parole humaine ? Cette
question implique d’abord de décrire minutieusement la vie quotidienne à Jesudi. Il
est nécessaire d’avoir une base ethnographique précise, une description des aléas
des rapports sociaux. Nous ne pouvons pas nous limiter à une étude des
généalogies, de la terminologie de parenté, de la classification des appartenances
claniques et du respect de la règle d’exogamie. Il faut se plonger dans le contenu
des rapports sociaux, là où l’idée de règle est aussi insaisissable que celle
d’exception. Il faudra prendre en compte les histoires d’amour, les commérages, les
infidélités, la manipulation de l’opinion publique, la création de consensus et les
tensions sociales qui éclatent et provoquent des fissions, mais également celles qui
n’éclatent pas. Il faut étudier attentivement tous les actes sociaux, aussi
insignifiants semblent-ils être, depuis les commentaires innocents que l’on fait
quand quelqu’un n’est pas là, jusqu’aux affrontements publics chargés
d’agressivité, depuis les blagues au moment de manger jusqu’au grave refus de la
nourriture offerte. C’est dans tout ce monde social de l’indéfini, à la fois changeant
et monotone, que la parole s’inscrit, catégorise et modifie les actes des personnes
de cette petite communauté. C’est une ethnographie du quotidien qui nous
permettra de saisir les charnières de la vie sociale où la parole joue un rôle.
Nous étudierons d’abord les clans, qui constituent une dimension
relationnelle de la vie des Ayoreo. Dans la littérature classique sur le groupe, les
153
�recherches se sont concentrées plutôt sur l’aspect classificatoire des entités du
monde (Bernand-Muñoz 1978, Fischermann 1988) ou sur la question de l’exogamie
(Bugos 1985). Nous analyserons ce que les clans font dans la vie quotidienne. Nous
essaierons de dégager les particularités des rapports entre humains du même clan,
entre humains de clans différents et le rapport général des individus avec des
appartenances claniques. Nous nous concentrerons dans le chapitre IV sur les
rapports médiatisés par les clans à l’intérieur d’une unité résidentielle.
Le chapitre V portera sur la description des rapports sociaux entre des
individus et entres des unités résidentielles à l’intérieur de la communauté. Nous
étudierons les divers niveaux de conflit, depuis la formation de nouvelles
communautés jusqu’au départ occasionnel et temporaire d’un homme ou d'une
femme à la suite d’une dispute avec son conjoint. Ce qui nous demandera plus
d’attention sera l’analyse non des disputes mais de la tension qui les précèdent. En
effet nous verrons qu’à Jesudi plusieurs précautions sont prises pour éviter la
migration d’une personne ou d’une unité résidentielle. Ces précautions concernent
un rôle social — une personne en particulier — qui retiendra notre attention.
Finalement, nous verrons que tous ces dispositifs qui permettent ou évitent que des
individus quittent Jesudi s’organisent autour de quelques concepts en particulier qui
relèvent en même temps du social, de l’individuel, de l’affectif et du physiologique.
Le chapitre VI mettra en rapport toutes les particularités de la vie sociale
décrites dans les chapitres précédents avec les chants d’amour irade et les chants de
tristesse uñacai. Nous verrons que les irade ont un rapport étroit avec la notion de
nostalgie problématisée dans le deuxième chapitre et que dans les uñacai plusieurs
aspects de la dimension clanique abordée dans le premier chapitre se rendent
manifestes. Finalement, nous repérerons des similarités entre ces deux genres de
chants qui se clarifient avec le passage du temps, quand ces compositions sont
moins liées aux circonstances qui ont été à leur origine. Nous verrons que ces
similarités acquièrent du sens si elles sont pensées comment étant à la base d’une
éthique sociale.
154
�CHAPITRE IV
LES CLANS DES AYOREO AU QUOTIDIEN
Les sept cucherane
Chiquenoi Étacori Dosapei Posorajãi Picanerai Cutamurajãi Jnurumini
Introduction : les clans perdus
Dans la conception du monde des Ayoreo, chaque personne, plante, animal,
objet ou accident géographique appartient à l’un des sept clans ou cucherane118
depuis le temps des Premiers Hommes119 . Il faut éclairer le rôle de ces clans dans la
vie quotidienne.
Nous avions naïvement supposé qu’il était possible d’aborder les clans
comme s’ils étaient des structures de pensée à partir desquelles les Ayoreo
élaboraient explicitement des théories. Au début, notre intention était d’établir de
118
Les noms de clans ont des inflexions de nombre et genre:
Chiquenoi (masc. sing.), Chiquejñoro (fem. sing.), Chiquenone (masc. pl.) et Chiquejnonie (fem. pl.)
Étacori (masc. sing.), Étacõro (fem. sing.), Étacorone (masc. pl.) et Étacoronie (fem. pl.)
Dosapei (masc. sing.), Dosapé (fem. sing.), Dosapéode (masc. pl.) et Dosapedie (fem. pl.)
Posorajãi (masc. sing.), Posijñoro (fem. sing), Posorajane (masc. pl.) et Posijnonie (fem. pl.)
Picanerai (masc. sing.), Picanere (fem. sing.), Picanerane (masc. pl.) et Picaneranie (fem. pl.)
Cutamurajãi (masc. sing.), Cutamijñoro (fem. sing.), Cutamurajane (m. pl.) et Cutamijnonie (f. pl.)
Jnurumini (masc. sing.), Jnuruminé (fem. sing.), Jnuruminone (masc. pl.) et Jnuruminenie (fem. pl.)
Le dictionnaire de HIGHAM et al. (2000) ne présente pas les pluriels du féminin, nous les avons ajoutés
à partir de nos notes de terrain. Comme les Ayoreo utilisent le nom de clan comme surnom — par
exemple Bajai Posorajãi, Jnumi Posijñoro —, nous ne l'écrivons pas en italique. Pour nous référer aux
individus d'un cucherai, nous utiliserons la forme du masc. sing. — par exemple, « les Dosapei ».
119
BÓRMIDA et CALIFANO (1978) et BARTOLOMÉ (2000) parmi d’autres ont souligné que le terme
« cucherane » ne correspond pas à la description classique de « clan » (au sens de MURDOCK 1960).
Bartolomé, face au choix entre « sibs », « clans » ou une autre catégorie, considère qu’il vaut mieux
« essayer de rendre compte de ses caractéristiques spécifiques au lieu de tenter de les définir en
partant de références conceptuelles antérieures qui peuvent être ambigües » (2000 : 256). Nous
sommes tout à fait en accord avec cette idée et ce chapitre poursuit le même but : apporter quelques
détails supplémentaires à la description des « cucherane » et de leur imbrication dans les activités
quotidiennes. Même si la traduction par « clan » est inexacte, nous l’utiliserons tout au cours de cette
discussion par des raisons de simplicité dans l’exposé mais aussi parce que les Ayoreo eux-mêmes
l’emploient quand ils parlent en espagnol.
155
�longues listes d’appartenances claniques, d’obligations entre membres du même
clan et de mythes qui instauraient ces coutumes. À part deux ou trois hommes âgés,
la plupart des Ayoreo avec lesquels nous parlions ne pouvaient pas se souvenir de
plus de trois ou quatre appartenances claniques et ne signalaient aucune obligation
— sauf celle de l’exogamie. Ils ne pouvaient pas non plus raconter de mythes
concernant l’instauration des clans. Face à cette situation frustrante, nous avions
décidé d’abandonner la recherche sur le sujet. Nous ne voulions pas faire, en effet,
une archéologie de réminiscences (« ce qui reste… ») ni reconstruire un passé
hypothétique à partir d’entretiens avec deux ou trois personnes (« cela a dû être
comme ça auparavant… »). Nous voulions connaître la vie et la pensée actuelles
des Ayoreo. L’idée de la reconstruction d’un passé à partir de déclarations
laconiques nous semblait analogue à l’autopsie d’un cadavre. Or, nous voulions
rendre compte de leur pensée en mouvement.
En nous intégrant progressivement à leur vie quotidienne et en apprenant
leur langue, au fil des jours, de nombreuses références — pas toujours explicites —
aux clans ont commencé à affleurer. La présence des clans s’est rendue manifeste
au fur et à mesure dans de multiples domaines de la vie ayoreo, depuis l’intensité
structurée d’un chant de deuil jusqu’à la banalité spontanée d’un éternuement. C’est
au quotidien que nous avons retrouvé la présence des clans et ce sera l’objet de
notre analyse.
Nous ne sommes pas les premiers à nous consacrer à l’étude des clans des
Ayoreo. Ces derniers sont habituellement décrits comme exogames et patrilinéaires
(Bernand-Muñoz, 1977 ; Bórmida y Califano, 1978 ; Fischermann, 1988). Même si
leurs clans ont été analysés comme des systèmes de catégories par Bórmida (1973,
1974, 1975, 1976, 1978-9a, 1978-9b), Dasso (2006) et Bartolomé (2000), il faut
souligner que c’est Fischermann (1988) qui les a explorés le plus en détail, de ce
point de vue.
En ce qui concerne l’étude de la dimension sociale des clans, nous sommes
obligé de mettre en relief l’énorme travail de Paul Bugos (1985) en Bolivie. Avec
156
�une perspective évolutionniste, ce chercheur analyse la conformation de réseaux de
parenté en tant que stratégie d’adaptation à l’environnement. Étant donné que nous
étudierons les aspects sociaux des clans, plusieurs considérations avancées dans sa
thèse sont pertinentes pour notre recherche, même si nous restons éloignés de son
point de vue théorique.
Ce chapitre se consacre donc à relever à partir de fragments d’expériences
quotidiennes le tréfonds clanique des pratiques des Ayoreo de Jesudi. Nous ne
cherchons pas ce tréfonds à un niveau abstrait, en tant qu’expression de rapports
logiques qui seraient pour la plupart inconscients. Nous nous intéressons à toutes
les manifestations affectives et sociales qui s’expriment dans leur discours et dans
leurs pratiques. Nous nous concentrerons sur leur vie quotidienne pour signaler
dans quels contextes les clans se rendent visibles, même si — et c’est souvent le
cas — cela n’implique pas une réflexion énoncée de leur part. Nous voulons
comprendre comment les clans imprègnent leur vie quotidienne.
Ainsi après avoir présenté un concept de Janet Carsten (1995) qui nous est
utile pour penser les rapports sociaux des Ayoreo, nous évoquerons les idées de
Bugos, Bórmida et Califano sur le système de parenté de ce groupe. Cela afin
d’entrer dans la problématique des clans à partir de nos observations sur le terrain :
nous analyserons les rapports entre les parents claniques de communautés
éloignées, entre les parents claniques à l’intérieur de Jesudi, et finalement entre les
non parents, et le rôle joué par les propriétés claniques.
IV.1. Janet Carsten : une vision locale des rapports humains
Nous étudierons ici l’organisation des rapports humains au quotidien.
Autrement dit, nous parlerons de la parenté. Cependant, nous n’aborderons pas la
parenté en tant que systèmes d’alliances entre groupes — analyse que Bugos a déjà
faite. En fait, nous n’analyserons pas les rapports entre diverses unités éloignées
géographiquement, mais plutôt tout ce qui concerne la cohésion interne d’une
157
�communauté et les unités qui l’intègrent. Dans ce but, nous porterons notre
attention sur quelques rapports de parenté dont nous essaierons de dégager la
conception et les comportements associés.
Le concept de relatedness développé par Carsten (1995, 2000) est tout à fait
pertinent pour notre étude. Carsten publie en 1995 — plus de dix ans après le
bouleversant travail de Schneider (1984) — un article sur les rapports
interpersonnels et la notion de personne dans l’île de Langkawi, en Malaisie.
Carsten affirme que les concepts classiques des études de la parenté — avec les
notions sous-jacentes de permanence de rapports et d’états — ne sont pas utiles
pour décrire les rapports fluides chez les Malay de Langkawi. Elle propose alors
une alternative : le concept de relatedness, qui devrait rendre compte des
conceptions natives des rapports humains : « J’utilise le terme ‘relatedness’ pour
indiquer les manières indiennes de représenter et de conceptualiser les rapports
entre les gens, en tant que distinctes des notions dérivées de la théorie
anthropologique120 » (1995 : 224).
La proposition de Carsten est sans doute novatrice mais, comme le remarque
Ladislav Holy (1996 : 168), il est difficile de voir où se trouve la différence entre la
relatedness et les autres types de rapports sociaux : comment préciser avec ce
concept la limite entre tout ce qui appartient au domaine de la parenté et tout ce qui
n’en fait pas partie ? Cela pose des problèmes aussi pour les visées comparatives :
cette catégorie est tellement vague — au moins dans cette formulation — qu’elle
pourrait inclure des phénomènes et des rapports trop hétérogènes (Holy 1996 :
170). Holy propose alors de suivre Raymond Quelly (1993) et de parler de
« parenté » — au sens de relatedness —, quand elle est instaurée à partir du partage
et de la transmission de substances physiques et spirituelles121. Quelly (1993) met
l’accent sur les processus de développement, tout ce qui fait d’un individu un
120
« I use the term “relatedness” to indicate indigenous ways of acting out and conceptualizing
relations between people, as distinct from notions derived from anthropological theory » (1995 :
224).
121
« I would similarly suggest that to be meaningful as a concept, kinship has to be understood as a
culturally specific notion of relatedness deriving from shared bodily and/or spiritual substance and
its transmission » (HOLY 1995 : 171)
158
�membre de sa société. Même si nous ne nous attarderons pas sur cet aspect
constructif du rapport de parenté, le fait de prendre en compte le partage des
substances physiques ou spirituelles et la vision des Indiens nous permet de
considérer quelques rapports sociaux sous la dénomination de relatedness, en
particulier ceux de parenté clanique et ceux de résidence commune. Cependant,
nous pourrons voir que ces deux rapports sont pensés différemment du point de vue
de leur constitution.
Dans le cas des Ayoreo, deux rapports principaux organisent la société : les
rapports entre parents claniques — ou igiosode — et les rapports entre membres
d’une même unité résidentielle — les ogasuode. C’est ici que nous prenons nos
distances par rapport à l’étude de la construction de rapports : en raison de leurs
conformations diverses, nous devons considérer certains rapports comme fixes et
d’autres, en formation permanente. Nous verrons que le rapport de parenté clanique
— le fait de se penser igiosode — préexiste aux échanges entre parents claniques et
persiste même quand ces obligations de réciprocité ne sont pas accomplies. Nous ne
dégagerons donc pas les détails de la construction d’un tel rapport de parenté. Nous
partons plutôt de la constatation selon laquelle deux personnes s’appellent yigiosi
(« mon parent clanique ») et nous analyserons ce qu’elles font, les attitudes qu’elles
ont ou qu’elles attendent les unes des autres. Dans ce cas, il est nécessaire de
penser que le rapport précède les interactions dont il est le moyen. Un igiosi qui
n’accomplit pas ses obligations est un mauvais parent, mais il n’est jamais un « non
parent ».
Le cas des rapports entre ogasuode, membres d’une unité résidentielle, est
assez différent. Cette unité résidentielle — l’ogadi — est composée idéalement par
un couple âgé, leurs fils et leurs filles célibataires, leurs filles mariées et leurs
époux et enfants respectifs. Le lien entre les membres d’un ogadi est établi par la
résidence commune et la production conjointe d’aliments et de biens. Si quelqu’un
quitte l’endroit et ne participe plus à la production, il ne sera plus considéré comme
un ogasui. Une structure généalogique est certainement à la base de ce groupe
— généralement celle d’une famille étendue. Mais cette structure n’est pas
159
�exclusive : certains individus n’ont pas de liens généalogiques (ni même claniques)
mais appartiennent à ces unités parce qu’ils suivent les règles de réciprocité et de
résidence.
Nous émettons quelques réserves sur les idées proposées par Carsten, surtout
sur l’aspect vague (signalé par Holy) de la catégorie de relatedness. Néanmoins,
l’aspect constructif de ce concept et sa mise en relief du côté performatif des
rapports humains nous semble très puissant du point de vue descriptif et explicatif.
Nous voulons également accorder l’importance exacte aux pratiques et concepts des
Ayoreo, souligner leur vision interne de la parenté et être attentif aux considérations
des membres de Jesudi sur les rapports humains. Carsten, à la manière de Viveiros
de Castro (2002 : 117), essaie de voir quels problèmes se posent les Malay, plutôt
que de chercher les solutions des Malay pour les problèmes que nous posons.
Carsten préfère étudier comment les gens de Langkawi « définissent et construisent
leur définition de relatedness 122 » (1995 : 224). C’est dans cette direction que notre
recherche nous emmène. Nous allons examiner comment les Ayoreo définissent et
construisent ces rapports — igiosode et ogasuode — par le biais des pratiques et du
discours quotidiens.
IV.2. La parenté des Ayoreo dans la littérature anthropologique
Il est nécessaire de présenter brièvement la littérature sur ce groupe en ce
qui concerne la parenté au sens classique. Nous devons rappeler ce qui a été dit sur
les rapports sociaux des Ayoreo et l’incidence des clans. Bugos (1985) et Bórmida
et Califano (1978) analysent les liens entre des individus ou entre des groupes mais
n’approfondissent pas le contenu de ces rapports (même s’ils mentionnent des
éléments comme les liens affectifs, ils présentent toujours la parenté dans un sens
pré-schneidérien). Sans doute peut-on dire que Fischermann (1976, 1988, 1998,
2005) est le spécialiste des Ayoreo, mais malgré ce juste titre, il consacre à peine
122
« […] define and construct their definition of relatedness » (1995 : 224).
160
�trois pages à la parenté en dehors des clans dans sa thèse (1988). Ce sont donc les
œuvres de Bugos et de Bormida et Califano qui nous seront utiles pour relever les
traits principaux de la parenté ayoreo.
Bugos, dans une perspective écologiste et évolutionniste, analyse la parenté
ayoreo en tant que stratégie d’adaptation à un environnement imprévisible. Cet
auteur décrit les deux types de rapports mentionnés auparavant : le rapport entre
parents claniques — igiosode — et le rapport entre membres d’une même unité
résidentielle — les ogasuode. Dans le cas des igiosode, Bugos remarque les deux
obligations fondamentales : l’hospitalité et la solidarité. Les Ayoreo évitaient, si
possible, d’attaquer des membres du même clan : des 52 morts violentes que Bugos
(1985 : 147) a enregistrées, seules 6 avaient eu lieu entre igiosode. Il mentionne le
lien affectif entre igiosode mais ne s’attarde pas sur cet aspect. Bugos indique aussi
que l’exogamie est le trait le plus important des clans, puisqu’elle a des effets
visibles dans la structure sociale123 . En ce qui concerne les ogasuode, le rapport qui
les définit est le fait d’habiter ensemble. Idéalement, une unité résidentielle est
composée d’un couple âgé avec leurs filles mariées et leur époux, et leurs fils et
filles célibataires. Le mot ogasui désigne, d’un côté, un groupe social concret et, de
l’autre, une catégorie sociale plus large. Il signifie en effet « ceux qui vivent
ensemble » et constitue l’unité de production et de consommation de nourriture
(1985 : 149). Bórmida et Califano (1978) expliquent l’étymologie du terme ogasui :
il vient d’ogadi — le lieu où l’on dort 124. En tant que catégorie sociale, il peut être
utilisé dans un sens plus large pour désigner des individus qui n’habitent pas
forcément au même endroit 125. Cette catégorie imprécise permet d’inclure des
123
« The most important function of the kucierane is that of defining an unambiguous exogamous
category » (1985 : 148).
124
Nous utilisons ogadi pour désigner l’unité résidentielle dans son ensemble. Autrement dit, le lieu
et les gens qui y habitent. Nous pourrions dire que les Ayoreo utilisent ce terme pour dire « lieu »,
mais il faut souligner qu’il est généralement associé à une personne (par exemple Chicori jogadi,
« le lieu – les maisons et l’espace qui l’entoure – de Chicori »)
125
« The Ayoreo also sometimes use ogasui to denote a broader social category that includes people
who have a right to live in a certain household whether they live there or not » (1985 : 150).
BÓRMIDA et CALIFANO (1978) signalent aussi que — au-delà du critère spatial — quelqu’un qui vit
loin mais qui maintient des liens affectifs et accomplit ses obligations socio-économiques
d’échanges est considéré comme un membre de l’ogadi.
161
�individus qui habitent dans le même ogadi et partagent la nourriture, mais n’ayant
pas de liens généalogiques. Cela revient à dire que, même si les rapports
généalogiques sont à la base de la constitution de l’ogadi, ils ne suffisent pas à le
définir. En effet, il existe une série d’interactions fondamentales pour la
constitution de cette unité et sur lesquelles nous reviendrons.
La résidence est uxorilocale et la filiation clanique est patrilinéaire, ce qui
fait que les hommes doivent habiter avec les parents de l’épouse, alors que ce sont
les parents agnatiques (de clan) qui les épaulent dans diverses situations. Même si
les données statistiques de Bugos confirment la pratique de ce type de résidence, il
arrive souvent que les hommes se débrouillent pour rester dans la même
communauté que leurs parents. L’endogamie de communauté est alors une stratégie
valide qui leur évite de partir. Bugos remarque, par ailleurs, que les Ayoreo trouvent
extrêmement dur d’accepter qu’une fille puisse partir, jusqu’au point de souffrir de
son absence comme d’un décès 126.
Le travail de Bugos nous permet d’avoir une perspective d’ensemble de la
population ayoreo. Il montre les effets que divers règles et types d’alliance ont sur
la structure de la population. En ce sens, Bugos nous présente un résultat général,
une structure à l’échelle de la population ayoreo dans son ensemble, qui est le
produit de beaucoup de décisions particulières. Nous voulons, au contraire, situer
notre analyse à un niveau local. Notre but est de relever les idées et les discours qui
entourent la pratique de l’exogamie clanique. Nous voulons connaître les raisons
pour lesquelles les Ayoreo de Jesudi ne se marieraient pas avec un parent clanique,
surtout quand, dans la plupart des cas, ils ne peuvent déterminer aucune connexion
généalogique.
126
« Parents whose married daughters live in other villages talk about their daughters as if they
were mourning them. » (1985: 153)
162
�IV.3. Les clans dans la vie quotidienne des Ayoreo
IV.3.1. Une affaire délicate
Le trait qui produit indéniablement des effets sur la structure sociale ayoreo
est l’exogamie clanique, comme l’ont remarqué plusieurs auteurs (Bugos 1985,
Bórmida et Califano 1978, Fischermann 1988, Bartolomé 2000). Grâce à ses
recensements exhaustifs, Bugos (1985 : 148) nous montre que cette règle était
effectivement suivie : des 750 unions conjugales seules 13 violaient le tabou. À
Jesudi, dont la population avoisine les 90 personnes dont 32 couples, il existe
quatre couples incestueux. C'est-à-dire, un pourcentage énormément élevé si on le
compare avec les données de Bugos. Cela signifie-t-il que cette règle n’a pas
d’importance à Jesudi ? On pourrait penser que le contact avec la société nationale
a affaibli certaines traditions. Après tout, nous avons fait notre terrain plus de 20
ans après Bugos, dans une communauté qui se trouve à 50 mètres d’une route
nationale. Or, pour répondre à cette question, nous nous éloignerons du domaine
des statistiques de population pour nous rapprocher du discours ayoreo. Nous
verrons que, contrairement à ce que ces données semblent indiquer, l’exogamie
clanique est encore un trait très marqué des cucherane.
Il n’est pas facile de parler de ce sujet — des règles et de leur violation —,
sans se mettre involontairement dans le rôle d’accusateur. Les réponses à mes
questions sur la rupture de l’exogamie n’ont pas été les mêmes selon les différents
moments de mon terrain. Dans mon imprudence initiale, à la fin du premier mois à
Jesudi, j’ai demandé à Jnumi, une femme d’une quarantaine d’années, s’il était
possible pour deux personnes du même clan de se marier. Elle a répondu
affirmativement et elle m’a donné l’exemple de Segundo et Rafaela Dosapei. J’ai
obtenu la même réponse de la part de Bajai, un homme âgé d’environ 70 ans. À
cette occasion l’exemple donné a été celui du frère aîné de Bajai, Sidi Posorajãi,
marié avec Poro Posijñoro. Tous les deux, Jnumi et Bajai, ont affirmé que pendant
la vie dans le monte, où ils avaient passé leur enfance, il en était de même. La
prohibition, à vrai dire, semblait ne pas exister.
163
�Avec le temps, je m’étais progressivement intégré à l’ogadi des Dosapei. À
l’intérieur d’un ogadi, il y a un cercle de confiance, de complicité, une intimité
collective qui permet aux individus de parler de leurs préoccupations personnelles
et surtout de celles des autres personnes. J’étais là, un soir, dans ce contexte intime
mais collectif autour du feu, en train de relever le vocabulaire de la parenté. J’en ai
profité pour poser à nouveau la question du mariage entre membres du même clan.
La première réponse a été « poitac » (« moche ») et après « puyac » (« interdit »).
J’ai mentionné alors l’exemple de Sidi et Poro, ce qui a provoqué des éclats de rire
à peine contenus : ce n’était pas la première fois qu’ils se moquaient d’eux. Ils ont
indiqué en plaisantant que Poro « tagu dedo » (phrase habituelle qui décrit ceux qui
ne respectent pas la règle)127 et ils se sont moqués aussi du couple conformé par
Segundo et Rafaela Dosapei. Je me suis souvenu d’un autre cas dans une autre
communauté très éloignée, mais avant que je n’aie fini de prononcer le nom de
l’homme, les cris « puyac !! » accompagnés d’éclats de rire m’ont interrompu. En
effet, ils connaissaient très bien chaque cas particulier et ils avaient des blagues
préparées qui, même répétées plusieurs fois, faisaient toujours rire. Il fallait bien
sûr que je fasse partie de ce cercle de confiance pour qu’ils se permettent de parler
des autres si librement. Dans l’ambiance générale, la gaieté et la désapprobation se
mélangeaient sous forme de blagues. Dans cette situation, cela ne semblait pas
quelque chose de grave, mais malgré les apparences, ce n’était pas quelque chose
de frivole non plus. D’après Jnumi, le lendemain, Poro a été mise au courant de
mes questions (les cercles de confiance ont toujours des fuites) et elle s’est fâchée
contre moi. Même si je n’ai pas perçu un tel sentiment — mais il faut avouer que je
suis resté à l’écart de son ogadi pendant quelques jours —, il est important de
remarquer que cette réaction était considérée comme tout à fait normale par Jnumi.
La question de l’exogamie était parfaitement présente à Jesudi.
127
Cette phrase est mentionnée dans la bibliographie sur ce groupe. Les Ayoreo ne savaient pas
expliquer le sens de ces mots. Pojnangue Dosapei a avancé une hypothèse : elle pensait que « tagu
dedo » (litt. : « mange son œil ») voulait dire que Poro avait mangé son œil et ne voyait pas que Sidi
était son parent. Jnumi, mère de Queneja, disait que ce n’était pas ainsi, que les ancêtres disaient
cela mais qu’elle n’en connaissait pas le sens. Pour notre part, nous pouvons seulement signaler que
« d-edo » peut signifier « son œil » mais aussi « son visage » et que « –agu » a une grande quantité
de traductions possibles (manger, brûler, faire du mal, énerver, etc.)
164
�Au début de notre séjour à Jesudi, deux personnes de deux ogadode
différents, qui avaient été élevées dans la forêt, nous avaient donné strictement la
même réponse. Cela veut dire qu’il y a une condamnation sociale de ce
comportement. Jnumi et Bajai n’ont pas nié l’existence des couples incestueux, ils
ont trouvé plus simple de nier directement l’existence de la règle. Quelques mois
après, avec la capacité de comprendre un peu les blagues et les moqueries —
sachant qu’au début de mon terrain, cela m’était totalement impossible —, nous
avons pu avoir une autre perspective. La condamnation sociale fait de l’endogamie
clanique quelque chose de honteux. Tout le monde sait à quel clan appartient un
individu, il n’y a pas moyen que cela reste secret. Les individus du même clan qui
veulent néanmoins se marier, dit Fischermann (1988 : 81), doivent faire preuve
d’une forte personnalité pour faire face aux rumeurs. Le puyac de l’exogamie est
fait pour être violé, mais il faut résister aux conséquences.
Les conséquences de l’union intra-clanique ne sont pas limitées aux
moqueries occasionnelles. Au contraire, des effets nocifs lui sont attribués, ce qui
fait de la rupture de la règle d’exogamie non seulement quelque chose à rejeter,
mais aussi une affaire dangereuse. Un exemple l’illustrera mieux. Quelques mois
après cette conversation sur les couples incestueux, une mauvaise nouvelle est
arrivée à Jesudi : Chugupei, un homme très apprécié de la communauté de Chaidi,
s’était enfui vers la forêt. Il existe une maladie chez les Ayoreo qui est appelée
urusoi — expression traduite par « fou » et que les Ayoreo utilisent pour dire dans
leur langue « ivre ». La personne qui devient urusoi s’enfuit dans la forêt et
commence à se comporter comme un lézard. C’est parce que Poji — le Premier
Homme lézard — est en train de lui enlever l’ayipie — l’un des principes
animiques de la personne — et de mettre le sien à sa place (Pagés Larraya 1973 ;
Bernand-Muñoz 1977 ; Bórmida 1984 ; Fischermann 1988). Chugupei était
quelqu’un de bien aimé à Jesudi et on voyait que les gens étaient consternés.
La première explication m’a été donnée par Jnumi. Elle m’a fait remarquer
que cet homme était marié avec quelqu’un de son propre clan : Chugupei et son
épouse étaient tous les deux Étacori, et c’était pour cela qu’il était parti ainsi.
165
�Même si Jnumi ne pouvait pas nous expliquer la manière ou les causes précises qui
allaient d’une telle union à la maladie, cette idée lui semblait tout à fait pertinente.
Elle répétait avec tristesse la phrase que son père lui avait dite quand elle était
petite : « ca ajnina bagiosi » (« N’accompagne pas — ne te marie pas avec — ton
parent clanique »). Se marier avec un parent clanique était dangereux. Jnumi nous a
donné un autre exemple pour montrer combien cette sorte d’union entraînait des
risques : les déficiences de développement d’un enfant de Jesudi se devaient au fait
que ses parents appartenaient au même clan. Il s’agissait de Juto, un des fils de
Rafaela et Segundo Dosapei, ceux qui quelques mois auparavant avaient été donnés
par Jnumi comme exemple de l’inexistence de la règle d’exogamie. Ce problème de
l’enfant était un détail remarqué assez souvent par les Ayoreo de Jesudi, qui lui
attribuaient un âge différent — mais toujours très avancé — à chaque occasion. Du
point de vue de Jnumi, l’union intra-clanique était la cause évidente de ces deux
situations malheureuses. Cependant une autre interprétation, qui laissait de côté les
clans, m’attendait dans un autre ogadi.
Un peu plus tard, je me suis rendu à l’ogadi de Sidi et Poro — un couple
appartenant tous les deux au clan Posorajãi — pour parler de la maladie de
Chugupei. Ils ont alors proposé une autre explication à ce qui lui était arrivé, selon
laquelle les clans ne jouaient aucun rôle. D’après Sidi et Poro, l’épouse de
Chugupei, Puudi, avait violé un tabou quand elle était jeune, ce qui avait provoqué
le décès de son premier mari. Le deuxième et le troisième mari de Puudi avaient
subi le même destin. Maintenant c’était Chugupei, le quatrième mari, qui était la
victime. La logique dans l’explication de Sidi et Poro et celle de Jnumi étaient la
même : la maladie était la conséquence de la désobéissance à une règle, le résultat
d’avoir fait ce qui était puyac (« interdit »). La seule variation était la règle
évoquée. Sidi et Poro appartiennent au même clan et ils ont dû formuler une
explication qui laissait délibérément de côté cet aspect.
Ces exemples montrent que la représentation d’une pensée dans les pratiques
n’est parfois ni directe ni simple. Même si quatre couples violent cette prohibition
dans la petite communauté de Jesudi — ce qui est significatif du point de vue
166
�statistique —, l’idée de la règle d’exogamie — surtout de l’aspect nuisible de
l’union intra-clanique — est très présente dans leurs discours et leurs silences.
C’est une affaire dont on ne doit pas parler ouvertement, mais dont on bavarde dans
l’intimité de l’ogadi. Ils ne nous ont pas dit qu’il était « moche » ou « interdit » de
se marier avec quelqu’un du même clan jusqu'à ce que nous leur ayons inspiré une
confiance suffisante, au moins celle de savoir que nous ne répéterions pas ce que
nous avions entendu. C’est aussi une sorte de circonstance constante — la rupture
permanente d’une prohibition — dont les aspects nocifs sont toujours là, latents,
jusqu’au moment où se produisent des effets d’une manière que nous n’avons pas
pu préciser. C’était la première explication à laquelle Jnumi avait pensé lors de la
fuite de Chugupei dans la forêt, ce qui lui a rappelé le cas de Juto, l’enfant qui ne
grandissait pas. Il est aussi vrai que c’est un sujet dont il vaut mieux ne rien dire :
Poro s’est fâchée avec nous (toujours selon Jnumi, mais c’est en tout cas une
réaction jugée acceptable) à cause de notre indiscrétion ; Sidi a formulé une
explication acceptable dans les termes de la pensée ayoreo pour la maladie de
Chugupei qui n’avait absolument rien à voir avec le fait que son épouse était son
parent clanique. Soit par mention, soit par omission, l’idée selon laquelle
« accompagner un parent » est interdite, est sous-jacente à ces deux explications
parfaitement valides. L’union entre deux personnes du même clan est certainement
une affaire délicate, voire dangereuse dans des circonstances déterminées.
IV.3.2. L’affectivité entre parents claniques : ceux qui habitent loin
C’est une évidence pour les Ayoreo qu’un lien clanique est un lien affectif.
J’étais un après-midi à Jesudi, en train de boire du tereré à l’ombre d’un cucoi
(Chorisia ventricosa alba). Je parlais avec Jnumi Posijñoro de la grande proportion
de Posorajãi et de Dosapei que l’on pouvait trouver à Jesudi. Echoi, du clan
Picanerai, qui nous accompagnait silencieusement dans la conversation, a dit tout à
coup : « Je suis triste à Jesudi parce que je n’ai pas ici d’igiosode » puis elle est
restée à nouveau silencieuse. Elle n’a mentionné aucun parent clanique en
particulier, aucun membre de sa famille : ce n’était pas qu’un individu spécifique
167
�lui manquait, la tristesse venait d’un état de solitude, disons « clanique ». Ni elle ni
Jnumi n’ont ajouté un mot car le sens était clair et évident pour elles, mais il ne
l’était pas pour moi au début. Cette expression laconique du lien affectif entre
parents claniques m’a frappé par la naturalité de son expression, c’était quelque
chose d’évident pour les femmes qui étaient là. Nous nous sommes demandé par
quels moyens, par quelles pratiques les Ayoreo instauraient et consolidaient une
telle affectivité clanique. Ils le faisaient, notamment, à travers l’échange de
nouvelles, de chants et de cadeaux.
Chez les Ayoreo — du Paraguay du moins —, il est normal d’avoir des
parents et des amis éparpillés dans plusieurs communautés ou dans des fermes
mennonites tout au long du Chaco. Ils restent en contact et se mettent au courant de
la vie des autres, en grande partie grâce à la communication par radio UHF et par
les messages enregistrés sur des cassettes qui sont apportées par des visiteurs
occasionnels. Après être resté quelques semaines à Jesudi, je voulais rendre visite à
la communauté de Chaidi, située à un peu plus de 150 km en chemin de terre, avec
l’intention de continuer mon terrain là-bas (ce qui n’a finalement pas été le cas).
Lors de ces voyages, j’ai servi — à la demande des Ayoreo — de facteur pour les
messages entre les deux communautés. Le soir, autour du feu, j’enregistrais leurs
messages avec mon magnétophone à cassettes.
La production de messages n’était pas quelque chose de privé. Bien au
contraire, ils étaient enregistrés dans l’espace ouvert d’un ogadi. Tous y étaient
réunis et écoutaient les messages que les autres envoyaient et, occasionnellement,
leur suggéraient des mots ou des chants. Le moment de l’écoute était semblable :
tous se rassemblaient autour du magnétophone. Ces messages produits dans une
ambiance collective avaient cependant un expéditeur et un destinataire spécifiques.
Les messages étaient un ensemble de nouvelles, de chants, de cadeaux et de
demandes de cadeaux. Ils mentionnaient toujours les expériences passées partagées
avec le destinataire et des nouvelles qui portaient sur des sujets habituels —santé,
travail, faim. Quelques-uns demandaient à une personne en particulier de prêcher la
168
�parole de Dupade (dieu chrétien) pour eux. Les chants envoyés étaient quelquefois
anciens. D’autres fois, ils étaient inspirés des événements qui s’étaient passés à
Jesudi, mais pas récemment. Le fait que le chant racontait n’était pas une
nouveauté, ce qui nous amène à penser que le chant en tant que composition était
plus important que le fait raconté. Les cadeaux que les membres de ces deux
communautés envoyaient s’établissaient en fonction de la richesse de la forêt qui
les entourait et de la distance de Filadelfia à laquelle elles se trouvaient. Des
vêtements et des machettes partaient de Jesudi tandis que du miel et du jnui, le
poivron bien aimé de la forêt, provenaient de Chadi.
Les liens de clan — au cas où il y en avait — entre expéditeur et destinataire
étaient certainement mis en relief. Dans le premier voyage de Jesudi à Chaidi, j’ai
enregistré une vingtaine de messages dont la moitié correspondait à quelqu’un qui
l’envoyait à son propre parent clanique ou au parent clanique de son conjoint. Cela
a été énoncé dans plusieurs enregistrements : « oh mon parent clanique, ces mots
t’appartiennent ». En dehors de cette déclaration directe, ils utilisaient avec les
igiosode la terminologie de la consanguinité, quand bien même ces parents
claniques n’avaient aucun lien généalogique reconnu. Les termes choisis variaient
selon l’âge des personnes impliquées. Une femme âgée appelait quelqu’un de son
propre clan et d’à peu près la même génération « yajabi » (« mon frère ») et une
femme de la génération suivante « yabujia » (« fille de mon frère »). Ces
dénominations nous indiquent au moins deux choses. D’un côté, les Ayoreo
s’adressent aux parents claniques comme si ces derniers étaient des consanguins,
ceux avec lesquels on ne se marie pas. De l’autre, le fait d’appeler ainsi quelqu’un
qui n’est pas consanguin le rapproche, le rend membre de la famille qui agit comme
une unité économique. C’est justement ce fort lien affectif que nous avons
remarqué entre les igiosode qui habitent loin les uns des autres.
Comme plusieurs de ces individus se connaissaient personnellement, on
pourrait penser que le fait d’être parents claniques était une circonstance secondaire
ou anecdotique. Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir fait connaissance
personnellement avec quelqu’un pour lui envoyer des chants et des cadeaux. Un cas
169
�l’illustrera clairement. Poro Posijñoro avait envoyé des messages pour Gachabia
Posijñoro, une jeune femme qui habitait à Chaidi. Comme d’habitude, elle lui
envoyait des nouvelles, des chants et des cadeaux, et attendait de même en retour.
Poro m’avait demandé une photo de Gachabia. Cette dernière m’a donné alors à
Chaidi un double qu’elle avait et que j’ai à son tour remis à Poro. J’ai pu alors
savoir que c’était la première fois que Poro voyait une image de Gachabia. Elles ne
se connaissaient pas personnellement, mais Poro était au courant que, dans la
communauté de Chaidi, parmi les Ayoreo sortis de la forêt en 2004, il y avait des
Posorajãi, et cela suffisait à Poro pour envoyer des cadeaux et des messages à
Gachabia. De la même manière, un autre Ayoreo de Jesudi, du clan Posorajãi,
voulait recevoir des cadeaux de la part de Gachabia. Dans la deuxième session
d’enregistrement de messages (de Jesudi pour Chaidi), Poro a raconté à Gachabia
qu’à Jesudi elle avait un autre igiosi, Mimie Posorajãi, qui ne voulait pas parler au
magnétophone parce qu’il n’avait pas reçu de cadeaux de Gachabia. Comme
Gachabia était sortie de la forêt en 2004, elle n’avait aucun rapport avec les gens de
Jesudi. C’est en raison du rapport clanique que Poro voulait envoyer des messages
à Gachabia et que Mimie considérait qu’il avait le droit de recevoir des cadeaux.
Les liens claniques sont propices à un lien affectif, mais ils ne le déterminent
pas (le cas d’igiosode à l’intérieur de Jesudi l’illustrera mieux). Quelques mois
après ces échanges de messages, j’ai pu organiser une visite de quinze personnes de
Jesudi à Chaidi. Dans cette dernière communauté, le chef mettait en valeur les
membres de divers clans : « lui, elle et elle, ce sont tous des Posorajãi, quant au
Chiquenoi, c’est lui, lui, elle… ». C’était une sorte de familiarité préalable, une
espèce de passoire affective. Ce que nous soutenons en tout cas, c’est que les liens
affectifs suivent les voies claniques mais ne s’y limitent pas.
Cette relation entre parents claniques est difficile à décrire en termes de
substances partagées — si l’on reprend l’idée de relatedness modifiée par Holy —,
mais on peut dire que les igiosode entretiennent un lien affectif et économique qui
souligne cette appartenance clanique à la base de ce rapport. Le lien affectif entre
igiosode est construit — l’exemple de Poro et Gachabia le montre — à partir de
170
�l’envoi de cadeaux et de chants et il est maintenu de la même manière. Cependant,
ce lien préexistant aux démonstrations de générosité ne disparaît pas — au sens
nominal — si elles ne sont pas accomplies. Or, pour décrire plus minutieusement
les aspects des liens affectifs qui vont au-delà du discours, il faut explorer les
rapports entre parents claniques, et entre ceux qui ne le sont pas, à l’intérieur de la
communauté de Jesudi.
IV.3.3. Les igiosode d’ici
Les rapports entre les igiosode à l’intérieur de Jesudi sont différents de ceux
tissés entre les parents des communautés lointaines, de la part de qui on attend
avidement des nouvelles, des chants et des cadeaux. L’observation des rapports
entre igiosode à l’intérieur de Jesudi nous permet de remarquer deux particularités.
D’un côté, ces liens ne semblent pas aussi étroits que ceux tissés avec les igiosode
qui habitent loin — d’après ce que l’expression dans les messages nous permet de
voir. Mais, parfois, il y a des moments où ces liens claniques à Jesudi deviennent
saillants, notamment dans des circonstances traumatisantes, d’une intense
affectivité. Voyons ces deux aspects plus en détail.
Nous avons mentionné que dans les messages la plupart des parents
claniques s’adressaient entre eux avec la terminologie de consanguinité, ce qui les
rendait membres de la même famille, au moins d’une manière nominale. À Jesudi,
au contraire, cette terminologie est beaucoup moins utilisée entre les igiosode. De
plus, très peu de ceux qui sont parents claniques s’appellent par le terme d’adresse
« yigiosi » (« mon parent clanique »). Les igiosode plus distanciés socialement à
Jesudi ne s’appellent pas avec la terminologie spécifique, mais seulement par le
prénom, dénomination qui n’indique pas le clan. Cela ne veut pas dire évidemment
qu’ils ignorent le lien, étant donné que, quand on les consulte, ils indiquent toutes
les personnes de Jesudi qui appartiennent à leur même clan. La terminologie
spécifique est réservée — d’après ce qu’on peut voir tous les jours — pour les
rapports les plus étroits, par exemple entre les femmes de l’ogadi de Dosapei et de
171
�l’ogadi de Sidi Posorajãi. Ces deux ogadi entretiennent de bons rapports : leurs
membres partagent de la nourriture et se rendent visite le soir autour du feu. La
terminologie des clans s’impose entre ces femmes, malgré l’existence d’autres
rapports. Par exemple, même si le rapport entre Jnumi Posijñoro et Chugupenatei
Posijñoro est en première instance d’affinité — Chugupenatei est l’épouse d’un fils
de Jnumi —, ces deux femmes s’appellent mutuellement « yigioto ». De plus, Jnumi
et Chugupenatei utilisent parfois la terminologie de consanguinité mentionnée
auparavant (elles s’adressent à l’autre avec les termes « fille de mon frère » et
« sœur de mon père » respectivement). Il y a une relation entre la construction
volontaire d’un certain rapport étroit et la mise en valeur d’un lien sous-jacent — le
clan — qui en fait était préexistant.
Il y a cependant des occasions dans lesquelles ces rapports claniques —
habituellement ensevelis — entre ceux qui sont éloignés socialement deviennent
visibles. C’est le cas, notamment, des chansons de deuil. Dans ce genre de
compositions une personne pleure en chantant des phrases qu’elle invente suivant
des règles strictes. Si le défunt ou malade est un parent clanique de celui qui pleure,
ce dernier en fera la remarque dans son chant, il manifestera sa tristesse pour son
igiosi. Pour quelle raison ces rapports sont-ils mis en relief alors que d’habitude ils
sont laissés de côté ? Nous avons pensé à deux explications qui renvoient l’une à
l’autre. Premièrement, cela pourrait être une conséquence des règles de ce genre
particulier de compositions. Dans tous les cas que nous avons enregistrés et
analysés, l’appartenance clanique du défunt ou du malade est marquée. Si le
chanteur est obligé de signaler le clan de celui qui est à l’origine de sa tristesse, il
rappellera aussi, le cas échéant, qu’ils sont igiosode. Deuxièmement, les
circonstances qui inspirent une telle sorte de chants — une maladie grave, la faim
ou la mort — sont des expériences vécues avec une grande intensité. Cette sorte de
situation traumatisante renforce les liens affectifs qui, à leur tour, mettent en relief
les rapports claniques. Selon Sidi Posorajãi, lors du décès de Manenacode
Posijñoro, c’étaient Jnumi, Bajai, Poro et lui-même, tous Posorajãi, qui ont pleuré
pour la défunte, parce qu’ils appartenaient au même clan. Il faut quand même
relativiser l’affirmation de Sidi, vu que j’étais présent dans d’autres occasions
172
�graves — des maladies en phase terminale ou des cas de malnutrition — et la
tristesse et le deuil n’étaient pas exclusifs des parents claniques des personnes
affectées. Cela n’invalide pas l’argument de Sidi selon lequel les parents claniques
ressentent fortement la perte d’un igiosi.
Soit dans des circonstances quotidiennes — cas du rapport entre Jnumi et
Chugupenatei —, soit dans des conditions spéciales — les chants de deuil —, les
rapports entre parents claniques à l’intérieur de Jesudi nous montrent un trait que
nous avions remarqué aussi dans le cas d’igiosode de communautés éloignées : la
mise en valeur de ce lien est facultative et elle est réservée aux rapports étroits
marqués par l’échange de nourriture. Les parents claniques des communautés
éloignées s’envoyaient des cadeaux, les igiosode de Jesudi qui sont proches — par
exemple Jnumi et Poro —partagent de la nourriture, et dans les occasions de chants
de deuil, il est habituel de remarquer la générosité du parent décédé. La mise en
valeur du rapport clanique, la générosité et l'affectivité sont trois aspects qui
s’imbriquent dans la pensée ayoreo.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le monde des Ayoreo n’est pas limité
aux parents claniques, c’est-à-dire aux humains du même clan. Suivant ces deux
oppositions — humains et non-humains, du même clan et d’un autre clan — deux
questions se posent. D’un côté, nous pouvons nous demander : quels rapports ontils avec les humains des autres clans ? De l’autre, quoi ou qui sont les non-humains
appartenant au même clan ou aux autres ? Comme nous le verrons, les réponses à
ces deux questions, elles aussi, s’imbriquent réciproquement.
IV.4. Les propriétés claniques : le rapport avec les non-humains du clan
Les cucherane (clans) ne sont pas limités aux igiosode (parents claniques).
Un cucherai comprend non seulement des êtres humains, mais aussi des animaux,
des plantes, des accidents géographiques et des objets. Les éléments d’un clan qui
ne sont pas humains s’appellent edopasade. Sebag (1965a, 1965b) et Bernand173
�Muñoz (1977), sous l’influence de Lévi-Strauss, ont cherché les principes sousjacents qui organiseraient le rassemblement des êtres et des objets dans les sept
clans : Chiquenoi, Étacori, Picanerai, Dosapei, Posorajãi, Cutamurajãi et Jnurumini.
Bórmida (1973, 1974, 1975, 1976, 1978-9a, 1978-9b) et surtout Fischermann
(1988) ont exhaustivement analysé les cucherane en tant que catégories de la
pensée selon des perspectives théoriques très différentes. Le travail de ces auteurs
s’appuie sur l’information du terrain, mais qui vient, pour la plus grande partie,
d’entretiens avec quelques individus qui avaient une connaissance — aussi
formidable qu’exceptionnelle — des edopasade et des nombreux récits des
origines.
Au début de ce chapitre, nous avons fait part de notre frustration sur le
terrain quand les Ayoreo ne pouvaient pas se souvenir de plus de quatre ou cinq
appartenances claniques. Cet oubli d’edopasade ne voulait pas dire, cependant, que
les clans avaient une importance mineure dans la vie des Ayoreo. Nous avons cité
Bugos plus haut : « Aujourd’hui, même si beaucoup d’edopasadie ont été oubliés,
les kucierane sont encore une source centrale d’identité sociale128 » (1985 : 144).
Malheureusement, l’auteur américain ne va pas plus loin sur ce point, mais son
affirmation est valide et nous mène à la question suivante : de quelle manière les
cucherane constituent-ils la source de l’identité sociale et dans quels contextes
cette dernière est-elle manifestée ? Cette importance sociologique, nous l’avons
trouvée dans les contextes dans lesquels nous avons vécu pendant notre terrain
entre 2008 et 2011. Ce n’est pas dans le scénario de la guerre, de la guérison
chamanique ou des attaques magiques avec des mots dangereux, que nous avons
perçu l’importance des edopasade, mais dans la monotone vie domestique. Cette
vie domestique se déroule à l’intérieur d’une unité résidentielle, ogadi, qui est
l’espace d’interactions défini par les ogasuode.
128
« Today, even though many edopasadie have been forgotten, the kucierane continue to be a
central source of social identity. » (BUGOS 1985 : 144)
174
�IV.4.1. « Cet edopasai est à moi »
Les edopasade sont mentionnés dans la bibliographie principale (Bórmida et
Califano 1978, Fischermann 1988 et Bernand-Muñoz 1977) comme « propriété
clanique ». En effet, le mot edopasai est un nom possédé, c'est-à-dire qui indique le
possesseur par la variation du préfixe (Bertinetto 2009) 129. Pour comprendre la
notion d’edopasai il faut étudier cet aspect, la possession, qui est — nous le
verrons — fondamental pour sa définition.
Observons alors ce qui se passe dans l’unité résidentielle, l’ogadi. Ses
membres se rassemblent au moment des repas : c’est le midi ou le soir que l’ogadi
est vraiment visible. La première impression ressentie au moment de manger est
celle du partage général : c’est un groupe d’objets — assiettes, chaussures,
cuillères, couvertures, etc. — qui passent indifféremment des uns aux autres, en
fonction des moments d’utilisation. Cela peut donner à première vue la fausse
impression d’une propriété collective. D’autres observations semblent soutenir cette
idée : au moment du repas, il est vrai, tous utilisent des plats et des cuillères qui
étaient dans la seule casserole où l’on fait le pot-au-feu ; si quelqu’un a besoin de
chaussures pour un moment, il prendra celles qui sont à sa portée. En effet,
quelques objets sont utilisés de temps en temps, par diverses personnes. Or, si l’on
fait attention aux plats, aux cuillères et aux chaussures, on trouvera toujours un
nom écrit quelque part : c’est le nom du propriétaire. Malgré l’utilisation collective
et occasionnelle, ces biens ont un propriétaire. Quand le propriétaire doit voyager et
qu’il a besoin de ses affaires, il les prend, les enlève de cet espace collectif, sans
hésiter. La propriété d’un objet n’empêche pas qu’il soit utilisé par d’autres
individus. En effet, ces objets sont mis à la disposition de tous les membres de
l’ogadi.
Le mot utilisé pour désigner ce rapport entre un sujet et un objet est –ajne,
par exemple « Pojnangue gajnaque bajo » (« Pojangue, son appartenance [est]
l’assiette »). Selon la grammaire de Bertinetto (2009 : 15), –ajne signifie
129
Par exemple yedopasai = mon edopasai ; bedopasai = ton edopasai.
175
�« appartenance, possession, propriété »130 et c’est un nom possédé. Ils utilisent
aussi ce mot au moment de faire un cadeau ou de partager de la nourriture :
« majné » (« c’est à toi »). Cette allocution indique certainement une sorte de
propriété : un jour, nous avons passé le tereré en disant « majné » et le destinataire
a remarqué en plaisantant qu’il remporterait le récipient chez lui — la guampa ne
serait plus à moi — vu que dans ce contexte il valait mieux dire « ojni
toa ! » (« bois ! »).
Ce même mot est utilisé pour décrire le rapport avec les edopasade :
« posorajnane ore gajneque ñacore » (« ceux du clan Posorajnai, leur appartenance,
le pécari »). Alors, les edopasade — qu’il s’agisse d’objets, d’accidents
géographiques ou d’animaux — sont des choses que l’on possède. Le rapport avec
eux est celui de la propriété. Que signifie cette propriété pour les Ayoreo de
Jesudi ? Nous pensons qu’un premier indice nous est fourni par les objets possédés
dans le contexte de l’ogadi : des objets que tout le monde peut utiliser mais sur
lesquels le nom du propriétaire est gravé. Ce que le nom indique est une priorité
d’utilisation, pas une exclusivité.
Nous avons été témoin à plusieurs reprises au moment des repas — quand
tous les membres de l’ogadi sont réunis — de ce que nous appelons « les disputes
du midi ». Celles-ci consistent, tout simplement, en la jactance comique des
edopasade. Un Dosapei dit ironiquement à un Étacori, pendant que celui-ci mange
du riz avec des courges : « unejna yedopasai ? » (« est-ce que c’est délicieux, mon
edopasai ? »), en désignant la cucurbitacée. L’Étacori répond que sans le feu —
edopasai des Étacori — le Dosapei ne pourrait pas cuisiner. Le Dosapei dit à son
tour qu’il s’en moque, qu’il est Dosapei et que, par conséquent, tous les fruits de
l’époque des pluies lui appartiennent, que les Étacori n’ont rien et qu’ils sont
pauvres. L’Étacori insiste sur l’utilité ou l’importance de ses edopasade tels que le
soleil, le feu, le jour, etc. La discussion continue de cette manière et il peut arriver
que d’autres membres de ces deux clans s’en mêlent, ou même qu’un individu d’un
autre cucherai indique qu’il peut vivre sans courge mais que personne ne pourrait
130
« belonging, possession, property ».
176
�survivre sans eau, vêtements ou une belle camionnette. Nous avons observé ces
discussions à plusieurs reprises et nous pouvons constater que leur déroulement est
toujours le même : elles commencent par une provocation d’une personne envers
quelqu’un d’un autre clan qui est en train d’utiliser une edopasai du provocateur.
Même si les edopasade varient, l’argument sous-jacent est toujours le même. Cet
argument a été présenté de manière inverse quand ils ont essayé de me convaincre
d’appartenir à un clan : « Tu dois devenir Posorajãi, comme ça tu mangeras de la
viande de vache et de la glace, tu boiras du lait et de l’eau », « Non, non, c’est
mieux d’être Dosapei, nous avons beaucoup d’edopasade, tous les fruits de la
saison des pluies ». Ils faisaient l’éloge de leurs clans en insistant sur la grande
quantité de biens possédés (même s’ils disaient qu’ils étaient nombreux, ils
pouvaient en nommer sept ou huit, tout au plus) ou l’importance de leur utilisation.
Ces discussions banales ne nous disent pas pour quelle raison tel animal ou
tel autre appartient à un clan déterminé. Elles ne disent effectivement rien sur les
principes de classification, mais nous aident à comprendre quel rôle jouent les
edopasai dans la vie des Ayoreo. Cette notion d’utilisation implique aussi l’idée du
« permis », qui se trouve dans la définition même d’edopasai. J’ai interrogé sur le
signifié du mot edopasai et, comme d’habitude, la réponse avait la forme d’un
exemple. Poro Posijñoro m’a dit : « yedopasai yodi ga je toque jeti gosi chijna to,
ñajne ! » (« l’eau est mon edopasai et personne ne l’utilisera aussi, ça
m’appartient ! »).131
Au lieu de me raconter une histoire des origines qui
expliquerait comment l’eau est devenue un edopasai des Posorajane, Poro a préféré
souligner cette idée d’appartenance et de priorité d’utilisation pour définir le
concept.
Cette attribution d’un edopasai à un clan vient des temps des Premiers
Hommes — les jnanibajade — (ce qui a été largement étudié par Fischermann et
Bórmida) et les Ayoreo supposent que tout existant appartient à l’un des sept clans.
131
Quelques mois auparavant, Ebedu Dosapei nous avait donné la même réponse en espagnol —que
nous n’avons pas pu comprendre avant de relire nos notes — : « el camino es dosapei, entonces yo
prohibe usar el camino » (« le chemin est dosapei, alors j’interdis d’utiliser le chemin »). La version
en ayoreo nous permet d’apprendre quelques détails : le préfixe possessif de –edopasai et l’emphase
à travers –ajnei, qui peut être utilisé pour indiquer par apposition la possession.
177
�Dès la prime enfance, les petits Ayoreo ont appris à être fiers de leurs edopasai. J’ai
vu les grand-mères, chargées d’élever leurs petits-enfants, leur enseigner quels
étaient les edopasai de chacun. « Ton edopasai est le miel, quant à toi, ton edopasai
est le camion ». Les enfants étaient ravis de savoir que ces objets étaient leurs
propriétés claniques. L’expression de ces enfants était similaire à celle qui se
manifestait quand un chocolat ou un jouet leur était offert. Une expression de
satiété utilisée quand on boit de l’eau ou on mange un fruit est « unejna
yedopasai ! » (« c’est délicieux, mon edopasai ! » sans que cela ne déclenche une
« dispute du midi ». Même s’il y a des discussions concernant l’appartenance
clanique des éléments nouveaux, ils ne doutent pas que le bien en question
appartienne à l’un des clans 132. Les Ayoreo sont nés dans un monde de sept
cucherane.
IV.4.2. Parents de l’univers ?
La constatation selon laquelle, pour les Ayoreo, tous les êtres du monde
appartiennent à l’un des sept clans a inspiré certaines idées dans la littérature du
groupe que nous voulons remettre en question. Bórmida et Califano disent que les
Ayoreo « étendent la parenté clanique [jusqu’au point d’inclure] toute la
réalité133 » (1978 : 97). Fischermann, de son côté, soutient que « les Ayoreo se
considèrent eux-mêmes comme faisant partie de la nature avec laquelle ils ont des
rapports de parenté par le biais du système d’edopasade134 » (1988 : 95). Ces
auteurs affirment que le rapport avec les edopasade est un rapport de parenté.
Autrement dit, le rapport avec les propriétés claniques serait équivalent au rapport
132
Ces discussions sont une belle occasion d’observer une idée de contiguïté dans les principes de
classification des edopasai. Un vieil homme dosapei et une vieille dame posijñoro discutaient, dans
la communauté de 15 de Septiembre, l’appartenance clanique du tereré. L’homme disait que la
boisson avait des feuilles et que, comme tout ce qui a des feuilles apparaît pendant la saison des
pluies qui appartient aux Dosapei, le tereré était dosapei. La femme, par contre, soulignait la
présence de l’eau — edopasai des Posorajãi — ce qui rendrait le tereré aux Posorajãi.
133
« extienden el parentesco clánico a toda la realidad » (1978 : 97).
134
« Los ayoréode se entienden como parte de la naturaleza, con la que están relacionados por
parentesco mediante el sistema de edopasade. » (1988 : 95)
178
�avec les igiosode, les parents claniques. Nous ne sommes pas d’accord avec cette
affirmation. Nous pensons que les rapports entre les humains du clan — igiosode —
et les rapports entre les humains et les non-humains du clan — edopasade — sont
tout à fait différents.
Le rapport avec les igiosode — quand il dépasse le simple lien nominal —
peut être décrit comme affectif et marqué par la réciprocité. Comme nous l’avons
montré, les igiosode de communautés éloignées s’envoient de la nourriture, des
chants, des prédications de Dupade, des cadeaux et ils se tiennent au courant des
nouvelles des uns et des autres avec une forte nuance affective. C’est une relation
d’entraide et d’échanges entre deux personnes. Le rapport avec les edopasade, par
contre, est un rapport de propriété et d’utilisation, qu’il s’agisse d’objets,
d’animaux ou d’accidents géographiques. Ce n’est pas le cas d’une interaction entre
pairs : les Posorajãi ont, parmi leurs edopasade, le pécari et le rapport avec celui-ci
est de consommation. Ils le chassent et — après la distribution des morceaux — le
mangent. Ils ne demandent pas la permission à un maître des espèces (comme c’est
le cas chez les Qom, Tola 2004) ni n’effectuent de chamanisme de la nourriture
(comme chez les Makuna, Århem 1996) pour envoyer l’âme de la proie vers une
maison de naissance. Cela veut-il dire que les non-humains ne sont jamais pensés
comme sujets ? Le rapport des Ayoreo avec les non-humains relève d’une grande
complexité, sans doute, et les ambiguïtés ne manquent pas.
Si l'on fait une révision des mythes recueillis dans la bibliographie
(Bernand-Muñoz 1977, Fischermann 1988, Bórmida 1973, 1974, 1975, 1976,
1978-9a, 1978-9b, Casalegno 1985), on peut remarquer que la plupart des nonhumains — à la notable exception du jaguar — ont été autrefois humains. Or, toute
ces histoires sont placées dans un passé lointain (indiqué par l’adverbe nanique, « il
y a longtemps ») et les interactions avec les non-humains en tant que sujets
n’arrivent presque jamais actuellement. Ils nous ont raconté des histoires
concernant des attaques de non-humains, mais il s’agit de chamans qui étaient
entrés dans ces animaux (c'est-à-dire que ces animaux sont plutôt les véhicules d’un
humain, ils n’ont pas d’intentionnalité propre). Nous n’affirmons pas que les non-
179
�humains ne soient jamais pensés comme des sujets. Cela n’empêche pas que ces
non-humains— en tant qu’edopasai — sont conçus en termes d’un rapport
d’utilisation et de consommation. Ce type de rapport avec les propriétés claniques
est fondamental pour entretenir des rapports avec les membres de la même unité
résidentielle, l’ogasui. C’est par le biais des edopasade — les non-humains du
même clan — qu’un lien particulier peut être tissé avec les ogasuode, les humains
qui ne sont pas du même clan et avec lesquels on habite et on mange.
IV.5. Le rapport avec les ogasuode : ceux qui sont près mais qui ne sont pas de
mon clan
La vie quotidienne se déroule surtout, comme nous l’avons dit, dans l’espace
de l’ogadi. C’est là que se tissent des liens de réciprocité qui dépassent en
importance ceux de la généalogie (la famille étendue est la base mais elle ne suffit
pas à expliquer le phénomène). Pour rester membre de cette unité, il faut maintenir
une continuité d’échanges de services et de nourriture tous les jours. La nourriture
est une sorte de thermomètre des rapports sociaux : quand Jnumi a voulu manifester
son rejet de la nouvelle épouse de son fils aîné Ceferino, elle a refusé de manger ce
qu’il lui avait offert. Lors d’une discussion forte, j’ai entendu la menace : « Va-t’en
et tu verras si ailleurs on te donne à manger ! ». Les liens affectifs sont manifestés
surtout sous la forme de générosité : les défunts pour lesquels on pleure le plus sont
ceux qui donnaient de la nourriture (cela est particulièrement mis en relief dans les
chants de deuil). Contrairement aux rapports impérissables — étroits ou
indifférents — des igiosode, le lien entre les membres d’un ogadi doit être construit
et constamment renforcé : il faut toujours partager la nourriture dans cet endroit
commun.
Toutes les entités du monde appartiennent à l’un des sept clans, ce qui veut
dire qu’on utilise tout le temps, soit ses propres edopasade, soit ceux des autres. Si
quelqu’un peut utiliser les edopasade des autres clans, c’est parce qu’il en a la
180
�permission implicite, c'est-à-dire qu’il y a là un rapport avec une autre personne.
Les « disputes du midi » rendent évidentes les conséquences hypothétiques du refus
de cette permission : sans les edopasade des autres clans, ils ne pourraient pas
vivre. Comme la plupart de ces particularités, cette dernière a aussi son expression
dans une histoire des origines. Selon cette histoire, au temps des Premiers Hommes,
les Ayoreo ont essayé de vivre en toute indépendance : les membres de chaque clan
utilisaient seulement leurs propres edopasade. Cela n’a pas fonctionné et ils ont
alors décidé de tout partager à nouveau.
Nous pensons que le rôle fondamental des edopasade dans la vie
quotidienne à l’intérieur d’un ogadi consiste à établir une idéologie de la
dépendance. Il faut souligner que ces discussions comiques ont lieu surtout entre
ogasuode, des individus qui partagent d’habitude de la nourriture, c'est-à-dire des
gens qui font partie d’un circuit de réciprocité — bref, des gens qui dépendent les
uns des autres. Ces commentaires sarcastiques rappellent en fait le mythe de la
réciprocité des clans, ils rendent explicite la permission implicite d’utilisation des
edopasade d’autrui. Ces provocations ne restent jamais sans réponse (« et toi,
qu’est-ce que tu ferais sans mon edopasai ? ») et le résultat est toujours le même :
tous utilisent les propriétés des autres (même si chacun tente de montrer qu’il
pourrait vivre exclusivement avec ses edopasade). Cette dépendance mutuelle est
une condition toujours présente. Les Ayoreo disent que, si quelqu’un éternue, c’est
parce qu’un autre lui en veut. Il faut dire alors, si on est Posorajãi, « ijnose ti gosi
que chijna yodi… ! » (« Il me semble que quelqu’un n’utilisera pas [n’aura pas le
droit d’utiliser] l’eau »)135 . C’est en fait une intimidation, une autre version de la
menace habituelle de ne pas partager les edopasade.
Cette dépendance mutuelle se situe à un niveau idéel mais elle a aussi des
conséquences dans la vie pratique quotidienne. Il faut avouer de toute évidence que,
dans la pratique, tous les Ayoreo peuvent utiliser tous les edopasade de tous les
clans (Fischermann 1988 : 156). De plus, même au niveau du discours de la
135
L’eau est un edopasai de Posorajnane. Quelquefois, je les ai entendus mentionner le savon (aussi
Posorajãi). La phrase est toujours la même, ce qui change est logiquement l’edopasai en question,
selon le cucherai.
181
�distribution des propriétés claniques, il n’existe pas d’échange équitable (les
Dosapei apporteraient les courges, les Étacori le feu, etc.). Plusieurs auteurs (Lind
1974, Bórmida et Califano 1978, Fischermann 1988) ont remarqué qu’il y avait des
clans riches ou puissants et des clans pauvres, mais que cela restait sur le plan
idéel. La réciprocité effective est accomplie à travers divers éléments — en général,
de la nourriture— et est limitée aux membres d’une même unité résidentielle. La
dépendance idéelle est à la base de cette réciprocité, même si ces deux plans ne
correspondent pas terme à terme. Le rapport avec les edopasade n’est pas limité à
cet aspect d’entraide, il dépasse largement ce domaine. Comme nous le verrons, les
edopasade sont aussi présents dans les expressions de remerciements, dans les
chants de guerre et de deuil, et dans les prémonitions pingogoningane, entre autres
domaines. Le monde est perçu par les Ayoreo comme un endroit où existent des
rapports claniques entre tous les existants. Les edopasade sont partout, les siens et
ceux des autres. C’est de là que vient la force symbolique de ces discussions du
midi. Ces interactions donnent un sentiment d’interdépendance au réseau de
relations constitué par igiosode et edopasade.
Conclusion du chapitre IV
Nous avons cherché, au début, à repérer les clans dans l’abstraction des
classifications, dans la possibilité d’élaborer de longues listes d’appartenances
claniques qui nous montreraient, par leur régularité, une règle sous-jacente. Nous
cherchions aussi des élaborations de la part des Ayoreo à ce sujet. Cependant, il n’y
avait pas de réflexions explicites dans les réponses que nos questions dignes de
Linné attendaient. D’une certaine manière, nous cherchions des exemples de ce que
nous pensions avant de poser les questions. Des régularités, des inclusions
hiérarchiques, des idées claires et distinctes nous guidaient sur un terrain que nous
croyions exploratoire, mais qui était en fait mené d’une manière déductive, dans
l’attente de confirmations ethnographiques de nos idées. La pauvreté de nos
résultats nous a obligé à explorer — au sens propre du terme —, à être inductif, à
faire attention à ce qui se passait réellement à Jesudi. Ce qui se passait, c’était la
182
�vie quotidienne, simple et monotone : et c’est précisément là que nous avons trouvé
que les clans jouaient un rôle. Quel rôle dans la vie ? Nous pensons qu’ils
constituent une sorte d’épistémologie relationnelle — un moyen d’établir des liens
entre des existants dans les aspects les plus divers de leur vie quotidienne. Cela
organise visiblement les comportements et les rapports sociaux des Ayoreo.
En ce qui concerne les rapports entre humains du même clan, on peut
distinguer dans leur discours deux principes à la base de la construction de la
société. D’un côté, le principe de l’exogamie : il faut chercher un conjoint chez
d’autre gens, non chez les igiosode : nous avons montré la condamnation sociale de
l’endogamie clanique, qui peut aller jusqu’à lui imputer des maladies. De l’autre,
l’obligation de solidarité entre membres du même cucherai, rapport qui est surtout
évident entre igiosode des communautés éloignées. Les parents claniques
— fondamentalement ceux qui habitent loin — entretiennent des liens à la fois
affectifs et économiques : les mots et les chants circulent aussi intensément que les
cadeaux. Ces deux aspects complémentaires de rapports entre parents claniques
étaient très clairement exprimés dans ce que le père de Jnumi lui disait quand elle
était petite : « Ne te marie pas avec tes igiosode, ils te donnent déjà de la nourriture
[sans que tu sois mariée avec eux] ». Ce conseil dit : « Tu dois profiter des rapports
d’affinité » tout en soulignant que les rapports claniques constituent une sorte de
consanguinité étendue à ceux avec qui on n’a pas de liens généalogiques reconnus.
Le rapport étroit — même s’il est intermittent — que les Ayoreo tissent avec
des individus d’autres communautés — généralement des igiosode — est d’une
certaine manière une occasion d’hospitalité en cas de migration. Selon Bugos,
l’interdiction d’épouser des cousins (croisés ou parallèles) a pour
conséquence — ou du moins c’était le cas en 1985 — que les Ayoreo ont des
parents généalogiques dans divers groupes. Cette familiarité entre les igiosode qui
habitent loin — dont les liens effectifs de parenté ne peuvent pas être retracés en
raison de la mémoire généalogique limitée — a le même avantage : la possibilité de
rapports de solidarité dans plusieurs communautés. Étant donné que les individus et
les familles continuent à se déplacer assez souvent — en raison d’opportunités de
183
�travail ou à cause de disputes —, cet atout peut avoir la même validité que
l’hypothèse de Bugos. Peut-être le fait que les clans ne soient pas localisés
contribue-t-il à renforcer cette affectivité. La parenté de clan, en fait, est une sorte
de filtre ou de carte affective provisoire, un point de repère pour aborder des gens
avec lesquels on a un contact intermittent.
La présence des clans se manifeste d’une autre façon dans les rapports entre
les membres d’une même communauté. Nous avons signalé que le lien entre
igiosode — avec l’échange de biens qui est impliqué — est moins fréquent à
l’intérieur de Jesudi. Néanmoins, on peut constater les mêmes types de rapports :
solidarité économique et affective — soit au quotidien, soit dans des circonstances
tragiques (deuil, maladie, faim). Le rapport le plus saillant à l’intérieur de la
communauté est celui des co-résidents ou ogasuode, des individus qui ne sont pas
des parents claniques, mais reliés par les cucherane. À l’intérieur d’une unité
résidentielle, on trouve souvent — par le biais des appartenances claniques, les
edopasade — la mise en scène de l’interdépendance de tous ses membres. Un
ogasui peut être quelqu’un d’un autre clan, quelqu’un avec qui on partage et on
échange des aliments. Les clans sont présents là aussi — à travers les appartenances
claniques — pour établir des rapports entre des Ayoreo qui ne sont pas des
igiosode.
Les Ayoreo sont membres d’un clan dès leur naissance, c'est dire que dès le
début ils sont propriétaires d’un certain nombre de choses. Les clans sont toujours
présents dans la vie quotidienne. Chez les Ayoreo, les clans sont à la base de deux
idées fondamentales : premièrement, il vaut mieux se marier hors du groupe — au
sens large et flou du terme —, avec quelqu’un d’un autre clan ; deuxièmement, sans
ces personnes externes, sans ces « autres », il est impossible de subsister.
184
�CHAPITRE V
CEUX QUI NOUS MANQUENT.
LES DISPUTES, LA MIGRATION ET LA NOSTALGIE À JESUDI
Introduction
Les gens de Jesudi ne sont pas toujours présents dans cette communauté.
Parfois, quelques Ayoreo doivent se rendre dans des fermes lointaines pour y
travailler pendant des semaines, voire des mois, parfois quelques autres ont quitté
la communauté parce qu’ils ne se sentaient plus à l’aise à Jesudi. Se sentir à l’aise
ne va pas de soi chez les Ayoreo : c’est quelque chose qu’il faut chercher, un état de
paix sociale qu’il faut maintenir. Nous avons décrit dans le chapitre précédent les
rapports entre les membres d’un même ogadi (unité résidentielle). Dans ce chapitre,
nous nous concentrerons sur les rapports entre les diverses ogadode à l’intérieur de
Jesudi. L’une des manifestations les plus claires de bons ou mauvais rapports entre
les ogadode est la stabilité de la population : la migration d’un ogadi est le dernier
chapitre d’une histoire de tensions personnelles.
Nous voulons montrer que la migration est un dispositif qui permet aux
Ayoreo de résoudre les problèmes posés par des tensions entre des unités
résidentielles. Ce mécanisme donne naissance à de nouvelles communautés quand il
implique des ogadode. Mais ce n’est pas le seul cas. Nous trouvons aussi un type de
migration plus fréquente, mais moins visible en termes d’organisation de la société
ayoreo : celle des individus. Des individus se déplacent très souvent entre les
communautés ou entre des fermes mennonites. Dans plusieurs cas, ces migrations
individuelles sont dues à des disputes à l’intérieur d’une famille ou d’un couple.
Nous verrons que ce type de migration permet de mettre en scène quelques traits
majeurs de la vie sociale ayoreo : les réverbérations d’un lien coupé. Dans la
situation où une personne est partie et une autre ressent son absence, plusieurs
niveaux s’entrecroisent, d’ordres affectif, social, économique et même physique.
Nous verrons que la nostalgie est un trait identitaire des Ayoreo et que la tristesse et
185
�l’affaiblissement corporel ne sont pas des états distincts. De plus, le concept de
santé implique l’accomplissement des rôles attendus et la participation active à la
vie sociale.
Premièrement, nous montrerons qu’à Jesudi se produit effectivement ce que
Bugos (1985) appelle « l’endogamie de village » : la plupart des membres de la
deuxième génération se sont mariés avec quelqu’un de la communauté.
Deuxièmement, nous nous concentrerons sur les gens qui quittent Jesudi. D’abord
les cas qui provoquent des scissions, puis la création de nouvelles communautés.
Ensuite les couples qui ne provoquent pas l’établissement d’une communauté mais
qui sont à la base de la tension ou de la tranquillité quotidienne. Jnumi, la femme
— ou la mère — du chef, exerce une influence directe sur les couples, elle gère
ainsi la vie sociale de Jesudi. Nous montrerons comment les problèmes concernant
les couples permettent la mise en scène des idées clefs de la convivialité ayoreo 136.
Cela nous permettra d’aborder des concepts qui portent simultanément sur le social,
l’affectif et l’économique. Nous verrons que tous ces niveaux se rendent explicites
dans la vie quotidienne.
V.1. Les gens qui sont restés à Jesudi
Nous pouvons distinguer trois générations dans la population de Jesudi. Les
membres de la première génération de Jesudi sont nés dans la forêt, quand leurs
bandes respectives n’avaient pas encore établi de contact avec le Blanc. La sortie
des Ayoreo de la forêt a été un processus lent et intermittent. Tantôt, ils retournaient
136
OVERING et PASSES (2000 : xiii-xiv) définissent le terme « conviviality » assez vaguement. L'idée de
conviviality serait assez proche de convivir — « vivre ensemble » — et de convivencia — « une vie
partagée » — en espagnol. Ces auteurs signalent une série de traits de la conviviality qui seraient les
fondements de la vie en société. OVERING (2003) rejette la perspective selon laquelle les sociétés des
basses terres sud-américaines seraient fondées sur des règles strictes (ce qu'elle appelle « notion juridique
de société ») et propose une alternative : l'ordre social s'instaurerait à partir du renforcement de certains
comportements et la condamnation morale d'autres. Cette perspective met en relief tout ce qui concerne la
vie à l'intérieur d'une communauté, surtout les rapports de consanguinités dans l'espace domestique.
Ainsi, la générosité et la tranquillité seraient des vertus valorisées, l'accumulation et la rage ses
contreparties négatives. Dans le cadre de cette recherche, nous utilisons le terme « convivialité » dans le
sens d’un état de paix sociale consciemment recherché. Même si cette paix sociale n'est pas nommée per
se, les comportements qui en sont les fondements sont explicitement décrits et mis en valeur par les
Ayoreo.
186
�dans la forêt à la suite d’une dispute à la mission, ou bien ils allaient chercher leurs
parents pour les convaincre de sortir de la forêt et de profiter des avantages du
monde des Blancs. Comme la plupart des individus de cette génération sont allés
habiter chez les Salésiens, ils sont nommés paibasadegosode (« ceux qui habitent
chez les prêtres »). Cela ne les empêche pas de se présenter aussi comme
garaigosode (« gens de la campagne ») ou guidaigosode (« gens du village »), des
noms de bandes d’Ayoreo. Ces individus avaient entre 7 et 25 ans au moment du
contact. Ils gardent beaucoup de souvenirs de la vie dans le monte : des fruits qu’ils
ne mangent plus, des formules de guérison qui ne sont presque plus jamais utilisées
et des raids guerriers auxquels ils ne participent plus. Ils se souviennent très bien
des batailles, des aventures des chamans et des chansons, toutefois il a été très
difficile de retracer leurs ancêtres pour former une généalogie. Même s’ils se
consultaient, nous n’avons obtenu que des résultats très maigres : il nous a été
impossible d’aller au-delà des noms des parents. Cela nous a donc empêché de
savoir si les individus de cette génération avaient des rapports généalogiques.
Comme nous l’avons déjà signalé, d’après les données de Bugos en Bolivie (1985 :
207), le mariage entre personnes liées généalogiquement n’est pas fréquent : dans
une étude, sur 312 unions enregistrées où l’on connaissait les quatre grands-parents
de chaque conjoint, il y avait seulement 47 couples avec un rapport d’un certain
degré.
Les individus de cette première génération de Jesudi étaient éparpillés au
moment de rencontrer leur futurs conjoints : quelques-uns dans la mission des
Salésiens María Auxiliadora, quelques autres à Loma Plata, d’autres encore dans
des missions des New Tribes Missions (voir carte dans le chapitre I). Tous ces
couples se sont réunis au moment d’aller dans le nouveau territoire obtenu auprès
de l’Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) par Ebedu Dosapei et Usigai
Chiquenoi. La plupart de leurs enfants n’avaient pas plus de dix ans quand ils se
sont établis à Jesudi en septembre 1989. Ces enfants constituent la deuxième
génération.
187
�La deuxième génération est constituée par ceux qui ont passé la plus grande
partie de leur enfance et de leur adolescence à Jesudi, et qui se sont mariés à
l’intérieur de cette communauté. Des 27 couples formés par des individus de cette
génération, dans 8 seulement on peut trouver un conjoint venu de l’extérieur. Dans
le reste des cas, il s’agit d’un couple formé par deux individus résidant à Jesudi.
Cela met en évidence une préférence pour les individus proches — de la même
communauté — au moment de former un couple. De plus, si on enlève de
l’équation les couples de Rafaela et Segundo, et d’Esoi et Mercedes (venus de la
communauté d’Ebetogue en 2000) et si on prend en compte 4 couples temporaires
qui n’ont pas eu d’enfant entre résidents de Jesudi137 , la préférence pour les
individus de la même communauté est encore plus marquée.
Parler des motifs que chaque individu peut avoir au moment de choisir son
conjoint à l’intérieur de la communauté s’avère difficile. Nous pouvons cependant
rappeler ce que Bugos (1985 : 152) avait signalé : l’homme essaie généralement de
se marier dans la même communauté pour ne pas s’éloigner de ses parents, même
s’il est obligé de déménager dans l’unité résidentielle de son épouse. Cela donne
lieu à une espèce d’« endogamie de village ». Il est possible, par contre, de décrire
les conséquences observables de ce type de mariage.
D’abord, il se trouve que les trois — et même quatre — générations de
Jesudi habitent dans la même communauté. Les enfants et adolescents de la
troisième génération ont littéralement tous les membres de leur parentèle à portée
de vue. C’est un détail qui nous avait frappé lors de notre arrivée à Jesudi : un petit
bébé avait ses quatre grands-parents avec lui, et tous ses oncles et tantes dans un
espace où les maisons les plus éloignées ne se trouvaient pas à plus de 150 m. Ils
étaient en contact pratiquement tout le temps : du matin au soir, les divers groupes
étaient réunis. Ce rassemblement des générations permet que les grands-parents
s’occupent de leurs petits-enfants. Plus spécifiquement, ce sont les grands-mères
qui sont chargées, dans la plupart des cas, de les élever. Nous pourrions penser que
ces facteurs contribuent à donner une forte cohésion à la communauté. En fait, nous
137
Iba et Cona, Eduardabi et Dajei, Pojnangue et Elado, Tamocoi et Mese.
188
�verrons que l’unité non seulement résidentielle et économique, mais aussi affective,
est l’ogadi, et pas la communauté.
Les petites maisons de Jesudi sont habitées par des familles étendues dont la
conformation est variable. Il est important de remarquer que ces maisons restent
vides pendant toute la journée. Même en hiver les habitants restent dehors, sous le
porche, mal protégés du vent froid du sud par un mur improvisé de nylon, près du
feu toujours allumé. C’est dans cet espace en dehors de la maison que la vie sociale
se déroule. C’est là où ils mangent, où les femmes tissent des sacs en caraguata, où
ils boivent du tereré et chantent autour du feu. Ces espaces sont reconnus par les
Ayoreo comme ogadi (pl. ogadode). De ce mot est dérivé ogasui (pl. ogasuode)
(Bórmida et Califano 1978 : 93) qui désigne les personnes qui y habitent. L’ogadi
est une unité économique : à l’intérieur, la nourriture obtenue est redistribuée et les
biens sont partagés. C’est aussi un cercle de confiance : on parle des autres
ogadode ou de leurs membres — parfois ce sont des commentaires inoffensifs, mais
le plus souvent il s’agit de commérages. Ce sont les raisons pour lesquelles un
ogadi est aussi une unité politique : dans ces conversations à propos des autres
unités résidentielles, les discordes s’intensifient parfois.
À Jesudi, des conflits de divers degrés d’intensité peuvent toujours surgir
entre individus et entre unités résidentielles. Parfois, ces conflits peuvent entraîner
des conséquences indésirables mais bien connues : la migration de quelques
habitants de Jesudi. En effet, la migration de quelques familles et la fondation de
nouvelles communautés n’est pas un phénomène inconnu pour les Ayoreo de Jesudi.
En 1989, cette petite communauté s’est établie à 70 km au nord de Filadelfia. En
2011, il y avait quatre autres communautés issues de Jesudi formées à cause des
disputes internes : Ogasui, 10 de Febrero, 2 de Enero et 15 de Septiembre.
189
�V.2. Les gens qui ont quitté Jesudi
Le recours à la migration, qui permet de détendre des tensions parfois
intenses, est utilisé à Jesudi. Fischermann (1988 : 66) avait déjà remarqué que,
même dans des conditions de sédentarisation dans les missions, la mobilité
persistait dans les pratiques des familles qui allaient vivre — provisoirement ou
définitivement — dans une autre communauté. La migration se présente à Jesudi
sous deux formes ou niveaux : des individus ou bien des familles étendues décident
de partir.
Dans le premier cas, celui des individus qui partent, il s’agit de disputes à
l’intérieur d’un couple : un homme trompé ou une femme qui en a assez de son
mari peuvent quitter la communauté. Suite à une discussion, l’un des deux
conjoints prend ses affaires, quelques enfants, et s’en va dans une autre
communauté où il a des parents ou des amis qui peuvent l’accueillir. Nous y
reviendrons.
Dans le deuxième cas, il s’agit d’unités résidentielles qui se détachent de
Jesudi. En fait, il s’agit plutôt d’hommes avec une forte personnalité et de grandes
ambitions politiques — en un mot, des leaders — qui sont capables de mobiliser
leur famille étendue dans sa totalité et d’établir une nouvelle communauté. Ce sujet
a été largement traité dans la littérature anthropologique des basses terres sudaméricaines138. Nous nous concentrerons spécifiquement sur les déplacements qui
138
Le sujet de la mobilité et les déplacements des groupes dans les basses terres sud-américaines est un
domaine complexe qui a été analysé par des spécialistes en écologie humaine, en ethnoécologie et en
ethnobotanique (cf. ALEXIADES 2013). Dans ce domaine, il y a un grand nombre de catégories qui
décrivent des phénomènes divers, telles que « migration », « mobility », « foraging », « trekking », etc.
Dans ce chapitre, nous utilisons le terme « migration » pour désigner une série de comportements que
nous considérons enchaînés, qui forment une unité. Ainsi, nous incluons dans cette catégorie les
déplacements individuels de courte durée — quelques jours — et les déplacements collectifs et définitifs
qui peuvent donner naissance à une nouvelle communauté. Notre intention est de montrer que le même
type de facteurs est mis en jeu dans les divers niveaux — un individu, un couple, une famille étendue —
de déplacement.
Nous avons signalé, dans le chapitre I, que les Ayoreo pratiquaient une vie semi-nomade avec
des déplacements pendant la saison sèche. Nous n'étudierons pas ce genre de déplacement, mais ceux que
nous avons observé lors de notre enquête ethnographique (2008-2011) et ceux dont ils nous ont parlé —
après leur établissement à la mission María Auxiliadora. Notre intention n’est pas de mettre en relation les
déplacements avant le contact avec ceux décrits dans ce chapitre, ni de suggérer un quelconque
parallélisme. Une telle recherche impliquerait une analyse de l'environnement au XXe siècle, de
l'établissement des mennonites, des conséquences de la Guerre du Chaco, et un approfondissement de
l'histoire orale ayoreo, ce qui dépasse largement le but de ce chapitre.
190
�permettent d'alléger les tensions générées entre divers individus d'une communauté,
autrement dit, les migrations qui suivent une dispute. Selon Santos Granero (2000 :
123), parmi les causes de disputes qui déclenchent une scission, les plus habituelles
concernent la concurrence de plusieurs hommes pour une même femme, les
accusations de sorcellerie et les disputes politiques avec les chefs.
En ce qui concerne les disputes pour les femmes, nous n’avons pas été
témoin de cas de cette nature à Jesudi. En fait, nous avons plutôt observé le
contraire : des femmes se sont disputées pour un homme139 — sans que cette affaire
provoque la scission de la communauté. Quant aux accusations d'attaque
chamanique, dans les rares cas dont les Ayoreo ont parlé, les gens de Jesudi
n’étaient jamais impliqués. Nous avons vu dans la première partie que le malfaiteur
était un chaman angaité — dont les deux victimes ont d’ailleurs été guéries. C’est
de la troisième cause à l’origine des scissions que nous connaissons le plus en
détails. Il s’agit de disputes pour le pouvoir entre un chef et d’autres qui veulent
pendre sa place. Mais auparavant, il faut aborder la question du leadership ayoreo.
Nous verrons d’abord le leadership selon les ethnographies des années 1970,
puis nous nous concentrerons sur nos observations à Jesudi. D’après la littérature
ethnographique du groupe, le pouvoir n’était pas concentré exclusivement chez une
seule personne. Il y avait, en fait, plusieurs hommes qui prenaient des décisions
dans des situations spécifiques. Le rang reconnu était celui d’asute (pl. asutedie),
celui qui avait tué une personne ou un jaguar, pouvait être considéré comme un
chef. Cette prouesse lui donnait le droit de porter l’ayoi¸ le chapeau de peau de
jaguar. Les asutedie ou les dacasutedie — grands chefs — étaient auparavant les
leaders politiques, à l’époque où les batailles avec d’autres bandes ou groupes et les
expéditions guerrières n’étaient pas inhabituelles.
139
Pojnangue Dosapé, pendant que son mari Tercio Chiquenoi travaillait dans une ferme lointaine
pour trois mois, a eu des relations avec un autre homme qui était marié, Elado Chiquenoi.
Concepción — l’épouse d’Elado — a essayé de frapper Pojnangue à cause de sa relation avec son
mari (ils étaient tous à un match de football à 10 de Febrero. Rosa — Pojnangue — et Elado sont
repartis et sont rentrés ensemble à Jesudi. Quelques semaines après, ayant terminé son travail, Tercio
est rentré, à son tour, à Jesudi. Cependant, Je n’ai jamais entendu de commentaires ni vu de disputes
entre ces deux hommes, même si Pojnangue accompagnait alternativement l’un et l’autre.
191
�Selon Bórmida et Califano (1978) deux rôles donnent du pouvoir : celui du
guerrier asute et celui du chaman naijnai140. Les deux sont chargés de protéger le
groupe contre des menaces extérieures. Selon l’analyse de ces auteurs, l’asute est
situé plus haut dans la hiérarchie que le chaman car il dispose de son courage à tout
moment, alors que le naijnai ne peut utiliser son pouvoir ujopie que pendant la
transe induite par le tabac. Bormida y Califano signalent aussi que le nombre
d’asutedie dans un groupe est variable (en tout cas, la plupart des hommes
acquièrent cet état). Les asutedie étaient surtout chargés de diriger les raids
guerriers, mais ils exerçaient aussi une certaine influence sur les décisions du
groupe. Les Ayoreo nous ont parlé d’Uejai Picanerai — le grand leader qui, dans les
années 1950-1960, avait uni presque toutes les bandes du Sud contre les
Direquedejnai-gosode en Bolivie (Fischermann 1988 : 75) — comme étant
yoquipresidente (« notre président »). Le cas d’Uejai est certainement très
particulier : il était non seulement un dacasute (« grand asute »), mais aussi un
naijnai très puissant.
Sebag (1965b), pour sa part, souligne l’absence d’un pouvoir établi : le chef
doit tout le temps fournir des preuves de son courage et de sa capacité à prendre les
décisions appropriées. À partir du moment où il n’est plus le plus courageux des
guerriers, son pouvoir se voit affaibli, les gens ne lui font pas autant confiance
qu’avant. Ce statut, de par sa nature performative et transitoire, n’est logiquement
pas héréditaire. À tout moment, quiconque peut le remettre en question.
D’après Fischermann (1988), même si plusieurs hommes étaient reconnus
comme dacasute — et c’était souvent le cas —, l’un d’eux était réputé avoir plus de
pouvoir que les autres. Ce chef devait démontrer sa supériorité par rapport au reste
des hommes, non seulement en mettant en avant ses qualités, sa férocité lors des
batailles notamment, mais aussi en se plaçant toujours à la tête du groupe. Les
Ayoreo disaient : « il doit souffrir le premier, lutter le premier. Si quelqu’un est
mordu par un serpent, il doit se faire mordre aussi. Si quelqu’un est blessé ou brûlé,
il doit aussi se blesser ou se brûler » (Fischermann 1988 : 77). Cet auteur signale
140
Daihsnái, selon la graphie de ces auteurs.
192
�aussi que le rôle du dacasute était moins saillant en temps de paix. En ce qui
concerne la succession, Fischermann nous présente un panorama différent de celui
de Sebag. Selon le premier, quand un chef décédait, sa place était prise par celui qui
le suivait dans la hiérarchie, ou bien par celui qui pouvait s’imposer. Fischermann
ajoute que si des enfants vivants remplissaient les conditions, l’un d’eux était choisi
pour occuper le poste de son père141 .
D’après le contexte que nous avons observé, quelques divergences se
présentent 142. D’abord, les chamans sont pour la plupart retraités et ils n’exercent
plus l’influence d’autrefois. Dans la partie paraguayenne du territoire ayoreo, les
chamans sont beaucoup moins nombreux qu’avant et, à vrai dire, ils n’exercent plus
leur métier. Le contexte actuel n’est pas celui des guerres et du nomadisme. La
situation actuelle ressemble plus à ce que Fischermann décrit en temps de paix.
Dans ce contexte, les aptitudes de guerrier ne sont pas tellement importantes. Il n’y
a pas plusieurs chefs mais un seul, le cacique. Son poste n’est pas transitoire
comme Sebag nous le décrivait : son nom est inscrit dans un document de
l’Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) qui attribue la propriété collective de la
terre à la comunidad (« communauté »).
Les concepts de « cacique » — utilisé en espagnol par les Ayoreo — et de
« comunidad » font partie d’une structure qui a été imposée par l’État paraguayen.
Il y a certainement, comme nous l’avons déjà signalé, une idée sous-jacente du
« bon sauvage » dans cette conception du pouvoir. La terre est octroyée aux Ayoreo
mais sous forme de propriété collective. Aucun individu ne peut vendre une
parcelle du territoire : tout appartient à la comunidad. Ce cliché est utilisé par les
Ayoreo au moment de demander de l’aide à l’État : c’est le cacique qui, en
représentant tous les individus de sa communauté, proposera un projet bénéfique
141
Cette tendance, nous signale l’auteur, était présente chez les Direquedejnaigosode plutôt que chez
les Cochocoigosode ou les Jnupedogosode. Toutes les trois sont des bandes du côté bolivien.
142
L'analyse du leadership ayoreo, imbriqué dans le complexe réseau social de fonctionnaires de l'État, de
représentants d’ONG et de mennonites, mérite un traitement plus détaillé que le nôtre (cf. FISCHERMANN
2008). Sur le leadership dans le Grand Chaco cf. l'intéressante œuvre éditée par BRAUNSTEIN et
MEICHTRY (2008).
193
�pour tout ce collectif amorphe et solidaire, reflet inversé de l’individualisme
occidental.
Les tâches du cacique ne se rapportent pas à la guerre, mais consistent à
faire des requêtes auprès de l’État pour améliorer les conditions de vie
(l’approvisionnement en eau, des services de santé) et pour attirer les ONG et l’État
afin qu’ils mettent en place des proyectos. Selon Toto Etacori, âgé de plus de 70 ans
et qui connaissait bien les leaders d’autrefois, les caciques doivent avant tout parler
couramment espagnol pour mener à bien toutes ces démarches. Ils sont chargés
aussi de veiller sur la paix de la communauté, surtout par rapport aux visiteurs
paraguayens. Ebedu Dosapei, par exemple, ne permettait pas l’exercice de la
prostitution à Jesudi143, ce qui obligeait les Blancs — souvent ivres — à chercher ce
« service » dans d’autres communautés.
Cette forme d’exercice du pouvoir est en fait très différente de celle de
quelques asutedie qui sont chargés de situations spécifiques à divers moments. Le
pouvoir est maintenant centralisé dans les mains d’une seule personne. Toutes les
actions, quelle que soit leur nature, doivent passer par lui : négociations avec les
mennonites sur le prix du charbon, demandes d’aides alimentaires à travers la
presse, réclamation d’essence pour le tracteur à la municipalité de Filadelfia,
obligation faite au professeur de donner des cours, etc. Il ne s’occupe plus
exclusivement des tâches pour lesquelles il est le mieux préparé, il doit toutes les
accomplir. De plus, il supporte tout le poids de la communauté : en raison de cette
conception collectiviste de la vie indigène venue des acteurs extérieurs, le cacique
doit générer des projets, trouver des financements, attirer des promesses politiques
qui bénéficient la communauté entière. Au moment de faire une réclamation auprès
de l’État ou des mennonites, c’est lui qui doit se mettre en représentation — après
avoir entendu les plaintes de ses concitoyens. Quand il reçoit des dons, il est
également obligé de les redistribuer immédiatement et équitablement car le soupçon
d’accaparement est toujours présent. Cette centralisation du pouvoir s’étend aussi
dans le temps : il n’y a pas d’élections, le poste est presque permanent. La stratégie
143
Sur la prostitution chez les Ayoreo, cf. P. CANOVA (2012).
194
�rhétorique du cacique qui demande de l’aide pour la partager avec toute sa
comunidad produit sans doute de bons résultats : de temps en temps, à Asunción,
les politiciens déclarent l’état d’urgence au Chaco — dû parfois à la sécheresse,
parfois à la pauvreté générale — et des tonnes d’aliments arrivent dans des camions
de l’armée ou du gouvernement de Boquerón. Mais, malgré ces avantages, ce
système est sensible aux scissions : un homme en désaccord avec les décisions du
cacique peut poser des problèmes. Si cet homme a les capacités de gestion
suffisantes, il peut partir avec sa famille —même ses fils mariés — et essayer
d’établir une nouvelle communauté. Plutôt que de devenir le chef de la
communauté où l’on habite — ce qui impliquerait que le chef actuel quitte son
poste —, il est plus simple d’être le premier chef d’une nouvelle communauté.
V.3. Les communautés issues de Jesudi
Une première fragmentation de Jesudi s’est produite quelques années après
sa fondation. Selon les versions des gens de Jesudi, Usigai — l’un des deux
gestionnaires du territoire — avait volé l’argent d’un proyecto (« tagu daplatadie »,
« il avait mangé l’argent »). Ces accusations144 l’ont finalement poussé à partir,
accompagné de sa famille. Il a fondé la communauté Ogasui — ou bien Km 32 —
située à dix kilomètres au nord de Jesudi. Un an après, Usigai a dû une deuxième
fois quitter la communauté, à cause de nouvelles disputes. Il en a alors fondé une
troisième, celle de 10 de Febrero, à un kilomètre au nord d’Ogasui.
V.3.1. La dispute pour Jesudi
En mars 2009, Ebedu Dosapei, le cacique de Jesudi, est tombé gravement
malade d’un cancer du cerveau. Il a dû suivre un long traitement à Capiatá, à plus
144
Plusieurs personnes de Jesudi me l’ont raconté, avec des divergences quant à la somme impliquée
(de 2 000 à 200 000 dollars américains)
195
�de 400 km de Jesudi. Il est rentré dans sa communauté en juin, mais son état ne lui
permettait plus d’assurer ses fonctions de chef.
Cela a posé le problème, dès le début de sa maladie, de savoir qui se
chargerait d’administrer les destinées de Jesudi. Pendant tout le mois de mars et une
partie d’avril, la plupart des Ayoreo de Jesudi — et beaucoup d’autres Indiens du
Chaco — sont restés à Asunción et aux alentours pour demander le changement du
196
�président de l’Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Baco Dosapei — fils
d’Ebedu —, affirme avoir entendu Sijnai Chiquenoi dire qu’il voulait qu’Ebedu
meure, pour devenir ainsi le chef de Jesudi. Baco a réagi et s’est disputé avec Sijnai
tout de suite. Je n’ai pas été témoin de cette scène qui s’est passée à Asunción, elle
m’a été racontée par Tamocoi Dosapei et confirmée par Baco et Jnumi Posijñoro 145.
Les tensions avec Sijnai, qui existaient depuis toujours, ont fini avec
l’établissement d’une nouvelle communauté, 2 de Enero, gérée par lui et habitée par
ses fils mariés et ses petits-enfants.
Le comportement de Sijnai ne m’a pas du tout étonné. C’était même quelque
chose à quoi je m’attendais — et les Ayoreo aussi. Au cours des premiers mois à
Jesudi, je me suis « situé » dans la communauté. C'est-à-dire que je suis devenu
conscient de ma position dans le réseau social de Jesudi, attaché à l’ogadi des
Dosapei. Peu après mon arrivée, on m’a parlé de Sijnai : c’était quelqu’un dont il
valait mieux se méfier146 . Selon les versions que j’ai entendues, Sijnai — ainsi que
sa famille — avait déjà résidé dans plusieurs communautés qu’il avait dû quitter à
cause de disputes avec d’autres Ayoreo. D’après le titre de propriété de Jesudi,
Sijnai a été pendant une brève période chef de Jesudi, mais ce poste a été
officiellement rendu tout de suite à Ebedu. La rumeur selon laquelle il voulait
devenir le cacique de Jesudi était souvent entendue mais — je dois le souligner —
toujours dans l’ogadi des Dosapei, à la tête duquel était Ebedu.
Même si je n’ai pas entendu cette expression de Sijnai « prendre le pouvoir
une fois Ebedu décédé », les événements qui suivirent ont confirmé cette idée.
Pendant tout le temps où Ebedu est resté à Capiatá pour suivre son traitement —
chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie —, il y a eu des tensions à Jesudi entre
Tamocoi et Puchiejna Dosapei, les fils qui pouvaient le remplacer. Grâce à une
assemblée — pimatapidi — organisée par les hommes âgés, ils se sont réconciliés.
145
En fait, elle a été confirmée par beaucoup de gens. Cette phrase de Sijnai a été un sujet de vives
conversations dans les jours qui suivirent.
146
Même Nito, un ami paraguayen qui m’a présenté à Jesudi, m’avait parlé de lui lors d’une visite
qu’il avait faite à la communauté. Selon Nito, Sijnai revendait des dons qu’il — ou l’INDI — lui
avait donnés à Asunción pour Jesudi.
197
�Finalement, Puchiejna Dosapei est devenu en 2009 le nouveau cacique de Jesudi, et
Roberto Posorajãi — fils de Bajai —, le deuxième en rang.
En juin 2009, Ebedu est rentré à Jesudi mais il n’en était plus le chef : il était
assez affaibli et devait continuer sa chimiothérapie. Les tensions entre les gens de
Jesudi — surtout l’ogadi des Dosapei — et Sijnai s’étaient accentuées. Sijnai avait
quitté la communauté mais il insistait avec l’idée d’être le cacique de Jesudi. Il
s’était établi avec son épouse à sept kilomètres au nord de Jesudi, non loin des
fermes mennonites où ses fils travaillaient.
À la demande des Ayoreo, j’ai rédigé en espagnol une lettre — à vrai dire,
j’ai transcrit leurs mots — qui était destinée au patron mennonite. Ils lui disaient
que Sijnai n’avait pas le droit de s’établir là et lui demandaient de le convaincre de
s’en aller. J’acceptais de les aider avec l’écriture mais je ne voulais pas leur donner
de conseils. J’ai essayé de garder leur expression exacte même si j’ai dû modifier
les phrases pour qu’elles soient compréhensibles pour un hispanophone. J’ai lu la
lettre à haute voix plus d’une fois et j’ai indiqué clairement que ces mots
appartenaient aux Ayoreo, et que je les avais seulement transcrits.
Quelques jours plus tard, j’ai dû me rendre à Filadelfia pour chercher des
provisions. Sijnai m’a vu et il est venu me menacer : il m’a dit qu’il était le
fondateur de Jesudi, que les autres mentaient et que si je n’arrêtais pas de faire des
lettres, il parlerait avec un avocat à Asunción. Je lui ai répété ce que j’avais dit aux
Dosapei à Jesudi : ces mots appartiennent aux Dosapei, mon travail avait tout
simplement consisté à les transcrire. Le soir, quand je suis rentré à Jesudi, j’ai parlé
de ma rencontre avec Sijnai et j’ai répété exactement le dialogue. Jnumi et les
autres ont dit que c’étaient de très bons mots que j’avais dits — alors que j’avais
l’impression de m’en être lavé les mains. Des rencontres et des menaces de ce type
ont continué pendant quelques semaines : Jnumi a rencontré Sijnai à Filadelfia et
lui a dit qu’elle n’avait pas peur de lui ; une voix non identifiée a téléphoné à Jesudi
et a dit : « papá gajneque Jesudi » (« Jesudi appartient à papa ») ; d’autres
événements du même genre ont perturbé la vie de Jesudi. Les tensions se sont
198
�atténuées peu à peu : Sijnai est finalement resté à sept kilomètres au nord et n’a
plus cherché à devenir le chef de Jesudi. L’inimitié avec lui persiste, cependant ses
fils rendent visite à Jesudi de temps en temps. La communauté de Sijnai a reçu le
nom de 2 de Enero.
Nous pouvons observer ici qu’à deux reprises les Ayoreo se mettent en
contact avec des agents externes pour résoudre ces conflits : les Dosapei écrivent
une lettre au patron mennonite et Sijnai menace d’appeler un avocat. Dans les deux
cas, nous pouvons remarquer l’importance nouvelle de l’écriture : « nous avons le
papier de l’INDI » soulignait Tamocoi, alors que Sijnai déclarait avoir un vieux
titre de propriété de Jesudi sur lequel on pouvait lire qu’il en était le fondateur.
Toute cette histoire nous permet de voir comment cette stratégie atteint l’objectif de
détendre les tensions, mêmes avec des personnages qui génèrent assez souvent des
conflits comme Sijnai. Les menaces, les soupçons, les commérages étaient
constants quand il habitait à Jesudi. Il voulait depuis toujours prendre le pouvoir.
La possibilité d’avoir sa propre communauté a finalement été un avantage pour tout
le monde. Ainsi, Sijnai peut demander des aides de l’État, développer les business
qu’il veut (il voyage jusqu’à la capitale pour vendre des produits artisanaux), bref
gérer le pouvoir tout seul. Les gens de Jesudi — surtout les Dosapei — n’ont plus
besoin d’être toujours sur leurs gardes. Aucune stratégie n’a jamais été mise en
place pour convaincre Sijnai de rester à Jesudi : les Dosapei —la famille la plus
influente de la communauté — préféraient qu’il s’en aille. Mais la migration n’est
pas exclusivement due à des raisons négatives comme dans ce cas. Elle peut aussi
être une stratégie pour disposer de plus de ressources, comme l’exemple de la
communauté 15 de Septiembre nous permettra de le voir.
V.3.2. 15 de Septiembre
Les scissions de Jesudi n’ont pas pris fin avec le déménagement de Sijnai et
de ses fils à 2 de Enero. Roberto Posorajãi — qui était le deuxième en rang après
Puchiejna — était allé travailler dans une ferme près de Mariscal Estigarribia en
199
�2010. Il s’est donc absenté de la scène politique pendant des mois. Puchiejna
Dosapei était alors le cacique de Jesudi, mais son frère aîné Tamocoi avait de bons
contacts parmi les patrons des fermes de la région et pouvait proposer des projets
économiques. Tamocoi et Puchiejna sont tous les deux d’un tempérament assez fort,
ce qui provoquait assez souvent des disputes concernant l’utilisation du tracteur ou
la gestion des ressources en général.
Les tensions continuaient, à tel point qu’ils ont décidé qu’il serait mieux de
migrer : Puchiejna établirait une nouvelle communauté. En mars 2010, Puchiejna et
sa famille, l’ogadi de Sidi, Uguri Dosapei, Ugoi Étacori et la famille du frère de
Poro (épouse de Sidi) se sont établis à six kilomètres au nord de Jesudi. Ils ont
nommé cette nouvelle communauté 15 de Septiembre en l’honneur de la date de
fondation de Jesudi. Alors, Baco Dosapei — le troisième frère — est devenu le chef
de Jesudi.
Les motifs pour fonder cette nouvelle communauté sont doubles : d’un côté,
cela a permis d’alléger les tensions entre les deux frères ; de l’autre, c’était une
stratégie pour recevoir plus d’aides de la part de l’État. Comme nous l’avons
remarqué à plusieurs reprises, l’État paraguayen vacille entre l’abandon des
indigènes et des actions aussi ponctuelles que paternalistes. Grâce à cette migration,
ce sont deux communautés qui demandent des aides de l’État et qui ensuite les
gèrent ensemble. Après s’être établi dans le nouvel endroit, Puchiejna a réussi à
obtenir du gouvernement plusieurs aides : la construction d’un système de
récupération des eaux de pluie, un réservoir d’eau, des feuilles de métal, un permis
pour produire du charbon de bois, entre autres. Les deux communautés ont de bons
rapports et partagent les ressources telles que le tracteur et les proyectos. Les
habitants des deux communautés se rendent visite assez souvent147.
La création de 15 de Septiembre nous permet de voir que la migration et la
fondation de nouvelles communautés sont des stratégies utilisées consciemment,
147
Les migrations, bien sûr, ne se sont pas arrêtées : en 2011, suite à une discussion avec Puchiejna
concernant la production de charbon, Ugoi Étacori a quitté 15 de Septiembre et s’est installé dans la
communauté d’Ijnapui, 35 km au nord de Jesudi. En 2011, la famille du frère de Poro était partie
aussi. Quant à Uguri Dosapei, il circulait régulièrement entre les deux communautés et on peut dire
qu’il appartenait aux deux.
200
�mais il faut avouer que c’est un mécanisme très rarement utilisé, seulement quand
la tension est insurmontable. D’après Santos Granero (2000), les sociétés des basses
terres sud-américaines n’ont pas d’institutions pour résoudre ce genre de
problèmes, d’où la dispersion fréquente de la population. Toutefois, une discussion
quelconque ne provoquera pas obligatoirement une scission et une nouvelle
communauté. Il faut que les personnes impliquées aient les capacités de gestion ou
la ténacité nécessaire pour qu’un tel résultat ait lieu. Les cas de Sijnai —
insupportable depuis longtemps pour les Dosapei — ou de Puchiejna et Tamocoi
— des disputes qui ne cessaient pas quand bien même leur père se trouvait face à la
mort — sont illustratifs des personnalités et des situations à l’origine de cette
stratégie. La question se pose alors de savoir ce qu’il en est des tensions
quotidiennes, toujours présentes mais pas si intenses — pas suffisamment intenses
pour déclencher une scission. Il y a certainement une disposition du pouvoir à
Jesudi qui est à l’origine de ces tensions, mais il y aussi toutes sortes de stratégies
— non institutionnalisées — qui aident à maintenir une certaine stabilité sociale.
V.4. Les pôles de pouvoir à Jesudi
V.4.1. Les Dosapei vs. l’olería
Les tensions — continues mais sans gravité — nous permettent en fait
d’observer que Jesudi n’est pas une unité politique et économique comme le
concept de comunidad — et comme les politiques de l’État et de certaines ONG qui
en dérivent — pourrait nous amener à le penser. Ces tensions sont perçues sous
forme de commérages, de critiques directes, de discussions et d'une moindre
fréquence de visites entre membres de quelques unités résidentielles particulières.
Les unités économiques et politiques sont les ogadode. À Jesudi, par leur capacité à
attirer des ressources des Blancs et à les administrer, deux unités constituent les
deux pôles de pouvoir de la communauté : l’ogadi des Dosapei et celui de Bajai.
L’ogadi des Dosapei est composé du couple formé par Ebedu Dosapei et
Jnumi Posijñoro, leur fils Tamocoi, leur fille Pojnangue, ainsi que leur famille
respective. Les familles des deux autres fils, Baco et Puchiejna, sont souvent là et
201
�participent aux réunions du soir autour du feu, aux discussions et aux
redistributions économiques. Baco habite juste à côté, dans l’ogadi de son beaupère Mimie, et Puchiejna — avant de migrer à 15 de Septiembre — de l’autre côté,
dans l’ogadi de son beau-père Sidi. Ebedu était le cacique, son fils Puchiejna lui a
succédé puis à son tour, Baco. C’est l’ogadi du chef, c’est donc avec eux, les
Dosapei, que les représentants de l’État et des ONG doivent parler pour proposer
des projets de développement, et ce sont eux qui reçoivent les dons et sont chargés
de les redistribuer dans toute la comunidad. C’est aussi avec le chef que les
politiciens doivent parler pour gérer les élections du maire de Filadelfia et du
gouverneur de Boquerón : en 2012, Baco — le cacique — avait offert une chèvre à
chaque famille afin qu’ils votent pour le candidat qu’il voulait favoriser. En
définitive, les Dosapei sont la face visible de la communauté auprès des étrangers.
L’ogadi de Bajai a aussi une ressource très importante : Bajai Posorajãi.
Bajai est cet Ayoreo kidnappé par les Paraguayens à l’âge de dix ans et exhibé
comme un animal à Asunción. Dans ces années-là, les Salésiens ont obtenu le droit
de le garder et de l’élever. Bajai a joué un rôle fondamental dans le contact avec les
Ayoreo encore dans la brousse. C’est grâce à lui que la plupart des épisodes de
premier contact avec les Ayoreo ont été pacifiques. Il est alors devenu le protégé
des Salésiens, particulièrement du prêtre Zanardini. Bajai et sa famille ont quelques
privilèges : ils peuvent, par exemple, habiter une maison qui leur est réservée —
propriété du prêtre salésien — pendant leurs séjours à Asunción. De plus, en raison
de sa grande aide lors du contact avec les Ayoreo dans les années 1960 et 1970, le
gouvernement paraguayen lui a attribué une retraite, la première accordée à un
Indien. Chaque fois que le prêtre Zanardini — devenu anthropologue — anime une
manifestation officielle à Asunción — présentation d’un livre sur les Indiens du
Chaco ou remise de prix —, il invite Bajai à y assister et à réaliser une performance
guerrière. Daisy Amarilla, une anthropologue qui a collaboré avec Zanardini, a
beaucoup travaillé avec Bajai. Quand cette chercheuse rend visite à Jesudi, elle est
logée à l’ogadi de Bajai, et leur apporte, logiquement, des provisions et achète leurs
produits artisanaux.
202
�Dans l’ogadi des Dosapei, des critiques se font entendre envers l’ogadi de
Bajai, surtout quand des visites préférentielles — Daisy Amarilla — arrivent. « Elle
doit aider toute la communauté, pas seulement eux » se plaignent-ils fréquemment,
mettant en évidence le traitement collectif auquel ils sont habitués. « Nous sommes
tous Ayoreo, et le gouvernement le paye seulement lui » disent-ils aussi, par rapport
à la retraite de Bajai. Dans l’ogadi de Bajai, il est possible d’entendre les mêmes
plaintes concernant l’ogadi des Dosapei et les aides de la part de Nito, photographe
paraguayen. Dans ce cas, il faut dire que les dons de Nito sont destinés à toute la
communauté,
mais ce sont les Dosapei qui doivent les gérer. Une fois, une
linguiste — fille de Nito — est restée deux semaines à Jesudi pour mener des
recherches sur la phonologie. Au lieu de manger à part comme lors des séjours
précédents, elle a décidé de donner ses provisions aux Dosapei et de manger avec
eux, c'est-à-dire d’être intégrée à leur ogadi. Après une semaine, Daju — l’une des
deux épouses de Bajai — est venue se plaindre : elle a dit que tout ce que cette fille
donnait devrait leur être destiné à eux aussi. Les Dosapei ont refusé, Tamocoi l’a
frappée148 et elle est repartie à son ogadi. Malgré les commérages et les épisodes
comme celui-ci, cette tension entre ces ogadi n’arrive jamais au point de provoquer
une scission. Tout compte fait, les Dosapei redistribuent assez équitablement les
dons — quoi qu’il en soit, des personnes croiront toujours avoir reçu trop peu —, et
les visites à Bajai ne sont pas tellement fréquentes — de plus, ces visiteurs font
aussi des cadeaux à d’autres familles. Les hommes et les femmes de ces deux
ogadode ont des emplois similaires — travail temporaire dans des fermes,
confection de sacs artisanaux destinés à la vente — qui ne permettent pas une
accumulation considérable d’argent. Ce sont, en tout cas, des facteurs externes
— des dons ou des proyectos — qui peuvent être à la base d’une différence
économique entre ces deux ogadode, mais ces acteurs en particulier — les Dosapei
et la famille de Bajai — n’oublient pas de redistribuer ce qu’ils obtiennent (ce qui
n’était pas le cas avec Sijnai). Même dans le cas du gibier — Bajai et Sidi sont les
deux seuls Ayoreo qui continuent à chasser régulièrement —, les morceaux de
viande voyagent d’un bout à l’autre de la communauté. Ils essayent aussi
d’équilibrer le pouvoir politique : au moment de choisir un successeur à Ebedu,
début 2009, ils ont décidé de donner ce poste à Puchiejna — moins agressif que
148
C’est la seule fois où j’ai vu un homme frapper une femme. Cependant, les Ayoreo m’ont parlé
d’autres cas.
203
�Tamocoi — et au fils aîné de Bajai, Roberto Posorajãi. Des deux plus importants
ogadi sont issus les leaders de Jesudi.
La disposition dans l’espace des ogadode est un indicateur de la distance
sociale entre leurs membres respectifs. Ainsi, nous pouvons voir aux deux
extrémités de Jesudi l’ogadi de Bajai et celui de Sidi, deux frères qui se sont
disputés quand ils habitaient à Chovoreca dans les années 1980 et qui ne
s’adressent plus la parole149 . L’ogadi des Dosapei est très lié à celui de Sidi, par le
biais de Puchiejna (marié avec la fille de Sidi) et aussi parce qu’il y a un rapport
étroit entre Jnumi et Poro, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre
précédent. De même, l’ogadi de Mimie est aussi assez présent chez les Dosapei,
surtout la famille de Baco. L’ogadi de Chicori a de bons rapports avec tous les
autres en général. De temps en temps, la famille de Rufino — de l’ogadi de
Chicori — venait le soir aux réunions autour du feu des Dosapei. En ce qui
concerne l’ogadi d’Ugui Dosapei, je pourrais dire que lui aussi avait de bons
rapports avec tous150. Quant à Inocencio et à Ugoi, je dois avouer que n’ai pas eu
beaucoup de rapports avec eux. Inocencio — le professeur — habite dans l’école.
Fréquemment, j’ai entendu des plaintes concernant Inocencio — toujours à l’ogadi
de Dosapei — parce qu’il ne donnait de cours qu’une seule fois par semaine —
voire même moins —, alors qu’il recevait un salaire de la part de l’État.
L’ogadi de Bajai est assez grand. Il a deux épouses et dix enfants. La plupart
d’entre eux sont mariés et ont des enfants : environ 33 personnes au total. Dans
l’ogadi des Dosapei, on les appelle pour plaisanter « olería » (« huilerie »), parce
qu’ils ressemblent à ces endroits où beaucoup d’Ayoreo travaillent et constituent
une sorte de communauté. Il est difficile par contre d’expliquer la localisation de
l’ogadi de Sijnai. Je pourrais dire — à partir de ce j’ai remarqué les premiers mois
du terrain — qu’il était plutôt associé à Bajai pour deux motifs. D’un côté, parce
149
D’après ce qu’ils m’ont raconté, Sidi s’est fâché au point de vouloir tuer Bajai.
150
En fait, il rendait visite à tous les ogadode tous les jours, de là son surnom de
« satelital » (« satellite ») parce qu’il « chajai iti, chajai ite… ! » (« il vient par ici, il va par
là… ! »), c'est-à-dire, il se promène partout.
204
�qu’il était toujours contre les Dosapei et, de l’autre, parce qu’il était très au courant
des ressources de Bajai et de la notoriété de son histoire.
Les maisons de briques ont été bâties grâce à un projet d’une université
canadienne en 2006. Les organisateurs du projet ont respecté les décisions des
Ayoreo concernant la localisation et l’orientation des constructions (Nito Rocha,
comm. pers.). Nous savons qu’au début il n’y avait que des maisons en bois à
Jesudi et qu’elles se trouvaient toutes à 500 m plus au sud. Nous n’avons pas fait le
recensement de l’emplacement de ces maisons ni des rapports sociaux entre les
premiers habitants de Jesudi. Cependant, la distance spatiale et la distance sociale
n’entraient pas en contradiction lors de notre enquête ethnographique. Cela nous
montre aussi que les rapports de clan n’établissent pas nécessairement de liens plus
forts : Bajai et Jnumi appartiennent au même clan, pourtant ils ne sont pas proches.
Jnumi et Poro, par contre, aiment mettre en relief leur lien de parenté clanique.
Les rapports entre les ogadode ne peuvent être réduits à une dispute pour les
ressources car on risquerait de tomber dans la simplification : ainsi présenté, tout
serait une sorte de concurrence économique. La question est plus complexe : d’un
côté, les ogadode ne sont pas des collectifs homogènes et, de l’autre, les rapports
affectifs sont aussi importants que les économiques (parfois l’un est l’expression de
l’autre). Dans les deux ogadode principaux, des personnes clefs dirigent les
opinions, imposent des idées et contribuent principalement à la prise de position de
l’unité résidentielle. Dans celui de Bajai, c’est Daju notamment —première épouse
de Bajai — qui joue ce rôle : elle fait des réclamations auprès des Dosapei,
demande des aides aux étrangers et suscite des conversations spécifiques autour du
feu. Dans le cas de Dosapei, il est clair que Puchiejna et Tamocoi ont une forte
présence, mais une autre personne a également une influence puissante : Jnumi
Posijñoro, la femme du chef.
V.4.2. La femme du chef
Jesudi est un réseau de relations où Jnumi Posijñoro joue le rôle d’une
architecte cachée. Elle est en fait une médiatrice de ces rapports car elle gère les
205
�fils de cette trame humaine. Sans être une figure visible, elle exerce son influence
sur beaucoup des questions qui sont à la base de la convivialité de cette
communauté.
Nous avons montré tout à l’heure que les ogadode des Dosapei et de Bajai
sont deux unités importantes à Jesudi et qu’il existe toujours une certaine tension,
une rivalité pas toujours explicite. Comme j’étais plutôt attaché aux Dosapei, je
n’allais pas très souvent à l’olería (l’ogadi de Bajai). Néanmoins, j’y allais de
temps en temps : Bajai aimait me raconter des histoires et j’aimais les écouter.
Quelquefois, quand Jnumi me voyait aller chez Bajai, elle venait avec moi. Elle
restait chez la famille de Bajai et tissait les sacs de caraguatá avec les épouses et
les filles du premier Ayoreo capturé par les Blancs. Jnumi m’a dit qu’elle avait
l’habitude d’aller chez eux de temps en temps. Cela permettait — Jnumi le savait
bien — de maintenir un rapport amical entre ces deux familles étendues. Jnumi
allait en fait dans d’autres ogadode — notamment dans celui de Mimie et de Sidi —
beaucoup plus fréquemment. Dans ces derniers cas, elle y allait souvent
accompagnée de sa fille ou de ses petites-filles. Les autres membres de l’ogadi des
Dosapei visitaient rarement l’olería.
Jnumi est aussi une médiatrice entre Jesudi et les agents externes à la
communauté, soit pour utiliser des ressources nécessaires — par exemple, les
services de santé —, soit pour empêcher l’entrée d’influences nocives. Si un
problème grave arrive, c’est elle qui gère les ressources pour trouver une solution.
Voyons un exemple. Caitabia Picanerai — une épouse de Bajai — est tombée
malade : elle avait la diarrhée et ne mangeait plus. Caitabia se sentait très faible :
« a yitoi jne » (« je vais mourir »), disait-elle. Jnumi est allée la voir et elle s’est
assise à côté de son lit. Elle l’a consolée et lui a promis de faire venir une
ambulance depuis Mariscal Estigarribia. Jnumi ne parle pas bien espagnol, elle ne
sait pas utiliser un portable, mais elle peut se débrouiller pour résoudre un
problème. Une nuit de 2011, un arrière-petit-fils de Jnumi, adopté par Daniela —
épouse de Baco — a eu une fièvre très forte. Baco, âgé de 30 ans, est venu réveiller
sa mère pour qu’elle résolve la situation. Elle a fait trouver un portable avec du
forfait, elle a demandé à Tamocoi — qui parle assez bien espagnol — d’appeler
206
�l’hôpital et de donner telle et telle indication pour que les médecins se voient
obligés d’envoyer un véhicule. Le lendemain, l’ambulance est venue chercher la
mère et le nourrisson qui a dû suivre un traitement pendant deux semaines. Jnumi
assure de cette manière l’interface entre les individus de la communauté — de tous
les ogadode — et les services de santé de l’État.
Elle exerce aussi une forte influence sur deux éléments qui, à première vue,
semblent inoffensifs, mais qui en réalité peuvent avoir des conséquences
indésirables dans les petites communautés du Chaco : la prostitution et l’alcool. La
prostitution implique non seulement la propagation de maladies contagieuses, mais
aussi d’autres dangers : en effet, des clients paraguayens ou mennonites — souvent
ivres et agressifs — pourraient rentrer dans la communauté — parfois armés —
pour enlever des femmes. Sachant qu’il n’y a pas de prostituées à Jesudi — ou
qu’elles ne travaillent pas si elles sont à la communauté —, ils se dirigent ailleurs.
L’alcool ne semble pas pouvoir être consommé avec modération chez les Ayoreo : à
la radio, on entend parfois parler de bagarres au couteau entre hommes ivres dans
d’autres communautés. Dans les très rares occasions où j’ai vu une personne
alcoolisée à Jesudi, j’ai remarqué l’immense peur que les Ayoreo manifestaient 151.
Jnumi non seulement réprimande ceux qui boivent occasionnellement — et dans
certains cas, les fait partir —, mais aussi elle conseille vivement les filles contre les
maladies sexuellement transmissibles, et ce, par le biais de l’interprétation
dramatique de l’histoire d’une fille imprudente. Un jour, une prostituée ayoreo est
venue à Jesudi pour quelques jours. Ensuite des problèmes avec de possibles
infidélités sont apparus. Jnumi l’a fait chasser de la communauté. C’est Jnumi aussi
qui a parlé avec les parents d’une femme de Jesudi qui se prostituait pour les
151
Un soir, nous sommes allés avec le tracteur au magasin rural « Km17 ». C’était un paseo
(randonnée) pratiqué de temps en temps : cela permettait non seulement d’acheter des provisions,
mais aussi de regarder la télé — surtout les matchs de foot —, de boire du coca et de manger des
biscuits. Un jeune Ayoreo de Jesudi s’est enivré avec un peu de bière : il était furieux et criait contre
une fille de la communauté. Les Ayoreo ont alors décidé de rentrer. Voir une personne ivre et
agressive n’avait rien de nouveau pour moi et c’est la raison pour laquelle la tension des Ayoreo m’a
beaucoup étonné : personne ne parlait, ils étaient tous très tendus, ils avaient vraiment peur. Ils
disaient seulement « urusoi ! urusoi ! », mot qu’ils traduisent par « borracho » (« ivre ») en
espagnol, mais qui est aussi une maladie en ayoreo : l’enlèvement du principe animique ayipie par le
Premier Homme Lézard. Nous sommes arrivés à Jesudi et la peur ne se dissipait pas. Puchiejna m’a
demandé de rentrer dans ma tente et d’y rester. Le jour suivant le jeune homme et la fille (avec leur
famille nucléaire) avaient quitté Jesudi, chacun de leur côté, dans des directions différentes.
207
�convaincre qu’elle ne devait pas travailler dans la communauté (Jnumi leur a dit
qu’elle pouvait travailler à Ogasui ou à 10 de Febrero). Concernant ces questions
— qui impliquent parfois de faire partir quelqu’un de Jesudi et sur d’autres
questions —, Jnumi est la conseillère de ses fils, les caciques de Jesudi et de 15 de
Septiembre, comme elle l’était avant, quand son époux Ebedu était encore vivant.
Un facteur très important pour maintenir la paix à Jesudi est la distribution
équitable des aides venues de l’extérieur. Nous avons indiqué tout à l’heure que les
dons qui arrivent à la communauté sont donnés au chef, aux Dosapei. C’est
justement Jnumi qui est chargée de redistribuer ces dons. Elle le fait toujours
équitablement car elle est bien consciente des problèmes qui peuvent surgir. De
plus, dans l’espace ouvert de la communauté, tout est à portée de vue et tout le
monde peut voir de loin quand un mennonite ou le camion du gouvernement entre
et laisse de gros sacs de provisions. La photo présentée ici est très illustrative : une
grande quantité de manioc leur avait été donnée en mai 2008. Aucune femme
n’osait toucher les pièces. Elles attendaient la méticuleuse distribution de Jnumi :
trois pièces à chacune jusqu’à épuiser la totalité.
Jnumi distribue un don de manioc (crédit : Ricardo Maldonado)
208
�C’est dans le domaine des couples que Jnumi exerce son métier silencieux
de conseillère matrimoniale. Comme nous l’avons déjà signalé, la plupart des gens
de la deuxième génération se sont mariés à l’intérieur de Jesudi. Ce sont alors les
couples qui établissent ou rompent des liens entre les ogadode, ce qui contribue
certainement à l’unité de Jesudi ou à son affaiblissent.
Carte de Jesudi avec quelques couples mentionnés dans le chapitre
209
�Quand les membres d’un couple se disputent, les parents de chaque conjoint
prennent position. Suite à des disputes entre Juguei Dosapei — fils adoptif de
Chicori — et Ina Posijñoro — fille de Bajai et Daju —, Rafaela — sœur de Juguei
qui le protège comme un fils — menaçait de quitter Jesudi et de s’installer à María
Auxiliadora. Bajai et Daju se sont alors fâchés avec Rafaela — qui conseillait à
Juguei de quitter Ina et d’aller avec Asema, fille de Sidi. Daju avait composé un
chant qui racontait cette histoire et sur lequel Rafaela insistait en disant qu’il
s’agissait d’un mensonge. Par ailleurs, les discussions entre Ijnamia — fille de
Tamocoi et petite-fille de Jnumi — et Ujniete — fils d’Inocencio — ont contribué à
l’éloignement des deux ogadode respectifs. Iba — sœur d’Ujniete et amie
d’Ijnamia — n’a plus rendu visite à l’ogadi des Dosapei et Inocencio a menacé plus
sérieusement qu’avant de migrer dans la communauté Esquina152 . La jalousie peut
aussi être la cause d’une migration temporaire : Apala — une fille de Tamocoi âgée
de quatorze ans — a dû rester quelques jours à 15 de Septiembre car Martina
— fille de Bajai — s’était fâchée avec elle parce qu’elle avait peur que la jeune
fille n’attire son ex-mari récemment revenu à Jesudi. Tous ces mouvements de
couples, les disputes et les commérages sont habituels à Jesudi, mais pas
nécessairement inoffensifs : ils peuvent effectivement provoquer le départ définitif
d’une personne, d’une famille nucléaire et même — en combinaison avec d’autres
facteurs — d’un ogadi tout entier.
Jnumi exerce son influence sur les couples en plusieurs sens et sur les
différentes étapes d’une relation, depuis le début jusqu’à la fin. En effet, elle a
formé un nouveau couple entre une femme de Jesudi et un Ayoreo qui travaillait
dans une ferme à une vingtaine de kilomètres — convaincu par Jnumi, j'ai
d’ailleurs accepté de transporter deux familles dans ma petite camionnette. Elle
donne des conseils avant même que des disputes ne se déclenchent : elle a dit à
Gera — fils de Mimie — qu’il valait mieux arrêter de rendre visite amicalement à
son ex-femme Golo — petite-fille de Chicori — alors qu’il commençait une
relation avec Daisy — petite-fille de Bajai —, car cela inspirait déjà des
152
Dans le cas d’Inocencio, il faut rappeler qu’il existait depuis longtemps une tension entre lui et
les Dosapei concernant le rendement de son travail à l’école.
210
�commérages. Si quelqu’un veut partir, Jnumi essaie — selon les cas et les
personnes impliquées — de le convaincre de rester : elle s’est empressée de parler à
Mercedes Chiquejñoro quand elle voulait s’en aller après s’être disputée avec son
mari. Même si Jnumi n’a pas réussi à la convaincre de rester, elle s’est assurée que
Mercedes monte dans un camion qui l’emmène jusqu’à une autre communauté153 .
Jnumi peut aussi contribuer à la dissolution d’un couple. Nous avons mentionné le
cas d’Ijnamia — première petite-fille de Jnumi — qui s’était mariée avec Ujniete
Chiquenoi — fils d’Inocencio. À plusieurs occasions, Jnumi s’est fâchée avec
Ujniete parce qu’il avait refusé de donner de l’argent à son épouse. Le mari idéal
chez les Ayoreo est celui qui peut apporter beaucoup de nourriture ou d’argent.
Selon ce critère — sur lequel Jnumi ne cessait d’insister — Ujniete était un très
mauvais conjoint. Nous le verrons dans le chapitre suivant, l’histoire d’Ijnamia et
d’Ujniete est longue mais elle a fini par la dissolution du couple et l’adoption de
leur bébé par une tante d’Ijnamia. Jnumi a toujours insisté sur le fait qu’Ujniete ne
faisait pas ce qu’on attend d’un bon mari et elle a consolé sa petite-fille lors de
séparations occasionnelles. Jnumi est aussi intervenue directement : elle a appelé
par radio HF Ujniete — qui travaillait dans une ferme pendant trois mois à 150 km
au nord — pour lui rappeler qu’il devait envoyer de l’argent à Ijnamia. La
séparation de ces deux personnes venait s’ajouter à d’autres tensions entre l’ogadi
des Dosapei et celui d’Inocencio.
Jnumi est consciente de son rôle et de son importance politique : « jireipise
trabajo omeñu ! » (« J’ai beaucoup de travail à faire »), m’a-t-elle dit quand je lui
demandais d’aller à Aregua s’occuper de son époux Ebedu dont la maladie était en
phase terminale. Elle ne voulait pas quitter la communauté parce qu’elle avait trop
de questions à régler — en plus de deux petits-fils qu’elle élevait comme si elle
était leur mère.
Jnumi n’est pas le cacique de Jesudi mais elle joue un rôle décisif dans cette
communauté. Elle essaie de conserver une certaine stabilité parmi les rapports
153
Nous avons mentionné auparavant une dispute entre Esoi Dosapei et Mercedes Chiquejñoro. Elle
avait perdu pour la deuxième fois un portable et son mari s’est beaucoup fâché contre elle. Elle a
quitté Jesudi avec une de ses filles, mais une semaine après elle est revenue et ils se sont réconciliés.
211
�sociaux à l’intérieur de Jesudi, par le biais des distributions équitables des
provisions et de son influence sur les couples. Si elle rejette vraiment certains
individus ou certaines familles — comme Sijnai et Inocencio —, il est très probable
que ceux qui n’ont pas mérité sa bienveillance doivent partir. Quant au rapport avec
ses fils — les caciques —, elle leur rappelle toujours ce qu’Ebedu aurait fait à leur
place, surtout en ce qui concerne le bon usage du tracteur, les réclamations fermes
face aux mennonites et à l’État, et l’interdiction de la prostitution et de l’alcool.
Cependant, il faut souligner aussi que certaines influences exercées par Jnumi ne
semblent pas avoir de conséquences directes sur l’administration de la
communauté, mais plutôt sur des questions personnelles. Nous verrons, cependant,
que ces affaires personnelles sont à la base de la convivialité de Jesudi.
V.4.3. Autour des couples
Les disputes entre les membres d’un couple provoquent la forme la plus
habituelle de migration. Généralement, cela n’entraîne pas la création d’une
nouvelle communauté, le résultat est une circulation d’habitants entre les
communautés. Les séparations sont parfois temporaires, parfois définitives. Quoi
qu’il en soit, il y a toujours quelqu’un qui quitte la communauté — et généralement
quelques enfants l’accompagnent —, et d’autres qui restent. C’est de ce lien coupé
— ou tissé grâce à sa coupure — dont les Ayoreo parlent beaucoup. Sentir
l’absence de quelqu’un est quelque chose de commenté, chanté, pleuré. Ce ne sont
pas seulement les membres du couple qui leur manquent, mais aussi les enfants.
J’ai vu Jnumi exercer son influence sur les enfants des couples séparés pour
éviter que ces derniers ne partent. Sa fille Pojnangue avait commencé à sortir avec
un autre homme, alors qu’elle ne s’était pas encore séparée de son premier mari
Tercio, qui travaillait à ce moment-là dans une ferme lointaine. Pojnangue avait dit
à sa mère que Tercio était trop jaloux et qu’elle voulait le quitter depuis longtemps.
Le mari trompé allait arriver à Jesudi dans deux semaines. Pendant tout ce temps,
Jnumi a préparé le départ de Tercio : elle a donné ses affaires à Rafaela — Tercio
avait de bon rapports avec l’ogadi de Chicori — et elle a convaincu tout le monde
212
�qu’il était un mari méchant. Tercio était déjà dans une camionnette en direction de
Jesudi quand le plan fut mis au point. L’idée était de ne pas le laisser descendre, de
lui donner ses affaires et de le faire continuer jusqu’à Campo Loro, la communauté
où ses frères habitaient. Jnumi avait peur que Tercio n’emmène son fils Chiqueno
avec lui. Cet enfant était le petit-fils préféré de Jnumi — pour ainsi dire, c’était elle
qui l’avait élevé. Dans les jours précédant l’arrivée de Tercio, Jnumi a donné des
tortillas supplémentaires à Chiqueno et lui a dit en lui caressant la tête : « ca ajnina
baye, ajaia ? ca ajnina baye » (« ne va pas avec ton père, tu sais ? Ne va pas avec
ton père »). Chiqueno a accepté et sa grand-mère a dit avec ravissement « uajate
ñajnami ! » (« il est fort mon petit-fils ! »). J’ai assisté à un épisode similaire lors
de la séparation de Tamocoi — fils aîné de Jnumi — et Lucía — fille de Bajai.
Dans les premier temps après leur séparation, Lucía allait d’une communauté à
l’autre uniquement accompagnée de sa fille cadette, Tu. Pendant quelques jours,
Lucía et Tu sont restées à Jesudi. Jnumi a appelé sa petite-fille Tu et lui a parlé
ainsi : « viens ma petite-fille, écoute ce que j’ai à te dire : ta mère ira chercher un
mari, mais reste ici chez ton père, ne pleure pas, ta mère est une femme, elle n’est
pas âgée, tu comprends ? Elle ira chercher un mari demain »154. Jnumi était sûre que
ces enfants lui manqueraient.
Le verbe utilisé pour désigner ce sentiment est –ujnusi, qui pourrait être
traduit en français par « manquer ». Selon le dictionnaire des New Tribes Mission :
« jnusi. Irreg. 3rd p. verb sad (to be) ; feel the loss/absence of (to) ; miss someone /
something (to). –ujnusi » (Higham et al. 2000 : 597). Le verbe –ujnusi est transitif,
il implique donc un complément d’objet. Ainsi, ce verbe ne décrit pas un sentiment
de tristesse générale, il s’agit au contraire d’une tristesse ciblée : c’est ressentir
l’absence d’une personne spécifique. C’est Chiqueno, le petit-fils de Jnumi qui lui
manquera. Cette absence ressentie par quelqu’un est indicatrice naturellement d’un
lien affectif entre les deux personnes concernées, mais elle va au-delà du domaine
individuel.
154
Quelques mois auparavant, Jnumi s’était vraiment fâchée avec Tamocoi à cause de sa séparation
de Lucía. Jnumi n’a pas accepté la nouvelle femme de Tamocoi — ni son nouveau petit-fils. Elle
avait peur que Lucía ne reste chez son père adoptif à María Auxiliadora, ce qui l’aurait empêchée de
voir sa petite-fille, Tu.
213
�V.5. Ceux qui nous manquent : la nostalgie et la pensée qui ronronne
En fait, chez les Ayoreo, « manquer à quelqu’un » est un processus social.
« Manquer » n’est pas une disposition qui implique tout simplement un individu qui
ressent l’absence d’un autre. Il y a des circonstances particulières qui produisent
une absence, qui font plonger une personne dans la tristesse, des manières
spécifiques dans lesquelles cette personne exprime ce sentiment, des discours sur ce
sentiment et des conséquences sociologiques concernant des comportements qui
visent à éviter ou à renforcer ce sentiment.
Le penseur ayoreo (crédit : Alfonso Otaegui)
Nous avons montré tout à l’heure que la migration est un dispositif qui
permet d’alléger les tensions entre individus ou unités résidentielles. Ce dispositif
produit aussi logiquement des circonstances propices à la nostalgie, car le résultat
est toujours l’absence d’un individu ou d’une famille. En ce qui concerne la
manière d’exprimer cette tristesse causée par l’absence de quelqu’un, nous pouvons
signaler qu’il y a un genre de chants qui est consacré à ce sujet. En effet, la plupart
des iradedie racontent des histoires sur des individus à qui leur conjoint manque.
214
�Ce qui est typique d’un irade est d’exprimer cette tristesse ciblée, jnusietigai
— terme qui équivaut à irade selon les recherches d’Estival (2006 : 26) — : dans
ces chants, abai jnusi dacote poga acote jnusi dabai (« à un mari son épouse lui
manque ou bien à une épouse son mari lui manque »). Nous verrons tout ce qui
concerne les chants iradedie dans le chapitre suivant. Ici nous voulons juste
souligner qu’il y a des formes spécifiques pour transposer un sentiment — la
nostalgie — en un discours structuré — le chant. Les Ayoreo produisent des chants
où ils expriment leurs sentiments ou ceux des autres, en plus d’écouter en
permanence ce genre de chansons. Jnumi était sûre que ces enfants lui
manqueraient et elle a fait énormément pour qu’ils ne partent pas. Elle a convaincu
tout le monde que Tercio — le mari de sa fille — devait quitter Jesudi et elle a
réussi à convaincre son petit-fils de ne pas partir avec son père. Dans le cas de
Tamocoi, après avoir essayé de nombreuses fois, sans succès, de convaincre son fils
de se réconcilier avec Lucía, Jnumi a persuadé Tu de rester à Jesudi pendant que sa
mère cherchait un autre mari. Ce lien de « jnusietigai » (« nostalgie ») n’est pas
seulement tissé entre les membres d’un couple. Comme nous venons de le voir, une
grand-mère est sûre qu’elle va jnusi ses petits-enfants. J’ai entendu cette expression
de tristesse dans différentes relations : entre fille et mère, entre hommes, entre
enfants et adultes.
La traduction du dictionnaire des New Tribes Mission est claire155 : jnusi
signifie « sentir l’absence de quelqu’un ». C’est toujours quelqu’un en particulier.
Mais il y a d’autres expressions également utilisées dans ces circonstances qui nous
permettent de mieux comprendre ce lien affectif de l’absence.
Les Ayoreo disent aussi « yayipie doi » ou bien « yayipie jno », expressions
qui traduites littéralement signifient « mon ayipie ramène (quelqu’un) » et « mon
ayipie va (vers quelqu’un) ». Ces deux expressions mettent en scène un concept
fondamental, celui d’ayipie, qui nous permettra de voir que la nostalgie est en
même temps un phénomène individuel et social. Selon le dictionnaire des New
155
« jnusi. Irreg. 3rd p. verb sad (to be); feel the loss/absence of (to); miss someone /something (to). –
ujnusi » (HIGHAM et al. 2000 : 597)
215
�Tribes Mission : « áyipie : n.f. soul ; memory ; mind ; heart ; will ;
toughts » (Higham et al. 2000 : 107). D’après le dictionnaire des Salésiens, ce
concept signifie « entendimiento, alma, y espíritu-memoria (…) sitio de la
afección » (Barrios et al. 1995 : 24). Ces définitions nous montrent que l’ayipie est
autant chargé de fonctions cognitives que d’aspects affectifs 156. La distinction des
limites entre l’affectif et le cognitif dans le concept d’ayipie dépasse largement le
but de cette thèse et, par ailleurs, elle ne nous semble pas pertinente. « Yayiedopise
ñajnami » (« je pense beaucoup à mon petit-fils ») implique simultanément les
registres intellectuel et affectif. Ce qui est pertinent pour notre analyse, ce sont les
liens interpersonnels de nature diverse que le concept d’ayipie — et les expressions
dans lequel il est impliqué — nous permet de voir.
La notion de personne implique pour les Ayoreo deux principes animiques :
l’ayipie et l’oregate. Le premier est associé à la respiration, à la pensée et aux
sentiments157, alors que le deuxième correspond au double de la personne. En fait,
dans le mot oregate on peut distinguer le mot ore, qui signifie « image, reflet ». Le
dictionnaire de la New Tribes Mission est excellent du point de vue linguistique et
pour l’usage sur le terrain, mais il faut avouer qu’il est très marqué
idéologiquement. Ces deux principes animiques ont subi deux traitements opposés
dans la conformation du dictionnaire. Oregate est associé au double du chaman qui
quitte son corps pendant le rêve ou la transe induite par le tabac et va à la rencontre
des Premiers Hommes. Le chamanisme a été très attaqué et condamné par ces
missionnaires. Ainsi, oregate signifie dans le dictionnaire des missionnaires
américains : « ph. ghost ; apparition ; idol ; image » (Higham et al. 2000 : 456). Ce
mot n’a été mentionné à Jesudi que lorsque l’on parlait des chamans qui envoyaient
leur esprit dans un animal. Quant à la vie après la mort, les Ayoreo de Jesudi
disaient que l’ayipie chajai gate (« l’ayipie va en haut », c'est-à-dire au ciel) ou
156
Dans ce sens-là, le concept d'ayipie a beaucoup de traits en commun avec celui de waxok, le centre
cognitif et affectif de la personne chez les Enxet du Paraguay (cf. KIDD 2000).
157
Nous avons demandé aux Ayoreo où était l’ayipie mais cette question n’avait pas de sens pour
eux. À partir des gestes des Ayoreo quand ils disent « yayipiedoi » ou « yayipie quiyiguiyi », il
semblerait que l’ayipie est localisé dans la tête. Selon LIND (1974 : 118), il est localisé dans la
vésicule biliaire, l’aguté.
216
�bien la personne est castigado158 et l’ayipie descend dans les feux de l’enfer. Selon
les œuvres classiques sur les Ayoreo — Fischermann (1988) et Lind (1974) —,
l’oregate est le principe animique qui va dans le monde des morts, alors que
l’ayipie se dissout. Selon Fischermann (1988 : 219), la conception de l’ayipie n’est
pas claire pour les Ayoreo. L’information varie selon les individus consultés et
certains Ayoreo lui ont donné des réponses contradictoires. Fischermann signale
qu’il y a des différences concernant ce sujet entre les groupes Ayoreo du nord
— avec lesquels il a travaillé — et les groupes du sud — d’après les données de
Lind (1974). Fischermann présente aussi des expressions où le concept d’ayipie est
impliqué, mais nous ne les avons jamais entendues lors de notre terrain à Jesudi. Ni
Fischermann ni Lind ne consacrent beaucoup de réflexions au concept d’ayipie. Ces
deux auteurs se concentrent davantage sur l’autre principe animique, l’oregate, le
double de l’individu qui peut se promener lors du rêve ou après la mort.
L’ayipie est présent dans plusieurs mots ou locutions qui se rapportent à
l’activité cognitive et affective :
(poss)-ayipie doi : penser à quelqu’un / quelque chose
(poss)-ayipie jno (ome) : penser à quelqu’un
(poss)-ayipie que jnojni : penser intensément à quelqu’un
bei bayipie ! : décide-toi !
choique bayipie ? : qu’est-ce que tu en penses ?
garosi ayipie : comportement qui n’a pas de sens (Litt. « peu d’ayipie »)
poitac ayipie : comportement méchant (litt. « ayipie moche »)
ayipie cho quiyiguiyi : confusion (Higham et al. 2000)
158
Cf. section II.4.5 du chapitre II.
217
�L’ayipie implique des aspects cognitifs et affectifs, et simultanément des
aspects concernant autant l’individu que le groupe. L’ayipie est un composant
animique de l’individu, mais il a un rapport très étroit avec le comportement social.
En effet, quand une personne fait quelque chose qui n’a pas de sens, on dit qu’elle a
« peu d’ayipie » (« garosi ayipie ») ou qu’elle a « un ayipie moche » (« poitac
ayipie »). Selon Lind (1974 : 119), le fait d’avoir « peu d’ayipie » est associé à la
stupidité.
Pojnangue, la fille de Jnumi, semble être l’exemple de garosi ayipie par
excellence. D’une forte personnalité, cette fille ose faire des choses qui — elle le
sait pertinemment — provoqueront des commentaires dans toute la communauté.
Par exemple, quand elle était encore avec son premier mari Tercio, elle allait à
Campo Loro et restait avec son mari chez le frère de celui-ci (c’est-à-dire, le beaufrère de Pojnangue). Selon Jnumi, les Premières Femmes — chequebajedie —
n’aimaient pas ce genre de comportement, il fallait ajnaingome dabaiñai (« avoir
honte-respect-distance du beau-frère »)159. Ensuite, quand Pojnangue a décidé de
quitter Tercio, elle a eu des relations avec un homme marié, sans s’en cacher du
reste de la communauté, lors d’un paseo un week-end à 10 de Febrero. Dans les
semaines qui suivirent, Pojnangue quittait l’un d’eux et retournait avec l’autre,
ainsi successivement. Pour compliquer encore plus les choses, le nouveau mari de
Pojnangue était un fils de Sijnai — le fondateur de 2 de Enero. Jnumi signalait que
quand les Premières Femmes quittaient leurs maris, elles ne retournaient pas avec
eux. Finalement Pojnangue s’est décidée à rester avec Tercio. Un an après, elle l’a
quitté pour un autre mari paraguayen, ce qui est très rare chez les Ayoreo. Elle a
deux enfants avec ce dernier mais parfois elle pense à Tercio — et elle a même
interprété une fois une chanson à son sujet —, qui désormais n’habite plus à Jesudi.
Ce comportement — aller et retour entre deux hommes — était toléré dans
le cas de Pojnangue, mais ce n’était pas quelque chose qui pouvait durer longtemps.
Ces situations d’indéfinition amoureuse peuvent accentuer les tensions existantes
159
« Le dabaiñai (« beau-frère », litt. « autre mari ») est très dangereux » disaient les Premières
Femmes, mais Jnumi ne savait pas pourquoi.
218
�entre deux ogadode, comme dans le cas d’Ina — fille de Bajai — et de Juguei
— fils adoptif de Chicori — qui se disputaient mais ne se quittaient pas
définitivement. De plus, cela contredit les habitudes des Premières Femmes
concernant les rapports habituels entre homme et femme. Autrefois, les femmes
quittaient leurs maris — nous disait Jnumi — mais si elles les quittaient, c’était
définitif. Le souvenir de la honte obligatoire envers le frère de l’époux est aussi un
indice de règles parfois oubliées. Même si les femmes et les hommes peuvent
quitter leurs conjoints quand ils le veulent, le comportement de Pojnangue allait audelà de ce qui était habituel.
Garosi ayipie désigne aussi des comportements imprudents, c’est une phrase
que les Ayoreo disent souvent aux enfants quand ils se rapprochent trop près du feu,
ou s’ils ne veulent pas prendre un médicament. Dans ce cas, il s’agit aussi de
comportements qui ont des conséquences négatives pour l’individu — bien qu’un
enfant malade préoccupe tout son entourage. Consulté sur la question de l’ayipie,
Chicori Dosapei — vieil homme de 70 ans — signalait que « peu d’ayipie »
équivalait à « sijnaque » (« méchant, agressif »). Ce dernier mot désigne le
comportement antisocial par excellence : sijnaque est celui qui est violent à
l’intérieur de la communauté, qui utilise de mots méchants contre les autres. De
plus, Chicori ajoutait que quand quelqu’un avait peu d’ayipie, le reste des Ayoreo
n’était pas content avec lui (« qué yasique »). C’est pour cela que si des jumeaux
naissaient, ils les enterraient tout de suite160 . Ces bébés avaient un seul ayipie divisé
en deux, ils avaient donc garosi ayipie.
L’ayipie est alors le principe qui accomplit des fonctions cognitives et
affectives. Si on exerce une influence sur l’ayipie d’une personne, on pourra
exercer une influence sur son comportement. Justement dans le domaine de la
nostalgie, pour faire revenir quelqu’un qui vous manque beaucoup, il est possible
de manipuler son ayipie. D’après ce que Jnumi m’a raconté, quelques années
auparavant, Poro et Sidi sont partis habiter à Campo Loro, la communauté la plus
160
L’infanticide était une pratique régulière des Ayoreo avant leur contact avec les missionnaires
dans les années 1950.
219
�grande du Paraguay, qui se trouve à environ 30 km au sud-est de Jesudi.
Chugupenatei, leur fille qui s’était mariée avec Puchiejna, était restée à Jesudi. La
mère de Chugupenatei lui manquait énormément. Puua Chuiquejno — la femme
d’Uguri Dosapei, décédée quelques années avant mon arrivée — connaissait
beaucoup d’histoires des Premières Femmes. Puua, émue par la tristesse de
Chugupenatei, a alors interprété le « ayipie cho quiyiguiyi ». C’est l’histoire d’une
femme qui coupa un arbre puissant et dont l’ayipie commença à faire « quiyiguiyi »
— une sorte de bourdonnement, d’après ce que nous avons déduit à partir des
gestes et des onomatopées. Cet effet arrive aussi au destinataire du chant — Poro,
dans ce cas. Le résultat ne s’est pas fait attendre : Poro ne s’est plus sentie à l’aise à
Campo Loro et soudainement elle et Sidi ont décidé de revenir à Jesudi.
Chanson pour faire revenir quelqu’un qui vous manque (par Jnumi
Posijñoro)
Gusu ojninga « payipie quiyiguiyi »,
gusu « payipie quiyiguiyi »
Ñetingai poridie yajesuode ga yichagu poridie
ga yii ga yichaga yitaroi gatajidi a cuya
ga yayipie cho « quiyiguiyi »
Dis seulement « payipie quiyiguiyi »,
seulement « payipie quiyiguiyi ».
Je fais des essais avec les arbres dans le chemin et j’enlève l’écorce161 [pour
voir si l’arbre est un cuya 162]
et j’appuie mon front sur le cuya et mon ayipie fait « quiyiguiyi »
Voyons maintenant le fonctionnement de cette formule. Selon Jnumi, quand
quelqu’un raconte ou chante cette histoire, l’ayipie du destinataire commence à
faire « quiyigui yigui yigui » et cette personne commence à ne plus se sentir à l’aise
161
Littéralement : « je perce l’arbre ».
162
Capparis retusa (SCHMEDA-HIRSCHMANN 1994)
220
�là où il est. Littéralement, « tout est moche devant lui » : « dioco iquei ». Cette
expérience malheureuse l’incite alors à revenir là où il était avant, où se trouvent
les gens auxquels il manque. Ce récit a quelques caractéristiques qui nous
rappellent les formules de guérison sarode : l’onomatopée163 , l’identification de
l’énonciateur avec l’effet qui se produira chez le patient, la Première Femme
protagoniste. Cette histoire, contrairement aux sarode, ne produit pas l’effet
contraire si elle est chantée quand on n’en a pas besoin. Ce manque de caractère
puyac (« interdit ») nous a permis de l’enregistrer. Jnumi a utilisé cette histoire
quand sa fille est allé de l’autre côté du Paraguay, après s’être mariée avec un
Paraguayen. Pojnangue, la fille de Jnumi nous a raconté qu’elle était là, chez sa
belle-mère et que son ayipie avait commencé à faire « quiyigui yigui yigui yigui » et
tout à coup elle a voulu revenir à Jesudi. Cette manipulation de l’ayipie nous
permet de voir que même un état affectif peut être le résultat d’une action externe.
De plus, la cause de l’utilisation de cette histoire et le résultat de son emploi dans
les deux exemples cités ont été les mêmes : la migration de quelques personnes. À
partir de la migration, nous sommes parvenu à traiter un principe animique de
l'individu ayoreo, qui à son tour, nous fait revenir à la question de la migration et
aux liens de nostalgie qui en résultent.
V.6. Ijnoninguei, la joie de vivre
Le rapport étroit entre individu et groupe est aussi exprimé dans le concept
de « santé » ou « bien-être ». Pour mieux comprendre le concept de « santé » chez
les Ayoreo, nous reprenons l’œuvre de Lind (1974) consacrée à l’étude de la
médecine de ces Amérindiens. Lind nous montre que l’idée de
« santé » (« ijnoninguei ») est complexe : elle implique à la fois des aspects
163
Les métaphores disons « onomatopéiques » sont utilisées en Ayoreo pour décrire des sons ou des
textures, avec le mot « cho » (« comme »). Selon le dictionnaire des New Tribes Mission « cho: v.
like (to be) ; go like (to) ; sound like (to) (HIGHAM et al. 2000 : 210). Ainsi, cho gara gara gara est
le son de l’eau qui tombe dans le réservoir, cho chiqui chiqui chiqui est la description de nuages qui
ressemblent à la peau des moutons (style cirrocumulus), cho pit pit est le klaxon d’une voiture, cho
tec tec tec était le son du cœur de Puchiejna quand il essayait de marcher alors qu’il était victime du
chaman angaité.
221
�physiques, sociaux et affectifs. Cet auteur relie le concept de « ijnoninguei » à
l’accomplissement de rôles sociaux :
Pour les Ayoreo « santé » signifie au sens positif bien-être et la capacité
d’accomplir les rôles attendus, au sens négatif, l’absence de maladie, de
malaise et de faiblesse. Les attentes des rôles correspondent aux idées sur
l’efficacité et la jouissance physiques et psychiques normales, et sur les
motivations psychiques conformes aux normes164. (1974 : 83)
Cela nous montre que pour les Ayoreo, un individu « sain » est celui qui
remplit ses obligations correspondantes envers la société. Ce concept va encore
plus loin. Il n’implique pas seulement le rapport entre l’individu et le groupe,
ijnoninguei se trouve en plus à l’intersection du physique, du social et de l’affectif :
Il serait faux de considérer le concept de santé seulement du point de vue
des obligations dans les rôles sociaux. Plus exactement, santé est
premièrement bien-être et jouissance. Cela veut dire aussi absence de fatigue
et de faiblesse. Plutôt que l’accomplissement de diverses obligations, c’est
un indice de bonne santé de participer aux bavardages, divertissements,
jeux, aventures amoureuses et aux rapports avec des partenaires selon les
classes d’âge. Ainsi le concept de santé n’est pas loin des concepts tels que
beauté, aisance, bonheur d’amour, force et courage guerrier165 . (1974 : 85)
D’après mon expérience à Jesudi, je peux remarquer que le concept
d’ijnuejna (« sain ») dérivé d’ijnoninguei, fait référence à un état qui est plutôt hors
164
« Dem Ayoré-Indianer bedeutet Gesundheit positiv Wohlbefinden und die Fähigkeit, die jeweilige
Rollenerwartung zu erfüllen, negativ die Abwesenheit von Krankheit, Unwohlsein und Schwäche. Die
Rollenerwartung entspricht den Vorstellungen über die normale physische und psychische Leistungs- und
Genußfähigkeit und über normgerechte psychische Antriebe. » (LIND 1974: 83)
165
« Es wäre aber falsch, den Begriff Gesundheit nur in Hinsicht auf die Pflichten in der
gesellschaftlichen Rolle zu betrachten. Vielmehr ist Gesundheit als allererstes Wohlbefinden und
Genußfähigkeit. Dies bedeutet auch Abwesenheit von Müdigkeit und Schwäche. Die Beteiligung an
Schwatzereien, Lustbarkeiten, Spielen, Liebesabenteuern und Partnerbeziehungen entsprechend den
Altersklassen ist daher noch eher Indiz für eine gute Gesundheit als die Erfüllung der verschieden
Pflichten. So rückt Gesundheit in die Nähe der Begriffe Schönheit, Wohlstand, Liebesglück, Stärke und
Kampfesmut » (LIND 1974 : 85).
222
�du commun. Il s’agit d’une joie de vivre qui se détache de l’habituel. Un jour,
Juguei Dosapei — fils adoptif de Chicori — était extraordinairement heureux : il
s’était réconcilié avec Ina, la fille de Bajai. J’étais — comme d’habitude — à
l’ogadi des Dosapei, quand j’ai vu passer Juguei portant un grand sac sur son dos.
Il se dirigeait vers le chemin, comme s’il allait partir en voyage. Il faut rappeler que
tout est à portée de vue à Jesudi et quand quelqu’un part ou quelqu’un arrive, tout
le monde peut le voir. J’ai demandé à Tamocoi où il allait et pourquoi il partait.
Tamocoi m’a répondu « ijnoque, ijnuejna, gu » (« ce n’est pas comme ça, il est
sain, c’est pour cela »), et il a ajouté tout de suite la traduction : « sano ! ». Juguei,
en fait, n’allait nulle part, il voulait juste faire croire qu’il partait pour plaisanter,
pour que les gens demandent : « Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi il s’en va ? »,
tout comme je l’avais fait. Parfois, il arrivait que j’étais particulièrement content à
propos de quelque chose (on allait manger de la viande ou jouer au football, ou
peut-être j’avais pu comprendre un concept important) et je plaisantais plus que
d’habitude. Dans ces occasions, les Ayoreo m’ont dit « sano ua ! » (« t’es sain ! »)
pour souligner que j’étais spécialement heureux. Ces remarques nous montrent que
l’idée de « sain » n’est pas conceptualisée tout simplement comme l’absence de
maladie, c’est plus que cela. Le concept implique une gaité particulière qui met en
relief une personne du paisible bonheur des autres. Le concept employé par les
Ayoreo de Jesudi est cohérent avec les détails que Lind nous montre. Il faut
cependant souligner que l’allocution « ijnuejna ua » est rarement utilisée, c'est-àdire qu’elle n’est exprimée que dans les cas de comportements exceptionnels.
Le concept de « santé » unit des états physiques, émotionnels et sociaux de
la même manière que le concept d’etotiguei, « force ». Ces deux concepts,
ijnoninguei et etotiguei, sont étroitement liés depuis les temps des origines. Voici
l’histoire racontée à Lind par Uejai Picanerai :
Etotiguei, la force, était un jnanibajai, un Premier Homme [du clan]
picanerai. Il s’est fait une coupure sur le côté droit, entre la hanche et le
thorax, et il a extrait de son intérieur beaucoup de jnanibajade. C’est comme
ça que ses filles Curudé et Dabidé sont venues au monde. Avec elles sont
223
�apparus aussi les fils Santé et Bonheur d’amour. Un peu après Etotiguei a
extrait de son intérieur le bijou de plumes du chef. Depuis lors, Oxyde
d’hématite, Santé, Bijou de plumes du chef et Courage guerrier vont
ensemble166 . (1974 : 85)
Etotiguei veut dire « force » (Lind 1974 : 85 ; Higham et al. 2000 : 308)
mais il implique aussi des états psychologiques. « Etoc’ua ia ? » (Litt. « t’es
fort ? » ou bien « tu te sens fort ? ») est une question habituelle quand deux
personnes se rencontrent après un certain temps sans se voir, c’est même une sorte
de salutation. Les réponses nous indiquent que ce concept n’implique pas seulement
des questions physiques, mais aussi affectives. Une réponse fréquente est « etoque
garosi, puajedie gu » (« peu fort, je suis enrhumé, c’est pour cela »)167 , mais celleci est aussi possible : « etoque garosi, ducode gu » (« peu fort, je suis triste, c’est
pour cela »).
La tristesse peut causer la mort d’un individu. En 2010, une jeune fille
ayoreo d’une autre communauté est décédée de leucémie. Le beau-frère de cette
jeune fille était très estimé par Bajai Posorajãi. Quelques semaines après le décès,
je suis arrivé à Jesudi. Bajai m’a dit qu’il était faible — etoque garosi — parce
qu’il était triste pour cet homme. Le beau-frère de la fille décédée était si triste
qu’il a failli mourir. Selon les Ayoreo, la tristesse les affaiblit et peut les mener
jusqu’à la mort. J’ai consulté Bajai et son épouse Caitabia sur la manière selon
laquelle cela pouvait arriver. D’après leurs réponses, il est possible de déduire que
même si la tristesse n’est pas une maladie — ejnaretac —, elle peut causer la mort :
« casi toi, ducode gu » (« il est presque mort, il était triste, c’est pour cela »). Ce
n’était pas non plus que la tristesse le rendait faible et sensible aux maladies. La
166
« Etótiguei, die Stärke, war einer der jnanibajáde, der ersten Menschen, ein picanerái. Er schnitt sich
in die rechte Seite zwischen Hüfte und Brustkorb und zog aus seinem Innern viele jnanibajáde heraus. So
kamen seine Töchter curudé und dabidé zur Welt. Zusammen mit diesen erschienen die Söhne Gesundheit
und Liebesglück. Etwas später zog etótiguei den Häuptlingsfederschmuck und den Kampfesmut aus
seinem Innern. Seitdem gehören Hämatitstein und Gesundheit, sowie Häuptlingsfederschmuck und
Kampfesmut zusammen. » (LIND 1974: 85)
167
Puajedie peut signifier le rhume mais aussi quelques symptômes isolés, tel que le mal de gorge
ou notamment la toux.
224
�tristesse elle-même « chise imainie » (« (elle) prend tout le corps ») prenait la
personne dans sa totalité. Si la santé est associée à une vie active, la tristesse est
associée à la faiblesse et à la quiétude, au point de ne plus avoir envie de manger. Il
est donc possible de supposer que ceux qui sont morts de tristesse par le passé ont
succombé à l’arrêt de leur alimentation.
J’ai demandé à Bajai et à son épouse s’il y avait des formules de guérison
sarode pour ces états graves de tristesse. Bajai et Caitabia ont dit que parfois les
gens racontaient « gaño adode », l’histoire de la fourmi qui construit des nids
énormes. Cette histoire ne m’était pas inconnue, car Jnumi m’en avait parlé
quelques mois avant. L’histoire de la fourmi gaño avait été racontée par le père de
Jnumi quand elle avait environ sept ans, alors qu’ils habitaient encore dans le
monte. Quand Jnumi était petite, elle ne mangeait rien et n’avait pas d’appétit.
Naturellement, elle avait commencé dangereusement à maigrir. Caagadé — le père
de Jnumi —, qui « savait beaucoup de choses », a raconté cette adode. Jnumi a tout
à coup recommencé à manger. La réponse de Bajai et Caitabia a du sens : un
symptôme de la tristesse est le manque d’appétit. La personne triste ne mange plus,
ce qui contribue à son affaiblissement causé par la tristesse. Chez les Ayoreo, il
n’est pas possible de guérir la tristesse, on peut en tout cas traiter une conséquence
— le jeûne involontaire — mais pas la cause. La tristesse ne se guérit pas, mais,
comme nous l’avons déjà souligné, elle est quelque chose de commenté, chanté,
pleuré.
Ce sentiment lourd de tristesse causé par l’absence de quelqu’un est quelque
chose de valorisé chez les Ayoreo. En fait, cet état — qui n’est pas désiré mais qui
arrive souvent à cause des migrations fréquentes — est un trait typique des Ayoreo :
« ayoreode jnusi, coñone qué jnusi » (« des personnes manquent aux Ayoreo, mais
personne ne manque aux Blancs »), nous a dit Daju Étacõro. Quand quelqu’un qui
n’est pas Ayoreo exprime de la tristesse à cause de l’absence de quelqu’un d’autre,
les Ayoreo disent « ayorepise… ! » (« c’est très ayoreo… ! »). Il ne serait pas
inexact de dire qu’il y a une valorisation de la tristesse comme un trait identitaire.
Daju Étacõro insistait sur l’opposition entre Blancs et Ayoreo par rapport à la
225
�tristesse : elle avait assisté aux funérailles d’un enfant blanc et l’absence de pleurs
l'avait frappée. Selon Daju, les Blancs ne pleuraient pas, ils déposaient des choses
— probablement des fleurs — à côté du cercueil. Les Blancs ne pleuraient pas, du
moins comme les Ayoreo. Nous le verrons dans le chapitre suivant : quand les
Ayoreo pleurent, ils crient et ils chantent. Ce sont des pleurs très intenses et
bruyants. De la même manière que tout le monde percevait que Juguei était sain
— ijnuejna —, il faut que tous puissent entendre la tristesse chantée d’un membre
de la communauté.
Conclusion du chapitre V
Dans ce chapitre nous sommes parti de la description des circonstances de la
fondation de nouvelles communautés issues de Jesudi jusqu’à la description de
certains aspects de l’un des deux principes animiques de la personne ayoreo. La
migration est présentée, d’un côté, comme la conséquence finale d’une série de
tensions, et de l’autre, comme l’origine de situations de nostalgie. Dans le premier
aspect, nous avons distingué deux niveaux, deux échelles de la migration, avec
deux causes différentes. Le premier niveau est celui des unités résidentielles qui
migrent et établissent de nouvelles communautés, guidées par une personne avec
les ambitions et les capacités de gestion requises. La cause principale est de l’ordre
de la politique classique : des disputes avec le cacique de Jesudi concernant la
gestion de dons, de proyectos, de l’argent en général. Le deuxième niveau est celui
des individus qui déménagent dans une autre communauté de manière temporaire
ou définitive. Dans ces cas, les aspects personnels sont plus visibles : il s’agit, pour
la plupart, de membres d’un couple qui se sépare. Ces deux niveaux, distingués
d’une manière si tranchante pour rendre l’analyse plus simple et l’exposition plus
claire, ne sont pas pour autant complètement indépendants. Parfois les disputes
entre conjoints viennent s’ajouter à la tension déjà existante entre deux unités
résidentielles.
226
�La migration, soit au niveau des unités résidentielles, soit au niveau des
individus, donne le même résultat : des gens qui partent et des gens qui restent.
Cette situation permet la mise en relief d’un trait que les Ayoreo considèrent
identitaire : la tristesse causée par l’absence de quelqu’un. Nous nous demandons
alors si ce sentiment peut servir à expliquer d’autres traits de la société ayoreo, s’il
dépasse l’aspect anecdotique. En fait, ce sentiment est un lien affectif dont la
conceptualisation est en même temps d’ordre sociologique, économique et même
biologique. C’est surtout la figure d’un couple séparé qui permet de mettre en scène
une série d’éléments individuels — tel que l’ayipie — qui sont en même temps de
nature relationnelle.
Nous avons signalé que cette nostalgie causée par l’absence d’un individu
existe entre plusieurs relations : entre grand-mère et petits-enfants, entre mères et
filles, entre membres d’un couple, entre amis, entre parents claniques, etc. Mais
c’est surtout le cas de figure des couples séparés qui devient exemplaire. Cela est
en fait logique, car c’est par le rapport entre les membres d’un couple que les unités
résidentielles se rapprochent ou s’éloignent, que des tensions peuvent être allégées
ou intensifiées. Pour cette raison, Jnumi — la femme ou la mère du chef — exerce
son influence surtout sur les couples : la personne qui gère les couples, gère la
communauté.
Manquer à quelqu'un ou être triste à cause de l’absence d’une personne est
un processus social qui implique des liens spécifiques entre individus. Dans le
chapitre précédent, nous avons montré que les parents claniques qui habitent dans
d'autres communautés manquent beaucoup aux gens de Jesudi. Ce sentiment est
notamment perceptible dans les messages enregistrés sur cassettes et a été exprimé
par Echoi très clairement : « je suis triste à Jesudi parce que je n’ai pas de parents
claniques ici ». L’absence de quelqu’un avec qui on a partagé de la nourriture et des
anecdotes est ressentie à tel point que les Ayoreo de la deuxième génération de
Jesudi ont préféré se marier à l’intérieur de la communauté. Même si l’un des deux
conjoints d’un nouveau couple doit changer d’ogadi, ils restent toutefois à Jesudi.
227
�La nature relationnelle de la nostalgie est visible dans la manière de
l’exprimer : « mon ayipie va vers quelqu’un ». D’une manière amusante, les Ayoreo
supposent que l’on pense constamment à quelqu’un : si un homme fait tomber par
distraction le tereré que l’on vient de lui passer, on lui dira tout de suite « bayipie
jno… ome mama ia ! » (« ton ayipie est allée… vers ta copine ! », ou bien on
mentionnera une femme déterminée pour plaisanter168). De plus, la conception de ce
principe animique est fortement sociale : celui qui a peu d’ayipie fait des choses qui
n’ont pas de sens ou qui peuvent déclencher des conflits sociaux — sortir avec plus
d’une personne ouvertement, ne pas partager la nourriture, être agressif. Cet aspect
social de l’ayipie, le principe animique de l’individu — il semble que l’oregate
n’existe plus, dû à l’action des missionnaires américains — est aussi exprimé dans
les concepts de santé et de force : un individu sain est socialement actif, un individu
triste ne s’engage pas dans les activités collectives et tombe dans l’inaction. Cette
inaction, ce manque de participation à la vie sociale s’exprime par le biais de la
nourriture : celui qui est triste n’a pas envie de manger. La tristesse, la faim, les
rapports avec les autres et les histoires sur ces rapports sont étroitement liés chez
les Ayoreo.
Les disputes pour le pouvoir, les commérages, les couples qui se séparent et
se réconcilient, Jnumi qui va d’un côté à l’autre, Bajai qui est triste et faible ; bref,
toutes les données que nous avons présentées dans ce chapitre semblent en fait
constituer un recueil chaotique des événements quotidiens. Nous avons essayé de
montrer que ces événements quotidiens donnent forme à la composition de la
population de Jesudi (et de 15 de Septiembre, 2 de Enero, Ogasui, etc.) et au
déroulement de la vie sociale à l’intérieur de cette communauté. Cet ensemble
chaotique de comportements est organisé par le biais de la parole. C’est dans la
parole que ces événements deviennent des histoires, des unités fermées et
transmissibles. À partir d'un certain nombre d’histoires, on peut tirer des idées
directrices sur lesquelles les Ayoreo insistent, et ces idées deviennent des points de
référence pour évaluer le comportement des autres. Ces histoires qui mettent en
168
Ce n’est pas n’importe qui, ce sera toujours une femme avec laquelle il a été marié, il a eu une
relation ou il veut en avoir une — d’après les commérages.
228
�relief notamment la tristesse causée par l’absence de quelqu’un — une personne a
migré dans une autre communauté, ou bien elle est décédée — se présentent sous
forme de chants. Ils constituent des points d’ancrage de la pensée et le
comportement des Ayoreo constituent le sujet du chapitre suivant.
229
�CHAPITRE VI
LES CHANTS AU QUOTIDIEN
Introduction : le prisme des chants
Nous avons vu dans le chapitre précédent que le prisme de l’affectivité nous
permet de saisir des aspects assez divers de la morphologie sociale de Jesudi. Les
données très disparates que nous avons repérées sont en effet hétérogènes et
imprécises. Il s’agit de données floues nées de l’observation de la monotonie de la
vie quotidienne : des commentaires entendus autour du feu, la variation de la
fréquence des visites entre membres de diverses unités résidentielles, des
commérages sur de possibles infidélités, des tensions entre personnes importantes
de la communauté, des conjoints qui quittent Jesudi et des parents qui souffrent de
leur absence. Nous avons montré que la mise en évidence de l’affectivité nous
permet de relier toutes ces données et de comprendre leur implication dans la
morphologie sociale de Jesudi. Ce rapport entre affectivité et vie sociale est
synthétisé dans les notions de nostalgie (jnusietigai), de bien-être (ijnoninguei) et
de force (etotiguei).
La nostalgie est particulièrement repérable dans les chants irade. C’est par le
biais de ces compositions que nous avons pu avoir ce regard d’ensemble sur la
diversité des données recueillies. Ce sont justement les chants irade qui nous ont
permis de repérer ces données et leurs relations. Les chants nous ont poussé à
porter notre attention sur les commérages, les rapports de couples, la nourriture qui
est offerte ou bien rejetée, ainsi que sur les gendres choisis par les belles-mères. Ils
nous ont permis de prendre en compte la dimension affective — et à la fois
économique — des rapports sociaux des Ayoreo. D’une certaine manière, les chants
ont conditionné notre perception de la vie sociale à Jesudi et nous ont permis de
définir notre objet d’étude : le rôle des chants dans la société ayoreo. Nous pensons
qu’ils accomplissent une fonction similaire — celle de « passoire cognitive » —
pour les Ayoreo : ils rassemblent diverses informations, synthétisent en une unité
230
�des éléments hétérogènes et catégorisent en unités discrètes le déroulement de la
vie quotidienne. Quel est alors le rapport entre les chants et les événements qu’ils
relatent ? Ce rapport change-t-il en fonction du temps qui passe ?
Nous présenterons tout d’abord quelques traits généraux des irade pour nous
pencher ensuite sur une étude de cas. Nous verrons trois chants en rapport étroit
avec les circonstances qu’ils décrivent et qui ont été à leur origine ; ces événements
se sont produits dans l’ogadi des Dosapei. Puis, nous nous concentrerons sur les
chants de tristesse uñacai. Plus spécifiquement, nous aborderons ce que nous avons
appelé « la première instance de la performance », moment où le chant est composé
et interprété pour la première fois. Enfin, nous analyserons les chants irade et
uñacai au cours du temps, une fois qu’ils sont devenus des histoires presque
indépendantes des circonstances dans lesquelles elles ont été créées. Nous verrons
que ces histoires contribuent à l’établissement de certaines catégories de la pensée
et de la vie sociale.
VI.1. Les irade, des histoires d’amour
Dans cette section, nous allons étudier les caractéristiques générales de ces
chants en guise d’introduction. La plupart des chants que nous écoutions le soir à
Jesudi étaient des irade, qui relatent des histoires de couples169. D’après Estival
(2006 : 472), les Ayoreo traduisent ce genre par « chants romantiques ». Selon cet
auteur, le nom de cette catégorie de compositions est spécifiquement jnusietigade,
qui veut dire — Estival s’appuie sur le dictionnaire de Barrios et al. 1975 —
« mélancolique, triste »170 . Effectivement, il s’agit d’histoires racontées sous le
169
Sur les quelques 150 enregistrements de chants réalisés entre 2008 et 2011, les trois quarts
correspondent à des irade. Nous avons fait une sélection des compositions pour cette thèse : 26
irade, 17 uñacai et 15 appartenant à d’autres genres.
170
Comme nous l’avons dit dans le chapitre III, ESTIVAL (2006) présente une classification
légèrement différente : il appelle « irade » tous les chants qui ne sont pas des formules de guérison et
fait une division à l’intérieur de cette catégorie. D’après cet auteur, les visions chamaniques « ore
enominone », les chants de guerre « pocaningai » et les chants romantiques « jnusietigade » (qui
correspondent à notre définition d’irade) sont des « irade ».
231
�signe de la tristesse : elles parlent, soit d’un couple qui vient de se séparer, soit
d’un couple qui ne réussit pas à se former.
Voyons un exemple. C’est un irade qui fait partie d’une sorte de sous-genre,
le pojnaquei. À vrai dire, il n y a pas de traits formels qui permettent de distinguer
les pojnaquei du reste des irade. Il s’agit d’une classification thématique : le verbe
pojna signifie « se mettre en colère contre quelqu’un » et le substantif qui en est
dérivé, pojnaquei. Même si ce sous-type de chants est centré sur un conflit, on peut
apercevoir clairement que la nostalgie et la tristesse sont toujours là, dans le
tréfonds.
Le cas suivant raconte la colère de Dajei Posijñoro, femme de l’ogadi de
Bajai. Dajei avait quitté son premier mari Simi Chiquenoi et était devenue la
femme d’Oonei Cutamurajãi. Dans ce chant, Dajei raconte qu’elle veut quitter
Oonei parce qu’il la frappe, mais elle hésite à le faire en raison de la bonne opinion
que sa mère a de lui. En effet, Oonei a la réputation d’être très travailleur, ce qui se
traduit par beaucoup de nourriture non seulement pour sa femme, mais aussi pour la
famille de celle-ci171 .
Dajei pojnaquei (par Daju Étacõro)
Ñijnecaosiabide yapacadi to gajine.
Que yedosu gajine cuchaique gajine yedogabiasu gajine Pascualita suaque
uruode gajine uje uñaque naome ñu ica « Dajei yipeco babia ga que yiya ua
jne, babai tuté majneone babai abode bisideque /abode to que yiya ua jne »
ga jeti je ure ñu, je ure ñu ga yiya uñeque to nanique mu yiji nanique uate
pataingane nanique. Yisapoi yoquirosori case
171
Cette notoriété fait d’Oonei un homme désiré. En 2009, Jnumi a contribué à former un couple :
Asema — fille de Poro et Sidi — était de nouveau célibataire. Le mari choisi était aussi Oonei qui
travaillait dans une ferme à 35 km de Jesudi. Jnumi — la « Célestine » de Jesudi —, après en avoir
parlé avec sa parente clanique Poro, a convaincu l’ethnographe débutant d’y emmener dans sa petite
camionnette tout le cortège nuptial : Asema, ses parents Sidi et Poro, sa sœur Chugupenatei et son
époux Puchiejna — le cacique de Jesudi —, et Jnumi, puis de revenir en plus avec Oonei et son
frère. Jnumi avait signalé à plusieurs reprises qu’Oonei était « paaque » (« bon ») et qu’il travaillait
énormément.
232
�ga totiga ga ñujnusiasi uñeque to ica mu mama jnusiete Oonei to uñeque ica
ga yisapoi uñeque to ica
yisapo yoquirosori casica to ica ga uñeque chaquesuyu utigo ica
ga ñaome disidequeamia « yico ga ñajningo to ga yibico mama to ! »
ga yico ome yocurasade ore ga Fibai uñeque tibagüi yu ga uñeque naome ñu
« abagüi bapagadi ».
Yiyaguiasi Oonei to ica mu mama ore ijnorac uñeque ica ga yayipiedoi
yabaiode jnani, que ore jno naquiningane udi to ga uñeque chaquesu yutigo
mu yico idai ude ga uñeque ijnojnoc jnanidacabi inijnai ga uñeque yacho
uñeque ica ga uñeque catecai ga ñaome « jetiga bacajeo ga ñijninapoi
uñeque bisideque to mu que yirajapise ñujnusietiguiji uñeque » mu mama
uñeque chijnora uñeque to ica.
La colère de Dajei (par Daju Étacõro)
Je chante ici dans mon lieu maintenant
Maintenant je parle beaucoup de quelque chose, je parle des mots de
Pascualita quand elle m’a dit « Dajei, nous adoptons ta fille et je n’arrêterai
pas [de te donner de la nourriture], ton mari [Sime] t’a fait des enfants pour
rien [il ne te donne pas d’argent] »
Et c’est vrai, c’est vrai moi, j’ai quitté celui-là [son mari Sime] ça fait
longtemps j’ai écouté ses mensonges [Pascualita] et je me souviens
de [l’époque de] notre ancien patron
Et celui-là [Oonei] ne me manque pas, mais il manque à maman et je suis
retournée avec lui
Je me souviens de [l’époque de] notre ancien patron et celui-là [Oonei] me
frappait sur tout le corps
Et j’ai dit à ma sœur [Ina] « allons-y, rentrons et appelons maman ! »
Et nous sommes rentrées chez nos paysans et Fibai nous a rencontrées et
celui-là a dit « va à ton lieu »
J’ai quitté Oonei mais maman est amie avec lui et mon ayipie amène mes
maris, ils ne se fâchaient pas avec moi et celui-là [Oonei] me frappait tout le
233
�corps Mais nous sommes allées à cette communauté [Jesudi] et je suis allée à
la maison de mon frère [Roberto] et j’en ai assez de celui-là, et j’ai dit « si
c’est votre désir, alors je serai de nouveau avec lui [Oonei] pour rien, il ne
me manque pas du tout », mais maman est amie avec lui.
Ceci est un irade assez exemplaire. C’est la description d’un épisode,
concernant un couple, qui se rapporte à la tristesse. Généralement, il s’agit d’une
rupture ou bien — comme ici — de la possibilité d’une rupture. Dajei raconte les
motifs pour lesquels elle veut quitter son mari et en quoi cette décision va à
l’encontre de la volonté de sa mère. Un argument assez repris dans les irade est
celui des mères qui veulent des gendres sachant chasser ou travailler. Comme c’est
le cas dans plusieurs compositions, si le protagoniste n’est pas heureux aujourd’hui,
il y opposera un passé heureux. Dajei fait allusion à ses premiers maris qui ne la
frappaient pas. Finalement, on peut remarquer que même dans les dernières lignes,
rien n’est résolu : Dajei continue à se plaindre de son mari et à exprimer son désir
de le quitter, mais elle attend, d’une certaine manière, le consentement de sa mère.
Du côté de la composition en tant que chant, il est typique des irade de
commencer par la formule d'introduction ñijnecamine « je chante ici », ce qui est
différent des chants de tristesse uñacai où le sujet énonciateur pleure –po. De plus,
généralement dans les premières lignes, le sujet énonciateur annonce de quoi il
parlera, notamment avec le verbe –edo. Ici, Dajei le dit yedosu- (en ajoutant des
suffixes que nous analyserons dans la troisième partie). Nous ne nous souvenons
pas d’avoir entendu ce verbe dans les conversations quotidiennes, il semblerait être
associé aux chants. Selon le dictionnaire des New Tribes Mission : « -edo : v. reg.
talk a lot about someone, whether good or bad (to) ; sing about, as in ayoré chants
(to) » (Higham et al. 2000 : 279). D’après cette définition, le signifié est plutôt
neutre, alors que, d’après notre expérience de terrain, il semblait avoir une
connotation nostalgique. Si l’on poursuit la lecture du dictionnaire, on trouvera que
la racine se rapporte non seulement au concept de chant, mais aussi à celui de
commérage : « edoi : n.m. gossiped about, one who is ; slandered, one who is » et
ensuite, dans l’entrée suivante : « edoi : n.m. theme of a song/chant ; message of a
234
�song/chant » (Higham et al. 2000 : 282). En d’autres termes, il s’agit d’une chanson
où le sujet énonciateur annonce qu’il parlera de quelqu’un d’un point de vue
spécifique, le sien. La perspective adoptée dès le début est toujours celle de la
parole d’un individu spécifique.
Il serait intéressant de jeter un coup d’œil aux sujets des irade que nous
avons sélectionnés. Ce qui identifie le plus clairement ce genre de compositions est
la thématique du couple.
Brefs aperçus du contenu des irade
Irade nº 1 : Chant de Daju. Un homme, Dai, en a assez de sa femme Gisela qui se
plaint de tout. Il se souvient des mots de son père et qu’avant elle était gentille.
Irade nº 2 : Chant de Daju. Dajei veut quitter son mari Oonei, mais elle hésite, car
sa mère Daju l’apprécie beaucoup.
Irade nº 3 : Interprété par Daju, auteur inconnu. Cuchanuto, une femme, dit que
Posuei lui avait promis de venir avec elle, mais cela ne s’est jamais produit.
Irade nº4 : Chant de Daju. Une fille, Chomanate, raconte que son père insiste pour
qu’elle se marie avec un homme, dont le frère est dacasute — « grand
guerrier » — et dont les parents n’ont pas faim.
Irade nº 5 : Chant de Poro. Laino, un jeune homme, regrette le mépris d’une fille,
Ale, alors qu’avant d’autres filles le désiraient.
Irade nº 6 : Chant de Poro. Asema raconte sa dispute avec Luciano — qui vient de
la quitter. Elle lui rappelle qu’il l’avait déjà quittée une fois pour Ina, mais qu’il
était finalement retourné avec elle — Asema.
Irade nº 9 : Chant de Jnumi. Umajno, une femme, se met en colère contre Guiejna.
Laino, jeune homme travailleur et généreux, s’est marié avec Leila, fille de
Guiejna, au lieu de le faire avec Ale, fille d'Umajno.
235
�Irade nº 10 : Chant de Jnumi. Terciodate, une jeune fille, raconte la pression de sa
mère pour qu’elle se marie avec un dacasute qui apportera beaucoup de nourriture.
Irade nº 11 : Chant de Jnumi. Pojnangue dit qu’elle n’aime plus Elado, elle veut
retourner avec le père de ses enfants, Tercio.
Irade nº 12 : Chant de Chuguadaye interprété par Jnumi. Ujnamia, une jeune fille,
raconte qu’un homme l’a rejetée. Elle lui rappelle qu’elle est encore jeune et
qu’elle est en train de chercher des hommes avec ardeur.
Irade nº 13 : Rêve de Jnumi. Le dernier mari de Pojnangue, Yue, quitte Jesudi parce
que selon lui, Jnumi ne l’aime pas. Jnumi est triste pour lui et chante sa nostalgie.
Irade nº 14 et nº 15 : Chant de Jnumi. Jnumi refuse d’accepter la nouvelle femme
de son fils Tamocoi et celui-ci se met en colère.
Irade nº 16 : Chant de Jnumi. Daju se fâche avec Bajai parce qu’il ira avec Caitabia
— son autre épouse — à Filadelfia. Daju se souvient quand elle était jeune et ses
maris étaient beaux.
Irade nº17 : Rêve de Caitabia. Chant de Fibai. Fibai, fils de Tamocoi et de Lucía,
dit que ses parents l’ont abandonné.
Irade nº18 : Chant de Daju. Rosa dit à Conchi, la femme d’Elado, qu’elle ne veut
plus être avec Elado, et que Tercio est le seul Ayoreo avec lequel elle serait à
nouveau.
Irade nº 19 : Chant de Daju. Ina dit que Juguei ne veut pas la quitter, que c’est sa
mère qui lui conseille de la quitter et d’aller avec Asema.
Irade nº 20 : Chant de Jnumi. Iba se fâche avec son mari parce qu’elle est jalouse.
Elle détruit les vêtements de son mari.
Irade nº 21 : Chant de Poro. Un homme est triste parce que sa femme est partie en
voyage.
236
�Irade nº 22 : Chant de femme inconnue, interprété par Cuia. Noe, une femme, dit
qu’elle quittera Chicori parce elle est tombée amoureuse d’un autre homme.
Irade nº 23 : Chant d’Aquesuide, interprété par Jnumi. Abeca se fâche avec sa sœur
parce que celle-ci l’accuse de vouloir être infidèle à son mari Jnani.
Irade nº 24 : Chant de Jnumi. Ijnamia décide de quitter son mari Ujniete.
Irade nº 25 : Chant de Jnumi. Un jeune homme, Eta, veut être avec Ijnamia, il ne
veut pas être avec Miriam, une autre fille. Le sujet énonciateur est Miriam.
Irade nº 26 : Chant de Daju. Ebedu est très triste parce qu’on lui a dit que sa femme
Jnumi le trompe avec Usigai. Ebedu dit qu’il partira en Bolivie.
Irade nº 27 : Chant de Jnumi. Jnumi se met en colère avec Umajno. Jnumi dit
qu’elle ne veut pas être avec Usigai, le mari d'Umajno.
Irade nº 28 : Chant d’Uejai. Une jeune fille dit qu’il n’y a pas d’homme comme
Ajideodaye (autre nom d’Uejai).
Nous pouvons constater qu’il s’agit d’un ensemble de commérages chantés.
Tous les personnages des chants sont des personnes humaines réelles, et ces
histoires sont vraies — disons biographiques. Si l’on excepte les irade 1, 4, 12, 23
et 24, le reste raconte des histoires d’amour des habitants de Jesudi. Commencer
l’analyse des chants par les chants eux-mêmes — c'est-à-dire, les paroles — serait
une erreur, car, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, ces irade ont été
composés par des individus avec des points de vue particuliers, personnels. Les
irade ne sont pas seulement des chants, ils incluent aussi tout ce qui est autour : les
commérages au coin du feu, les opinions sur tel ou tel couple, les critiques des gens
d’un ogadi au sujet d’un autre — liés par des couples —, et les versions opposées
sur les disputes d’amour. Il nous faut, pour commencer à dévoiler le rôle des chants
dans la vie sociale des Ayoreo, analyser un cas dont on connaît l’histoire avant
qu’elle ne soit devenue un chant.
237
�VI.2. Les irade. La belle-mère et les deux belles-filles
Nous allons voir comment est présentée une séparation dans les chants
irade, comment elle est construite, et quels événements postérieurs y sont associés.
Le but de cette section est de montrer que ce qui pourrait être considéré tout
simplement comme une affaire entre deux personnes a des conséquences dans le
reste du tissu social de Jesudi. Nous étudierons comment le chant permet de mettre
en relief la tristesse et la nostalgie déclenchées par la migration d’une ou plusieurs
personnes de Jesudi. C’est une sorte de dispositif qui fait que la dispute d’un couple
soit interprétée comme une blessure dans le tissu social de Jesudi. Par le biais du
chant, ce qui pourrait être privé devient une affaire — encore plus — publique.
Examinons, par exemple, le cas de la séparation de Tamocoi Dosapei —fils du chef
Ebedu Dosapei et de Jnumi Posijñoro — et de Lucía Posijñoro — fille de Bajai
Posorajãi. Ce cas est emblématique. Nous y verrons concentrés tous les traits des
rapports sociaux que nous venons de décrire dans le chapitre précédent : l’influence
de la mère sur le fils, la préférence pour une belle-fille, et surtout la migration
comme une menace distante, mais toujours possible.
VI.2.1. L’histoire
Quand je suis arrivé pour la première fois à Jesudi en 2008, Tamocoi avait
entre 28 et 30 ans et il était marié avec Lucía Posijñoro. Ils avaient trois filles —
Ijnamia, Apala et Tu — et un fils — Fibai. Des disputes particulièrement intenses
entre ces conjoints semblaient avoir commencé vers 2009. Cependant, il faut
rappeler qu’au début je ne parlais pas la langue, ce qui veut dire que je ne pouvais
pas suivre le circuit des nouvelles, commentaires et commérages. Au cours de
l’année 2009, il y eut une série d’infidélités de la part de Tamocoi, mais celles-ci
n’avaient pas abouti à la séparation du couple.
D’après ce que Tamocoi racontait à la fin de 2009, il n’avait jamais eu de
problèmes avec son épouse. Il avait dit cela après une série de disputes conjugales
dont tout le monde avait été témoin. Cette construction d’un passé heureux en
238
�opposition au présent triste est un trait qui apparaît à plusieurs reprises dans les
chants et sur lequel nous reviendrons. Selon Jnumi, la mère de Tamocoi, c’était la
faute d’un Ayoreo qui avait raconté l’histoire du renard, erapujnangue adode (voir
section II.3.3 du chapitre II), ce qui avait provoqué des infidélités et des
séparations. À peu près à la même époque, Pojnangue — fille de Jnumi — trompait
son mari Tercio avec un autre Ayoreo qui lui aussi était marié.
En octobre 2009, les épisodes d’infidélités devinrent plus évidents et se
produisirent même avec des filles de Jesudi. Le couple se séparait mais, quelques
semaines plus tard, ils reprenaient leur relation conjugale. Les allers et retours du
couple affectaient le reste de la communauté, surtout avec les déménagements
intermittents de Lucía entre l’ogadi des Dosapei et celui de Bajai. Parfois des
discussions nocturnes réveillaient tout le monde : Lucía criait, Tamocoi partait dans
la forêt tout seul, Tu — leur fille âgée de sept ans — pleurait et essayait de suivre
son père ; ou bien c’était Lucía qui allait sur le chemin pour prendre un camion
avec Apala et Tu. Dans toutes ces occasions, Jnumi intervenait contre Tamocoi. Elle
criait, ce qui le rendait furieux. La séparation définitive eut lieu en 2010. Lucía
quitta Tamocoi et s’installa — quand elle venait à Jesudi — à l’ogadi de Bajai.
Tamocoi commença à fréquenter une femme d’une autre communauté.
Fin 2010, la situation était un peu plus stable. Tamocoi avait une nouvelle
femme et Carme — Lucía — de son côté cherchait un autre homme. Tamocoi
voulait s’établir à Jesudi avec sa nouvelle épouse mais Jnumi les a chassés. Jnumi a
fait alors une chanson à ce sujet entre juin et novembre 2010.
VI.2.2. Les chants
« Pojna ñu dirica » (« il s’est fâché avec moi hier »), nous a dit Jnumi avant
de chanter, en novembre 2010. Tamocoi se fâche avec sa mère — Jnumi
Posijñoro — en 2010 parce qu’elle n’accepte pas sa nouvelle épouse. À l’exception
de trois phrases prononcées par Jnumi, le sujet énonciateur de cette composition de
239
�Jnumi est Tamocoi. C’est toujours lui qui parle de ses désirs et de ses frustrations à
la première personne. Tamocoi est présenté comme quelqu’un qui ne peut pas
prendre de décision définitive : il veut aller avec sa nouvelle femme, mais la mère
de ses enfants lui manque. Il cherche l’approbation de Jnumi, qui rejette cette autre
femme et refuse la nourriture que son fils lui offre. Tout cela déclenche bien sûr la
colère de Tamocoi, colère intense et profonde tristesse à la fois.
VI.2.2.a)- « Tamocoi pojna Jnumi » (2010), par Jnumi Posijñoro
(enregistré en novembre 2010)
Ñijnecaosiabide gajine ga yedosuabu ñajinga datei udo gajine uengate que
yiraja yisocaique ga yacai ñujnusietigai ajeique
ga uengate que yiraja yisocai ome dicore, dicore tuaque deipise ñajenique
mu yayipieraque que jno jni disidacabode ore date case
ga uengate yayipieraque jejogatipise uñaque dei degüi quenejnaique
ga uengate que yiraja ñajeningo jeti ñijnina dicore uñaque aja yoquidai
tude uajate jeti ñijnina dicore,
(Tamocoi uruode) « mama, bajeo? Dicore uñaque chi chata cuchapisagode
ua to »
mu (Jnumi) ñojninga (Jnumi uruode :) « que mayúo ga ñimo gotoraque »
ga mama uaqué tagupusu ñajenique uje chetaque dicore.
(Jnumi uruode :) « Ijnamiane, ma ca moto uje ñijnora tu Ijnamianate? Ga
gusu pitoningaique jeti jno uyu di ga uate chicai yoquidai, que gapupe
porojo dei yajeique »
a yositome ga (Tamocoi uruode :) « yudute uje chi Lucía suaque dei siñeque
que ñimoji dejatique utigo ga yijique ga yibagüi Nena iñoquijnai
ga ñaeque ‘Nena, angosia mayoquijnai ga yisi bacatabia suaque uje yudute
to uje Nené suque chingoñu dipotac chocabode sui 15 urasabode’
e ñirique mu uengate que disiode dacatabiate pojnasia yu
ga yayipieraque dói yujoaque dicore, dicore uaque ñango ome ñu
ga dicore uaqueñaque deipise ñajenique utigo
240
�ga yii gajine ga que yayipieraque dói poi disiode ore date tuaque gajine ome
jê yayipieraque que jno jni mama uaque uje ujnai dei gate ome Lucía, mama
uaqué chopise jetiga uro Lucía
ga e ñiringo i Piradesia uengate ga mama pusi yu i gate »
ga (Jnumi uruode) « que yagu baboade, asiome dicore ga tagu baboteque.
Ijnamiane, macamo uje que bé baodie uguchade mu babe ayoré quénejna
uguchade ? Ijnamiane, macamo ore imatañone ? Ijnamiane, boto ga ajnina
dicore, date, ore, gajine ga ñisiome babode ome Lucía uaqueñaque gajine
ga ore chajni daquide i Pai Idai gajine. »
« Tamocoi s’est fâché avec Jnumi » (2010), par Jnumi Posijñoro
Je chante ici et je raconte avec nostalgie ma grande colère et je ne sais pas
quoi faire et la tristesse reste dedans
et fortement je ne sais pas quoi faire avec dicore, dicore est à l'intérieur de
moi mais je pense à la mère des enfants dans le passé [Lucía]
et fortement je pense à celle qui est dans une autre communauté [Lucía]
et fortement je ne connais pas mes désirs, si [je veux] être avec dicore à
notre communauté fortement, si je suis avec dicore
[Tamocoi à Jnumi] « maman, tu es d'accord ? Dicore a dit qu'elle t'aidera à
travailler »
mais [Jnumi] j'ai dit « je ne veux pas la voir »
et [Tamocoi] « maman m'a mis beaucoup en colère quand elle a rejeté
dicore »
[Jnumi] : « Ijnamiane172 , tu ne vois pas qu'Ijnamianate est mon amie ? Et
seulement si je meurs celle-là [dicore] viendra dans notre communauté, je ne
veux pas que celle-là travaille à côté de moi »
172
Les suffixes –ne et –nate (ou –de et –date quand il n’y a pas de sons nasaux) signifient
respectivement « père de » et « mère de ». Ijnamia est la fille aînée de Tamocoi (Ijnamiane) et Lucía
(Ijnamianate).
241
�j'ai fait comme ça et [Tamocoi] « j'ai entendu dire que Lucía est ailleurs
[communauté de 15 de Septiembre] et je ne dors pas la nuit et je suis allé
chez le beau-père de Nena173
et j'ai dit [Tamocoi à Ijnamia] « Nena, demande à ton beau-père [la moto] et
je cherche votre mère, vu que j'ai entendu dire, Nené m'a dit, qu'il y a des
jeunes qui veulent des femmes parmi les compatriotes de 15 [de
Septiembre] »
je suis arrivé mais la mère des enfants s'est fâchée avec moi
et je pense à celle-là, dicore, dicore, celle-là m'a dit [qu'elle voulait vraiment
être avec moi]
et dicore, celle-là est vraiment à l'intérieur de moi dans tout mon corps
et je ne pense pas à nouveau à la mère des enfants mais je pense beaucoup à
maman qui a la tension artérielle élevée à cause de Lucía, maman celle-là, il
semble que Lucía est sa fille
et je vais à Filadelfia fortement et maman m'a mis en colère
et [Jnumi] « je ne mange pas ta nourriture, donne ça à dicore, qu'elle mange
ta nourriture. Ijnamiane, tu ne vois pas que tu ne donnes pas de choses à tes
filles mais que tu donnes des choses à des femmes inconnues ? Ijnamiane, tu
ne vois pas qu'ils n'ont pas de vêtements ? Ijnamiane, va-t’en, va avec
dicore, sa mère, eux, et je donnerai tes enfants à Lucía, et ils retourneront
chez leur grand-père à María Auxiliadora ».
Je suis retourné à Jesudi sept mois après, en juillet 2011. La séparation de
Tamocoi et Lucía était encore plus nette. Lorsque je suis arrivé, j’ai demandé où
était Tamocoi. C’est Lucía qui m’a répondu : « dei Piradesia, nona dacote » (« il
est à Filadelfia, il est avec son épouse »). Lucía était à Jesudi en visite pour
quelques jours, puisqu’elle habitait désormais à 10 de Febrero avec sa fille cadette
Tu, à dix kilomètres au nord de Jesudi. Jnumi avait composé un autre chant dans les
derniers mois. Ce deuxième chant raconte la suite. Dans l’ensemble, il s’agit de la
même histoire, quelques mois plus tard. Tamocoi habite à Campo Loro avec sa
nouvelle femme, mais il insiste, selon Jnumi, pour obtenir le consentement de sa
173
« Nena » est un autre nom d’Ijnamia.
242
�mère. Ici l’opposition entre les deux femmes est encore plus marquée : la nouvelle
épouse est toujours rejetée alors que Lucía est présentée à plusieurs reprises comme
l’ujnai de Jnumi. Dans ce cas, la détermination de Tamocoi de quitter Jesudi semble
définitivement plus ferme.
VI.2.2. b)- « Tamocoi pojna Jnumi », (2011) par Jnumi Posijñoro
(enregistré en juillet 2011)
Uengate ñirique mu cheque dacatabia pusi yu i gateique
uengate yayipieraque jejogat ome ore disidacabode databia casica
uje yijoga yiboade aja mama mu uengate mama pojna ñu yudode
ca chi edopaique yu ome disidacabode ore databia casica uje yibai tu ome
mama a yijiape ga ñajnani yacote gajine
mu uengate mu uengate yayipieraque que chamuase pisi ore databia casica
que yiraja yisocaingome yacote uaqueñeque uje mama chapusajna
nerejaraingome mama uaque que ñamuase
(Jnumi uruode:) « jetoque jeti yagu baboade udo je chaca, yayipieraque
jejogat yicaia eo ».
(Tamocoi uruode :) « yisape yachidi ga Jesudi je chimo poi yu to, Jesudi ude
etoque jeti chimo poi ñu gajine, mama majnai tu Lucía suaque uñaque »
ga uengate pujnusietigaique ujuyapise yu ome yacote uaqueñaque uje mamá
ujnai tu disiode databia
mu a yii ga etoque jeti ude chimo poi yu to.
« Tamocoi s’est fâché avec Jnumi » (2011), par Jnumi Posijñoro
Fortement je me suis réveillé mais la femme mère [Jnumi] m'a mis en colère
Fortement je pense à la mère des enfants avant [Lucía]
J'ai dit que j'allais donner de la nourriture à maman, mais fortement elle s'est
mise en colère contre moi
elle [Jnumi] a dit que je suis aveugle avec la mère des enfants [Lucía], c'est
ma faute d'après maman, je vais et je suis avec mon épouse maintenant
[Tamocoi était allé à Campo Loro, chez dicore]
243
�et maintenant je n'oublie pas leur mère d’avant [Lucía]
je ne sais pas quoi faire avec mon épouse [dicore], vu que maman se met en
colère pour rien, je n'oublie pas [Lucía]
[Jnumi] « je ne mange pas ta nourriture, je pense beaucoup à ma première
belle-fille »
[Tamocoi] « je prends ma moto et Jesudi ne me verra pas à nouveau, Jesudi
ne me verra pas à nouveau, maman ton ujnai est pour la mère des enfants »
et fortement je suis accablé par la tristesse pour mon épouse [dicore], vu que
l'ujnai de maman est pour la mère des enfants
je m'en vais et on ne me verra plus ici.
Il y a trois aspects de ces chants sur lesquels nous voulons attirer
l’attention : la mise en évidence de la migration, la caractérisation des deux femmes
de Tamocoi, et la nourriture comme moyen d’établir des liens et de les couper.
Dans ces chants, la migration est présentée comme une conséquence, une
possibilité réelle — quelque chose qui arrivera tôt ou tard — et aussi comme la
cause d’une forte tristesse. Du point de vue exprimé dans ces compositions, la
migration est le résultat final et inévitable d’une longue histoire et c’est justement
cette certitude que ces chants contribuent à instaurer. D’après cette composition, la
conséquence du rapport entre Tamocoi et une autre femme est une double
migration. Jnumi dit à son fils Tamocoi de partir, de quitter Jesudi. Jnumi donnerait
alors ses petits-enfants à sa belle-fille et ils partiront à María Auxiliadora, chez le
père adoptif de Lucía. À cette époque-là, Jnumi était très préoccupée par cette
possible migration. Elle était très triste à l’idée de l’éloignement de ses petitsenfants — de Tu en particulier. Jnumi reproche à Tamocoi l’état déplorable dans
lequel se trouvent ses enfants. Ici l’absence de Tamocoi équivaut à l’abandon de sa
famille. Dans le deuxième chant, la situation décrite est celle de quelques mois plus
tard ; Tamocoi a finalement quitté Jesudi, ainsi que Lucía. Elle ne s’était pas établie
définitivement. Pendant plusieurs mois, elle était restée à 10 de Febrero avec sa
fille cadette, Tu ; mais parfois elles passaient quelques jours à Filadelfia et à Jesudi.
Ce deuxième chant raconte, du point de vue de Jnumi, comment son fils aîné a
244
�encore essayé d’obtenir l’approbation de sa mère concernant sa nouvelle femme.
Tamocoi essaie à nouveau de plaire à sa mère mais celle-ci le rejette encore une
fois. Ici la colère sera exprimée par Tamocoi avec la menace de la migration
définitive : « on ne me verra pas ici à nouveau ».
Dans ces deux chants, on peut voir que le moyen utilisé pour tisser un lien
entre deux individus est le même : la nourriture. Nous avons signalé dans le
chapitre précédent, qu’à l’intérieur de l’unité résidentielle ogadi, les liens
interpersonnels s’affirmaient par le biais de la co-résidence et le partage de la
nourriture. Ici Jnumi, d’un geste très fort et symbolique, rejette la nourriture offerte
par Tamocoi : « je ne veux pas ta nourriture, donne ça à dicore ». Jnumi dit aussi à
son fils de s’en aller, de ne plus habiter à l’ogadi. Elle coupe ainsi les deux types de
liens principaux qui unissent ceux qui vivent ensemble dans le même ogadi.
Finalement, il faut signaler que Jnumi refuse d’établir un lien avec sa nouvelle
belle-fille : Jnumi ne veut pas que cette femme travaille pour elle ou même à côté
d’elle.
Un troisième point qui n’est pas tellement évident est celui de la
représentation des deux femmes de Tamocoi dans les chants. L’image de Lucía est
diamétralement opposée à celle de la nouvelle épouse de Tamocoi. Jnumi présente
Lucía comme quelqu’un à qui elle est très attachée : « l’ujnai de Jnumi est la mère
des enfants » ; alors que la nouvelle femme est toujours nommée avec un terme qui
ne laisse pas de doutes sur l’opinion que Jnumi a d’elle : dicore. Il est nécessaire
d’expliquer les significations de ces deux dénominations.
VI.2.3. Les deux femmes et la mère de Tamocoi
Jnumi rejette la nouvelle épouse de Tamocoi, et cela s’entend à travers les
mots qu’elle choisit. Jnumi nomme la nouvelle épouse de Tamocoi « dicore », mot
que nous avons décidé de laisser en ayoreo dans la traduction. Dicore, au sens
propre du terme, est une sorte de démon nocturne, d’esprit malfaisant qui sort le
soir. Nous l’avions mentionné dans la section 1.4.4 de la première partie, quand
245
�nous avons signalé que les personnages monstrueux des films étaient nommés
dicore au lieu de naijnai « chaman », terme réservé aux êtres d’apparence humaine.
Par extension, on appelle ainsi pour plaisanter ceux qui sortent la nuit,
généralement, les personnes infidèles. Ainsi, Pojnangue — fille de Jnumi — fut
appelée dicore quand elle partit un matin avant le lever du soleil, sans rien dire à
personne. Elle allait rencontrer son amant à Filadelfia (c’était à l’époque où elle
était successivement avec son mari Tercio et son nouvel amant Elado). Ici, Jnumi
utilise ce mot pour faire allusion avec mépris à la nouvelle épouse de son fils,
même au point de l’utiliser dans les phrases attribuées à Tamocoi.
Concernant Lucía, Tamocoi dit dans le chant que l’ujnai de Jnumi est pour
cette femme. Qu’est-ce que cela veut dire ? La question n’est pas simple, car ujnai
est un concept qui mérite une analyse plus détaillée que celle que nous ferons dans
cette section. D’abord, partant de notre expérience de terrain, nous pouvons dire
qu’ujnai est associé à l’air et au souffle. Par exemple, quand on parlait de sexe, nos
interlocuteurs disaient qu’au moment d’avoir des relations intimes, « ujnai
tocade » (« le souffle émerge ») et ils haletaient pour nous faire comprendre. Par
ailleurs, ce terme est utilisé pour dire si un pneu ou un ballon est suffisamment
gonflé. Le gonfleur est également nommé ujnai. Dans un autre domaine, celui de la
médecine des Blancs, les Ayoreo ont des traductions pour la plupart des termes que
l’on utilise à l’hôpital. Ainsi, ujnai veut dire « tension artérielle » et ujnai dei gate
(« ujnai en haut ») signifie « hypertension ». Nous pensons — mais cette hypothèse
n’a pas été confirmée — que la traduction de ce terme physiologique tellement
spécifique aurait son origine dans les instruments avec lesquels on prend la tension.
En effet, pour la mesurer, on utilise une sorte de gonfleur. Cela nous permettrait de
comprendre le lien entre une notion médicale — la tension artérielle — relevée
dans un établissement des blancs — l’hôpital — et un concept ayoreo qui est plutôt
rapporté à l’air et au souffle vital.
Cependant, il y a une autre information qui ne vient pas du domaine
quotidien actuel mais qui peut nous aider à comprendre cette notion. Dans la
bibliographie classique de ce groupe, il y a un concept très lié aux formules de
246
�guérison sarode, celui d’uhnari. Si nous nous souvenons que le « r » intervocalique
ne se prononce pas dans la variante méridionale de la langue ayoreo, il est possible
de penser qu’il s’agit du même mot. Quant à uhnari, les interprétations varient
selon les auteurs. Selon Mashnshnek (1991), les uhñaúne sont des formules tirées
de la série de mythes concernant Asojna, l’engoulevent. D’après Bessire (2011), les
termes sarode — les formules de guérison — et ujnarone sont équivalents. Lind
(1974 : 149) signale que parfois sari et le souffle de vie ujñari174 sont équivalents,
surtout quand on construit des mots composés pour nommer une formule. Ainsi, la
formule (sari) d’un oiseau (chugupe) était appelé chugupe-ujñari175 . Sebag, pour sa
part, lie ce concept à une sorte d’essence vitale :
Ce terme d’uhrnari semble désigner « ce qui d’un être fait ce qu’il est », ce
qui lui donne sa force, sa permanence vitale : l’uhrnari est, en quelque sorte,
confondu avec la respiration et chaque être vivant possède le sien. (1965b :
94)
Dans tous les cas trouvés dans la bibliographie que nous venons de citer,
l’ujnari est associé à des êtres premiers, des entités qui ont la capacité de guérir ou
de nuire selon les circonstances. Il ne s’agit pas d’êtres humains176. Néanmoins, la
définition de Sebag met en évidence des éléments de l’uhrnari qui nous permettent
de le rapprocher du concept d’ujnai trouvé lors de notre terrain à Jesudi, notamment
l’association entre le souffle et son caractère vital.
174 « Lebensatem » dans l’original en allemand.
175 Selon SEBAG — nous rappelle LIND — l’ujñari est le souffle de vie de l’être qui a laissé la
formule de guérison sari. Ce souffle de vie de l’entité première passe au malade au moment où le
guérisseur souffle les formules sur son corps. LIND indique que ses informateurs ne voyaient pas ce
rapport entre souffle et formule. Ces informateurs parlaient plutôt d’un adjectif — ujñái, dont la
prononciation était très similaire à ujnari — se rapportant au danger et à l’effectivité, en opposition
à des formules non effectives. (LIND 1974 : 149).
176 Même si la définition de SEBAG dit « chaque être vivant », il semble attribuer ce concept
exclusivement aux êtres premiers : « [L’uhrnari] a été transmis aux hommes après avoir été exprimé,
synthétisé en une formule qu’il suffit de répéter pour que son pouvoir spécifique pénètre dans le
corps du malade. Les mots ne sont que le support d’une puissance confondue avec le souffle de tout
vivant […] » (SEBAG 1965b : 94)
247
�Lorsque nous faisions la transcription des paroles de deux chansons qu’elle
avait composées, Jnumi nous a précisé que, par exemple, « ñujnai tu
Lucía » (« mon ujnai est Lucía ») voulait dire qu’elle tenait beaucoup à Lucía.
Selon Jnumi, c’était une expression du temps des Premières Femmes. Comme il
arrivait souvent quand je demandais encore plus d’explications, Jnumi traduisit
directement le mot en espagnol : « ujnai… presión ! » (« tension artérielle»). La
traduction était la même pour la ligne « ujnai dei gate ome Lucía » : cela signifiait
que Jnumi avait une tension artérielle élevée mais aussi qu’elle était très attachée à
sa belle-fille. Nous pensons que ce n’est pas incohérent, car dire de quelqu’un bien
aimé qu’il est l’essence est clair du point de vue affectif (comme dire « mon
cœur », expression que les Ayoreo utilisent parfois en espagnol). En ce qui
concerne le signifié « tension artérielle », on peut souligner que c’est une donnée
vitale. La physiologie du système circulatoire n’est peut-être pas comprise par les
Ayoreo dans les mêmes termes que les nôtres, mais ils savent bien que la tension en
tant qu’« information du médecin blanc » est capitale et que des complications
peuvent entraîner des risques vitaux. L’association entre tension artérielle, essence
vitale et nostalgie intense pour quelqu’un est tout à fait cohérente avec les concepts
d’ijnoninguei — « santé » — et etotiguei — « force » — développés dans le
chapitre précédent. Il ne faut pas oublier que la tristesse, dans certains cas, peut être
mortelle pour les Ayoreo.
VI.2.4. Le chant dans le rêve et les pleurs matinaux
Autour de la séparation de Tamocoi et Lucía, il y a un autre chant qui a
l’avantage de nous montrer un point de vue tout particulier : celui de Fibai, le fils
de ce couple. Cet enfant âgé de neuf ans, chantait dans un rêve de Caitabia, la
deuxième épouse de Bajai. La vieille dame voyait dans son rêve le fils de Tamocoi
qui chantait avec désolation. Caitabia s’est réveillée le lendemain et a fait venir
Jnumi. Elle a interprété cet irade devant Jnumi et les deux femmes ont pleuré
ensemble. Le sujet énonciateur de cette composition est l’enfant de neuf ans qui
chante l’état d’abandon dans lequel ses parents l’ont laissé.
248
�VI.2.4. a) - « Fibai chijneca » (Caitabia urigode, juillet 2011)
Ñijnecasiabide ga oyopacho ga ñijnecaosiabide to gajine
ga jodeti je ue papá ica ga ca disijate uyoque ome uñeque to ica
mu naeque ome yapade suque gajine ga (Fibai uruode :) « que uñeque
chosiape » gajine
ga uñeque nae ome uyoque to ica (Tamocoi uruode :) « Fibai que disijat ua
gajine »
mu taaque papá uque to ica.
Ore tora ñoque to ica, ñujnusipise ite tuaqué uje yayipiedopise ite uaque que
casi ñongome cuchaique ica
ga chaguode chuje yoque ga yayipiedepise ite uñaque to dejaque uje uñaque
naeque (Lucía uruode :) « Fibai, a yii jne ga jetoque jeti yayipiedopoi
auatique gajine » ite uaque naomeñu
ga cuchaique jeti gajine chaguei urosoique ute Ijnamia uyoque
ga yayipieraque dojogui ite uñangue ome ñoque ga ñaeque (Lucía uruode :)
« a yi gajine ga que yayipieraque doipoi guidai ude gajine »
ga (Fibai uruode) « yii gajine ga yitarata je eratique gajine » yayipieraque
udaque dojogui ite uru casode ome uyoque dejaque uje que casi ñongome
chaguei urosoique dirica chisapie cuchadacadode ome uyoque.
Je ue pise ite uaté dejaque uje que ñimopoi ite uaté
ga yii gajine ga papá que chimopoi uyoque gajine Ijnamia uyoque uje que
casi ñongome cuchapisatique uté ica
uaté jnopise ica ité uaque dejaque uje que chimo poi uyoque to uje yapade
chañome uyoque ica ga je yuruabio sudoque uñeque chosi (te) ome ñu to
« Fibai a yii gajine ga etoque jeti yajíe uaque gajine ga quetoque ti ñajni
macamanique gajine ».
« Fibai a chanté » (rêve de Caitabia, juillet 2011)
Je chante ici et taisez-vous, je chante ici maintenant
Papa ne disait pas la vérité [quand il a dit] que nous n'étions pas des
orphelins
249
�mais j'ai dit à mon père « personne ne fait comme ça » maintenant
et celui-là [Tamocoi] nous a dit : « Fibai, tu n'es pas un orphelin »
mais papa mentait.
Ils nous ont abandonné. Ma mère me manque beaucoup, quand je pense
beaucoup à ma mère qui ne me demandait pas de faire des choses
et la faim nous frappe et je pense beaucoup à ma mère, c'était le soir quand
elle a dit « Fibai, je m'en vais et je ne penserai plus à ce lieu » ma mère m'a
dit.
Et la faim nous fait tellement de mal à moi et à Ijnamia !
Et mon ayipie amène ma mère pour nous et elle a dit « je m'en vais et je ne
penserai plus à cette communauté »
et [Fibai] « je m’en vais maintenant et je mourrai maintenant », mon ayipie
amène les vieux mots de ma mère pour nous le soir, la faim nous fait du mal,
je pense à ce qui nous est arrivé
C'était vrai ce que ma mère disait, que je ne la reverrai pas
et je [m’en] vais et papa ne nous verra plus, Ijnamia et nous, vu qu'il ne nous
donne pas de nourriture
elle s'en est vraiment allée, ma mère, le soir elle ne nous verra plus, vu que
mon père ne nous aime plus et voici mes mots, celui-là a fait comme ça avec
moi « Fibai, je m'en vais et je ne vous regarde plus et je ne retournerai pas à
votre lieu »
Ce troisième chant nous montre une vision de la même situation du point de
vue des enfants abandonnés. Dans la vie quotidienne, Fibai ne chante pas ; aucun
enfant ni aucun jeune ne chante. Chanter ou écouter un chant dans un rêve arrive
parfois chez les Ayoreo de Jesudi. Ainsi, Jnumi a rêvé une fois que le dernier époux
de Pojnangue partait et qu’elle chantait sa nostalgie pour lui (irade nº 13) et Echoi
Picanerai — qui ne chante pas — a interprété un chant dans un rêve d’Uguri
Dosapei. Ces chants étaient ensuite interprétés par Jnumi et Uguri comme s’il
s’agissait de n’importe quelle autre composition qu’ils aimaient partager le soir
autour du feu. Par ailleurs — dans un autre domaine de chants —, la plupart des
enominone — chants prémonitoires de chamans — racontent des visions présentes
250
�dans des rêves177. Le statut des irade — ceux de Fibai, Jnumi et Echoi — ne semble
pas être différent des chants composés et interprétés en état de veille. Quand
Caitabia nous en a parlé, elle disait que l’auteur du chant était sans aucun doute
Fibai. En plus, elle signalait qu’il semblait s’être inspiré d’un chant d’une femme
— Amoinate — qui vivait dans une autre communauté car les deux chants
racontaient des histoires similaires. De notre point de vue, même si d’après
Caitabia, c’est un chant composé et interprété par Fibai, elle a fait venir Jnumi pour
qu’elle l’écoute, pour partager cet irade avec des caractéristiques d’uñacai. Nous
interprétons cela comme un effort de rapprochement des femmes de deux ogadode
entre lesquelles il y a souvent des tensions.
Ce chant présente plusieurs particularités ; entre autres, celle d’avoir
quelques traits caractéristiques des chants de tristesse uñacai, bien qu’il s’agisse
d’un irade. Les irade racontent les mésaventures d’un couple du point de vue de
l’un des deux conjoints ou bien de celui d’une belle-mère. Quoi qu’il en soit, ces
compositions parlent d’un couple qui va se séparer — « je te quitte » ou « il/elle
m’a quitté(e) » — ou qui devrait se constituer — « marie-toi avec telle personne »
ou « ta fille a volé le mari de la mienne ». Les irade sont centrées sur les relations
entre conjoints, alors que le chant de Fibai nous parle des enfants abandonnés par
leur mère et leur père. Cependant, ce n’est pas un chant de tristesse uñacai, car les
individus qui sont partis — Lucía et Tamocoi — ne sont ni malades ni décédés.
Les caractéristiques formelles générales sont celles d’un irade : il est
introduit par la phrase « je chante ici », il raconte deux dialogues avec Tamocoi et
Lucía, un couple qui s’est séparé et qui est finalement parti. Le verbe –ujnusi —
définitoire de ce genre — est utilisé pour exprimer les sentiments du sujet
énonciateur. Or, quelques particularités se rapprochent de la tristesse intense des
uñacai. Dans la première ligne, l’interpellation oyopacho — « taisez-vous » — est
une marque des uñacai, utilisée quand la personne qui va se mettre à pleurer,
demande l’attention du reste de la communauté avant de commencer à pleurer en
177
Pour d’autres aspects concernant les rêves et le rôle de l’uritai « rêveur », cf. CALIFANO (1990) et
BÓRMIDA (1984).
251
�criant. De plus, la référence à la « faim qui fait du mal » — « chaguei
urosoique » — est la phrase la plus typique des chants uñacai. Nous verrons ces
aspects plus en détail dans la section suivante. Ce que nous voulons mettre en
évidence, c’est que l’irade de Fibai va encore plus loin que celui de Jnumi dans la
description des conséquences néfastes de la séparation d’un couple, au point
d’ajouter des traits caractéristiques des chants uñacai, compositions qui sont
interprétées suite à la mort de quelqu’un, ou lorsque l’on redoute son décès.
Si l’on connait les gens de Jesudi, particulièrement les ogasuode — parents
de la même unité résidentielle — de Fibai et de Ijnamia, on sait que cette
déclaration d’abandon, de la faim qui fait du mal est — disons — un peu exagérée.
Même si Tamocoi et Lucía quittaient Jesudi et laissaient Fibai tout seul, sa grandmère Jnumi le prendrait sans aucun doute en charge. Généralement, Fibai joue avec
Chiqueno, fils de Pojnangue, petit-fils préféré de Jnumi. Ces deux enfants sont
presque toujours ensemble à l’ogadi des Dosapei, et c'est là où Fibai mange tous les
jours. Dans le cas très hypothétique où Jnumi ne pourrait ou ne voudrait pas
s’occuper de Fibai, il pourrait aussi aller chez les ogasuode du côté de sa mère,
c’est-à-dire à l’ogadi de Bajai. Quant à Ijnamia, elle était mariée depuis début 2009
avec Ujniete. Autrement dit, elle avait un homme qui subvenait à ses besoins
— même si Ujniete ne le faisait pas très bien, comme Jnumi le signalait souvent. La
séparation de Lucía et Tamocoi, l’éparpillement des membres de leur famille, sont
des événements importants et graves pour les gens de Jesudi et c’est cette gravité
que ce chant rêvé met en relief. Ce n’est pas qu’ils mourront de faim, mais il
signale l’absence de la personne qui les nourrit. Le signe employé pour transmettre
les sentiments de solitude et de tristesse est celui de la faim.
VI.2.5. Conclusion de VI.2
Nous avons vu comment, à partir d’une situation banale — la séparation
d’un couple —, se construit toute une série de récits. En fait, « l’affaire Tamocoi »
dépasse largement le traitement que nous lui avons consacré. Il est difficile de saisir
cette affaire dans toute sa dimension, car le faire impliquerait de pouvoir enregistrer
252
�tous les commentaires dans les divers ogadode, les conversations entre Tamocoi et
sa mère, entre Lucía et Pojnangue, etc. Parmi tous ces récits à propos de Lucía et
Tamocoi, certains sont plus transmissibles que d’autres. Les chants sont répétés
— parfois enregistrés et envoyés — et écoutés par tout le monde. En revanche, la
circulation des commérages est plus limitée. Ils sont souvent déformés quand ils
sont transmis. Nous avons enregistré certains chants plusieurs fois et nous pouvons
dire qu’en dehors du changement de quelques mots ou du raccourcissement de
quelques phrases, l’histoire racontée reste la même. Ce sont donc les chants, que
nous pourrions appeler « commérages chantés », qui deviennent les récits les plus
entendus à propos d’une histoire. Dans le cas de la séparation de Tamocoi et Lucía,
il s’agit de la description d’une séparation au travers du prisme de la nostalgie
— jnusietigai —, état affectif lié à l’absence de quelqu’un. La migration comme
menace distante est bien présente dans ce chant et elle est la conséquence des
actions de Tamocoi, et cause de la tristesse de sa mère et de ses enfants. Dans ce
cas, un troisième élément s’ajoute : le chant de Fibai, qui fait monter la composante
tragique à un niveau extrême. Comme nous venons de le dire, ni Fibai ni Ijnamia —
et les deux autres filles non plus — ne risquent de mourir de faim. Néanmoins,
Caitabia « fait » un chant qui va au-delà de l’irade courant pour incorporer des
traces de chants uñacai : de deux adultes qui se disputent, nous sommes parvenus à
un enfant dans un tel état d’abandon que la faim lui fait mal. Voici ce qu’un chant
peut faire d’une affaire conjugale : il sert à mettre en rapport cette situation
particulière avec le concept de jnusietigai qui survole toute la vie sociale ayoreo, le
don de nourriture comme établissement d’un lien, la migration comme conséquence
habituelle des disputes, et ses effets sur les personnes proches qui souffriront de la
tristesse ou de la faim. Ces chants montrent les conséquences sur d’autres
personnes, ils rappellent à Tamocoi que son rapport avec Lucía et Dicore va bien
au-delà de leurs personnes, qu’il ne représente qu’un maillon de chaîne.
253
�VI.3. Les chants de tristesse uñacai
Les Ayoreo disaient toujours qu’ils chantaient le soir parce qu’ils étaient
contents. Cela est vrai indépendamment du contenu du chant, qui peut aller d’une
auto-glorification guerrière après avoir tué deux victimes, jusqu’à une dispute entre
deux femmes pour le futur époux de leurs filles respectives. Une catégorie a
particulièrement attiré notre attention, celle des uñacai. Ces chants racontent le
décès ou la maladie grave de quelqu’un et mettent en relief l’état d’abandon et de
solitude dont l’épouse ou le frère du défunt souffrent. Malgré le contenu fort triste
de ce genre, ils continuent à signaler que la personne qui chante est contente.
Après un an de terrain, une autre circonstance s’est finalement présentée,
radicalement différente de celle des interprétations quotidiennes du soir. Lors de
cette première occasion — d’autres sont arrivées dans les mois qui suivirent —, une
femme criait et pleurait en chantant : elle était visiblement triste. Son chant donnait
l’impression d’être interprété avec autant de sentiment que de correction stylistique.
Cette section se consacre à l’analyse de ces pleurs à haute voix, des circonstances
dans lesquelles il est indiqué de les interpréter, et des paroles — toujours nouvelles
mais suivant des règles spécifiques. Il faut souligner que nous ferons une microanalyse de ces chants ayoreo dans le but de les mettre en relation avec le reste des
chants, notamment les irade178.
Nous distinguerons tout d’abord deux instances de la performance des
uñacai et nous nous concentrerons, dans cette section, sur la première instance.
Nous analyserons la première instance du point de vue de la mise en place du
chant : la personne qui pleure, qui crie et qui chante, et ceux qui sont présents et
l’écoutent. Puis nous analyserons les paroles des uñacai : ce qu’ils disent
ouvertement et ce qu’ils laissent entendre par le biais des références indirectes.
Enfin nous verrons que la tristesse n’est pas une affaire individuelle.
178
Notre étude porte sur les rapports entre vie sociale et discours, affectivité et rapports politiques à
l’intérieur de la communauté de Jesudi. Il y a une vaste bibliographie sur les chants de deuil (…) de
laquelle on pourrait partir, mais une telle analyse impliquerait une autre approche qui ferait de l’étude de
ces chants l’élément central. Ici, les uñacai constituent un pas dans notre parcours qui va de la vie sociale
affective au discours, puis de nouveau à la vie sociale.
254
�VI.3.1. Pleurer avec des mots
Les uñacai constituent l’un des deux genres de chants que les Ayoreo aiment
le plus interpréter. Selon le dictionnaire des New Tribes Mission, ce mot signifie :
Uñacarãi : n.m. –NP mourner. // var. uyacarãi. //f. uñacaré. //
pl. uñacarane (‘) ; dim. uñacarámi ; d.f. uñacarãc, uñacarãcho ; i.f.
uñacarãtic, uñacarãtigo. (Higham et al. 2000 : 830 )
Uyacade : n.m.pl. wailing ; grieving, with mournful crying ; mourning, with
loud crying. // Dupade tangári israélgosode cutejmane ore uyaca uje ore
chisa dabade iji damajosórone josipiedie jmainie… (JUE 2 :18). // God
paid attention to the Israelites’ great amount of wailing when they cried out
loudly under the control of their enemies’ mistreatment…// pl. uyacade (‘) ;
dim. Uyácabóde ; d.f. uyaca ; i.f. uyacárigo. (Higham et al. 2000 : 862).
D’après les Ayoreo, le sujet énonciateur d’un uñacai ne chante pas
— chijneca —, il pleure — po. Les Ayoreo mettent en relief le contraste entre les
irade et les uñacai. Même s’il est possible de voir que les deux genres se rapportent
à l’absence d’un individu, il y a une distinction très nette entre les sujets
énonciateurs et les états affectifs que ces sujets expriment respectivement. Comme
nous l’avons signalé plus haut, dans les irade un conjoint ressent de la nostalgie
— jnusietigai — pour son partenaire qui est parti et il chante ce sentiment. Dans les
uñacai, le sujet énonciateur typique est tout simplement quelqu’un qui pleure pour
un quelqu’un d’autre — un enfant, un frère, un ami, pas nécessairement un
conjoint. C’est en tout cas cette action — pleurer — qui est signalée comme celle
qui définit ce genre. Les Ayoreo remarquent en plus que, même si on peut percevoir
une vocalisation rythmée, la personne ne chante pas. Or, il est possible de chanter
un uñacai. Il faut maintenant entrer dans les détails de la performance de ces chants
de tristesse pour pouvoir comprendre cette contradiction apparente.
Il est possible de distinguer deux instances de la performance d’un uñacai.
Nous les nommerons la première et la deuxième instance de la performance. La
255
�première instance est celle où le chant est à la fois composé et interprété. Le sujet
énonciateur et le compositeur sont une seule et même personne qui pleure en criant
et en chantant. La deuxième instance a lieu lorsque le chant est répété par son
auteur ou toute autre personne dans un contexte très différent du cas précédent,
c’est-à-dire dans les circonstances quotidiennes du chant (le soir autour du feu, par
plaisir, etc.). Dans ce cas, celui qui chante est en train d’imiter — chirate — les
pleurs de l’auteur. Le chanteur, en effet, chante parce qu’il est content — chijneca,
yasique gu179 —, alors que le sujet énonciateur du chant est accablé par la tristesse.
Les circonstances des deux instances sont très différentes. Dans cette section, nous
nous concentrerons sur la première instance, celle où les mots et l’esprit se
conjuguent.
Nous pensons que l’uñacai, en dehors du côté cathartique toujours présent,
sert à mettre en relief le rapport de dépendance entre les individus. Cet aspect est
aussi présent dans la performance que dans les paroles de ces chants de tristesse.
Voyons maintenant un exemple de la première instance d’un uñacai.
Un soir, vers minuit, j’étais en train de dormir dans ma tente quand, tout à
coup, j’ai entendu une voix qui criait et pleurait rythmiquement. Elle venait de la
maison de la famille Dosapei. C’était une sorte de pleur à haute voix avec des
phrases intercalées et longues jusqu’au point de perdre le souffle. D’autres pleurs
sans mots se faisaient entendre comme une seconde voix. De toutes les maisons,
des individus sortaient et se rendaient sur le lieu d’où les cris et les pleurs
provenaient. J’y suis allé aussi. À l’intérieur de la maison, Jnumi, femme d’une
quarantaine d’années — l’épouse du chef —, était assise sur ses talons et elle
pleurait en chantant, les yeux vers le sol. Lucía, l’épouse de Tamocoi — fils de
Jnumi — pleurait sans chanter d’une manière continue. À côté de Jnumi, Ebedu,
son époux, était allongé et totalement couvert par un drap. Je ne pouvais pas
comprendre les mots du chant mais Ome, épouse d’un autre fils de Jnumi, m’a dit
que Ebedu avait mal aux oreilles. Après des mois de chimiothérapie et de
179
Ch – ijneca,
yasique
gu
3ºsing – chanter –content def. form – Caus
256
�corticoïdes, la chute des défenses immunitaires d’Ebedu le rendaient sensible à tout
type d’infections. Ebedu souffrait et Jnumi craignait sa mort. Je lui ai donné un
anti-inflammatoire. Soudain, Jnumi s’est arrêtée de chanter, Ebedu a pris la pilule et
chacun est rentré chez soi.
J’ai été témoin des chants uñacai dans neuf autres occasions, dont aucune
n’était liée à un décès. À une exception près 180, dans tous les cas il s’agissait d’une
personne qui craignait la mort d’une autre, soit à cause d’une maladie, soit à cause
de la faim. En dehors de ces dix occasions en première instance, j’ai enregistré dixsept exemples de la deuxième instance, c’est-à-dire quand l’uñacai est devenu un
chant. De ces dix-sept exemples, dix sont des cas de décès, et le reste est constitué
de cas de maladies graves.
Les uñacai peuvent être interprétés — en ce qui concerne la première
instance — à n’importe quel moment de la journée, pas exclusivement le soir.
D’ailleurs, celle que l’on vient de décrire était la seule occasion nocturne. J’ai vu
des hommes et des femmes chanter de la même manière, avec la même
combinaison de cris, de larmes et de phrases rythmées. Le début et la fin du pleur
sont abrupts. Avant de commencer, la personne ne pleure pas du tout. Une fois
l’uñacai fini, l’individu sèche ses larmes, nettoie son nez et généralement demande
un peu d’eau pour se refroidir la gorge. Ces démarcations si tranchantes permettent
de le repérer clairement comme une unité distinguable. Ce ne sont pas des mots que
l’on laisse écouler accidentellement entre les sanglots. Bien au contraire, il s’agit
d’une vraie technique de chant et de pleurs, d’une composition qui présente des
régularités dans sa performance et dans son contenu.
Voyons les traits les plus caractéristiques que nous avons repérés lors de
notre terrain. D’abord, il faut souligner — comme Seeger l’avait fait pour les Suya
(1985) — que le son voyage bien dans cette petite communauté. Nous avions
remarqué dans le chapitre précédent que tout est à portée de vue. Il faut dire en plus
180
La seule exception est le cas de Daju qui pleurait parce que l’une de ses filles était allée à Asunción :
la mère craignait que la fille se perde dans la grande ville. Nous n’avons pas pu savoir si Daju considérait
cette possible mésaventure comme mortelle.
257
�que tout est à portée d’ouïe : si quelqu’un pleure en chantant, on l’entendra aux
quatre coins de Jesudi. La combinaison particulière de pleurs et de mots est
reconnaissable de loin. La personne qui pleure — nous le verrons en détail —
n’appelle pas les gens d’une manière explicite « venez… ! », mais ses lamentations
à haute voix constituent une convocation, confirmée par l’immédiate réponse de
presque tout le monde. Les gens viennent et se mettent à côté de celui qui pleure
sans rien dire — ou bien parfois ils demandent ce qui se passe. Ils restent silencieux
avec le sourcil légèrement froncé, une expression que j’attribuais à la tristesse ou à
la préoccupation.
L’uñacai est une composition qui relie deux aspects apparemment
contradictoires : la spontanéité et la structuration. Déjà, la première fois, l’intensité
des pleurs m’avait autant impressionné que la régularité rythmée du chant. En
réalité, c’était la conjonction de ces deux caractéristiques en tension qui m’avait
frappé. Greg Urban, dans son célèbre article de 1988 sur les chants rituels de deuil
au Brésil, avait remarqué la nature double de ce genre de chants. Urban signale que
les chants de deuil servent à deux fins : l’expression ouverte des émotions de
tristesse et la manifestation du désir de sociabilité. Ces chants sont toujours
interprétés — nous dit l’auteur — quand une mort s’est produite. C’est dans ces
moments bouleversants que les rapports de solidarité risquent de s’affaiblir. Urban
propose alors l’intéressante hypothèse selon laquelle l’aspect le plus structuré du
chant concerne la manifestation d’un désir de sociabilité : chanter au bon moment
en suivant des règles rhétoriques spécifiques signifierait que, même dans ce
moment d’angoisse extrême de la perte d’un être cher — qui était par ailleurs une
ressource économique —, on veut se conformer aux règles de la société.
Les chants de deuil mettent en jeu, d’après cet auteur, trois méta-signes.
Autrement dit, trois caractéristiques du chant le situent par rapport au contexte et
aux autres domaines du discours. D’abord, le méta-signe de la tristesse, c'est-à-dire
les traits qui pourraient être reconnus comme indices de cet état affectif dans
diverses cultures : les pleurs marqués, les larmes et la voix en falsetto connotent la
tristesse de la manière la plus évidente possible. Ensuite, le méta-signe de la
258
�sociabilité : les régularités rhétoriques — longueur de la ligne, intonation, etc. —
montrent que l’individu suit et veut suivre des règles, il veut rester membre de la
société. Finalement, le méta-signe poétique : l’aspect musical du chant accomplit la
fonction d’attirer l’attention sur lui-même, de le détacher du discours quotidien.
Le pleur chanté uñacai est quelque chose de vraiment structuré : c’est une
technique que l’on doit apprendre à maîtriser. Le processus d’apprentissage n’est ni
complexe ni systématique, puisqu’il consiste tout simplement en une imitation.
Selon Jnumi, Puua Chiquejñoro, vieille dame de la première génération, lui avait
appris à –uñaca quand elle était jeune : « osi te :… » (« fais comme ça :… »), et
elle lui avait montré comment on devait faire selon le clan de la personne pour
laquelle on pleurait. Jnumi à son tour a essayé en 2011 d’enseigner à Meri
Dosapé — petite fille de Chicori — à pleurer en chantant. Golo Dosapé, cousine de
Meri, était à l’hôpital dans un grave état de septicémie et cela rendait Meri
naturellement très triste. D’après ce que Jnumi nous a dit, il n’y a rien de particulier
dans l’enseignement : cela consiste tout simplement à donner des exemples
d’uñacai. Il s’agit de dire les mots précis au moment adéquat. Nous y reviendrons.
Urban met en relief que, pour les Shavante et les Shokleng, il y a une
distinction claire entre pleurer seulement avec des larmes — à la manière des
enfants — et pleurer en chantant (Urban 1988 : 394). La même opposition existe en
ayoreo. Jnumi nous a raconté que quand elle était jeune, elle ne savait pas chuñaca
(verbe –uñaca en 3e pers. sing), elle pouvait seulement po bisideque. Le verbe –
uñaca et –ungu signifient « pleurer en chantant ». Les Ayoreo opposent ce verbe à
celui de –ibo (3e pers. sing. po) qui est généralement présenté ainsi : po bisideque
pour renforcer le contraste. Bisideque est un mot employé dans plusieurs
allocutions et qui indique que l’activité menée est d’une certaine manière
incomplète ou bien qu’elle n’atteint pas son objectif original. Ainsi, par exemple :
259
�ñisore bisideque181 : « je me promène », alors que -isore tout seul signifie
« partir à la chasse »
choji bisideque182 : « il boit (le cocido) sans rien manger ». (-oji : boire)
chisiome (quelque chose) bisideque183 : « il lui a offert (quelque chose) ». Au
sens littéral : « il lui a donné (quelque chose) gratuitement »
Selon le dictionnaire des New Tribes Mission :
Bisidei : adj m. free ; without charge ; for no reason ; just for fun ; of no
value ; of little importance (…). d.f. bisidec. (Higham et al. 2000 : 125)
Dans les circonstances appropriées pour l’interprétation d’un uñacai, c'est-àdire quand on craint la mort de quelqu’un, pleurer tout simplement, –po, est
considéré comme dépourvu de sens, comme une action incomplète. L’aspect
cathartique se rend manifeste ici : si on po bisideque (pleurer sans chanter), ça fait
très mal à la tête (gatoi urôso184). C’est comme s’il fallait pleurer en chantant pour
expulser ce sentiment d’angoisse qui resterait dangereusement dans le corps,
comme si pleurer sans mots ne suffisait pas. En outre, l’uñacai doit être interprété
dans les jours suivant le décès de la personne pleurée, pas beaucoup plus après.
Cette idée d’interpréter un uñacai bien après semblait tout simplement laide
(« poitac ») pour Jnumi et elle ne pouvait pas se souvenir d’un exemple. Le seul
exemple auquel elle a pensé était celui d’une femme qui avait chuñaca un an après
le décès de son fils. Néanmoins, cette femme pouvait être excusée — nous a dit
Jnumi — parce qu’elle avait, au moment de chuñaca, un autre fils malade qui lui
rappelait le destin tragique de son frère, décédé l’année précédente. Même si le
181
ñ-isore
bisideque
1re sing - partir à la chasse sans raison
182
ch-oji
bisideque
3e sing-boire sans raison
183
ch- isiome bisideque
3e sing- donner sans raison
184
gatoi urôso
tête douleur
260
�chant parlait d’une douleur ancienne, il exprimait une peur bien actuelle : le
possible décès d’un autre fils.
VI.3.1.1 Conclusion de VI.3.1
L’uñacai est une sorte d’appel. Il a une double nature. Individuelle, c’est
l’expression de douleur d’une personne spécifique pour une autre personne
spécifique. Mais cette douleur est mise en scène de manière à faire participer
passivement, en tant que public, le reste de la communauté. Cette performance
inclut tout le monde — en tant qu’auditeur, même si c’est par accident (Urban
1988) — dans une affaire qui pourrait être considérée comme personnelle. La perte
d’un proche n’est pas une affaire qui reste dans le domaine privé. Le fait même de
la chanter la situe dans le domaine du langage, la met en circulation. Le fait de la
chanter convertit cette situation personnelle et traumatisante en une affaire sociale
et partagée. Interpréter un uñacai — et le composer en même temps — consiste
d’abord à sociabiliser la douleur, à la faire entrer dans la sphère sociale. Or, il est
extrêmement difficile de parler — en tant que chercheur — de la douleur des
autres, d’un état interne dont on ne connaît que les manifestations verbales et
comportementales. Nous ne pouvons rien dire des états affectifs internes des
Ayoreo. Nous pouvons, au contraire, signaler qu’ils combinent des traits associés à
la tristesse dans la plupart des cultures — des pleurs, des larmes, la voix de
fausset — avec des procédés fortement structurés de la parole. Si nous osons dire
que les Ayoreo sociabilisent la douleur, c’est parce que cet état affectif est exprimé
dans les paroles de ces chants. Contrairement aux exemples présentés par Urban,
les Ayoreo font une déclaration explicite et directe de la tristesse. Nous verrons
qu’en même temps, mais d’une manière plus subtile, ils demandent à être intégrés à
un réseau de réciprocité, car avoir perdu un ami ou un parent signifie avoir perdu
une ressource économique.
VI.3.2. Les paroles des chants de tristesse
La moitié des uñacai que nous avons enregistrés commencent par cette
allocution : « Taisez-vous maintenant, je pleure ». Cette phrase est une
261
�interpellation directe aux autres — à l’impératif — et demande leur attention et leur
silence. Contrairement aux exemples présentés par Urban (1988), il y a un moment
dans l’interprétation de ces chants de tristesse où le souffrant s’adresse au public.
Cela se passe au début, et il ne répétera pas cette demande. Quelle est la raison de
cette introduction ? On pourrait penser aux contextes quotidiens des Ayoreo :
plusieurs personnes parlent autour du feu, parfois les phrases des uns et des autres
se superposent. « Oyopacho » (« taisez-vous ») consiste à demander d’arrêter ce
déroulement partagé de la parole et de devenir le centre de d’attention : les autres
sont à l’écoute d’une seule personne.
Voyons maintenant les éléments les plus récurrents de ces chants à partir
d’un exemple. C’est un uñacai interprété par Jnumi Posijñoro quand son fils
Puchiejna Dosapei était gravement malade, en raison de l’attaque d’un chaman
angaité. Il ne pouvait plus marcher, « son sang ne coulait pas » et les médecins
d’Asunción n’avaient pu trouver ni la cause ni la solution pour le guérir.
Uñacai pour Puchiejna Dosapei (par Jnumi Posijñoro)
Oyopepaque gajine ga ñunguamu cutemai tuqué ñujnacari gajine.
Oguiyabape yu iji auatadatei yabai uyoque gajine i quiganingo jnacari
ujadode i quigade gajine ca chi yajiase yiquenique iji yoquidai.
Oguiyabape coongopiejna ojosogoma yabi uyoque i quiganingo gajine
pitoningai enoñaique ujnienepise.
Oguiyabape yu iji cutema case ñujnacari i quiganingo gajine pitoningai
enoñangue ujnienepise aquesua tiachutic yape uñengomeñu ga ca chi
uñeque dei dojoique jnacari ajnamitic
ga uñeque naiase omeñu gajine « mama yoquicho i yocajnamite date »
yichapia yu aja yoquirosori casicaite ga yajíe putugutaroi penojnangue
ñujnacari uñeque gajine ga ñimo duasede uñeque i yiquenique gajine ga
uñeque doi dapaganejnai daecujat ome nanique uyoque ca chi uñeque dei
siñeque gajine.
262
�Oguiyabape aquiajna ojosogoma yacaía gajine chaguei urosoique
ujnienepise uñaque gajine uñeque nae « aja bei ga agu yigaidode
cuchapibose ».
Oguiyabape ome uñeque ategoningai uñeque ategoningaique cutema case
ñujnacari uñeque.
Taisez-vous maintenant, je pleure en chantant pour mon très beau fils
Je pleure pour mon époux, le jaguar sans peur. Nous sommes restés derrière,
parmi les jeunes [vivants] et je ne le vois pas devant moi dans notre
communauté.
Je pleure pour la belle plante de courge, mon fils. Nous sommes restés
derrière. La très laide mort a pris celui qui est très beau
Je pleure pour celui qui avant était beau. La mort très laide [a pris] celui qui
est très beau, le bel arc-en-ciel, mon fils. Peut-être est-il en train de jouer
avec les jeunes. Il m’a dit « maman, nous avons gagné un match
important ».
Je pense à notre ancien patron [à Loma Plata] et je vois mon fils, la très
belle peau de jaguar, et je le vois devant moi, celui-là nous apportait de
beaux mots et peut-être il est ailleurs [il n’est pas malade ou décédé]
Je pleure pour la belle vache, ma belle-fille, elle est belle, la faim lui fait du
mal. Celui-là avait dit « tiens, mange mon repas »
Je pleure pour celui qui avant était beau et généreux, mon fils.
VI.3.2.1. Le passé heureux et le triste présent
Jnumi pleure pour son fils, elle craint sa mort et elle met en relief ce
malheureux état de Puchiejna notamment à travers le contraste entre passé et
présent. Cela permet de construire dans le récit deux situations diamétralement
opposées. D’un côté, le passé est identifié au temps où Puchiejna était en bonne
santé, beau et fort. De l’autre, le présent est le moment où Jnumi chante : Puchiejna
263
�a été pris par la mort et ses parents sont restés « derrière », parmi les jeunes
hommes vivants.
Le moment du passé dont Jnumi se souvient est celui d’un match de football
qu’ils ont joué à Faro Moro, à dix kilomètres au nord, quelques mois avant le début
de sa maladie. Même si les caractéristiques de ce temps passé nous font penser à
une idéalisation, cette image précise d’une anecdote a une force toute particulière :
c’est un moment défini, une image vécue où l’on peut voir Puchiejna — l’un des
meilleurs joueurs de Jesudi — dans toute la splendeur de sa jeunesse.
Par ailleurs, il arrive, comme dans les dernières lignes, que ces temps du
passé soient identifiés au travail dans une ferme des mennonites185 . Cette
identification est compréhensible pour deux motifs : d’un côté, le travail chez un
mennonite implique une migration de la famille nucléaire, ce qui définit une
période identifiable dans le temps ; de l’autre, avoir du travail implique de gagner
de l’argent pour manger, mais aussi de pouvoir aller à la chasse ou à la cueillette de
tortues aux alentours de la ferme. C’est une période — parfois des semaines,
parfois des mois — de facilité économique.
Ces moments du passé heureux ne se rapportent pas seulement au défunt ou
au malade. Bien au contraire, cette référence est une occasion pour Jnumi de
montrer son propre bonheur d’autrefois :
uñeque nae « aja bei ga agu yigaidode cuchapibose » : Celui-là avait dit
« tiens, mange mon repas »
En fait, ce que Jnumi est en train de nous dire n’est pas seulement que son
fils était en bonne santé avant et que maintenant il risque de mourir. En réalité, elle
parle d’elle et de son époux Ebedu, elle insiste sur le fait qu’ils ont perdu quelqu’un
qui leur donnait à manger, ils ont perdu un lien dans cet important réseau
d’échanges qui constitue la vie sociale ayoreo.
185
Voir aussi les uñacai 2, 5, 11, 15 et 16.
264
�Le présent construit dans l’uñacai transmet la même information mais sous
le signe du désespoir :
Oguiyabape yu iji auatadatei yabai uyoque gajine i quiganingo jnacari
ujadode i quigade gajine ca chi yajiase yiquenique iji yoquidai.
Je pleure pour mon époux, le jaguar sans peur. Nous sommes restés derrière,
parmi les jeunes [vivants] et je ne le vois pas devant moi dans notre
communauté.
Ce qui auparavant était une situation heureuse est maintenant une source
d’angoisse et d’abandon, exprimée surtout par l’absence de nourriture :
Oguiyabape aquiajna ojosogoma yacaía gajine
chaguei urosoique ujnienepise uñaque
Je pleure pour la belle vache, ma belle-fille, elle est belle,
la faim lui fait du mal.
Dans ce contraste passé-présent, le pleureur est celui qui recevait avant des
cadeaux de la part de celui qui aujourd’hui est malade : « Celui-là avait dit ‘tiens,
mange mon repas’ ». Au moment de chanter, cette personne généreuse est décédée
ou malade et le pleureur se trouve dans une situation d’abandon. La phrase la plus
récurrente dans les uñacai, celle qui exprime le plus clairement la tristesse de celui
qui est resté est : « chaguei urosoique » (« la faim me fait du mal »). La faim, bien
sûr, n’est pas seulement un état physiologique, elle indique l’abandon, la perte d’un
lien de réciprocité : « to be hungry therefore, implies more than merely a condition
of physical need. It also implies isolation from companionship » (Schieffelin 1976 :
71). L’uñacai constitue la verbalisation de cet état et sa communication aux autres
membres de la communauté (la voix du pleureur est entendue bien au-delà de
l’unité résidentielle). Non seulement dans la performance, mais aussi dans le
contenu, il est possible de trouver des signes qui renvoient constamment à la
265
�dépendance des autres. L’un des plus remarquables est la mention des edopasade,
les appartenances claniques.
VI.3.2.2. Le bel arc-en-ciel et la belle plume de cigogne
Le trait qui a attiré notre attention dès le début était naturellement la mention
récurrente des edopasade. Les edopasade, comme nous l’avons expliqué dans le
premier chapitre de cette partie, sont les appartenances claniques : chaque plante,
animal, objet ou accident géographique appartient à l'un de sept clans ou cuherai.
La personne pour laquelle on pleure n’est pas nommée, elle est désignée par le biais
de ses edopasade. Ainsi, Puchiejna, du clan Dosapei, est remplacé dans ce cas par :
coongopiejna ojosogoma yabi : « la belle plante de courge, mon fils »
yajíe putugutaroi penojnangue ñujnacari : « je vois, la très belle peau de
jaguar, mon fils »
aquesua tiachutic yape : « le bel arc-en-ciel, mon fils »
L’arc-en-ciel, la courge — comme tous les autres végétaux qui poussent à la
saison des pluies — et la peau de jaguar sont des appartenances claniques des
Dosapei. Mais ce n’est pas seulement Puchiejna qui est remplacé par ses
edopasade : son père — Ebedu — et son épouse — Chugupenatei — sont aussi
nommés de cette manière. Ainsi,
auatadatei yabai : « le jaguar sans peur, mon époux » pour Ebedu (du clan
Dosapei)
et
aquiajna ojosogoma yacaía : « la belle vache, ma belle-fille » pour
Chugupenatei (du clan Posorajãi)
Nous constatons qu’aucune personne n’est nommée directement dans
l’uñacai pour Puchiejna. Y aurait-il un rapport spécifique entre l’edopasai
266
�mentionné et la personne que ce non-humain désigne ? Souvenons-nous que dans le
chant de guerre pinangoningai par exemple186 , le guerrier faisait référence à son
appartenance clanique, le pécari187 , pour indiquer un trait commun aux deux : la
bravoure. Nous avons remarqué que Jnumi fait également référence à son époux
Ebedu comme « auata datei » « le jaguar sans peur » dans les uñacai 5, 6 et 11.
Cela semblait tout à fait logique : quand Ebedu n’était plus le cacique de Jesudi,
Jnumi rappelait toujours à ses fils que leur père n’avait pas peur de se confronter
aux patrons mennonites ou aux fonctionnaires à Filadelfia. Néanmoins, consultée
spécifiquement à ce sujet, Jnumi a affirmé que c’était ainsi que l’on nommait tous
les Dosapei dans les uñacai. En fait, mise à part le cas d’Ebedu où on peut trouver
une ressemblance entre l’appartenance clanique et la personne mentionnée, il
semble que ces substitutions sont faites d’une manière systématique. D’après ce
que l’on peut déduire de l’analyse de plusieurs exemples, ce sont toujours les
mêmes edopasade qui sont utilisés dans les chants de tristesse. Voyons quelques
exemples dans chaque clan.
Dosapei
asú pojnangue : « la fleur asú »
abubie sogoma : « les beaux bourgeons » (probablement de courge, Cucurbita
maxima)
putugutaoi nequenojnangue : « la belle peau de jaguar » (Panthera onca)
aquesu tíachutiguei : « le bel arc-en-ciel »
auata datei : « celui qui n’a pas peur » (le jaguar, Panthera onca)
congopiejna ojosogoma : « les beaux bourgeons de courge »
dutue asigueac uerade case uquide / dutue penojnangue : « les beaux fruits de
courge » (Cucurbita maxima)
186
Cf. chapitre III.
187
Tayassu tajacu.
267
�Picanerai
bora poro : « les vêtements blancs »
abubie sogoma : « les beaux bourgeons » (peut-être d’une plante des Picanerai)
cuchapijogui : « caracara » (oiseau rapace, Polyborus plancus)
pamoi tiachugue : « le beau pamoi » (sorte de ceinture pour maintenir le dos droit)
Posorajãi
aquiajna utata : « la vache noire »
chuguperenatei ama poro : « la plume blanche de la cigogne » (Jabiru mycteria)
Chiquenoi
inguiane pejnungongue : « la belle herbe »
Cutamurajãi
pedobicadedie tiachugué : « les beaux pedobicadedie » (dessin de sacs de
caraguatá)
nasaruinate : « le grand serpent nasaru » (sans identification)
tujnite datei : « le grand arbre tujni » (Schinopsis haenqueana)
Nous n’avons d’exemples ni du clan Étacori ni du clan Jnurumini pour deux
raisons. D’une part, il y a peu d’individus appartenant à ces clans à Jesudi (qui
auraient donc des parents agnatiques ou de clan pour lesquels ils pleureraient) : on
trouve six individus du clan Étacori — Daju, Toto, Ugoi et les trois fils de ce
dernier — et aucun du clan Jnurumini (Raul est parti avec sa famille à Ijnapui en
2008). D’autre part, certains chants (c'est-à-dire des uñacai en deuxième instance
268
�de performance) sont interprétés plus fréquemment que d’autres188, ce qui limite le
répertoire disponible en termes de diversité de clans représentés.
Pourquoi cette utilisation des edopasade dans les uñacai ? Pourquoi les
personnes ne sont-elles pas mentionnées directement par leurs noms ? Dans un
premier temps, nous avons laissé de côté la possibilité d’un rapport entre la
personnalité de l’individu impliqué et l’edopasai en question. Consultés à ce sujet,
tout ce que les Ayoreo disaient est que cela leur plaît que quelqu’un mentionne
leurs beaux edopasade189 . Cela nous fait penser aux remerciements190 : il faut faire
l’éloge des appartenances claniques du bienfaiteur. Or, il ne semble pas que le
pleureur s’adresse au défunt — rappelons la première ligne destinée au public — ;
en outre, le chant porte plus sur les personnes qui l’entourent, parents et amis, que
sur lui. Quel est alors le sens de ces remplacements systématiques des noms ?
Il est nécessaire de reprendre quelques idées développées dans le premier
chapitre de cette partie, concernant les clans dans la vie quotidienne des Ayoreo.
Nous avons établi que les edopasade deviennent, en fait, un langage de la
dépendance, un souvenir constant du besoin que l’on a des autres. Mentionner
quelqu’un par le biais des edopasade équivaut à le considérer comme une partie
d'une relation. Les edopasade constituent une sorte d’épistémologie relationnelle,
une mise en valeur de l’idée d’interdépendance entre tous les éléments. Il ne s'agit
pas seulement d'un rapport entre humains, qui peut être rompu comme dans le cas
de rapports d’affinité. Les edopasade constituent une donnée de l’expérience pour
les Ayoreo qui existe depuis les temps des Premiers Hommes.
Cet aspect relationnel des edopasade était surtout visible dans les « disputes
du midi », au moment du repas. Les rapports affectifs et sociaux sont
188
En fait, l’uñacai pour Puchiejna composé par Sidi (nº 4 de l’appendice), celui de Checabiade pour
son frère (nº 10, interprété toujours par Sidi) et celui pour Yoeja (nº 13, interprété par Caitabia et
Jnumi) sont les trois que l’on entend le plus souvent, le soir autour du feu. Au moment où Sidi se
mettait à chanter, on lui demandait souvent celui pour Puchiejna.
189
À part cette réponse, on avait bien sûr aussi l’explication traditionnelle : « jnanibajade ore
isocade, gu ! » (« ce sont les coutumes des Premiers Hommes, c’est pour cela ! »).
190
Voir section III.3.1 du chapitre III.
269
�fondamentalement des rapports économiques et la nourriture est l'élément qui sert à
l'exprimer le mieux. La faim est un signe du manque de ce lien à la fois affectif et
économique. La mention des edopasade est en fait un outil poétique pour mettre en
relief l'aspect fortement relationnel d'une absence — réelle dans le cas d'un décès,
potentielle dans le cas d'une maladie.
L'association de la faim à la tristesse et la référence constante aux
appartenances claniques ne sont pas les seuls indices de ce type. En fait, nous
verrons que tout dans l’uñacai est une « clef relationnelle ». Les personnes
mentionnées dans ces chants sont aussi nommées — mais avec une fréquence
moindre — à travers des rapports de parenté. Ainsi par exemple191 :
que tagu dejoi ome damanique igioto uaqué : « elle ne se fâchait pas avec le
parent clanique de son époux ». Uñacai 2 : pour Tujninia Cutamijñoro, par
Jnumi Posijñoro. Tujninia était mariée avec Mimie Posorajãi. « Le parent
clanique de son époux » est une allusion à Jnumi Posijñoro.
congopiejna yabaiñai : « les bourgeons de courge, mon beau-frère ».
Uñacai 6 : pour Fibai Dosapei, par Jnumi Posijñoro. Fibai Dosapei était le
frère aîné d’Ebedu, l’époux de Jnumi Posijñoro.
Amate dacaía tuaque chuguperenate unonucâe tuaque yape : « elle est forte
sa belle-fille la cigogne ma fille » Uñacai 15 : pour Ebedu Dosapei, par
Daju Étacõro. Lucía Posijñoro, fille de Daju Étacõro, était mariée à ce
moment-là avec Tamocoi Dosapei, fils aîné d’Ebedu Dosapei.
L’uñacai, dans la première instance de la performance, est une mise en
valeur de deux éléments : le caractère relationnel de chaque individu et la faim —et
son inverse, la générosité — comme marque d’intégration au réseau humain de la
communauté. Il y a en plus une dimension qui traverse toute la composition, celle
de la tristesse. Cet état affectif est une conséquence de la faim — quand celle-ci
191
Voir aussi les uñacai 5, 7, 14 et 17.
270
�signifie « abandon » —, mais il peut en être aussi la cause : celui qui est triste n’a
pas envie de manger et risque de s’affaiblir jusqu'à en mourir. Nous pensons que
l’uñacai joue un rôle cathartique de deux manières différentes. D’une part, il sert à
annoncer aux autres l’état d’abandon du pleureur que la perte récente ou future peut
provoquer et, de l’autre, il sert à transformer ce moment tragique en paroles. Dans
les uñacai, le compositeur accentue, de diverses manières, l’état de disgrâce dans
lequel il se trouve. Il ne cesse de créer des images d’un passé doré, de dire qu’il
voit le défunt vivant devant lui et alors la peine disparaît, ou de déclarer qu’il est
accablé par la tristesse :
ñimo ayore nequeamia apaganejnai dabai ga pijode chonaque ome ñu : « je
vois la femme ayoreo parent [ma sœur] et son mari et la tristesse s’arrête
pour moi ». Uñacai 8. Pleurs de Mese Dosapé, par Jnumi Posijñoro.
ga uñeque pujnusietigaique ujuyapise192 : « et celui-ci [Tercio] est accablé
par la tristesse ». Uñacai 14. Pour Terciode (père de Tercio) Chiquenoi, par
Jnumi Posijñoro.
VI.3.2.3. La tristesse intense et brève
Nous pensons que ce chant ne sert pas à réconforter la personne qui est
triste, car il n’y a aucune ébauche d’espoir dans son contenu. Bien au contraire, il
semblerait que le but du chant est d’exprimer de la manière la plus intense possible
ce sentiment de tristesse et de douleur. Jnumi présente le possible décès de son fils
comme si cela était déjà arrivé : « nous sommes restés derrière, parmi les jeunes
[vivants] », « la très laide mort a pris celui qui était très beau ». Cette
intensification verbale de l’état affectif se combine avec le choix du moment
adéquat. D’après Jnumi, il faut interpréter l’uñacai au moment du décès ou de la
192
« Ujuya » veut dire « accablé », comme supportant un poids intolérable. Un jour, nous étions
allés chercher du jnui, le piment de la forêt. Ayojai, le futur mari d’Apala Dosapé — la deuxième
petite-fille de Jnumi Posijñoro — voulait impressionner sa future belle-mère. Il avait recueilli
beaucoup plus de jnui (Capsicum chacuense) que le reste et il portait deux sacs énormes sur son dos,
ce qui l’empêchait de marcher aisément. Jnumi l’a vu de loin et elle a crié « pujuya…! » pour
indiquer la démesure des kilos qu’Ayojai supportait sur ses épaules. Dans le même sens, ils disent
« pujnusietigaique ujuyapise yu » (« je suis très accablé par la tristesse »).
271
�maladie, pas longtemps après. C’est comme s’il fallait condenser l’état d’abandon
et de perte dans les cinq à huit minutes que dure un uñacai. En outre, il y a une
espèce de fatalisme dans certains uñacai, une mise en relief de l’irréversibilité
d’une perte. C’est une absence absolue, la personne qui est décédée ne reviendra
jamais :
Uñacai suite à la mort de Fibai Dosapei, par Jnumi Posijñoro
Ñunguamu uñeque gajine ga oguiyabape yu ome icanigatiguei
uje di yocuniri to ude gajine congopiejna yabaiñai.
Ca chi uñeque dei siñeque gajine ga
“yisabi aja bei ga ase yuguchade” uñeque
oguiyabape auata dateraque yabai uyoque i quinganingo gajine
ca chi uñeque dei dapaganejnai
oguiyabape aquesua tiachutigo ñujnacarode i quinganingo gajine
ga amate ayore que yitogoi gajine ga que ñijningopoi ome yocatique.
Yichapia yu aja uniri case ga yajiome uñeque abubie sogomaque gajine ca
chi uñeque dei dapaganejnai daruode omeñu gajine ga maisabi choique to.
Je pleure pour celui-ci maintenant et je pleure pour celui-ci, le généreux,
qui est arrivé à notre territoire, maintenant, les bourgeons de courge, mon
beau-frère.
Ce n’est pas vrai qu’il est ailleurs [vivant] maintenant
et [il a dit] « mon frère cadet, tiens, prend mes affaires »
Je pleure pour le jaguar sans peur mon époux et nous qui sommes restés
derrière maintenant
et ce n’est pas vrai qu’il se promène [il est ailleurs, vivant]
Je pleure pour les beaux arcs-en-ciel mes fils qui sont restés derrière
maintenant
Et les Ayoreo, [nous savons que] quand nous mourrons, nous ne
retournons pas à notre lieu
272
�Je pense à notre ancien territoire [communauté de Fibai en Bolivie] et je
vois celui-là les beaux bourgeons maintenant
et ce n’est pas vrai qu’il se promène, ses mots pour moi et ton frère cadet il
est fort 193.
La phrase « les Ayoreo, quand nous mourrons, nous ne retournons pas à
notre lieu » est d’une force affective remarquable. Jnumi pleurait pour Fibai
Dosapei, le frère aîné de son époux, Ebedu Dosapei. Cela nous montre en fait un
certain sens tragique de la vie ayoreo, qu’il nous est difficile de comprendre.
D’après les ethnographes des années 1970 (Fischermann 1988, Bórmida et Califano
1978, etc.), les Ayoreo allaient après la mort au jnaropie, une espèce de territoire
souterrain. Après l’évangélisation, le monde des morts est devenu plus semblable à
celui des représentations chrétiennes : si l’individu est bon, son âme (ayipie) ira au
ciel, sinon elle ira en enfer. Il y a toujours une destination pour l’âme, ce qui
permettrait de transformer l’absence du mort en une présence éloignée. Mais non,
au contraire, ces chants de tristesse nous frappent par leur fatalité, car la personne
décédée disparaît définitivement :
ñajnami iji jnani uecaique ujnaigo : « mon grand fils [est resté] parmi les
hommes vivants » (Sidi, dans l’uñacai pour Puchiejna).
Puchiejna est parti, son fils est resté. Cette ligne exprime la solitude de celui
qui est resté « derrière » ou « parmi les vivants ». C’est aussi une autre manière de
mettre en relief qu’un lien s’est perdu, mais son fils est également présenté comme
entouré de personnes qui pourraient prendre le relais dans les rapports de générosité
et de protection. Il semble que cette tristesse doit être interprétée avec autant
d’intensité que de brièveté. Il faut pleurer juste après la mort de quelqu’un — ou
bien quand on craint la mort de quelqu’un —, mais il faut aussi cesser de pleurer
juste après. Manenacode Posijñoro était une tante de Jnumi Posijñoro qui habitait
dans la communauté Esquina, située à dix-sept kilomètres au sud de Jesudi. Elle est
193
Dans cette dernière ligne, Jnumi s’adresse effectivement au défunt, il lui dit qu’Ebedu, frère
cadet de Fibai, est fort. C’est le seul cas que nous avons trouvé.
273
�décédée quelques années avant notre arrivée194 . À ce moment-là, Jnumi était
vraiment triste, elle pensait intensément à sa tante et parent clanique, et elle la
pleurait beaucoup. Ebedu lui a dit « toi ga toi, ayá bagoyedie ! » « elle est décédée
et elle est décédée, arrête de pleurer ! » et Jnumi n’a plus pleuré : « ga e yiya ! »
« et je me suis arrêtée ! ». Il semblerait qu’on ne doit pas laisser trainer la tristesse
ou tomber dans un état d’inaction. Comme nous l’avions montré dans le chapitre
précédent, la tristesse peut provoquer la mort. Même avant cet état final, la tristesse
intense peut contraindre un individu à ne plus s’engager dans la vie quotidienne :
c’est quelqu’un qui n’a plus envie de manger, ni d’aller à la chasse, ni de se
compromettre au déroulement courant de la vie sociale.
VI.3.3. Conclusion de VI.3
Une personne triste n’est pas utile à la société ayoreo. C’est quelqu’un qui
ne s’engage pas dans la vie sociale, qui ne mange pas, qui ne veut pas chercher de
nourriture et, par conséquent, qui ne pourra pas en donner aux autres. L’aspect
cathartique des uñacai est certainement important : il faut maîtriser la tristesse
(signe d’abandon et du manque d’intégration au déroulement quotidien de la vie
sociale ayoreo). L’uñacai sert à concentrer ce moment de tristesse. Ses règles
strictes montrent que l’uñacai est structuré, ce qui nous permet de penser — avec
Urban — qu’il sert à transformer une affaire personnelle en un événement social.
L’uñacai, dans la première instance de sa performance, sert à rappeler aux autres
membres de l’ogadi, et même de la communauté, que l’on a perdu un lien. Plusieurs
ressources poétiques permettent de mettre le chant en « clef relationnelle » : le
pleureur parle plutôt de lui et de sa famille que du défunt ou du malade. Il met en
relief la faim et la tristesse qu’il ressent : la première est le signe de la solitude et le
manque de liens, la deuxième est un état qui ne devrait pas durer longtemps.
L’uñacai est une manière de prendre position dans le réseau social, c’est une
déclaration de l’appartenance de l’individu au groupe, de l’individu comme un fil
dans le tissu relationnel de Jesudi. Cela est dit de deux façons : dans la performance
même et dans le contenu des chansons. Nous verrons dans la section VI.4 que les
194
Manenacode Posijñoro était très aimée par beaucoup de gens de la première génération à Jesudi. C’est
pour elle que les Posorajãi avaient beaucoup pleuré, nous disait Sidi (voir chapitre IV).
274
�uñacai peuvent être répétés comme des chansons. Dans ce cas spécifique, ils ne
rempliront pas les fonctions de la première instance, mais ils seront nécessaires
pour l’établissement d’une esthétique qui est à la fois une éthique sociale.
VI.4. Les chants, quand on les entend de loin
Nous avons analysé, jusqu’à présent, les chants en rapport très étroit avec les
circonstances de leur production. Autrement dit, nous avons analysé le rôle de ces
chants par rapport à la situation spécifique à laquelle ils font allusion, avec une
attention spéciale aux personnages de ces compositions. Dans le cas de l’irade
étudié, nous avons vu que le chant servait à mettre en relation la séparation de
Tamocoi et Lucía avec ses conséquences diverses, notamment la migration des
conjoints et le possible abandon des enfants. Dans le cas de l’uñacai, nous nous
sommes concentré sur ce que nous appelons « la première instance de la
performance », le moment tragique pendant lequel le chant est à la fois composé et
interprété par la personne qui subit la tristesse. Nous avons remarqué alors que
l’uñacai a deux utilités. D’un côté, il permet une expression de catharsis aussi
brève qu’intense. De l’autre, il sert au pleureur — par le biais des artifices
rhétoriques — à déclarer la perte d’un lien de réciprocité.
Nous nous demandons alors : que se passe-t-il quelques temps plus tard ?
Nous analyserons dans cette section ce qui se passe quand ces chants sont répétés et
entendus bien longtemps après, lorsqu’ils sont détachés des circonstances qui ont
été à leur origine. Nous avons remarqué que quand les Ayoreo parlent des chants du
passé, la trame semble importer plus que les personnages ; c’est comme si ce
détachement produisait une certaine abstraction et l’histoire était répétée par plaisir
littéraire. Nous étudierons tout d’abord ce que nous avons appelé « la deuxième
instance de la performance » des chants de tristesse uñacai. Ensuite, nous
aborderons les chants de nostalgie irade de la même manière que nous le faisions
tous les soirs à Jesudi : comme un grand répertoire d’histoires d’amour du passé.
Enfin nous essaierons de dégager les traits communs de ces deux chants, néanmoins
275
�très différents par leurs origines. Nous verrons que tous ces chants parlent d’un
même sujet : comment vivre ensemble.
VI.4.1. L’uñacai le plus beau
Nous avons pu recueillir un modeste répertoire d’uñacai. La tâche n’a pas
été simple, car il fallait insister pour que les Ayoreo interprètent d’autres chants que
ceux que l’on entendait habituellement le soir. En effet, certaines compositions sont
interprétées plus souvent que d’autres. Nous n’avons pas repéré de régularités qui
puissent expliquer le choix de certains uñacai plus que d’autres. Nous avons
remarqué que s’il s’agissait d’un soir plus animé que les autres, le public demandait
plus fréquemment au chanteur — généralement Sidi — certains irade ou uñacai en
particulier. La même chose arrivait quand, après un paseo (randonnée, voyage de
visite à une autre communauté), ils me demandaient de leur faire écouter les
enregistrements que je venais de recueillir : ils manifestaient leur préférence pour
certaines compositions. Il est possible de dire qu’un des critères est tout simplement
esthétique : ils disaient aimer certains uñacai parce qu’ils étaient beaux — ome —
ou bien délicieux –unejna195 . Parmi les uñacai qu’ils aimaient le plus, se trouvait
celui de Checabiade qui pleurait suite au décès de son frère cadet Tamocojnai.
195
Il est possible de dire que le mot « unejna » est lié à une expérience sensorielle. J’ai entendu dire
« unejna » à propos de la nourriture, de l’eau, mais aussi par exemple quand du vent frais souffle les
jours de novembre. Quant à « ome », il semble traduire un jugement esthétique mais avec une valeur
éthique aussi. Ainsi, au sens premier, Jnumi disait que son petit-fils Romerito était « omepise
ñajnami… ! » (« il est très beau, mon petit-fils »). Pour ne donner qu’un exemple dans le sens plutôt
éthique, on peut mentionner l’histoire de Tercio et Pojnangue. Quand Tercio est revenu après trois
mois de travail, Jnumi avait déjà tout arrangé pour qu’il ne reste plus à Jesudi, car Pojnangue — fille
de Jnumi — sortait avec un autre homme et craignait son ancien mari. Cependant, Tercio a dit qu’il
resterait à Jesudi pour donner de l’argent et de la nourriture à ses enfants, et que si Pojnangue
voulait le quitter, il n’y avait pas de problème. Jnumi m’a dit « omepise uruode ! » (« de très beaux
mots ») et elle lui a permis de rester. Selon le dictionnaire des New Tribes Mission : « omé : adj. f.
good ; good-looking ; beautiful nice » (HIGHAM et al. 2000 : 626).
276
�VI.4.1.a)- Uñacai pour Tamocojnai, par Checabiade (interprété par Sidi
Posorajãi)196
Ñunguamu cuchapijoguode dateraque uque yesaque
jnupe chagüi ujniete uñeque gajine.
Yisapie yu ga ñipojna uñeque ga yayipieraque doasi aicujatac urosorac
ga yibeo yu ome pujnusietigaique ome uñeque yibeo uyu iji pujnusietigaique
gajine iji quigade jetiga yayipiedoi yaicujatac uroso uñeque.
Yichapia yu aja yacajnaminone casode
ga uñeque baque uñeque di dagatoja cutêi udi iji yu dirica.
Yichapia yu aja tiegosode yoquitojaite casica nanique
« yotabidi uroso » « bo beyoi yigueite ga acayoji ».
Je pleure en chantant pour mon frère cadet le caracara,
la terre est laide à cause [du décès] de celui-là maintenant
Si je m’étais fâché avec lui, si mon ayipie amenait de vilains mots [de sa
part contre moi],
je serais peu triste pour celui-ci, j’aurais peu de tristesse s’il avait utilisé des
mots qui font du mal contre moi
Je pense à nos jeux,
et il est allé en forêt et il m’a apporté une courge remplie de miel
Je pense à notre guerre contre les Tiegosode, ça fait longtemps,
[Aeguede a dit] « j’ai mal à la jambe » et [Tamocojnai a dit] « allez et restez
là [je reste ici et je lutterai] »
Les Ayoreo aimaient souligner particulièrement une ligne de ce chant, celle
où Checabiade regrette de ne jamais s’être disputé avec son frère. Si son frère
l’avait insulté, s’il avait été méchant envers lui, il ne lui manquerait pas autant.
Mais Tamocojnai a été gentil et généreux, ce qui rend sa perte insurmontable.
196
Checabiade est décédé en 1986 lors d’une rencontre fatale entre Ayoreo de bandes ennemies, des
Guidaigosode et des Totobiegosode. Les Guidaigosode habitaient à la mission des New Tribes
Mission à Campo Loro et — selon la version officielle des New Tribes Mission — ils sont allés
chercher les Totobiegosode non contactés pour leur prêcher la parole de Jésus. Les Totobiegosode
ont attaqué leurs anciens ennemis : cinq Guidaigosode — dont Checabiade — ont été tués.
277
�Caitabia nous disait que cette phrase était très belle parce qu’elle exprimait la
profondeur de la tristesse de Checabiade. L’uñacai le plus triste est justement le
plus beau. De plus, Caitabia signalait que l’on n’était pas triste pour n’importe qui :
on ne pleurait en chantant — on faisait un uñacai — pour une personne que si
celle-ci était paaque. Il y a alors un enchaînement qui va de la qualité de la
personne décédée aux considérations esthétiques : Tamocojnai était paaquepise
(« très paaque »), sa disparition a fait tomber Checabiade dans la tristesse et a fait
un uñacai à partir de cette douleur. Cet uñacai est beau alors parce qu’il montre la
tristesse intense du chanteur causée par l’absence d’une personne très paaque. Il
nous faut alors étudier cette notion.
VI.4.2. La notion de paaque
Les Ayoreo mettent en relief que les chants de deuil les plus beaux sont ceux
qui expriment un sentiment de tristesse avec le plus d’intensité. En outre, ils
signalent que l’on chante exclusivement pour quelques personnes qui étaient
paaque, c'est-à-dire « gentil ».
Paaque est la forme énonciative (« il est gentil ») de l’adjectif parai :
parai : adj m. righteous ; morally good ; gentle ; kind ; humble. (…)
f. parague (…) d.f. parac, paracho (Higham et al. 2000 : 661)
Les missionnaires des New Tribes Mission ont remarqué le caractère moral
de paaque : « moralement bon ». Mais il nous faut analyser ce que cela veut dire
chez les Ayoreo. Qu’est-ce qui est impliqué dans la notion de paaque ? D’après les
Ayoreo, une caractéristique est définitoire : cette personne leur donnait des choses,
de la nourriture ou de l’argent. Autrement dit, elle était généreuse. Logiquement, il
y a des allusions à cette qualité dans la quasi-totalité des chants de tristesse. Voyons
l’uñacai pour Tamocojnai :
ga uñeque baque uñeque di dagatoja cutêi udi iji yu dirica : « et il m’a
apporté une courge remplie de miel »
278
�Dans d’autres uñacai, il y a aussi des exemples d’actes de générosité surtout
dans la construction d’un passé heureux :
ga uñaque nae gajine « Jnumi aja beite ga agu yibosode to gajine » : et elle
m’a dit maintenant « Jnumi, tiens et mange ma nourriture
maintenant » (uñacai pour Tujninia, par Jnumi)
ga « Jnumi aja beite gajine ga bé majnei gajine » : et [elle a dit] « tiens
Jnumi, cela est pour toi’ [un rouleau de fil de caraguata] » (uñacai pour Tie,
par Jnumi)
uñaque naeque « Jnumi aja beite gajine ga a yii platadie ga Ebedu gajne
gajine » : elle a dit « Jnumi, tiens, je te donne de l’argent pour Ebedu
maintenant » (uñacai pour Golo, par Jnumi)
yisabi aja bei ga ase yuguchade : « mon frère cadet, tiens, mes choses sont
pour toi » (Fibai à Ebedu, uñacai pour Fibai, par Jnumi)
Jnumi aja beite ga agu yiquibosode udo to gajine : « Jnumi, tiens et mange
ma nourriture » (uñacai pour Cajoidate, par Jnumi)
Jnumi aja beite gajine ga aja beite gajine a yii platadie gajine : « Jnumi,
tiens maintenant, tiens et je te donne de l’argent maintenant » (Ebedu à
Jnumi, uñacai pour Ebedu, par Jnumi)
yuguedie gai iji ñacorenie ga « ajnime ga asiome batate uñaque » : il a tué
deux pécaris et [il m’a dit] « prends-en et donne à ta sœur aînée » (uñacai
pour Picha, par Edabia, interprété par Sidi)
yicaía atatayo uaque jeti chagueique chejna uaque ga yii uacabotique
cuchapibose etoquei : « ma belle-fille, dites-moi si vous avez faim et je
chercherai beaucoup de nourriture » (Ebedu dit à Lucía, uñacai pour Ebedu,
par Daju)
279
�Aube a gajine be baplatadie : « Aube, tiens ton argent » (uñacai d’Aube
pour son mari, interprété par Jnumi)
aja bei ga agu yigaidode cuchapibose : « tiens et mange ma
nourriture » (uñacai pour Puchiejna, par Jnumi)
Parfois, la générosité de la personne pour laquelle on pleure est directement
nommée :
ga uñaque doipise dategoningai case : et celle-ci était très généreuse avant
(uñacai pour Tie, par Jnumi)
Oguiyabape ome uñeque ategoningai uñeque ategoningaique cutema case
ñujnacari uñeque : Je pleure pour celui qui avant était beau et généreux,
mon fils (uñacai pour Puchiejna, par Jnumi)
Il ne faut pas oublier que la générosité est fondamentale au sein de l’ogadi,
l’unité économique et politique de la société Ayoreo. Cette unité s’appuie sur un
lien qui dépend de l’exercice de la résidence commune et du partage de la
nourriture. La générosité — dont le résultat final est la réciprocité — est une
condition indispensable pour la survie de l’ogadi. Or, ce n’est pas la seule qualité
nécessaire pour la résidence commune ; il faut naturellement une certaine harmonie
dans les rapports sociaux. La notion de paaque implique non seulement la tendance
à aider les autres et à leur donner de la nourriture ou de l’argent, mais aussi la
qualité de « ne pas se fâcher avec les autres » que nous appelons « calme », pour
être plus clair dans l’exposition.
Ce deuxième aspect du concept de paaque est clairement opposé à la notion
de sijnaque197 , qui signifie « méchant, agressif ». Ces qualités personnelles sont
valorisées différemment selon les circonstances. Ainsi, sijnaque dénote une
agressivité qui est tenue comme positive quand elle est concentrée sur l’ennemi. Il
197
Sijnaque « il est méchant » est la forme énonciative de sijnai : « sijnai : adj. m. bad ; mean ; evil ; wild
(…) d.f. sijnac, sijnácho. » (HIGHAM et al. 2000 : 744)
280
�faut se souvenir des chants guerriers pinangoningai et ingojnangai, et du « rituel
d’excitation pré-guerre » chuguji : dans ces cas, l’exaltation des pulsions agressives
et homicides constitue un atout pour la communauté (qui sert à se défendre contre
des ennemis potentiels ou réels). Logiquement, cette qualité est vue comme
négative si elle est dirigée vers l’intérieur de la communauté, et c’est par le biais de
la négation — « ne pas se fâcher avec les autres » — qu’elle est présentée dans les
chants uñacai. L’exemple le plus clair se trouve dans celui dédié à Tamocojnai,
quand Checabiade dit que si son frère avait été méchant avec lui, il ne serait pas si
triste maintenant. Il semble que dans certains cas on insiste sur le fait que la
personne malade ou décédée ne se fâchait pas même avec les « gens étrangers »,
c'est-à-dire en dehors de l’ogadi. Voyons quelques exemples :
uñaque que chinguira daecujatac aja yoque cheque quenejnane : celle-ci
n’utilisait pas de mots méchants contre nous, des femmes étranges — qui
n’appartenaient pas au même clan ou au même ogadi (Uñacai pour Golo,
par Poro)
que yayipiedoi ipojnaqueingo omeñu gajine : je ne me souviens pas qu’elle
se soit fâchée avec moi maintenant (Uñacai pour Golo, par Jnumi)
amate cho dojoaque cheque gajine ga que tagu dejoi ome damanique igioto
uaqué : la femme était gentille et elle ne se fâchait pas avec la parente
clanique de son mari (Uñacai pour Tujnina, par Jnumi)
uñeque que tagu dejoi ome uñaque gajine : celui-ci [Ebedu] ne se fâchait pas
avec celle-ci [Lucía, belle-fille d’Ebedu] maintenant (Uñacai pour Ebedu,
par Daju)
Dans ces descriptions, les épisodes de colère consistent à utiliser des mots
méchants. Dans le même esprit, les beaux mots sont mis en valeur et reflètent
l’affection :
281
�uñeque gajine deji dapagadode daruode ome ñu : celui-ci [son mari] avait
de beaux mots pour moi (Uñacai pour son mari, par Aube, interprété par
Jnumi)
Pour comprendre l’importance du « calme », il faut se souvenir de deux
facteurs de la société ayoreo dont on a parlé dans le chapitre précédent. D’un côté,
la migration comme stratégie pour alléger les tensions sociales et, de l’autre, la
mise en relief de la nostalgie.
La générosité est la condition essentielle pour rester membre d’une unité
résidentielle ogadi, et c’est aussi une manière d’établir des liens avec des parents
claniques qui habitent dans des communautés éloignées. Le fait de ne pas se fâcher
ou du moins de ne pas l’exprimer avec des mots agressifs contribue notablement à
la convivialité des Ayoreo de Jesudi. On a vu d’innombrables fois qu’après une
dispute conjugale, l'un des membres du couple partait sur la route attendre un
camion qui l’emmènerait loin de là pour un certain temps. Il serait peut-être un peu
exagéré d’affirmer que la communauté — ou ses unités, les ogadi — risque
d’éclater à tout moment, mais il est vrai aussi que tous les soirs les chants
rappellent combien l'absence d'un conjoint, d'un parent ou d'un ami, serait
douloureuse.
VI.4.3. Le chant d’un moment et l’accumulation d’anecdotes
L’uñacai semble pouvoir synthétiser la vie d’un individu ou du moins sa
personnalité dans un seul chant, provoquant l’intensité des pleurs. Ce chant de
tristesse — nous l’avons vu — met en évidence une ou deux occasions particulières
qui justifient l’inclusion de cette personne dans la catégorie générale de paaque, le
bon citoyen généreux qui utilise de beaux mots. Les irade, quant à eux, nous
fournissent des exemples de situations plus spécifiques, des événements ponctuels
tels qu’une dispute entre conjoints ou une femme qui rejette son prétendant. Les
irade sont logiquement beaucoup plus nombreux que les uñacai, car tout au long
282
�d’une vie on se dispute plusieurs fois avec son conjoint, mais on ne meure qu’une
fois198.
Dans la section VI.2, nous avons présenté trois chants associés à la dispute
de Tamocoi avec son épouse Lucía. Nous avons analysé le rapport étroit entre ces
compositions et la situation sociale spécifique dont ils parlaient. À ce moment
précis de la vie sociale de Jesudi, les personnes mentionnées dans les irade sont le
sujet principal des commentaires et des commérages. Au fur et à mesure que le
temps passe, que les humeurs s’apaisent et que de nouvelles situations prennent le
relais dans la une des journaux verbaux autour du feu, le centre d’attention de ces
chants commence à se déplacer. Les personnages ne sont plus aussi attirants, mais
c’est plutôt la situation générale — le scénario disons — qui prend le dessus. Le
temps passant, cet irade est moins « le chant de la colère de Tamocoi envers
Jnumi » et davantage « le chant qui raconte qu’une mère a rejeté la nourriture que
son fils lui offrait ». C’est comme si les irade se détachaient de la situation décrite
et devenaient des histoires intéressantes en elles-mêmes — c’est-à-dire vraies —,
mais qui ne produisent ni n’expriment de tristesse comme dans le premier moment.
Ce moment d’interprétation postérieure équivaut à la deuxième instance de
performance des uñacai. Dans le cas de chants de tristesse, la différence est plus
marquée : dans la première instance, on pleure et on crie, dans la deuxième, on
chante. Ici, la différence est un peu floue, mais elle existe néanmoins.
Les uñacai avaient des régularités très marquées : on pleure pour celui qui
est paaque et on donne des exemples, généralement deux. Les irade constituent une
sorte d’accumulation d’anecdotes diverses, où il est possible de repérer quelques
régularités dans les événements racontés.
198
Il faut cependant rappeler que les uñacai sont également composés quand quelqu’un est malade,
ce qui veut dire qu’un individu peut avoir plusieurs uñacai qui parlent de lui (certains lors d’une
maladie, d’autres après sa mort). En plus, il est possible que plusieurs personnes chantent leur
tristesse pour quelqu’un en particulier. Dans tous les cas, cette quantité sera toujours inférieure au
nombre de disputes conjugales, la matière première des irade.
283
�VI.4.3.1. Les gendres bien-aimés et les conjoints abandonnés
Les irade parlent d’histoires d’amour. Nous pouvons voir dans les irade que
la décision de former un couple ou de le dissoudre n’appartient pas seulement aux
membres de celui-ci. Dans plusieurs cas, on peut remarquer la pression des parents
sur leur fille pour que celle-ci se marie avec un homme en particulier. L’irade de
Terciodate est le plus emblématique, il est presque un cas exemplaire. Il raconte
l’histoire de cette jeune fille — presque une enfant — à qui sa mère fait remarquer
que son père est vieux — et ne peut donc plus apporter de nourriture — et lui
demande de se marier avec un dacasute, un grand guerrier et chasseur :
VI.4.3.1. a) Terciodate irade, par Jnumi
Ite suaque naeque « Doia, macamo uje baye que chijnime daboaique ? » ga
ite suaque chositomeñu, ga ite suaque naeque « Doia, auaji ? ». Ite chimosi
ñuringa, que gapupe uejatac ga ite naeque « Doia, apota ia jnani
pamanique ? Macamo Pajei uñeque uje cuchapibose gajnesore ga macamo
uje dacasute Pajei? » Ite suaque chimo ñuringa disap, ite suaque
chositomeñu « jetiga apota jnani pamanique ga oji Pajei ucode ñeque gai,
macamo cuchapibose gajnesore uje dacasute Pajei? »
Ma mère a dit « Doia, tu ne vois pas que ton père n’apporte plus de
nourriture ? » et ma mère a fait comme ça avec moi, et ma mère a dit « Doia,
tu veux ? ». Ma mère a vu que je n’étais pas une fille adulte [mais] elle m’a
dit « Doia, tu veux un mari ? Tu ne vois pas que Pajei a beaucoup de
nourriture et tu ne vois pas qu’il est un dacasute ? ». Ma mère a vu que
j’étais une enfant, [mais] ma mère a fait comme ça avec moi « si tu veux un
mari alors va avec Pajei, tu ne vois pas qu’il a beaucoup de nourriture parce
qu’il est dacasute ? »
Ce thème du gendre préféré se trouve en fait dans plusieurs irade sous
différentes formes. Nous pouvons mentionner le cas de la femme qui n’a pu marier
sa fille avec le jeune homme qu’elle voulait. C’est l’irade de la colère d'Umajno
284
�envers Guiejna parce que Leila — fille de Guiejna — s’était mariée avec Laino.
Umajno dit tristement :
Laino ategoningai ome ñoque. (...) Que ayoreique cho Laino. Laino suque
chejnapise cuchade.
Laino était généreux avec nous (…) il n’y a pas d’Ayoreo comme Laino.
Laino celui-ci donne beaucoup de choses [à la belle-mère199 ]
Un autre exemple est celui de Chomanate, dont le père insiste pour qu’elle
se marie avec le frère d’un dacasute :
Eabia [-lui dit son père-] ca ayá Chigabi uñeque to, dacasute desaque ga
que casi ñongome dajogasui ome changüenique.
« Eabia ne quitte pas Chigabi celui-ci, car son frère cadet est dacasute et ses
ogasuode n’ont pas faim. »
(Chomanate irade, par Daju)
Le fait de voir le gendre comme un fournisseur potentiel de nourriture est
tout à fait conscient : « Yoquisarane ore gajnecho ! » « C’est dédié à nos
gendres… ! » 200, nous a dit Daju Étacõro — la mère de Dajei, justement 201 — avant
d’interpréter cet irade de Chomanate. Dans d’autres cas, moins nombreux, le
« gendre préféré » est exemplifié par son inverse, celui qui ne répond pas aux
attentes. Ainsi, dans l’irade de Dajei par Daju, il est signalé que son premier mari
ne faisait pas ce qu’il devait :
199
Commentaire de Jnumi quand on faisait la transcription. C’est Jnumi l’auteure de l’irade.
200
Yoquisar- ane,
ore
gajnecho
Poss 1re pl – gendre- Pl., 3e pers Pl propriétaire (definite form)
« Nos gendres, c’est leur appartenance »
201 Nous avons vu aussi dans la section VI.2 que Dajei veut quitter son mari Oonei, mais qu’elle hésite
parce que sa mère l’aime bien. Par ailleurs, c’était avec Oonei — connu pour être très travailleur — que
Jnumi a formé le couple avec Asema.
285
�babai tuté majneone babai abode bisideque : « ton mari [Sime] t’a fait des
enfants pour rien [il ne te donne pas d’argent] »
(Dajei pojnaquei, par Daju)
Jnumi aussi, pour sa part, fait deux irade où Ujniete, le mari de sa première
petite-fille Ijnamia, est présenté comme le contraire de ce qu’on attend d’un époux
et d’un gendre. Dans le pojnaquei d’Ijnamia, celle-ci — le sujet énonciateur — dit :
uje yise bacatamajnaningai casodica ga yicode uaque chutajo ua bapatadie
mu etoqueti ajíe code uaque yuique. Ñamapua ome batejoique Ujniete
bapesu babi bisideque cuchamaringa amanosia yocuguchatique.
il y eut un temps où tu travaillais avant et ma grand-mère t’a demandé ton
argent mais tu ne regardais pas vers elle. Je me suis fâchée avec toi Ujniete,
tu as fait ton fils pour rien, tu ne nous achètes pas de choses
(« Ijnamia pojna Ujniete », par Jnumi)
Le deuxième irade est assez particulier, car le thème du chant est une
dispute entre Iba — sœur d’Ujniete et amie d’Ijnamia — et son mari parce qu’elle
est jalouse. Jnumi profite du chant pour se plaindre à nouveau du comportement
d’Ujniete, qui n’a rien à voir dans la dispute entre sa sœur et son beau-frère. À un
moment donné du récit, quand Iba veut quitter son mari, Jnumi lui rappelle que
celui-ci lui donne de l’argent, contrairement à Ujniete qui ne donne rien à sa femme
Ijnamia :
mu Jnumi naeque « Ibaguiede mojingai uasu bajate que chijnime
uguchaique aique ua ga boide babai platadie ». Jnumi suaque quenejna
uruode omeñu.
mais Jnumi a dit « Ibaguede ton frère aîné ne donne pas de choses [à
Ijnamia] mais ton mari te donne de l’argent ». Étranges les mots de Jnumi
celle-ci pour moi
(« Iba pojna dabai » par Jnumi)
286
�Quand la décision de former ou de dissoudre un couple se maintient dans la
sphère des conjoints, on peut remarquer une certaine liberté pour quitter le mari ou
la femme. Plusieurs irade racontent une dispute suite à laquelle l’un des deux
conjoints décide de s’en aller. Parfois, il n’est même pas nécessaire de s’être
disputé : il arrive tout simplement qu’une personne plus attractive se présente,
comme l’irade avec les mots de Noe le montre assez bien. Elle était mariée avec
Chicori, mais elle est tombée amoureuse d’Igaubi. Elle a alors décidé de quitter son
mari du jour au lendemain :
Yujode dosapequedate deji Asuncion ica, que pamuañaque uñangue omeñu
ga Chicori dei yejoique mu yicha Chicori yidoboi.
le grand [du clan] Dosapei [Igaubi] était à Asunción hier, je n’arrête pas
de penser à celui-ci et Chicori est à côté de moi, mais j’ai tourné le dos à
Chicori [je ne l’aime plus]
(Noe irade, interprété par Cuia, auteur inconnu)
Dans d’autres cas, la décision de se séparer fait suite à une dispute et elle
peut être prise par l’homme (comme dans les irade 1, 6, 19 et 26) ou par la femme
(comme dans les irade 11 et 18). Ce qu’on peut remarquer, c’est qu’il existe une
seule contrainte : le désir des parents. Après cela, c’est aux conjoints de choisir. La
liberté concernant le choix de la séparation est aussi mise en relief par le biais du
doute : dans plusieurs cas, le caractère dubitatif est marqué. Par exemple, dans
l’irade de Juguei et Ina, l’homme est présenté comme celui qui n’est pas sûr de
quitter sa femme. Voyons les mots d’Ina, le sujet énonciateur :
mu uñeque naome uyu que " ñijnina cheque uñaque mu ñajnipoi bacabai jeti
yetaque uñaque atique, ñujnusiede u yabi gu "
mais celui-là m’a dit « j’irais avec cette femme-là [Asema] mais je
reviendrai avec vous [pl.] si je déteste que celle-là [Asema] se fâche avec
moi, mon fils me manque »
(Ina pojna Juguei, par Daju)
287
�Si on étudie ce chant en étroite relation avec les circonstances de sa création,
une perspective différente se présente. Nous savons que Daju a fait cet irade et que,
de son point de vue, Ina ne mérite pas d’être quittée — du moins, aucune raison est
montrée dans le chant. C’est la faute de Rafaela qui exerce une influence négative
sur son frère. Mais ce qui restera, une fois le temps écoulé et le chant diffusé parmi
les gens des ogadi et mêmes des autres communautés, ce sera l’histoire d’un
homme qui n’arrivait pas à quitter sa femme, parce qu’il savait qu’elle et son fils
lui manqueraient trop.
Il est possible de trouver deux aspects en tension : d’une part, la pression des
mères — et, dans une moindre proportion, des pères — sur leurs filles pour qu’elles
se marient avec — ou ne quittent pas — un homme en particulier, et de l’autre, une
mise en relief de la liberté de quitter son conjoint quand on le souhaite. Or, il est
difficile de soutenir cette dernière idée si l’on prend en compte les irade concernant
Tamocoi : le chant même est une sorte de pression contre son fils, une forme de
punition publique. Mais il faut rappeler que nous analysons ces chants, les irade,
bien après les événements, quand l’histoire chantée est détachée des faits vécus.
Rafaela nous disait que l’irade de Daju, qui relatait les discussions entre son frère
Juguei et Ina — fille de Daju —, n’avait aucun sens, que ce qu’il racontait — même
si elle ne l’avait pas écouté — n’était pas vrai. Ceci n’est pas important quand des
mois se sont écoulés, car ce que l’on analyse est l’histoire d’un couple qui s’est
séparé. Nous nous concentrons maintenant sur l’histoire, sans tenir compte des
opinions émises sur le chant dans les premiers moments de ses interprétations. Cet
ensemble de compositions entendues tous les soirs constitue un réservoir
d’anecdotes à partir duquel le comportement actuel est pensé. Ces histoires ne sont
pas des modèles, elles jouent un rôle semblable à celui d’une jurisprudence : c’est
un ensemble d’exemples. Ce qui est faisable : quitter son compagnon si on ne
l’aime plus. Ce qui est désirable : un gendre ou un mari qui fournit beaucoup de
nourriture. Ce qui peut arriver si on se comporte d’une manière déterminée :
frapper sa femme entraîne son départ. Ces histoires — même si les protagonistes
sont des individus spécifiques — ne sont pas des cas isolés, des anecdotes uniques.
Bien au contraire, les histoires se répètent et on peut constater des régularités, mais
288
�ces régularités ne sont pas des déclarations aussi explicites que dans les uñacai
— où le malade ou le mort est toujours généreux et bon —, qui semblent plus
proches d’une idée de règle. C’est comme s’il fallait écouter beaucoup d’irade pour
que des idées s’instaurent subtilement et progressivement dans l’esprit. Au fur et à
mesure que l’on écoute ces chants, on commence à soupçonner la fin de l’histoire et
il est possible de l’appliquer dans la vie quotidienne. Quand nous sommes allés en
paseo à la communauté d’Esquina pour enregistrer des chants d’un vieil homme
très réputé — Chomane —, Jnumi écoutait avec attention et elle faisait des
comparaisons entre ce que les chants racontaient et ce qui se passait au même
moment à Jesudi : « chopise Pojnangue !202 » (« cela ressemble beaucoup à
[l’affaire] de Pojnangue »), nous disait-elle alors qu’elle écoutait un irade d’une
femme qui ne quittait pas définitivement son mari.
VI.4.4. Conclusion de VI.4
Il est possible de trouver quelques traits en commun entre les uñacai et les
irade en ce qui concerne les idées fondamentales qui sont exprimées et soutenues
dans leurs paroles. Nous avons vu dans les uñacai que deux images principales se
répètent : le mort était généreux et il ne se fâchait avec personne. Dans les irade, à
travers les nombreuses anecdotes d’amour, il est possible de percevoir des
régularités similaires : d’un côté, nous pouvons voir que l’homme le plus recherché
est celui qui donne beaucoup de nourriture ou d’argent, soit en tant que mari, soit
en tant que gendre ; de l’autre, ces histoires nous montrent que la résolution d’une
dispute par la séparation est une chose habituelle. Nous pensons que du point de
vue de la vie sociale à Jesudi, ces deux types de chants mettent en relief des valeurs
similaires : la générosité — et la capacité de produire de nourriture — et la
prédilection pour le fait de « ne pas se fâcher avec les autres », que nous appelons
« le calme ».
202
cho3rd pers sing –o to be like
pise Pojnangue
-intensif nom propre
289
�Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises que partager la nourriture, qui
implique l’obligation de la donner et la certitude de la recevoir, est l’un des deux
liens fondateurs de l’ogadi en général. Nous pourrions ajouter qu’un certain
souvenir des devoirs liés à l’uxorilocalité est encore présent à Jesudi : le gendre
devait travailler pour les parents de son épouse. Cependant, il ne faut pas oublier
que ce trait est également marqué quand il s’agit des uñacai dédiés à des femmes
— même si dans ces occasions, la générosité prend la forme du travail partagé ou
des cadeaux en fils de caraguatá. La générosité par le biais de la nourriture est
alors le langage de l’établissement de liens, comme le refus de Jnumi envers
Tamocoi et dicore — sa nouvelle femme — nous le montre. Ces échanges, car ce
sont des échanges, malgré l’accent mis sur l’action de donner, sont également à la
base des rapports sociaux entre ogadi — des morceaux de proies provenant de la
chasse occasionnelle voyagent d’un point à l’autre de la communauté.
En ce qui concerne la justification de la mise en relief du « calme », nous
pouvons dire que tout le chapitre précédent le prouve. La possibilité de partir vers
d’autres communautés ou de demander des terres fait que la migration est une
réaction habituelle et acceptable à une dispute interne. Nous avons été témoin des
migrations à différents degrés de gravité : depuis les cas d’épouses qui sont parties
à cause de discussions que nous considérons banales — « tu as perdu le portable à
nouveau !! » —, jusqu’au départ d’une famille entière parce que le chef de l’ogadi
voulait devenir le chef de Jesudi. Ce ne sont pas simplement des discussions
verbales qui provoquent la dispersion de la communauté, tous ces conflits sont
synthétisés dans l’allocution « utiliser des mots méchants ». En fait « c’étaient de
très beaux mots » ceux de Tercio, quand il a convaincu Jnumi qu’il pouvait rester à
Jesudi, mais au sens précis, l’essentiel était qu’il allait supporter économiquement
sa famille, ne plus être jaloux de sa femme et même permettre que celle-ci s’en aille
avec un autre homme.
S’il fallait proposer quelques règles fondamentales pour que l’unité sociale
de Jesudi — c'est-à-dire, l’ensemble des ogadi — perdure dans le temps, ce seraient
justement ces deux-là : le partage de nourriture et l’abstention de disputes. Les
290
�disputes que nous avons vues dans ce chapitre concernent en général les membres
des couples, mais en fait cette règle s’applique aussi aux rapports entre parents
claniques — comme les uñacai le montrent —, entre amis et autres relations.
Souvenons-nous des uñacai pour Golo : Jnumi et Poro, chacune de son côté,
insistaient sur le fait que cette jeune fille « ne se fâchait pas avec les femmes
étrangères ». Tout cela, bien sûr, sur un fond toujours présent de nostalgie,
jnusietigai.
La générosité, le calme, la peur de la dispersion et la nostalgie seraient ainsi
à la base de la vie sociale des Ayoreo. Cela ne concerne pas seulement ce groupe,
comme plusieurs recherches dans les basses terres sud-américaines en témoignent,
notamment celles de Joanna Overing (2000, 2003). Overing essaie de comprendre
la vie sociale des groupes amazoniens, des peuples qui semblent ne pas cadrer dans
le sens habituel de « société » comme un groupe organisé par un ensemble de règles
explicites qu’il faut respecter. Ces groupes — nous dit l’auteure — mettent
l’accent, fondamentalement, sur le confort émotionnel au quotidien, ils visent à
atteindre un certain degré de convivialité dans la vie communautaire. Overing et
Passes signalent l’importance que les Amérindiens donnent aux émotions dans leur
conversations et suggèrent que le discours indigène est une porte d’entrée au
fonctionnement de leurs sociétés :
In other words, their ‘emotion talk’ is also ‘social talk’ in that they
consider the management of their affective life vis-à-vis other people to be
constitutive of moral thought and practical reason. It is a language that
speaks axiologically of the social benefits of the practice of the everyday
virtues of love, care, compassion, generosity and the spirit of sharing (…).
It dwells equal upon the antisocial inclinations of anger, hate, greed and
jealousy that are disruptive to the human social state. (2000: 3)
Cette mise en évidence du discours et son rôle dans la vie sociale des
Indiens est d’importance fondamentale pour notre recherche. C’est justement dans
le discours quotidien — voire profane — que nous avons trouvé les idées
291
�directrices des comportements individuel et collectif des Ayoreo. Overing signale
que se focaliser sur le quotidien n’est pas banal, bien au contraire, cela implique de
suivre les intérêts des Indiens. En fait, c’est dans le discours quotidien sur des
affaires qui semblent dépourvues d’importance — une dispute conjugale, le projet
d’un voyage, des chants à propos de tout cela — que se trouvent les éléments clefs
permettant de capter des régularités sociales.
Une idée centrale de son analyse est celle de convivialité qui pourrait être
décrite comme une stabilité sociale, proche du signifié en espagnol du mot
« convivir » : « vivre ensemble ». Cette stabilité requiert que certains
comportements soient renforcés alors que d’autres doivent être condamnés, faisant
apparaître une éthique de la vie communautaire.
Their quest for a convivial sociality is the product of a powerful and highly
egalitarian ethics and social philosophy, where humour, generosity
a n d
goodwill provide its sustenance. (Overing et Passes 2000 : 17)
Ces auteurs insistent aussi sur le rapport nécessaire entre morale et
esthétique, contrairement à l’idée kantienne qui les sépare. Cette éthique serait
présente dans la complexité du discours quotidien :
Certainly, to clarify the Amerindian stress upon the need for beauty in the
everyday, we must understand the verses of their chanting and the poetics
of their everyday speech, their artful use of copulas, affixes, noun classes
and possessives, and understand their humour and irony, and their crafty,
complex wordplay (...), all expressive of their strong sense of the follies of
existence, its myriad of interconnections within an animated universe, its
ambiguities and dangers and its possibilities for beauty. (2000: 12).
Nous pensons que les uñacai et les irade mettent en scène les deux valeurs
fondamentales de la stabilité sociale à Jesudi — ou convivialité — : la générosité et
l’abstention de conflits. D’un côté, il s’agit de renforcer l’idée centrale de la
générosité : soit sous la forme du mari recherché, du gendre préféré ou du parent
292
�clanique décédé ; c’est toujours l’image du bon ayoreo — paaque —, celui qui
donne de la nourriture. De l’autre, c’est la condamnation de l’agressivité — « the
other side of the coin » (Overing et Passes 2000 : 20) — qui se montre surtout par
le biais de l’exemplification dans les nombreux irade racontant l’histoire de
quelqu’un de bien aimé qui a dû partir.
Nous sommes d’accord avec l’idée selon laquelle le discours quotidien sur
les émotions est un discours qui aide à l’instauration d’une éthique sociale, mais il
nous semble que cette formulation est limitée. Il faut que ces comportements soient
typifiés avec des exemples, et que ces exemples soient répétés et mis en valeur.
Nous pensons que les différentes catégories de chants organisent la pensée et
l’affectivité et, par conséquent, la vie sociale. Le discours en tant que tel, en tant
qu’échanges linguistiques quotidiens, ne suffirait pas à notre avis à organiser
l’expérience. Il faut qu’il y ait des catégories qui permettent d’aborder plusieurs
événements différents et en repérer les traits communs. C’est justement ce rôle qui
est joué par les chants, surtout les irade et les uñacai. Leur définition même
constitue une première façon de trier les expériences quotidiennes : l’irade raconte
qu’un conjoint manque à l’autre, l’uñacai, que quelqu’un pleure en chantant pour
quelqu’un d’autre. Les histoires d’amour sont nombreuses et diverses, mais
finalement les éléments principaux sont toujours là et ils sont mis en évidence par
les conventions du chant. Il n’est pas possible de penser que tous ceux qui meurent
étaient des individus exemplaires, pourtant c’est l’effet produit par les uñacai.
Parce qu’en fait, même si quelqu’un était méchant et égoïste, le chant dira qu’il
était généreux et aimable. En définitive, ce qui est important, ce sont les chants
parce qu’ils perdurent. Comme le disait Toto Étacori, l’un des chanteurs nocturnes :
« ayoreode ore toi mu iradedie que toi » (« les Ayoreo meurent, mais les chants ne
meurent pas »).
Conclusion du chapitre VI
Nous avons vu tout au long de ce chapitre plusieurs aspects du rapport entre
les chants et la vie sociale à Jesudi. D’abord, nous avons observé que les chants
293
�irade permettaient de mettre en relief quelques conséquences spécifiques d’une
séparation. Un des effets de ces chants est d’établir une association directe entre
une séparation et la nostalgie jnusietiagi, car après tout c’est ce caractère qui définit
le genre. Puis, nous nous sommes concentré sur les chants de tristesse uñacai qui
nous avaient frappé par leur rare combinaison de sentiments intenses et de
structuration discursive. Nous avons montré que ces compositions servaient à
concentrer la tristesse, à des fins cathartique et individuelle, et à rassembler des
gens autour du pleureur, à des fins sociales, qui venait de perdre un lien de
réciprocité. Ensuite nous nous sommes penché sur les mêmes chants — les uñacai
et les irade — mais dans un temps différé, quand les circonstances de la création
n’avaient plus d’effets sur les gens mentionnés ou sur le public. Les chants d’un
moment étaient devenus des histoires indépendantes. Ces histoires indépendantes
— issues de circonstances très diverses — ont en commun certaines idées qu’elles
contribuent à instaurer, par le biais de la répétition.
Les chants nous ont permis de rassembler des données hétérogènes sur la vie
sociale à Jesudi et nous nous sommes interrogé sur leur rapport avec les
événements sociaux. Nous nous sommes concentré sur les chants irade et les
uñacai, car ce sont les chants les plus interprétés à l’occasion des séances
nocturnes. Ces deux catégories particulières de chants continuent à être composées
dans la vie quotidienne à Jesudi. Les autres chants — chants de guerre et chants
chamaniques — sont à notre avis des souvenirs du passé et les Ayoreo de Jesudi en
ont comparativement peu de souvenirs.
Nous avons distingué deux instances de performance de chants. La
distinction est plus claire dans le cas des uñacai, mais elle est aussi valide dans le
cas des irade. Dans cette première instance, nous pouvons voir un rôle certainement
herméneutique des chants : ils servent à faire d’une affaire plutôt individuelle ou
presque — un décès, un couple qui se sépare — un événement qui affecte le réseau
social, tel que la famille, l’ogadi, et même la communauté. Ce n’est pas un individu
qui est mort, c’est un fil du tissu social qui est déchiré. Ce n’est pas non plus une
simple infidélité connue de tous, ce sont les répercussions dans le réseau social,
294
�dans lequel ce couple est une charnière indispensable. Tout événement peut avoir
des conséquences visibles sur le reste de la communauté. Dans le cas des irade,
c’est sous le signe de la nostalgie jnusietigai que nous percevons les allers et
retours des couples. Quant aux chants de tristesse uñacai, c’est la puissante figure
de « la faim qui fait du mal », qui nous fera voir le pleureur comme une personne
sans défense, un individu resté hors du réseau d’échanges sans le vouloir. Son cri
est un appel, et les gens répondent toujours par la simple présence physique. Plus
tard, le temps viendra de tisser de nouveaux liens.
Au fur et à mesure que le temps passe, les chants constituent de moins en
moins des clefs pour comprendre des événements traumatisants — la mort de
quelqu’un, l’obligation de migrer tout de suite. Ils deviennent des unités autonomes
ou du moins indépendantes de ces circonstances. Nous pensons que plus le temps
passe, plus ces chants deviennent, d’une certaine manière, des objets littéraires plus
abstraits, c’est-à-dire que le scénario attire plus l’attention que les personnages
impliqués. De plus, comme les chants circulent entre communautés, il est possible
que, mis à part le chanteur et quelques membres de la première génération, la
plupart du public ne connaisse pas les protagonistes. Dans cette deuxième instance
de la performance, les chants accomplissent le rôle d’établir par répétition ce qui se
présente comme une habitude. Ainsi, on entend des centaines de chants sur
quelqu’un qui est vraiment triste pour quelqu’un qui était généreux et pacifique, qui
donnait de la nourriture à ses amis et ses parents, et qui n’a jamais osé utiliser de
mots méchants contre personne. De nombreux chants racontent aussi que les
femmes veulent se marier avec des hommes qui savent chasser ou travailler et que
surtout les mères de ces femmes aiment ce type de gendres. Enfin, on entend
souvent que suite à une discussion, la femme ou le mari peut partir d’un moment à
l’autre et abandonner son conjoint, ses enfants et sa famille, dans un état de
profonde nostalgie. Les chants ainsi répétés, soir après soir, insistent sur des valeurs
telle que la générosité et le calme, des vertus sociales qui sont à la base de la
convivialité dans de nombreux peuples des basses terres sud-américaines.
295
�Conclusion de la deuxième partie
Nous avons parcouru un chemin particulier tout au long de cette partie,
depuis l’étude des rapports sociaux jusqu’aux chants de nostalgie et de tristesse. Le
chemin logique choisi pour l’exposer est à l’opposé de ce que nous avons vécu sur
le terrain. Les chants — quand nous avons pu finalement les comprendre — ont été
pour nous la porte d’entrée vers la vie sociale des Ayoreo. Nous avons commencé
cette deuxième partie par la description d’un rapport de base : la trame des
cucherane, des igiosode et des edopasade. Les clans, les parents claniques et les
appartenances claniques semblaient au début n’être que des souvenirs d’une vie qui
n’était plus sur le terrain mais dans la bibliographie. En réalité, cette trame était
bien présente dans les rapports quotidiens, surtout visibles au moment des repas
dans l’ogadi. La pensée clanique constitue alors une sorte de connaissance de base
qui précise non seulement que tout est en rapport avec tout mais aussi que tous
dépendent de tous, un principe aussi basique que fortement établi. Ensuite, nous
nous sommes occupé de l’informe matière de la vie sociale. C’est ici où
fondamentalement le concept de jnusietigai — sentir l’absence de quelqu’un —
nous a permis d’organiser le tableau. Cette idée a été sans aucun doute la clef de
voûte qui a rendu possible la compréhension d’une telle myriade d’informations
hétérogènes. Mais cette perception de la centralité de la nostalgie n’aurait pas été
possible sans les chants irade et, d’une certaine manière, sans les chants uñacai.
Ces chants ont fonctionné pour nous comme un filtre cognitif de la réalité sociale.
Nous pensons que ces chants jouent un rôle similaire pour les Ayoreo. Les uñacai
leur permettent de concentrer la douleur et la tristesse dans un moment aussi
traumatisant que bref et intense. L’expression de l’individualité — le sentiment
exprimé dans les pleurs et les cris — se combine avec le respect des règles sociales
— le rythme dans les pleurs et les cris, la poétique précise du chant. L’uñacai met
en relief cette trame clanique de la dépendance, la fait remonter à la surface des
mots : tout est mentionné à travers les edopasade ou les rapports directs de parenté.
C’est une déclaration formidable de la double nature de la personne ayoreo :
individuelle et sociale en même temps — comme le principe animique qui a
survécu à l’évangélisation, l’ayipie, le montre. Les irade, pour leur part, mettent en
296
�scène tous ces échanges affectifs et économiques que sont les rapports conjugaux :
un homme idéal — mari ou gendre — est celui qui donne de la nourriture, et les
femmes — épouses et belles-mères — les recherchent. Ces chants romantiques
constituent un dispositif qui produit des exemples de situations de jnusietigai. Si,
suite à une dispute conjugale, quelqu’un en fait un chant, cette affaire sera
présentée sous le signe de la nostalgie d’amour. De cette affaire, on se souviendra
surtout de la tristesse qu’elle a produite, des enfants ou des conjoints qui ont été
abandonnés. Mais tous ces chants — irade et uñacai — peuvent être répétés, imités
et interprétés à nouveau par n’importe quel individu qui en a apprécié la
composition. Au fur et à mesure que le chant est répété, il commence à faire partie
du grand répertoire des commérages chantés et des tristesses d’autrefois. À partir
du moment où l’uñacai n’est plus un pleur mais un chant, et que l’histoire de
l’irade est plus importante que ses personnages, il est possible de remarquer des
similarités. Ces similarités insistent notamment sur deux vertus sociales par
excellence, la générosité et l’abstention de disputes. Dans une aire culturelle, les
basses terres sud-américaines, où l’idée de société au sens juridique semble
absente, il est nécessaire de trouver un dispositif par lequel un système social centré
sur les vertus s’établirait. Nous pensons que ce dispositif est constitué par le
discours indigène, notamment par les chants. Les chants, en tant que genres de la
parole, constituent des catégories. Ces catégories organisent la pensée et donnent
une signification à l’expérience. Nous avons vu dans la première partie les
nombreux genres de la parole : autrefois, il y avait aussi beaucoup plus de chants de
guerre pinangoningai et ingojnangai, et de chants chamaniques liés à la guerre
enominone. Ces chants — les deux premiers notamment — insistaient sur des
vertus diamétralement opposées à celles que les irade et les uñacai contribuent à
instaurer. Il s’agissait de la mise en valeur de l’agressivité et de l’appropriation des
biens des autres. C’est logique, car ces chants étaient destinés à leurs ennemis. Ce
que nous avons vu sur le terrain, ce que nous avons entendu, ce sont les chants
destinés aux membres de la même communauté, ceux avec lesquels il est nécessaire
de pouvoir vivre ensemble. Autrement dit, d’établir une convivialité.
297
�Cependant, il faut avouer que la convivialité ne va pas de soi, car on risque
de tomber dans l'irénisme. Cette paix sociale est minutieusement établie au
quotidien, car c'est au quotidien qu'une dispute banale peut devenir le premier pas
vers la dissolution d'une communauté. Il y a toujours une tension à Jesudi entre les
facteurs qui lient les membres de la communauté et les facteurs qui les séparent.
Les chants insistent sur tout ce qui unit les Ayoreo, mais l'effectivité de cette
pratique est relative : les gens s'en vont et de nouvelles communautés se forment
assez régulièrement. Nous avons montré comment ces migrations éclatent — ou
sont constamment sur le point d'éclater — et qu’elles sont à l'origine de situations
de nostalgie. Les gens effectivement partent — et leur absence est ressentie — et la
possibilité qu'ils partent est réelle et tangible. C'est-à-dire, les chants contribuent à
contrebalancer les forces disruptives, mais le poids affectif d'une situation de
nostalgie est une condition sine qua non de leur existence. Si cette instauration de
la convivialité — surtout en ce qui concerne le calme — avait trop de succès, les
chants de nostalgie et de tristesse n'auraient pas de raison d'être.
298
�TROISIÈME PARTIE
LES MOTS QUI VOYAGENT
299
�Introduction
Nous avons étudié jusqu’ici le rôle de la parole dans la création du monde
ayoreo. Nous avons analysé les rapports internes au discours, à partir de la grande
division entre parole puissante et parole humaine. Ensuite nous nous sommes
penché sur le rôle des mots dans le déroulement de la vie sociale à Jesudi. Nous
avons dû d’abord nous concentrer sur les détails de l’organisation clanique et des
interactions sociales dans toute l’épaisseur de la vie quotidienne. C’est là que nous
avons mis en évidence que les chants permettent d’organiser les données
hétérogènes des rapports humains dans cette petite communauté. Les mots
organisent la pensée et les émotions, ils servent à valoriser certains comportements
et à en condamner d’autres, suivant une éthique simple et précise. Or, les mots ne
restent pas à Jesudi. Comme les individus qui vont d’une communauté à l’autre, les
mots voyagent.
Quelquefois les mots voyagent avec les individus, contenus dans des
cassettes. Dans la plupart de cas, les mots voyagent dans l’air par le biais des
téléphones portables et de la radio HF. Les Ayoreo ont progressivement adopté ces
technologies depuis le début de la vie dans les missions. Quel est alors le rôle de
ces outils dans la vie des Ayoreo de Jesudi ? Y-a-t-il un rapport entre ces pratiques
communicatives et l’implication de la parole dans la vie sociale ? Nous verrons que
l’un des éléments fondamentaux de ces communications est justement la
transmission de chants.
Nous pensons que les liens affectifs impliquent la transmission
d’informations. Nous avons signalé que le lien de base des membres de l’unité
résidentielle ogadi est l’échange de nourriture. Cela ne suffit pas. Entretenir un
rapport social — c'est-à-dire, économique et affectif — implique un savoir et une
connaissance sur la vie de l’autre, où il se trouve, s’il est etoque ou faible. Ceci
implique de l’amener avec l’ayipie (ce qui veut dire « souvenir » et « penser » mais
aussi « l’amener au cœur »). Nous devons d’abord étudier plus précisément la
300
�création des irade pour savoir ce qu’ils peuvent signifier pour ceux des autres
communautés, quand ils reçoivent ces cadeaux chantés.
Nous étudierons comment et pourquoi les chants irade sont envoyés entre
parents et amis des communautés éloignées, mais avant, nous sommes obligé de
faire le chemin inverse. Nous devons analyser le rapport entre la composition
chantée et l’événement raconté d’un autre point de vue que celui adopté dans la
deuxième partie. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les aspects
sémiotiques de la création des chants. Nous verrons que ce rapport particulier entre
événement et chant est à la base des rapports entre individus qui envoient et
reçoivent des chants.
Nous analyserons d’abord la méthode de composition d’un chant et la
manière dont on peut devenir chanteur. Cela nous permettra d’aborder le caractère
existentiel du lien entre l’événement et le chant. Ensuite, nous nous concentrerons
sur le trait le plus remarquable des irade : la mise en valeur de la dimension
affective. Nous verrons que le mouvement constant des émotions pourrait aider, du
point de vue cognitif, à l’inscription mnésique de l’information contenue dans les
chants. Ce sont justement ces compositions émouvantes et en étroite relation avec
les faits racontés, qui sont envoyées aux autres communautés. Nous examinerons
d’abord quelques comparaisons possibles avec des anciens systèmes de
communication, élaborées par d’autres auteurs. Nous aborderons brièvement
l’utilisation de la radio HF, pour nous plonger plus en détail dans les messages
enregistrés sur cassettes. Dans ce cas, nous verrons plus clairement que les rapports
sociaux présentent une nature à la fois économique et affective.
301
�CHAPITRE VII
LE FAIT, LE CHANT ET LA MÉMOIRE DU CHANT
Introduction
Le fait de voir les Ayoreo chanter tous les jours avait attiré mon attention.
Quand j’ai eu l’opportunité d’enregistrer des messages sur cassettes, j’ai pu
remarquer que tous — sauf ceux qui ne savaient pas chanter — enregistraient des
chants. À ce moment-là, je ne parlais pas la langue et donc, je n’avais aucune idée
du contenu de ces compositions. Quand Poro a essayé d’envoyer un chant à ses
amis et parents d’Arocojnadi, sa fille ainé Asema est venue et a commencé à la
frapper. Tout le monde riait mais je ne comprenais rien. Poro a changé de place
deux fois, mais sa fille la suivait et l’empêchait de chanter. C’est là que j’ai compris
que cette composition parlait d’Asema (c’est l’irade nº 12), qu’elle avait honte et
ne voulait pas que ses disputes avec son mari soient entendues par d’autres
personnes. Ces chants étaient biographiques, en quelque sorte.
Dans quelle mesure ces chants reflètent la réalité ? Nous savons que les
uñacai sont faits par celui qui est aussi le sujet énonciateur. Or, ce n’est pas la
même chose dans le cas des irade. Qui fait les chants irade ? Quel est le rapport
entre le compositeur et le ou les sujet/s énonciateur/s ? Quel est le rapport entre
l’événement, disons, original — une dispute conjugale, une fille qui rejette un
prétendant — et la composition qui en résulte ? Nous avions vu, dans la deuxième
partie, que l’irade mettait en relief certains aspects du fait social, surtout ceux qui
concernent la nostalgie et la migration. Pour que ces mises en relief aient des effets,
il faut qu’un certain degré de véracité soit attribué aux chants. Nous nous
demandons alors, comment les chants acquièrent ce statut de « non fictionnel ».
Quand les Ayoreo de Jesudi parlent des chants, ils mentionnent le compositeur,
mais quand s’il s’agit d’évaluer ou de commenter, ils se concentrent plutôt sur les
personnages du chant. C’est comme si le chant n’était pas construit à partir d’un
point de vue — ou plutôt un point d’écoute.
302
�Premièrement, nous aborderons la question du rapport entre l’événement
social raconté et le chant en relation avec celui-ci. Nous verrons qu’une série
d’artifices poétiques permettent de créer l’illusion du témoignage : le chant se
présente comme une preuve de l’événement social, voire comme un enregistrement
de ce qui est arrivé. Ensuite, nous analyserons la dimension affective du chant,
manifeste dans des détails linguistiques et dans la performance. Finalement, nous
réfléchirons au rôle des chants dans la mémoire sociale des Ayoreo de Jesudi.
VII.1. Le fait et le chant
VII.1.1. L’observateur qui n’est pas là
Nous avons montré, dans la section VI.2 du chapitre consacré aux chants
(deuxième partie), qu’un événement social — une dispute entre Tamocoi et
Lucía — était présenté sous le signe de la nostalgie : les tristes conséquences
étaient mises en relief. Ce chant composé par Jnumi — mère de Tamocoi qui tenait
beaucoup à sa belle-fille — implique d’abord une perspective, une lecture
personnelle de la situation décrite. Or, le chant n’est pas une histoire inventée, une
fiction, ce qu’il raconte est présenté comme un fait réel de la vie des Ayoreo. Nous
avions montré que les chants constituaient un recueil d’anecdotes et que les Ayoreo
de Jesudi les prenaient en compte pour réfléchir aux situations dans lesquelles ils se
trouvaient. Les irade — stricto sensu — ont un caractère véridique qui est à la base
de cette sorte de jurisprudence.
Dans ces chants, le point de vue du compositeur n’est pas évident, c’est
comme s'il n’avait pas de perspective, comme s'il n’occupait pas de position
spécifique dans le réseau social de Jesudi. Voyons le bref irade de la colère
d’Asema — fille de Sidi et Poro — contre Luciano Iqueai Chiquenoi, son mari qui
s’était décidé une fois de plus à la quitter :
303
�Asema pojnaquei
Ñimosi ñimochatique dirica mu yudute Luciano pijnatigo dirica ga ñaeque :
« Luciano, ma ca araja ite yoquijogatique? ».
[Luciano] Ñaeque: « Asema, uyu, ga yise ua ide mu a yiya u ato, majnue
yibai uje sijnangue ua »,
mu ñaome Luciano uque [Asema uruode] : « Luciano majne baruode udoe
chise uje baya yu nanique ga majnina Ina nanique mu bayipie doi yu
mu a yiya pusua to jne betaque yica, yabi i ajei gu, ma ca bayipie doi poi yu
jetiga yica tudaque base ».
[Luciano uruode] : « Chise uje jnanidacayabi jno ome datamajnaningai
gajine nanique que yipota jeta yiya Asema, Asema dei quenejnane ga
yagupusu yajei »
La colère d’Asema
Je dormais dans mon lit hier mais j’ai entendu les cris de Luciano et j’ai
dit : « Luciano, est-ce que tu ne connais pas notre lieu [ogadi], celui de ma
mère ? »
[Luciano] a dit : « Asema, moi, je t’ai trouvée ici mais je te quitte, tu te
fâches avec moi parce que t’es méchante »
mais j’ai dit à Luciano : « Luciano, tes mots sont des mensonges, une fois
tu m’as quittée et t’es allé avec Ina203 , mais ton ayipie m’amenait [tu
pensais à moi]
mais moi je te quitterai, tu détestes mon [gros] ventre, car il y a un enfant
dedans [c’est pour cela qu’il est gros], mais que ton ayipie ne m’amène pas
[ne pense pas à moi] quand mon ventre tombe [l’enfant soit né] »
[Luciano] a dit : « Il était une fois où son père est allé travailler, et je ne
voulais pas quitter Asema, elle était ailleurs et elle me manquait beaucoup »
La compositrice de ce chant est Poro, la mère d’Asema, mais les voix que
l’on entend ici sont celles d’Asema et de son mari, Luciano. Poro a dû entendre
203
Fille de Bajai et de Daju, voir irade nº 19 sur Juguei, Ina et Asema.
304
�cette discussion — qui a eu lieu dans son ogadi —, mais c’est comme si elle
observait et restait silencieuse. Ce qu’on peut remarquer dans les irade n’est pas
l’absence du compositeur, bien au contraire, c’est la déclaration de sa présence et la
neutralité de son exposition. Sa présence en tant qu’observateur des faits qu’il
raconte est marquée par l’absence de la particule chi204 . Nous avions mentionné
cette particule lors de l’analyse de mythes à la différence des formules de guérison.
Chi veut dire « on dit que » et introduit des événements que le sujet n’a pas vus,
mais dont on lui a parlé. C’était la marque typique des mythes. Dans les irade, on
ne trouve nulle part cette particule, car le chanteur est en train de raconter des
événements dont il a été témoin (ou du moins, il se présente de cette manière).
Il y a — comme toujours quand on énonce un principe général — une
exception qui cadre très bien avec la règle. C’est le cas de cet hybride chanté qui est
le versículo — vers de la bible sous la forme d’un irade —, car il raconte une
histoire de la vie de Jésus, vie qu’aucun des Ayoreo n'a pu voir directement :
chi Jesus acadigode ore chise cheque ga chi ore chojinga ome cheque
« coñoi deiti ga chiqueta coñone edopaigode » ga chi cheque tuate ga...
« on dit que les apôtres de Jésus sont parvenus à la femme et on dit qu’ils
ont dit à la femme ‘il y a un homme blanc là qui guérit les hommes blancs
aveugles’ et ont dit que cette femme-là et… »
(Versículo, par Jnumi Posijñoro)
Nous avons alors dans l’irade une sorte de description véridique : un témoin
qui nous raconte ce qui s’est passé. Or, comment pourrait-on assurer la fidélité
d’une telle description ? Nous savons bien qu’une description disons « pure »
n’existe pas, car dans l’observation de ce qui s’est passé et dans sa reconstruction
postérieure, il y a toujours une interprétation subjective, une perspective
incorporée. Dans les irade, tous ces problèmes n’existent pas — on pourrait dire
204
« chi : it is said ; he/she/ it says ; they say that…(…) Note : used when quoted indirectly. » (HIGHAM et
al. 2000 : 205).
305
�qu’ils sont évités —, parce que les descriptions sont absolument absentes.
Autrement dit, il n’y a pas de descriptions de la part du compositeur, on ne peut pas
percevoir de « voix off ».
Les irade sont exclusivement constitués — comme celui d’Asema — par des
phrases textuelles du sujet énonciateur et des autres personnages de la composition.
En fait, ce n’est qu’un long recueil de dialogues transformé en chants. Il y a bien
sûr des développements dans le scénario de l’histoire, même des épisodes (par
exemple dans celui de Dajei : « nous sommes allées à Jesudi (…) je suis allée à la
maison de mon frère »), mais ces descriptions des actions sont toujours racontées à
travers la voix de l’un des personnages, jamais par le compositeur.
VII.1.2. Commencer à chanter
Qui est alors le compositeur ? Comment fait-on un irade ? Le compositeur
est une personne ayant écouté des dialogues à partir desquels il pourra réaliser des
chants. Il ne semble pas y avoir de méthodologie spécifique pour composer, il suffit
d’écouter quelques phrases et de les répéter : « yirate Puchiejna uruode ga yipesu
pirade » (« j’imite les mots de Puchiejna et je fais un irade ») nous a dit Jnumi.
Quand Puchiejna ne s’était pas encore mariée avec Chugupenatei, celle-ci habitait à
Campo Loro. Puchiejna a dit à son ami Pajei — lui aussi avait sa copine là-bas —
d’aller rendre visite aux filles, car elles leur manquaient beaucoup. Jnumi a entendu
ces phrases et en les répétant elle a fait un irade. Jnumi n’a jamais voulu
l’interpréter pour que je l’enregistre, car elle disait que son fils aurait honte.
Néanmoins, elle nous a raconté les phrases que Puchiejna et son ami Pajei disaient.
C’était le soir et ces deux amis ne pouvaient pas dormir, car ils pensaient à leurs
copines qui étaient ailleurs. Puchiejna a dit :
Yajíe yiquei mu ñimo ñijnorai ga pujnusietigai chise yu : « je regarde devant
moi mais je vois mon ami [et pas ma copine] et la tristesse m’atteint »
306
�Jnusietigai ujuyapise ñiquijnorai uyoque : « mon ami et nous, nous
sommes accablés par la tristesse »
Ces phrases nous semblent familières, car des lignes similaires se trouvent
dans des irade et même des uñacai (par exemple l’irade nº 21). Nous ne savons pas
si Puchiejna a effectivement dit ces mots précis ou si c’est le souvenir de Jnumi. En
tout cas, Jnumi présente ces phrases — soit dans la conversation avec nous, soit
dans le chant — comme des répétitions textuelles de ce qui a été dit. En général, le
compositeur d’irade n’est pas le sujet énonciateur, du moins dans quasi-totalité des
cas que nous avons analysés. Même dans les deux chants de la colère de Tamocoi
contre sa mère — composés justement par elle —, nous pouvons écouter les phrases
de Jnumi sans qu’elle soit le sujet énonciateur. C’est ce que Jnumi dit selon
Tamocoi — le seul sujet énonciateur. En fait, le mot « composer » n’est pas
vraiment applicable, car il nous renvoie à l’idée d’invention. Créer un irade
consiste à écouter et à imiter. Cela ne veut pas pour autant dire que les chants sont
créés depuis un point de vue neutre — les cas cités de Jnumi et Tamocoi le
montrent très clairement —, mais ils semblent l’être, ils sont construits comme s’ils
l’étaient.
Quant à la préparation du chant, le cas de l’irade est radicalement différent
de celui de l’uñacai. Nous n’avons pas été témoin de la préparation complète d’un
irade, mais nous avons vu Jnumi répéter quelquefois (au sens de « dire deux fois »
et aussi de « préparer une scène ») des phrases en les chantant à voix basse. Dans
ces occasions — lors de la création d’un irade pour sa fille Pojnangue et un autre
pour Ijnamia —, Jnumi nous a empêché d’enregistrer les chants, car « elle faisait
des essais mais elle n’avait pas encore fini ». D’après Jnumi, les Premiers Hommes
faisaient comme ça, s’ils entendaient les mots de quelqu’un, ils imitaient et
faisaient un chant. En ce qui concerne les motifs pour interpréter des chants — soit
des originaux ou des imitations —, la réponse était toujours la même : « terachu,
yasique gu » (« il chante parce qu’il est content »).
307
�La formation d’un chanteur ou d’une chanteuse ne semble pas être structurée
non plus. Cela ne nous étonne pas, car pour d’autres professions il n’y a aucune
sorte d’apprentissage établi205 . Jnumi disait que quand elle était jeune, elle avait
honte de chanter. Elle écoutait Sidi, Uguri et Gaaçai, mais n’osait pas interpréter
d’irade. Elle essayait parfois, mais elle ne savait si elle le faisait correctement. Elle
a commencé à chanter parce qu’elle voulait aider Nito. Nito, l’ami paraguayen de
Jesudi que nous avons mentionné auparavant, avait financé toutes les analyses
médicales de Puchiejna lors de sa maladie inexplicable. Nito aidait de diverses
manières les Ayoreo — il leur donnait de la nourriture, des médicaments, il
arrangeait des visites à l’hôpital, etc. —, mais il ne leur donnait pas directement
d’argent. Or, ceci était une condition indispensable pour la plupart des Ayoreo face
à un homme blanc désirant enregistrer des chants206 . Jnumi s’est décidée à
apprendre à chanter pour aider l’ami paraguayen de Jesudi — ce qui est aussi une
stratégie économique pour assurer une ressource. Jnumi était en paseo à la
communauté d’Ebetogue. Elle a alors commencé à imiter un chant racontant la
tristesse d’amour d’une femme appelée Ujnamia. Aquesuide, un chanteur réputé
d’Ebetogue lui a dit « baraja » (« tu sais [chanter] »). Voilà qui était fait : Jnumi a
commencé à chanter et même à imiter les phrases des autres pour faire des chants.
Son premier irade a été celui de Puchiejna pour Chugupenatei.
Quand nous avons demandé aux autres chanteurs ou chanteuses de Jesudi
comment ils avaient appris à chanter, la réponse a toujours été la même : « j’ai
entendu et j’ai imité ». Chanter semble être aussi simple que de répéter : il n’y a pas
de formation requise, il suffit d’écouter et de répéter. Il faut maintenant analyser le
205
SEBAG l’avait remarqué notamment pour le cas du chaman : l’initiation très brève et le manque
de conditions requises l'avaient frappé (1965b : 116).
206
Nito est une sorte de protecteur de Jesudi : il les aide avec la réparation du tracteur, les soins
médicaux à Asunción et diverses démarches. Il avait organisé avec une université du Canada la vente
des produits artisanaux des Ayoreo pour financer la construction de six maisons en briques de Jesudi,
parmi d’autres projets. Les Ayoreo, de leur côté, lui ont donné la permission de prendre des
photographies et d’enregistrer des chants gratuitement. Habitués à certains anthropologues et
documentalistes, les Ayoreo demandent toujours de l’argent pour chanter ou se laisser prendre en
photo. Seuls les Ayoreo de Jesudi et ceux de 15 de Septiembre aiment faire remarquer qu’ils ne
demandent pas d’argent, car « ils ne sont pas comme ceux de Campo Loro ».
308
�rapport entre l’événement — une dispute conjugale, un homme désiré par une
femme ou une belle-mère — et la composition construite à partir de celui-ci.
VII.1.3. Écouter et répéter, l’enregistrement de la vie conjugale
L’irade est un fragment de la vie sociale qui est devenu chant. Il a vraiment
la valeur d’un témoignage. Nous nous demandions comment les chants acquièrent
ce statut de véracité. Nous avons été témoin de situations où les paroles des chants
étaient prises comme si elles étaient des enregistrements des situations sociales
décrites, non comme des versions, comme l’expression d’un point de vue. Cette
qualité des chants soulève d’abord deux questions. En premier lieu, il faut savoir
comment le chant devient la « copie fidèle » de ce qu’il décrit. En deuxième lieu,
cette idée de copie suppose que les techniques pour élaborer un chant
constitueraient un dispositif qui permettrait cet enregistrement des situations
observées.
Le chant devient la copie fidèle de ce qu’il décrit à travers une mise en relief
de la parole. Voyons un exemple. À partir de la situation sociale originale —la
dispute entre Asema Posijñoro et son mari Luciano Iqueai Chiquenoi —, Poro fait
abstraction de toute description et se concentre sur les mots : son chant n’est
finalement qu’un recueil de dialogues. Il n’y a aucune description de la situation du
point de vue de Poro, tout est raconté à travers les mots d’Asema. Ces dialogues
entre Luciano et sa femme sont censés être répétés textuellement par Poro.
Les chants irade ont certains traits qui rendent relativement simple la tâche
de faire une composition. D’abord, nous pouvons remarquer leur matière première :
les dialogues. Au vu de nos conversations avec Jnumi, il semble que ce sont
effectivement des phrases prononcées par les personnages du chant. Or, il y a sans
doute un travail de sélection. Jnumi avait choisi les phrases de Puchiejna
ressemblant le plus aux phrases habituelles des chants, celles qui exprimaient de la
manière la plus intense des sentiments tels que la nostalgie : « pujnusietigai chise
309
�yu » « la tristesse m’atteint ». Ensuite, ces phrases sont enchaînées
chronologiquement. Les seuls retours en arrière dans le temps sont quelques
références à un passé plus heureux. Ces références sont intercalées dans le but
d’établir un contraste avec la tristesse du présent — comme par exemple l’irade de
Dajei.
Ce qui marque le début des chants est la phrase « ñijnecamine » (« je chante
ici ») ou bien « yipesabu enuei ga yedobu… » (« je fais une corde et j’imite… »).
Jnumi nous avait dit que généralement les femmes faisaient des cordes de hamac en
chantant, puis qu’elles se balançaient dans le hamac au moment de chanter207 . Il n’y
a pas de formule de clôture.
Faire un irade consisterait, selon ce que nous venons de montrer, à écouter
les paroles de tristesse et de nostalgie d’un individu, à en sélectionner quelques
phrases, à les enchaîner chronologiquement et puis à ajouter au début la formule
d’introduction « ñijnecamine » (« je chante ici »). Nous pourrions nous demander
alors : quel est le rapport entre cette situation et le chant qui en résulte ? Nous
pensons que la mise en relief de la parole et la répétition de certaines phrases sont
les deux traits fondamentaux de ce dispositif poétique. Les chants, en tant que
dispositifs poétiques, permettent d’enregistrer des événements avec une force de
vérité notable. Nous croyons que cette répétition — même si elle n’est pas
textuelle, elle est pensée comme si elle l’était — fait du chant un indice — au sens
de Peirce — de l’événement raconté208 .
L’exemple classique de l’indice est le suivant : la fumée est un indice du feu,
les empreintes sur la neige sont des indices des pieds qui s’y sont enfoncés. Il y a
un lien direct entre representamen et objet — l’interprétant est existentiel. C’est un
207
Même si nous n’avons jamais vu cela lors de notre terrain, nous pouvons signaler que Daju
chante en se balançant dans le documentaire « Las Tortugas de Chovoreca » (GAYET 2010).
208
PEIRCE est un auteur aussi intéressant que difficile à interpréter. Notre perspective sur les
concepts de PEIRCE suit en grande partie les réflexions du sémiologue Eliseo VERÓN, dont l’œuvre la
plus connue est La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad (1988).
310
�rapport concret, existant dans le monde209, qui est devenu signe —complété par un
interprétant — dans la tercerité. Ainsi, les indices ont la force de l’évidence, de la
contiguïté : les reliques de saints — ou de la croix — en sont de bons exemples. La
photographie analogique, les enregistrements avec des magnétophones constituent
des exemples d’indices aussi, car une partie de l’objet — la lumière reflétée, les
ondes sonores reproduites — est restée dans le representamen210 .
Nous pensons que ce même rapport indiciel existe pour les Ayoreo entre un
événement social et le chant qui en résulte. C’est comme s'il avait été enregistré : le
chant apporte au public les mots de cette dispute amoureuse, les mêmes mots qui
furent une fois prononcés par un homme et une femme. Ce lien indiciel est ici fait
par quelqu’un qui n’a pas été le protagoniste de la situation. Nous croyons qu’au
fur et à mesure que le temps passe, tout doute possible sur la véracité du chant
s’évanouit. La seule occasion où on nous a signalé qu’un irade n’était pas véridique
fut le jour où il venait d’être interprété pour la première fois. Daju était venue chez
nous et s'est mise à chanter pour que nous l’enregistrions. Il s’agissait de l’irade de
la dispute entre sa fille Ina et Juguei. Rafaela — sœur de Juguei et qui n’était pas là
lors de l’enregistrement — nous a dit l’après-midi que tout ce que Daju avait chanté
étaient des mensonges. À part cette occasion, nous avons ressenti dans le reste des
cas le sentiment contraire : les personnages des chants —Asema, Pojnangue,
209
À vrai dire, du point de vue de PEIRCE, nous ne pouvons pas atteindre ce monde « concret »
antérieur — au sens logique — des signes, car nous ne pouvons vivre que dans la tercerité, c'est-àdire, dans le monde de la pensée.
210 Ch. S. P EIRCE (1931-1958) présente d’abord le concept de trois niveaux logiques de la réalité : la
primérité, la secondité et la tercerité. La primérité est le monde de la pure possibilité, il n’y a pas
d’événements concrets ici. Dans ce monde, il n’existe pas par exemple « la couleur rouge », mais la
rougitude, autrement dit, c’est la qualité sans concrétisation. La secondité est le monde des faits, de
ce qui est concret, mais avant toute classification. On peut trouver dans ce monde un objet en bois
qui sert à s’asseoir, mais ce n’est pas « une chaise », car cela impliquerait d’ajouter une catégorie, de
faire une abstraction à partir d’une collection d’objets. Ici, il n’y a que des objets uniques. Enfin, la
tercerité est le monde des signes, des lois, de la pensée (ces termes sont des synonymes pour PEIRCE.
Ainsi nous sommes dans la tercerité, il n’y a pas de signes dans la primérité et la secondité, car le
signe est d’une nature ternaire. Le signe est un rapport ternaire entre trois instances : un
representamen, un objet et un interprétant. L’icône est un signe206 où le rapport entre le representamen
et l’objet est de similitude, de qualité — ce qui renvoit à la primérité. L’indice est un signe où le rapport
entre le representamen et l’objet est existentiel, généralement causal — ce qui renvoit à la secondité. Le
symbole est un signe où le rapport entre le representamen et l’objet concerne la pensée et la
catégorisation — ce qui renvoit à la tercerité.
311
�Puchiejna — avaient honte que Poro ou Jnumi puisse chanter leurs histoires
d’amour, comme si ces femmes étaient en train de nous dévoiler des archives
intimes de leurs filles et leurs fils. Le même lien indiciel pourrait être signalé pour
les autres genres de chants concernant la première instance de la performance. Il y a
une différence nette avec les irade : dans ces autres cas, le chanteur est le
producteur du signe. Ainsi, l’uñacai est l’expression directe de la tristesse ressentie,
le pinangoningai et l’ingojnangai sont celles de la bravoure et de la fierté
guerrières respectivement, et le yasitigai est un indice de la joie vécue. Le seul cas
ne cadrant pas avec cette proposition, serait celui des enominoi, les visions
chamaniques. Le naijnai chante après s’être réveillé, après que cette vision se soit
présentée en rêve. Dans ce dernier cas, le chant est plutôt le souvenir d’une vision,
il y a un décalage entre l’objet — la situation amoureuse, le sentiment de tristesse,
de bravoure ou de joie — et le representamen — le chant. C’est ce rapport de
contiguïté que les chants apportent au public. Il y a en fait deux ordres d’indices.
D’abord, le rapport indiciel entre chant et sentiment dans les cas des uñacai,
pinangoningai, ingonjangai et yasitigai, et entre chant et dialogues dans le cas des
irade. Ensuite, un rapport indiciel secondaire — comme un enregistrement — entre
la première et la deuxième instance dans les chants où le chanteur est le
compositeur (autrement dit : tous sauf les irade). Les irade constituent une
catégorie différente, car dans la plupart des cas, la personne qui compose le chant
n’est pas le protagoniste des événements racontés.
Les règles de composition des irade permettent de composer des chants par
le biais de la sélection de phrases et leur répétition textuelle. Ces techniques
poétiques relativement simples permettent cependant d’attribuer aux compositions
une force importante d’évidence, qui est à la base de leur rôle dans l’établissement
d’une éthique sociale et dans la création de liens entre des parents et amis qui
résident dans des communautés éloignées.
312
�VII.2. Les émotions, les chants et la mémoire
Uguri Dosapei (crédit : Ricardo Maldonado)
VII.2.1. Les signes de l’affectivité
Les chants irade sont, par définition, chargés d’émotions. Ils racontent des
histoires d’amour sous le signe de la tristesse. Il y a toujours une mise en relief de
la nostalgie, de la frustration ou de la tristesse dans le thème même du chant.
Cependant, la mise en relief de l'aspect affectif des chants n'est pas limitée aux
paroles. Il y a des marques d'affectivité tant au niveau des morphèmes qu'au niveau
de la voix, des mouvements du corps, du scénario — bref, de la performance.
Les marques linguistiques d’affectivité sont employées surtout dans les
chants, alors que dans la parole quotidienne leur utilisation est limitée à quelques
situations spécifiques. Ces marques sont de deux types. D’une part, nous avons
remarqué l’utilisation de certains affixes et, de l’autre, quelques mots — que l’on
313
�pourrait considérer comme des adverbes — semblent mettre en relief l’intensité
affective du chant. Voyons ces marques dans les exemples suivants :
Ñijnecaosiabide yapacadi to gajine. Que yedosu gajine cuchaique gajine
yedogabiasu gajine Pascualita suaque uruode // Yiyaguiasi Oonei to ica :
« Je chante ici dans mon lieu maintenant. Je parle beaucoup maintenant de
quelque chose, je parle des mots de Pascualita // J’ai quitté Oonei »
(Dajei pojnaquei, par Daju)
Uengate ñirique mu cheque dacatabia pusi yu i gateique uengate
yayipieraque jejogat ome ore disidacabode databia casica : « Fortement je
me suis réveillé mais la femme mère [Jnumi] s'est fâchée avec moi.
Fortement je pense à la mère des enfants avant [Lucía] »
(Tamocoi pojna Jnumi 2011, par Jnumi)
Uengate inna suaque inna Osora suaque pojnasia yu que : « Fortement ma
sœur celle-là, ma sœur Osora, m’a mise en colère »
(Abeca pojnaquei, par Jnumi)
suque diosique chose ti ca yiraja purusaratique ga uñatique uñatique suque
uñatique churusa suque ñatique cuchamaringa ga jeaque ñipojnasia
uñatique : « celui-ci est arrivé [du travail] comme s’il ne savait pas lire et
celle-ci avait écrit dans [le chapeau de] celui-ci et vite je me suis fâchée
contre lui »
(Iba pojna dabai, par Jnumi)
gajine uengat pujnusietigaique ujuyapise yu : « maintenant fortement je
suis accablée par la tristesse »
(Pojnangue jnusi Tercio, par Jnumi)
Yipesabu enuei ga yedobu yujode dosapequedate Igaubi uqué : « je fais la
corde et je parle du grand dosapei Igaubi »
(irade pour Chicori, auteur inconnu, par Cuia)
314
�Nous pouvons remarquer l’utilisation des suffixes -si (et ses variantes –sia et
–osi) et –abi (et la variante –abu). Selon le dictionnaire des New Tribes
Mission, ces deux suffixes manifestent un traitement de tendresse :
-abu [mais aussi ‘-abi’ et ‘-bi’] : v. suffix 1. minimizer (a bit, a while, a
little) ; 2. shows a polite attitude (…)
-osi [mais aussi ‘-si’ et ‘-sia’] v. suffix shows diminution / endearment of
subject or object.
Le suffixe –si ajouté aux verbes est un indice de tendresse, d’un traitement
familier. Par exemple, quand un enfant dort, on dit mosi au lieu de mo. Ce suffixe
est employé normalement quand le sujet ou l’objet de l’action est un enfant. Mais il
peut arriver que ce traitement affectif soit dispensé à une personne âgée : si celle-ci
est très aimée et elle meurt, on dira tosi au lieu de toi.
Le même phénomène se produit avec les noms et le suffixe –abi. Ce suffixe
indique une petite taille, désigne la progéniture des animaux ainsi qu’un traitement
familier vis à vis de l’objet 211.
Nous pouvons remarquer également l’utilisation répétée du mot uengate.
Quand nous avons essayé de traduire ce mot, Jnumi nous a donné une idée
d’intensité. En effet, traduisant un uñacai, Jnumi nous a expliqué : « ducodepise,
gu » (« il est très triste, c’est pour cela »), alors que quand il s’agissait d’un irade,
elle a dit : « jnusipise dabai, gu » (« son mari lui manque beaucoup, c’est pour
cela »). Nous croyons que c’est un mot que l’on peut mettre assez librement dans la
phrase, du même style que gajine, et qui permet d'enchaîner les lignes du chant.
Cela pourrait être aussi une mise en relief de la phrase je ué ! (« c'est vrai ! »). Les
Ayoreo utilisent cette phrase lors de performances guerrières — les spectateurs
disent : « je ué ! » pour donner un feedback à l'acteur — et quand ils racontent des
211
Les Ayoreo utilisaient ce suffixe pour nommer une camionnette que j’ai eue pendant quelques
mois. Elle était très petite et abimée, surtout en comparaison avec les puissants 4x4 des mennonites.
Les Ayoreo étaient habitués à la pousser dans les chemins du Chaco quand elle tombait en panne. Ils
l’appelaient bachidabi (« ta petite mascotte/ton petit véhicule »).
315
�événements — je ué pise ñu uje ñojninga… (« j'avais beaucoup de raison quand j'ai
dit... »). Uengate — avec gate, « en haut », qui pourrait être un intensificateur —
signifierait « c'est très vrai ». De toute façon, nous avons préféré la traduction
« fortement », ou bien « intensément ».
Cette utilisation marquée de suffixes signifiant la tendresse et d’adverbes qui
signalent l’intensité, nous montre un certain effort poétique pour communiquer des
sentiments et provoquer des émotions dans le public. Cependant, ce n'est pas
seulement dans l'aspect purement verbal — des morphèmes, des adverbes, des
paroles — qu'il y a une mise en relief volontaire de l'affectivité ; c’est aussi dans la
performance de ces chants. Estival (2006a) signale que plusieurs détails de la
performance provoquent des émotions intenses chez le chanteur et dans le public.
Certains concernent l’auditif, par exemple le vibrato de grande hauteur et de forte
intensité — associé au courage, selon l'auteur. Certains portent sur le visuel : la
performance à la lumière du feu, les expressions faciales et les mouvements du
corps ont une grande force dramatique.
Nous pouvons voir qu'il y a une mise en valeur des émotions à plusieurs
niveaux, il y a des manipulations poétiques et performatives qui semblent destinées
à émouvoir les gens qui écoutent. Pourquoi cette mise en valeur de l'affectivité ?
Estival (2006a) propose l’hypothèse suivante : les Ayoreo préféreraient chanter les
irade — au lieu de tout simplement les narrer — pour mieux se souvenir de ces
événements. L’émotion suscitée par la performance du chanteur, les paroles du
chant et la totalité du fait social général — le public, les histoires d’amour relatées,
etc. — conformeraient une partie fondamentale de ce renforcement de la mémoire.
Cette mémoire serait utile aux Ayoreo, d'après Estival, pour ne pas oublier l’identité
des parents claniques et les affins, et surtout pour renforcer les liens sociaux à
l’intérieur de la communauté (2006a : 327).
Nous avons du mal à accepter cette idée de finalité mnésique des chants.
C’est comme si les Ayoreo chantaient parce que narrer ne suffisait pas. Sans doute
peut-on dire que les chants aident à la mémoire et que les Ayoreo en sont
316
�conscients, mais nous trouvons difficile d’accepter l’hypothèse qui décrit ce trait
comme l’élément fondamental. En tout cas, ils ne chantent pas pour se souvenir. Ils
aiment faire des chants pour des motivations diverses dans le cas des irade et des
uñacai, comme nous l’avons montré dans le chapitre VI. Après, ce qui a été chanté
perdure plus longtemps dans la mémoire, comme le travail d’Estival l’a bien
expliqué. De plus, il faut souligner que la mémoire collective des chants a un
fonctionnement qui n’est pas clair, du moins dans l’état actuel de notre recherche.
D’une part, j’ai remarqué en 2010 que Jnumi et Poro avaient oublié des chants que
j’avais enregistrés en 2008. D’autre part, au fur et à mesure que l’on fouillait dans
les souvenirs de Jesudi, ces deux femmes se sont souvenues soudainement des
chants qu’elles n’avaient pas interprétés depuis une quinzaine d’années. Comme
nous l’avons remarqué auparavant, l’esthétique joue ici un rôle, car elle relie
l’intensité affective des chants avec leur instauration dans la mémoire. Les Ayoreo
aiment écouter les chants les plus beaux, ce qui influence les demandes du public et
les choix du chanteur. Les chants les plus beaux sont ceux qui montrent une
émotion de la manière la plus forte — comme le bel exemple de l’uñacai pour
Tamocojnai. Nous pensons qu'il y a une esthétique directement liée aux émotions.
Dans les conversations quotidiennes, les commérages sur les couples occupent une
place très importante — n'oublions pas que « 'emotion talk' is also 'social
talk' » (Overing et Passes 2000 : 3). Un récit est toujours différent du fait original,
il y a « une mise en texte » (Bauman et Briggs 1990) qui implique un
développement. Dans cette transformation du fait au récit, il y a une mise en relief
des aspects affectifs : les affixes, les adverbes, la sélection des dialogues à
reproduire ont pour but d'élever autant que possible le poids de l’émotion,
émouvant, de l'histoire. Si c'est un bel irade, c'est parce le sujet énonciateur
jnusipise (3e sg. « manquer » - intensif), si c'est un uñacai, parce qu'il est
ducodepise (adj. « triste » -intensif).
317
�Conclusion du chapitre VII
Nous avons suivi le processus créatif des chants et la manière de devenir un
chanteur. Un peu à la façon des chamans, il s’agit d’une élection volontaire, la
profession est accessible à tout le monde. Il suffit de faire attention aux chanteurs
célèbres — « ñangai, ñangai, ñangai… » (« j’écoutais, j’écoutais, j’écoutais… »),
disait Jnumi — et d’imiter les phrases choisies. Le chant consiste alors en une
répétition textuelle des dialogues. Cette simplicité de composition est à la base de
l’un des traits fondamentaux du chant : son caractère indiciel. Les mots de
l’événement raconté sont les mots du chant. Le chant devient ainsi un attribut de ce
qui s’est passé, c’est une partie de la situation sociale décrite. Ce lien indiciel se
caractérise notamment par une mise en valeur de la dimension affective. Des
marques linguistiques spécifiques sont employées avec une fréquence supérieure à
celle de la parole quotidienne. De plus, les divers éléments de la performance — la
voix, le corps qui se balance, la lumière du feu — et l’ambiance générale se
combinent pour renforcer les effets émotionnels sur le public et sur le chanteur.
Ces souvenirs chantés, si chargés d’affectivité, ont en plus un lien étroit,
indiciel, avec les événements d’origine. Il serait exagéré d’affirmer que les chants
apportent l’événement au public, car nous avons distingué clairement deux
instances de la performance. Cependant, nous pensons que la valeur esthétique et
affective — et donc, mnésique — des chants se fondent justement sur ce lien
indiciel avec les situations sociales décrites. C'est-à-dire, nous pensons que quand
un événement se détache du quotidien — généralement dû à un aspect affectif —,
les Ayoreo produisent un chant et ils le font sous le signe d'une intense affectivité.
Ce qui est chanté, est logiquement mieux inscrit dans la mémoire. Les chants se
transforment en souvenirs transmissibles. La circulation des chants constitue le
sujet du chapitre suivant.
318
�CHAPITRE VIII
LOVE IS IN THE AIR. LES MESSAGES DANS LES CASSETTES ET LA RADIO HF
Introduction
Quand je suis arrivé en mai 2008 à Jesudi la couverture du réseau de
téléphonie mobile n’était pas encore arrivée. Néanmoins, les Ayoreo n’étaient pas
isolés des autres réseaux de communications. Tous les jours, à midi et en fin
d’après-midi, les Ayoreo allumaient la radio HF et parlaient avec leurs parents et
amis des autres communautés. La radio AM était allumée toute la journée et
synchronisée sur la même fréquence : « Radio Pa’i Puku, la voz del Chaco
paraguayo ». Parfois on pouvait entendre des messages en langue ayoreo, moment
où la radio était mise à plein volume. Quand une opportunité se présentait, ils
enregistraient des messages sur des cassettes et les envoyaient à d’autres Ayoreo de
la région.
Nous nous questionnions sur le signifié de ces pratiques, à savoir si elles
pouvaient être considérées tout simplement comme des échanges d’informations, si
elles avaient été instaurées par l’instrument utilisé — les émetteurs de HF et les
magnétophones — ou par l’environnement où les Ayoreo les ont connues — les
missions —, ou si elles présentaient en fait une continuité avec d’autres pratiques
communicatives précédant l’arrivée de ces technologies. Nous voulions savoir aussi
ce qui se passait quand ces messages arrivaient au destinataire, quelle était la suite
de ces paroles entendues.
Premièrement, nous étudierons les hypothèses de divers auteurs sur
l’utilisation de la radio HF chez les Ayoreo. L’idée à la base des hypothèses de ces
chercheurs est qu'il y a un rapport entre les systèmes de communication des Ayoreo
avant le contact et l'utilisation de nouvelles technologies. Nous analyserons les
similitudes et les différences entre ces deux moyens en reprenant la distinction
entre parole puissante et parole humaine élaborée dans la première partie de cette
thèse.
319
�Deuxièmement, nous laisserons le terrain spéculatif concernant les pratiques
du passé et nous passerons à l’ethnographie des messages lors de notre terrain entre
2008 et 2011. Nous nous consacrerons à l’étude des messages enregistrés sur des
cassettes parmi les communautés de Jesudi, Chaidi et Arocojnadi. Ce sont des
messages dont les circonstances de création nous sont extrêmement familières, car
nous avons été le messager entre ces communautés. À partir de l’analyse des
messages qui sont partis de Jesudi, nous verrons que les chants en sont les éléments
fondamentaux, car ils synthétisent plusieurs aspects de ces échanges affectifs,
économiques et poétiques.
VIII.1. Les messages dans la forêt et les voix dans l’air
VIII.1.1. Les marques dans les arbres et les marques dans les magnétophones
Les auteurs sur lesquels nous nous appuierons pour mener une analyse sur
l’utilisation de la radio HF et AM chez les Ayoreo — Estival (2006), Bartolomé
(2000) et Bessire (2011) — font — avec quelques divergences — des comparaisons
entre ces nouvelles technologies et les moyens traditionnels de communication de
ce groupe. Nous devons alors faire un bref rappel de ces moyens pour pouvoir bien
situer nos réflexions autour de ce sujet.
Bartolomé (2000 : 42-44) nous présente une série d’éléments que les Ayoreo
utilisaient pour communiquer dans la forêt. Cette communication portait surtout sur
des aspects liés aux ressources de l’environnement : la chasse, le miel, des zones
difficiles à traverser, etc. Les gamini étaient des signes —Bartolomé ne les décrit
pas — que les Ayoreo utilisaient dans la forêt et qui servaient à indiquer la présence
de chemins, de zones de chasse, de miel ou de campements. Les yichagu poria212
étaient des marques faites dans les arbres désignant des points d’entrée ou de sortie
d’une partie très épaisse de la forêt, ou pouvant indiquer la présence de miel dans
un arbre — préalablement découvert par une autre personne.
212
Cette dénomination est présentée ainsi par BARTOLOMÉ. On peut ajouter qu’elle signifie
littéralement « je perce l’arbre » : yichagu poria
1ºpers sing.- percer arbre
320
�L’umusuri était une empreinte faite avec le pied servant à indiquer la
direction vers un rayon de miel ou le chemin vers un campement. Les icai étaient
des lignes tracées sur le sol indiquant la direction pour trouver de l’eau ou des
animaux. Il y avait d’autres systèmes qui permettaient de ne pas se perdre — au cas
où on s’éloignait du groupe pendant les excursions — ou qui étaient utiles pour les
familles séparées à la saison sèche afin de se retrouver et de former à nouveau la
bande. L’un de ces systèmes était l’ujuyaque ou « bâton des nouvelles » qui était
placé au début du chemin pris par un groupe. Dans ce bâton, on mettait les marques
distinctives de chaque clan, et son inclinaison et sa disposition servaient à indiquer
la distance et la direction où le groupe se trouvait (Bartolomé 2000 : 43).
Une importance particulière était réservée aux signaux associés aux
chamans. Ces signes contenaient du pouvoir du naijnai et servaient surtout à divers
types de protection. Les plus importants étaient le tunucujnai, le tunungue et
l’ujeobe. Voici une brève description à partir de l’article posthume de Sebag (1965 :
21).
Le tunucujnai était un bâton chargé de pouvoir. Il était de couleur noire et
rouge213 , mesurant entre deux et trois mètres de hauteur et il était fourchu. Plusieurs
tunucujnai servaient aussi à délimiter le territoire occupé par le groupe. Ils
marquaient une frontière qui était à la fois politique et magique, car la maladie
n’était pas capable de la traverser. Il semble que le tunucujnai serait une sorte de
double du chaman, d’après ce que Sebag nous raconte (1965a : 21). Tout ce qui
affectait ce bâton avait des conséquences manifestes sur le naijnai — par exemple,
brûler ce bâton pouvait provoquer de la fièvre chez lui. Il servait aussi à prévoir
l’arrivée des ennemis.
213
Malheureusement, SEBAG ne nous dit rien sur la signification spécifique de ces deux couleurs sur
le tunucujnai. Cette combinaison attire notre attention, car le rouge et le noir ont des signifiés
opposés. Cela est clair dans le récit de la rencontre de Bajai avec des Ayoreo non contactés en 1958
(PERASSO 1987 : 16). Le noir était la couleur de la guerre (les Ayoreo se noircissaient le visage et la
poitrine avant d’aller au combat) et le rouge, la couleur du bonheur ou de la paix : Bajai s’est peint
tout le visage avec un rouge à lèvres avant d’aller parler avec les Ayoreo sortis de la forêt.
321
�Le tunungue était d’une grandeur moindre que le tunucujnai mais il était
fourchu aussi. Il était lié à chugupejna (l’un des oiseaux-chamans dans les histoires
des origines). Cet être puissant avait commandé aux naijnane de le confectionner.
Ses fonctions se rapportent à la guérison : il empêche l’entrée de maladies dans la
communauté et a le pouvoir de guérir aussi (on pouvait l’utiliser si le chaman
n’était pas là). Ce bâton, comme le tunucujnai, pouvait aussi protéger des régions
délimitées.
L’ujeobe était une branche orientée vers la zone où l’on supposait qu’un
événement allait se produire. Cette marque servait autant à indiquer la provenance
des ennemis qu’à protéger le groupe contre eux. Quand les Ayoreo partaient à la
guerre, ils mettaient cette branche au centre du campement. Si l’ujeobe tombait par
terre, cela annonçait la triste défaite. Il définissait aussi le centre d’une zone où la
maladie ne pouvait pas entrer. Ce bâton était imbu du pouvoir du naijnai : si
quelqu’un était malade, il lui suffisait de frotter la partie affectée contre
l’instrument pour guérir.
Les Ayoreo de Jesudi ne semblaient pas savoir beaucoup au sujet de ces
bâtons chargés de pouvoir. Ils nous ont parlé de chamans qui pouvaient faire sortir
de l’eau de la terre avec un bâton, mais il s’agit d’une histoire des origines qui n’a
rien à voir avec le tunucujnai. Bajai a identifié le tunucujnai sur une photo que
nous lui avons montrée. Il nous a dit que c’était quelque chose de chamanique mais
pas beaucoup plus. Quant aux marques dans les arbres, ils ont identifié des marques
des Totobiegosode non contactés (Gayet 2010 : 55) lors d’une expédition à la région
de Chovoreca en quête de tortues. Il est difficile d’affirmer si les Ayoreo de Jesudi
utilisent ces marques aujourd’hui. D’un côté, parce qu’ils sont sédentaires et les
expéditions dans la forêt sont plus limitées à des zones très connues. De l’autre,
parce qu’il nous a été presque impossible de les convaincre d’accepter notre
présence lors d’une expédition de chasse (nous avons pu les accompagner à
chercher du caraguatá et du piment de la forêt214). En 2011, nous avons consulté la
214
Seulement dans deux occasions ils m’ont laissé les accompagner, bien qu’ils s’y opposaient
fermement. Ces expéditions furent extrêmement brèves et sans aucun résultat — mis à part le fait
d’avoir rapporté un peu de miel.
322
�collection d’Ian Kelm à Bonn215 . Nous avons photographié des morceaux de bois
mesurant approximativement 15 x 30cm avec des inscriptions en rouge et noir.
Nous avons montré les photos à Jesudi : personne ne savait de quoi il s’agissait.
Quelle serait la relation entre ces anciens moyens de communication et les
technologies actuelles selon Estival et Bartolomé ? Estival (2006) soutient
l’hypothèse selon laquelle la communication ayoreo serait passée du visuel au
sonore : la pratique de graver les tunucjnai équivaudrait à l'enregistrement des
cassettes216 . Bartolomé (2000 : 286-290), pour sa part, signale que, comme dans
tous groupes chasseurs-cueilleurs, la transmission d’informations sur la
disponibilité des ressources est fondamentale. Elle était réalisée chez les Ayoreo par
le biais des gamini, yichagu poria, tunucujnai, etc., avant les contacts. Ces marques
servaient à localiser du miel ou des animaux. Cette communication, médiatisée
actuellement par la radio, serait orientée dans les temps actuels — nous dit
Bartolomé — vers d’autres types de nouvelles. Un processus de transformations de
ces objets — la radio, les magnétophones — aurait permis leur utilisation selon les
formes communicatives des Ayoreo. Les magnétophones seraient ainsi incorporés
au patrimoine matériel de cette culture, ce qui expliquerait le fait qu’ils sont inclus
dans la classification par clan. Dans le cas ponctuel de la radio Pa’i Puku,
Bartolomé signale que cette station, à travers la transmission de nouvelles et de
messages dans toute la région du Chaco, a contribué à maintenir l'identité collective
des Ayoreo, malgré l’éparpillement des communautés sur le territoire.
L’anthropologue remarque aussi que cette idée du collectif ethnique s’étend jusqu’à
inclure des bandes qui étaient ennemies autrefois. Par rapport à la radio HF,
Bartolomé soutient aussi l’hypothèse selon laquelle ce moyen de communication
aurait remplacé les signes utilisés lors de la vie dans la forêt. De nos jours, ce
215
Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Abteilung für Altamerikanistik (Université de
Bonn).
216
« Enregistrer [graver] dans les tunucujnai, enregistrer les cassettes : la communication est passée
du visuel au sonore. Le camion ou le bus ont substitué les longs parcours dans la forêt, les naijnai
[chamans] ne mettent plus autant de pouvoir dans les signes. Mais les fortes valeurs de solidarité, et
aussi d’intimité entre les membres des cucherane [clans] — ou des autres parents — restent les
mêmes pour les Ayoreo, dans le monde, encore plus dur et épineux, des cohñone [hommes blancs]
» (ESTIVAL 2006 : 112, notre traduction)
323
�dispositif permettrait de définir les Ayoreo en tant que communauté communicative,
voire un sujet collectif.
Les deux propositions ont des similitudes remarquables. Estival et
Bartolomé présentent quelques moyens spécifiques de communication — des
bâtons et des marques sur les arbres ou sur le sol — et suggèrent que la radio HF, la
radio AM et l’envoi de cassettes les ont remplacés actuellement. Bartolomé parle
d’une réutilisation dans les termes de leur culture des dispositifs — le chapitre du
livre s’appelle « La transfiguración cultural » — qui servent surtout à générer des
liens communicatifs et sociaux. Tous les deux remarquent que par le biais de la
radio, des Ayoreo de bandes anciennement ennemies se mettent aujourd’hui en
contact et établissent des liens politiques et solidaires.
Nous avons une autre réflexion concernant l’utilisation de la radio et des
cassettes, même si plusieurs remarques proposées par Bartolomé et Estival nous
semblent pertinentes. Ces deux auteurs partent d’une comparaison : celle entre les
nouvelles technologies et les signes utilisés dans la forêt auparavant. Notre
première remarque concerne la complexité de cet ancien système de
communication : il y a une hétérogénéité de base qu’il ne faut pas négliger.
D’abord, ces signes peuvent être organisés suivant la division entre puyac (interdit,
puissant) et non puyac exposée dans la première partie de la thèse. Du côté des
éléments puyac, nous avons le tunucujnai, le tunungue et l’ujeobe, des bâtons
préparés par le chaman ou bien imbus de son pouvoir. Du côté des éléments non
puyac, on peut mentionner les gamini, yichagu poria, umusuri, icai et ujuyaque.
Ces derniers éléments non puyac portent des informations sur la forêt et les Ayoreo,
mais ils n’ont aucun rapport avec le chaman ni avec les Premiers Hommes. Nous
reprendrons cette distinction dans la suite de notre thèse. Notre deuxième remarque
porte sur le type d’information que ces derniers éléments transmettaient en
contraposition aux messages actuels. Les anciens signaux fournissaient des
informations sur le territoire et sur l’environnement, c'est-à-dire qu’ils indiquaient
des chemins, du miel, où se trouvaient des animaux, où finissait la forêt épaisse, par
contre ils ne donnaient aucune indication sur des personnes —sauf pour la
324
�localisation des campements, mais dans ce cas, il s’agissait d’un groupe, d’un
collectif et non d’individus.
Il nous semble difficile de trouver des similarités — en dehors de l’aspect
très général qu’ils soient tous « des systèmes de communication » — entre ces
signaux d’autrefois et les messages envoyés par la radio HF, la radio Pa’i Puku et
les cassettes. Premièrement, en ce qui concerne les non puyac, l’information
transmise n’a rien à voir. Auparavant, il s’agissait surtout de délimiter un espace
— du territoire — ou de localiser des ressources — « il y a du miel ici », « par là il
y a des pécaris ». Dans les cas actuels, il s’agit de nouvelles concernant des
personnes : quelqu’un est malade, un autre a trouvé du travail, tel patron mennonite
passera le chercher tel jour, etc. La première remarque que l’on pourrait faire à
cette critique serait, bien sûr, que les temps ont changé et que — comme Bartolomé
le dit — l’information porte sur d’autres choses. Mais, si c’est le cas, si les temps
ont changé, en quoi est-il nécessaire d’établir un tel lien ? Le seul rapport clair
serait de dire que, dans les deux cas, il s’agit d’informations qui circulent entres
parents ou communautés éloignés. Mais ce rapport nous semble trop vague. En
plus, — nous le verrons dans la section suivante — il y a d'autres formes de
communication passées qui cadrent mieux avec l’utilisation actuelle des nouvelles
technologies.
En ce qui concerne les signes chargés de pouvoir tels que les bâtons
chamaniques, les deux auteurs mettent en relief qu’occasionnellement des formules
de guérison sarode sont enregistrées et envoyées sur des cassettes217 , et que dans
ces cas, l’objet même — la cassette — devient puissante. Il faut avouer qu’il est
possible de tracer un lien avec la notion de puyac qui soit applicable aux bâtons et
aux formules. Cependant, il faut rappeler que les formules de guérison sarode ne
sont pas un patrimoine exclusif du chaman. N’importe quelle personne qui connaît
217
Nous avons enregistré des messages entre Jesudi, Chaidi et Arcojnadi à cinq reprises. Dans aucun
cas, nous avons enregistré de sarode. À la radio Pa’i Puku, nous n’avons jamais entendu de formules
non plus. De toute façon, il est tout à fait possible que cela varie significativement entre
communautés, selon le degré d’influence des missionnaires, le savoir des vieux hommes et surtout la
peur des effets néfastes qui pourraient arriver — ou être attribués à la prononciation de formules
dangereuses.
325
�les formules peut les utiliser — il y avait même une rivalité entre chamans et
souffleurs de sarode, nous dit Sebag. Le pouvoir des bâtons dépendait de l’action
d’un individu spécifique, car ces éléments étaient liés à lui. Nous pouvons dire
alors, que même dans ce cas d’apparentes connexions, il s’agit de phénomènes
différents.
VIII.1.2. Les formules de guérison d’autrefois, les voix d’aujourd’hui
Nous analyserons maintenant la perspective de Bessire (2011), qui met en
relation les sarode avec la radio HF. Pour comprendre le rôle des nouveaux médias
dans la vie des Ayoreo, cet auteur propose de prendre en compte à la social poetics
(2011 : 260) des formules de guérison ujnarone — appelées sarode à Jesudi218 .
Bessire se consacre à définir autrement les ujnarone : plutôt que d'analyser la
formule en tant que récit puissant hérité des Premiers Hommes, l'auteur signale
qu’il s’agit d’une configuration sociale où des éléments exogènes participent et où
plusieurs niveaux s’entrecroisent. Dans ce sens-là, Bessire met en relief le caractère
social de l’ayipie et sa nature hétérogène qui comprend des aspects affectifs,
cognitifs et même corporels (2011 : 275 -276). Voici l'argument principal de
Bessire : les ujnarone, en tant que technologie linguistique, permettaient aux
parents et aux amis du malade de participer aux processus de guérison (2011 : 276).
La radio HF serait ainsi un moyen actuel d’appliquer la même poétique
participative des ujnarone d’une manière plus étendue. L'ayipie voyagerait dans les
mots, à travers l'air et aiderait le destinataire à guérir plus rapidement.
218
Nous avons choisi de traiter ce texte ici et non dans le chapitre I de la première partie. Dans la
section de la première partie consacrée aux formules de guérison sarode (BESSIRE préfère la
dénomination ujnarone), nous nous sommes concentré sur le contenu des formules — les mots — et
le rapport avec celui qui les prononce. Notre discussion concernait la pratique du souffle des
formules au moment des ethnographies classiques, telles que celles de LIND et SEBAG (terrains en
1969 et 1965 respectivement). Dans notre étude à partir de nos observations en 2008-2011, nous
avons analysé le concept de puyac, car c’était un composant fondamental des sarode dont les Ayoreo
de Jesudi parlaient assez souvent. L’article de BESSIRE s’appuie sur des observations de guérisons
avec des ujnarone et la parole de Dupade en Bolivie — alors que nous n’avons seulement été témoin
de deux occasions d’utilisation de sarode — et mène des comparaisons avec l’utilisation de la radio
HF. C’est pour cela qu’il nous a semblé plus pertinent d’aborder ce texte dans cette partie pour
enrichir nos réflexions concernant le rôle des nouvelles technologies dans la vie des Ayoreo.
326
�À partir de nos analyses (cf. chapitre II), il nous est difficile d'accepter
cette idée d'une poétique sociale et participative des formules de guérison.
L'utilisation des ujnarone est proprement une intervention individuelle : c'est une
personne qui connaît la formule et la souffle — à voix basse — contre la partie
affectée du corps du malade. Il est difficile d'imaginer une mise en pratique
collective. Il peut y avoir des gens, bien sûr, qui observent attentivement et qui
souhaitent le rétablissement du malade, mais cela ne veut pas dire qu'ils font partie
de la guérison. Par ailleurs, ces formules sont gardées comme un secret et on évite
de les répéter ouvertement, à cause de ses possibles effets dangereux.
À notre avis, les considérations sur la poétique sociale sont plutôt
pertinentes pour les irade, des compositions qui parlent des gens, de leurs rapports
et obligations, et qui circulent librement — contrairement aux ujnarone. L'uñacai,
lors de la première instance de la performance, vise clairement à faire venir tous
ceux qui peuvent entendre les cris et les pleurs. Dans ces deux cas, non seulement
le contenu mais aussi la performance des chants, impliquent activement le public
— car écouter et comprendre ne sont pas des activités passives (Hanks 1996).
Cependant, il y a un genre de paroles qui guérissent et qui peuvent faire
partie d'une poétique sociale : les paroles de Dupade. Ces paroles font preuve d'une
certaine ambigüité : ce sont des paroles puissantes, toutefois elles peuvent être
répétées ouvertement, sans conséquences nocives. Nous avons donné l'exemple du
versículo, chant à mi-chemin entre l'irade et le sarode. Ces paroles de Dupade sont
envoyées par le biais de cassettes et de la radio HF, elles sont écoutées à plusieurs
reprises et auraient des effets bénéfiques. Par ailleurs, l'idée d'un collectif qui
demande l'action d'un pouvoir guérisseur est plutôt cohérente avec la pratique du
culte chrétien : « prions tous ensemble pour lui ! ». Le yasitigai de Jnumi pour
Ebedu — où elle demande aux Ayoreo de Campo Loro de prier pour son mari —
pourrait être considéré comme une poétique sociale et participative qui engage le
pouvoir des non-humains. Rappelons cependant que ce n'était pas de cette façon
que les Premiers Hommes agissaient, d'après la littérature classique (Sebag 1965a,
Lind 1974, Bórmida et Califano 1978, Fischermann 1988).
327
�La radio, nous dit Bessire, permet de rassembler la poétique des formules
d’un côté, et les formes discursives de prêches destinées à assurer l’intervention de
Jésus dans la guérison, de l’autre. Les principes qui guidaient la mise en pratique
des ujnarone seraient, selon cet auteur, à la base de l’utilisation de nouvelles
technologies et des performances chrétiennes. Il faut souligner que Bessire a fait
référence à des ujnarone où la figure de Jésus était présente. Ces formules de
guérison pourraient être alors différentes de celles observées par les auteurs
classiques qu’il a cités (Bórmida, Sebag, Fischermann, Casalegno). Nous pensons
qu'il faut distinguer les pratiques qui impliquent les Premiers Hommes
traditionnels219 de celles où Jésus ou Dupade sont les personnages principaux, car
dans ce dernier cas, la dynamique de la participation du public et de l'utilisation des
paroles sont fort distinctes. La perspective de Bessire est sans doute intéressante
pour analyser les enjeux sociaux et politiques actuels des Ayoreo, à un moment où
la communication à travers diverses technologies et les réclamations de droits et de
territoires ont permis de créer une conscience ethnique et politique qui n'existait pas
avant.
Nous croyons qu'il est possible de lier certaines pratiques avant le contact
avec l'utilisation de la radio et les cassettes. Nous avons trouvé dans nos
conversations avec les Ayoreo de Jesudi une référence à une pratique qui
signifierait à la fois une continuité de structure et de contenu avec l’utilisation des
nouvelles technologies. Nous nous étions demandé tout simplement pourquoi ils
chantaient dans les messages enregistrés. Ils nous ont répondu que quand des
petites bandes se rencontraient dans la forêt, ils interprétaient leurs chants et
apprenaient les chants des autres220. Tous étaient des chants en deuxième instance
de performance, c'est-à-dire détachés des circonstances de création. Nous
reprendrons l’analyse de ces échanges dans le chapitre suivant.
219
Des figures chrétiennes, telles que Jésus ou Noé, sont considérées comme des Premiers Hommes.
Dans ce cas, nous nous référons strictement aux Jnanibajade de la mythologie ayoreo avant le contact :
Asojna (l'engoulevent), Poji (le lézard), Quiraquirai (le caracara), etc.
220
Ils interprétaient toute sorte de chants, à l’exception des pujnuingane, qui faisaient partie du rituel
pré-guerre chuguji.
328
�VIII.2. Les cassettes de Jesudi
Après être resté un mois à Jesudi, je voulais me rendre dans une autre
communauté, Chaidi, située à 150 km par les chemins de terre du Chaco (à 100 km
à vol d’oiseau à travers la forêt). Le fait qu’il y avait là des Totobiegosode sortis de
la forêt en 2004 — c'est-à-dire, non contactés — attirait mon attention. Dans ces
moments initiaux de mon terrain, l’exotisme était encore un composant lourd de
mon bagage anthropologique (heureusement, j’ai pu m’en débarrasser — aussi
progressivement qu’involontairement — au cours des longs mois à Jesudi). Quand
j’ai commenté mes projets aux Ayoreo de la petite communauté qui m’avait si bien
accueilli, leur première réaction fut double : d’un côté, ils m’ont demandé
d’enregistrer des messages pour les Totobiegosode, de l’autre, ils ont insisté à
plusieurs reprises pour que ces Ayoreo de Chaidi leur envoient des chants aussi.
C’était au début de mon terrain et ma maîtrise de la langue était presque
nulle. Ils préféraient enregistrer les messages le soir. Je suis allé à l’ogadi de Bajai
où la plupart des gens se trouvaient. Chacun à son tour, en commençant par Daju,
l’épouse de Bajai, a enregistré des mots et des chants que je ne pouvais pas
comprendre, sauf la dernière phrase « e gusu ..! » (« C’est tout ! »). J’ai alors
remarqué que cette soirée présentait un caractère particulier — un peu comme le
soir du récit guerrier de Sidi décrit dans le chapitre II de la première partie —, il y
avait plus de gens que d’habitude à l’olería, même Sidi — qui n’adressait plus la
parole à son frère Bajai — était là. Les uns après les autres m’appelaient pour que
je me mette à côté d’eux avec le magnétophone. Les messages étaient personnels et
dirigés à des individus en particulier :
Isabia Ijnacha, Bajai tu yu nanique, i tu Bajai nanique
« mon petit frère cadet Ijnai, je suis Bajai autrefois, mon nom est Bajai
autrefois [mon ancien nom est Bajai] »
(message de Bajai Posorajãi à Ijnai Posorajãi, le 23 mai 2008)
329
�Malgré ce caractère individualiste, tous participaient à la production du
message. Les autres personnes — le conjoint, en particulier — suggéraient à
l’émetteur du message des phrases à prononcer un peu à la manière des souffleurs
de théâtre, comme s’il y avait des choses que l’on disait habituellement dans ces
communications. L’enthousiasme avec lequel ils enregistraient les messages était
seulement surpassé par le moment de l’écoute. Quelques semaines après, je suis
revenu de Chaidi avec des messages de réponses pour les Ayoreo de Jesudi221 . Dès
qu’il m’ont vu de loin avec le magnétophone, ils sont venus en courant de l’autre
coin de la communauté et m’ont demandé de leur faire écouter tout de suite les
messages. Bajai et Daju ont décrit cette émotion dans la deuxième séance
d’enregistrement de messages ce soir-là. J’ai remarqué alors que le contact par le
biais de la voix enregistrée avec des parents et des amis était un événement hors du
commun, avec une composante affective considérable.
Il est possible de repérer quelques régularités dans le contenu des messages.
D’abord, quand un lien précédent existe entre l’émetteur du message et le
destinataire, il est mis en relief. Ils rappellent des anecdotes partagées du passé,
quand ils habitaient dans la même communauté ou quand ils se sont rencontrés lors
d’une visite. Ce n’est pas nécessairement « la première fois qu’on s’est vus » mais
ces moments du passé ont certainement un caractère fondateur :
Ñujnusinango uaque, ga ñujnusina uje yico uaque iji hospital ica (…)
ñojninga chosi cojñone uate yabujabia : « nous nous souvenons de vous, et
221
Je suis resté un peu plus d’un mois à Chaidi. Malheureusement, nous n’avons pas pu établir de
bons rapports avec les Ayoreo de cette communauté pour pouvoir y mener notre terrain. Nous
sommes retourné définitivement à Jesudi et c’est là — et à 15 de Septiembre — que nous avons
mené notre recherche. Nous avons officié de messager — avec notre magnétophone — entre Jesudi,
Chaidi et Arocojnadi. Les deux dernières sont des communautés de Totobiegosode et elles
constituent une unité politique en ce qui concerne les ONG avec lesquelles elles travaillent et les
réclamations auprès de l’État paraguayen. C’est pour cela que nous ne reproduisons ici aucun
message des habitants de Chaidi ou d’Arocojnadi, et que nous avons changé les noms des individus
mentionnés (même dans les citations des messages de Jesudi). Par ailleurs, comme nous sommes
resté à Chaidi et Arocojnadi au début de notre terrain — moment où nous ne maîtrisions pas la
langue — nous n’avons pas pu comprendre l’information contextuelle autour des messages. Dans les
cas de messages de Jesudi, nous avons naturellement beaucoup plus d’informations : nous en avons
discuté avec eux à plusieurs reprises et en plus nous avons vécu avec ces personnes tout au long de
notre terrain.
330
�je me souviens quand nous vous avons trouvé à l’hôpital (…) j’ai dit ‘elle
ressemble à une femme blanche, ma petite nièce’ »
(message de Caitabia Picanere à Puru Picanere)
Yayipie dejipisi ua uje ñiquijnorapise ñane nanique, uje yibajo ga je toque
jeta yicadigui uaque Utata : « mon ayipie est vraiment dans toi, vu que nous
étions de très bonnes amies autrefois, quand nous sommes allées chercher
du miel et je ne vous oublierai pas, Utata »
(message de Poro Posijñoro à Utata Picanere)
Le souvenir d’une rencontre constitue en fait un lien. C’est une manière de
remarquer que cette continuité dans la pensée — l’ayipie — est à la base du rapport
social qui sera aussi médiatisé par des cadeaux et des chants.
Du temps s’est écoulé entre ces rencontres rappelées et le présent du
message. Parfois, ils n’étaient pas sûrs si les destinataires — ou des amis en
commun — se trouvaient encore dans la communauté. Un autre sujet des messages
était alors de se questionner sur la localisation des membres de la famille et de se
demander s’ils avaient des nouvelles de tel ou tel Ayoreo dont on avait perdu la
trace222 . Les femmes notamment racontaient aussi si elles avaient des petits-enfants
et si on s’adressait à elles par leurs prénoms ou par les teknonymes.
Un trait qui est naturellement récurrent est la référence de diverses manières
à la nourriture, soit pour dire qu’ils n’ont rien à manger, soit pour demander qu’on
leur envoie des aliments spécifiques tels que de la viande, du miel ou du piment de
la forêt. Comme nous l’avons remarqué lors de l’analyse des chants de tristesse
uñacai, l’échange de nourriture est la manière principale d’établir des liens sociaux,
alors que déclarer que l’on a faim équivaut justement à signaler que l’on n’a plus de
liens — ou à demander qu’ils soient visibles. Ainsi, Sidi demande des tortues et
222 José chigo yu uje jeti Edabia dei sañeque to, agoyo poi yoque iji cintadie : « José me dit si
Edabia est ailleurs, répondez-nous dans des cassettes » (message de Caitabia Picanere, épouse de
José Bajai Posorajãi)
331
�Poro du piment de la forêt jnui. Quand je suis retourné à Jesudi quelques semaines
après avec des cassettes et des bouteilles remplies de piment — que l’on ne trouve
plus aux alentours de Jesudi — ils étaient ravis.
Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre IV, la dimension clanique était
mise en relief dans la plupart des messages. Ainsi, Daju se demande s’il y a des
parents claniques parmi ceux qui sont sortis de la forêt en 2004, Sidi envoie un
chant à Emi, à qui il s’adresse comme étant yigioto abai (« l’époux de ma parente
clanique »). De la même manière, Caitabia met en relief qu’Ijnai est igiosi de Bajai
et elle appelle Puru, du clan Picanerai, yabujabia « ma petite nièce ». Ce lien
affectif privilégié par les cucherane est mis en relief par Poro avec justement un
exemple a contrario :
Cucheraque unejaque uaque mu bacarajayo yu ga a yiraja uaque to je! :
« vous êtes d’un autre clan mais vous me connaissez
et je vous connaîtrai aussi ! »
(message de Poro à Adie)
Comme c’était le cas dans les communications par radio HF selon Bessire
(2011), les paroles de Dupade étaient sollicitées et envoyées par le biais de
cassettes. Il n’y a pas de missionnaires à Jesudi — hormis un missionnaire
mennonite qui leur rend visite très occasionnellement —, ni de prédicateurs Ayoreo
comme à Campo Loro ou à Arocojnadi. Parfois les dimanches, l’un des jeunes
— dans les très rares occasions que nous avons vues, c’était Puchiejna ou Adi — va
à l’église et catecai Dupade uruode (« parle les mots de Dieu ») : il lit un passage
de la bible, fait des commentaires et dirige les prières qui consistent en demandes et
remerciements concernant l’etotiguei (« force » mais aussi dans ce cas, ce terme
pourrait être traduit vaguement comme « santé »). Étant donné ce manque de
prédicateurs, ils demandaient des paroles de Dupade à un Ayoreo de Chaidi. Celuici a envoyé des citations de la bible et des réflexions — à la manière du culte
dominical. Il semble qu’il y avait plusieurs prédicateurs autrefois à Jesudi, ce qui
rendait tout le monde heureux. Poro avait composé un yasitigai — chant de joie —
332
�que nous avons transcrit dans le chapitre II de la première partie. Par ailleurs,
c’était au cours de l‘enregistrement d’un de ces messages que nous avons entendu
pour la première fois un versículo — sorte d’irade qui parle de Jésus —, interprété
par Daju Étacõro. Elle disait dans le message qu’elle n’avait pas eu honte de le
chanter à l’hôpital quelques années auparavant.
Dans la plupart de ces messages il y avait des chants. En fait, on pourrait
dire que ce sont les éléments principaux de ces communications. Ce n’est pas tout
puisque les Ayoreo aiment aussi chanter et écouter des chants, ce qui expliquerait
assez logiquement que toute personne qui sait chanter enregistre un irade ou un
uñacai. C’est beaucoup plus que cela : les chants sont des opérateurs fondamentaux
de ces échanges affectifs et économiques des messages. Nous verrons maintenant
les particularités des chants dans ce genre d’interactions.
Premièrement, les chants ont des propriétaires, ils sont comme des présents
que l’on peut envoyer. Ici, la notion de don est un peu problématique, car un irade
peut être envoyé à un destinataire, mais cela ne veut pas dire que l’émetteur a un
chant de moins. Il faut ici rappeler que ces messages impliquent au moins trois
éléments : des mots, des chants et des cadeaux (du piment de la forêt, des
vêtements, des machettes, etc.). Quand ils parlent des mots et des chants au cours
des messages, ils utilisent toujours les préfixes de possession. De la même manière,
pour la dédicace d’un message ou d’un chant ils changent logiquement la personne
du préfixe :
Cuchajnu je ñira to cinta ome uaque ga yajabi macajeque yuruode :
« Cuchajnu, je parle dans la cassette pour vous et pour mon frère cadet, mes
mots vous appartiennent »
Puru a, macajepise yiradeque, agachopisi je, majongate uyu ei! : « Puru,
mon irade vous appartient beaucoup, écoutez-le beaucoup, je suis la sœur
de ton père ! »
333
�unejapise baradedie que ome yoque : « ils ont été très beaux [litt. :
délicieux] tes irade pour nous »
(Messages de Caitabia Picanerai)
Ce préfixe indique-t-il vraiment une notion de propriété ? Ce morphème
justifierait-il le rapport entre la notion de propriété et celle de création d’une œuvre
chantée ? À vrai dire, la notion de « propriétaire » n’implique pas celle d’auteur.
Par exemple, Sidi dit dans son message :
Emi gajé yiradedie je, a yirate Cuchanutode je. (...) macajé yirade te jé, e yi
yirade : « mes chants sont pour Emi [à Emi lui appartiennent mes chants],
j’imiterai Cuchanutode (...) mon irade est pour vous, voilà mon irade » [le
chant commence]
Le chant de Cuchanutode est un uñacai, ce qui veut dire que Cuchanutode
fut le compositeur quand il a pleuré en chantant lors de la première instance de
performance du chant de tristesse. Sidi n’est pas alors l’auteur de « son irade ». Ce
n’est pas une contradiction. En fait, c’est que nous devons être plus précis avec
l’utilisation du mot irade. Tout au long de cette thèse, nous avons employé ce mot
de la même manière que le font les Ayoreo dans la plupart des cas : au sens strict, il
signifie « chant de nostalgie d’amour (ou jnusietigai) ». Or, ce mot a dans un sens
plus large une autre acception : c’est un substantif qui — nous croyons — est
dérivé du verbe –irate (« imiter »). Cette acception223 d’irade existe selon le
dictionnaire des New Tribes Mission : « iradé : n.f. imitated. who/what is. m.
iradi » (Higham et al. 2000 : 483). Ce deuxième signifié nous permet de
comprendre pourquoi Sidi utilise le préfixe possessif pour un chant qu’il n’a pas
composé : ceci est son imitation de l’uñacai de Cuchanutode. Il faut remarquer ici
que cela ne veut pas dire que Sidi a entendu directement la première instance de
performance de la part de Cuchanutode. Il est possible que Sidi ait écouté une
imitation par une autre personne (probablement de Gaaçai Chiquenoi à Jesudi, de
223
La première acception du mot dans le dictionnaire : « iradé : n.f. song ; words of a song ; hymn,
when used with ‘Dupade’ » (HIGHAM et al. 2000 : 483)
334
�qui Sidi avait appris plusieurs chants anciens, dont les pinangoningane). Cela nous
permet aussi de comprendre pourquoi Estival classifie tous les chants non sacrés
dans la catégorie d’iradedie — tous sont en fait des imitations actuellement 224.
Pour revenir à la question que nous nous sommes posée, nous pensons que le
préfixe possessif n’indique pas la possession de la même manière que quand il est
appliqué à un objet ou à un parent. Nous croyons qu’il s’agit plutôt d’une marque
de l’individualité. Les chants, même si répétés, sont matérialisés par la voix de
quelqu’un, d’un individu. La voix est une marque aussi personnelle que
reconnaissable. Une brève anecdote l’illustrera mieux. En février 2011, j’ai rendu
visite à M. Ulf Lind à Linz-am-Rhein (en Allemagne). Ce chercheur avait enregistré
des chants d’Uejai Picanerai à Faro Moro225 en 1969. Uejai fut le grand leader
guerrier — dacasute, chaman et mari de quatre épouses — qui avait rassemblé les
bandes du sud contre les Direquedejnaigosode de Bolivie et les Totobiegosode du
Paraguay. Ulf Lind a eu l’énorme gentillesse de m’offrir une copie. En juillet 2011,
je suis retourné à Jesudi avec l’enregistrement des chants d’Uejai. Les Ayoreo les
plus âgés — Bajai et Sidi — ont reconnu la voix d’Uejai plus de trente ans après
son décès226. Nous pensons alors que le préfixe possessif veut dire « le chant qui
part de moi, telle personne en particulier, un individu spécifique avec une voix
identifiable ».
En deuxième lieu, ces chants sont envoyés dans l’espoir qu’ils seront non
seulement écoutés, mais aussi — et surtout — imités par les destinataires. Dans
plusieurs messages, nous trouvons la même phrase au début du chant : Cucoidate
angari je ga arate to je... ! « Cucoidate [destinataire], écoute et imite [mon chant]
224
De toute façon, les deux acceptions — stricto et lato sensu — se superposent, car même si un
irade est un chant de nostalgie d’amour, il est aussi l’imitation des dialogues des protagonistes.
225
Établissement temporaire des New Tribes Mission qui n’a duré que quelques années. Il était situé
à dix kilomètres au nord de Jesudi.
226
Je peux affirmer avec certitude qu’ils ont reconnu la voix d’Uejai spécifiquement. J’avais pensé
que tous les chants étaient d’Uejai et c’était ce qu’ils attendaient. Cependant, quand on a commencé
à écouter la cassette, ils ont dit que le chanteur n’était pas Uejai. Effectivement, il y avait trois
chants au début qui étaient interprétés par une autre personne (qu’ils ont nommée aussi). Après ces
trois chants et une coupure dans l’enregistrement, ils ont reconnu la voix d’Uejai qui chantait la
nostalgie d’amour d’une fille.
335
�… ! » (message de Poro). Ce n’est pas un simple envoi unidirectionnel qui finit son
parcours quand il arrive au destinataire, il y a aussi la volonté manifeste d’une mise
en circulation du chant.
Il ne serait pas inexact de voir dans ces demandes d’imitation une idée de
transcendance, de perpétuation de l’individu à travers les chants. Les plus âgés de
Jesudi227 insistent sur le fait qu’il faut apprendre leurs chants pendant qu’eux, les
chanteurs, sont encore vivants :
Ga agachopisi yirade to je, cuchadacate emi uje yetotigueode garosi to!
« et écoutez beaucoup mon irade,
car j’ai peu de force ! [pas en bonne santé] »
(message de Caitabia Picanere)
Les chants mettent en scène un échange, car interpréter un chant — même
s’il est imité —, c’est donner quelque chose de soi, quelque chose de l’ogadi ou de
la communauté où l’on vit. Quand un chant est interprété — donné — dans un
message, un autre est systématiquement demandé — « envoie-moi ton irade ». Ces
deux compositions seront répétées par leurs destinataires. Il est habituel dans les
messages de rappeler le nom de la personne de qui on a appris le chant. Cette
circulation peut arriver même à une sorte de cercle : dans deux occasions, les
Ayoreo de Jesudi ont envoyé à Chaidi des chants anciens qui avaient été composés
justement par des Totobiegosode :
Chugupe a, majé yirade te je uje bacarasai u nanique, Sugacade chi
inagoningai nanique : « Chugupei, mon irade t’appartient, c’est de votre
compatriote autrefois, Sugacade on dit qu’il a fait un pinangoningai
autrefois »
(message de Sidi)
227
Cela nous est arrivé aussi avec un chanteur et chaman retraité d’Ijnapui, Pojnanguene Étacori.
336
�Conclusion du chapitre VIII
Nous avons analysé la communication à travers la radio HF et les cassettes,
et nous avons montré que ces moyens ne peuvent pas être considérés comme une
version actuelle des anciens systèmes de communication destinés à la gestion des
ressources dans la forêt. Nous avons détaillé, par contre, que le contenu et la nature
des messages ressemblent plutôt aux rencontres des bandes lors desquelles les
Ayoreo interprétaient et apprenaient des chants. Nous avons vu que les chants sont
les éléments fondamentaux des messages enregistrés sur cassettes.
Les chants sont en fait des indices des événements décrits dans leurs paroles.
Cela était clair grâce à l’exemple des irade constitués par la répétition textuelle des
dialogues. Nous allons plus loin dans ce chapitre, car nous proposons qu’un lien
existentiel puisse s’établir entre personnes par le biais de mots envoyés. Les chants
permettent de générer des liens indiciels entre parents et amis qui vivent très
éloignés les uns des autres. Un chant, même s’il s’agit d’une imitation, est un chant
qui fut une première fois interprété par quelqu’un de spécifique qui l’a lui-même
envoyé. Répéter ce chant en tant que destinataire signifie affirmer ce lien avec
l’émetteur, et en fait prolonger aussi sa voix, car cette répétition sera à son tour
entendue par d’autres personnes. Cela veut dire que le destinataire a écouté
attentivement le chant et que ce chant pourra survivre à celui qui a été l’interprète
— l’émetteur. Même si l’émetteur n’est pas décédé, sa voix, ses mots ont circulé,
ont été écoutés et répétés.
Les messages enregistrés sur cassettes appartiennent en même temps aux
domaines économique, affectif, social et poétique. Quand c'est possible, les Ayoreo
envoient des cadeaux et ils demandent aussi des contreparties228. La référence à des
anecdotes partagées et les phrases « je me souviens de toi » ou « souvenez-vous de
nous… ! » nous montrent que les messages constituent la perpétuation d’un lien
tissé depuis longtemps. Presque toujours au centre des enregistrements, il est
228
Même si les Ayoreo de Jesudi se déclaraient pauvres dans les messages — et avouaient que ceux
de Chaidi l’étaient aussi — ils envoyaient des jupes, des T-shirts et des pamoi d’occasion.
337
�possible de trouver un chant : une pièce de discours qui constitue une synthèse de
tous ces domaines, car il est offert comme un cadeau, il est le véhicule des
attachements et des rapports sociaux (non seulement par le contenu, mais par le fait
d’envoyer une interprétation) et il est en lui-même un message dans un message.
Envoyer un chant équivaut à partager les moments significatifs de la propre
expérience. Ces moments importants de la vie — de la propre vie ou de celle des
autres — doivent laisser leur empreinte par le biais d’un chant. C’est comme s’il
fallait chanter, comme s’il était nécessaire d’enfermer un moment ou un état affectif
dans une succession de lignes. Il y a un message enregistré sur une cassette qui met
en valeur l’importance de transmettre un moment sous la forme d’un chant. C’est
celui de Echoi Picanerai — l’épouse d’Inocencio — qui ne chante pas et qui
regrette de ne pas pouvoir le faire :
Echoi uyu e ga yasitigai jireipise dirica uje ñajnecho bacajiode dirica ga
yasepise yu dirica ajea ?229 (…) ñisarac, ute Disiejoi, Adie, bacamoño to
nanique iji Campo Loro –ajea ?— ga anire230 yasitigai jirepise uje Disiejoi
chisapise Dupade uruode, mu que yiraja yasitigai piradedie to, yase to mu
que yiraja to, ajaia ?
« Je suis Echoi et j’ai été très contente hier quand j’ai reçu [j’ai été
propriétaire de] vos piments et j’ai été très contente — tu sais ? — (…) mon
gendre, Disiejoi — tu sais, Adie ? —, vous l’avez vu autrefois à Campo
Loro — tu sais ? — euh… j’ai été très heureuse quand Disiejoi a pris
beaucoup la parole de Dupade [il est devenu prédicateur], mais je ne sais
pas [chanter] les chants de joie, je suis contente mais je ne sais pas [en
faire un] tu sais ? »
229
Les phrases « ajea » ou « ajaia » sont des versions raccourcies — comme il arrive toujours à
l’oral en Ayoreo — de « araja ia ? » (savoir 2e pers. sing – interrogatif).
230 « Anire » équivaut à l’exclamation « euh... » en français. Selon le dictionnaire des New Tribes
Mission : « aniri : interj. what-do-you-call-it ; uh…, uh… (looking for the right word). Note : often
used in oral speech when a person is stalling to think. Other forms used are anírone, anírami,
anitique, anitigo. var. anire. » (HIGHAM et al. 2000 : 63)
338
�Conclusion de la troisième partie
Dans cette partie nous avons suivi le parcours qui va d’un événement social,
tel qu’une dispute entre une femme et son mari, jusqu’au moment où une personne
écoute le chant qui raconte cette scène de la vie conjugale, dans une communauté
éloignée du lieu des événements. Ce chemin nous a permis d’étudier le lien entre le
fait et le chant. Dans la création des chants, il y a une mise en valeur de la parole :
les irade consistent en une répétition textuelle des dialogues, il s’agit du discours
direct qui est chanté. Cet aspect répétitif du chant produit d’abord deux
conséquences. En premier lieu, la composition de ce genre de chants devient
relativement simple, il suffit de choisir les bonnes phrases et de les enchaîner
chronologiquement. En deuxième lieu, le fait qu’il s’agisse de mots exactement
restitués — du moins, c’est l’idée et personne n’en doute — donne aux irade le
statut indiscutable de témoignages. Ce rapport entre l’événement et le chant est de
nature indicielle — selon les mots de Peirce — car il consiste en la répétition des
dialogues. De plus, le thème du chant, quelques marques linguistiques et la
performance dramatique font preuve d’une intense affectivité. Nous avons alors
montré, à partir des recherches d’Estival, l’importance de cette dimension affective
dans l’inscription mnésique des événements racontés. Les Ayoreo aiment faire des
chants sur les événements qui ont attiré leur attention, ainsi ce qui est chanté est
plus susceptible de rester dans la mémoire du groupe. Les irade deviennent donc
des cartes postales intimes de la vie communautaire, le souvenir chanté d’un
moment.
Les chants sont des fragments de la vie des gens que l’on envoie aux parents
et aux amis de communautés éloignées. Nous avons analysé le rôle des nouvelles
technologies, telles que le portable et la radio HF, et nous nous sommes concentré
sur les messages transmis par le biais des cassettes. La plupart de ces messages
enregistrés à Jesudi contiennent des chants et ils sont envoyés avec quelques objets.
Des nouvelles, des histoires, des chants et des cadeaux — des vêtements, des
machettes et du piment de la forêt — voyagent entre communautés ayoreo du
Chaco.
339
�Il est possible de classer les chants envoyés des Ayoreo de Jesudi en deux
grandes catégories. D’une part, les chants composés à Jesudi, ceux qui racontent
des histoires d’amour et de tristesse des habitants de cette communauté. De l’autre,
les compositions transmises d’une ou deux générations précédentes. Ces dernières,
dont les mots sont un peu archaïques et les thèmes rappellent la vie dans la forêt,
ont la valeur de pièces de collection. Les chants composés à Jesudi ont une valeur
double dans le contexte des messages. D’un côté, ce sont des témoignages de la vie
sociale de Jesudi : les envoyer équivaut à partager la mémoire, à faire entrer le
destinataire dans le collectif social et économique de la vie quotidienne. De l’autre,
ces irade et uñacai ont été faits par la personne qui les interprète, ce sont ses biens.
S’il y a un lien indiciel entre événement et chant, il y en a un autre entre
compositeur et chant. Ces multiples liens servent à en tisser ou à en renforcer un
autre, celui entre deux Ayoreo de deux communautés éloignées.
L’idée principale que nous soutenons est simple : l’affectivité est
information. Être attaché à quelqu’un implique de tout savoir — ou presque — de
sa vie personnelle. Dans ces liens sociaux tissés jour après jour, le fait d’être au
courant de la vie des autres est un composant fondamental. C’est ici que les chants
en tant qu’information réifiée jouent leur rôle. Les chants fonctionnent comme les
photos que nous nous montrons dans le but de partager nos expériences : elles sont
des référents indiciels des événements et de leurs protagonistes. Les chants
permettent alors d’étendre ces liens affectifs et sociaux au-delà de la communauté
par le biais de cassettes.
Les chants sont les éléments fondamentaux des messages mais ils en sont
également une métaphore. Nous avons montré que l’envoi de messages sert à tisser
des liens à plusieurs niveaux. D’une part, si les Ayoreo en ont la possibilité, ils
enverront des cadeaux et demanderont d’autres choses en retour, ce qui établit un
lien économique de base. De l’autre, ils donneront de leurs nouvelles — santé,
travail et faim — et ils rappelleront une anecdote partagée du passé, ce qui
renforcera — ou établira — les liens affectifs. Les chants accomplissent ces deux
fonctions symboliquement : ce sont des biens qui sont donnés en cadeaux, et qui
340
�contiennent de l’information intime concernant les Ayoreo d’aujourd’hui et
d’autrefois. Ce lien affectif, économique et social représenté par le chant ne s'établit
pas tout simplement quand le destinataire l’écoute, il faut que celui-ci le répète.
Interpréter un chant signifie contribuer à sa circulation et, certainement, à la
transcendance de celui qui l’a chanté une fois.
341
�CONCLUSION
342
�Conclusion
Nous sommes arrivé à la fin de notre parcours. Nous sommes parti des mots
prononcés par les Premiers Hommes aux temps des origines — des mots que l’on
n’entendait presque plus et que l’on a dû chercher dans la bibliographie — pour
aboutir aux chants enregistrés sur des cassettes que nous avons apportées, en
personne, d’une communauté à l’autre du Chaco boréal.
La première partie fut pour nous l’occasion de montrer que la parole est un
marqueur important de la culture Ayoreo. En suivant les catégories employées par
les Ayoreo concernant cette dimension rhétorique, nous avons pu délimiter deux
grands domaines : la parole puissante ou puyac, et la parole non interdite — que
nous appelons humaine.
La parole puyac est rapportée aux jnanibajade, les Premiers Hommes.
L’épisode fondamental de chaque histoire des origines est centré sur la parole. Dans
ces histoires, un être humain — et non-humain à la fois — se transforme
définitivement en animal. Au moment crucial de sa métamorphose, cet être premier
énonce certaines phrases qui auront le pouvoir de changer le cours des choses dans
le monde des humains. Lors des séances de guérison, la reproduction de ces mots
engendre un vacillement des temporalités puisque leur énonciation fait surgir le
temps des origines. Ainsi, les mots sont les protagonistes de ces séances : les
formules sont plus importantes que celui qui les énonce, voire que l’être premier
qui les avait énoncées pour la première fois. Raconter un mythe provoque aussi
certaines conséquences, et même si l’action déclenchée a un lien moins précis avec
l’histoire, personne ne remet en question leur efficacité. Quant à la parole humaine,
celle-ci est associée aux temps actuels, ceux des disiejode, « parmi les enfants ».
Les nombreuses catégories du discours humain constituent une sorte de dispositif,
où chaque orateur pourra prélever de quoi constituer des histoires à partir de tout
événement qui aura mérité l’attention des Ayoreo. L’existence de plus de sept
genres de chants, du théâtre guerrier et d’autres genres mineurs permet d’organiser
l’expérience et de la raconter.
343
�Il fut nécessaire de parcourir toute la complexité de la parole puissante et
celle de la parole humaine pour être capable de poser la première problématique de
notre thèse : la parole humaine, peut-elle avoir un effet sur la vie des Ayoreo ?
Peut-elle entraîner des conséquences qui soient systématisées et structurées comme
celles de la parole puissante ?
En tant que signe du point de vue de la sémiotique de Peirce, la parole est un
symbole. Or, c’est le rapport indiciel entre certaines phrases et le cours des
événements, qui s’impose dans la relation entre la parole et la vie humaine chez les
Ayoreo. Les formules de guérison sarode — et d’une certaine manière, les
mythes également — fonctionnaient comme des indices inversés. Dans un indice, il
y a un lien existentiel entre l’objet et le representamen. Ainsi, les phrases énoncées
au moment de la métamorphose de l’être premier en sont l’indice, car elles
appartiennent à ce processus, elles en sont un attribut indispensable : aucun Premier
Homme ne se transforme en silence. La répétition actuelle de ces phrases fait
ressurgir le temps des origines. La capacité d’utiliser cette parole puissante
s’appuie sur la possibilité de manipuler ce lien indiciel. Quand il s'agit de la parole
humaine, le lien indiciel possède un autre sens : les chants irade — grâce au lien
indiciel avec les événements racontés — se constituent comme témoignages de ces
faits. Chez les Ayoreo, il est remarquable que la parole tisse un lien d’indice avec
les faits auxquels elle se rapporte — soit dans un sens, soit dans l’autre —, avec la
possibilité de pouvoir reproduire les faits dans le cas de la parole puissante. Qu’estce que cela nous apporte pour mieux comprendre la parole humaine ?
La parole humaine permet d’établir un répertoire de cas exemplaires, des
histoires à partir desquelles partiront des réflexions sur des sujets divers. Or,
l’intelligibilité de ce répertoire n’est appréhendable que lorsqu’on aura pu préciser
davantage le rôle de l’affectivité dans les rapports sociaux, ce qui constitue un autre
axe fondamental de notre recherche.
Tout au long de la thèse, nous avons parlé des rapports affectifs et de
certains sentiments tels que la nostalgie d’amour et la tristesse. Nous n’avons pas
344
�cherché à approfondir les définitions concernant les émotions, ni même la manière
dont le sujet ayoreo les expérimente — en effet, ce n’est pas sur ces
questionnements que nous avons mené notre recherche.
Nous avions, en premier lieu, une contrainte méthodologique : nous ne
pouvons pas connaître les états internes d’autres personnes, même si les états
subjectifs de l’ethnographe peuvent être une source d’inspiration — et avoir une
éventuelle utilité pour la discipline. Cependant, il nous faut pouvoir prendre en
considération quelques aspects de l’affectivité. Dans le but de surmonter les
difficultés mentionnées, nous avons choisi d’appuyer nos réflexions sur le discours
ayoreo à propos des états affectifs. Mais, à vrai dire, l’analyse focalisée sur les
mots ne s’avère pas suffisante : il est nécessaire de voir l’implication des mots dans
certaines interactions. La parole ne peut contenir toute l’épaisseur du signifié dans
la surface des morphèmes ou même de la phrase, il faut tenir compte des situations
communicatives dans lesquelles cette parole est inscrite. C’est pour cela que tout au
long de la thèse, nous avons essayé de combiner la citation textuelle avec la
description ethnographique précise des scènes quotidiennes et des individus
impliqués. Nous avons essayé de reconstruire cet ensemble, qui fut pour nous
indispensable à la compréhension d’une déclaration verbale à un moment donné.
En deuxième lieu, nous n’envisageons pas l’étude des émotions ou des états
affectifs dans leur totalité, étant donné que notre but n’est pas de déchiffrer ce que
les Ayoreo ressentent. Ce qui nous intéresse, c’est de comprendre comment ces
états internes peuvent organiser le comportement d’un collectif — la communauté
de Jesudi dans ce cas (cf. Surrallés 1998, 2013). Ce n’est pas à partir des subtilités
cognitives de la notion de jnusietigai que nous voulions approfondir notre étude. Ce
qui nous intéresse, par contre, c’est le fait que ce concept est d’une nature
fondamentalement relationnelle, car jnusietigai veut dire : « ressentir l’absence de
quelqu’un ». Dans le but d’éviter cette absence douloureuse, il est nécessaire
d’empêcher que cette personne s’en aille, autrement dit, il faut trouver une manière
de régler les conflits d’une manière telle que la migration — la terrible menace de
l’abandon — soit exclue. Dans le même sens, nous n’avons pas abordé toute la
345
�complexité de la tristesse ayoreo. Nous nous sommes penché seulement sur le fait
que quand les Ayoreo pleurent pour quelqu’un — et nous supposons avec Urban
que pleurer est un signe de tristesse — ils chantent et crient « la faim me fait mal »
et que cela signifie qu’ils ont perdu non seulement un être aimé, mais aussi un lien
social qui les nourrissait. La mise en scène constitue un appel qui semble dire
« sachez bien que maintenant je suis tout seul ». Nous avons aussi étudié largement
la notion de jnusietigai comme opérateur sociologique dans la deuxième partie.
Nous avons analysé les aspects sociaux de ces états, tout ce qui renvoie aux autres
personnes.
Quelle est alors l’implication de ces états affectifs dans le déroulement de la
vie sociale de Jesudi ? Les idées développées par Joanna Overing nous aideront
dans notre réflexion. Overing typifie deux modèles de société : la société centrée
sur les droits et celle centrée sur les vertus. Le premier modèle correspondrait à une
organisation sociale fondée sur le juridique et le prescriptif — des règles et des
structures sociales diverses —, alors que le deuxième se concentrerait plutôt sur les
vertus et sur le performatif — l’établissement de rapports par l’intermédiaire de
l’exercice. C’est dans une société du deuxième type que la nostalgie et la tristesse
— pour n’en citer que deux — joueraient un rôle structural-performatif. Ces états
internes sont verbalisés et codifiés par la parole, et liés à une éthique centrée sur les
valeurs : on pleure pour celui qui était généreux et pacifique, paaque. Si nous
reprenons les concepts de sociality et convivialité développés par Overing, une
société pourrait s’établir, rester unie par le biais du renforcement de certains
comportements et la condamnation morale d’autres. Une société ainsi établie, ne se
fonde pas, par conséquent, sur des règles légèrement abstraites et explicitement
formulées — comme c’est le cas dans les sociétés centrées sur le droit. Une société
centrée sur les valeurs doit se fonder sur une idée commune de ce qui est un
comportement acceptable et de ce qui ne l’est pas, autrement dit, d’une éthique
sociale.
Or, si une telle éthique n’est pas explicitée dans un code normatif —
indiquant ce qui est bon ou mauvais —, elle devrait s’appuyer sur une idée établie,
346
�une sorte de sens commun. Ce sens commun pourrait être confirmé par
l’accumulation d’exemples de comportements, ce qui génèrerait l’abstraction
involontaire et implicite de ce que l’on peut faire d’habitude, ou de ce que l’on doit
faire si on connait les conséquences nocives de certains comportements.
Cependant, partir d’un exemple assez basique d’un comportement jugé
comme étant adéquat — un homme donne de la nourriture à sa belle-fille — ne
nous semble pas suffisant. Des exemples de comportement comme celui-ci — c'està-dire, voir quelqu’un réaliser une bonne action — n’auraient pas de consistance.
Ils n’auraient pas d’influence sur la pensée des gens, à cause des modifications
engendrées par les commentaires, la construction de différentes versions et des
commérages autour de ce qui s’est passé.
Cette idée d’une sorte « d’exemplier » des comportements semble trop floue
pour délimiter et communiquer avec clarté ce qui, dans une société au sens
juridique, se construit par les règles. Il est vrai que dans une société centrée sur le
système des valeurs, il n’y aura pas de règles explicites ni de structures sociales
comme on peut le percevoir dans d’autres sociétés : groupes d’âge, sections, classes
professionnelles, etc., mais il doit exister un dispositif qui puisse fournir un
minimum de régularité pour assurer la perpétuation de certaines idées directrices du
comportement collectif. Cette régularité, nous l’avons trouvée dans le discours, non
pas dans le discours basique, mais dans le discours structuré des chants, pour deux
raisons qui s’imbriquent l’une dans l’autre.
En premier lieu, le chant est un témoignage d’un fait raconté. Personne ne
doute qu’une histoire se soit réellement passée comme le chant l’indique. Nous
avons analysé les stratégies sémiotiques qui font du chant un indice, un témoignage
du fait comme si aucun point de vue particulier extérieur aux protagonistes n’était
pris en considération : l’observateur n’est pas là ou bien il est caché derrière les
mots du sujet énonciateur. Ainsi, étant donné ce caractère non fictionnel des chants,
ils se transforment en exemples de situations, des exemples qui s’accumulent dans
le répertoire nocturne des chants. C’est une systématisation d’histoires, ce qui aide
347
�logiquement — vu que l’on chante souvent — à la perpétuation de ces histoires et
— selon Estival — à leur inscription mnésique.
Les chants contribuent notamment à l’instauration de la convivialité. Ces
chants racontent diverses histoires qui mettent en valeur deux idées fondamentales :
l’importance de la générosité — généralement associée à la nourriture — et la
gravité de se fâcher avec les autres — souvent liée aux insultes verbales. Ces
valeurs sociales par excellence sont à la base de la convivialité ayoreo. Ces chants
contribuent à instaurer ces idées par répétition et par l’établissement d’une
esthétique fondée sur une éthique sociale : le chant le plus beau est aussi le plus
triste.
Les chants agissent d’une façon récursive dans la catégorisation des
situations de la vie quotidienne. L’affectivité organise les rapports sociaux par le
biais de chants. Nous avons vu que la première instance de performance d’un irade
servait à catégoriser une situation déterminée comme un exemple de jnusietigai.
Ainsi, la séparation de Tamocoi était dans ce chant la cause de la tristesse de sa
mère et de ses enfants, il y avait une mise en relief de la migration comme la
conséquence habituelle, une condamnation du mari infidèle, la désolation pour les
enfants affamés. Cette vision de Jnumi sur la séparation de Tamocoi deviendra, le
temps passant et avec les répétitions en deuxième instance de performance, un autre
exemple dont le caractère véridique ne sera pas mis en doute. Cette affaire
deviendra ainsi une autre histoire qui s’ajoutera au répertoire de tristesses qui
semble constituer l’éthique sociale ayoreo. Il en est de même pour le cas des
uñacai : c’est un moment intense et dramatique qui sera ensuite partagé par le biais
de la répétition. Ce chant a été en première instance la déclaration à haute voix de
la perte d’un lien, une expression qui tire profit du vocabulaire relationnel des
clans. Ce chant de tristesse deviendra en deuxième instance un autre exemple de
des pleurs de quelqu’un pour quelqu’un d’autre qui était bon et généreux.
Tout lien social est affectif et économique à la fois, l’un n’existe pas sans
l’autre. L’affectivité organise les comportements à travers les chants, mais elle
348
�implique un rapport économique. Les rapports sociaux codifiés par les chants ont
toujours un aspect affectif et un aspect économique. L’affectivité ne peut pas être
considérée comme un épiphénomène de la vie sociale que l’on pourrait laisser de
côté, elle est la dimension qui met en relation les états internes de l’individu avec
les comportements collectifs. Les liens à l’intérieur de l’ogadi sont affectifs et en
même temps économiques. Les liens de l’ogadi sont surtout des liens d’échanges de
nourriture. Jnumi rejette la nourriture offerte par son fils, l’échange de gibier entre
ogadi contribue à maintenir la paix sociale, tout est clair dans la simple expression
des uñacai « la faim me fait mal » : la faim comme métaphore et conséquence du
manque de protection, de l’abandon affectif et économique, bref, de la perte d’un
lien social. Être triste et faible implique de ne plus être fonctionnel dans la société,
car on ne veut plus chasser ou travailler et donner de la nourriture aux autres.
Donner de la nourriture est le premier pas pour établir un lien : aimer, c’est nourrir.
Bisideque veut dire « gratuit » mais aussi « dépourvu de sens, incomplet ».
Les chants ne circulent pas seulement à l’intérieur de Jesudi, car ils peuvent
être envoyés par le biais de cassettes. D’après ce que les Ayoreo racontent,
auparavant ils avaient l’habitude de chanter leurs répertoires lors de rencontres de
bandes dans la forêt, dans le but d’apprendre les chants des autres. Cela permet
d’enrichir ce recueil d’anecdotes, et probablement d’établir des idées similaires de
convivialité dans d’autres communautés des Ayoreo. Nous avons eu par ailleurs le
privilège d’enregistrer des messages sur des cassettes pour d’autres Ayoreo, de la
part de ceux de Jesudi. Cela nous a permis d’observer des Ayoreo qui parlaient des
chants avec d’autres Ayoreo. C’était comme si des collectionneurs échangeaient et
partageaient des objets précieux, quelques-uns étaient de facture propre, d’autres
étaient des pièces anciennes. Ils insistaient toujours sur le fait que les destinataires
devaient imiter leurs chants. C’est comme si écouter ne suffisait pas, il fallait aussi
répéter : « écoute et imite mon chant, car je suis faible ». On pourrait penser peut
être que les chants qui sont passés par la voix d’une personne, sont aussi des
indices de cette personne, des vestiges de son existence, de quelqu’un qui a dit une
fois « ñijnecamine » (« je chante ici »). « Les hommes meurent, les chants ne
meurent pas », nous disait Toto Étacori.
349
�Nous nous sommes posé deux questions au début de cette thèse.
D’abord, « pourquoi chantent les Ayoreo ? » et, ensuite, « quel est le rôle des chants
profanes dans la vie sociale des Ayoreo ? ». Nous croyons avoir répondu assez
aisément à la deuxième question — en fait toute la thèse était consacrée à cette
problématique. Quant à la première, nous n’avons d’autre réponse que celle des
Ayoreo : terachu, yasique gu... ! (« il chante, il est content, c’est pour cela… ! »).
350
�BIBLIOGRAPHIE
AMARILLA-STANLEY, D. 2001. Oe chojninga. Relatos bilingües ayoreo-castellano.
Biblioteca Paraguaya de Antropología, 40. Asunción : CEADUC.
ÅRHEM, K. 1996. « The cosmic food web. Human-nature relatedness in the Northwest
Amazon », dans Nature and Society. Anthropological perspectives, ed. par P. Descola et
G. Palsson, Routledge, New York.
BAKHTIN, M. 1986. Speech Genres and Other Essays. Ed. par M. Holquist et C.
Emerson ; traduit par V. McGee. Austin : University of Texas Press.
BALDUS, H. 1932. « Beiträge zur Sprachenkunde der Samuko-Gruppe », Anthropos, 27 :
361-416.
BARTOLOMÉ, M. 2000. El encuentro de la gente y los insensatos. La sedentarización de
los cazadores ayoreo en el Paraguay. Biblioteca Paraguaya de Antropología, 34.
Asunción/ México : Instituto Indigenista Interamericano.
BARRIOS, A., BULFE, D. et ZANARDINI, J. 1995. Ecos de la selva. Ayoreode uruode.
Asunción : CEADUC.
BATESON, G. 1979. Mind and Nature : A Necessary Unity. Bantam Books.
BAUMAN, R. et BRIGGS, CH. L. 1990. « Poetics and Performance as Critical Perspectives
on Language and Social Life », Annual Review of Anthropology, 19 (1990) : 59-88.
BERNAND-MUÑOZ, C. 1977. Les Ayoré du Chaco septentrional. Étude critique à partir
des notes de Lucien Sebag. La Haya : Mouton.
351
�BERTINETTO, P. 2009. « Ayoreo (Zamuco). A grammatical sketch », Quaderni del
Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore, 8. Pisa.
2010. « Riflessioni diacroniche sulla categoria della persona nelle lingue Zamuco »,
Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore, 9 / 2. Pisa
BERTINETTO, P.M., et CIUCCI, L. 2010. « Parataxis, hypotaxis and para-hypotaxis in the
Zamucoan languages », Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale
Superiore, 9 / 2. Pisa
BERTINETTO, P.M., CIUCCI, L. et PIA, G.E. 2007-2008. « Inquadramento storico,
etnografico e linguistico degli Ayoreo del Chaco », Quaderni del Laboratorio di
Linguistica della Scuola Normale Superiore, 7. Pisa.
BESSIRE, L. 2011. « Ujnarone chosite : ritual poesis, curing chants and becoming ayoreo
in the Gran Chaco », Journal de la Société des Américanistes 97 / 1 : 259 - 289.
BOGGIANI, G. 1899. « Cartografía lingüística del Chaco por el Dr. Brinton », Revista del
Instituto Paraguayo, II, III (16) : 106-137.
BÓRMIDA, M.
1973 « Ergon y mito 1. Una hermenéutica de la cultura material de los Ayoreo del
Chaco Boreal ». Scripta Ethnologica, 1/1: 9-68.
1974 « Ergon y mito 2 ». Scripta Ethnologica, 2/2: 41-107.
1975 « Ergon y mito 3 ». Scripta Ethnologica, 3/1: 73-130.
1976a « Ergon y mito 4 ». Scripta Ethnologica, 4/1: 29-44.
1976b. Etnología y Fenomenología. Buenos Aires : Cervantes.
1978-9a « Ergon y mito 5 ». Scripta Ethnologica, 5/1: 6-25.
1978-9 b « Ergon y mito 6. » Scripta Ethnologica, 5/2: 21-75
1984. « Cómo una cultura arcaica concibe su propio mundo ». Scripta Ethnologica, 8 :
5 -161.
352
�BÓRMIDA, M. et CALIFANO, M. 1978. Los indios Ayoreo del Chaco Boreal : información
básica acerca de su cultura. Buenos Aires : FECYC.
BRAUNSTEIN, J.
1976-1977. « Cigabi va a la matanza. Un canto de guerra de los Ayoreo », Scripta
Ethnologica, 4 / 2 : 32 - 54.
1983. « Algunos rasgos de la organización social de los indígenas del Gran Chaco »,
Trabajos de Etnología, 2 : 9-102.
BREMEN, V. VON
1988. Los ayoreos cazados. Asunción : Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y
Jurídicos.
1991. Zwischen Anpassung und Aneignung. Zur Problematik von WildbeuterGesellschaften im modernen Weltsystem am Beispiel Ayoréode. Münchner
Amerikanistik-Beiträge, 26. Munich : Anacon.
2008. « Impactos de la Guerra del Chaco en la territorialidad ayorea », dans Richard, N.
(ed.), Mala guerra. Los indígenas en la Guerra del Chaco (1932-35) : 333 - 354.
Asunción/París : ServiLibro/Museo del Barro/ CoLibris.
BRIGGS, J. 1973. « Ayore narrative analysis », International Journal of American
Linguistics, 39 / 3 : 155 - 163.
BRINTON, D. 1898. « The linguistic cartography of the Chaco region », Proceedings of
the American Philosophical Society, 37 / 158 : 178-205.
BUGOS, P. 1985. An evolutionary ecological analysis of the social organization of the
Ayoreo of the Northern Gran Chaco. Thèse de doctorat. Northwestern University.
Evanston, Ill.
353
�CABRERA, A. et WILLINK, A. 1980. Biogeografía de América Latina. Washington,
Organización de Estados Americanos.
CALIFANO, M. 1990. « El soñador en la cultura de los ayoreo (zamuco) del Chaco
Boreal », dans Perrin, M. (ed.), Antropología y experiencias del sueño : 363 - 275.
Quito : Abya - Yala.
CALIFANO, M. et TOMASINI, A. 1963. « Ayoreo, Zamuco », Antropológica, janvier - mars
1963, 2 : 23-24. Buenos Aires.
CALIFANO, M. et BRAUNSTEIN, J. 1978-1979. « Los grupos ayoreo: contribución para el
conocimiento de gentilicios y topónimos del Chaco Boreal », Scripta Ethnologica, 5 /
1 : 92-101.
CANCELLU, E. 2007-2008. « Alcune particelle dell’ayoreo », Quaderni del Laboratorio
di Linguistica della Scuola Normale Superiore, 7. Pisa.
CANEVARI, M. et FERNANDEZ BALBOA, C. 2003. 100 Mamíferos Argentinos. Buenos
Aires, Editorial Albatros.
CANEVARI, M. et VACCARO, O. 2007. Guía de mamíferos del Sur de América del Sur.
Buenos Aires, L.O.L.A., Literature of Latin América.
CANOVA, P. 2012. « Tracing Intimate Subjectivities of Ayoreo Women in the Mennonite
Colonies of the Paraguayan Chaco », 2012 American Anthropological Association
Annual Meeting, San Francisco, California.
CARSTEN, J.
1995. « The Substance of Kinship and the Heat of the Hearth : Feeding, Personhood,
and Relatedness among Malays in Pulau Langkawi », American Ethnologist, 22, 2 :
223-241.
354
�2000. Cultures of Relatedness : New Approaches to the Study of Kinship. Cambridge,
Cambridge University Press.
CASALEGNO, U. 1985. Les Ayoré du Gran Chaco par leurs mythes : essai de lecture et
de classement des mythes Ayoré. Thèse de doctorat. Paris : Université de Paris VII.
COMBÈS, I. 2009. Zamucos. Scripta Autochtona 1. Cochabamba : Ed. Nómades et
Insituto de Misionología.
COMBÈS, I., VILLAR, D.
ET
LOWREY, K. 2009. « Comparative Studies and the South
American Gran Chaco », dans Tipití : Journal of the Society for the Anthropology of
Lowland South America, 7 / 1, 3.
CRÉQUI-MONTFORT, G.
DE
et RIVET, P. 1913. « Linguistique bolivienne. Les affinités
des dialectes Otuké », Journal de la Société des Américanistes, 10 : 369-377.
CHOMÉ, P. I.
1958 [1745]. « Arte de la lengua Zamuca. Présentation de Suzanne
Lussagnet », Journal de la Société des Américanistes, 47 : 121-178.
DASSO, M.C.
2001. « La cosmogonía ayoreo y su relación con el medio actual », Moana. Estudios de
Antropología Oceánica, 6 / 1.
2003. « Comentario sobre las costumbres alimentarias de los ayoreo », Scripta
Ethnologica, 23 : 21-38. Buenos Aires.
2006. « Notas acerca de los clanes ayoreo del Chaco boreal », Acta Americana. Journal
of the Swedish Americanist Society, 14 / 1 : 39 - 68.
DASSO, M.C. et RINALDI, C. 2004. « La noción de mal y de temor ayoréi », Archivos.
Departamento de Antropología Cultural, II (2) : 52-77. Buenos Aires : Centro de
Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural.
355
�DÉLÉAGE, P. 2011. « Présentation : les discours du rituel », Journal de la société des
américanistes, 97-1 : 77-86.
DESCOLA, P. 2005. Par-delà nature et culture. NRF Bibliothèque des sciences humaines.
Gallimard.
DI GIACOMO, A. et KRAPOVICKAS, S. (eds.). 2005. Historia natural y paisaje de la
Reserva El Bagual, Formosa, Argentina. Buenos Aires, Aves Argentinas y Asociación
Ornitológica del Plata.
DIRECCIÓN GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS
Y
CENSOS (DGEEC). 2003. II
Censo Nacional Indígena de Población y Viviendas 2002. Pueblos indígenas del
Paraguay. Resultados finales. Asunción.
DIXON, R.
ET
AIKHENVALD, A. 1999. The Amazonian Languages. Cambridge:
Cambridge University Press.
D'ONOFRIO, S.
2003. « Guerre et récit chez les Indiens Ayorés du Chaco paraguayen », Journal de la
Société des Américanistes de Paris, 89 / 1 : 39 - 81.
2004. « Premiers contacts entre Ayorés et Blancs dans le Chaco paraguayen. Le point de
vue des Amérindiens », Recherches Amérindiennes au Québec, 34 (2).
2005. « Le discours du mythe », Gradhiva, 2 : 69-87. París.
ESCOBAR, T. 1989. Ethnocide : mission accomplished? Copenhague : IWGIA.
ESTIVAL, J.P.
2005. « Introducción a los mundos sonoros ayoreo: referencias, etnografía, texto de
cantos », Suplemento Antropológico, 40 (1) : 451-502.
356
�2006a. « Memória, emoção, cognição nos cantos irade dos Ayoré do Chaco Boreal » ,
Mana, 12 (2) : 315-332.
2006b. « Os caçadores e o rádio: sobre o novo uso dos meios de comunicação entre os
Ayoreo do Chaco Boreal ». Anthropológicas, 17 (1) : 103-114.
EVANS-PRITCHARD, E. 1993 [1937]. Brujería, magia y oráculos entre los Azande.
Barcelona : Anagrama.
FABRE, A. 2007. « Los pueblos del Gran Chaco y sus lenguas, cuarta parte :
Los
zamuco », Suplemento Antropológico, 42 / 1 : 271 - 323, Asunción. [Dernière mise à
jour sur le web : le 2 juillet 2012]
FERNANDEZ, J. P. 1895 [1726]. Relacion historial de indios Chiquitos. Ed. Victoriano
Suarez. Madrid.
FERNANDEZ DISTEL, A. 1983. « La cultura material de los Ayoreo del Chaco Boreal »,
Scripta Ethnologica, Supplementa, 3. Buenos Aires.
FISCHERMANN, B.
1976. « Los ayoreode », dans J. Riester (ed.). En busca de la Loma Santa: 67-100. La
Paz : Los Amigos del Libro.
1988. Zur Weltsicht der Ayoréode Ostboliviens. Bonn : Rheinische Friedrich-WilhelmUniversität.
1998. « Una frontera frágil. Cultura y natura entre los ayoreode », dans Cabrera, A. et
al., El último canto del monte. Biblioteca Paraguaya de Antropología, 29. Asunción :
CEADUC.
2005. « La fiesta de la Asojna o el cambio de las estaciones entre los ayoréode del
Chaco Boreal », Suplemento Antropológico, 40 / 1 : 391 - 450.
357
�GINZBURG, R. et ADÁMOLI, J. 2006. « Situación ambiental en el Chaco Húmedo », dans
Brown, A., Martínez Ortiz, U., Acerbi, M. et Corcuera, J. (eds.). La Situación Ambiental
Argentina 2005 : 103-112. Buenos Aires, Fundación Vida Silvestre Argentina.
GORDILLO, G. 2006. En el Gran Chaco : antropología e historias. Buenos Aires :
Prometeo.
HAEKEL, J. 1955. « Berichte. Studienreise eines jungen Österreichers in Ostbolivien »,
Wiener Völkerkundliche Mitteilungen, 3 / 1 : 100-103.
HANKS, W. F.
1996. Language and communicative practices. Boulder : Westview Press
2000. Intertexts, writings on language, utterance and context. Denver : Rowman and
Littlefield.
2005. « Pierre Bourdieu and the practices of language », dans Annual Review of
Anthropology. 34 (2005) : 67-83.
2006. « Context, communicative », dans BROWN, K. (ed.). 2006. Encyclopedia of
language and linguistics. 2 ed. Oxford, Elsevier, 2006, 3 : 115-128
HEIN, D. (ed.). 1988. Die Ayoreo — unsere Nachbarn der Mission im nördlichen Chaco.
Asunción.
HEREDIA, L. 1997. « Algunas manifestaciones del pensamiento y de la percepción en la
etnia de los ayoreo del Chaco Boreal », Bulletin de la Société Suisse des Américanistes,
61 : 115- 126.
HIGHAM, A., MORARIE, M. et GRETA, P. 2000. Ayoré-English dictionary. Sanford, FL. :
New Tribes Mission.
358
�HOLY, L. 1996. Anthropological perspectives on kinship. Chicago et Londres, Pluto
Press.
IDOYAGA MOLINA, A.
1979-1980. « El daño mediante la palabra entre los ayoreo del Chaco Boreal »,
Göteborgs Etnografiska Museum Årstryck, 1979-80 : 21 - 38.
1989. « La significación de la mítica de Susmaningái (El Coraje) en la cosmovisión
ayoreo », Mitológicas, 4 : 31- 37. Buenos Aires.
1991. «El armadillo en la cosmovisión de los ayoreo del Chaco Boreal », Latin
American Indian Literatures Journal, 7 / 1 : 81 - 94.
1995. « Cosmología y sistema de representaciones entre los Ayoreo del Chaco Boreal »,
Scripta Ethnologica, 19.
1998. « La interpretación nativa de la historia. Análisis de dos relatos míticos de
contacto », Mitológicas, 13 : 7 - 18. Buenos Aires.
IDOYAGA MOLINA, A. et MASHNSHNEK, C.
1988. « La significación del concepto de paragapidí entre los ayoreo del Chaco
Boreal », Scripta Ethnologica, Supplementa, 7 : 87 - 92.
JOHNSTON, J. 1966. God planted five seeds. Woodworth, Wisconsin : New Tribes
Mission.
KELLY, R. 1993. Constructing Inequality : The Fabrication of a Hierarchy of Virtue
among the Etoro. Ann Arbor, University of Michigan Press.
KELM, H.
1960. « Zur Frage der ethnographischen Einordnung der Ayoré Moro und Yanaigua im
ostbolivianischen Tiefland », Baessler Archiv, 8 (2) : 335 - 361.
1962. « Die Ayoré im Gran Chaco. Zauberer und Krieger », Umschau, LXII (17) : 533 536. Frankfurt.
359
�1963a. « Die Identität von Ayoréo und Moro in Ostbolivien und Nordparaguay »,
Baessler Archiv, 10 (2) : 309 - 312.
1963b. « Die Zamuco (Ostbolivien) », Zeitschrift für Ethnologie, 88 (1) : 66-85.
1964. « Das Zamuco: eine lebende Sprache », Anthropos, 59 : 457-516 et 770-842.
1971. « Das Jahrfest der Ayore (Ostbolivien) », Baessler Archiv, 19 (1) : 97 - 140.
KIDD, S. 1999. Love and hate among the people without things. The social and
economic relations of the Enxet people of Paraguay. Thèse doctorale. University of St.
Andrews, Écosse.
KLEIN, H. 1985. « Current status of argentine indigenous languages », dans South
American Indian Languages. Klein et Stark (Eds.). Austin : University of Texas Press.
KLEIN, H. et STARK, L. 1977. « Indian languages of the Paraguayan Chaco »,
Anthropological Linguistics, 19/8 : 378 - 401.
LÉVI-STRAUSS, C.
1949a. « L'efficacité symbolique », Revue de l'histoire des religions, 135/1 : 5 - 27.
1949b. Les Structures élémentaires de la parenté. Paris, PUF.
1966. La pensée sauvage. Paris : Plon.
LIND, U.
1974. Die Medizin der Ayoré-Indianer im Gran Chaco. Hamburg : Arbeits-gemeinschaft
Ethnomedizin/ Renner.
1977. « Zur Heilkunde der Ayoré-Indianer im Chaco Boreal », Saeculum. Jahrbuch für
Universalgeschichte, 28 (2) : 122-134. Munich.
LOWREY, K. 2006. « Entre estructura e historia: el Chaco », dans Isabelle Combès
(ed.) : Definiciones étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la
Chiquitania, Santa Cruz : IFEA/SNV/El País : 25 - 34.
360
�LOZANO, P. 1941 [1733]. Descripción corográfica del Gran Chaco Gualamba.
Tucumán : Universidad Nacional de Tucumán.
LUSSAGNET, S.
1961. « Vocabulaires Samuku, Morotoco, Poturero et Guarañoca précédés d'une étude
historique et géographique sur les anciens Samuku du Chaco bolivien et leurs voisins »,
dans Journal de la Société des Américanistes de Paris, 50 : 185-243.
1962. « Vocabulaires Samuku, Morotoco, Poturero et Guarañoca (suite et fin) », dans
Journal de la Société des Américanistes de Paris, 51 : 35-64.
MALDONADO, A. 1997. (Régisseur). When they came… (Film). Canada / Paraguay :
Global Film Festival Nanaimo / Sambuku Films.
MASHNSHNEK, C.
1985. « Sobre los rituales de los Ayoreo del Chaco Boreal », Göteborgs Etnografiska
Museum Årstryck, 1983 / 84 : 60 - 66. Gotemburgo.
1986. « Acerca de las ideas de menarca, concepción, alumbramiento e infanticidio entre
los ayoreo del Chaco Boreal », Scripta Ethnologica, 10 : 47 - 53.
1986-1987. « Predicaciones potentes de Asohsná: la deidad más temida de los ayoreo
del Chaco Boreal », Mitológicas, 2 : 65- 69. Buenos Aires.
1989a. « La instrumentación de la ciencia en la economía de los Ayoreo del Chaco
Boreal », Scripta Ethnologica, Supplementa, 12 : 43 - 49.
1989b. « Los ayoreo del Chaco Boreal », Scripta Ethnologica, Supplementa 12.
1990. « Las nociones míticas en la economía de producción de los Ayoreos del Chaco
Boreal », Scripta Ethnologica, Supplementa, 8 : 119 - 140.
1990-1991. « La percepción del blanco en la cosmovisión de los Ayoreo (Chaco Boreal)
», Scripta Ethnologica, Supplementa, 11 : 67 - 72.
1991. « Las categorías del discenso narrativo y su significación en la cultura de los
Ayoreo del Chaco Boreal », Anthropologica, 9 : 19 - 38. Lima : PUCP.
361
�MASHNSHNEK, C.
ET
GONZALO, J. 1988. « Mitología americana. Los Ayoreo »,
Mitológicas, 3 : 7 - 21. Buenos Aires.
MEDRANO, C., MAIDANA, M. et GÓMEZ, C. 2011. Zoología Qom. Conocimientos tobas
sobre el mundo animal. Santa Fe, Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad, Ediciones
Biológica.
MESSINEO, C., SCARPA, G. et TOLA, F. (eds.). 2010. Léxico y categorización
etnobiológica en grupos indígenas del Gran Chaco. La Pampa, Universidad Nacional
de La Pampa.
MÉTRAUX, A. 1946. « Ethnography of the Chaco », dans Steward, J. (ed.), Handbook of
South American Indians 1 : 197 -370.
MISIÓN NUEVAS TRIBUS. 1982. Dupade Uruode. Dupade ayipie ejode u udire ome
yoque. El Nuevo Testamento en ayore y en español (Dios llega al hombre).
Cochabamba : Bolivia.
MORARIE, M. 1980. Simplified Ayore Grammar. Cochabamba : Publicaciones Nueva
Vida.
MURDOCK, G. 1960. « Cognatics forms of social organisation », Viking Fund
Publications in Anthropology, 29.
NUÑEZ, C. E. 1978-1979. « Asái, un personaje del horizonte mítico de los Ayoreo »,
Scripta Ethnologica, 5 (1) : 103-114.
OEFNER, L. 1940-1941. « Apuntes sobre una tribu salvaje que existe en el Oriente de
Bolivia », Anthropos, 35 / 36 : 100-108.
362
�OTAEGUI, A.
2008. « Comparación de sistemas analogistas mesoamericanos y animistas del noroeste
amazónico », Anthropologica, 26 : 143-172. Lima : PUCP
2011. « Los ayoreos aterrorizados. Una revisión del concepto de puyák en Bórmida y
una relectura de Sebag », Runa – archivo para las ciencias del hombre, Instituto de
Ciencias Antropológica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,
32 (1) : 9-26.
OVERING, J. 2003. « In praise of the everyday: Trust and the art of social living in an
Amazonian community », Ethnos : Journal of Anthropology, 68 : 3, 293-316.
OVERING, J. et PASSES, A. (Eds.) 2000. The Anthropology of Love and Anger. The
Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia. London : Routledge.
PAGÉS LARRAYA, F. 1973. « El complejo cultural de la locura en los moro-ayoreo »,
Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, 19 (4) : 253-264. Buenos Aires.
PEIRCE, CH. S. 1955. Philosophical Writings of Peirce. Ed. par J. Buchler. New York :
Dover Publications.
PERASSO, J. 1987. Crónica de cacerías humanas. La tragedia ayoreo. Asunción : El
Lector.
RADIN, P. 1960 [1956]. El hombre primitivo como filósofo. Buenos Aires : EUDEBA.
REHNFELDT, M. et MALDONADO, R. 1993. Cuando Dupade ya no pinta: historia y
retratos de los Ayoreode de Jesudi. Asunción.
RENSHAW, J. 2006. « 'A eficácia simbólica' revisitada. Cantos de cura ayoreo », Revista
de Antropologia, 49 (1) : 393-427.
363
�RIESTER, J. et ZOLEZZI, G. 1999. (Eds.). Cantaré a mi gente : canto y poesía ayoreode.
Santa Cruz de la Sierra : APCOB.
RICHARD, N.
2008a. Les chiens, les hommes et les étrangers furieux. Archéologie des identités
indiennes dans le Chaco boréal, Thèse de doctorat en anthropologie, EHESS, París.
2008b. (Ed.) Mala guerra. Los indígenas en la Guerra del Chaco (1932-35). Asunción/
París : ServiLibro / Museo del Barro / CoLibris.
RIVIÈRE, P. 2000. « The more we are together… », dans Overing, J., et Passes, A. (eds.),
The Anthropology of Love and Anger. The Aesthetics of Conviviality in Native
Amazonia. London : Routledge.
SANTOS-GRANERO, F. 2000. « The Sisyphus Syndrome, or the struggle for conviviality
in Native Amazonia », dans Overing, J., et Passes, A. (eds.), The Anthropology of Love
and Anger. The Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia. London : Routledge.
SCHIEFFELIN, E. 1976. The Sorrow of the Lonely and the burning of the Dancers. New
York : St. Martin's Press.
SCHMEDA-HIRSCHMANN, G.
1993. « Magic and medicinal plants of the Ayoreo of the Chaco Boreal (Paraguay) »,
Journal of Ethnopharmacology, 39 (2) : 105-111.
1994. « Etnobotánica ayoreo », Universum. Revista de la Universidad de Talca, 9 :
107-156. Talca.
SCHNEIDER, D. 1984. A Critique of the Study of Kinship. Ann Arbor, University of
Michigan Press.
364
�SEBAG, L.
1965a « Le chamanisme Ayoreo (I) ». L'Homme, 5/1 : 5-32.
1965b « Le chamanisme Ayoreo (II) ». L’Homme, 5/2 : 92-122.
SEEGER, A. 1987. Why Suya Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People.
Cambridge : Cambridge Univ. Press
SEEGER, A., DA MATTA, R., et VIVEIROS DE CASTRO, E. 1979. « A construçao da pessoa
nas sociedades indígenas brasileiras », Boletim do Museu Nacional, 32: 2-19.
SEVERI, C. 2010. El sendero y la voz : una antropología de la memoria. Buenos Aires :
Grupo Editorial SB.
SHERZER, J. 1987. « Discourse-Centered Approach to Language and Culture »,
American Anthropologist, 89 : 295–309
SURRALLÉS, A.
1998. « Entre el pensar y el sentir. La antropología frente a las emociones »,
Anthropologica, 16 : 291-304. Lima : PUCP
2013. « Afectividad y relacionalidad », dans Tola, F., Medrano, C. et Cardin, L. 2013.
(Eds.). Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad. Buenos Aires : Asociación Civil
Rumbo Sur.
SUSNIK, B.
1961. « Apuntes de etnografía paraguaya », Manuales del Museo Etnográfico « Andrés
Barbero », v. II. Asunción.
1963. « La lengua de los Ayoweo-Moros : nociones generales », Boletín de la Sociedad
Científica del Paraguay, 8 : 1 - 148.
1973. La lengua de los Ayoweo-Moros. Estructura gramatical y fraseario etnográfico.
Asunción : Museo Etnográfico “Andrés Barbero”.
365
�TOLA, F. 2004. Je ne suis pas seul(ement) dans mon corps. Corps et multiplicités chez
les Toba (Qom) du Chaco argentin. Thèse de doctorat en ethnologie, Paris/Buenos
Aires : EHESS/UBA.
TOLA, F., MEDRANO, C. et CARDIN, L. 2013. (Eds.). Gran Chaco. Ontologías, poder,
afectividad. Buenos Aires : Asociación Civil Rumbo Sur.
URBAN, G. 1988. « Ritual wailing in Amerindian Brazil », American Anthropologist, 90
(2) : 385 - 400.
VILLAR, D. 2005. « Indios, blancos y perros », dans Anthropos 100/2 : 495 - 506.
ZANARDINI, J. 2003. (Ed.). Cultura del pueblo ayoreo: manual para los docentes.
Biblioteca Paraguaya de Antropología, 44. Asunción : Centro Social Indígena,
CEADUC.
ZULOAGA, F., MORRONE, O., BELGRANO, M., MARTICORENA, C. et MARCHESI, E. 2008.
(Eds.) Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 107(1): i–xcvi, 1–
983; 107(2): i–xx, 985–2286; 107(3): i–xxi, 2287–3348,
366
�ANNEXES
I. CHANTS
I.1 Enominoi, la vision du chaman
1. Enominoi de Pojnanguene Étacori, interprété par Sidi Posorajãi
Ajnito ga angai ñurusorone quigode gajine gusu ca atodo yu jne
yigaidode uacaniri arode gusu bacacugue erueode iji uacanirone udojo.
Emi chosite ga chingomeñuque Jnoede chi ore tora yoquiquigade udo
ga chi ore jno yocudi dayode coñoque.
Ajni -
to
Imp.2e sg - ADV
lève
ga
-angai
CONJ
Imp.2e g
maintenant
et
gusu
ca
ADV
ADV
neg fut
mes
erue- ode
iji
avoir peur
jne
1re sg Obj
ar-ode
votre territoire
uac-anir-one
non
gusu
dans
vos territoires
seulement votre bâton brûlé
udojo. Emi
ch -osi te
ch- ing- ome-
CONJ
3e sg.-V-PREP-1re sg.Obj-Passé nom propre
m'a dit
que
celui-ci. Vent
ga
et
ñu-
bac-acugue
ADV 2e pl.poss-NOM
NOM-pl. PREP 2e pl.poss-NOM-pl DEM NOM
bouts
neg fut
moi
2e pl.poss-NOM NOM-pl.
intentions
signifiés
yu
Imp.2e sg
uac-aniri
1ºsg.poss-NOM-pl.
NOM-fon-pl
mes mots
atodo
maintenant seulement non
qui-g-ode
1re sg poss-NOM-pl
écoute
gajine
y- igaid -ode
ñ-urusor-one
Jnoede
Jnoede
3e sg-V
fait comme ça
chi
V.
ore
3e pl.
tora
V.
on dit que ils apparaissent
367
�yoqui-
quigade
udo
ga
chi
1re pl.poss-POSTPOS DEM CONJ V.
notre derrière
ore
3e pl.
ils
celui-ci
jno
V.
amener[1]
et
on dit que
yoc-udi
1re pl.poss-POSTPOS
notre - amener[2]
day-ode
NOM-pl
pères [anciens]
cojñoque.
NOM def form.
Blancs
« Lève-toi et écoute le sens de mes mots maintenant. N’aie pas peur de moi,
il n’y a que des restes dans votre territoire, seulement des restes de bûches
dans votre territoire. »
Le vent a fait comme ça, il m’a dit que Jnoede apparaîtrait derrière nous et
qu’ils nous amèneraient chez les Blancs.
2. Enominoi d'Ajeyide, interprété par Toto Étacori
Aobe a ajnito angai yocaquide noai maneguode ome ayowe ore uyoque iji erami
udode.
Yocaquide noai naome ñu « ñajnami ajni ga angai yuruode : yijigode erami ».
Aobe a amate que pángate ayore uritatique uyoque. Aobe a noai maneguode
chositome : ayoreode ore uyoque iji erami ude. Aobe a, que naijnapise uyu ga
que yipogu yocaquide noai maneguode quigode ome ayoreo ore uyoque iji erami
ude.
Aobe a, arijni ñujnuñeque ga angai yocaquide noai maneguode ayoreode ore
uyoque iji erami.
Aobe a jeti Disiejoide jeti ore chejnañu iji erami jeti ore pesu diri eruei ore
chejna ñoque ijnoque ayoreode iji erami.
Aobe a jeti Disiejoide pesu diri eruei ore chejna dojode ayore uyoque iji erami
ude.
368
�Aobe a diri gajine ga ore tua cuude ichai nerejnai ga chi yajo basieque
yocaquide maneguode ome ayowe uyoque iji erami.
Aobe, lève-toi et écoute les paroles de notre grand-père l'oiseau chugupejna qui
dit qu'il n'y aura plus d'Ayoreo, nous, dans le monde.
Notre grand-père l'oiseau m'a dit « mon petit-fils, lève-toi et écoute mes paroles :
il n'y aura plus d'Ayoreo dans le monde ».
Aobe, très fortement, nous n'écoutons pas mes visions dans les rêves.
Aobe, les paroles de l'oiseau chugupejna ont fait comme ça : « il n'y aura plus
d'Ayoreo dans ce monde ».
Aobe, je ne suis pas un chaman puissant et je ne cache pas les paroles de notre
grand père l'oiseau chugupejna qui dit qu'il n'y aura plus d'Ayoreo dans le
monde.
Aobe, lève-toi, mes nouvelles, et écoute les paroles de notre grand-père l'oiseau
chugupejna qui dit qu'il n'y aura plus d'Ayoreo dans le monde.
Aobe, si Disiejoide, eux, s'ils nous finissent dans ce monde, s'ils font la fin du
jour [s'ils nous tuent], il n'y aura plus d'Ayoreo dans le monde.
Aobe, si Disiejoide fait la fin du jour, s'ils exterminent nos paysans dans ce
monde.
Aobe, c'est déjà le matin, et elles peignent [leur visages] avec l'oxyde d’hématite
et nous mangeons les aliments de la brousse, les paroles de notre grand-père
l'oiseau chugupejna qui dit qu'il n'y aura plus d'Ayoreo dans le monde.
3. Enominoi de Picha, interprété par Toto Étacori
Dajepajami a ore dei yoquiquigade ayore etoque.
Dajepajami a dosoguedie que ore dei yoquiquigade ayore etoque ore jeti ore
chuje ñoque i siñeque to nirome chi ore chatia yoque aja quenejnane to nirome
etoque ome chugupejna Guiejna sudaque.
369
�Dajepajami a, chi ore pesu cureseo iji jnacari to nirome.
Dajepajami a chi ore chichagu etaudi nirome suaia caí to nirome ga ore pesu
cureseo to nirome. Ayore chicho nirome tomejnai caí to nirome.
Dajepajami a, Dajepajami a, chi ore chuinguia pinguiane a jnumi to nirome
etoque. Dajepajami a ajnusoangome to nirome jnacari uejane to nirome etoque.
Dajepajami a, catecai yu que chugupejna mu tagu daruode ome uyoque ga que
yiraja uruode, tagu daruode ome uyoque ga que yiraja uruode.
Dajepajnami, ils [Uejai et les Guidaigosode] sont derrière nous des Ayoreo forts.
Dajepajnami, les méchants sont derrière nous, des Ayoreo forts eux, s'ils nous
tuent ailleurs, demain ils nous feront fuir en directions diverses, d'après l'oiseau
puissant.
Dajepajnami, on dit qu'ils feront un trou dans un jeune homme demain.
Dajepajnami, on dit qu'ils perceront les cuisses, la queue du perroquet demain, et
ils feront un trou demain, un Ayoreo tuera avec une flèche la queue de l'oiseau
tomejnai demain.
Dajepajnami, Dajepajnami, on dit qu'un pinguiane sera tué demain.
Dajepajnami, n'aie pas peur demain, tu es un jeune adulte [tu es courageux].
Dajepajnami, l'oiseau chugupejna m'a parlé mais il mangeait ses mots pour nous
et je ne sais pas ce qu'il dit, il mangeait ses mots pour nous et je ne sais pas ce
qu'il dit.
Note : selon Toto, la dernière ligne [répétée] signifie que Picha ne peut pas
écouter les mots parce qu'il est déjà décédé. Cette ligne signifie aussi — Toto
insiste sur cela — que l'oiseau chugupejna mangera le corps de Picha.
370
�I.2 Pinangoningai, « j’ai tué une fois » (et je le ferai à nouveau)
1. Pinangoningai de Manene Dosapei, interprété par Sidi Posorajãi
Que ñiñanguena ñaqueamai Ingoine ore yuite.
Ñimopie jne ñajne yayode ore icomejna ga chi ca ayore susmaningai
gajneique
ga chi ca ore tujnuna dacañoacha datei ude ca chi yigaudo udo umaiga.
Yichietigai yadode udo umaiga ca aquesuyo uyu a jnumi yayode icaite
Uguide cachodi.
Ñacañujna ite ore ujnatarojna disigajade ore tayipie tigaite.
Je suis fâché avec mon oncle Ingoine.
Je suis content parce que l’icobidie de mes parents m’appartient
et eux, ils ne portent pas le grand icobidie.
Quand j’étais enfant ils m’ont attaqué lors du meurtre du père d’Ugui.
Je suis comme l’edopasai de ma mère, les jumeaux et leur ayipie.
2. Pinangoningai de Sugacade, interprété par Sidi Posorajãi
Disi jno catade uacugaratade ma que agupua yu ome uaque.
Bacapeo yibaite ica i siñeque. Yicha uaqueñeque cachotique ñuajeque piagoi ga
yurasaigui cheque ore pañaji yatedatei.
Bacapeoyo yibaite iji bacaingane casodicaite ayore gay isa ñasore ga yichagu
yuyai Atujnaine pajenique poga ñacañu aja yatedie ore edopasai arocojna
gajnei côachaque dipeseo.
Les oiseaux chantent [augure de l'arrivée des ennemis] mais je suis courageux
devant vous.
Vous m'aviez attaqué ailleurs. Je vous tuerai à côté du chemin et les femmes de
mon groupe observeront mon grand massacre.
371
�Vous m'aviez attaqué dans votre ancien endroit. Je prends ma lance et je perce
mon frère [parent clanique] Atujnaine et je cite l'appartenance clanique de mes
mères, le lézard [celui qui n'a pas peur malgré le grand nombre des victimes]
3. Pinangoningai d'Unguijnamuine, interprété par Toto Étacori
Yisagodacha ma ca adute uje guidaigosode icaguejnangue ore yui iji ude.
Guidaigosode ore sue yibai poga uñeque chuje ñu nirome ore chejnasia doidedie
ga dajose catade iji uyu to nirome jetiga yusaque ome ore i siñeque nirome to.
Ore chejnape doidedie ga dajose catade iji yudode ga yujego ore gai ga yisa
ñingojongoade ore i siñeque to nirome ga yisa ñingojongoai ñejnami ore udode,
ñingojongoai uñeque edoducadoi to nirome jetiga yujego ore i siñeque to
nirome.
Yujuegope guidaigosode icaguejnangue ore i siñeque.
Ñujnume chise Putugutaoidaye ore nirome ga i siñeque angacho ñujnumei
pimijnate darai ore chojninga nirome uyoque um guidaigosode ore yuite
Unguijnamuine yurasacasode ore naome uyu i siñeque ga guidaigosodeo ore yui
Unguijnamuine dayabi casicaite
etoque jetiga ore sue poi yoquibai nirome ome Putugutoidaye ore i siñeque ore
uniri ogatique to nirome ore chosite nae ñujnomei jetiga Putugutaoidaye
chudute ujumei i ore i siñeque to.
Yisagodacha, tu n'as pas entendu dire que les enfants guidaigosode viennent ici.
Les Guidaigosode, ils me tueront ou quelqu'un me tuera — je m'en fous, car je
suis courageux. Demain ils me couperont les jambes avec les haches si j'arrive
où ils sont ailleurs demain, ils me finiront avec les haches,
ils me couperont les jambes et tout le corps et je les tuerai et je pendrais ma
massue, eux ailleurs demain, et je prendrai ma massue et je les frapperai dans
tout le corps, je casserai le front à quelqu'un demain, si je les tue ailleurs demain.
372
�Nous tuerons les enfants guidaigosode ailleurs.
Je veux que mes nouvelles arrivent à Putugutaoidaye et eux demain, et ailleurs,
qu'ils écoutent mes nouvelles, que les mots arrivent jusqu'à là-bas, ils nous
diront demain « les Guidaigosode ont tué Unguijamuine ». Mes paysans ont dit
ailleurs « les Guidaigosode ont tué le vieux Unguijnamuine,
c'est difficile qu'ils nous frappent à nouveau demain, selon Putugutaoidaye, eux
ailleurs, leur territoire demain », ils ont fait comme ça, je raconte mes nouvelles
pour que Putugutaoidaye écoute mes nouvelles, eux ailleurs aussi.
Note : « enfants » est un terme méprisant pour se référer aux Guidaigosode.
I.3 Chingojnangai, la joie par l’abattage d’une victime
1. Chingojnangai de Paojnaine, interprété par Sidi Posorajãi
Yurugaisone ayore uaque ga angacho yujumenatei coñone cuchabia.
« ñajnaingo ñiquijnora cámejnai ga a yico Paojnaine gotique i siñeque, a
chayo i siñeque yiquiPaojnai, mecarane »
ga ñejna dogue jeti ore utigo degode coñone
ga yisapie yurugasone ayore eramone ga ore tangai yatedateique.
Putugutoi po iji ore puruque achutigo disidacabode yequejoigo, que yiraja
maqueñingueique bate gotique, gusu baradie iji babai.
Mes ennemis ayoreo, écoutez ma grande nouvelle sur les Bancs puissants.
[Les Blancs ont dit :] « Allons chez Paojnai, [qui est] ailleurs, il fuira, il
s’en ira »
et j’ai pris ma massue et je les ai frappés dans tout le corps les Blancs
et je pense à mes ennemis ayoreo [qui sont] ailleurs, qu’ils connaissent ma
grande tuerie !
Le jaguar rugit aux alentours des enfants et je n’ai pas peur de toi, ce ne
sont que des taches sur ta peau.
373
�2. Chingojnangai de Jooidé, interprété par Sidi Posorajãi
Dapuede di echoi udi ga Caichaquede di echoi udi. Diabia aguito gadoite
ga chicaji dacoteraque yui ga isabi Congoite di echoi udi dacote ore uyoque
ga chinguia ayore poi tuique jnongonone a jnumi.
Dapuede a apporté du sel et Caichaquede a apporté du sel. Que le jour
arrive… ! Et comme ça il arrive chez sa femme [qui sera contente grâce au
sel] et mon frère Congoite a apporté du sel pour son épouse, pour eux, pour
nous et il a tué un Ayoreo [sur le chemin de retour].
3. Chingojnangai de Cajoidate Chiquejñoro, interprété par Uguri Dosapei
Arijni ga bapesu ñiñosongueone iji yachidi tamocoi quigade je asago iji
bejoi ome Bajai Sijnai ucode ore. Adute ujnumeone mu que bo ga ajnai
ñeque manirique uñeque.
[Cajoidate s'adresse au jaguar tué par Bajai et Sijnai] Lève-toi ! Tu as fait
ma tristesse avec mon animal domestique le chien, tu n’as pas fui d’eux –
Bajai et Sijnai. Tu avais entendu qu’ils venaient mais tu ne t’es pas en allé,
va-t’en ailleurs, vers un autre territoire.
I.4 Irade, une histoire de nostalgie et d’amour
2. Gisela pojna dabai, par Daju Étacorõ
[Gisela uruode :] « Ñajna aja majaminone ga yisi ua ga ñau badode
bacajnacani piroi / piroque gajine » ñaome uñaque. [Dai uruode :] « Gisela,
yijogadi uaite ga yiya dajaminone ga ñajnito gajine cucha moroca ñu ome
bojodie dieque ore to mu je basocaite gajine ga a yii gajine ga ñajai
yuechade jeti yacho mapojnaqueode, jeaque yayipieraque udoaque doi
374
�jnanidacai casicaite ome ipojnaqueode etoque, Gisela ajose ti que
unejnangue Daju ome ñu ga yaca ide ga yo pac unejna jeti yacaji
yaquiningane ga yo pac yaquiningane jeti bajeo gajine ga yiyago ñane
gajine que yicadigui jnanidacaiabi casicaite acaditigade jode ti paague
yacoteraque nanique. »
Sujet énonciateur : Dai (le mari)
[Gisela a dit :] « J'irai là où tu joues et je te trouverai et je te brûlerai avec le
feu, le grand feu ». J'ai dit à celle-là : « Gisela, c'est mon lieu ici et j'arrête
de jouer et je rentre, maintenant, pourquoi tu te fâches avec moi comme si je
cherchais des filles ? Mais c'est comme ça que tu fais [c'est habituel que tu
te fâches avec moi] maintenant et je m'en vais. Je m'en vais plus loin, vu que
j'en ai assez de tes crises, tout de suite je pense à mon père [à ce qu'il disait]
sur les crises, Gisela il semble que Daju n'est pas étrange pour moi [Daju est
ma parente, parente de mon père, je pense à mon père], et je reste ici,
tranquille, c'est bon de rester ici tranquillement dans mon lieu, si tu veux,
on se quitte, je n'oublie pas les conseils de mon père, elle était gentille mon
épouse, ça fait longtemps… ! »
2. Dajei pojnaquei, par Daju Étacorõ
Ñijnecaosiabide yapacadi to gajine.
Que yedosu gajine cuchaique gajine yedogabiasu gajine Pascualita suaque
uruode gajine uje uñaque naome ñu ica « Dajei yipeco babia ga que yiya ua jne,
babai tuté majneone babai abode bisideque /abode to que yiya ua jne »
ga jeti je ure ñu, je ure ñu ga yiya uñeque to nanique mu yiji nanique uate
pataingane nanique. Yisapoi yoquirosori case
ga totiga ga ñujnusiasi uñeque to ica mu mama jnusiete Oonei to uñeque ica ga
yisapoi uñeque to ica
375
�yisapo yoquirosori casica to ica ga uñeque chaquesuyu utigo ica
ga ñaome disidequeamia « yico ga ñajningo to ga yibico mama to ! »
ga yico ome yocurasade ore ga Fibai uñeque tibagüi yu ga uñeque naome ñu
« abagüi bapagadi ».
Yiyaguiasi Oonei to ica mu mama ore ijnorac uñeque ica ga yayipiedoi
yabaiode jnani, que ore jno naquiningane udi to ga uñeque chaquesu yutigo
mu yico idai ude ga uñeque ijnojnoc jnanidacabi inijnai ga uñeque yacho
uñeque ica ga uñeque catecai ga ñaome « jetiga bacajeo ga ñijninapoi uñeque
bisideque to mu que yirajapise ñujnusietiguiji uñeque » mu mama
uñeque chijnora uñeque to ica.
La colère de Dajei (par Daju Étacorõ)
Sujet énonciateur : Dajei (femme)
Je chante ici dans mon lieu maintenant
Maintenant je parle beaucoup de quelque chose, je parle des mots de Pascualita
quand elle m’a dit « Dajei, nous adoptons ta fille et je n’arrêterai pas [de te
donner de la nourriture], ton mari [Sime] t’a fait des enfants pour rien [il ne te
donne pas d’argent] »
Et c’est vrai, c’est vrai moi, j’ai quitté celui-là [son mari Sime] ça fait longtemps
j’ai écouté ses mensonges [Pascualita] et je me souviens de [l’époque de] notre
ancien patron
Et celui-là [Oonei] ne me manque pas, mais il manque à maman et je suis
retournée avec lui
Je me souviens de [l’époque de] notre ancien patron et celui-là [Oonei] me
frappait sur tout le corps
Et j’ai dit à ma sœur [Ina] « allons-y, rentrons et appelons maman ! »
Et nous sommes rentrées chez nos paysans et Fibai nous a rencontrées et celui-là
a dit « va à ton lieu »
J’ai quitté Oonei mais maman est amie avec lui et mon ayipie amène mes maris,
ils ne se fâchaient pas avec moi et celui-là [Oonei] me frappait tout le corps
376
�Mais nous sommes allées à cette communauté [Jesudi] et je suis allée à la
maison de mon frère [Roberto] et j’en ai assez de celui-là, et j’ai dit « si c’est
votre désir, alors je serai de nouveau avec lui [Oonei] pour rien, il ne me manque
pas du tout », mais maman est amie avec lui.
3. Cuchanuto chiedo Posuei, par Daju Étacorõ
Ñijnecamine Unijnamuidaye inijnai ajei ga yedobu Posuei uñeque gajine
cho jeti je ure uñeque uje Posuei naome ñu « Cuchanuto a, ca boto jne ga
arote gadode, ñijninango ñane, yucuego baye iji montedie ». Uñeque chosite
« ajnina yujoique jnacari ga yaquesu bacadode ». [Posuei] jno ome
tamajnaningane mu changureta yui.
Sujet énonciateur : Cuchanuto (femme)
Je chante ici dans la maison d'Unguijnamuine et j'imite [les mots de] Posuei
celui-là, il semble que celui-là m'a menti quand Posuei a dit : « Cuchanuto,
reste ici et attends-moi, nous serons ensemble, nous chercherons ton père
dans la forêt ». Il a fait comme ça : « si tu es avec un autre jeune homme je
vous frapperai ». Il est parti travailler et il n'est jamais revenu.
4. Chomanate irade, Daju Étacorõ
Ñijnecaosiabide to gajine ga yedosuabu Ichoatedate uñaque uruode to
gajine –yoquisarane ore gajnecho- gajine uje Ichoatedate chetaque Chigabi
ica mu Ichoatedaye naeque « Eabia ca ayá Chigabi uñeque to, dacasute
desaque ga que casi ñongome dajogasui ome changuënique ». Ichoatedaye
chijnora Chigabi ome uyu to ica « que yipota piyatique ome uñeque ».
Sujet énonciateur : Eabia (femme)
Je chante ici et j'imite [les mots de] la mère de Ichoate, celle-là a dit — ce
chant est dédié à nos gendres — qu'elle détestait Chigabi mais le père de
377
�Ichoate a dit « Eabia, ne quitte pas Chigabi, son frère est dacasute et ses
parents n'ont pas faim ». Le père de Ichoate a défendu Chiagabi devant moi
[car il a dit :] « je ne veux pas que tu quittes celui-ci ».
5. Laino agoyedie, par Poro Posijñoro
Yacai yapade inijnai ajei yudute ore pijnane ga ore chojninga « Laino a, Ale
ore di » ga yayo iji ore yui ga yo pe ayore pimeseaique ome Ale. Yosi
posorajnane ore ujnie ñu mainga que yipogu yayipieraque, yacagoji ore
ejoique mu Ale que chajíe gadoique ga yayipieraque doi yujoaque dosape
date Acu casicaite cho gapu uejanie ome ñu nanique. [Acu uruode :]
« Laino ajna yigaiato ga yisapidi ujna » ga yii itamajnaningai i Martinez mu
ñaome Conami « ajiape Ale yuode ome coñone ga ango atigaja yu jne » mu
Umajno pusi yu i gate dirica ga ñaome [Umajno uruode ome Guiejna :]
« jode ti acañoa Laino suque ategoningai ome yujoaque cheque bacatique
ñimininga Laino Guiejna aca manirique, masoranenie bape disia, chajnose
Ale, Guiejna aca manirique ome bacuegode jnacari ome bape disia uje
chajnose Ale uengate que yiya manetique »
Sujet énonciateur : Laino (jeune homme)
Je suis dans la maison de mon père et j'entends leurs cris et ils disent
« Laino, Ale et eux, ils sont arrivés », et j'ai couru vers eux, mais Ale me
détestait. Je suis beau comme les Posorajnane et je ne cache pas ce que je
ressens. Je me suis assis à côté mais Ale ne me regardait pas et moi, je me
souvenais d'Acu du clan Dosapei, elle était comme les grandes filles avec
moi. [Acu disait :] « Laino, tiens mon serre-tête et mon bracelet [et nous
partons ensemble] » et je suis parti travailler à Teniente Martinez mais j'ai
dit à Comai : « surveille Ale [pour voir si elle est] avec les Blancs et dis-moi
si elle ne m'appartient plus », mais Umajno s'est fâchée et elle a dit : « Laino
est généreux avec sa femme [il travaille], Guiejna, reste dans ton territoire,
ta fille a volé le mari d’Ale, Guiejna, reste dans ton territoire, tu cherches
des jeunes pour ta fille, celle qui a volé le mari d’Ale, je suis très fâchée
avec toi ».
378
�6. Asema pojnaquei, par Poro Posijñoro
Ñimosi ñimochatique dirica mu yudute Luciano pijnatigo dirica ga ñaeque :
« Luciano, ma ca araja ite yoquijogatique ? ».
[Luciano] Ñaeque : « Asema, uyu, ga yise ua ide mu a yiya u ato, majnue
yibai uje sijnangue ua »,
mu ñaome Luciano uque [Asema uruode] : « Luciano majne baruode udoe
chise uje baya yu nanique ga majnina Ina nanique mu bayipie doi yu
mu a yiya pusua to jne betaque yica, yabi i ajei gu, ma ca bayipie doi poi yu
jetiga yica tudaque base ».
[Luciano uruode] : « Chise uje jnanidacayabi jno ome datamajnaningai
gajine nanique que yipota jeta yiya Asema, Asema dei quenejnane ga
yagupusu yajei »
La colère d’Asema
Sujet énonciateur : Asema (femme)
Je dormais dans mon lit hier mais j’ai entendu les cris de Luciano et j’ai
dit : « Luciano, est-ce que tu ne connais pas notre lieu [ogadi], celui de ma
mère ? »
[Luciano] a dit : « Asema, moi, je t’ai trouvée ici mais je te quitte, tu te
fâches avec moi parce que t’es méchante »
mais j’ai dit à Luciano : « Luciano, tes mots sont des mensonges, une fois
tu m’as quittée et t’es allé avec Ina231 , mais ton ayipie m’amenait [tu
pensais à moi]
mais moi je te quitterai, tu détestes mon [gros] ventre, car il y a un enfant
dedans [c’est pour cela qu’il est gros], mais que ton ayipie ne m’amène pas
[ne pense pas à moi] quand mon ventre tombe [l’enfant soit né] »
[Luciano] a dit : « Il était une fois où son père est allé travailler, et je ne
voulais pas quitter Asema, elle était ailleurs et elle me manquait beaucoup »
231
Fille de Bajai et de Daju, voir irade nº 19 sur Juguei, Ina et Asema.
379
�9. Colère d’Umajno contre Guiejna, par Jnumi Posijñoro
Uengate que, Guiejna yedogabia Guiejna.
Guiejna uneagajnamio Guiejna maneangajnamio uje majnose Ale
uaqueñaque.
Guiejna que yiya maneatique ga uengate Guiejna.
Guiejna tagusupusu ñajenique.
Guiejna maneanguejnamio ome Laino, ñujnusietigai garañi.
Guiejna majnose Ale uaqueñaque.
Guiejna que yiya maneatique gajine bagupusu yajei ga uengate
yayipiedopusu Laino, Laino ategoningai ome ñoque.
Laino suque uñatic. Laino suque disape mu uengate.
Laino suque chejnapise picanigatiguei ga uengate pujnusietigaique
ujuyapise yu ome Laino ucode uñatic.
Guiejna bagusupusu ñajenique ome uñatic.
Guiejna uengate yasiguepise Laino gu uje que doi Ale uñaque.
Yasitigai garañi Laino uje que doi Ale ga Laino sucode ga Laino sucode
uñatic pujnusietigaique ujuya ga Laino suque uñatic chejnapise yuchade.
Que ayoreique cho Laino.
Laino suque chejnapise cuchade ga uengate.
Guiejna tagusupusu ñajenique uengate ga Guiejna que yiya maneatique.
Yico mu yajíe yiquei mu ñimo Laino daye iji yiquenique ga uengate ore
iotopatiguei di ore platadie udi
uengate Guiejna tagusupusu ñajenique
Guiejna mejnasi guidaiode uje bacuegode bape catejamia abaiode.
Sujet énonciateur : Umajno (femme)
Je pense à Guiejna avec intensité
Guiejna je suis fâchée avec toi parce que tu as volé un mari qui était pour
Ale
Je serai fâchée tous les jours avec toi et avec intensité, Guiejna
Guiejna, je suis fâchée avec toi
380
�Guiejna je suis fâchée avec toi à cause de Laino, ma tristesse apparaît
Guiejna, tu as volé un mari qui était pour Ale
Guiejna, je n’arrêterai pas d’être fâchée avec toi, je suis tellement fâchée
que j’ai mal au ventre, je pense beaucoup à Laino, Laino était très généreux
avec nous
Laino, Laino était jeune mais très fort
Laino était très généreux et je suis accablée par la tristesse pour Laino
Guiejna, je suis très fâchée avec toi
Guiejna, je suis heureuse parce que Laino ne couche pas avec Ale.
Guiejna je trouve le bonheur parce que Laino ne couche pas avec Ale. Je
suis accablée par la tristesse et je la ressens dans mon ventre
Il n’y a pas d’Ayoreo comme Laino
Laino donne beaucoup de nourriture à la belle-mère
Guiejna je suis très fâchée avec toi et je n’arrêterai pas d’être fâchée
On y va, je regarde devant moi et je vois le père de Laino, leur patron leur a
donné de l’argent
Guiejna je suis très fâchée avec toi
Tu déménages tout le temps d’une communauté à l’autre parce que tu
cherches des maris pour ta jeune fille.
10. Teciodate irade, par Jnumi Posijñoro
Ite suaque naeque « Doia, macamo uje baye que chijnime daboaique ? » ga
ite suaque chositomeñu, ga ite suaque naeque « Doia, auaji ? » ite chimosi
ñuringa, que gapupe uejatac ga ite naeque « Doia, apota ia jnani
pamanique ? macamo Pajei uñeque uje cuchapibose gajnesore ga macamo
uje dacasute Pajei ? » ite suaque chimo ñuringa disap, ite suaque
chositomeñu « jetiga apota jnani pamanique ga oji Pajei ucode ñeque gai,
macamo cuchapibose gajnesore uje dacasute Pajei ? »
381
�Sujet énonciateur : Doia (jeune fille)
Ma mère a dit « Doia, tu ne vois pas que ton père n’apporte plus de
nourriture ? » et ma mère a fait comme ça avec moi, et ma mère a dit « Doia,
tu veux ? ». Ma mère a vu que je n’étais pas une fille adulte [mais] elle m’a
dit « Doia, tu veux un mari ? Tu ne vois pas que Pajei a beaucoup de
nourriture et tu ne vois pas qu’il est un dacasute ? ». Ma mère a vu que
j’étais une enfant, [mais] ma mère a fait comme ça avec moi « si tu veux un
mari alors va avec Pajei, tu ne vois pas qu’il a beaucoup de nourriture parce
qu’il est dacasute ? »
11. Disidacabode irade, par Jnumi Posijñoro
Ñijnecamine ga que yedotic cuchuñec yedogabiasu yu gajine ñuringamia
pujnusiete ome disidacabode ore dai casicai. Yajie Elado uque, uengate
Elado uqueñeque que chacai poi ñajenique ga yayipie jejogat disidacabode
ore dai casicai mu a yii gajine ga etoque jeti yayiperaque doi poi Elado
ñeque gajine uengat pujnusietigaique ujuyapise yu, cho jeti
cuchachungunique chequesa disiode ore dai casicai omeñu degüi uechai,
yiiape gajine ga yibagüi disiode dai casicai jetoque ti chetaque yu, yosipie
ayoabidie ñamuase yajíe mamá uaque mu jnusiete ome Tercio ucodeñeque
ñae duasede ga yii gajine, a yii gajine ga que ñangai poi yoquicelular, a yii
gajine ñerasia udaque gajine que yudute cuchaique etoque jeti yayipieraque
doi poi Elado uñeque ome ñu gajine, que pamuañaque, yopise yayugu ome
yabode cho disijadode mu ite uaque naeque « baraja cuchade jeti yuje ua
ica ».
Sujet énonciateur : Pojnangue (femme)
Je chante ici et il n'y a pas d'autre qui me manque. Je chante mon état de
tristesse pour l'ancien père des enfants. Je vois Elado celui-là. Elado n'est
plus dans mon intérieur, mon ayipie va beaucoup vers le père des enfants
mais je vais et mon ayipie n’amène plus Elado. Je suis accablée par la
382
�tristesse, comme si une maladie avait pris le père des enfants pour moi. De
l’autre côté de la communauté, je vais et je rencontrerai le père des enfants,
c'est difficile qu'il me rejette, « j'ai fait n'importe quoi ! » [elle regrette
d’avoir quitté Tercio]. Je regarde maman, elle est triste pour Tercio. J'ai dit,
ça fait un temps, « je vais, je vais et je n'écouterai pas le portable, je vais et
je l'éteins et je n'écouterai rien, mon ayipie n’amène plus Elado, mon ayipie
ne l’amène plus, je me préoccupe beaucoup de mes enfants, [ils sont] comme
des orphelins », mais maman m'a dit « tu sais bien, je t'ai frappée une fois ».
12. Chuguadaye irade, interprété (imité) par Jnumi Posijñoro
Ñijnecamine yedogabi Antonio suque gajine yedosuabu ñujnusietigabode
omé ñangai ñiquigade mu yududosi chequedacatabia pijnane ga naeque
« Ujnamia ajnito ome bajate Pajei ucodeñeque tibidi ua » ga ñaeque ite
«macamoto uje pujnusietigaique ujuyapise yu ome Antonio ucodeñeque ? »
ñaeque ite « ajnito, a yii jne ga ñaja Antonio ucodeñeque » uengate yise
Antonio, yise Antonio uñatique mu uñeque chetaque yu ga ñaeque « Antonio,
macamotoa uje gapu boquechocabidie Uñamia su yu ome dioquiode ?
macamo ñuringatac ? »
Sujet énonciateur : Ujnamia (jeune fille)
Je chante ici et Antonio me manque. Je chante ma tristesse pour celui qui est
beau. J'entends [des cris] derrière moi et j'entends les cris de ma mère qui
dit : « Ujnamia, va avec ton parent. Pajei t'appelle », et j'ai dit à ma mère
« tu ne vois pas que je suis accablée par la tristesse pour Antonio ? », j'ai dit
à ma mère « rentre, j'irai chercher Antonio, je vais et je cherche Antonio ».
Fortement, je suis arrivée où Antonio [était], mais celui-là m'a rejetée et j'ai
dit « Antonio, tu ne vois pas que je suis Ujnamia, la jeune fille chaude qui
cherche des hommes ? Tu ne vois pas dans quel état je me trouve ? »
383
�13. Jnumi jnusi Yue iji darigode, par Jnumi Posijñoro
A yii gajine uengate Yue uaque ga Yue uqueñeque yichapie yu aja
tamajnaningai casode ga yajíe yiquei mu ñimo Yue uaqué uñeque ga Yue
uaqué naeque ga « Pojnangue a yii jne ga eramone que chimopoi yu to » uje
uengate Yue uaqué ñae. Pujnusietigaique ujuyapise yu ome Yue uaqué mu
Yue uaqué naeque ga « Pojnangue a yii jne uje bate je doi poi yuruode ». A
yichapie yu aja niquiñosora casica ga [Pojnangue uruode :] « yajíe yiquei
ga ñimo Yue uaque gajine ga pijode chonaque omeñu gajine ga Yue
uaqueñeque mijna ome ñu ga pujnusietigaique ujuyañu ome Yue uaqué » ga
[Ramon uruode :] « a yii jne ñimo dejatique utigo ga eramone que chimo
poi yu to gajine ».
Yue manque à Jnumi (rêve)
Sujet énonciateur : Jnumi (belle-mère de Yue)
Je vais maintenant, fortement, Yue celui-là, et Yue, je pense aux travaux
avant [à ceux qui travaillaient] et je regarde devant moi et je vois Yue celuilà, et Yue a dit : « Pojnangue, je m'en vais et le monde ne me verra plus »
quand Yue a parlé intensément. Je suis accablée par la tristesse pour Yue
mais Yue a dit « Pojnangue, je m'en vais et le monde ne me verra plus »
quand Yue a parlé intensément. Je suis accablée par la tristesse pour Yue,
mais Yue celui-là a dit : « Pojnangue, je m'en vais parce que ta mère ne me
parle pas ». Je pense à notre ancien patron et [Pojnangue a dit :] « je regarde
devant moi et je vois Yue celui-là et la tristesse est finie soudainement et Yue
celui-là a disparu pour moi et je suis accablée par la tristesse pour Yue celuilà » et [Yue a dit :] « je partirai, je ne dors pas la nuit, et le monde ne me
verra plus ».
384
�14. Tamocoi pojna Jnumi (2010), par Jnumi Posijñoro
Ñijnecaosiabide gajine ga yedosuabu ñajinga datei udo gajine uengate que
yiraja yisocaique ga yacai ñujnusietigai ajeique
ga uengate que yiraja yisocai ome dicore, dicore tuaque deipise ñajenique
mu yayipieraque que jno jni disidacabode ore date case
ga uengate yayipieraque jejogatipise uñaque dei degüi quenejnaique
ga uengate que yiraja ñajeningo jeti ñijnina dicore uñaque aja yoquidai tude
uajate jeti ñijnina dicore,
[Tamocoi uruode] « mama, bajeo ? Dicore uñaque chi chata cuchapisagode
ua to »
mu [Jnumi] ñojninga [Jnumi uruode :] « que mayúo ga ñimo gotoraque »
ga mama uaqué tagupusu ñajenique uje chetaque dicore.
[Jnumi uruode :] « Ijnamiane, ma ca moto uje ñijnora tu Ijnamianate ? Ga
gusu pitoningaique jeti jno uyu di ga uate chicai yoquidai, que gapupe
porojo dei yajeique »
a yositome ga [Tamocoi uruode :] « yudute uje chi Lucía suaque dei siñeque
que ñimoji dejatique utigo ga yijique ga yibagüi Nena iñoquijnai
ga ñaeque ‘Nena, angosia mayoquijnai ga yisi bacatabia suaque uje yudute
to uje Nené suque chingoñu dipotac chocabode sui 15 urasabode’
e ñirique mu uengate que disiode dacatabiate pojnasia yu
ga yayipieraque dói yujoaque dicore, dicore uaque ñango ome ñu
ga dicore uaqueñaque deipise ñajenique utigo
ga yii gajine ga que yayipieraque dói poi disiode ore date tuaque gajine ome
jê yayipieraque que jno jni mama uaque uje ujnai dei gate ome Lucía, mama
uaqué chopise jetiga uro Lucía
ga e ñiringo i Piradesia uengate ga mama pusi yu i gate »
ga [Jnumi uruode] « que yagu baboade, asiome dicore ga tagu baboteque.
Ijnamiane, macamo uje que bé baodie uguchade mu babe ayoré quénejna
uguchade ? Ijnamiane, macamo ore imatañone ? Ijnamiane, boto ga ajnina
dicore, date, ore, gajine ga ñisiome babode ome Lucía uaqueñaque gajine
ga ore chajni daquide i Pai Idai gajine. »
385
�« Tamocoi s’est fâché avec Jnumi » (2010), par Jnumi Posijñoro
Sujet énonciateur : Tamocoi (homme, fils de Jnumi)
Je chante ici et je raconte avec nostalgie ma grande colère et je ne sais pas
quoi faire et la tristesse reste dedans
et fortement je ne sais pas quoi faire avec dicore, dicore est à l'intérieur de
moi mais je pense à la mère des enfants dans le passé [Lucía]
et fortement je pense à celle qui est dans une autre communauté [Lucía]
et fortement je ne connais pas mes désirs, si [je veux] être avec dicore à
notre communauté fortement, si je suis avec dicore
[Tamocoi à Jnumi] « maman, tu es d'accord ? Dicore a dit qu'elle t'aidera à
travailler »
mais [Jnumi] j'ai dit « je ne veux pas la voir »
et [Tamocoi] « maman m'a mis beaucoup en colère quand elle a rejeté
dicore »
[Jnumi] : « Ijnamiane232 , tu ne vois pas qu'Ijnamianate est mon amie ? Et
seulement si je meurs celle-là [dicore] viendra dans notre communauté, je ne
veux pas que celle-là travaille à côté de moi »
j'ai fait comme ça et [Tamocoi] « j'ai entendu dire que Lucía est ailleurs
[communauté de 15 de Septiembre] et je ne dors pas la nuit et je suis allé
chez le beau-père de Nena233
et j'ai dit [Tamocoi à Ijnamia] « Nena, demande à ton beau-père [la moto] et
je cherche votre mère, vu que j'ai entendu dire, Nené m'a dit, qu'il y a des
jeunes qui veulent des femmes parmi les compatriotes de 15 [de
Septiembre] »
je suis arrivé mais la mère des enfants s'est fâchée avec moi
et je pense à celle-là, dicore, dicore, celle-là m'a dit [qu'elle voulait vraiment
être avec moi]
232
Les suffixes –ne et –nate (ou –de et –date quand il n’y a pas de sons nasaux) signifient
respectivement « père de » et « mère de ». Ijnamia est la fille aînée de Tamocoi (Ijnamiane) et Lucía
(Ijnamianate).
233
« Nena » est un autre nom d’Ijnamia.
386
�et dicore, celle-là est vraiment à l'intérieur de moi dans tout mon corps
et je ne pense pas à nouveau à la mère des enfants mais je pense beaucoup à
maman qui a la tension artérielle élevée à cause de Lucía, maman celle-là, il
semble que Lucía est sa fille
et je vais à Filadelfia fortement et maman m'a mis en colère
et [Jnumi] « je ne mange pas ta nourriture, donne ça à dicore, qu'elle mange
ta nourriture. Ijnamiane, tu ne vois pas que tu ne donnes pas de choses à tes
filles mais que tu donnes des choses à des femmes inconnues ? Ijnamiane, tu
ne vois pas qu'ils n'ont pas de vêtements ? Ijnamiane, va-t’en, va avec
dicore, sa mère, eux, et je donnerai tes enfants à Lucía, et ils retourneront
chez leur grand-père à María Auxiliadora ».
15. Tamocoi pojna Jnumi (2011), par Jnumi Posijñoro
Uengate ñirique mu cheque dacatabia pusi yu i gateique
uengate yayipieraque jejogat ome ore disidacabode databia casica
uje yijoga yiboade aja mama mu uengate mama pojna ñu yudode
ca chi edopaique yu ome disidacabode ore databia casica uje yibai tu ome
mama a yijiape ga ñajnani yacote gajine
mu uengate mu uengate yayipieraque que chamuase pisi ore databia casica
que yiraja yisocaingome yacote uaqueñeque uje mama chapusajna
nerejaraingome mama uaque que ñamuase
[Jnumi uruode :] « jetoque jeti yagu baboade udo je chaca, yayipieraque
jejogat yicaia eo ».
[Tamocoi uruode :] « yisape yachidi ga Jesudi je chimo poi yu to, Jesudi ude
etoque jeti chimo poi ñu gajine, mama majnai tu Lucía suaque uñaque »
ga uengate pujnusietigaique ujuyapise yu ome yacote uaqueñaque uje mamá
ujnai tu disiode databia
mu a yii ga etoque jeti ude chimo poi yu to.
387
�« Tamocoi s’est fâché avec Jnumi » (2011), par Jnumi Posijñoro
Sujet énonciateur : Tamocoi (homme, fils de Jnumi)
Fortement je me suis réveillé mais la femme mère [Jnumi] m'a mis en colère
Fortement je pense à la mère des enfants avant [Lucía]
J'ai dit que j'allais donner de la nourriture à maman, mais fortement elle s'est
mise en colère contre moi
elle [Jnumi] a dit que je suis aveugle avec la mère des enfants [Lucía], c'est
ma faute d'après maman, je vais et je suis avec mon épouse maintenant
[Tamocoi était allé à Campo Loro, chez dicore]
et maintenant je n'oublie pas leur mère d’avant [Lucía]
je ne sais pas quoi faire avec mon épouse [dicore], vu que maman se met en
colère pour rien, je n'oublie pas [Lucía]
[Jnumi] « je ne mange pas ta nourriture, je pense beaucoup à ma première
belle-fille »
[Tamocoi] « je prends ma moto et Jesudi ne me verra pas à nouveau, Jesudi
ne me verra pas à nouveau, maman ton ujnai est pour la mère des enfants »
et fortement je suis accablé par la tristesse pour mon épouse [dicore], vu que
l'ujnai de maman est pour la mère des enfants
je m'en vais et on ne me verra plus ici.
16. Daju pojna Bajai, par Jnumi Posijñoro
Uengate yedogabisu José suque uñatic gajine uje José suque charangosi
yisagabidie suabidie ga yitamajnaningai bisideque uengate ga chisosiase
poasei uje aê chejnasi yu bisideque ome José ucodeñeque uengate ga yii
gajine ga José ucodeñeque naome « Caitabia, apesu yocuguchade ga
yicagoi Piladesia » chisipie ñuringa casica gapu, José, que pujnuengaique
uyu, José ñuringa casicaite gapu ga yeteque ti jnacanique uaqueñai
chetaque yu. Ñijnimepie uringa case Daju jno gajine José maosiome ñu que
388
�ome yibatigai bisideque ga uñaingo ingojna uñaque, ingojna ore uje jnusi
dabaiode ga chise ñuringa case gapu ga yabaiode jnacari ueiat.
Sujet énonciateur : Daju (femme de Bajai)
Intensément, j'imite José celui-là maintenant, vu que José ne veut pas donner
les perroquets que j'ai attrapés et j'ai travaillé pour rien et je me fâche, vu
que j'ai eu un coup de soleil pour rien pour José celui-là, intensément, je vais
maintenant et José celui-là a dit : « Caitabia [l'autre femme de Bajai],
prépare nos affaires, nous irons à Filadelfia ». Je pense à quand j'étais une
jeune fille [sans enfants], José, les hommes me désiraient, José, j’étais jeune
et un homme [en particulier] ne me rejetait pas. La jeunesse de Daju est
partie, José m'a dit d'aller à la forêt et j'ai travaillé pour rien, elle est bête
celle-là [référence à Lu, à qui son mari manque], elles sont bêtes ces femmes
auxquelles leurs maris manquent. Ça fait longtemps, j'étais jeune et mes
maris étaient de beaux jeunes hommes.
17. Fibai chijneca (Caitabia urigode), par Caitabia Picanere
Ñijnecasiabide ga oyopacho ga ñijnecaosiabide to gajine
ga jodeti je ue papá ica ga ca disijate uyoque ome uñeque to ica
mu naeque ome yapade suque gajine ga [Fibai uruode :] « que uñeque
chosiape » gajine
ga uñeque nae ome uyoque to ica [Tamocoi uruode :] « Fibai, que disijat ua
gajine »
mu taaque papá uque to ica.
Ore tora ñoque to ica, ñujnusipise ite tuaqué uje yayipiedopise ite uaque que
casi ñongome cuchaique ica
ga chaguode chuje yoque ga yayipiedepise ite uñaque to dejaque uje uñaque
naeque [Lucía uruode :] « Fibai, a yii jne ga jetoque jeti yayipiedopoi
auatique gajine » ite uaque naomeñu
ga cuchaique jeti gajine chaguei urosoique ute Ijnamia uyoque
389
�ga yayipieraque dojogui ite uñangue ome ñoque ga ñaeque [Lucía uruode :]
« a yi gajine ga que yayipieraque doipoi guidai ude gajine »
ga [Fibai uruode] « yii gajine ga yitarata je eratique gajine » yayipieraque
udaque dojogui ite uru casode ome uyoque dejaque uje que casi ñongome
chaguei urosoique dirica chisapie cuchadacadode ome uyoque.
Je ue pise ite uaté dejaque uje que ñimopoi ite uaté
ga yii gajine ga papá que chimopoi uyoque gajine Ijnamia uyoque uje que
casi ñongome cuchapisatique uté ica
uaté jnopise ica ité uaque dejaque uje que chimo poi uyoque to uje yapade
chañome uyoque ica ga je yuruabio sudoque uñeque chosi [te] ome ñu to
« Fibai a yii gajine ga etoque jeti yajíe uaque gajine ga quetoque ti ñajni
macamanique gajine ».
« Fibai a chanté » (rêve de Caitabia, juillet 2011)
Sujet énonciateur : Fibai (fils de Tamocoi)
Je chante ici et taisez-vous, je chante ici maintenant
Papa ne disait pas la vérité [quand il a dit] que nous n'étions pas des
orphelins
mais j'ai dit à mon père « personne ne fait comme ça » maintenant
et celui-là [Tamocoi] nous a dit : « Fibai, tu n'es pas un orphelin »
mais papa mentait.
Ils nous ont abandonné. Ma mère me manque beaucoup, quand je pense
beaucoup à ma mère qui ne me demandait pas de faire des choses
et la faim nous frappe et je pense beaucoup à ma mère, c'était le soir quand
elle a dit « Fibai, je m'en vais et je ne penserai plus à ce lieu » ma mère m'a
dit.
Et la faim nous fait tellement de mal à moi et à Ijnamia !
Et mon ayipie amène ma mère pour nous et elle a dit « je m'en vais et je ne
penserai plus à cette communauté »
390
�et [Fibai] « je m’en vais maintenant et je mourrai maintenant », mon ayipie
amène les vieux mots de ma mère pour nous le soir, la faim nous fait du mal,
je pense à ce qui nous est arrivé
C'était vrai ce que ma mère disait, que je ne la reverrai pas
et je [m’en] vais et papa ne nous verra plus, Ijnamia et nous, vu qu'il ne nous
donne pas de nourriture
elle s'en est vraiment allée, ma mère, le soir elle ne nous verra plus, vu que
mon père ne nous aime plus et voici mes mots, celui-là a fait comme ça avec
moi « Fibai, je m'en vais et je ne vous regarde plus et je ne retournerai pas à
votre lieu »
18. Pojnangue pojna Conchi, par Daju Étacorõ
Yedobu ñuringa tudaque pica « Conchi majneque yuruode udo, ñijnecade
udo quigode gajine Conchi ayá ñuringa piminingane ome babai etoque ti
que yipota bacabaiode, jetiga yipota poi ayoreode, ñijnorai omijna tu poi
disidacabode ore dai casicai uje yayipieraque doi uje gapape yu ga que
petegue yu ga yisocai je tu basocai mu majnu yibai ome badode ome babai,
jetiga yiya ñijnoari coñoc ga ñijnora tu poi uñeque. Etoque ti petegue yu,
etotiguei uje je toi uñeque, que ñamuase uñeque ga isocaite uje uñeque
yedoaque chomane uyu nanique joti je ure ñu nanique ga que yiya uñeque to
uje ipesute chagüeode jnanidacai casicai ejode nanique ga yayipiedo
udaque ujade ga je ñamuase ujade uje yayipiedo yipesudi uje jetoque ti
uñeque nanique uje yayipiedopoi uñeque to yise yoquipesudi casodicaite
yocacho nanique ga yajíe babai nanique ga yayipiedopusu nanique mu udo
ga yajíe uñeque mu ayorei que dei poi ñajenique »
Sujet énonciateur : Pojnangue (femme qui a eu une affaire avec Elado, le
mari de Conchi)
Je chante ma situation : ils se fâchent avec moi tous les jours. Conchi, mes
mots sont pour toi. Conchi, arrête de surveiller ton mari, je ne veux pas vos
391
�maris. Si je veux un Ayoreo à nouveau, j'irai avec celui qui est beau, le père
de mes enfants, à qui je pense, vu que je suis une jeune fille et si je veux un
homme, cet homme me veut et je ne fais pas ce que tu fais [se prostituer],
mais je me fâche dans tout mon corps à cause de ton mari [car il te vend]. Si
je quitte mon ami blanc [mari de Pojnangue au moment de la discussion], je
retourne avec celui-là [Tercio, son premier mari ayoreo]. Mon mari est fort,
il ne mourra pas, je n'oublie pas que celui-là me manque. Ce n'était pas vrai
ce que j'ai dit et je ne quitte pas celui-là, celui qui faisait des choses à côté
de mon père, je pense parfois à ça et je n'oublie pas. Parfois quand je pense à
mon fils adopté, c'est difficile [que j'oublie] celui-là, quand je pense à celuilà, j'arrive où notre fils adopté [se trouve] et j'ai regardé ton mari [Elado]
avant et j'ai pensé beaucoup à lui avant, mais maintenant je regarde celui-là
[Elado] et cet Ayoreo-là n'est plus dans mon intérieur.
19. Ina pojnaquei, par Daju Étacorõ
Uengate ñijnecaosiabide yocapacadode ude yocuburude gajine
joti je uesi Porai uñeque dejaque uje uñeque naomeñu dirica [Juguei uruode :]
« yasique yu uje ñimate yu a bacari etoque ti que yicadigui disidacabi »
mu uñeque yutô dateraque dirica uñeque tibidi yu i dateraque ore jogatique
dirica gadoide ome uyoque dirica
ga yico ñeque dirica date dirica uñaque naome ñu dirica [Gabriela uruode :]
« Juguei, que pajeigadode majnora uate to, yajegaide tu Asema uaqué » ñangai
ñaome uñeque [Ina uruode :] « Porai a yii to jne mu a ca yisapoide gajine »
cuchapiñosonguio uñeque
dejaque uñeque chise yu dejaque ga uñeque naome uyu dirica « Ina yise ua ide
a yigo noticias ua bajaque » gajine
uñeque naome ñu dirica « ca asa mamanique to, ñijnina poi ua to »,
naome uñeque dirica « ajnina bacoteraque to mu ga ñijnina ñamanique to,
ajnina bacoteraque »
392
�uñeque charaque jnanione ome ñu, ñojninga ome uñeque « ma cuchaique que
ñijnina jnanique »
mu ute todo yu ome Apai uñeque i dejaque ga uñeque chisa dedo aja yu dirica
cuchapiñosongui
uje uñeque naome ñu dirica « Ina yudute to uje chi majnina Eduardabi ome
Ujniete to »
mu ñae « macamoto uje yoquiasique Eduardabi uñeque que yipota jnani
pamañane to »
mu uñeque naome uyu que « ñijnina cheque uñaque mu ñajnipoi bacabai jeti
yetaque uñaque atique, ñujnusiede u yabi gu »
« Ina s’est fâchée avec Juguei »
Sujet énonciateur : Ina (femme de Juguei)
Fortement, je chante dans notre lieu à l’ombre maintenant
ce n’était pas vrai quand Porai m’a dit hier « je suis heureux d’être à nouveau
avec toi, je n’oublie pas mon fils »
mais sa mère ne veut pas. Hier celui-ci m’a appelée depuis le lieu de sa mère
pour que j’y aille, nous
et nous sommes allés chez lui hier et celle-là a dit hier « Juguei, ce n’est pas mon
désir que tu sois avec elle, mon désir est que tu sois avec Asema », j’ai entendu
j’ai dit à elui-ci « Porai, je m’en vais et je ne retournerai pas ici », je me fâche
avec celui-ci [insulte]
celui-là est arrivé chez moi et il m’a dit hier « Ina je te trouvé ici, je te dirai
d’abord des nouvelles »
maintenant celui-là m’a dit hier « ne cherche pas de maris, je serai de nouveau
avec toi »,
j’ai dit à celui-là « va avec ton épouse [Asema] et j’irai avec un mari, va avec
ton épouse »
celui-là m’a interdit les hommes, j’ai dit à celui-là « mais je ne suis pas avec des
hommes… ! » celui-là a peur de que j’aille avec Apai
393
�et celui-là [Juguei] ne me désirait pas hier [insulte] quand il m’a dit « Ina, selon
Ujniete, tu es avec Eduardabi »
mais je lui ai dit « tu ne vois pas que nous [famille de Bajai] sommes contents
avec Eduardabi ? Je ne désire pas mon beau-frère »
mais celui-là m’a dit « j’irai avec cette femme-là [Asema] mais je reviendrai
avec vous si je déteste que celle-là [Asema] se fâche avec moi, mon fils me
manque »
20. Iba pojna dabai, par Jnumi Posijñoro
Uengate yeteque moi dejatique utigo uje yayipieraque que jnojni suque –
abai i tu suque, que chica i to- suque uñatique ore di datamajnaningane mu
suque diosique chose ti ca yiraja purusaratique ga uñatique uñatique suque
uñatique churusa suque ñatique cuchamaringa ga jeaque ñipojnasia
uñatique mu suque naeque « Iba, je puê penojnangue, Iba majnui tu catai
ome ñu uje cucha maringa bojoaque cheque chacai yejoingome, Iba, Iba,
Iba majnimi ñu i tamajnaningai, Iba chise uje yico yoquitamajnaningane iji
olería ga majnime ñuque Iba bajosipiejani chacai pise yudode » suque
uñatique « cuchamaringa que ajnime yuguchaique aique que ayowe cho
ua » mu ayore nequeamia naeque « Iba, jeta puê penojnangue ua, uje
ñimongo Rufina i to ome babai, Iba » yisape mamá yugode gajine ga tijeras
gajine ga yaquesu baguchade i babai ga ochoquide amaengüi ga suque
uñatique yeteque moi i dejatique utigo to mu Jnumi naeque « Ibaguiede
mojingai uasu
bajate que chijnime uguchaique aique ua ga boide babai
platadie » Jnumi suaque quenejna uruode omeñu (commentaires) mu yajíe
yiquigade mu ñimosi chequedacatabia suaque nae « Ibaguede, uyu ga a yuje
ua gajine ga acá uaité ga yuje ua jne que yome yujodie chequei ga je yagu
tu ñoachaic »
394
�« Iba s’est fâchée avec son mari »
Sujet énonciateur : Iba (femme)
Intensément, je ne peux pas dormir, car je pense beaucoup à lui [mari], ils
sont arrivés du travail mais celui-là est arrivé comme s'il ne savait pas lire et
celle-là, celle-là a écrit dans celui-là et j'ai compris et tout d'un coup je me
suis fâché avec celui-là, avec celle-là mais celui-là [le mari] a dit : « Iba,
c'est vrai ça [il y a un nom de femme écrit dans mon chapeau], tu es comme
un tigre avec moi, comme si une femme qui me désire était avec moi. Iba,
Iba, Iba, tu ne veux plus que je travaille, Iba quand nous travaillions à
l'huilerie tu t'es fâchée avec moi. Iba, j'en ai assez [littéralement : elle est
dans tout mon corps] de ta rage de tous les jours », celui-là [a dit :] « tu ne
fais rien pour moi, il n'y a pas de femme ayoreo comme toi », mais ma sœur
m'a dit : « Iba, c'est vrai, nous avons vu le nom de Rufina dans [le chapeau
de] ton mari ». J'ai pris les affaires de ma mère, les ciseaux et j'ai coupé
toutes tes choses et tu es maintenant sans vêtements dans le campement et
celui-là… je ne peux pas dormir et Jnumi m'a dit : « Ibaguede, ton frère ne
donne pas de choses [à sa femme Ijnamia, petite-fille de Jnumi] et toi, tu
reçois de l'argent de ton mari ». Ils étaient étranges les mots de Jnumi pour
moi, mais je regarde derrière moi et je vois ma mère qui me dit : « Ibaguede,
je te frapperai, reste ici et je te frapperai, je ne suis pas comme les autres
femmes [je te frapperai] ».
21. Gosi jnusi cheque, par Poro Posijñoro
Gajine ga yedosuabu ñujnusietigaique date ome yujoaque dosapedate ga a
yise ude ga ñimo yujoaque dosapedate Ana uñaque ga pijode chonaque ome
ñu gajine ga pujnusietedate chicai dajesui ga pijode chonaque omeñu jetiga
ñimo uñangui iji yiquenique
395
�Sujet énonciateur : un homme
Je chante ma grande tristesse pour une femme Dosapé et je suis arrivé ici et
je vois la grande Dosapé Ana et la tristesse est finie pour moi maintenant et
la grande tristesse s'en va et la tristesse est finie, si je vois celle-là devant
moi.
22. Noe irade, interprétée par Cuia
Yipesabu enuei ga yedobu yujode dosapequedate Igaubi uqué. Yujode
dosapequedate deji Asuncion ica, que pamuañaque uñangue omeñu ga
Chicori dei yejoique mu yicha Chicori yidoboi, yujode dosapequedate Igaubi
uque diapoi Asunción ga yajíe que pamuañaque uñequei. Chicori uque,
yichaga uñeque a yidoboi, yichapoi yajeode uñeque, uje uñeque di
Sujet énonciateur : Noe (femme de Chicori)
Je fais cette corde et ce grand [homme] Dosapei, Igaubi, me manque. Le
grand Dosapei est à Asunción, je n'arrête pas de penser à lui et Chicori est à
côté de moi je tourne mon dos [je ne l'aime plus]. Le grand Dosapei Igaubi
est arrivé d'Asunción, et je le regarde et je ne l'oublie pas. Chicori celui-là,
je tourne mon dos à celui-là [Chicori], je désire à nouveau celui-là, quand
celui-là [Igaubi] arrive.
23. Abeca pojnaquei, par Jnumi Posijñoro
Uengate inna suaque inna Osora suaque pojnasia yu que naeque ga « inna
ma cuchaique gu ua uje mapojnañu, inna, macamoto mayosi checape uyu ga
que yipota jnani quenejnai » ga yico to mu uengate yajíe yenomite yajesui
ga uengate yajíe yenomite ajesuique mu ñimo uque ñimo Delio ucodeñeque
ae ujnietepise uñeque ga jeaque Jnani uñeque ñiriji yaquiningaique mu
Jnani uñeque naeque « ome… » uengate Jnani uñeque naeque ga « Abeca
ome yajeode ga ajasi uaiti gajine ome yajeode (commentaires) » ga ñaeque
396
�« mayosi checape ñu mainga que yipota jnani quenejnaique » mu Jnani
naeque « ome yajeode ga jne omape ua Delio dosi ua » uengate ñaeque ome
Jnani « ma checape uyu mainga que yipota jnani quenejnaique » inna Osora
uaque ñaome ga. [Abeca uruode :] « inna ma ca bayipie cuse uje chise
yoquirosori casica ga majne yiplatadie, yiplatadie 60 000, bosipie ayoabidie
» mu inna uaque nae ga [Osora uruode :] « Abeca macamoto uje ñosorai
ujnacari daye ucodeñeque, inna bopise ayore unejnangue omeñu ».
Sujet énonciateur : Abeca (femme)
Intensément, ma sœur celle-là, ma sœur Osora celle-là s'est fâchée avec moi
et j'ai dit « ma sœur, pourquoi tu te fâches avec moi ? Tu ne vois pas que je
suis une femme mais je ne vaux pas un autre homme ? » Allons-y et
intensément, je regarde devant moi et intensément, je regarde devant moi
mais je vois celui-là, je vois Delio celui-là, qui a eu un coup de soleil [il a
beaucoup travaillé] très vite et Jnani celui-là, je vais à mon endroit, mais
Jnani celui-là, il dit « arrête… ! ». Intensément, Jnani celui-là, il dit « Abeca,
il me semble que tu dois rester là [je ne t'aime plus], il me semble [gros
mots] » et j'ai dit : « je suis une femme mais je ne veux pas un autre homme
» mais Jnani a dit : « il me semble que tu as été avec un autre homme, Delio
t'a baisée ». Intensément j'ai dit à Jnani : « je suis une femme mais je ne
veux pas un autre homme ». Ma sœur Osora, celle-là, j'ai lui ai dit : « ma
sœur, tu ne sais pas [tu ne te souviens pas] que quand [j'ai travaillé avec]
mon ancien patron, je t'ai donné mon argent, 60 000 [guaranis] ? Tu sembles
être une femme qui n'est pas ma parente ». Mais ma sœur celle-là a dit : «
Abeca, tu ne vois pas que je suis amie du père de ton fils, tu me sembles
vraiment être une femme ayoreo étrange ».
24. Ijnamia irade (Ujniete), par Jnumi Posijñoro
Ñijnecaosiabide gajine ga que yedogabite cuchabape cuse yedogabite suque
disidacabi suque gajine uengate Ujniete maniami su que yiradosi badabode
to (commentaires) Ujniete maniami su epiadigap ua ome ñu ga uengate que
397
�ma chisosi siquere casica basocabode je sú ome ñu mu ide gajine yiadosi
badabode Ujniete etoqueti que payipie gajneque ua ome ñu amate yo
yujoaque dieque gajine ga payipie gajnetique que dei pise ua, Ujniete
maniamia su jeti ajnieta yujodie dieque etoque ti que yiradosi badabode
gajine ga bagachodabi su diri ude ome uyu gajine uje yise
bacatamajnaningai casodica ga yicode uaque chutajo ua bapatadie mu
etoqueti ajíe code uaque yuique ñamapua ome batejoique Ujniete bapesu
babi bisideque cuchamaringa amanosia yocuguchatique ga yii to gajine ga
je piodigape gajine que yome code gajine ga –chacarañu uyu gu uje yabai
toi ica, mu que yipota poi jnanione to- que yome code gajine ga que yacai
code uaque ejode ga Ujniete cho jeti ñujnusi ua mu yedogabi mengami
atenoñagap Ujniete etoque ti yosiome ñacode uñataque mu pujnusietigaique
chise yu uhu uje disidacabi queñeque mu yucue yajeo ome ñaquea a ñisiome
yabi ome uñengome Dionisio ucodeñeque gajine uengate que yeteque
bayipie gajnetique iji ua mu ayore nequeamia Rosana suaque nae « Ijnamia
ayá mecaranedo ga yico gajine ga ñajnango iti ga yoquidaiode datâ
macamoto a uje e gusu code uaqueñeque ga poitaque jeti ñijniongome code
uaque yoquiquinganingo » mu yositome ayore nequeamia suaque « yibagabi
mama uaque gajine ga yigo yaecujadedie gajine uje ca chi mama suaque
chosipie checabidie uje que doi yuruode ga yico ga ñajnaingo code Idai
Arode ome yajeode ca chi mama uaque uruabio uje chi Nani dei siñeque
(commentaires) mayosi yujabidie gapape gajine ga uñane ore chajni
dabaiode gayode mu Ujniete suque ingoijongueiñu uje daye suque pesu
arode mu etoque ti que payipie gajneique bacabi case ome ñu
(commentaires) Ujniete maniami su uje majnime ñu i escuela nanique ga
ijnose ti nanique je ure ua nanique ga ajei bacaidi tu nanique uje bapesu
babi bisideque
Sujet énonciateur : Ijnamia (petite-fille de Jnumi et femme d'Ujniete)
Je chante ici et ce n'est pas grand-chose qui me manque, le petit enfant celuilà me manque maintenant intensément. Ujniete, tu parlais avec des filles et
moi, je ne faisais pas ce que tu fais, Ujniete, tu parlais avec des filles et moi,
398
�je ne me fâchais pas avec toi. Et intensément, l'année dernière tes habitudes
[parler avec des filles] ne me fâchaient pas mais maintenant je ferai ce que
tu fais. Ujniete, je ne pense plus à toi, les hommes donnent de l'argent à leur
femme, maintenant et je ne pense absolument pas à toi. Ujniete, c'est ton
problème si tu veux des filles, j'imiterai tes habitudes, je chercherai un autre
homme pour moi aujourd'hui. Avant tu travaillais et ma grand-mère t'a
demandé de l'argent mais tu ne regardais pas vers Jnumi. Je me suis fâché
avec toi, Ujniete, tu as fait ton fils pour rien, tu n'achètes pas de choses pour
nous. Je m'en vais, je ne reste pas ici, je ne suis pas comme ma grand-mère
[elle est âgée et elle reste] — commentaire de Jnumi : « elle fait une
comparaison avec moi parce que je n'ai pas voulu d'autres hommes quand
mon mari est décédé —, je ne suis pas comme ma grand-mère et je ne
resterai pas ici avec elle. Ujniete, il semble que tu me manques, mais je
chante ton avarice avec l'argent. Ujniete, je ne ressemble pas à ma grandmère mais la tristesse m'arrive à cause de l'enfant celui-là [le fils qu'elle a eu
avec Ujniete]. Je pense à mon oncle, je donnerai mon fils à mon oncle à
Dionisio celui-là intensément, je ne pense pas du tout à toi, mais ma sœur
Rosana a dit : « Ijnamia, arrête de penser à quitter Jesudi, allons-y [à la
communauté 15 de Septiembre], les autres communautés ne sont pas les
nôtres, tu ne vois pas que notre grand-mère est toute seule et c'est moche si
nous la laissons derrière nous ? », mais j'ai dit à ma sœur : « je veux chez
maman maintenant et je lui dis mes mots, mais je me fâche avec maman, car
elle n’a pas fait attention à moi, allons, allons à l'ancienne communauté de la
grand-mère [Jnumi] Idai Arode, maman ment car le père est ailleurs. Je ne
suis pas comme les autres filles, les autres, elles retournent avec leur mari,
mais Ujniete, je suis célibataire, son père [Inocencio, père d'Ujniete] a fait
une lettre, Ujniete je me fâche avec toi, car tu m'as fait sortir de l'école, ça
fait longtemps et il semblait que tu disais la vérité et ton désir était de faire
un bébé, et tu as fait un bébé dans moi pour rien.
399
�25. Ijnamia irade (Eta), par Jnumi Posijñoro
[Miriam uruode :] Ñijnecaosiabide gajine ga yedosuabu, yedogabite suque
Eta ga Eta ucodeñeque gajine ga uje yajíe yiquenique
mu ñimo ñijnora Iba yajíe yiquenique mu ñimo ñijnora Iba ga naeque ga
« Miriam aja beite ga ñingosia ñujnungami noticias gajñaique omua » ga
ñijnora uengate naeque « Miriam adute to a uje Eta urusarane di ga
uengateque urusarane di Ijnamia uñaque ga ca chirajasiapoi cuchaigui ua »
[Miriam uruode :] « Ijnamia tagupusu yajenique ga que deji penochaique
Ijnamia que deji penochaique »
[Eta uruode :] « uengate Ijnamia be ga arate ñurusarane uengate Ijnamia
be gajine ga arate ñurusarane to gajine, Ijnamia be gajine, arate
ñurusarane ga apogu maurusaratigo gajine ga uengate Ijnamia bagusipise
yajei ga basaga Miriam suaque ga yichasia Miriam suaque iji yosatique gu
uje coñone chirajasi Miriam i yocuniri ude mu ñaeque Ijnamia be gajine ga
arate ñurusarane ga ñijninangosia ñane jetiga ñimaco yoquigaidi estudio a
guesi. Yajíe yiquenique mu ñimo Miriam uñaque ga que yichaga ñajeningo
aja Miriam cho jetiga Miriam uñaque que deipise ñajenique. Yajeode ti
Ijnamia arate ñurusarane gajine mu yajeode jeti ca ango ñurusarane ome
baye ore gajine mu ayore pijogamia Rosa uaque naeque ‘Ijnamia a yipogo
cuchade udo, ango bacode uaque ga macamotoa uje Pascualita totiga ayore
ga que pogu daruingome dojodie ayore’ ».
Sujet énonciateur : Miriam (jeune fille)
Je chante ici et celui-là Eta me manque, Eta celui-là maintenant, je regarde
devant moi mais je vois mon amie Iba, je regarde devant moi
mais je vois mon amie Iba et elle dit : « Miriam, viens, je te dirai de
mauvaises nouvelles pour toi » et, intensément, mon amie a dit : « Miriam,
j'ai entendu dire que la lettre d'Eta est arrivée et, intensément, la lettre d'Eta
est arrivée à Ijnamia et lui [Eta], il ne t'aimera plus ».
Je me fâche beaucoup avec Ijnamia, elle est laide Ijnamia !
400
�[Eta a dit :] « Intensément, Ijnamia vas-y et répond à ma lettre, intensément,
Ijnamia vas-y et répond à ma lettre, vas-y et répond à ma lettre, cache ta
lettre et, intensément, Ijnamia est vraiment à l'intérieur de moi et je n’aime
plus Miriam, Miriam est restée derrière, vu que les Blancs connaissent
Miriam dans notre territoire ici, et j'ai dit 'Ijnamia vas-y et répond à ma lettre
et nous sortirons ensemble quand nous aurons fini nos études [l'école]', je
regarde devant moi mais je vois Miriam celle-là, mon intérieur n'est pas vers
Miriam, c'est comme si Miriam n'est pas du tout dans moi, c'est mon désir :
'Ijnamia, répond à ma lettre mais ne montre pas ma lettre à ton père et à eux',
mais Pojnangue [tante d'Ijnamia], la parente, a dit 'Ijnamia, nous raconterons
cela, raconte à ta grand-mère [Jnumi], tu ne vois pas que Pascualita [mère
d'Eta] est méchante [elle se fâche très vite] et elle ne cache pas ses mots
envers les autres personnes ?' »
26. Ebedu pojnaquei, par Daju Étacorõ
[Ebedu uruode :] ñijnecarosiabi yapagadi ude ga yedobu gajine
yayuguetiga dateode gajine a yisapo chequedie ore diringai case dejaque ga
yajíe ore ujnaigo dejaque mu titá ore ujnaigo Jnumi dejaque mu titá ore
ujnaigo dejaque ga dejaque dirica ga Guieja uñaque nae dirica « Ebeducha,
adute to, a yigo cuchaiga ua jne uje chi Uneai chi uñeque ipotigade tu
Jnumi ore ajesuode eramone » ga ñaome Guieja uñaque. [Ebedu uruode :]
« a yii to ga ñajni to a yigo yu ja abuja [x2] dejaque mu yabuja naome
ñoque ‘ Luis ajnito jne jeti bajeo to ga aje ute macamo yoqueajepidode ? Ga
que pijocayaque uyoque, ¿macamoto uje bacote uate marai uñeque to ? ’ »
ga ñaome disidacabi. [Ebedu uruode ome Cepe :] « a yaji to a ñajnani to
Bolivia ga ñajnani Fibai ore ga beyoi bacaquitigo to ga uje jnani uaque ga
yajujo uñengome uñane to que yiraja ñujnusietigade quitique dejaque ga yiji
guesi ñimochatique dirica ga yajíe ore igidedie ga yicha yagoyedie aja to
dirica yosisidoe dirica ñaome yu yujode jnani a ñajni to ga yajeo ga ore
nona ñane ga ñijnauangajna puesidie to ga yicho ore guidaiode ga ore nona
401
�uñane jeti yiyago uñane ga jeti yajeo ga ñajnauajna Asunción to que yiraja
ñujnusietigadode quitic ome uñaque [por Jnumi] ».
Sujet énonciateur : Ebedu (mari de Jnumi)
Je chante ici dans mon endroit et je chante mes grandes préoccupations
maintenant, j’ai retrouvé les femmes qui sont arrivées et je regarde parmi
elles mais parmi elles Jnumi n'est pas là. Et hier soir Guieja celle-là a dit : «
petit Ebedu, écoute ce que je te dirai : on dit qu'Usigai désire Jnumi là-bas »
et j'ai dit à Guieja celle-là : « je vais et je rentre, je dirai au patron, je vais et
je rentre, je dirai au patron, mais mon patron nous a dit : ' Ebedu, rentre si tu
veux, et frappe-le, tu ne vois pas que nous frappons [ou bien : tuons] ceux
qui veulent nos femmes et ce n'est pas un problème [c'est notre droit] ? Tu
ne vois pas qu'elle est ta femme et celui-là a fait des problèmes ? ' »
et j'ai dit à mon fils [Tamocoi] celui-là : « je rentre à Jesudi et je vais en
Bolivie et je vais chez Fibai [frère d'Ebedu], chez eux, et alors vous allez où
vous voulez, vu que vous êtes déjà des hommes ». Je suis très triste et
j'apporte dehors ma moustiquaire et je regarde ses vêtements et j’ai
beaucoup pleuré hier, j'ai dit hier, j'ai dit hier aux autres hommes : « je rentre
et je veux qu'eux [Jnumi et Usigai], qu'ils soient ensemble et je les emmène
à la police et je tire sur leurs pieds, et ils formeront un couple si nous nous
quittons, et si je veux, je vais à Asunción, car celle-là me manque
beaucoup ».
27. Jnumi pojna Umajno, par Jnumi Posijñoro
Ñijnecaosiabide gajine uengate mu yedosuabu ñuringamia sudaque checape
uyu gajine eramone chimo ñu ga popise uje ga ñijnina ayore piguiosi acote
mu pujnuedie noñangune ujuyapise uyoque ñijnora suaque disi pabujia
[Sonia-Dogobede] ga uñaque date [Tujninia] po aja dajesuode ome ñu
ñaeque ome Sonia [Jnumi uruode ome Sonia :] « que nucarane ñoque
402
�gajine » uengate yiiape ga yibagabi Tito uñeque a yigopie cuchaique uñeque
(commentaires) ga yicoto mu a yibagui Tito uñeque mu uñeque chi ayape
que chiji cuchaingome ñu ga uñeque ga [Tito uruode ome Jnumi :] « ma
apota Jesudi » mu uengate pujnusietigaique ujuyapise ome disidacabode mu
chi Umajno toque ti ñuasia yabai ueca ga toqueti yipota jnani quenejnaique
que chimo ñu (commentaires) mu Sonia uaque naeque [Sonio uruode ome
Jnumi :] « Jnumi isemu que ñiringo po toi uje yiyagopise » (commentaires)
terminal jogatique- ga uñaque naome ñu [Sonia uruode ome Jnumi :]
« Jnumi yico gajine ga ca apojna Uneai uñeque jne » ga [Jnumi uruode :]
« Sonianate, cucha jetiga Uneai chuje ñu gajine ga a yatasia acotabia
gajine » (commentaires) ga [Tujninia uruode ome Jnumi :] « Jnumi, Uneai
chijnaque » mu ñojningame Sonianate [Jnumi uruode ome Tujninia :] « a
ñijnaiuja Uneai uñeque gajine » [Jnumi uruode ome Uneai :] « Uneai
mayuode que yipota jnani quenejnaique » mu yajíe yiquenique mu ñimo
ayore piguioto uaque [Poro] ga naeque ga [Jnumi uruode ome Poro :]
« yiguioto, yabode deique ? » mu yiguioto uaqueñaque naeque [Poro uruode
ome Jnumi :] « yiguioto, Ebedu uñatique ñipojna » ga [Jnumi uruode :]
« jeaque que yajíe cuchaique ga yii ga yisi Umajno uñataque ga yisi ga
etoque ti yitodo abai ».
Sujet énonciateur : Jnumi [Umajno avait dit que Jnumi voulait être avec son
mari Usigai. À propos de la réaction d'Ebedu, le mari de Jnumi, voir l'irade
nº 26].
Je chante ici maintenant intensément, et je chante ma petite situation de
femme qui est loin et elle [Tujninia] pleure beaucoup et j'accompagne à la
femme ayoreo, l'épouse de mon parent clanique, mais nous sommes
accablées par la rage, mon amie celle-là, ma nièce [Sonia] et sa mère
[Tujninia ] pleure parce que nous sommes loin [littéralement : elle pleure
[pour les chemins] mais j'ai dit à Sonia : « nous ne sommes pas ñucarane
[comme nous n’énervons pas Nito, il nous paiera les billets de retour] et
intensément ». J'y vais, je vais où Nito se trouve, et je lui dis ça, et nous
allons, et je vais où Nito se trouve, mais celui-là m'a dit d'attendre, il a
403
�compris tout de suite ce que je voulais, celui-là [a dit] : « tu veux aller à
Jesudi », mais, intensément, je suis accablée par la tristesse pour mes
enfants, mais Umajno, je ne veux pas que mon mari s'en aille, mon mari est
vivant et je ne veux pas d'autre homme, il ne me voit pas, mais Sonia cellelà a dit : « Jnumi, il semble que nous ne retournerons jamais à Jesudi parce
que nous sommes très loin » [commentaire de Jnumi : elles se sont perdues
dans la station de bus], et celle-là m'a dit : « Jnumi, allons-y, et ne te fâche
pas avec Usigai celui-là » et [Jnumi a dit à Tujninia :] « Mère de Sonia, si
Usigai me frappe, je me fâcherai beaucoup avec son épouse [Umajno] » et
[Tujninia a dit :] « Jnumi, Usigai est méchant », mais j'ai dit à Tujninia :
« Mère de Sonia, je vais tout de suite chez Usigai », [Jnumi dit à Usigai :]
« Usigai, je ne veux pas d'autre homme » et je regarde devant moi mais je
vois ma parente clanique celle-là [Poro] et j'ai lui ai dit [Jnumi dit à Poro :]
« ma parente clanique, où sont mes enfants ? », mais ma parente clanique
m'a dit [Poro dit à Jnumi :] « ma parente clanique, Ebedu celui-là s'est fâché
» et vite, sans regarder, je vais et j'arrive où Umajno celle-là se trouve, et
j'arrive et je n'ai pas peur de son mari.
28. Ajideodaye irade, par Uejai Picanerai
Uengate que jnacari uñeque dei yajenique ome Ajideodai, Ajideodaye
uqueñeque uje que tagusu dejoingome dacote gapu quenejna uyoque ga que
ñamuase jnacari Ajideodai uñengomeñu que pachoc Ajideodaye
uñengomeñu uengate que jnacari ua sumajingai gajnetique que desi
ñajenique uñengome ore ayore piguiosode ore chiraja Ajideodaye uque
uñeque uringaique jnacari dicase uac ga que pamuañaque uñengo ome
ñoque ga Ajideodaye que jnacari dei yajenique uñeque to.
Sujet énonciateur : une fille
Intensément, il n'y a pas d'autre jeune homme dans mon intérieur mais
Ajideodaye, Aideodaye celui-là ne se fâche pas avec son épouse ni avec les
404
�filles étrangères, nous, et je n'oublie pas le jeune homme Ajideodaye, je n'en
ai pas assez de Ajideodaye. Intensément, un homme qui n'est pas courageux,
n'est pas dans mon intérieur. Les parents claniques connaissent Ajideodaye,
ils savent qu'il est courageux et nous n’oublions pas celui-là, Ajideodaye, il
n'y a pas d'autre jeune homme dans mon intérieur.
I.5 Uñacai, l’expression spontanée et structurée de la tristesse
1. Uñacai pour Golo Dosapé, par Poro Posijñoro
Chimojnoque, ñungu, chimojnoque asú pojnangue gapu paragueac ome
ñoque ga jê ure pise gajine, chisipie uajade dirica uringa case gapu etogue
dejaque ga uñaque que pojna ga uñaque que chinguira daicujatac aja
cheque quenejnane uyoque cojnai disi pujnuñasoe gajine ga chijnime
yedocatique ga gajine amate chise yoquidai case dejaque ga yajíe dajei
garatique dejai ga yajíe uñaque abubie sogoma ajesuique dirica ga uñaque
chijnorase yu ga chi uñaque deji etotiguei gajine putugutaoi
nequenojnangue date daye uñaque i ejode uñaque chisipie uringa case
etotiguei casode dejaque ga uñaque que chinguira daecujatac aja yoque
cheque quenejnane ga chijnime yedocatique.
Je pleure, je pleure, je pleure pour la fleur d'asú, la jeune fille [était] gentille
avec nous et je ne sais pas si c'est vrai [qu'elle est malade]. Autrefois, elle
était forte [etogue], forte la jeune fille et celle-là ne se fâchait pas, celle-là
n'utilisait pas de mots méchants contre nous, les femmes étrangères, la fille
est presque décédée maintenant et elle me fait pleurer maintenant fortement,
je suis arrivée à notre ancienne communauté [Poro habitait déjà à 15 de
Septiembre, elle arrive à Jesudi] et je regarde vers le chemin et je vois cellelà — les beaux bourgeons de courge — qui part hier, et celle-là était mon
amie et celle-là a de la force maintenant, la belle peau de tigre son père et sa
mère à côté d'elle, celle-là. Autrefois elle était forte et elle n'utilisait pas de
405
�mots méchants contre nous, les femmes étranges — qui n’appartenaient pas
au même clan ou au même ogadi, et cela me fait pleurer.
2. Uñacai pour Tujninia Cutamijñoro, par Jnumi Posijñoro
Oyopepacho gajine ga ñunguamu pedobicadedie tiachugué uaqué gajine /
amate gajine ga pitoningaique ujnienepise uña/que ome ñoque gajine
yucuingaique cuchpibose etogue uñangomeñu/ oguiyabape yu ome chaguei
urosoique gajine / ga yichapia yu a yoquirosori casicai yajie yiquenique
gajine ga ñimo pedobicadedie tiachugue gajine ga pijode chonaque gajine
ome ñu gajine ga uñaque nae gajine « Jnumi aja beite ga agu yibosode to
gajine ». Oguiyabape aquiajna utata yiquenique ayore piguiosi gajine
uñaque quinganingo gajine amate cho dojoaque cheque gajine ga que tagu
dejoi ome damanique igioto uaqué uyoque gajine ga pamuaña ome ñu
gajine.
Taisez-vous maintenant, je suis en deuil de celle-là, le beau dessin de tissu
de caraguatá, elle était belle et la mort a pris celle-là, très belle pour nous,
maintenant il n'y a pas de nourriture pour moi comme [quand elle était]
forte. Je pleure pour la faim qui fait du mal, et je me souviens de notre
ancien patron et je regarde devant moi et je vois le beau dessin de tissu de
caraguatá, et la tristesse s'arrête pour moi maintenant et maintenant celle-là
dit : « Jnumi, prends ça et mange ma nourriture maintenant. » Je pleure pour
la vache noire devant moi, un parent clanique qui est resté derrière celle-là
maintenant. Elle était très gentille cette femme-là et elle ne se fâchait pas
avec la parente clanique de son mari, nous maintenant, et je pense à elle tout
le temps maintenant.
406
�3. Uñacai pour Tie Picanere, par Jnumi Posijñoro
Oyopepaque gajine ga ñunguamu cutema tuaqué yocujo cheque gajine ga
chi uñaque dei dagaitique cuchapigaite gajine ga uñaque dei dapaganejnai
ome ñu gajine ga « Jnumi aja beite gajine ga bé majnei gajine » ga uñaque
chosite duasede oguiyabape yu iji bora poro, bora poro tuaque yocujo
cheque uñaque uyoque i quiganingo gajine ga uñaque doipise dategoningai
case gajine ga pamuañase uñangue omeñu gajine ga oguiyabape aquesua
tiachutigo ujnacarode iji quinganingo gajine oguiyabape atigo
aquesuñachutigo disidacabio ore gajine ga ca chi uñeque dei siñeque gajine
ga ñimo uñaque ga bora poro ga yujo cheque gajine ga cuchachungu
enoñaique ujnienepise uaqué abubié sogoma yujocheque duasede uñase
deiasi dategoningai ome ñu gajine ga chise uje yico cuchapigaitigo duasede
ga uñaque « majneque ude ga e yata ua ga ñingau bequedie dajnui gajine »
ga je ure pise pitoningaique enoñangue.
Taisez-vous maintenant, je suis en deuil de cette belle femme-là, et [dans la
phrase qui suit, Jnumi refuse d'accepter le décès de Tie] celle-là doit être en
train de chercher du miel et du caraguatá maintenant, elle doit être en train
de se promener pour moi. [Tie avait dit :] « Jnumi, prend cela et apporte ce
qui t'appartient maintenant », et celle-là a fait comme ça autrefois. Je pleure
pour les vêtements blancs, les vêtements blancs, cette femme-là, derrière
laquelle nous sommes restés, et celle-là était très généreuse et je pense à elle
tout le temps maintenant, et je pleure pour le bel arc-en-ciel, ses enfants qui
sont restés derrière maintenant, je pleure pour ses enfants maintenant, les
beaux arcs-en-ciel, et peut-être elle est ailleurs et je vois celle-là, les
vêtements blancs, cette femme-là, la maladie laide [a pris] la belle femme,
les beaux bourgeons, la femme autrefois, celle-là me donnait des choses, elle
n'est pas là maintenant pour moi. Une fois, nous sommes allées chercher du
caraguatá, et celle-là [a dit] : « cela t'appartient, je t'aiderai et je ferai du fil
avec ton caraguatá » et je ne sais si c'est vrai, que la mort laide l'a prise.
407
�4. Uñacai pour Puchiejna Dosapei, par Sidi Posorajãi
Oyopacho ga ñunguamu putugutaroi nequenojnangue.
Amate cho cuchachungunique ga je piquetac.
Oguiyabape dutue penojnangue ñajnami iji jnani uecaique ujnaigo.
Oguiyabape chuguperenatei ama poro yuo,
Oguiyabape uñaque namanique quiganingo.
Taisez-vous… ! Je pleure pour la belle peau du jaguar
Sa maladie est très forte et il n’y a pas de remède
Je pleure pour mon petit-fils, la belle calebasse, qui restera parmi les
hommes vivants.
Je pleure pour la plume blanche de la cigogne, ma fille.
Je pleure pour celle-là qui est restée derrière son mari.
5. Uñacai pour Golo Dosapé, par Jnumi Posijñoro
Oyopepaque gajine ga ñunguamu aquesu tíachutiguei, ñunguamu cutema
tuaque aquesu tiachugue yocúo uñaque gajine amate cho dojoaque gapu
gajine ga uñaque que chinguira daecujate urosorac aja cheque quenejnane
uyoque gajine oguiyabape auata date yabai uyoque gajine chaguenique
urosoique gajine amate gajine ga uñaque cho dojoaque gapu gajine ga
pamuaña omeñu auatadatei yabai uyoque gajine uñaque oguiyabape
congopiejna uñeque daye ejodie ica gajine amate cho dojoique jnani gajine
jê pamuañac uñeque punope urosoique chejnañoque gajine oguiyabape
coongopiejna ojo songoma disidacabia gajine ga uñengo uñaque igioto iji
quinganingo cuchachungunique enoñai ujnienepise gajine ga je ure pise
gajine ga uñaque mijna omeñoque to gajine amate cho dojoaque gapu
gajine que yayipiedoi ipojnaqueingo omeñu gajine ga chisipie ore irosori
ica ga uñaque naeque « Jnumi aja beite gajine ga a yii platadie ga Ebedu
gajne gajine » uengate.
408
�Taisez-vous maintenant et je pleure pour le bel arc-en-ciel, je pleure pour la
belle celle-là, le bel arc-en-ciel notre fille maintenant, la fille était très
gentille avec nous et elle n'utilisait pas de mots méchants contre nous, les
femmes étrangères. Je pleure pour mon mari, celui-sans-peur [référence au
tigre, edopasai des Dosapei], nous, et la faim fait du mal, elle était gentille
et généreuse et nous ne l'oublierons pas, mon mari celui-sans-peur et moi. Je
pleure pour celui-là, les bourgeons de courge, son père, qui était toujours à
côté d'elle, il est gentil cet homme, il ne l'oublie pas, la douleur de la
tristesse nous épuise maintenant, je pleure pour la jeune fille, les beaux
bourgeons de courge, les fils pour la parente de celle-là qui sont restés
derrière. La maladie laide [a pris] la fille très belle et je ne sais pas si c'est
vrai que celle-là s'est perdue pour nous [elle a disparu] maintenant, elle était
très gentille cette jeune fille, je ne me souviens pas qu'elle se soit fâchée
contre moi maintenant et autrefois, [au temps de] son ancien patron, celle-là
a dit : « Jnumi, prend ça et je te donne de l'argent pour Ebedu maintenant »,
intensément.
6. Uñacai pour Fibai Dosapei, par Jnumi Posijñoro
Ñunguamu uñeque gajine ga oguiyabape yu ome icanigatiguei uje di
yocuniri to ude gajine congopiejna yabaiñai. Ca chi uñeque dei siñeque
gajine ga « yisabi aja bei ga ase yuguchade » uñeque oguiyabape auata
dateraque yabai uyoque i quinganingo gajine ca chi uñeque dei
dapaganejnai oguiyabape aquesua tiachutigo ñujnacarode i quinganingo
gajine ga amate ayore que yitogoi gajine ga que ñijningopoi ome yocatique.
Yichapia yu aja uniri case ga yajiome uñeque abubir sogomaque gajine ca
chi uñeque dei dapaganejnai daruode omeñu gajine ga maisabi choique to.
Je pleure pour celui-là maintenant et je pleure pour celui-là, généreux, qui
est arrivé à notre territoire, maintenant, mon beau-frère, celui-beaucoup
bourgeons-de-courge. Peut-être il est ailleurs maintenant et [Fibai a dit à
Ebedu :] « mon frère cadet, prend ça et prend mes choses » celui-là, je
409
�pleure pour celui-sans-peur [référence au tigre, edopasai des Dosapei], mon
mari, et nous sommes restés derrière maintenant et peut-être il est en train de
se promener maintenant. Je pleure pour les beaux arcs-en-ciel, mes enfants
qui sont restés derrière et les Ayoreo nous savons que quand nous mourons,
nous ne retournons pas chez nos enfants. Je pense à notre territoire avant et
je vois celui-là, qui est beau et peut-être celui-là est en train de se promener
maintenant, ses mots pour moi maintenant et ton frère cadet fort aussi.
7. Uñacai pour Cajoidate Chiquejñoro, par Jnumi Posijñoro
Oyopepaque gajine ga ñunguamu ga inguiane pejnungongue tuaqué ayoré
nequeó. Amate ayore duasede cojnaite pitoningaique chijnime yedocatique
duasede pamuaña uñangue omeñu gajine oguiyabape yu ome uñaque
yujoraque cheque isatique pigaidode gajine ca chi uñaque di dasatique
cuchapigaite ga uñaque nae gajine ga « Jnumi aja beite ga agu yiquibosode
udo to gajine » oguiyiabape inguiane pejnungongue tuaqué ñeó duasede
gajine ga je uré pise gajine uñaque ejnarataque datei chequesa uñaque
duasede pitoningai enoñangue ujnienepise uñaque cutema tuaqué inguiane
pejnongongué ca chi chise yoquidaiode ga uñeque nae duasede naome
aquesutia tiachutic disidacap doi dapaganejnai gajine « angome Jnumi ‘ajai
ti ga ajose papaigatojna ome mamá’
». uñaque chosite duasede ga
oguiyabape pujnusietigai uroso ca chi uñaque doi dapagadode daruode ome
ñu gajine. Oguiyabape yu ome cheque ueca gajine ca chi yajíe yiquenique
un ñimo uñangue gajine ga pijode chónaque gajine oguiyabape ñu ome
inguiane pejongongue tuaqué.
Taisez-vous maintenant, et je pleure pour la belle herbe celle-là, la sœur
ayoreo. Elle était belle, la femme ayoreo, ça fait un temps elle est décédée et
je pleure pour elle, je ne l'oublie pas, je pleure pour cette femme-là qui
cherche du caraguatá maintenant et peut-être elle est en train de chercher
des choses dans la forêt et celle-là a dit : « Jnumi, prend ça et mange ma
nourriture maintenant », je pleure pour la belle herbe celle-là, ma sœur, ça
410
�fait un temps et je ne sais pas si c'est vrai qu'une grande maladie a pris cellelà, ça fait un temps et la mort laide [a pris] la femme très belle celle-là, la
belle herbe, elle est arrivée à nos communautés et elle a dit avec des beaux
mots à son fils le petit bel arc-en-ciel : « dis à Jnumi : 'vas-y et rempli la
calebasse avec du miel, pour maman et pour papa' ». C'est comme ça qu'elle
a fait, ça fait un temps. Je pleure et la tristesse me fait du mal, celle-là me
disait de beaux mots, maintenant je pleure parmi les femmes vivantes et je
regarde devant moi et je vois celle-là maintenant et la tristesse s'arrête
maintenant, je pleure pour la belle herbe celle-là.
8. Mese agoyedie, par Jnumi Posijñoro
Uengate yaquiningai pujnusietigaique ujuyapise ome ayoré ñucuñaña ayore
dacate casica. Cuchamaringa que yibotique, yajie guede a jnumi ga
pujnusietigaique ujuyapise yu ga yijoque quede a jnumi ite suaque ñimo
ayoré nequeó suaque ñimo ayore nequeó tuaqué uguchaingo yiagoye date
ñae ome ayoré nequeó suaque ga yajíe guede garatic ga ñimo yabaiñai mu
ayoré pijnongamia Rosana suaque chise yoque ga naeque « Mese cuchaique
gu uje babopise? » naeque « Rosana yibo gu ore uruode chise yoque ga chi
ayore nequeamia toi pise » ga ñaeque ga « a ñañujna, Rosa, a yiipisi coñone
ga jecucha jetiga yitata i erami » uengate pujnusietigaique ujuyapise yu ome
ayore nequeamia suaque yajie uguchade ga yiagoye datei mu yajíe dajei
garatic mu ñimo ayore nequeamia apaganejnai dabai ga pijode chonaque
ome ñu. Yajíe guede garatic mu ñimo ayore nequeamia apaganejnai dabai
ga pijode chonaque ome ñu. Yajíe guede garatic ga yajíe guede sutigo ga je
ue pise Jnumi suaque naosiomeñu « Mese agu comida, godogap ua » Jnumi
suaque naome ñoque « jetoque ti Golo uaqué toi » uengate.
Sujet énonciateur : Mese (sœur de Golo, jeune fille qui est à l'hôpital)
Je suis très triste lors de ma randonnée [chez Pojnangue], je suis accablée
par la tristesse pour ma sœur et ma mère. Je mange mais j'ai encore faim, je
regarde le soleil qui est près de la terre [elle regarde le temps passer] et je
411
�suis accablée par la tristesse et je veux que le soleil arrive à l'horizon et que
ma mère arrive, je vois ma sœur, je vois les choses de ma sœur et mon cri est
énorme, je regarde le chemin [elle attend quelqu'un] et je vois mon beaufrère [mais sa sœur ne vient pas avec lui], et l'amie Rosana est arrivée chez
nous et elle a dit : « Mese, pourquoi pleures-tu tellement ? », et j'ai dit
[Mese] : « Rosana, je pleure parce que leurs mots sont arrivés chez nous et
ils disent que ma sœur est très décédée », et j'ai dit [Mese] : « je me
prostituerai, Pojnangue, j'irai avec beaucoup de Blancs et je mourrai »,
intensément, je suis accablée par la tristesse pour ma petite sœur, je regarde
ses choses et mon cri est énorme, et je regarde le chemin et je vois ma sœur
très belle avec son mari, et la tristesse s'arrête. Je regarde le soleil qui
descend, et Jnumi a raison quand elle dit : « Mese, mange de la nourriture, tu
es très mince », Jnumi nous a dit : « Golo ne mourra pas », intensément.
9. Manene uñacai, interprété par Caitabia Picanere
Yico ga yayipiedoi ca chi date dei yiquenique chaguei urosoi chejnañu ga
chaguei chejna yise Jutaguedate gajine ga yaose yugueape ga gajine ca chi
uñaque dei yiquenique chaguei urosoique gajine ca chi uñaque dei
yiquenique gajine ga yaose yugueape gajine chagueique chejna ñu ga
joguiyabape coongone tiotique uquide neonie ore uyoque iji cheque uecaque
cuchapisatique gajine ca chi uñaque dei siñeque diri noñai to gajine ca chi
uñeque chosite gajine ga carataque aroi ueradi yái uñeque uyoque gajine
ome cheque isagoqueac gajine ome uyoque gajine yojoguisite ome uyoque
ca chi uñaque dei siñeque gajine ga ñimo [uate] iji yiquenique ca chi
inguiane pejongongue tuaque ite dei yiquenique gajine ga ñimo uñaque
abubie sogoma uñaque gajine oguiyabape dutue asigueac uerade case
uquide nequeonie uyoque gajine cheque isagoqueac ore maneigui ome
yapade uqué gajine oguiyabape auata pejungongue gajine ome cheque
uecaque gajine ore pisatique cuchapisangome uyoque gajine.
412
�Allons-y et peut-être la mère est devant moi et la douleur de la faim
m'épuise, et j’ai faim et je suis allé chez Jutaguedate et j'ai épluché une noix
de coco et peut-être celle-là est devant moi et j'épluche une noix de coco
maintenant, j'ai faim et je pleure pour les beaux bourgeons de courge, mes
sœurs et nous, parmi les femmes vivantes et les aliments, peut-être celle-là
est ailleurs, c'est un jour laid et celui-là a fait comme ça, la belle peau de
tigre, mon père et nous, pour cette femme qui travaillait beaucoup,
maintenant j'ai dit comme ça pour nous, peut-être celle-là est ailleurs, et je la
vois devant moi et elle est une belle herbe, ma mère, devant moi, et je vois
celle-là, les beaux bourgeons de courge maintenant et je pleure pour les
beaux fruits de courge, mes sœurs et nous maintenant, la femme qui
travaillait beaucoup, ses orphelins, pour mon père je pleure maintenant, je
pleure pour le beau-sans-peur [référence au tigre, edopasai des Dosapei]
parmi les femmes vivantes maintenant, ils ont trouvé de la nourriture
maintenant.
10. Checabiade uñacai, interprété par Sidi Posorajãi
Ñunguamu cuchapijoguode dateraque uque yesaque jnupe chagüi ujniete
uñeque gajine. Yisapie yu ga ñipojna uñeque ga yayipieraque doasi
aicujatac urosorac ga yibeo yu ome pujnusietigaique ome uñeque yibeo uyu
iji pujnusietigaique gajine iji quigade jetiga yayipiedoi yaicujatac uroso
uñeque. Yichapia yu aja yacajnaminone casode ga uñeque baque uñeque di
dagatoja cutêi udi iji yu dirica. Yichapia yu aja tiegosode yoquitojaite
casica nanique « yotabidi uroso » « bo beyoi yigueite ga acayoji ».
Je pleure pour le caracara mon frère cadet, la terre est laide pour celui-là
maintenant. Si je m'étais fâché contre celui-là et je me souvenais de mots
méchants, je serais peu triste pour celui-là, j'aurais peu de tristesse pour être
resté derrière, si je pense aux mots méchants de celui-là [mais Tamocojnai
n'était pas méchant avec Checabiade, c'est pour cela que Checabiade est
tellement triste]. Je pense à nos jeux autrefois, et celui-là est allé à la forêt et
413
�il m'a apporté une calebasse remplie de miel. Je pense à notre guerre contre
les Tiegosode autrefois. [Aeguede a dit :] « j'ai mal à la jambe » [et
Tamocojnai, très courageux, a dit :] « Allez-y et restez là » [Tamocojnai est
resté sur le champ de bataille, permettant à ses amis de s’échapper]
11. Uñacai pour Ebedu Dosapei, par Jnumi Posijñoro
Oyopepaque gajine ga ñungamu cutemai case yabai uñeque gajine amate
cho dojoique jnani gajine ga que chinguira daecujataque uroso ga ñungu
gajine cojnaite ga cuchachungüe duasede ga chijnime yedocatique ga
oguiyabape, ñungu aquesua tiachutigue yabai ucode ñeque gajine ca chi
deji uñeque iji tamajaningai gajine ga uñeque naome ñu gajine ga « Jnumi
aja beite gajine ga aja beite gajine a yii platadie gajine » ga oguiyabape
coongopiejna yape uyoque i jnani uecaique quiganingo oguiyabape aquesua
tiachugo disidacabio ca chi dei dojoique jnani iji tamajnaningai gajine ca
chi oguiyabape auata dateraque disidacabio i jnani uecaique ujnaigo iji
tamajnaningai ga oguiyabape aquesua tiachutigo ca chi uñeque dei
tamajnaningatique gajine ga uñeque doi dapagade daruode omeñu gajine
yichapia yu a yoquirosori idai case gajine ga yajiome uñeque gajine uñeque
doi trabajadi icaite, ca chi uñeque dei siñeque gajine ga auata date yabai iji
tamajnaningane ga que chinguira daecujate urosorac
Taisez-vous maintenant, je pleure pour celui qui avant était fort, mon mari
maintenant, il était gentil cet homme-là maintenant, il ne se fâchait pas avec
moi et je pleure maintenant, très malade, et la maladie l'a pris ça fait quelque
temps, et cela me fait pleurer et je pleure, je pleure pour le bel arc-en-ciel
mon mari et peut-être il est en train de travailler maintenant, et celui-là a
dit : « Jnumi, prend ça, prend ça et je te donne de l'argent », et je pleure pour
les beaux bourgeons de courge, mes enfants et nous, nous sommes restés
derrière, parmi les hommes vivants, je pleure pour le bel arc-en-ciel mes
enfants, et peut-être cet homme-là est en train de travailler et je pleure pour
celui-sans-peur [référence au tigre, edopasai des Dosapei] mes enfants parmi
414
�les hommes vivants, et je pleure pour le bel arc-en-ciel, peut-être il est au
travail, et il avait de beaux mots pour moi et je pense à la ville de notre
ancien patron [Loma Plata, communauté de mennonites] et je vois celui-là
maintenant, celui-là travaillait là-bas, peut-être il est ailleurs et celui-sanspeur mon mari est au travail, il n'utilisait pas de mots méchants contre moi.
12. Edabia uñacai, interprété par Sidi Posorajãi
Yajíe yabai ujode jnani ujade ga penocha uñamio ome pamoi tiachugue
yabai ga yichapie yu aja yoquitie caside ga ñajiome enoaque ueradi yabai,
yuguedie gai iji ñacorenie ga « ajnime ga asiome batate uñaque »
Je regarde les hommes et je ne vois mon mari parmi eux, le beau pamoi, et je
pense à notre ancien patron et je vois le beau caracara mon mari, il a tué
deux pécaris et [il a dit :] « enlève une partie et donne-la à ta sœur ».
13. Uñacai pour Yoeja, interprété par Caitabia Picanere
Ga je ure pise gajine ga Yoeja toi, uaqué toi gajine uñaque. Ga je ure pise
gajine ga uñaque toi gajine Yoeja tuaque ga chi uñaque dei siñeque gajine
ga ñimo uñaque enochai goningajai gajine Yoeja tuaqué gajine ga ca chi
inguiane pejongangue ga tuaqué dei disia ujnanique gajine ga ñimo uñaque
gajine ga pijode chonaque ome ñu gajine ga je ure pise gajine ga enocha
ueradi uaque toi ome ñoque. Oguiyabape yu inguiane pejongongué uaqué
yocabia ore ujnaigo gajine ga disi uecaigo gajine ga ñajiongomeque
Yoejadate uaque ayoweidate « ajíe Yoeja tuaque yuode gajine, macamoño
ñucuingane pingoijonguei » yojoguisi udoe ome Yoejadate uaque.
Oguiyabape yu iji uñaque quinganingo gajine inguiane pejnongongué uqué
dayé uñeque jnusi ome ujnaigo disi uecaigo ujnaigo gajine ga yojoguisi
udoe ome yoejadate uaque gajine ga ca chi ñimo ujoique disi enochai
uyoque ñeque ore ujnaigo enga ñimo uñangui ore ujnanique gajine
415
�oguiyabape yu ujode disi ueca ujade gajine ga ca chi ñimo uñangui iji
uñeque ore ujnaigo gajine ga pijode chonaque ome ñu gajine uñaque toi
duasede, uñaque dei yejoi iji siñeque gajine.
Je ne sais pas si c'est vrai que Yoeja est décédée, celle-là est décédée
maintenant. Je ne sais pas si c'est vrai que celle-là est décédée, Yoeja, cellelà, et [je me souviens de] celle-là ailleurs et je la vois très belle, Yoeja cellelà, et [mention aux edopasade non identifiés], celle-là parmi les filles
vivantes, et je vois celle-là maintenant et la tristesse s'arrête, celle-là très
belle est décédée pour nous. Je suis triste pour [edopasai des Chiquenoi],
notre fille parmi les filles vivantes, j'ai dit à la mère de Yoeja « regarde
attentivement Yoeja, tu ne vois pas que nos ennemis sont là ? ». J'ai dit ça à
la mère de Yoeja. Je suis très triste pour celle-là qui est restée derrière,
[edopasai] son père, elle manque à son père, parmi les filles vivantes, et j'ai
dit ça à la mère de Yoeja, celle-là, et je vois la fille très belle parmi tous, et
je la vois parmi eux. Je suis très triste parmi les filles vivantes maintenant, et
je la vois maintenant parmi elles maintenant et la tristesse s'arrête. Celle-là
est décédée ça fait un temps, elle est ailleurs à côté de moi [image d'un
souvenir] maintenant.
14. Uñacai pour Teciode Chiquenoi, par Jnumi Posijñoro
Ñunguamu inguiane pejnongongue uqué ñisaraque pujnusietigai urosoique
gajine ca chi uñeque nanique nae ome dategoningai ome ñu gajine ga nae
gajine ga « Tercio bei ga
bei cuchapibose bei gajine ga agu gajine »
oguiyabape uñeque i quiganingo iji jnani uecaique ujnanique gajine amate
cho dojoique jnani ga je chinguira daecujat uroso ga ujnacarode gajine ga
pamuañac uñengo uyoque gajine ga chise ñiringo ore idai casica nae
duasede ga « Tercio bei gajine, aja yiplatadie udi gajine ga beyoi bacabotic
ome bejo » oguiyabape inguiane pejongongue uqué ñisaraque ga uñeque
pujnusietigaique ujuyapise uñeque ga amate uñeque yitogoi gajine ga que
416
�ñiringopoi ome uñane ga uñeque gajine oguiyabape inguiane pejongongue
ñisaraque ucodeñeque gajine cuchapibotique eruenique.
Je pleure pour la belle herbe, mon beau-fils, la tristesse fait du mal
maintenant et celui-là a dit pour qu'on partage avec moi, maintenant, et il a
dit : « Tercio, prend la nourriture et mange ». Je pleure pour celui-là, [nous
sommes restés] derrière, parmi les hommes vivants maintenant, il était gentil
cet homme et il n'utilisait pas de mots méchants contre ses fils, et nous ne
l'oublierons pas. Une fois, nous sommes arrivés à son ancienne communauté
[Campo Loro] et il a dit : « Tercio, tiens, prend mon argent et apporte de la
nourriture pour ta belle-mère », je pleure pour la belle herbe, mon beau-fils
et celui-là est accablé par la tristesse et intensément, nous mourrons et nous
ne retournons pas avec les autres, et celui-là maintenant, je pleure pour la
belle herbe, mon beau-fils maintenant, c'est la fin de la nourriture.
15. Uñacai pour Ebedu Dosapei, par Daju Picanere
Ñunguamu coongopiejna tiotigo gajine amate gunoí ute ducose cho gajine
gajine dojoique ducose gajine ga chicha dabotique ore ayore aja
nocunirique gajine. Oguiyabape atigo ore uyoque i quiganingo gajine.
Amate dacaía tuaque chuguperenate unonucâe tuaque yape cho gajine
uñeque que tagu dejoi ome uñaque gajine chise yoquiningane casode i
dejaque ga uñeque naome yatigui ore uyoque « yicaía atatayo uaque jeti
chagueique chejna uaque ga yii uacabotique cuchapibose etoquei » yichapia
yu aja yoquioto casicaite abuja ga yajiome uñeque gajine yajiase yiquei ga
ñimo uñengui i yiquei uñeque ojotiogue yiquenique yoquiengoi casodicaite
gajine.
Je pleure pour les beaux bourgeons de courge, ses enfants maintenant, la
maladie forte, la maladie ducose est forte et elle a pris l'Ayoreo dans notre
territoire. Je pleure pour ses enfants et nous, qui sommes restés derrière. Elle
est forte sa belle-fille, cette cigogne ma fille, il ne se fâchait pas avec elle
maintenant, ça fait longtemps il nous a dit : « ma belle-fille, dites-moi si
417
�vous avez faim et je vous donnerai de la nourriture », je pense à notre ancien
patron et je regarde celui-là, et je regarde devant moi et je le vois devant
moi, il est bien devant moi dans notre ancienne maison.
16. Aube uñacai, interprété par Jnumi Posijñoro
Oyopepaque ga ñunguamu uqué oguiyabape yu ome nasaruinate yabai
uñeque. Ca chi uñeque gajine deji dapagadode daruode ome ñu gajine ga jê
ure pise ga pocaningai enoñangue chuje nasarunatei yabai gajine.
Oguiyabape pedobicade tiachugue disidacape jnani uecaique ujnaigo gajine
ga yichapia yu aja gajine yoquirosori casica deji dapagatique daecujate
gajine ga « Aube a gajine be baplatadie » gajine uñeque chositomeñu
gajine. Oguiyabape yu ome tujnite datei yabai uñeque piosomanejnai ca chi
e déji siñeque. Oguiyabape yu ome nasaruinatei yabai uyoque gajine ga
jetiga jê ure pise gajine chisipie uje nae duasede « Aube a ca chi ayoreode
yocuruo, jê ñanguretago Dupade, apesu yibotique ga yii tabajadite ome
bajate ejnarataque » uñeque chopisite duasede ga jê ure pise ga
pocaningaique erueminonique chuje nasarunatei yabai ucodeñeque.
Taisez-vous, je pleure pour celui-là, je pleure pour le grand serpent nasaru,
mon mari celui-là, celui-là avait de beaux mots pour moi et je ne sais pas si
c'est vrai que la guerre laide a tué le grand serpent nasaru mon mari. Je
pleure pour le beau dessin de tissu de caraguatá, ses filles, parmi les
hommes vivants et je pense à notre ancien patron [à Neuland] et les beaux
mots « Aube, maintenant prend ton argent », celui-là a fait comme ça avec
moi. Je pleure pour le grand arbre tujni, mon mari celui-là, il était redouté,
peut-être il est ailleurs. Je pleure pour le grand serpent nasaru mon mari et
je ne sais pas maintenant, je me souviens quand il a dit autrefois : « Aube,
les Ayoreo nous mentons, nous ne croyons pas en Dieu, prépare mon repas et
j'irai travailler pour ta sœur aînée, [car] elle est malade ». Celui-là a dit
comme ça, et je ne sais pas si la guerre finale a tué le grand serpent nasaru
mon mari.
418
�17. Uñacai pour Puchiejna Dosapei, par Jnumi Posijñoro
Oyopepaque gajine ga ñunguamu cutemai tuqué ñujnacari gajine.
Oguiyabape yu iji auatadatei yabai uyoque gajine i quiganingo jnacari
ujadode i quigade gajine ca chi yajiase yiquenique iji yoquidai. Oguiyabape
coongopiejna ojosogoma yabi uyoque i quiganingo gajine pitoningai
enoñaique ujnienepise. Oguiyabape yu iji cutema case ñujnacari i
quiganingo gajine pitoningai enoñangue ujnienepise aquesua tiachutic yape
uñengomeñu ga ca chi uñeque dei dojoique jnacari ajnamitic ga uñeque
naiase omeñu gajine « mama yoquicho i yocajnamite date » yichapia yu aja
yoquirosori casicaite ga yajíe putugutaroi penojnangue ñujnacari uñeque
gajine ga ñimo duasede uñeque i yiquenique gajine ga uñeque doi
dapaganejnai daecujat ome nanique uyoque ca chi uñeque dei siñeque
gajine. Oguiyabape aquiajna ojosogoma yacaía gajine chaguei urosoique
ujnienepise uñaque gajine uñeque nae « aja bei ga agu yigaidode
cuchapibose ». Oguiyabape ome uñeque ategoningai uñeque ategoningaique
cutema case ñujnacari uñeque.
Taisez-vous, je pleure pour mon fils, il est beau, maintenant. Je pleure pour
celui-sans-peur [référence au tigre, edopasai des Dosapei] mon mari, et
nous, nous sommes restés derrière, parmi les jeunes hommes et je ne le vois
pas devant moi dans notre communauté. Je pleure pour le beau bourgeon de
courge, mon fils et nous, nous sommes restés derrière. La mort très laide a
pris celui qui était très beau. Je pleure pour celui qui avant était beau
derrière et la mort très laide a pris celui qui était très beau, très bel arc-enciel mon fils, peut-être il est en train de jouer avec les jeunes et celui-là m'a
dit : « maman, nous avons gagné notre match important ». Je pense à notre
ancien patron [à Loma Plata] et je vois mon fils, la belle peau de tigre et je
vois, autrefois, devant moi et celui-là nous apportait de beaux mots et peutêtre il est ailleurs et je pleure pour la belle vache ma nièce celle-là, très
belle, la faim lui fait du mal et celui-là a dit « tiens, mange mon repas », je
pleure celui qui était beau et généreux avant, mon fils.
419
�I.6 Yasitigai, « je suis ravie »
1. Yasitigai ome Ebedu, par Jnumi Posijñoro
Uengate, jê ure pise, yocanganejnai Jesucristo uje chiqueta disigajnamenie
ore daquide ome uyoque aja que yirajaque cuchadacadode uje ñae ome
disidacabode ga uengate yasiguipise uyu ome yocanganejnai Jesucristo.
Disidacabia nae ga « ite ajocha Dupade angüesone » –viento- uengate
yasitigai garañi tu yocurasa ñane. Que taague pise ñu ome yocurasa ñane,
ore angüenejna Jesucristo uje chiqueta disidacabode ore daqui casicaite
ome ñu um uengate ñae duasede que taague pise ñu ome ñujnacarode ore
gajine Dupade ajegaite ore ome ñujnacarode ore idaiode yijocha ore
anganejnai uengate yocujode ayore beyoi gajine ga angacho, angachopise
uje jê cho nequejnarai ajatiq ome ñajnamenie daqui casica uñengo,
yocanganejnai Jesucristo chiqueta pise uñengome uyoque duasede ga
yasitiga garapi yocuasa ñane iji ore idaiode beyoi gajine ga angacho pise
macanganejnai Jesucristo uje chiqueta disdacajnamenie ore daqui casica
ome ñu.
Intensément, c'est très vrai, notre seigneur Jésus-Christ qui a guéri le grandpère des enfants pour nous, j'en sais beaucoup quand je dis aux enfants et
fortement, je suis ravie pour notre Seigneur Jésus-Christ. La fille a dit : «
maman, appelle à ceux qui croient à Dieu », fortement mon bonheur vient de
nos compatriotes dans les autres communautés. Je ne mens pas à nos
compatriotes des autres communautés, ils croient à Jésus-Christ qui a guéri à
l'ancien grand-père des enfants pour moi, j'ai dit autrefois, je ne mens pas à
nos jeunes, maintenant ils sont prédicateurs de Dieu pour nos jeunes dans
leurs communautés, j'appelle le Seigneur [Jésus-Christ] fortement tous les
Ayoreo, allez et écoutez beaucoup, il n'y avait pas de maladie comme celleci, celle de l'ancien grand-père de mes petits-enfants celui-là, notre Seigneur
Jésus-Christ a guéri beaucoup celui-là pour nous ça fait un temps et le
bonheur, nos compatriotes des autres communautés dans leurs communautés,
420
�allez et écoutez beaucoup votre Seigneur Jésus-Christ, qui a guéri l'ancien
grand-père des enfants pour moi.
2. Yasitigai ome Ebedu (deuxième version), par Jnumi Posijñoro
Uengate, yiyasiguepise uyu uje yocanganejnai Jesucristo chiqueta
disidacajnamenie ore daquide ome ñu gajine que taague pise yu ome
ñanguretigai ome yocanganejnai Jesucristo que ñajneninga ome yocurasa
ñane uje disidacabia nae duasede « mamá ayoja Dupade angüesone iji
Campo Loro gajine macamo a uje ore etotiguei ome ayoreode que ore cho
pac iji dapacatic ome yocanganejnai Jesucristo » (commentaires) cucha
chungunique chojninga aja dajesuique ome disiode ore daye duasede nae
ome ore daquide duasede « Jesucristo angüesone ore chiqueta yabai to »
Fortement, je suis ravie, car notre Seigneur Jésus-Christ a guéri le grandpère de nos petits-enfants maintenant, je ne mens pas au croyant pour notre
Seigneur Jésus-Christ, je pense à nos compatriotes des autres communautés,
car la fille [Pojnangue] a dit : « maman, ceux qui croient à Dieu à Campo
Loro, ils donnent de la force aux Ayoreo, ils ne se taisent pas [ils n'arrêtent
pas de prier] dans l'église pour notre Seigneur Jésus-Christ. La maladie a dit
que le père des enfants ne mourra pas encore, elle dit à son grand-père «
ceux qui croient à Jésus-Christ ont guéri mon mari »
3. Yasitigai ome Chaguadaye, Juan, Disiejoi, par Poro Posijñoro
Chimojnoque yasitigai,
yisape yasitigai ome Chaguadaye uñeque uje Chaguadaye uñeque gajneque
yasitigai tude uje chimate najnorane ome dagaidode Dupade uruode dojode
ayore ore.
Cuchiyiode uñai tu Juan uqueñatic. Juan suque gajneque yasitigai ome
Jesucristo iroqueode ore chimate dagaidode.
Cuchiyi tuqué Disiejoi chimojnoque Disiejoi ore itamajnaningai etoque ome
Jesucristo.
421
�Ñujnacari gatode gajneque yasitigai Jesus yoquiroqueode i erami uje ore
chimate datatagode Jesus.
Je suis ravie
Chuguadaye me rend joyeuse, c’est à lui que mon chant de joie est dédié,
il enthousiasme pour la parole de Dupade à ses amis et à tous les Ayoreo.
Juan est fort avec la parole de Dupade, et mon chant est dédié à lui, les
apôtres de Jésus-Christ. Ils enthousiasment avec la parole [de Dupade]
Disiejoi est fort avec la parole de Dupade, Disiejoi et eux, ils travaillent
pour Jésus-Christ.
Mon chant de joie est dédié à mon jeune fils, nos apôtres de Jésus vont
partout, ils enthousiasment avec la parole de Jésus.
I.7 Versículo, un irade-sarui en code chrétien
1. Versículo : histoire de la femme qui a touché la tunique de Jésus,
interprété par Jnumi Posijñoro
Chi cheque uate que chiraja dasocai ome nejnarai ga chi Jesus acadigode
ore chise cheque ga chi ore chingome cheque « coñoi deiti ga chiqueta
coñone edopaigode » ga chi cheque tuaté ga chi « yijiape ga yibagabi
gotique to » ga chi cheque que chajíe cuchaique chi cheque tuate chejna
daguchade a naijna porode ga chi cheque tuate que chiraja dasocai ome
nejnarai ga jno ga chajnajni Jesus chi chajnajni Jesus mu acadigode ore
iagu ejode ga chi chojninga « uengate » ga chi châchê Jesus igide eruei ga
chi jeaque iyode chonaque ga chi cheque chojningame « atigati yisapise
quejni… ! » ga chi cheque iyode chonaque ga chi chojninga « atigati ga
yisapiseque…! » ga chi Jesus chojninga « yajeode jeti ñimopise cheque
coñoque tuaté » mu chi Jesus acadigode ore chojninga « yocacanisori
macamoa cojñonguemui ñinguiango ñane gatoidie uñane » chi coño chi
Jesus chojninga « bo jne mu ajacamopoi cuchaique ome ua jne » chi cheque
tuate jno chajnaji Jesus iquei ga chi jogadi cheque tuate chichaga
422
�dagataidie a jnumi i Jesus iquei ga jogadi chatata dasocai ome Jesus ga chi
cho ta ta.
On dit que cette femme ne savait pas quoi faire avec sa maladie et on dit que
les apôtres de Jésus sont arrivés où la femme était et on dit qu'ils ont dit à la
femme : « il y a un Blanc là-bas et il guérit les Blancs aveugles » et on dit
que la femme a dit : « j'irai et je rencontrerai celui-là » et on dit que la
femme sans voir les choses avait donné ses choses aux chamans sans
pouvoir et on dit que la femme ne savait pas quoi faire avec sa maladie et
elle est allée et elle est arrivée où Jésus était mais les apôtres étaient autour
de lui. et on dit qu'elle a dit : « intensément » et on dit qu'elle a pris le bout
de la tunique de Jésus et soudainement le sang qui tombait [d'elle] s'est
arrêtée et elle a dit : « je prendrai tout » et on dit que soudainement le sang
qui tombait s'est arrêtée et on dit qu'elle a dit : « je prendrai tout » et on dit
que Jésus a dit : « je veux voir qui est cette femme » mais on dit que les
apôtres ont dit : « notre Maître, tu ne vois pas qu'il y a une multitude et on
peut voir seulement les têtes ? » et on dit que Jésus a dit [à la femme] : « vat’en et tu ne verras plus la maladie » et on dit que la femme est allée devant
Jésus et elle a raconté [ce qui lui est arrivée] et elle bégayait.
2. Versículo pour que le ciel s’éclaircisse, interprété par Jnumi Posijñoro
« Yocacanisori ajnito uñujna Guiejna a chejna ñoque jne... ! »
mu yocacanisori chicha namane gatade yui
ga jeaque uñujna Guiejna jeaque chonaque
mu yocacanisori nae ga « ome yajeode ga ijnoque panguretigai uaque
uje bacatodoyo uñujna Guiejna bisideque, ijnoque bacanguretigade »
« Notre Maître, viens, le grand orage nous exterminera… ! »
mais notre Maître a levé le bras
et tout de suite l’orage a disparu.
Notre Maître a dit : « il me semble que vous n’avez pas la foi,
vu que vous craignez l’orage pour rien, vous n’avez pas la foi. »
423
�II. ESPÈCES ANIMALES RECONNUES PAR LES AYOREO
Cette information a été tirée de Fischermann (1988). Nous avons mis en relief
les espèces qui ont été mentionnées spontanément à un moment ou à un autre de notre
terrain, ce qui ne veut pas dire que les Ayoreo de Jesudi ignorent nécessairement le reste
des animaux de la liste fournie par Fischermann. Nous avons ajouté la dénomination en
français à partir du nom scientifique.
Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
achinguirai
Cascabel
(Crotale cascabelle)
Crotalus durissus terrificus
achinguiraque
quedéjnai
Cascabel púa
Lachesis muta noctivaga
adudui
Coatí (Paraguay)
Tejón (Bolivie)
Nasua nasua
ajaramei
Tatú
(Tatou à neuf bandes)
Dasypus novemcinctus
ajidábia ajidi
Señorita (Bolivie)(abeille qui
produit du miel très apprécié)
ajojo
Abeille qui fait la ruche sur la
terre.
amitai
petite tortue, dont la carapace
est très dure
añojnatai
Puerco espín (porc-épic
brésilien)
aoojnai
Barbo (Bolivie)
(poisson)
apiejnai
Peta (Bolivie)
Tortuga barrosa (Paraguay)
(tortue)
Kinosternon scorpioides
aramoro
Ciervo
Urina (Bolivie)
(Daguet rouge)
Mazama americana
Coendou prehensilis
424
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
arapotori
Buitre
Sucha; Zamuro cabecirroja
(Bolivie)
(Urubu à tête rouge)
Cathartes aura ruficollis
are
Tachacá (Bolivie)
(Poisson)
Megalodoras irwini
aruco
Armadillo
Corechi (Bolivie)
(Tatou à trois bandes de Sud)
Tolypeutes matacus
asai
Pájaro carpintero
Carpintero negro (Bolivie)
(Pic lucifer)
Dryocopus schulzi
asojna
Atajacamino
Cuyabo común (Bolivie)
(Engoulevent des bois)
Caprimulgus parvulus
bajuganoi
Aguila
Aguilucho blanco (Bolivie)
(Buse blanche)
Leucopternis albicollis
bari
(Guêpe)
bujote
Boyero
Güira-jhú (Paraguay)
Tojo (Bolivie)
(Cassique solitaire)
Cacicus solitarius
cabayujnai
Tapir
Mboreví (Paraguay)
Anta (Bolivie)
(Tapir)
Tapirus americanus
cachui
Larve de la taille d'un doigt, qui
mange des feuilles de tabac
camane
Anguila
(Anguille)
Adontosternachus sp.
caratai
Jaguar
Yaguareté (Paraguay)
Tigre; jaguar (Bolivie)
(Jaguar)
Panthera onca
425
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
carate
Puma
León (Bolivie)
(Puma)
Puma concolor
carichai
Langosta
(orthoptère dont les aîles se
plient comme un couteau)
coboto
Buitre
Sucha (Bolivie)
(Urubu noir)
cochagajnai
Gallo
(Coq)
corabe
Mariposa blanca
(Papillon)
cosarei
Avispa
(Guêpe)
cúcujna
Topo
Cujuchi (Bolivie)
(Taupe)
Stenomys boliviensis
cucujúdaijnai
Paloma
Paloma colorada (Bolivie)
(Pigeon rousset)
Columba cayennensis
cucujui
Paloma
Cuquiza; tórtola torcaza
(Bolivie)
(Tourterelle oreillarde)
Zenaida auriculata
cuguei uniei
Pájaro
Trepador chinchero (Bolivie)
(Grimpar porte-sabre)
Drymornis bridgesii
cuo
Pájaro
Urutau (Paraguay)
Guajojó (Bolivie)
(Ibijau gris)
Nyctibius griseus
cura
Rana
Jui vaca ra'y (Paraguay)
(Grenouille)
Physalaemus biligonigerus
Coragyps atratus
Anteos clorinde
426
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
curichejna
Chancho del monte
Taguá (Paraguay)
Jabalí (Bolivie)
(Pécari du Chaco)
Catagonus wagneri
curiquejnai
Perdiz
Perdiz moradita (Bolivie)
(Tinamou à petit bec)
Crypturellus parvirostris
chaboto
Murciélago
(Chauve-souris; grand
noctilion)
Noctilio leporinus
chabotogúnori
"Celle qui mange des chauvesouris" (rapace)
(Milan des chauves-souris)
Machaeiramphus alcinus?
chacajnai
Armadillo; quirquincho
Peji chico (Bolivie)
(Pichi; tatou)
Zaedyrus pichiy
chacasi
Avispa
(Guêpe)
chacuto
Pájaro de agua
Batitú (Bolivie)
(Maubèche des champs)
Bartramia longicauda
chagua
Piraña
(Piranha)
Serrasalmus humeralis
chai
Abeja
Orosepeú (Bolivie)
(Abeille)
chigorocojnai
Pájaro
Chacurú grande (Bolivie)
(Tamatia à gros bec)
Notharchus macrorhynchos
chioi
Pájaro
Suso (Bolivie)
(Geai acahé)
Cyanocorax chrysops
choquijnai
Pájaro carpintero
Carpintero cabeciblanco
(Bolivie)
(Pic à tête pâle)
Celeus lugubris
427
�Nom ayoreo
Nom courant
chuguyúa
Langosta
(orthoptère)
chugupei
Ave
(Ois
chunguperedatei
Jabiru
Tujujú (Paraguay)
Bato (Bolivie)
(Jabiru d'Amérique; cigogne)
Jabiru mycteria
chunguperejna
Cóndor del oriente
Condor real (Bolivie)
(Sarcoramphe roi; vautour)
Sarcoramphus papa
(Totobiegosode et
Jnupedo-gosode).
Employé à Jesudi
Nom scientifique
ou jnanucuto
(Direquedejnaigosode)
dacharangori
Avispa
Pelopeo (Bolivie)
(Guêpe)
détingori
Anguila
(Anguille)
dibe
Zorra
Aguara chai (Paraguay)
Zorro (Bolivie)
(Renard)
Dusicyon gymnocerus
dicacue
Ave de rapiña
Aguilucho pampa (Bolivie)
(Buse à tête blanche; rapace)
Busarellus nigricolis
dicamichoi
Víbora venenosa
Coral (Bolivie)
(Serpent)
Micrurus frontalis
dicore
Hormiga
(Fourmi)
digorocoi
Lechuza
Sumurucucu
(Petit-duc choliba; chouette)
Otus choliba
428
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
diguiriquia
Pava de monte
Pava pintada (Bolivie)
(Hocco à face nue)
Crax fasciolata
dirai
Pájaro carpintero
Viudita (Bolivie)
(Picidé)
Leuconerpes candidus
diraye
Caracol
(Escargot)
dire
Grillo
(Grillon)
direcarua
Pájaro
Jichi tarumá (Bolivie)
(Merle à ventre clair)
direjna
Grillo
(Grillon de grande taille qui
habite près de l'eau)
disojne
Iguana
Teju guazú (Paraguay)
Peni (Bolivie)
(Tégu rouge)
diti
Hormiga
(Fourmi vénéneux)
docarame
Caracol
(Escargot)
doridi
Pájaro
Boyero con cola amarilla
(Bolivie)
(Cassique huppé)
Psarocolius decumanus
edorobe
Tapetí
Tapití (Paraguay et Bolivie)
(Lapin du Brésil)
Silvilagus brasiliensis
gaco
Ave de rapiña
Macono (Bolivie)
(Élamion perle; rapace)
Gampsonyx swainsonii
Turdus amaurochalinus
Tupinambis rufescens
429
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
gajno
Hormiga cortadora
Sepe (Bolivie)
(Fourmi)
garaca
Pava silvestre
Charata (Paraguay et Bolivie)
gatabia
Escarabajo
(Scarabée)
gatia
Ave acuática
Grulla colorada (Bolivie)
(Spatule rosée)
Ajaja ajaja
gatode pororoi
Pájaro carpintero
Carpintero cabeciamarillo
(Bolivie)
(Pic ocré)
Celeus flavescens
gatodejabi
Armadillo
Peji chico (Bolivie)
(Tatou)
Euphractus villosus
gatodejai
Dénomination alternative d'
ajaramei (Tatou)
gatodejajnai
Armadillo grande
Tatú carreta (Paraguay)
Pejichi; tatu gigante (Bolivie)
(Tatou géant)
Priodontes giganteus
gogocoi
Ave
Socori (Bolivie)
(Cariama huppé)
Cariama cristata
gogocojnai
Ave
Socori patinegra (Bolivie)
(Cariama de Burmeister)
Chunga burmeisteri
guidebei
Ave
Patiamarillo mayor (Bolivie)
(Grand Chevalier)
Tringa melanoleuca
guiejna
Abeja
Sicaé amarilla (Bolivie)
(Abeille)
Trigona tataira
Ortanis canicollis
430
�Nom ayoreo
Nom courant
guioramia
Conejo pequeño
(Lapin)
imochai
Lagartija
(Lezard)
imoijna
Araña venenosa
Viuda negra (Bolivie)
(Araignée)
irigue
Pájaro
(Tangara à galons blancs)
itoquoque
Pájaro
(Oiseau)
jachacai
Hormiga
(Fourmi)
jadiabia
Loro
(Conure de Vieillot)
Pyrrhura frontalis
jai
Ave acuática
Manguari (Bolivie)
(Héron cocoi)
Ardea cocoi
jarai
Tucán
Tucá guasú (Paraguay)
Tucán grande (Bolivie)
(Toucan toco)
Ramphastos toco
jiridia
Perdiz
(Perdicinae)
jmajogunori
Ave rapaz
(rapace)
jnaguto
Libélula
Caballito del diablo (Bolivie)
(Insecte; anisoptera)
jochacai
Armadillo grande
voir gatodejnai
(Tatou géant)
(Direquedejnaigosode)
jochongori
Nom scientifique
Tachyphonus rufus
Avispa
(Guêpe)
431
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
jocoyori
Iguana
Teju tará (Paraguay)
Jaúsi azul (Bolivie)
Tropidorus spinulosus
joniamia
Pájaro
Pecho colorado (Bolivie)
(Sturnelle à sourcils blancs)
Sturnella superciliaris
jopadi
Tayra
Melero (Bolivie)
(Tayra ou Martre à tête grise)
Eira barbara
joro
Pato silvestre
Pato gargantilla (Bolivie)
(Canard des Bahamas)
Anas bahamensis
rubirostris
jubi
Mosca
(Mouche)
juchaqueguto
Escarabajo pelotero
(Scarabée)
judui
Armadillo
Tatú hu (Paraguay)
Peji grande (Bolivie)
(Tatou à six bandes)
Euphractus sexcinctus
gilvipes
judui
Pájaro
Bugo verde (Bolivie)
(Motmot houtouc)
Momotus momota
pilcomajensis
juticai
Tábano
(Insecte; Tabanidae)
jutoi
Abeja
(Abeille)
jutojnai
Abejarron
(Bourdon)
jutongua
Pájaro
Surirí cabeza negra (Bolivie)
(Tyran tritri)
Tyrannus tyrannus
mujnagami
Pájaro carpintero
Carpintero variado (Bolivie)
(Picumne frangé)
Picumnus cirratus
432
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
mujnai
Pájaro carpintero
Carpintero chorreado (Bolivie)
(Pic varié)
Picoides mixtus
ñacore
Chancho silvestre
Tañycati (Paraguay)
Tropero (Bolivie)
(Pécari à lèvres blanches)
Tayassu pecari
najusui
Tapir (voir cabayujnai)
namuchai
Lagartija blanca
(Lezard)
netei
Pájaro trepador
(Grimpar des plateaux)
Dendrocolaptes platyrostris
ngai
Culebra, Yvy'ja (Paraguay)
Cutuchi (Bolivie)
(Serpent; Amphisbaenidae)
Leposternon sp.
ngarai
Rana
(Grenouille)
ngiamia
Rana
(Grenouille)
ngongoo
Sapo
Kururu (Paraguay)
(Amphibien; Bufonidae)
ñongongo
Rana pequeña y negra
(Grenouille petite et noire)
ogo
Mirasol
Mirasol grande (Bolivie)
(Butor mirasol; héron)
Botaurus pinnatus
ojojoi
Mono
Maneche (Bolivie)
(Alouate; Hurleur)
Alouatta ursina
orojoi
Avestruz
Ñandu (Paraguay)
Piyo (Bolivie)
(Nandou d'Amérique)
Rhea americana alberscens
Bufo granulosus
433
�Nom ayoreo
Nom courant
oyidi
Pez
(Poisson; dénomination
générale)
pepei
Ave de rapiña
Gavilán rabadilla blanca
(Bolivie)
(Buse cul-blanc)
petarugai
Mariposa nocturna
(Papillon nocturne)
picha
Pájaro
Tordo de cobija canela
(Bolivie)
(Oriole à épaulettes)
pidejnai
Insecto
Matacaballos (Bolivie)
(Insecte; Phasmatodea)
poji
Iguana
Teju guazú (Paraguay)
Peni (Bolivie)
(Tégu commun)
pororoi
Iguana de cola larga
(Tégue de queue longue)
potajnai
Atajacamino
Cuyabo (Bolivie)
(Engoulevent pauraqué)
pucutiajnai
Murciélago
(Chauve-souris)
purudi
Ave acuática
(Oiseau)
putugutoi
Jaguar (voir caratai)
quebidi
Ave acuática
(Oiseau)
Nom scientifique
Buteo leucorrhous
Icterus cayanensis
Tupinambis teguixin
Nyctidromus albicollis
Panthera onca
434
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
quiraquirai
Carancho
Carancho (Bolivie)
(Caracara huppé)
Polyborus plancus
quirigabia
Hornero
Tiluchi (Bolivie)
(Fournier roux)
Furnarius rufus
quiriquiabia
Loro
Cotorrita frentidorada (Bolivie)
(Conure couronnée)
Aratinga aurea
quirisabejnai
Ave de rapiña que come
conejos
(Oiseau rapace qui mange des
lapins)
quirisabejnai
Langosta
(Orthoptère)
quirisabi
Lechuza
(Petit-duc à mèches noires)
Otus atricapillus
saramia
Picaflor garganta blanca
(Colibri à gorge blanche)
Leucochloris albicollis
sore
Aguila
Aguila harpía (Bolivie)
(Harpie féroce)
Harpia harpyja
suacara
Loro
Calancate (Bolivie)
(Conure à tête bleue)
Aratinga acuticaudata
suarejna
Paraba
Paraba roja (Bolivie)
(Ara chloroptère)
Ara chloroptera
suaria
Loro
Loro hablador (Bolivie)
(Amazone à front bleu)
Amazona estiva xanthop.
tachei
Aguti
Jochi colorado (Bolivie)
(Agouti)
Dasyprocta variegata
435
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
tainasori
Lorito
(Petit perroquet)
tamore
Ave acuática
Pato cuervo (Bolivie)
(Oiseau; cormoran)
tayua
Caracol
(Escargot)
te
Ave acuática
Leque (Bolivie)
(Vanneau téro)
Vanellus chilensis
tirite
Picaflor
Picaflor de barbijo (Bolivie)
(Colibri d'Angèle)
Heliomaster furcifer
tiroi
Ave de rapiña
Chuuvi (Bolivie)
(Buse roussâtre)
Heterospizias meridionalis
tobejnai
Ave de rapiña
Gavilán de garfio (Bolivie)
(Milan bec-en-croc)
Chondrohierax uncinatus
toje
Ave
Chajá (Paraguay)
Tapacaré (Bolivie)
(Kamichi à collier)
Chauna torquata
tororoi
Pájaro
(Oiseau)
tosoi
Anguila del río
(Anguille)
totitabia
Pajarito
Mosqueta enana (Bolivie)
(Microtyran oreillard)
Myiornis auricularis
totite
Pajarito
Chivi ojorrojo (Bolivie)
(Viréo aux yeux rouges)
Vireo olivaceus
Phalacorcorax olivaceus
436
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
toto
Chancho del monte
Cureí (Paraguay)
Taitetú (Bolivie)
(Pécari à collier)
Tayassu tajacu
tue
Ave
(Oiseau)
tujnini
Pájaro del agua
Gallineta; tiwiwi (Bolivie)
(Marouette plombée)
Porzana albicollis
turiamia
Pájaro
Espinero de frente rojizo
(Bolivie)
(Synallaxe à front roux)
Phacellodomus rufifrons
turidigajnami
Pájaro trepador
Trepador pardo (Bolivie)
(Grimpar enfumé)
Dendrocincla fuliginosa
atrirostris
ucucui
Lechuza
Lechuzito vizcachera (Bolivie)
(Chevêche des terriers)
Athene cunicularia
ugameo
Lagartija que vive en los
árboles
Amberé (Paraguay)
(saurien, famille Scincidae
Mabuya frenata
uguidabia
Abeille qui fait la ruche sur la
terre.
ujnaruchai
Piojo de cabeza
(pou de l'humain)
ujnase
Rana
(Grenouille)
ujnoi
Tortuga de agua
(Tortue)
ujnunai
Lombriz larga de tierra
(Ver de terre)
Hylarana sp.
437
�Nom ayoreo
Nom courant
Nom scientifique
yajogue
Oso hormiguero grande
Yurumi (Paraguay)
Oso bandera (Bolivie)
(Tamanoir)
Miymecophaga tridactyla
jubata
yame
Mono
Mono cuatro ojos (Bolivie)
(Douroucouli commun)
Aotus trivirgatus
yamepai
Mono
(Hurleur noir)
Alouatta caraya
yamisai
Cigarra
Cuco; Cucu (Bolivie)
(Cigale; Cicacidae)
yamori
Cigueña
Cigueña americana
(Cigogne maguari)
Ciconia maguari
yequequebi
Pájaro de agua
Gallareta (Bolivie)
(Jacana noir)
Jacana jacana
yiquiqui
Aguila
Aguila de penacho (Bolivie)
(Aigle orné)
Spizaetus ornatus
yocai
Tortuga
Karumbe; Karecaya (Paraguay)
(Tortue charbonnière à pattes
rouges)
Geochelone carbonaria
438
�III. LES PLANTES DES AYOREO
III.1. Les plantes et les formules de guérison (Schmeda-Hirschmann 1994)
Liste de plantes invoquées dans les formules de guérison sarode pour guérir des
maladies diverses (Schmeda-Hirschmann 1994).
Nom scientifique
Famille botanique
Nom ayoreo
Maladie traitée
Arrabidaea
corallina
Bignoniaceae
Erejna pahk
rhumatisme
Aspidosperma
quebracho blanco
Apocynaceae
Ebedu
toutes (panacée)
Caesalpinia
paraguariensis
Caesalpiniaceae
Carujnangue
toutes (panacée)
Capparis
tweediana
Capparaceae
Guioatua
toux
Capsicum
chacoense
Solanaceae
Nurujna
pour éviter de
maladies, invoquée
le jour d'Asojna
(l'engoulevent)
Castela coccinea
Simaroubaceae
Chumé
pour éviter l'arrivée
de maladies, on
balaie les chemins
de la forêt avec une
branche
Chorisia insignis
Bombacaceae
Cuco
des blessures et des
coupures
Chorisia pubiflora
Bombacaceae
Cuconeja
des blessures et des
coupures
Cissus hassleriana
Vitaceae
Erejna utata
rhumatisme
Cissus palmata
Vitaceae
Erejna utata
rhumatisme
Herreria
montevidensis
Liliaceae
Jnose catade
rhumatisme
Jatropha
grossidentata
Euphorbiaceae
Caniroja
hémorragie
Lagenaria
siceraria
Cucurbitaceae
Duchubire
sensation du corps
lourd
439
�Nom scientifique
Famille botanique
Nom ayoreo
Maladie traitée
Morrenia odorata
Asclepiadaceae
Pongorapita
paralysie et
attaques (au
cerveau, etc.)
Morrenia
stormiana
Apocynaceae
Pongora
paralysie
Neea pendulina
Nyctaginaceae
Erejna
rhumatisme
Paullinia pinnata
Sapindaceae
Erejna
rhumatisme
Pereskia
saccharosa
Cactaceae
Potajao
pour enlever des
épines
Prosopis affinis
Mimosaceae
Mugunujnu
maladie des os,
douleur entre les
côtes
Prosopis kuntzei
Mimosaceae
Ajnaro utata
toutes (panacée)
III. 2. Les plantes cultivées par les Ayoreo (Schmeda-Hirschmann 1994)
Famille botanique
Nom ayoreo
Nom scientifique
Caricaceae
Namona
Carica papaya
Convolvulaceae
Batata
Ipomoea batatas
Cucurbitaceae
Mimiojó
Citrullus lanatus
Cucurbitaceae
Dutué
Cucurbita maxima
Cucurbitaceae
Purudie
Curbita pepo
Cucurbitaceae
Duchubire
Lagenaria siceraria
Euphorbiaceae
Pejek
Manihot esculenta
Gramineae
Guejnai
Zea mays
Myrtaceae
Guayaba
Psidium guajava
Papilionaceae
Cugué
Phaseolus lunatus
Solanaceae
Sidí
Nicotiana tabacum
Musaceae
Banana
Musa paradisiaca
440
�IV. TERMINOLOGIE DE PARENTÉ AYOREO
La terminologie de parenté ayoreo varie selon les auteurs (Susnik 1963, BernandMuñoz 1977, Bórmida et Califano 1978, Braunstein 1983, Bugos 1985,
Fischermann 1988). Les données de notre enquête ethnographique, par ailleurs,
ajoutent un peu plus de variabilité. Étant donné que la parenté n'est pas notre
domaine d'expertise, et que quelques dénominations semblent être oubliées dans la
petite communauté de Jesudi — où d'habitude on s'appelle par le prénom —, nous
avons décidé de reproduire ici la terminologie de parenté recueillie par Bugos
(1985). La thèse doctorale de Bugos, consacrée à l'étude de la parenté ayoreo, est
encore la recherche la plus approfondie sur le sujet.
Terminologie de consanguinité (Bugos 1985)
Ego masculin
rapport de
parenté
Ego féminin
rapport de
parenté
ite
M
ite
M
yapade
F
yapade
F
yakeramai, dai
uñai
FB
yakeramai, dai
uñai
FB
ijnogate
FZ
ijnogate
FZ
iterama, ite uña
MZ
iterama, ite uña
MZ
niamai
MB
niamai
MB
neyo, itate
(aînées) Z, FBD,
FZD, MBD, MZD
nujnairia
(aînées) Z, FBD,
FZD, MBD, MZD
dahai, itigate
(aînés) B, FBS,
FZS, MBS, MZS
yahai, yahakuñai
(aînés) B, FBS,
FZS, MBS, MZS
nayo, inamia
(cadettes) Z, FBD,
FZD, MBD, MZD
inamia
(cadettes) Z, FBD,
FZD, MBD, MZD
dahau, isate, isari,
jnuyabi, jnuhai
(cadets) B, FBS,
FZS, MBS, MZS
yahabi
(cadets) B, FBS,
FZS, MBS, MZS
code
MM, FM
code
MM, FM
yakide
MF, FF
yakide
MF, FF
codegate
MMZ, MFZ,
FMZ, FFZ
codegate
MMZ, MFZ,
FMZ, FFZ
441
�Ego masculin
rapport de
parenté
Ego féminin
rapport de
parenté
yakigate
MMB, MFB,
FMB, FFB
yakigate
MMB, MFB,
FMB, FFB
yunakairi, abi
S, BS, FBSS,
FZSS, MZSS,
MBSS
yunakairi, abi,
yanapujnai
S, ZS, FBDS,
FZDS, MZDS,
MBDS
uwo, abia
D, BD, FBSD,
FZSD, MZSD,
MBSS
uwo, abia,
yanapujna
D, ZD, FBDD,
FZDD, MZDD,
MBDD
yabai, yati
ZS, FBDS, FZDS,
MBDS, MZDS
yabuhi
BS, FBSS, FZSS,
MZSS, MBSS
yasé, yasá
ZD, FBDD, FZDD,
MBDD, MZDD
yabuhia
BD, FBSD, FZSD,
MZSD, MBSD
yanami
SS, DS, FZDDS,
MBDSS
yanami
SS, DS, FZSDS,
MBSSS
yanamai
SD, DD, FZDDD,
MBDSD
yanamai
SD, DD, FZSDD,
MBSSD
Terminologie d'affinité (Bugos 1985)
Ego masculin
rapport de
parenté
Ego féminin
rapport de
parenté
yacote
W
yabai
H, ZH
yacote uña
WZ, BW
yabai uñai
HB
jneyáte
WB, ZH
gikairia
SW, BW
gikairia
SW
gisárai
DH
gisárai
DH
yejo
HZ, HM
yejo
WM
yejoi
HF
yejoi
WF
yejo uña
HMZ, HFZ
yejo uña
WFZ, WMZ
yejoi uñai
HMB, HFB
yejoi uñai
WFB, WMB
442
�V. LES FAMILLES DE JESUDI
Nous présentons ici un bref schéma des familles de Jesudi.
Légendes:
Do : Dosapei
Po : Posorajãi
Pi : Picanerai
Et : Étacori
Chi : Chiquenoi
Cu : Cutamurajãi
Ju : Jnurumini
Adoptions (indiquées par des lignes discontinues)
Marisel Chi (26), fille de Sime Chi (12) et Dajei Po (13), a été adoptée par
Pascualita Chi (90).
Aruco Chi (59), fils d'Ujniete Chi (52) et Ijnamia Do (27) a été adopté par Baco Do
(46) et Ome Po (47).
Juguei Cu (10) a été adopté par Chicori Do (100). Juguei dit qu'il est Cu mais aussi
Do.
Romerito Cu (58), fils d'Oonei Cu et Cuia Chi, a été adopté par Pojnangue Do (51).
Les individus de Jesudi sont toujours en mouvement, mais ils se reconnaissent
comme appartenant à cette communauté. Quelques-uns habitent toute l'année dans
des fermes — Helvetia ou Boréal —, alors que d’autres, seulement quelques mois.
443
�444
�445
�Note : 61 et 63 n'habitent pas à Jesudi.
446
�447
�448
�449
�
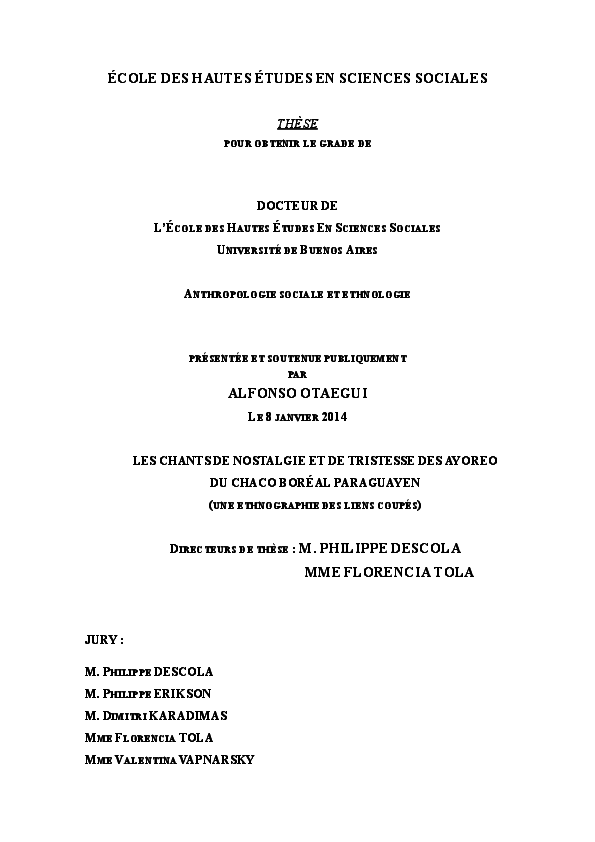
 Alfonso Otaegui
Alfonso Otaegui