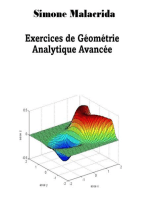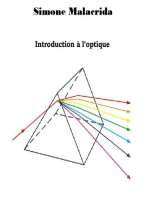Wahab Diop CHIMIE WTS LSLL
Wahab Diop CHIMIE WTS LSLL
Transféré par
Ikram ChamixoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Wahab Diop CHIMIE WTS LSLL
Wahab Diop CHIMIE WTS LSLL
Transféré par
Ikram ChamixoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Wahab Diop CHIMIE WTS LSLL
Wahab Diop CHIMIE WTS LSLL
Transféré par
Ikram ChamixoDroits d'auteur :
Formats disponibles
COLLECTION SAWD
WAHAB
DIOP
TERMINALES S2 & S1
Notes de cours | Lyce Seydina Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
Table des matires
Les alcools ....................................................................................................................................... 7
I.
RAPPELS (COURS DE 1ERE S) ............................................................................................................ 7
1.
Dfinition : ............................................................................................................................... 7
2.
Classes d'un alcool : ................................................................................................................. 7
3.
Nomenclature des alcools: ...................................................................................................... 8
4.
Tests didentification des aldhydes et ctones: ..................................................................... 8
II.
PROPRIETES CHIMIQUES ................................................................................................................... 9
1.
Obtention des alcools par hydratation dun alcne ................................................................ 9
2.
Dshydratation dun alcool ................................................................................................... 10
4.
Oxydation brutale .................................................................................................................. 10
5.
Oxydation mnage .............................................................................................................. 11
6.
Estrification directe .............................................................................................................. 13
III.
LES POLYALCOOLS ..................................................................................................................... 13
1.
Cas dun dialcool: le glycol ..................................................................................................... 13
2.
Cas dun trialcool: le glycrol ................................................................................................. 13
Les amines .................................................................................................................................... 14
I.
Les amines ................................................................................................................................. 14
1.
Dfinition et formule gnrale .............................................................................................. 14
2.
Les classes damines .............................................................................................................. 14
3.
Nomenclature ........................................................................................................................ 14
II.
Proprits chimiques des amines.............................................................................................. 15
1.
Action sur les indicateurs colors .......................................................................................... 15
2.
Basicit compare des amines .............................................................................................. 16
3.
Action sur les ions mtalliques .............................................................................................. 16
III.
Caractre nuclophile des amines : alkylation des amines ................................................... 16
1.
Raction des amines tertiaires avec les drivs halogns .................................................. 16
2.
Raction des amines primaires ou secondaires avec les drivs halogns ........................ 16
Les acides carboxyliques et drivs ............................................................................................... 18
I.
Gnralits ................................................................................................................................ 18
1.
Dfinition ............................................................................................................................... 18
2.
Nomenclature ........................................................................................................................ 18
3.
Obtention ............................................................................................................................... 19
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
II.
Proprits chimiques ................................................................................................................. 19
1.
Proprits acides ................................................................................................................... 19
2.
Dcarboxylation..................................................................................................................... 19
3.
Obtention des anhydrides d'acide ......................................................................................... 20
4.
Obtention des chlorures d'acyle ............................................................................................ 21
5.
Passage l'amide .................................................................................................................. 22
III.
ESTERIFICATION ........................................................................................................................ 24
1.
Estrification directe .............................................................................................................. 24
2.
Exemple de raction d'estrification ..................................................................................... 25
3.
Estrification indirecte ........................................................................................................... 26
4.
Nomenclature ........................................................................................................................ 26
5.
Importance des esters ........................................................................................................... 27
Cintique chimique ....................................................................................................................... 29
I.
VOLUTION DU SYSTEME CHIMIQUE ................................................................................................ 29
1.
Systmes stables et systmes chimiquement inertes ............................................................ 29
2.
Classification cintique des ractions naturelles. .................................................................. 29
II.
TUDE EXPERIMENTALE DE LA CINETIQUE D 'UNE REACTION ............................................................... 30
1.
Raction des ions iodures I- avec l'eau oxygne H2O2 .......................................................... 30
2.
Dosage par iodomtrie .......................................................................................................... 30
3.
Dtermination de la composition instantane du mlange ractionnel ............................... 30
III.
VITESSE DE REACTION ................................................................................................................ 31
1.
vitesse de formation du diiode .............................................................................................. 31
2.
vitesse de disparition ............................................................................................................. 33
3.
vitesse volumique .................................................................................................................. 34
4.
Relation entre les vitesses ..................................................................................................... 34
5.
Temps de demi-raction ........................................................................................................ 35
IV.
FACTEURS CINETIQUES .............................................................................................................. 36
1.
Agitation thermique .............................................................................................................. 36
2.
Chocs efficaces....................................................................................................................... 36
3.
Influence de la concentration et de la temprature. ............................................................. 36
4.
Autocatalyse .......................................................................................................................... 37
pH dune solution aqueuse Autoprotolyse de leau Produit ionique - Indicateurs colors .......... 38
I.
PH DUNE SOLUTION AQUEUSE ....................................................................................................... 38
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
1.
Dfinition: .............................................................................................................................. 38
2.
Proprits mathmatiques de la fonction log ....................................................................... 38
3.
Mesure de pH ........................................................................................................................ 38
4.
pH et concentration ............................................................................................................... 38
II.
EAU PURE .................................................................................................................................... 39
1.
pH de leau pure .................................................................................................................... 39
2.
Autoprotolyse de leau........................................................................................................... 39
3.
Produit ionique ...................................................................................................................... 39
III.
CARACTERE ACIDE, BASIQUE OU NEUTRE D UNE SOLUTION AQUEUSE ............................................. 39
1.
Solution neutre ...................................................................................................................... 39
2.
Solution acide ........................................................................................................................ 40
3.
Solution basique .................................................................................................................... 40
4.
Relation entre pH et [OH-] ..................................................................................................... 40
5.
lectroneutralit .................................................................................................................... 41
IV.
INDICATEURS COLORES .............................................................................................................. 41
1.
Dfinition ............................................................................................................................... 41
2.
Zone de virage des principaux indicateurs colors ................................................................ 41
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage .................................................. 42
SOLUTION DACIDES FORTS ............................................................................................................ 42
I.
1.
Un acide fort: lacide chlorhydrique ...................................................................................... 42
2.
Gnralisation: notion dacide fort........................................................................................ 42
3.
pH dune solution dacide fort ............................................................................................... 42
4.
Dilution dun acide fort .......................................................................................................... 42
II.
SOLUTION DE BASE FORTE .............................................................................................................. 43
1.
Une base forte: lhydroxyde de sodium ................................................................................. 43
2.
Gnralisation: notion de base forte ..................................................................................... 43
3.
pH de solution basique .......................................................................................................... 43
4.
Dilution de bases fortes ......................................................................................................... 43
III.
REACTION ENTRE UN ACIDE FORT ET UNE BASE FORTE ................................................................... 44
1.
quation de la raction.......................................................................................................... 44
2.
tude pH mtrique dune raction acide ............................................................................... 44
Acide faible Base faible - Couples acide/base .............................................................................. 49
I.
EXEMPLE DUN ACIDE FAIBLE : LACIDE ETHANOQUE ......................................................................... 49
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
1.
Ionisation de lacide actique ................................................................................................ 49
2.
Concentration des espces .................................................................................................... 50
3.
Gnralisation ....................................................................................................................... 50
II.
EXEMPLE DE BASE FAIBLE : LAMMONIAC ......................................................................................... 50
1.
Ionisation de lammoniac dans leau ..................................................................................... 50
2.
Calcul des concentrations ...................................................................................................... 51
3.
Gnralisation ....................................................................................................................... 51
III.
COUPLE ACIDE BASE .................................................................................................................. 51
1.
Acide base selon Bronsted ..................................................................................................... 51
2.
Couple acide base .................................................................................................................. 52
3.
Gnralisation. ...................................................................................................................... 52
4.
Couples de leau ..................................................................................................................... 52
5.
Cas des acides forts et bases fortes ....................................................................................... 52
IV.
REACTION ACIDE BASE ............................................................................................................... 53
Constante dacidit - Classification des couples acide/base ........................................................... 54
I.
CONSTANTE DE REACTION .............................................................................................................. 54
1.
Ractions limites .................................................................................................................. 54
2.
Cas particuliers des ractions en solution aqueuse ............................................................... 54
II.
CONSTANTE DACIDITE DUN COUPLE ACIDE /BASE ............................................................................ 54
1.
quilibre de dissociation dun acide faible. ........................................................................... 54
2.
quilibre de la protonation dune base faible........................................................................ 55
3.
Constante dacidit ................................................................................................................ 55
4.
Les couples H3O+/H2O et H2O/OH- ...................................................................................... 55
III.
CLASSIFICATION DES COUPLES ACIDE BASE ................................................................................... 56
1.
Force dun acide faible ........................................................................................................... 56
2.
Force dune base faible .......................................................................................................... 57
3.
Classification (voir fiche annexe) ........................................................................................... 57
4.
Domaine de prdominance ................................................................................................... 57
5.
Diagramme de distribution ................................................................................................... 59
IV.
REACTION ACIDO-BASIQUE ........................................................................................................ 60
1.
Dfinition ............................................................................................................................... 60
2.
Prvision des ractions acido-basiques ................................................................................. 60
Raction entre acide faible-base forte et vice versa Effet tampon ............................................... 61
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
I.
REACTION ENTRE UN ACIDE FAIBLE ET UNE BASE FORTE .................................................................... 61
1.
Exemple de lacide actique et de la soude ........................................................................... 61
2.
tude exprimentale de pH=f(V) ........................................................................................... 61
3.
Principales caractristiques du graphe.................................................................................. 62
4.
quivalence acido-basique .................................................................................................... 62
5.
Demi-quivalence acido-basique ........................................................................................... 62
II.
REACTION ENTRE ACIDE FORT ET BASE FAIBLE ................................................................................. 63
III.
EFFET TAMPON ......................................................................................................................... 63
1.
Dfinition de leffet tampon .................................................................................................. 63
2.
Solutions tampons ................................................................................................................. 63
IV.
APPLICATIONS .......................................................................................................................... 64
1.
Application 1 .......................................................................................................................... 64
2.
Application 2 .......................................................................................................................... 64
Les acides -amins : lments de strochimie ........................................................................... 65
I.
QUELQUES NOTIONS DE STEREOCHIMIE ........................................................................................... 65
1.
Rappels .................................................................................................................................. 65
2.
Carbone asymtrique ............................................................................................................ 66
3.
Configuration ......................................................................................................................... 67
4.
Activit optique...................................................................................................................... 67
II.
LES ACIDES -AMINES .................................................................................................................... 68
1.
Dfinition ............................................................................................................................... 68
2.
Nomenclature ........................................................................................................................ 68
3.
Structure ................................................................................................................................ 69
III.
PROPRIETES CHIMIQUES ............................................................................................................ 70
1.
Proprits acido-basiques ..................................................................................................... 70
2.
Condensation entre molcules dacide -amins .................................................................. 72
3.
Raction entres deux acides -amins .................................................................................. 73
Documents annexes ...................................................................................................................... 76
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
Serigne Abdou Wahab Diop
Email 1: wahabdiop@yahoo.fr
Email 2: wahabdiop@hotmail.fr
Retrouver ce document sur le net: http://physiquechimie.sharepoint.com
Professeur de sciences physiques au lyce Seydina Limamou Laye
Ce document comporte des notes de mes cours en classe de Terminales S1,2 au lyce
l attention de mes lves et collgues.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
Les alcools
I.
RAPPELS (COURS DE 1ERE S)
1.
Dfinition :
La molcule d un alcool est caractrise par la prsence d un groupe hydroxyle OH li un carbone
ttragonal.
Exemples:
CH3
CH3
OH
CH3
CH2
OH
CH3
CH2
CH2
CH
CH3
OH
OH
Remarque:
Le groupe hydroxyle apparat dans d'autres types de composs qui ne sont pas des alcools car dans
ces cas l'atome de carbone porteur du groupe hydroxyle n'est pas ttragonal. Voici quelques
OH
exemples:
O
CH3
CH3
OH
CH
OH
CH3
Acide carboxylique
nol
phnol
La formule gnrale d un alcool satur est CnH2n+2O ou CnH2n+1-OH ou R-OH.
2.
Classes d'un alcool :
La classe d'un alcool dpend du nombre datomes de carbone li au carbone fonctionnel (atome de
carbone reli au groupe OH).
Si cet atome de carbone fonctionnel est, par ailleurs, reli un seul atome de carbone, il est
primaire. L'alcool est galement primaire ou de classe (I).
CH3
OH
CH3
CH2
CH2
CH2
OH
Si cet atome de carbone fonctionnel est, par ailleurs, reli deux atomes de carbone, il est
secondaire. L'alcool est galement secondaire ou de classe (II).
CH3
CH
CH2
CH3
OH
Si cet atome de carbone fonctionnel est, par ailleurs, reli trois atomes de carbone, il est
CH3
tertiaire. L'alcool est galement tertiaire ou classe (III).
CH3
OH
CH3
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
Remarque: dans le cas du mthanol CH3OH, le carbone fonctionnel n'est reli aucun atome de
carbone nanmoins il constitue une exception classe dans le groupe des alcools primaires.
3.
Nomenclature des alcools:
Le nom dun alcool sobtient partir du nom de lalcane correspondant en remplaant la terminaison
"ane" par "ol", prcd, entre tirets, de lindice de position du groupe hydroxyle. La chane principale
est la chane la plus longue contenant le groupe OH. Elle est numrote de telle sorte que le groupe
OH porte lindice le plus petit possible.
Exemples : Nommons et classons les alcools de formule brute C4H10O.
4.
Tests didentification des aldhydes et ctones:
Rsultat du test
Ractifs
Expriences
DNPH
ractif de
Schiff
Ctone
Aldhyde
Prcipit
jaune
orang
Prcipit jaune
orang
La solution
reste
incolore
La solution devient
rose violace
Prparer deux tubes essai contenant
respectivement environ 1mL de DNPH.
Ajouter dans le premier tube quelques
gouttes de la solution d'thanal.
Ajouter dans le second tube quelques
gouttes de propanone.
Observer.
Prparer deux tubes essai contenant
respectivement environ 1mL de ractif de
Schiff.
Ajouter dans le premier tube quelques
gouttes de la solution d'thanal.
Ajouter dans le second tube quelques
gouttes de propanone.
Observer.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
liqueur de
Fehling
Dans un tube essai, verser environ 2mL
de liqueur de Fehling. Ajouter environ
1mL de la solution d'thanal.
Tidir lgrement la flamme du bec
Bunsen en maintenant le tube avec une
pince en bois.
Observer.
Formation dun
prcipit rouge
brique
Dpt dargent sur
les parois du tube:
miroir dargent
Ajouter environ 1mL de la solution
d'thanal dans le tube contenant le ractif
de Tollens et placer au bain marie une
dizaine de minutes.
Ractif de
Tollens
Remarque: la DNPH (2,4-dinitrophnylhydrazine) ne permet pas didentifier un aldhyde dune
ctone mais elle met en vidence la prsence du groupe carbonyl.
II.
PROPRIETES CHIMIQUES
1.
Obtention des alcools par hydratation dun alcne
L'addition d'eau sur un alcne conduit un alcool selon la raction d'quation bilan:
H3PO4 OU H2SO 4
CnH2n + H2O
CnH2n+1OH
L'hydratation d'un alcne symtrique conduit un produit unique
CH3
CH3
H2O
+
CH
CH
CH
CH2
CH3
OH
CH3
L'hydratation d'un alcne dissymtrique conduit prfrentiellement l'alcool
de la classe la plus leve.
H3C
+
H3C
CH
CH2
H2O
CH
CH3
propan-2-ol
OH
majoritaire
H3C
CH2
CH2 OH propan-1-ol
minoritaire
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
10
Les alcools
NB: l'obtention d'un alcool primaire (except l'thanol) ne peut donc pas se faire par hydratation
d'un alcne .
2.
Dshydratation dun alcool
dshydratation en alcne
La dshydratation d'un alcool conduit un alcne. La raction est catalyse par l alumine Al2O3
porte 350C. On obtient de manire prfrentielle lalcne le plus substitu (c'est--dire le moins
hydrogn sur les deux atomes de carbone qui sengagent dans la double liaison).
CH3
CH2
Al2O3
OH
CH2
350
CH2
CH3
CH3
H3C
H3C
Al 2O3
CH2 CH3
CH
CH3
majoritaire
2-methylbut-2-ene
350
OH
H2O
CH3
H2C
CH2 CH3
H2O
minoritaire
2-methylbut-1-ene
dshydratation en ther-oxyde
Dans des conditions moins douce caractrises par un chauffage vers 140C en prsence d'acide
sulfurique concentr, ou 200C sur l'alumine on obtient un ther-oxyde.
2 CH
CH2
OH
Al2O3
140C
CH3
CH2
CH2
CH3
H2O
.
3.
Raction avec le sodium
La raction entre un alcool et le sodium est une raction d oxydorduction rsultant d un transfert
d lectron du sodium vers l alcool.
CH3CH2OH + Na
CH3CH2O- + Na+ +
1
H2
2
4.
Oxydation brutale
Cest la combustion dans le dioxygne de lair dun compos organique. Dans le cas des alcools, Il se
forme toujours du CO2 et H2O selon lquation gnrale:
3n
CnH2n+2O + 2 O2
n CO2 + (n+1) H2O
Loxydation brutale dtruit la chane carbone du compos. Pour viter cette destruction, on fait
appel une oxydation douce dite oxydation mnage.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
5.
Oxydation mnage
Une oxydation mnage est une oxydation douce qui seffectue sans rupture de chane carbone
laide doxydants tels que lion dichromate (Cr2O72-), lion permanganate (MnO4-), etc.
a) Oxydation mnage des alcools primaires
Loxydation mnage dun alcool primaire conduit la formation de laldhyde correspondant. Si
loxydant est en excs, laldhyde est oxyd son tour en acide carboxylique.
-
Oxydation par le Cr2O72-
La raction entre l thanol et les ions dichromate met en jeu les couples redox suivant: Cr2O72-/Cr3+ et
CH3- CHO/CH3-CH2-OH
Cr2O72- + 14H+ + 6e(CH3 CH2 OH
2Cr3+ + 7 H2O
CH3 CHO +2H+ + 2e-) 3
Cr2O72- + 3CH3 CH2 OH + 14H+
2Cr3+ + 3CH3 CHO +6H+ + 7H2O
En simplifiant par H+, on a: Cr2O72- + 3CH3 CH2 OH + 8H+
2Cr3+ + 3CH3 CHO + 7H2O
Si l oxydant est en excs, on obtient de l acide carboxylique (acide thanoque ou acide actique)
suivant l quation:
(Cr2O72- + 14 H+ + 6e-
CH3 COOH +4 H+ + 4e-) 3
(CH3 CH2 OH + H2O
2Cr2O72- + 16 H+ + 3CH3 CH2 OH
-
2Cr3+ + 7 H2O) 2
4Cr3+ + 11H2O + 3CH3 COOH
Oxydation par le MnO4-
La raction entre l thanol et les ions permanganate met en jeu les couples redox suivants:
MnO4-/Mn2+ et CH3- CHO/CH3-CH2-OH
(MnO4- + 8 H+ + 5e(CH3 CH2 OH
CH3 CHO +2 H+ + 2e-) 5
2MnO4- + 6H+ + 5CH3 CH2 OH
-
Mn2+ + 4H2O) 2
2Mn2+ + 8H2O + 5CH3 CHO
Oxydation catalytique par le dioxygne de l air (lampe sans flamme)
L oxydation mnage de l thanol est catalyse par le cuivre. Elle produit de l thanal et de
l acide actique.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
11
12
Les alcools
Introduisons alors l ouverture du bcher
-
Un papier imbib de ractif de Schiff rosit, ce qui confirme la formation d thanal
CH3-CHO;
Un papier pH mouill rougit, mettant donc en vidence l apparition d un acide qui ne peut
tre que l acide thanoque CH3-COOH.
L oxydation de l thanol en thanal par le O2 donne:
CH3 CH2 OH
1
2 O2
CH3 CHO + H2O
L oxydation d une partie de l thanal ainsi forme conduit l acide carboxylique.
1
2 O2
Oxydation par dshydrognation catalytique
CH3 CHO
CH3 COOH
En faisant passer les vapeurs d thanol en absence d air sur le cuivre catalyseur maintenu une
temprature d environ 300C. On obtient de l thanal et d un dgagement de dihydrogne.
CH3CH2OH
Cu
300C
CH3CHO + H2
Cette raction est endothermique, elle cesse si on ne maintient pas le catalyseur une temprature
suffisante.
b) Oxydation mnage des alcools secondaires
L oxydation mnage d un alcool secondaire conduit une ctone. L oxydation mnage du
propan-2-ol par le permanganate de potassium met en jeu les couples redox suivant:
MnO4-/Mn2+ et CH3- CO CH3/CH3 CH(OH) - CH3
(MnO4- + 8 H+ + 5e(CH3 CH(OH) CH3
Mn2+ + 4H2O) 2
CH3 CO CH3 + 2H+ + 2e-) 5
2MnO4- + 6H+ + 5CH3 CH(OH) CH3
2Mn2+ + 8H2O + 5CH3 CO CH3
Remarque: les alcools tertiaires ne s oxydent pas.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les alcools
6.
Estrification directe
Les acides carboxyliques ragissent avec les alcools pour donner un ester et de l eau.
O
Exemple:
H3C
C
OH
H3C
OH
O
H3C
C
O
H2O
CH3
L estrification directe est une raction lente, athermique et limite (rversible) par une raction
inverse appele hydrolyse:
Ester + Eau Acide + Alcool
Lorsque la vitesse de la raction d hydrolyse est gale celle de la raction d estrification, il s tablit
un quilibre chimique.
LOI DE LE CHATELIER OU LOI DE MODERATION
Toute modification d un facteur d quilibre (concentration, temprature, quantit de matire, )
dplace l quilibre dans le sens qui s oppose cette modification.
Exemple: on peut dplacer l quilibre chimique dans le sens 1 en vaporant l eau par chauffage.
III.
LES POLYALCOOLS
1.
Cas dun dialcool: le glycol
Le glycol ou thane-1,2-diol de formule OH CH2 CH2 OH est le plus simple des dialcools. Il est
utilis comme antigel pour les circuits de refroidissement des moteurs et la fabrication de polyesters.
2.
Cas dun trialcool: le glycrol
Le glycrol (commercialis sous le nom de glycrine) ou propane-1,2,3-triol de formule OH CH2
CH(OH) CH2 OH se retrouve gnralement dans les corps gras (huile, graisse, )
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
13
14
Les amines
Les amines
I.
Les amines
1.
Dfinition et formule gnrale
La formule d'une amine aliphatique s'obtient partir de la formule de l'ammoniac NH3 en
remplaant un, deux ou trois atomes H par des groupements alkyles ou aryles. La formule gnrale
d une amine est CnH2n+3N.
Exemples:
H3C
H3C
NH2
H3C
CH2 NH CH3
(I)
2.
H3C
(II)
CH3
(III)
Les classes damines
La classe d une amine dpend du nombre d atomes d hydrogne remplac dans la molcule
d ammoniac. Pour un atome d hydrogne remplac l amine est dite primaire, secondaire si deux
atomes de H sont remplacs et tertiaire si les 3 atomes de H sont remplacs. (Exemples: voir cidessus)
3.
Nomenclature
Nomenclature radico-fonctionnelle
Le mot amine est prcd du nom des substituants alkyles (ou aryle) de l atome d azote, numrs
dans l ordre alphabtique.
Exemple:
H3C
NH2
methylamine
H3C
NH
CH2
CH3
thylmthylamine
H3C
CH3
CH3
trimthylamine
H3C
NH2
phnylamine (aniline)
Nomenclature substitutive
a) Amines primaires
Pour une amine primaire, on nomme l alcane correspondant en remplaant le "e" final par la
terminaison "amine" prcd, entre tirets, de l indice de position du groupe NH2
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les amines
Exemples:
CH3
H3C
NH2
H3C
methanamine
CH
CH2
H3C
CH3
C
CH2 CH2 NH2
CH3
NH2
3,3-dimethylbutan-1-amine
butan-2-amine
b) Amines secondaires ou tertiaires
Les formules des amines secondaires et tertiaires sont respectivement reprsentes ci-dessous:
R
NH
R1
R2
R1
Pour nommer une amine secondaire ou tertiaire, on cherche celui des groupes R1, R2, R3 qui possde
la chane carbone la plus longue et l on forme partir de cette chane le nom de lamine primaire
correspondant. Les noms des autres groupes carbons lis l atome d azote sont mentionns devant
celui de l amine prcds par la lettre N pour indiquer qu ils sont directement lis l atome d azote.
Exemples:
H3C
NH
CH3
H3C
N-methylmethanamine
CH2 CH2
CH3
C2 H 5
N-ethyl-N-methylpropan-1-amine
II.
Proprits chimiques des amines
1.
Action sur les indicateurs colors
Introduisons quelques gouttes de chaque indicateur dans un tube essai contenant une solution
aqueuse damine. On observe le rsultat ci-contre.
Conclusion : Les amines ont un caractre basique en solution
aqueuse:
H3C
NH2
H2O
H3C
NH3
ion mthylammonium
HO
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
15
16
Les amines
2.
Basicit compare des amines
Une solution de NH3 a un pH=11,1 ; une solution dthanamine pH=11,8 et une solution de
diethylamine a un pH=12,2. Les solutions ont la mme concentration.
L amine tertiaire est plus basique que l amine secondaire qui elle est plus basique que l amine
primaire.
3.
Action sur les ions mtalliques
2+
Fe
Fe(OH)2 + 2C2H5NH3
+ 2 (C2H5NH3 ,OH-)
Une solution aqueuse d amine donne avec les ions mtalliques une raction de prcipitation
d hydroxyde mtallique.
III.
Caractre nuclophile des amines : alkylation des amines
Le doublet libre de latome dazote des amines intervient dans les ractions acide/base et met en jeu
une autre proprit, trs importante, des amines : leur caractre nuclophile.
1.
Raction des amines tertiaires avec les drivs halogns
Au cours de la raction entre une amine tertiaire et un driv halogn, le doublet libre de latome
dazote est attir par latome de carbone, charg positivement, du driv halogn.
R2
R1
N
R3
R2
R4
R1 N
R4
R3
ion ttraalkylammonium
2.
Raction des amines primaires ou secondaires avec les drivs halogns
Prenons lexemple de la raction entre une amine primaire, la mthanamine et liodothane.
La premire tape est identique celle vue avec les amines tertiaires avec la formation dun
ion thylmthylammonium :
H3C
NH2
+ H5C2
H3C
NH2
C2H5
Cette raction est lente et la totalit de lamine ne disparat pas immdiatement.
Lion ammonium form est susceptible de librer un proton. Il ragit avec une molcule
damine primaire encore prsente dans le milieu ractionnel selon la raction :
H3C
NH2
CH3
+ H3C
NH2
H3C
NH
C2 H 5
+ H3C
NH3
Cette raction, rversible, conduit la formation dune amine secondaire : lthylmthylamine.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les amines
Lamine secondaire peut son tour ragir avec une molcule de driv halogn selon un
bilan analogue au premier :
H3C
NH
C2H5
+ H5C2
H3C
NH
C2H5
C2H5
Une des molcules damine, encore prsente dans le milieu peut ragir avec lion ammonium
form dans ltape prcdente. La raction aboutit la formation de la diethylmthylamine,
amine tertiaire :
H3C
NH
C2 H 5
+ H3C
H3C
NH2
C2 H 5
+ H3C
NH3
C2 H 5
C2 H 5
Enfin, lamine tertiaire, peut son tour ragir avec liodothane en donnant un ion
ammonium quaternaire, particulirement stable :
C2 H 5
H3C
N
C2 H5
C2 H5
+ H 5C2
H3C
C2 H5
H 5 C2
Conclusion : la raction dune amine primaire sur un driv halogn conduit un mlange complexe
contenant, entre autres, des molcules damines secondaire et tertiaire et lion quaternaire.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
17
18
Les acides carboxyliques et drivs
Les acides carboxyliques et drivs
I. Gnralits
1. Dfinition
Les acides carboxyliques sont des composs organiques renfermant dans leur molcule le groupe
caractristique (COOH) appel groupe carboxyle.
O
Leur formule gnrale est CnH2nO2 ou
o R- est un groupe alkyle ou aryle ou mme une
OH
chane carbone insature. L'atome de carbone du groupe caractristique est le carbone fonctionnel.
Certains composs possdent plusieurs groupes carboxyles: ce sont des polyacides.
2. Nomenclature
Le nom d'un acide carboxylique s'obtient en remplaant le e final du nom de lalcane
correspondant par la terminaison oque en le faisant prcder du mot acide.
H3C
CH2
CH
CH3
OH
CH3
H3C
CH3
C HC
COOH CH2 CH3
acide 2,2,3-trimethylpentanoque
acide 3-methylbutanoque
Lorsque la chane carbone est ramifie, la chane principale est la chane la plus longue contenant le
groupe carboxyle; elle est numrote partir du carbone fonctionnel.
Remarque: certaines molcules d'acide carboxylique ont des noms usuels.
O
H3C
O
C
O
OH
acide acetique
OH
acide benzoque
acide formique
O
O
O
C
HO
C
OH
acide oxalique
C
OH
CH2
OH
acide malonique
OH
O
OH
acide orthophthalique
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides carboxyliques et drivs
3. Obtention
On peut obtenir les acides carboxyliques par une oxydation mnage des alcools primaires (avec
passage l'aldhyde).
II. Proprits chimiques
1. Proprits acides
- Les acides carboxyliques s'ionisent partiellement dans l'eau selon l'quation:
O
O
R
+ H2O
C
-
H3O
OH
ion carboxylate
Cette raction n'est pas totale, elle est limite par une raction inverse: on dit que les acides
carboxyliques sont des acides faibles.
-
les solutions aqueuses d'acides carboxyliques peuvent tre doses par des solutions
aqueuses basiques telles que NaOH, KOH, Ca(OH)2 selon l'quation:
O
R
C
OH
HO
C
O
+ H2O
2. Dcarboxylation
Les acides carboxyliques peuvent par chauffage dans certaines conditions chimiques conduire une
perte d'une molcule de CO2.
En prsence de nickel vers 200C, les acides carboxyliques conduisent la formation d'un alkyle ou
aryle.
O
R
Ni
R H
~200C
CO 2
OH
En prsence d'alumine vers les 400C, on obtient la formation d'une ctone selon l'quation
suivante:
O
2
Al 2O3
400C
OH
O
R
CO 2
H2O
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
19
20
Les acides carboxyliques et drivs
Cas particulier de l'acide malonique
O
CH2
OH
Ni
200C
OH
H3C
CO 2
OH
acide malonique
Remarquer que l'acide malonique ne subit qu'une seule dcarboxylation.
3. Obtention des anhydrides d'acide
Par limination d'une molcule d'eau entre deux molcules d'acides carboxyliques on obtient
formellement une molcule d'anhydride d'acide de formule (R-CO)2O.
a) Dshydratation intermolculaire
En chauffant une solution d'acide carboxylique en prsence de P2O5 (pentaoxyde de diphosphore) ou
du P4O10 (dcaoxyde de ttraphosphore) on obtient un anhydride d'acide et de l'eau selon l'quation:
O
O
R
P2O 5
HO
OH
anhydride d'acide
+ H2O
Exemple:
O
O
H3C
C
OH
P 2O 5
CH3
H3C
HO
+ H2O
CH3
b) Dshydratation intramolculaire
La dshydratation intramolculaire est valable pour les diacides. Elle consiste en l'limination d'une
molcule d'eau dans la molcule du diacide.
O
C
O
C
OH
P 2O 5
OH
H2O
O
C
O
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides carboxyliques et drivs
Remarque: l'hydrolyse d'un anhydride d'acide donne deux acides carboxyliques.
2R
H2O
C
OH
c) Nomenclature
Le nom d'un anhydride d'acide s'obtient en remplaant le terme "acide" du nom de l'acide
carboxylique correspondant par le terme "anhydride".
O
H3C
CH2
O
C
CH2
CH3
anhydride propanoque
Remarque: il existe des anhydrides d'acide mixtes c'est--dire des anhydrides d'acide dont les deux
chanes carbones sont diffrentes.
H3C
CH2
CH2
anhydride thanoque butanoque
H3C
CH3
CH
O
O
CH3
CH3
anhydride thanoque 2-methylpropanoque
4. Obtention des chlorures d'acyle
Formellement on passe d'une molcule d'acide carboxylique une molcule de chlorure d'acyle en
remplaant le groupe -OH de l'acide carboxylique par un atome de chlore: R COCl
O
Le groupe caractristique d'un chlorure d'acyle est:
C
Cl
a) Nomenclature
Le nom d'un chlorure d'acyle s'obtient par suppression du mot "acide" du nom de l'acide
carboxylique correspondant que l'on remplace par le terme "chlorure de"; et remplacement de la
terminaison "oque" par la terminaison "oyle".
O
H3C
H3C
CH2
CH
C
Cl
chlorure d'thanoyle
O
C
CH3
Cl
chlorure de 3-mthylbutanoyle
Remarque: la chane principale est toujours numrote partir du carbone fonctionnel.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
21
22
Les acides carboxyliques et drivs
b) Prparation
Le passage de l'acide carboxylique au chlorure d'acyle peut se faire suivant trois mthodes:
o
Par action du PCl5 (pentachlorure de phosphore)
O
O
R
PCl 5
POCl 3
Par action du PCl3 (trichlorure de phosphore)
O
O
3 R
3R
PCl 3
P(OH) 3
Cl
OH
Cl
OH
HCl
Par action du SOCl2 (chlorure de thionyle)
O
O
R
SOCl 2
SO 2
HCl
Cl
OH
Cette dernire mthode est prfrable puisque les produits secondaires forms sont gazeux et se
dgagent au fur et mesure de leur formation.
Les chlorures d'acyle sont trs ractifs d'o leur grande utilisation en synthse chimique. Ils
ragissent rapidement avec l'eau pour donner l'acide carboxylique correspondant.
O
R
C
Cl
H2O
HCl
OH
Cette raction est exothermique.
5. Passage l'amide
a) Formules gnrales
Formellement on obtient une amide en remplaant le groupe OH de l'acide carboxylique par l'un
des groupes suivants: -NH2, R-NH-, R-N-R1, on obtient ainsi trois types d'amide.
O
Les amides non substitues l'atome d'azote:
C
NH2
Les amides monosubstitues l'atome d'azote:
Les amides disubstitues l'atome d'azote:
NH
C
N
C
R1
R1
R2
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides carboxyliques et drivs
b) Nomenclature
-
Amides non substitues: on obtient le nom par suppression du mot "acide" du nom de
l'acide carboxylique correspondant et remplacement de la terminaison "oque" par la
terminaison "amide".
Amides substitues: les groupes alkyles ou aryles lis l'atome d'azote sont prcds de la
lettre N et cits avant le nom de l'amide non substitue de mme chane principale.
H3C
CH
H3C
CH3
CH
CH3
NH2
H3C
CH
CH3
NH CH3
N
CH3
N-mthyl 2-methylpropanamide
2-methylpropanamide
CH2 CH3
N-ethyl-N-methyl 2-mthylpropanamide
c) Prparation
Action de l'ammoniac sur un acide carboxylique
O
O
R
NH3
O
+
NH4
O
OH
amide
Action de l'ammoniac sur un chlorure d'acyle
O
+ H2O
NH2
carboxylate d'ammonium
NH3
HCl
Cl
NH2
Pour obtenir une amide substitue on utilise la place de l'ammoniac une amine primaire ou
secondaire.
O
H3C
+ H2N
chlorure d'thyle
O
CH3
HCl
methanamine
Cl
H3C
C
NH CH3
N-methylacetamide
O
H3C
C
Cl
H3C
NH CH3
N,N-dimethylamine
HCl
chlorure d'thyle
H3C
C
N CH3
CH3
N,N-dimethylacetamide
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
23
24
Les acides carboxyliques et drivs
H3C
Action de l'ammoniac sur un anhydride d'acide
NH3
C
NH2
OH
H3C
H3C
OH
aniline
anhydride actique
H2N
CH3
NH
acide acetique
N-phenylacetamide
III. ESTERIFICATION
1. Estrification directe
C'est l'action d'un acide carboxylique sur un alcool, on obtient un ester et de l'eau.
O
O
R
R1
OH
C
O
OH
H2O
R1
Cette raction est lente, elle est limite par une raction inverse appele raction d'hydrolyse. Ces
deux ractions (estrification et hydrolyse) sont inverses l'une de l'autre et se droulent
simultanment en se compensant parfaitement au bout d'un certain temps: on dit qu'on a atteint
l'quilibre chimique d'estrification - hydrolyse. L'tat final est le mme que l'on parte d'un mlange
quimolaire d'acide et d'alcool ou d'un mlange quimolaire d'ester et d'eau. A l'tat final les quatre
constituants coexistent dans le milieu: on a un tat d'quilibre chimique.
O
R
R1
OH
OH
t0
tf
n/3
C
O
n/3
2n/3
H2O
R1
0
2n/3
On dtermine ainsi une grandeur caractristique de cette raction: la constante d'estrification KE.
2n 2n
n eau n ester
3
3 4
KE
n n
n acide n alcool
3 3
KE ne dpend que de la temprature.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides carboxyliques et drivs
2. Exemple de raction d'estrification
Considrons la raction entre l acide mthanoque et l thanol. L tude de l influence d un catalyseur
et de la temprature tant effectue, on obtient la courbe ci-dessous.
La courbe montre l'volution du nombre de moles d'ester form au cours du temps.
-
La limite d'estrification est indpendante de la temprature. L'lvation de la temprature
accrot seulement la vitesse de la raction.
La prsence d'un catalyseur permet d'atteindre plus rapidement la limite d'estrification,
mais ne la modifie pas.
Pour amliorer un rendement on peut :
o
Introduire l'un des ractifs en excs.
Extraire l'ester ou l'eau au fur et mesure de leur formation.
Influence de la nature des ractifs: Le taux d'avancement (rapport entre le nombre
de moles dissocis sur le nombre de moles initial) de l'estrification ne dpend
pratiquement pas de la nature de l'acide carboxylique utilis. Par contre la classe de
l'alcool est dterminante comme le montre les valeurs indicatives concernant un
mlange quimolaire d'acide et d'alcool donn dans le tableau ci-dessous:
pour un alcool primaire R'CH2OH
67%
pour un alcool secondaire R'CHOHR" 60%
pour un alcool tertiaire
5%
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
25
26
Les acides carboxyliques et drivs
3. Estrification indirecte
a) partir d'un chlorure d'acyle
O
R
R1
OH
Cl
HCl
R1
Cette raction est rapide et totale.
b) partir d'un anhydride d'acide
R1
OH
R1
OH
Cette raction est lente mais totale.
Exemple: synthse de l'aspirine (ou acide actylsalicylique)
H3C
C
O
C
H3C
O
HO
anhydride actique
C
H3C
acide actique
HO
O C CH3
OH
acide salicylique
OH
aspirine
4. Nomenclature
Le nom d'un ester comporte deux termes:
-
le premier, avec la terminaison oate , dsigne la chane principale provenant de l'acide
carboxylique R-COOH.
Le second, avec la terminaison "yle", est le nom du groupe alkyle prsent dans l'alcool R1-OH
Ces deux chanes carbones, chane principale et groupe alkyle, sont numrotes partir du groupe
fonctionnel.
H3C
H3C
4
CH CH2
3
C
1
CH3
O HC
1
3-methylbutanoate de 1-mthylpropyle
CH2 CH3
2
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides carboxyliques et drivs
5. Importance des esters
a) Polyesters
Les industries du textile utilisent de plus en plus les fibres polyesters; ces polyesters sont des
polymres qui sont obtenus par poly estrification d'un diacide et d'un alcool.
Exemple: pour obtenir le tergal on part de l'acide trphtalique et de l'than-1,2-diol ou glycol.
HO
CH2
CH2
OH
O
C
HO
polyestrification
CH2O
HO CH2
OH
CH2 O
CH2 CH2
n H2O
O
C
OH
O
C
O
HO
OH
O
C
HO CH2
+ H2O
O CH2 CH2 O C
O
C
OH
n-1
b) Raction de saponification d un ester
C'est l'action des ions HO- (ion hydroxyde) sur un ester, elle donne un ion carboxylate et un alcool
suivant la raction:
O
R
C
O
+
R1
O
-
HO
C
-
R1
OH
ion carboxylate
Cette raction est lente mais elle est totale, c'est la raction de saponification. Elle est utilise pour la
fabrication des savons partir des corps gras.
c)
saponification des corps gras (triesters du propan-1,2,3-triol) savons
Les corps gras sont essentiellement constitus de triglycrides. Ce sont des triesters du propan-1, 2,
3-triol (glycrol) et d'acides gras (acide chane non ramifie, nombre pair d'atomes de carbone, en
gnral de 4 22 atomes C).
La saponification des triesters gras (triglycrides) conduit au propan-1,2,3-triol (glycrol) et des
carboxylates de sodium ou de potassium qui sont des savons.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
27
28
Les acides carboxyliques et drivs
Remarque: le savon est dur lorsque le cation de la base utilis est l'ion sodium Na+; il est mou lorsque
le cation est l'ion potassium K+.
Prparation d'un savon : un mlange dhuile et de soude est chauff, reflux, vers 120 C pendant
une demi-heure (voir le schma).
Le savon form est spar du glycrol et de lexcs de soude par relargage dans une solution
concentre de chlorure de sodium. Le savon est en effet trs peu soluble dans leau sale. Il prcipite
donc et ne reste qu le recueillir par filtration sur un filtre Bchner.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Cintique chimique
Cintique chimique
I.
VOLUTION DU SYSTEME CHIMIQUE
1. Systmes stables et systmes chimiquement inertes
Lorsqu'on met en contact diffrents corps purs, il arrive parfois qu'on ne dcle aucune volution du
systme pendant la dure des observations. Cette apparente inertie peut correspondre deux
situations diffrentes:
E0(V)
le systme n'volue pas, car aucune raction naturelle ne peut s'y
drouler: le systme est stable.
1,36
Exemple: mtal cuivre en prsence d'acide chlorhydrique
1,23
Faisons l'inventaire des espces chimiques prsentes (en rouge) dans la
solution, puis appliquons la rgle du gamma . Aucune raction naturelle ne
peut se drouler.
Cl 2
O2
2+
Cu
0,34
0,00
Cl
H2O
Cu
H2
le systme n'volue pas, car la raction naturelle qui peut s'y drouler est trs lente, voire
infiniment lente: le systme est cintiquement inerte.
Exemple: considrons une solution aqueuse de permanganate de potassium.
E0(V)
MnO 4-
L'quation de la raction en appliquant la rgle du gamma est:
O2
4MnO4- + 2H2O 4MnO2 + 3O2 + 4OH-
L'apparente stabilit de la raction provient donc de la grande lenteur de la
raction dans les conditions de l'exprience.
MnO 2
1,69
H2O
1,23
H2
0,00
-2,91
2. Classification cintique des ractions naturelles.
a) raction instantane
Une raction est dite instantane lorsque l'volution du systme est si rapide qu' nos yeux la
raction semble acheve l'instant o les ractifs entre en contact. Exemple: les ractions de
prcipitation
b) raction lente
Une raction est dite lente lorsque son droulement dure de quelques secondes plusieurs minutes,
voire plusieurs dizaines de minutes. Exemple: action des ions MnO4- sur l'acide oxalique H4C2O4
c) raction trs lente
Une raction est dite trs lente lorsqu'elle ne s'achve qu'au bout de plusieurs heures voire plusieurs
jours. Exemple: les ractions d'estrification directe.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
29
30
Cintique chimique
II.
TUDE EXPERIMENTALE DE LA CINETIQUE D'UNE REACTION
1. Raction des ions iodures I- avec l'eau oxygne H2O2
Pour tudier la cintique de cette raction on cherche dterminer l'volution du nombre de moles
de diiode form au cours du temps. L'quation de la raction de la cintique tudie est:
H2O2
H2O2 + 2e +2H+
H2O
2I-
I-
I2
2 H2O
I2 + 2e
H2O2 + 2I- + 2 H+
I2 + 2H2O
2. Dosage par iodomtrie
On dtermine la quantit de I2 form en dosant la solution par le thiosulfate de sodium Na2S2O3 afin
de suivre l volution du nombre de mole de I2 form en fonction du temps. L'quation de la raction
du dosage est:
I-
I2
I2 + 2e
2S2O32-
S2O32-
S4O62-
2S2O32- + I2
2IS4O62- + 2e
2I- + S4O62-
1
C 2V 2
2 S 2O3 S 2O3
3. Dtermination de la composition instantane du mlange ractionnel
a) dtermination de la quantit instantane de diiode
A l'quivalence du dosage iodomtrique: 2n0(I2) = nq(S2O32-); soit n0 ( I 2 )
Analyse en parallle:
Afin d'tudier le droulement temporel de la raction des ions iodures I- avec H2O2 (peroxyde
d'hydrogne), mlangeons les ractifs, en quantits connues, un instant pris comme origine. Aprs
avoir homognis le mlange, fractionnons le en plusieurs chantillons de mme volume v0. Tous
les systmes obtenus S1, S2, S3,, sont identiqu
es : ils ont le mme volume, la mme composition initiale et volue donc en parallle, de faon
identique.
Trempe:
A l' instant t o nous souhaitons tudier l'chantillon Si, on dilue et refroidie brutalement
l'chantillon d'eau et de glace pile. Le systme Si voit ainsi son volution fortement ralentie voire
ngligeable: il subit une trempe; la trempe fige donc le systme dans un tat cintiquement inerte.
On dit que la raction est stoppe.
Rsultats:
A un instant t=0 (dclencher un chronomtre), mlangeons 50 mL d'eau oxygne 0,056 mol/L
pralablement acidifi avec 1 mL d'acide sulfurique 3 mol/L avec 50 mL d'une solution d'iodure de
potassium 0,2 mol/L. Le mlange est rparti entre dix bcher raison de 10 mL par bcher.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Cintique chimique
A un instant t quelconque, dosons un chantillon par une solution de thiosulfate de sodium de
concentration Cred = 0,04 mol/L, en prsence d'un peu d'emploi d'amidon. En dressant le tableau des
volumes quivalents et en calculant pour chaque chantillon la quantit de I2 ou de H2O2, on obtient
le tableau de rsultats suivant:
t(s)
0
60
180
270
350
510
720
890
1080
1440
1800
n(I2)(t) mmol
0
0,044
0,096
0,126
0,146
0,180
0,213
0,235
0,254
0,274
0,277
n(H2O2)(t)mmol
0,28
0,236
0,184
0,154
0,134
0,100
0,067
0,045
0,026
0,006
0,003
b) courbes d'volution du systme tudi
La reprsentation de la courbe d volution donne la figure ci-dessous.
0,3
mmol
0,25
0,2
n(I2)
0,15
n(H2O2)
0,1
0,05
0
0
500
1000
1500
2000
III. VITESSE DE REACTION
1. vitesse de formation du diiode
a) vitesse moyenne de formation
La vitesse moyenne de formation d un produit pendant la dure t2 t1 est donne par la relation:
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
31
32
Cintique chimique
n (t2) n (t1)
t2 t1
La vitesse s exprime en mol/s
La vitesse de formation d un produit entre t1 et t2 est gale au coefficient directeur de la scante
[M1M2] passant par les points de d abscisses t1 et t2.
0,3
mmol
M2
0,25
0,2
0,15
M1
n(I2)
0,1
0,05
t1
500
1000
t2 1500
2000
Application: Dterminer la vitesse de formation moyenne de I2 entre les dates t1=440 s et t2=800s
v
0,2291 0,1691
800 440
1,7.10 4 mmol/s
b) vitesse instantane de formation
La vitesse instantane de formation d un produit l instant t1 est gale au coefficient directeur
(pente) de la tangente la courbe au point M d abscisse t1.
0,3
dn
dt
t1
mmol
0,25
0,2
0,15
n(H2O2)
0,1
0,05
0
0
500
t 1000
1500
2000
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Cintique chimique
Application: dterminer la vitesse instantane de formation du diiode la date t=1400 s.
2. vitesse de disparition
a) vitesse moyenne de disparition dun ractif
La vitesse moyenne de disparition d un ractif pendant la dure t=t2 - t1 est donne par la relation:
0,3
n (t2) n (t1)
t2 t1
mmol
0,25
0,2
M1
0,15
n(H2O2)
0,1
0,05
M2
0
0
t1 500
1000 t2 1500
2000
Application: calculer la vitesse de disparition de H2O2 entre les dates t1=440s et t2=800s:
b) vitesse instantane de disparition
La vitesse instantane de disparition d un ractif, l instant de date t1 est gale l oppos de la
valeur, la date t1, de la fonction driv de n.
v
dn
dt
t1
mmol
0,3
0,25
0,2
0,15
n(H2O2)
0,1
0,05
0
0
t500
1
1000
1500
2000
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
33
34
Cintique chimique
Application: calculer vd (H 2 O 2) la date t=0. ( vdt
5.10 3 mmol/s)
3. vitesse volumique
pour une raction se droulant dans un volume
: on dfinit la vitesse volumique de
formation d un produit D(ou de disparition d un ractif A) comme le quotient de la vitesse de
formation D(ou de disparition A) par le volume.
vD
f
1 dnD
et v A
d
v dt
1 dnA
v dt
Cette vitesse s exprime en mol.m-3.s-1 ou plus frquemment mol.L-1.s-1.
Si le volume
est constant la vitesse de formation de D et de disparition de A peuvent se
mettre sous la forme:
1 dnA
v dt
vA
d
do:
4. Relation entre les vitesses
Soit la raction d quation bilan: A + B
dates t et t + t satisfont aux relations:
n(A)
vA
d
nA
d[A]
dt
dt
d[A]
et v D
f
dt
d[D]
dt
C + D. Les variations de quantit de matire entre les
n(B)
n(C)
n(D)
En divisant tous les termes par t, nous obtenons des relations semblables entre les vitesses
moyennes.
1
n(A)
t
n(B)
n(C)
t
n(D)
t
En faisant tendre t vers 0, nous tablissons enfin les relations concernant les vitesses instantanes:
1
n(A)
t
vd( A)
n(B)
t
vd( B)
vf( C)
n(C)
t
n(D)
t
vd( D)
Application:
En solution dans un mlange d'actone et d'eau, le 2-bromo-2-mthylpropane (not RBr, par la suite)
ragit avec une molcule d'eau selon une raction de substitution pour donner le 2-mthylpropan-2ol selon l'quation-bilan:
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Cintique chimique
(CH3)3CBr + H2O
t(h)
(CH3)3COH + H+ + Br-
3,15 4,10 6,20 8,20 10,0 13,5 18,3 26,0 30,8 37,3
[RBr](mmol/L) 104
90
86
77
70
64
53
39
27
21
14
a) Tracer la courbe donnant la concentration en RBr en fonction du temps. Quels
sont les facteurs cintiques qu'elle met en vidence? Dterminer la vitesse
volumique de disparition de RBr l'instant initial, puis lorsque sa concentration
prend les valeurs 104, 75, 50 et 25 mmol.L-1
b) On reprend la mme exprience avec la mme concentration en bromoalcane
RBr, mais la proportion d'eau du mlange initial est double. La vitesse
volumique initiale de disparition de RBr est 5,2 mmol.L-1.h-1. Que peut-on en
conclure?
Rsolution :
a) L'aspect de la courbe montre que la vitesse volumique de disparition du
bromoalcane Vd RBr dcrot au fur et mesure de la consommation des ractifs.
.
La vitesse volumique de disparition de RBr est l'oppose de la pente de la tangente la
courbe pour les valeurs indiques:
[RBr] (mmol.L-1)
104 75 50 25
-1 -1
Vd RBr (mmol.L h ) 5,2 3,7 2,6 1,5
b) Dans ces deux expriences, seule la concentration initiale en eau diffre. Or VdRBr,
t=O, est la mme: VdRBr est donc indpendant de [H20].
La concentration en eau n'est pas un facteur cintique de cette raction.
5. Temps de demi-raction
On appelle temps de demi-raction t1/2 ou la dure ncessaire pour consommer la moiti du ractif
limitant initialement prsent. (Cas des ractions quantitatives)
Cest aussi le temps not t1/2 quil faut lavancement pour atteindre la moiti de sa valeur finale. Ce
temps permet dvaluer la rapidit dune raction chimique par une seule valeur numrique.
Attention : Lavancement final xf peut-tre infrieur ou gal lavancement maximal xmax.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
35
36
Cintique chimique
0,3
mmol
0,28
0,25
0,2
0,15
0,14
n(H2O2)
0,1
0,05
0
0
On a:
t1/2500
1000
1500
2000
328s
IV. FACTEURS CINETIQUES
Les facteurs cintiques sont des paramtres sur lesquels on peut agir pour faire varier la vitesse
d apparition ou de disparition d un corps. Les principaux facteurs cintiques sont: la temprature, la
concentration des ractifs et l utilisation d un catalyseur. L exprience montre que la vitesse
d volution d un systme chimique augmente avec ses facteurs cintiques. Faisons une
interprtation microscopique de l influence de ses facteurs cintiques sur la vitesse.
1. Agitation thermique
Les entits chimiques (atomes, ions ou molcules) prsentes dans un fluide sont en mouvements
rapides incessants et totalement dsordonns. Plus la temprature est leve, plus lagitation est
forte.
2. Chocs efficaces
Dans un milieu ractionnel lagitation entrane des chocs entre les ractifs et toutes les autres
espces chimiques prsentes, y compris les molcules deau.
Ce sont les chocs entre ractifs qui permettent la raction chimique de se faire car ils permettent
le contact entre les ractifs et ils peuvent provoquer la rupture des liaisons sils sont suffisamment
violents.
Ces chocs sont efficaces sils permettent la transformation des ractifs en de nouvelles espces
chimiques qui sont les produits de la raction.
Mais beaucoup de chocs au sein du mlange ractionnel sont inefficaces : les chocs entre ractifs et
solvant, entre ractifs et produits de raction, entre ractifs et dautres espces chimiques prsentes
dans leau, les chocs entre ractifs avec une mauvaise orientation, ou les chocs trop faibles qui ne
provoquent pas de rupture de liaison. (Certains chocs entre produits de raction peuvent mme
provoquer la raction inverse celle recherche, dans ce cas la raction ne peut pas tre totale.)
3. Influence de la concentration et de la temprature.
Les chocs sont alatoires et leur efficacit aussi, mais leur nombre augmentent avec la concentration
et la temprature. De plus la violence des chocs devient plus grande avec laccroissement de la
temprature.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Cintique chimique
La frquence des chocs efficaces augmente donc avec la temprature et la concentration, ce qui
explique laugmentation de vitesse de raction.
On peut aussi en dduire que les ractions sont plus rapides entre deux ractifs en phase liquide
quentre un ractif en phase liquide et un solide car la frquence des chocs est alors rduite la
surface de contact entre le solide et le liquide. Par contre augmenter la surface de contact avec le
solide en le broyant permet daugmenter la vitesse de la raction.
4. Autocatalyse
Une raction chimique catalyse par l un de ses produits est dite autocatalytique. Ce type de
raction est appele autocatalyse.
V=d[C]/dt
Au cours dune raction
autocatalytique, la vitesse de
formation dun produit C passe
par un maximum.
t
A cet instant, la courbe
[C]
reprsentant la concentration
de C en fonction du temps
admet un point dinflexion.
t
La raction entre les ions MnO4- et H2C2O4 est catalyse par les ions Mn2+ dont l quation bilan est la
suivante:
2MnO4- + 6H3O+ + 5H2C2O4
2 Mn2+ + 10CO2 + 14H2O
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
37
38
pH dune solution aqueuse Autoprotolyse de leau Produit ionique - Indicateurs colors
pH dune solution aqueuse
Autoprotolyse de leau Produit ionique
- Indicateurs colors
I.
PH DUNE SOLUTION AQUEUSE
1.
Dfinition:
Le pH (potentiel d hydrogne) d une solution aqueuse est l oppos du logarithme dcimal de sa
concentration en ion hydronium H3O+ exprime en mol.L-1.
pH
Cette relation est quivalente [H 3 O ]
mol/L
2.
log[H 3 O ]
10 pH et est valable pour: 10-6 mol/L
[H3O+]
10-1
Proprits mathmatiques de la fonction log
log( a n )
n.log(a) ; log(a b)
a
log(a) log(b) ; log b
log(a) log(b)
3.
Mesure de pH
On mesure le pH d une solution l aide d un papier pH (mesure imprcise) ou d un pH-mtre
(mesure prcise).
Remarque: la valeur du pH doit tre exprime en 1/100 prs.
4.
pH et concentration
Soient deux solutions aqueuses notes S1 et S2 tel que [H3O+]1> [H3O+]2
la fonction log est croissante.
-log[H3O+]1 < -log[H3O+]2
log[H3O+]1 > log[H3O+]2 car
pH(S1) < pH(S2)
Le pH d une solution est d autant plus faible que sa concentration en ion H3O+ est leve.
Application:
1) Calculer le pH d une solution d acide chlorhydrique de concentration C=4,6.10-3 mol/L
2) L tiquette d une eau minrale gazeuse indique pH=6,5. En dduire la concentration des ions
H3O+ de cette eau.
Rsolution: 1) pH=-log[H3O+]=-log4,5.10-3=2.35; 2) [H3O+]=10-pH=10-6,5 3,2.10-7 mol/L .
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
pH dune solution aqueuse Autoprotolyse de leau Produit ionique - Indicateurs colors
II.
EAU PURE
1.
pH de leau pure
A 25C le pH de l eau pure est gale 7. L eau pure contient donc des ions H3O+ tel que [H3O+]=10-7
mol/L.
2.
Autoprotolyse de leau
La prsence dans l eau des ions H3O+ rsulte de l ionisation partielle de l eau selon l quation:
H2O + H2O
OH- + H3O+
2H2O
OH- + H3O+
Cette raction est limite et connue sous le nom d autoprotolyse de l eau. Dans l eau pure 25C:
[H3O+]= [OH-]=10-7 mol/L .
3.
Produit ionique
toute solution aqueuse contient, entre autres, des ions hydronium H3O+ et des ions
hydroxyde OHA une temprature donne, le produit des concentrations des ions H3O+ et des ions OH- est
constant. Ce produit, appel produit ionique est not Ke et ne dpend que de la
temprature. Il est indpendant de la prsence et de la nature des substances dissoutes.
Ke=[H3O+][OH-] o [ H3O+] et [OH-] sont exprimes en mol/L .
On dfinit aussi le pKe=-logKe ou Ke=10-pKe
t(C)
Ke
pke
+
-7
-7
-14
25C Ke=[H3O ][OH ]=10 10 =10
14
-14
40C
2,95.10
13,53
-14
100
55.10
12.26
Rmq: ke augmente avec la temprature
III.
CARACTERE ACIDE, BASIQUE OU NEUTRE D UNE SOLUTION AQUEUSE
1.
Solution neutre
Une solution aqueuse est neutre si elle contient autant d ions H3O+ que d ion OH-.
[H3O+]=[OH-]
-log[H3O+]=-logKe
A 25C pH n e u t r e
1
2 pKe
[OH
ke
[H 3 O ]
2log[H3O+]=-logKe
2pH=pKe
Ke=[H3O+][OH-]
1
2
14
Ke
pH
2
[H 3 O ]
1
2 pKe
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
39
40
pH dune solution aqueuse Autoprotolyse de leau Produit ionique - Indicateurs colors
A 100C (pke=12,26) pH n e u t r e
1
2 pKe
1
2
12,26
6,13
2.
Solution acide
Une solution aqueuse est acide si elle contient plus d ions H3O+ que d ions OH-.
[H3O+]>[OH-]
[H 3 O ]
Ke
[H 3 O ]
[H3O+]>Ke
2pH
pKe
1
2 pKe
pH
A 100C une solution acide un pH
-log[H3O+]<-logKe
6,13
3.
Solution basique
Une solution est basique si elle contient plus d ions OH- que d ions H3O+
[H3O+]<[OH-]
[H 3 O ]
Ke
[H 3 O ]
[H 3 O ]<Ke
-log[H 3 O ]>-logKe
2pH
pKe
1
2 pKe
pH
A 60C (pKe=13,02): une solution basique a un pH>6,51
Acide
Neutre
[H 3 O ]>[OH-]
1/2
pKe
Basique
[H3O+]<[OH-]
pKe
[H3O+]=[OH-]
4.
Relation entre pH et [OH-]
du pH la [OH-]
Ke
[H 3 O ]
[OH
pH
log[H 3 O ]
10 pKe
10 pH
10 pKe pH
[OH
10 pKe pH
de la [OH - ] au pH
(
pH
pH
pKe
log[OH ]
logKe
log[HO
pKe
log[HO ]
Application: Complter le tableau suivant 25C (il s'agit de trouver les valeurs en rouge)
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
pH dune solution aqueuse Autoprotolyse de leau Produit ionique - Indicateurs colors
[H 3 O + ]
4.10 - 1 0
2,2.10 - 1 3
6,2.10 - 9
[HO - ]
2,5.10 - 5
4,5.10 - 2
1,6.10 - 6
pH
9,4
12,65
8,21
5.
lectroneutralit
Une solution tant lectriquement neutre, le nombre de charge positive doit tre gal au nombre de
charge ngative. En d autre terme, on a:
q i(
) [cation]
q (i
) [anion]
Exemple: soit une solution aqueuse de Na2SO4. Les espces chimiques prsentes sont : Na+, H3O+,
SO42-, HO-. Lquation dlectroneutralit scrit sous la forme: [Na+]+[ H3O+]=2[ SO42-]+[ HO-]
IV.
INDICATEURS COLORES
1.
Dfinition
Un indicateur color est une substance qui en solution aqueuse change de couleur pour un intervalle
de pH appel zone de virage.
2.
Zone de virage des principaux indicateurs colors
Principaux indicateurs colors
Vert de malachite (1e vir.)
Teinte acide
Zone de virage
Teinte basique
Jaune
0,1 2,0
Vert
Hlianthine
Rouge
3,1 4,4
Jaune
Bleu de bromophnol
Jaune
3,0 4,6
Bleu
Jaune
3,8 5,4
Bleu
Rouge de mthyle
Rouge
4,2 6,2
Jaune
Bleu de bromothymol
Jaune
6,0 7,6
Bleu
Rouge de crsol
Jaune
7,2 8,8
Rouge
Phnolphtalne
Incolore
8,2 10,0
Rose
Vert de malachite (2e vir.)
Vert
11,5 13,2
incolore
Carmin d indigo (2e vir.)
bleu
11,6 14,0
Jaune
Vert de bromocrsol
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
41
42
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
Acide fort base forte Raction acide
fort base forte Dosage
I.
SOLUTION DACIDES FORTS
1.
Un acide fort: lacide chlorhydrique
Lacide chlorhydrique est une solution aqueuse de HC qui colore en jaune le bleu de bromothymol :
il est acide.
La dissolution du chlorure d hydrogne dans l eau est une raction totale: HC s ionise totalement
dans l eau en donnant, entre autres, des ions H3O+; on dit pour cela que l acide chlorhydrique est un
acide fort.
HC+H2O
H3O+ + C-
2.
Gnralisation: notion dacide fort
Un acide fort est une espce chimique qui s ionise totalement dans l eau pour donner, entre autres,
des ions hydronium H3O+.
Exemples:
HNO3 + H2O
HBr + H2O
H3O+ + NO3H3O+ + Br-
3.
pH dune solution dacide fort
Soit une solution d acide fort AH de concentration C: AH + H2O
pH
- log[H 3 O ] or d aprs l quation d ionisation [H 3 O ]
A- + H3O+
C d o pH=-logC
Cette relation est valable dans le domaine de concentrations suivant: 1.10
5.10
mol/L
REMARQUE: pour un diacide tel que H SO4 de concentration C, on a: [H3O+] = 2C d aprs l quation
d ionisation: H SO4 + 2H2O
2H3O+ + SO42Ainsi pour un diacide: pH
log2C
4.
Dilution dun acide fort
Soit une solution S1 d acide fort de volume v1 et de pH
une solution fille S2 de volume v2
pH1. Diluons n fois la solution: on obtient
n v1, n est le facteur de dilution.
Au cours d une dilution le nombre de moles se conserve : C1v1 C2v2
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
C2
pH2
logC2
v1
v2 C1
C1
log n
v1
nv1 C1
C1
n d o C2
logC1 logn
C1
n
pH1 logn
pH2
pH1 logn
Conclusion: lorsqu on dilue n fois une solution d acide fort AH de concentration C (telle que
C
10 6M), la concentration des ions H3O+ et A- est divise par n et le pH augmente de logn.
n
II.
SOLUTION DE BASE FORTE
1.
Une base forte: lhydroxyde de sodium
La dissolution de l hydroxyde de sodium dans l eau est une raction totale. L quation bilan s crit:
NaOH solide Na+ + OHLa solution obtenue, appele soude fait virer au bleu le BBT: elle est basique. La dissociation est
totale, on dit que l hydroxyde de sodium est une base forte.
2.
Gnralisation: notion de base forte
Une base forte est une espce chimique qui se dissocie totalement dans l eau pour donner, entre
autres des ions hydroxydes HO-.
Exemples:
K+ + OH-
KOH
C2H5O- + H2O
C2H5OH + OH-
noter: C2H5O- (ion thanolate)
3.
pH de solution basique
Soit une solution de base forte B de concentration C: B + H2O
D aprs l quation [B]
[OH
C d o pH
pH
BH + OH-
pKe logC avec 1.10 -6 M
5.10 -2 M
pKe logC
Remarque: pour une dibase telle que l hydroxyde de calcium Ca(OH)2 de concentration C.
pH
pKe log2C
4.
Dilution de bases fortes
Soit une solution S1 de base forte, de volume v1, de concentration C1 et de pH
cette solution. Soit S2 la solution fille obtenu de volume v2
n1
n2
C 1v 1
C 2v 2
C2
v1
v2 C1
pH1. Diluons n fois
n v 1.
v1
nv1 C1
C1
n
C2
C1
n
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
43
44
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
pH2
pKe logC2
C1
pKe log n
pH2
pKe logC1 logn
pH1 logn
pH1 logn
C
Conclusion: lorsqu on dilue n fois une solution de base forte de concentration C (telle que n
M), la concentration des ions hydroxyde OH- est divise par n et le pH diminue de logn.
III.
10 6
REACTION ENTRE UN ACIDE FORT ET UNE BASE FORTE
1.
quation de la raction
Un acide fort et une base forte ragissent par une raction chimique rapide et exothermique.
L quation bilan de la raction qui se produit est : H3O+ + OH2H2O
Exemple: raction entre l acide chlorhydrique et l hydroxyde de sodium
(H3O+, C-) + (Na+, OH-)
2 H2O + (Na+,C-)
En simplifiant les ions spectateurs Na+ et Cl-: on obtient: H3O+ + OHtransfert de protons des ions H3O+ vers les ions OH-.
2.
2H2O. Cette raction est un
tude pH mtrique dune raction acide
a) Dispositif exprimental
Le montage pour effectuer le dosage est schmatis ci-dessous.
On ajoute VB (mL) d une solution de soude de concentration CB =2.10-2 mol/L 10 mL d une solution
d acide chlorhydrique de concentration inconnue Ca. En relevant le pH aprs chaque ajout, on
obtient les rsultats suivants:
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
vB
6.5
pH 1.80
1.90
2.05
2.15
2.30
2.5
2.70
2.90
vB
7.5
8.5
10
11
12
6.95
10.75
11.4
11.5
11.60
pH 3.25
11.05 11.2
b) Graphe pH=f(vB)
Le trac de la courbe correspondant au tableau ci-dessus donne la reprsentation suivante.
c) Principales caractristiques du graphe pH =f(vB)
La courbe est croissante ; elle prsente 3 parties distinctes :
-
Partie AB: la courbe est presque rectiligne et le pH varie peu lors de l addition de base
Partie BC : nous observons un saut de pH et la courbe change de concavit (prsence d un
point d inflexion)
Partie CD: le pH varie ensuite faiblement, la courbe tend vers une asymptote horizontale
d) Point dquivalence
Dfinition
Il y a quivalence lorsque les ractifs sont mlangs dans les proportions stchiomtriques de la
raction du dosage.
A l quivalence n(OH-)ajouts l quivalence = n(H3O+)initialement p r s e n t s
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
45
46
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
CAVA=CBVBE
VBE est le volume de base vers l quivalence
pH lquivalence
A l quivalence: n H 3 O
initial
La raction s effectue mole mole: n H 3 O
n H3O
initial
- n H3O
n H3O
restant
ragit
n OH
n OH
ragit
n OH
.
n OH
ragit
ragit
restant
Par suite [H 3 O + ] E =[OH - ] E. La solution est donc neutre son pH vaut 7 25C.
Dtermination du point quivalent
Le point quivalent E est le point de la courbe pH
f ( VB ) tel que VB
VBE . Le point d inflexion
correspondant au point d quivalent. On le dtermine par la mthode des tangentes.
-
On trace deux tangentes la courbe, parallles entre elles et situes de part et d autres du
point quivalent.
On trace ensuite la parallle ces deux tangentes, quidistantes de celles-ci. Son point
d intersection avec la courbe dtermine le point quivalent E.
On trouve sur la courbe: pH E 7 et VBE=7,86 mL
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
On peut ainsi calculer la concentration de la solution d acide chlorhydrique dose:
CA
VBE
CB V
A
0,02 7,86
10
1,5.10-2 molL 1
Influence de la concentration
Recommenons l exprience en faisant modifiant chaque fois la concentration de l acide
CA
CA
chlorhydrique ( CA , 10 et 100 ).
Afin de comparer les diffrents rsultats obtenus, traons, sur un mme graphe, les trois courbes
f ( VB )
pH
Lobservation des courbes ci-dessus montre que:
-
lquivalence, le pH est toujours gal 7,0;
le saut de pH et la pente de la courbe pH f(V B ) diminue autour du point quivalent E
lorsque les concentrations des solutions utilises diminuent.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
47
48
Acide fort base forte Raction acide fort base forte Dosage
Lajout deau distille la solution doser ne modifie ni le volume quivalent VE, ni le pH
lquivalence: pH E 7. Il a simplement pour but de faciliter lagitation du mlange et de
favoriser limmersion des lectrodes du pH-mtre.
Ajout dune solution dacide fort une solution de base forte
tudions de mme l volution du pH d une solution de base forte laquelle on ajoute une solution
d acide fort. (CA =CB =0,1 molL -1; VB=10 mL)
L quivalence, encore obtenue pour pH
7, est telle que: n(OH-)int=n(H3O+)aj
C B VB
C A VA
Les consquences de la dilution sont les mmes que celles observes ci-dessus.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Acide faible Base faible - Couples acide/base
Acide faible Base faible - Couples
acide/base
I.
EXEMPLE DUN ACIDE FAIBLE : LACIDE ETHANOQUE
1.
Ionisation de lacide actique
a) Conductibilit
L acide thanoque pur CH3COOH ne conduit pas le courant lectrique: il n est pas alors ionis.
La solution aqueuse d acide actique conduit le courant lectrique: elle contient des ions. Ces ions
proviennent de son ionisation dans l eau selon l quation:
O
H3C
+ H2O
H3C C
OH
H3O
b) Ionisation partielle de lacide actique.
Considrons une solution d acide thanoque de concentration C=10-2 mol/L 25C, son pH mesur
donne 3,4. Exploitons ces valeurs.
-
pH 7: la solution est acide.
[H3O+] = 10-pH = 10-3,4 = 4.10-4 mol/L
[H3O+]<C
ionisation partielle: l acide actique est
un acide faible.
Si la raction tait totale, nous aurions [H3O+] = C et pH = 2.
c) Conclusion
Dans une solution d acide thanoque de concentration C:
-
[H3O+]<C ce qui quivaut pH
L acide actique se dissocie partiellement: c est un acide faible.
d) Degr dionisation ou taux davancement final:
logC
Considrons l ionisation de no mol d acide actique et dressons le tableau d avancement de la
raction.
O
H3C
A la date t=0
A la date t
O
+ H2O
H3C C
+
-
H3O
OH
n0
no x
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
49
50
Acide faible Base faible - Couples acide/base
Le coefficient d ionisation
est dfini par la relation
x
no avec x (nombre de mol dissoci ou
avancement) et no le nombre de mole initial. Cette relation est quivalente d aprs l quation :
[H 3 O ]
[CH3 COO ]
=
C
C
Remarque: la dilution favorise la dissociation de l acide actique: le coefficient d ionisation augmente
lorsque la dilution augmente.
2.
Concentration des espces
A 25C une solution d acide actique de C=10-2 mol/L a un pH=3,4. Calculons la concentration de
l ensemble des espces chimiques prsentes dans la solution.
Espces chimiques prsentes: CH3COOH, CH3COO-, H3O+ et HO-
[H3O+]=10-pH = 10-3,4 = 4.10-4 mol/L
[HO-] = 10(pH-pKe) = 10(3,4-14) = 2,5.10-11 mol/L
L lectroneutralit: [CH3COO-] + [HO-] = [H3O+]
[CH3COO-] = [H3O+] [HO-]
[CH3 COO ]=4.10 - 4 2,5.10-11 = 4.10-4 mol/L
Conservation de la matire: C= [CH3COOH] + [CH3COO-]
[CH3COOH] = C - [CH3COO-] = 10-2 4.10-4 mol/L = 9,6.10-3 mol/L
[H 3 O ]
4.10 4
0,04 4% (ionisation
On peut remarquer le taux d ionisation est
C
10 2
partielle)
3.
Gnralisation
Un acide est faible en solution aqueuse si sa raction avec l eau est limite ; ce qui est quivalent
logC.
[H3O+]<C ou pH
Exemple: les acides carboxyliques sont des acides faibles.
II.
EXEMPLE DE BASE FAIBLE: LAMMONIAC
1.
Ionisation de lammoniac dans leau
Soit une solution aqueuse de NH3 de concentration C=10-1 mol/L, 25C. La mesure du pH donne
11,1 au lieu de 13 (valeur du pH si l ammoniac s tait totalement dissoci).
-
pH
la solution dammoniac est basique
3
[HO
1011,1 14 10 2,9 1,26.10
10 1
c est une base faible.
[HO -]<C
log[HO
logC
pKe log[HO
.
PH
Pour une base faible: [HO
[HO-]<C: la dissociation est partielle:
pKe logC
pKe logC
C ce qui est quivalent pH
pKe logC
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Acide faible Base faible - Couples acide/base
L ionisation de l ammoniac dans l eau est partielle: c est un quilibre chimique suivant l quation:
NH3 + H2O NH4+ + OH2.
Calcul des concentrations
Considrons une solution dammoniac de concentration C=0,1 mol/L et de pH=11,1 25C. Calculons
la concentration de lensemble des espces prsentes dans la solution.
Espces chimiques prsentes: NH3 , NH4+ , H3O+ et HO[H3O+]=10-pH = 10-11,1 = 7,9.10-12 mol/L
[HO-] = 10(pH-pKe) = 10(11,1-14) = 1,26.10-3 mol/L
L lectroneutralit: [NH4+] + [H3O+] =[HO-]
[NH4+] = [HO-] - [H3O+]
[NH4+]=1,26.10 - 3 7,9.10-12 = 1,26.10-3 mol/L
Conservation de la matire: C= [NH3] + [NH4+]
[NH3]restante = C - [NH4+] = 10-1 1,26.10-3 mol/L = 9,87.10-2 mol/L
On peut remarquer le taux d ionisation est
[NH 4 ] 1,26.10
=
C
10 1
3
1,26 % (ionisation partielle)
3.
Gnralisation
Une base est faible en solution aqueuse si sa raction avec leau est limite ; ce qui quivaut
[OH-]<C ou pH<pKe+ logC
Exemples : les carboxylates et les amines son des bases faibles.
H3C
COO-
H5C6 NH2
III.
H2O
H3C
COOH
H2O
H5C6 NH3
HO
HO
COUPLE ACIDE BASE
1.
Acide base selon Bronsted
Un acide est une substance chimique (molcule ou ion) capable de librer un ou plusieurs protons.
Exemples :
H3C
COOH
+ H3C COOH
+ Cl
+
H
+ NH3
+
HCl
+
NH4
Une base est une substance chimique (molcule ou ion) capable de capter un ou plusieurs protons.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
51
52
Acide faible Base faible - Couples acide/base
H3C
COONH3
H3C
COOH
NH3
2.
Couple acide base
Dans une solution aqueuse dacide thanoque ou dthanoate de sodium, les ions thanoates et les
molcules dacide thanoque sont en quilibre chimique selon lquation :
CH3-COOH + H2O CH3-COO- + H3O+
En liminant une molcule deau, on obtient : CH3COOH CH3COO- + H+
Lacide thanoque et lion thanoate constituent un couple acide/base : CH3-COOH/CH3-COOCH3-COOH est lacide conjugu de la base CH3-COOCH3-COO- est la base conjugue de lacide CH3-COOH
3.
Gnralisation.
Lorsquun acide et sa base conjugue sont en quilibre dans leau, ils forment un couple acide/base.
Acide Base + H+ ; Acide/Base
NH4+ NH3 + H+ ; NH4+/NH3
NO2- + H+ HNO2 ; HNO2/NO-2
4.
Couples de leau
Lion H3O est un acide car il peut librer un proton selon lquation : H3O+ H+ + H2O o l on
+
associe le couple H3O+/H2O. Dans ce couple leau se comporte comme une base.
Lion OH- est une base, il peut capter un proton selon lquation : OH- + H+ H2O associe au
couple H2O/OH-. Dans ce couple leau se comporte comme un acide.
Leau est la base du couple H3O+/H2O et lacide du couple H2O/OH- : leau est une espce amphotre
ou ampholyte.
5.
Cas des acides forts et bases fortes
HCl se dissocie totalement dans leau : cest un acide fort. HCl H+ + Cl- (couple HCl/Cl-).
Lion Cl- est la base conjugue de HCl, il ne ragit pas avec leau : on dit que cest une base
indiffrente leau.
La soude est une base qui se dissocie totalement dans leau : cest une base forte.
eau
NaOH Na+ + OH- (couple Na+/NaOH). Lion Na+ est lacide conjugu de NaOH. Il ne
ragit pas avec leau : cest un acide indiffrent leau.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Acide faible Base faible - Couples acide/base
IV.
REACTION ACIDE BASE
Exemple 1 : raction entre lacide chlorhydrique et lammoniac.
HCl H+ + Cl+
NH3 + H+ NH4
HCl + NH3
+
Cl- + NH4
Exemple 2 : dissociation de lacide thanoque
CH3COOH H+ + CH3COOH2O + H+ H3O+
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
Conclusion : une raction acide base est un transfert de proton de l acide vers la base
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
53
54
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
Constante dacidit - Classification des
couples acide/base
I.
CONSTANTE DE REACTION
1.
Ractions limites
Soit la raction suivante: R1 + R2 P1 + P2. Les concentrations des quatre corps en quilibre sont
lies par une constante appele constante de raction, quotient de raction ou constante dquilibre
note Q ou K.
Q
[P 1][P 2]
[R 1][R 2]
Remarque : cette constante ne dpend que de la temprature
2.
Cas particuliers des ractions en solution aqueuse
Lorsque lun des ractifs ou des produits est en trs grand excs par rapport aux autres (cas de leau
dans les solutions dilues), on dfinit une constante de raction Kr, dite constante rduite, pour
laquelle ce constituant en excs ne figure pas.
Exemple : dissociation de lacide actique dans leau.
CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-
II.
[H 3 O ][CH3 COO]
[H 2 O][CH3 COOH]
Kr
[H 3 O ][CH3 COO]
(sans unit)
[CH3 COOH]
CONSTANTE DACIDITE DUN COUPLE ACIDE/BASE
1.
quilibre de dissociation dun acide faible.
Soit AH un acide faible du couple AH/A- . AH + H2O A- + H3O+
La constante de raction, note ici Ka est appele constante dacidit du couple AH/A-. Par
dfinition : Kr
Ka
[A ][H 3 O ]
[AH]
On dfinit aussi le pKa du couple AH/A- selon la relation : pka
logKa ou Ka
10 pKa
Exemple : mise en solution de lacide benzoque
C5H6COOH + H2O C6H5COO- + H3O+
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
Ka
A 25C, Ka
6,3.10
soit pKa
[C 6 H 5 COO ][H 3 O ]
[C 6 H 5 COOH]
4,20
2.
quilibre de la protonation dune base faible
Soit A une base faible du couple AH/A-. A- se protonise partiellement dans leau selon lquation :
A- + H2O AH + OHKr
Multiplions lexpression par
Kr
[OH ][AH]
[A]
[H 3 O ]
, on obtient :
[H 3 O ]
[OH ][AH]
[A]
[H 3 O ]
[AH]
=
[OH ][H 3 O ]
[H 3 O ] [A ][H O ]
3
kr
Ke
Ka
La constante de protonation Kr est appele constante de basicit note KB.
+ + OHExemple : HN3 + H2O NH4
Pour le couple NH+4/NH3 ; Ka
3.
6,3.10 10 25C
Kr
Ke
Ka
10 14
6,3.10 10
1,6.10 5
Constante dacidit
Un couple acide faible/ base faible not AH/A- est caractris par une seule constante, note Ka
appele constante dacidit et dfinit par :
Ka
4.
[A ][H 3 O ]
(valeurs des Ka et pKa 25C, voir fiche documents annexes)
[AH]
Relation entre pH et le pKA
logKa
[A ][H 3 O ]
= (log([A - ][H 3 O ]) log[AH])
[AH]
log
pKa=-log[A-] log [H3O+] + log [AH]
pH
5.
pKa = pH - log [A-] + log [AH]
[ AH]
pKa log
Les couples H3O+/H2O et H2O/OH-
Les couples acide/base auxquels participe leau, peuvent galement tre caractriss par une
constante Ka, dduite des rsultats suivants.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
55
56
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
H3O+ + H2O = H2O + H3O+ ; KA
[H 3 O ]
[H 3 O ]
[H 3 O ]
Ke
Pour le couple H3O+/H2O : Ka = 1 et pKa = 0
H2O + H2O = OH- + H3O+ ; KA
OH
10
25C
Pour le couple H2O/OH- : Ka = 10-14 et pKa = 14 25C.
Pour tout couple acide faible/base faible : 0
pKa
14
L'ion hydronium H3O+ est l'acide le plus fort existant dans l'eau. En solution aqueuse, tous les acides
forts sont plus forts que l'acide H3O+.
L'ion hydroxyde OH- est la base la plus forte existant dans l'eau. En solution aqueuse, toutes les bases
fortes sont plus fortes que la base OH-.
pKa
bases fortes
-
HO
bases faibles
H2O
Ka
III.
H2O 14
acides faibles
+
H3O 0
acides forts
CLASSIFICATION DES COUPLES ACIDE BASE
1.
Force dun acide faible
Un acide faible est dautant plus fort quil cde plus facilement un proton H+. On peut utiliser deux
mthodes pour comparer la force de deux acides faibles.
a) Comparaison des pH
Considrons 25C deux solutions S1 dacide formique, lautre S2 dacide actique, toutes deux de
concentration C=10-2 mol/L. Nous mesurons pour S1, pH1 = 2,9 et pour S2, pH2 = 3,4
-
Dans S1 : HCOOH + H2O HCOO- + H3O+
[HCOO-]1=[H3O+]1=10-pH = 10-2,9 = 1,26.10-3 mol/L
Dans S2 : CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COOSerigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
[CH3COO-]2 = [H3O+]2 = 10-pH = 10-3,4 = 4.10-4 mol/L
Nous constatons que [H3O+]1 > [H3O+]2 donc lacide mthanoque est le plus dissoci donc le plus
fort.
Conclusion : pour comparer deux acides faibles, il suffit de comparer les pH des
deux solutions de mme concentration de ces acides : lacide le plus fort est
celui qui donne la solution dont le pH est plus faible.
b) Comparaison des constantes dacidit
(1)
AH + H2O A- +H3O+
(2)
Ka
[A ][H 3 O ]
[AH]
Plus lacide AH est fort, plus lquilibre est dplac dans le sens (2), plus les concentrations [A-] et
[H3O+] sont leves et plus celle de [AH] est faible.
Conclusion : un acide faible est dautant plus fort que sa constante dacidit Ka
est leve donc son pKa est faible.
Exemple : acide mthanoque (Ka1 =1,8.10-4, soit pKa1 = 3,8) est plus fort que lacide thanoque
(Ka2 = 1,8.10-5, soit pKa2 = 4,8)
2.
Force dune base faible
a) Comparaison des pH
Pour deux bases faibles de mme concentration, la plus forte est celle qui a la
valeur de pH la plus leve.
b) Comparaison des Ka
Pour deux bases faibles, la plus forte est celle qui a le Ka le plus faible, soit le
pKa le plus lev.
3.
Classification (voir fiche annexe)
4.
Domaine de prdominance
a) Cas gnral : diagramme de prdominance
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
57
58
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
Lorsque des espces acido-basiques conjugues coexistent en solution, lexpression du pH scrit
sous la forme : pH
A . Une espce chimique A est dite prdominante devant une
[ AH]
pKa log
espce B ds que [A]>[B].
-
Si pH<pKa
A <0
[ AH]
log
A
<1
[AH]
[A-]<[AH]
Pour pH<pKa, lespce acide prdomine dans la solution. Lintervalle de pH<pKa est le domaine de
prdominance de lespce acide.
-
Si pH>pKa
A >0
[ AH]
log
A
>1
[AH]
[A-]>[AH]
Pour pH>pKa, la base A- est lespce prdominante. Lintervalle de pH>pKa est de domaine de
prdominance de lespce A-.
-
Si pH=pKa
A
=0
[ AH]
log
A
=1
[AH]
[A-]=[AH]
Pour pH=pKa, les deux espces ont la mme concentration molaire.
[AH]= [A-]
AH prdomine
A- prdomine
[AH] > [A-]
[AH] < [A ]
pKa
pH
b) Application aux indicateurs colors
Dfinition
Les indicateurs colors sont constitus par des couples acides faibles/bases faibles dont les espces
conjugues ont des teintes diffrentes.
Zone de virage et teinte sensible
Soient HInd et Ind- les espces acide et basique dun indicateur color : HInd + H2O Ind- + H3O+,
associe au pKai(HInd/Ind-).
La teinte dun indicateur color en solution aqueuse dpend de lespce qui prdomine donc du pH
de la solution.
pH
pKa i log
Ind
[
HInd]
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
Nous admettrons que lindicateur prend sa teinte acide, c'est--dire celle de HInd si
Ind
[ HInd]
Pour pH
1
10
log
Ind
[
HInd]
pH
[Hind]
Ind
10
pKa i 1
pKa i 1, lindicateur prend sa teinte acide.
Lindicateur prend sa teinte basique, c'est--dire celle de Ind- si
Ind
>10
[ HInd]
log
Ind
[
HInd]
Pour pH
pH
pKa i 1 .
pKa i 1, lindicateur prend sa teinte basique.
teinte sensible
zone de virage
teinte acide
pKai - 1
pKai
teinte basique
pH
pKai + 1
Les conventions prcdentes conduisent dfinir un domaine de pH tel que :
pKa i 1
pH
pKa i 1
Ce domaine de pH dans lequel lindicateur color possde alors une teinte plus ou moins variable est
appel zone de virage. Cette teinte, dite sensible, est la superposition de teinte basique et de la
teinte acide.
5.
Diagramme de distribution
Soit une solution contenant lacide du couple AH et sa base conjugue A-. On dfinit les pourcentages
de forme acide et de forme basique par %[AH] et %[A-] tels que :
[AH]
%[AH] =
100
[ AH ] [ A ]
et
[ A ]
%[A ] =
100
[ AH ] [ A ]
-
Le pKA du couple AH/A- correspondant au pH
lorsque les deux espces ont mmes
concentrations, il est donc dtermin par le point
dintersection des courbes %[AH] et %[A-] en
fonction du pH.
Ce diagramme permet de choisir correctement un
indicateur color en fonction de la zone de pH
dans laquelle on veut travailler.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
59
60
Constante dacidit - Classification des couples acide/base
IV.
REACTION ACIDO-BASIQUE
1.
Dfinition
Soient les couples A1/B1 et A2/B2. Mlangeons A1 et B2, il y a transfert de H+ de A1 vers B2 selon
lquation : A1 + B2 B1 + A2
Kr
Kr
[B1][A2]
[A1][B2]
[ B 1 ] [ A2 ]
[ A1 ] [ B 2 ]
[H 3 O ]
[H 3 O ]
constante de la raction.
[B1][H 3 O
[A1]
Kr
[ A2 ]
[B2][H 3 O
Kr
Ka1
1
Ka2
Ka1
Ka2
Ka1 (Constante dacidit du couple jouant le rle dacide) et Ka2 (Constante dacidit du couple
jouant le rle de base).
Si Kr>104 la raction est totale ou est dite quantitative
2.
Prvision des ractions acido-basiques
Selon les valeurs des constantes d acidit KA1 et KA2 des deux couples A1/ B1 et A2/ B2, trois possibilits
peuvent tre envisages.
-
KA1 <KA2 ou pKA1 >pKA2 : la constante d quilibre de la raction K est plus petite que 1. L acide
et la base ont des domaines de prdominance communs.
La raction est bloque si pKA1 >>pKA2
KA1 =KA2 ou pKA1 =pKA2 : la constante de raction est gale 1. Les deux formes acides et les
deux formes basiques ont des domaines de prdominance gaux.
La raction acido-basique n volue pas.
KA1 >KA2 ou pKA1 <pKA2 : la constante d quilibre K est suprieure 1. L acide et la base ont
des domaines de prdominance compltement disjoints. Ils ragissent donc ensemble et la
raction est considre comme totale si K 104.
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Raction entre acide faible-base forte et vice versa Effet tampon
Raction entre acide faible-base forte et
vice versa Effet tampon
I.
REACTION ENTRE UN ACIDE FAIBLE ET UNE BASE FORTE
1.
Exemple de lacide actique et de la soude
On a : pKa(CH3COOH/CH3COO-)= 4,8 et pKa(H2O/OH-)=14
Lquation de la raction est : CH3COOH + OH- CH3COO- + H2O. valuons la constante de la
Ka(acide) 10 4,8
raction : K r
1,6.109
Ka(base)
10 14
K
104 la raction entre lacide actique et la soude est quantitative et lquation de la raction
peut scrire sous la forme : CH3COOH + OH-
CH3COO- + H2O
Remarque : la raction entre un acide faible et une base forte est toujours totale.
2.
tude exprimentale de pH=f(V)
Le dosage de VA=20 mL dune solution dacide actique de concentration CA inconnue par une
solution de soude CB= 10 2 mol/L permet de tracer le graphe pH=f(VB) ci-dessous.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
61
62
Raction entre acide faible-base forte et vice versa Effet tampon
3.
Principales caractristiques du graphe
La courbe pH=f(VB) est croissante et peut tre dcompose en quatre parties :
-
Une partie AB o le pH croit assez nettement.
Une partie BC o le pH varie peu, la courbe tant quasi rectiligne.
Une partie CD o lon observe une variation brusque du pH moins importante que dans le cas
dun acide fort.
Une partie DF o le pH varie faiblement et tend vers une asymptote horizontale.
Par ailleurs la courbe change deux fois de concavit : elle prsente donc deux points dinflexions.
tudions les proprits de ces deux points dinflexion.
4.
quivalence acido-basique
A lquivalence la quantit de base verse est gale celle de lacide initialement prsent.
CAVA = CBVBE
nH3O+ = nHO-
Dans lexemple du cours : CA
VBE
CB V
A
10 2 mol/L
Remarque: On dtermine les coordonnes du point quivalent par la mthode des tangentes.
pHE = 8,2, lquivalence la solution est basique car on a une solution aqueuse dactate de sodium.
5.
Demi-quivalence acido-basique
VBE
A la demi-quivalence correspond VB
2 .
Soit n0 le nombre de mole de CH3COOH initial et ni(OH-) le nombre de mole de OH- introduit la
demi-quivalence.
CH3COOH + OH-
CH3COO- + H2O
n0
A la demi-quivalence : nCH3COO-=nCH3COOH ni(OH-) = n0 2
n0
nCH3COO-= 2 .
Nous avons aussi la 1/2 quivalence :
n0
nCH3COOH, restant =nCH3COOH, initial - nCH3COO- = n0 2
n0
2
Donc la demi-quivalence : nCH3COO- = nCH3COOH soit [CH3COO-] = [CH3COOH]
Do pH
CH3 COO
[CH3 COOH]
pKa log
pKa
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Raction entre acide faible-base forte et vice versa Effet tampon
A la demi-quivalence pH=pKa
Dans le cas de lexemple du cours : le pKa(CH3COOH/CH3COO-) = 4,8
II.
REACTION ENTRE ACIDE FORT ET BASE FAIBLE
On fera le rsum de cette partie de par ses ressemblances avec les ractions acide faible- base forte
?
++H O
Soit la raction entre lacide chlorhydrique et lammoniac : NH3 + H3O+ NH4
2
Kr
Ka(acide)
Ka(base)
100
6,3.10 10
1,6.109
La raction entre un acide fort et une base faible est toujours totale (quantitative).
A lquivalence le pH est acide car on a une solution aqueuse de chlorure dammonium qui est acide.
III.
EFFET TAMPON
1.
Dfinition de leffet tampon
Un systme en solution a un effet tampon lorsquune addition modre dacide, de base ou une
dilution modre, nentraine pratiquement pas une variation de pH de cette solution.
2.
Solutions tampons
Une solution tampon contient un acide faible et sa base conjugue en concentration voisine : le pH
dune telle solution est voisin du pKa de ce couple.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
63
64
Raction entre acide faible-base forte et vice versa Effet tampon
Les mlanges obtenus vers la demi-quivalence du dosage dun acide faible par une base forte ou du
dosage dune base faible par un acide fort sont des solutions tamponnes.
IV.
APPLICATIONS
1.
Application 1
On dispose dun volume V=20 mL dune solution dacide actique et dactate de sodium, chacun la
concentration C=10-2 mol/L.
On ajoute alors un volume VB=1 mL dune solution dhydroxyde de sodium CB = 10-2 mol/L.
1. Sachant que pKa(CH3COOH/CH3COO-)=4,8 ; dterminer le pH de la solution initiale.
2. crire lquation bilan de la raction qui se produit. Dterminer sa constante. Que peut-on
en dduire ?
3. Le pH de la solution vaut 4,9. Vrifier le. Conclure.
Solution : 1) pH=pKa=4,8 ; 2) CH3COOH + OH-
CH3COO- + H2O ; Kr=1,6.109 raction totale 3)
pH=4,9 (faire le tableau davancement)
2.
Application 2
Soit une solution dacide thanoque
1. tablir la relation qui lie , C et Ka o reprsente le coefficient dionisation, Ka la
constante dacidit et C la concentration molaire volumique.
2. Montrer que pour un acide faible, tant ngligeable devant 1, le pH de la solution peut
1
scrire : pH 2 (pKa logC). Calculer pH pour Ka=2.10-5 et C=2.10-1 mol/L.
3. On mlange un volume V1=3L de la solution aqueuse dacide thanoque de concentration
C1=2.10-1 mol/L avec V2 = 2L de soude C2 = 2.10-1 mol/L. Calculer le pH de la solution
obtenue.
Solution : 1) Ka=C /(1- ) 2) <<1
Ka=C
pH=1/2(pKa logC)= 2,69 3) pH=5
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides -amins : lments de strochimie
Les acides -amins : lments de
strochimie
I.
QUELQUES NOTIONS DE STEREOCHIMIE
La strochimie tudie les positions relatives dans lespace des atomes dune molcule et les
proprits physico-chimiques qui en dcoulent.
1.
Rappels
a) Gomtrie de quelques molcules
Molcule de mthane : CH4
HCH =10928 ; dC-H = 109 pm (1 pm = 10-12m)
Un carbone qui change quatre liaisons covalentes simples est un carbone ttradrique. La molcule
de mthane est un ttradre.
CONVENTION POUR LA REPRESENTATION EN PERSPECTIVE
H
liaison dans le plan
liaison en avant du plan
liaison en arrire du plan
H
H
Molcule dthylne : C2H4
HCH = HCC = 120
La molcule est plane
H
dC-H = 109 pm
C
dC=C = 134 pm
C
H
Molcule dactylne : C2H2
la molcule est linaire : dC-H = 109 pm ; dCC = 121 pm
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
65
66
Les acides -amins : lments de strochimie
b) Conformation
La conformation est lensemble des positions relatives des atomes dans lespace du fait de la rotation
autour des axes de liaisons covalentes. On passe dune conformation une autre par une simple
rotation autour des liaisons de covalence.
Exemple : reprsentation de Newman de la molcule dthane
HH
H
C
H
H
H
H
H
HH
H
H
Reprsentation en perspective
H
H
position clipse
position dcale
Reprsentation de Newman
2.
Carbone asymtrique
a) Dfinition
Un atome de carbone ttradrique li quatre atomes ou groupe datomes diffrents est un carbone
H
asymtrique. On le note C*.
Exemple : le 1-bromo-1-chlorothane.
C*
H3C
Cl
Br
b) nantiomres :
Lorsquune molcule possde un C*, pour la reprsenter dans lespace on peut construire deux
molcules diffrentes car elles ne sont pas superposables. Ces deux molcules sont symtriques
lune de lautre par rapport un plan ; on dit aussi quelles sont images lune de lautre dans un
miroir plan. Ces deux molcules sont appeles nantiomres ou nantiomorphes.
C
H3C
Br
Cl
Cl
Br
CH3
miroir
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides -amins : lments de strochimie
c) Chiralit
Un objet non superposable son image dans un miroir est dit chiral. Lorsque deux molcules sont
des nantiomres chacune delles est chirale.
3.
Configuration
La configuration dune molcule possdant un carbone asymtrique (C*) est dtermine par la faon
dont sont disposs les 4 atomes ou groupes datomes lis au C*.
La configuration est diffrente de la conformation ; en effet pour passer dune configuration une
autre des rotations autour des liaisons covalentes ne suffisent pas. Il faut rompre des liaisons et
changer les dispositions des diffrents atomes lis au C*.
4.
Activit optique
a) Lumire polarise
La lumire polarise est obtenue en faisant passer de la lumire naturelle travers un polarisateur
(miroir). Un rayon de lumire polarise est une onde lectromagntique qui se propage le long dun
rayon. En chaque point du rayon lumineux vibrent en phase un champ lectrique E et un champ
magntique B (tels que E
B). Le plan form par E et B est perpendiculaire la direction de
propagation. Le plan form par E et la direction de propagation du rayon lumineux est le plan de
vibration.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
67
68
Les acides -amins : lments de strochimie
b) pouvoir rotatoire
Lorsquune substance qui est traverse par une lumire polarise provoque une rotation du plan de
vibration dun angle : on dit que cette substance est optiquement active ou quelle possde un
pouvoir rotatoire.
Pour un observateur qui reoit la lumire :
-
sil voit la rotation se faire vers la droite (sens des aiguilles dune montre), la substance est
dite dextrogyre (+).
Sil voit la rotation se faire vers la gauche (sens trigonomtrique) la substance est dite
lvogyre (-).
Les nantiomres ont des activits optiques : lun est (+) lautre (-).
Remarque : un mlange quimolaire (50%) de chacun est optiquement inactif : cest un mlange
racmique.
II.
LES ACIDES -AMINES
1.
Dfinition
Un acide -amin est un compos organique qui possde un groupe carboxylique COOH et un
groupe amino NH2 lis au mme atome de carbone (position 2 ou ). Leur formule gnrale est :
R
CH
COOH
NH2
Remarque : il existe des acides -amins, le groupe amino NH2 se trouve en position 3 ou .
2.
Nomenclature
Les acides -amins drivent des acides carboxyliques par remplacement dun atome dhydrogne
de la chaine carbone par un groupe NH2, ainsi le groupe carboxylique est dsign par la
terminaison oque et le groupe NH2 par le prfixe amino .
Exemples :
H2N
CH2
COOH
H3C
CH
H3C
acide 2-aminothanoque
CH COOH
NH2
acide 2-amino-3-mthylbutanoque
Remarque : la plus part des acides -amins portent des noms usuels
H2N
CH2
COOH
acide 2-aminothanoque
ou la glycine (Gly)
H3C
CH
CH
CH3
NH2
COOH
acide 2-amino-3-mthylbutanoque
ou la valine (Val)
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides -amins : lments de strochimie
H3C
CH
COOH
H3C
CH
NH2
CH3
acide 2-aminopropanoque
ou alanine (Ala)
3.
CH2
HC
COOH
NH2
acide 2-amino-4-mthylpentanoque
ou La leucine(Leu)
Structure
a) Carbone asymtrique
A lexception de la glycine toutes les molcules dacides -amins possdent un C* donc pour toutes
molcule dacides -amins excepte la glycine il y a deux nantiomres.
H
R
COOH
NH2
C
HOOC
R
H2N
b) Reprsentation spatiale
Par convention on dispose la molcule dacide -amin de la faon suivante :
-
Le groupe carboxyle COOH est plac en haut et le groupe alkyle R est plac en bas.
Ces deux groupes (-COOH et R) sont situs en arrire par rapport au plan contenant le
carbone asymtrique.
Le groupe amino NH2 et latome dhydrogne H sont situs en avant du carbone
asymtrique.
COOH
COOH
H
NH2
H2N
c) Reprsentation de Fischer
Pour obtenir la reprsentation de Fischer on projette orthogonalement sur le plan de la molcule
dacide -amin ainsi dispose dans lespace.
COOH
COOH
H
C
R
NH2
H2N
Remarque : deux nantiomres ont des reprsentations de Fischer diffrentes.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
69
70
Les acides -amins : lments de strochimie
d) Nomenclature L et D
Par dfinition lnantiomre dont le groupe amino NH2 se projette droite dans la reprsentation
de Fischer est nomme D : on dit quil a la configuration D.
Lnantiomre dont le groupe amino NH2 se projette gauche dans la reprsentation de Fischer est
nomme L : on dit quil a la configuration L.
Remarque : il nexiste pas de relation entre la configuration L ou D dun acide -amin et son
caractre dextrogyre ou lvogyre. Exemple : la L-alanine est dextrogyre (+)
A lexception de la glycine toutes les molcules dacides -amins sont chirales (car ils possdent un
C*) et donc une activit optique.
III.
PROPRIETES CHIMIQUES
1.
Proprits acido-basiques
a) Caractre ampholyte des acides -amins
R
CH
COOH
NH2
Considrons les molcules dacide -amins, le groupe COOH est donneur de proton H+ tandis que
NH2 est capteur de proton. La proximit de ces groupes facilite le transfert intramolculaire du
proton H+ du groupe COOH vers le groupe NH2. On a ainsi un quilibre chimique suivant
lquation :
R
CH
COOH
CH COO+
NH3
(ion dipolaire)
NH2
Lion dipolaire est appel Amphion ou Zwitterion. Cest la forme majoritaire sous laquelle lacide amin se prsente en solution. LAmphion est un ampholyte car il peut capter un proton H+ par le
groupe COO- ou librer un proton par le groupe -NH3+.
b) Caractre acide
R
CH COO+
NH3
+ H2O
CH
COO-
H3O
NH2
Couple Amphion/anion :
Si R=H
pKa=9,8
CH COO+
NH3
CH COONH2
c) Caractre basique
R
CH COO+
NH3
+ H2O
CH
COOH
+
HO
NH3
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides -amins : lments de strochimie
Couple cation/Amphion :
Si R=H
CH COOH
+
NH3
pKa=2,3
CH COO+
NH3
d) Domaine de prdominance
En solution lacide -amin se prsente sous 4 formes :
R
CH COOH , cette espce est minoritaire quelque soit le pH de la solution
NH2
CH COO- , cette espce est majoritaire si le pH de la solution est tel que pKa1
+
NH3
CH COOH
+
NH3
CH COONH2
pH
pKa2
, cette espce est majoritaire si pH<pKa1
, cette espce est majoritaire si pH>pKa2
+Amphion A
cation A+
pKa1
anion A-
pH
pKa2
Exercice dapplication :
Dans un litre deau on dissout 1,5g de glycine. Par dissolution de gaz chlorhydrique ou de
dhydroxyde de sodium on peut faire varier le pH de la solution sans modifier son volume. La glycine
a pour pKa1=2,4 et pour pKa2=9,8.
1. Calculer la concentration de la solution.
2. Sur un axe gradu en pH situer les domaines de prdominance des diverses espces.
3. On fixe successivement le pH de la solution 1 ; 8 et 11. Placer ces valeurs sur laxe gradu de la
question 2) et dterminer pour chaque cas la concentration de lespce prdominante.
4. On se place pH=6,1 ; montrer que le cation et lanion ont la mme concentration.
Resolution:
A NH2-CH2-COOH ; M=75 g/mol.
1. C
n
V
m
MV
+
2.
H3N
1,5
75 1
2.10 2 M.
CH2 COOH 2,4
A+ 1
pKa1
3. Calcul des concentrations
Si pH=1 A+ prdomine
C=[A]+[A+]+[A]+[A-]
H3N CH2 COO-
A+-
9,8 H N
2
8 pKa2
CH2
COO-
A-
11
pH
[A+]+[A]+[A-], [A] est toujours ngligeable quelque soit le pH.
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
71
72
Les acides -amins : lments de strochimie
Ka1
(1) et (2)
[A ]1
[A ]
[A ]
[H ][A ]
[A ]
Ka1
[H ]
Ka1
(2)
[H ]
C
Ka1
[H ]
[A ]
1
[A ]
(1)
[A ]
[A ]1
[A+]+[A]= car A- est ultra minoritaire : C
1,9.10
M, noter [H+]=10-pH
- si pH=8, lAmphion est majoritaire
C=[A]+[A+]+[A]+[A-]
Ka2
[H ][A
[A ]
(3) et (4)
[A ]
[A]+[A-]
[A
[A ]
[A
[A ] (3)
[A ]1
Ka2
(4)
[H ]
C
Ka2
[H ]
1,97.10
- si pH=11, lanion est majoritaire
C
[A-]+[A]=[A-](1+[A]/[A-])=[A-](1+[H+]/Ka2)
C
=1,88.10-2 M
[H ]
1
Ka 2
[A-]
4. si pH=6,1 [A+]=[A-] , on a alors C=[A+]+[A]+[A-]
En tirant les expressions de [A] dans les quations (2) et (4) et en faisant lgalit, on obtient la
2
[H ]
+
relation suivante : [A ]/ [A ] Ka Ka
1
[A+]= [A-]
1 2
2.
Condensation entre molcules dacide -amins
a) liaison peptidique
La condensation entre deux molcules dacide -amins sobtient en liminant une molcule deau
selon lquation :
O
R1
CH
NH2
C
OH
O
H2N
CH
R2
R1 CH
OH
La molcule obtenue est un dipeptide. Le groupe H3C
acides -amins est appels liaison peptidique.
O
NH
NH2
C
HC
R2
NH
C
OH
H2O
CH3 qui relie les deux
b) Polycondensation : les polypeptides
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides -amins : lments de strochimie
R1
.... + H2N CH
O
C
O
CH
H2N
OH
R1
NH
R1
HC
+ ....
OH
R1
OH
R1
H3C
O
CH
H2N
O
CH C
NH
NH
R1
CH
+ n H2O
CH3
On obtient un polypeptide qui est caractris par la prsence de plusieurs liaisons peptidiques.
Comme les polypeptides, les protines sont des polyamides. Seulement les protines ont des chaines
beaucoup plus longues, se sont des macromolcules. Leur masse molculaire est suprieure 10000
g/mol.
Exemples : lhmoglobine (66000 g/mol) ; kratine (cheveux) ; insuline (pancras).
3.
Raction entres deux acides -amins
Considrons un mlange quimolaire de deux acides -amins, la condensation entre ces deux peut
se faire de diffrentes manires et on obtient en milieu quatre dipeptides diffrents.
O
H2N
CH2 C
O
NH
HC
OH
CH3
H2N
H2N
CH2 C
OH
glycine
O
H2N
CH
OH
H3C
CH
H3C
O
C
O
NH
(2)
CH2
H2O
OH
HAla-GlyOH
(3)
O
H2N
alanine
H2O
HGly-AlaOH
(1)
CH2 C
O
NH CH2 C
OH
H2O
Gly-Gly
(4)
O
H2N HC
CH3
O
NH
HC
CH3
H2O
OH
Ala-Ala
a) Synthse slective dun dipeptide
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
73
74
Les acides -amins : lments de strochimie
Si on veut obtenir dun seul dipeptide (par exemple le dipeptide HGly-AlaOH ou la glycine est
terminal N) partir dun mlange quimolaire de glycine et dalanine, on doit empcher les autres
ractions (2,3 et 4) qui sont des ractions parasites pour cette synthse. Pour cela il faut :
- Bloquer ou dsactiver les groupes qui ne participent pas la raction
- Activer lun des groupes qui participe la raction.
b) Exemple dune synthse slective du dipeptide HGly-AlaOH
1re tape : blocage du groupe COOH de lalanine en le transformant en ester
O
H3C
NH2
CH
OH
H3C
CH C
OH
NH2
H2O
2me tape : blocage du groupe NH2 de la glycine en le transformant en amide
O
R1
C
Cl
O
H2N
CH2 C
R1
O
NH
CH2 C
OH
OH
HCl
3me tape : activation du groupe COOH de la glycine en le transformant en chlorure
dacyle
O
R1
O
NH
CH2 C
OH
O
R1
SOCl 2
O
NH
CH2 C
Cl
SO 2
HCl
4me tape : formation de la liaison peptidique
O
R1
O
NH
CH2 C
Cl
O
H3C
CH C
NH2
R1
O
NH
CH3
O
CH2 C NH CH
O
C
HCl
R
5me tape : rgnration des groupes bloqus
O
R1
NH
CH3
O
CH2 C NH CH
O
C
O
+ 2 H2O
O
H2N
CH2 C
O
NH
CH C
H3C
OH
O
R1 C
OH
OH
HGly-AlaOH
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Les acides -amins : lments de strochimie
Remarque : lors de la rgnration du groupe NH2 il ne faut pas rompre la liaison peptidique pour
cela on utilise des esters particuliers tels que : C6H5-CH2-COOCl ; CH3-CH2-COOCl qui donnent des
amides faciles dtruire.
c) Aspect strochimie de la synthse peptidique
Le blocage, lactivation ou la rgnration dun groupe ne modifie pas sa position dans la molcule ;
au cours de la synthse peptidique la configuration des atomes de carbone asymtrique situs en
se conservent.
Exemple : A partir dun acide -amin de configuration L, on obtient des dipeptides de configuration
LL, mais si on part dun mlange racmique (c'est--dire qui contient des acides -amins L et des
acides -amins D) on obtient quatre dipeptides diffrents suivant leur configuration.
Exemple : considrons un mlange racmique dalanine et de valine. Si nous synthtisons le
dipeptide Ala-Val.
Ala(L)-Val(D) Ala(L)-Val(L)
Ala(D)-Val(L) Ala(D)-Val(D)
http://physiquechimie.sharepoint.com | Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
75
76
Documents annexes
Documents annexes
Serigne Abdou Wahab Diop Lyce Limamou Laye | http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
(C) Wahab Diop
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
SERIGNE ABDOU WAHAB DIOP
Professeur au lyce de Bambey
Ceci est une note (trace crite) de cours et ne peut en aucun cas se substitue du
cours magistral du professeur. Vous pouvez utiliser ce document en tant que
complment d
Ce document comporte des notes de mes cours en classe de Terminales
S1 & S2 au lyce Limamou Laye l attention de mes lves et collgues.
Notes de COURS CHIMIE TERMINALES S
(C) Wahab Diop
Vous pouvez utiliser librement ce document
mais en aucun vous ne devez enlever les
rfrences de son propritaire. Ayez un
profond respect la proprit intellectuelle.
Ce document a t tlcharger sur le site:
http://physiquechimie.sharepoint.com
Vous aimerez peut-être aussi
- ShituruDocument36 pagesShituruMANDE KANONGA JÉRÔME0% (1)
- Chimie Wts PDFDocument79 pagesChimie Wts PDFAbdoul-lahi Saâdou MoussaPas encore d'évaluation
- Science Physique SBT SetDocument154 pagesScience Physique SBT Setmariame1999100% (6)
- Physique en PremièreDocument88 pagesPhysique en PremièreCecile Spykiline100% (4)
- Fascicule 1Document101 pagesFascicule 1Bariche Bondo moloki100% (2)
- Annale Bac - TS2 - 26 - 05 - 2k15 - Daouda-NdongDocument315 pagesAnnale Bac - TS2 - 26 - 05 - 2k15 - Daouda-Ndongbibos8318100% (1)
- Annale Bac S2 R-1Document140 pagesAnnale Bac S2 R-1koliepierre144Pas encore d'évaluation
- Annale Bac 2011 Sces Phy.1Document119 pagesAnnale Bac 2011 Sces Phy.1wilfried zadoc kouadio100% (2)
- CPex 2012 2017Document30 pagesCPex 2012 2017Gerardin100% (1)
- Physique TerminaleDocument175 pagesPhysique TerminaleCecile Spykiline100% (6)
- Chimie Terminale D VraiDocument79 pagesChimie Terminale D VraiJean Emmanuel Ouedji100% (3)
- Fascicule Ts PhysiqueDocument66 pagesFascicule Ts PhysiqueBrice Gael Tsop100% (2)
- Annale de Physique TD FinaleDocument172 pagesAnnale de Physique TD Finalejunior100% (6)
- Chimie Terminales C Et E - Collection Eurin-GiéDocument291 pagesChimie Terminales C Et E - Collection Eurin-Giéjannate el maoukour100% (3)
- Physique Chimie 1Document72 pagesPhysique Chimie 1Jalel Khediri75% (4)
- Annale Physique TC (Finale)Document250 pagesAnnale Physique TC (Finale)MocasPas encore d'évaluation
- Annale Bac TS CorrigésDocument129 pagesAnnale Bac TS Corrigésmultibio100% (4)
- Exercices de Chimie TSDocument108 pagesExercices de Chimie TSbeebac2009100% (4)
- Fascicule de Physique Ts 2018Document75 pagesFascicule de Physique Ts 2018Yahya Aidara50% (2)
- Fascicule MathsDocument115 pagesFascicule MathsNgos Jean100% (2)
- PHYSIQUE - TERMINALE - S.PDF Accélération Lois Du Mouvement de Newton 3Document1 pagePHYSIQUE - TERMINALE - S.PDF Accélération Lois Du Mouvement de Newton 3seybou DRAME100% (2)
- Wahab Diop Physique Wss LSLLDocument93 pagesWahab Diop Physique Wss LSLLhakima032Pas encore d'évaluation
- Exo Chimie TS2 CorrigéDocument102 pagesExo Chimie TS2 Corrigéy7mdwxk9x6100% (3)
- Exercices de Physique TSDocument116 pagesExercices de Physique TSerrairachid100% (4)
- Physique Terminale S Tome 1 135Document3 pagesPhysique Terminale S Tome 1 135ely ElassryPas encore d'évaluation
- Physique ChimieDocument759 pagesPhysique ChimieAggouni Mohamed100% (2)
- Terminale D PDFDocument75 pagesTerminale D PDFMohieddine Khaili100% (7)
- Annales Sciences Physiques Tle CeDocument78 pagesAnnales Sciences Physiques Tle CePetit Frère À Jésus100% (4)
- Chimie Tes 2019-1Document151 pagesChimie Tes 2019-1efoalphonse5Pas encore d'évaluation
- Bac S 2018 Washington Mathématiques ObligatoireDocument9 pagesBac S 2018 Washington Mathématiques ObligatoireLETUDIANTPas encore d'évaluation
- Recueil de Sujets PC Bac C-EDocument96 pagesRecueil de Sujets PC Bac C-EAmond Marc-vianney100% (2)
- BAC 2009 AfriqueDocument43 pagesBAC 2009 AfriqueDivin MAKITAPas encore d'évaluation
- Annale de Sciences PhysiquesDocument65 pagesAnnale de Sciences PhysiquesDabo88% (8)
- Exercice Sur Les Suite s1 PDFDocument2 pagesExercice Sur Les Suite s1 PDFDavid60% (5)
- Livre Physique Bac Math PDFDocument320 pagesLivre Physique Bac Math PDFعبد الحميد100% (5)
- Annales - Sciences - Physiques Tle DDocument67 pagesAnnales - Sciences - Physiques Tle DSIRIKI YEO100% (2)
- Wahab Diop Physique WTL LSLLDocument72 pagesWahab Diop Physique WTL LSLLHe Ke100% (2)
- Terminale D PDF PDFprof - Com 2Document1 pageTerminale D PDF PDFprof - Com 2jjPas encore d'évaluation
- Mathematiques Par Les Problemes Au BrevetD'EverandMathematiques Par Les Problemes Au BrevetÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Du Point à l'Espace: Introduction formelle à la géométrie euclidienneD'EverandDu Point à l'Espace: Introduction formelle à la géométrie euclidiennePas encore d'évaluation
- Introduction à la physique nucléaire et des particulesD'EverandIntroduction à la physique nucléaire et des particulesPas encore d'évaluation
- Exercices sur les vecteurs et les espaces vectorielsD'EverandExercices sur les vecteurs et les espaces vectorielsPas encore d'évaluation
- Galilei Et Einstein: Réflexions Sur La Théorie De La Relativité General - La Chute Libre Des CorpsD'EverandGalilei Et Einstein: Réflexions Sur La Théorie De La Relativité General - La Chute Libre Des CorpsPas encore d'évaluation
- Exercices d'intégrales de lignes, de surfaces et de volumesD'EverandExercices d'intégrales de lignes, de surfaces et de volumesPas encore d'évaluation
- Alcool 3Document79 pagesAlcool 3Cecile Spykiline100% (2)
- Chimie en SecondeDocument40 pagesChimie en SecondeCecile Spykiline100% (6)
- Cours Chimie TLDocument34 pagesCours Chimie TLDaboPas encore d'évaluation
- Cours D'orthop PDFDocument74 pagesCours D'orthop PDFIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- DM5 Methodes de Suivi Cinetique CorrectionDocument4 pagesDM5 Methodes de Suivi Cinetique CorrectionIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- 3 - Psychologie de L EnfantDocument38 pages3 - Psychologie de L EnfantIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Anatomie Et Physiologie de L'oeilDocument36 pagesAnatomie Et Physiologie de L'oeilIkram Chamixo50% (2)
- Enseignement ThéoriqueDocument2 pagesEnseignement ThéoriqueIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Le Fonctionnement Des Cellules Musculaires TC PDFDocument3 pagesLe Fonctionnement Des Cellules Musculaires TC PDFIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- TP1 Transformations Lentes Ou Rapides 2-Correction PDFDocument5 pagesTP1 Transformations Lentes Ou Rapides 2-Correction PDFIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Mitochondrie PDFDocument16 pagesMitochondrie PDFIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Transformations Lentes Et Transformations RapidesDocument5 pagesTransformations Lentes Et Transformations RapidesIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- 1 Cours Respiration Fermentation PDFDocument8 pages1 Cours Respiration Fermentation PDFIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- 1-Respiration Et FermentationDocument9 pages1-Respiration Et FermentationIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Traitement Des Essences PetrochimieDocument9 pagesTraitement Des Essences Petrochimiebedouil30Pas encore d'évaluation
- Examen Catalyse Enzymatique 2020-2021Document3 pagesExamen Catalyse Enzymatique 2020-2021PaulPas encore d'évaluation
- I-Principe de L'extraction Par Solvant.: Correction Du TP: Extraction Du Diiode D'Un Antiseptique: La BetadineDocument2 pagesI-Principe de L'extraction Par Solvant.: Correction Du TP: Extraction Du Diiode D'Un Antiseptique: La BetadineNumi MitchouPas encore d'évaluation
- Les Fonctions en Chimie Organique (PartieII) (2023-2024 ) Dr.N ZAABATDocument32 pagesLes Fonctions en Chimie Organique (PartieII) (2023-2024 ) Dr.N ZAABATyouldalbert1380Pas encore d'évaluation
- Examen 20041Document4 pagesExamen 20041Dahlia SawadogoPas encore d'évaluation
- Chapitre4.1 Biochimie Cellulaire Et FonctionnelleDocument7 pagesChapitre4.1 Biochimie Cellulaire Et Fonctionnelledraboissouf174Pas encore d'évaluation
- Hal, La SonochimieDocument6 pagesHal, La SonochimieMaka MagnaretognePas encore d'évaluation
- Memoire Abbas WahebDocument86 pagesMemoire Abbas WahebKouassi Christian KoffiPas encore d'évaluation
- Nouveau FasciculeDocument75 pagesNouveau FasciculebourdettePas encore d'évaluation
- Etude Sur Les AsphaltènesDocument7 pagesEtude Sur Les Asphaltènesayoub hamidanePas encore d'évaluation
- Devoir - Équilibrage Des Réactions ChimiquesDocument2 pagesDevoir - Équilibrage Des Réactions Chimiquesjasmine rollockPas encore d'évaluation
- Les OrganometalliquesDocument14 pagesLes OrganometalliquesIkram ADNANEPas encore d'évaluation
- Devoir C3 2023 2Document4 pagesDevoir C3 2023 2lenamouneraPas encore d'évaluation
- TSP2SP3Ch19T5-TP16 Correction Synthese AspirineDocument2 pagesTSP2SP3Ch19T5-TP16 Correction Synthese AspirineSelma Hassuon100% (1)
- Rapport de Stage PDFDocument51 pagesRapport de Stage PDFIhsan AfriadPas encore d'évaluation
- TD2 SMP3 2021 2022 CorrectionDocument6 pagesTD2 SMP3 2021 2022 Correctionhamza.tarfaouiPas encore d'évaluation
- Série 1 Espèces Chimiques Extraction Séparation Et Identification Despèces Chimiques TC BIOF Réalisée Par PR JENKAL RACHIDDocument3 pagesSérie 1 Espèces Chimiques Extraction Séparation Et Identification Despèces Chimiques TC BIOF Réalisée Par PR JENKAL RACHIDzzomaridoPas encore d'évaluation
- Serie2 Alcanes 1eres2!22!23Document2 pagesSerie2 Alcanes 1eres2!22!23hzq44xqvh4Pas encore d'évaluation
- Schema Typique Sur LDocument3 pagesSchema Typique Sur Ljkatumbwe1Pas encore d'évaluation
- Chimie Générale-MQIA - GC CUPK 23-24Document29 pagesChimie Générale-MQIA - GC CUPK 23-24fulbertkorgo703Pas encore d'évaluation
- File 2Document2 pagesFile 2ayaelalami530Pas encore d'évaluation
- TP3A Orga 2024Document12 pagesTP3A Orga 2024clouclourouPas encore d'évaluation
- PolyTPphyveg L2 Semestre 4 2023-2024Document8 pagesPolyTPphyveg L2 Semestre 4 2023-2024Sandrine AchPas encore d'évaluation
- Hétérocyclique: ChimieDocument60 pagesHétérocyclique: ChimieThamer CHERIETPas encore d'évaluation
- TD 7 Complexo 2021-2022Document3 pagesTD 7 Complexo 2021-2022ouiambouzidi23Pas encore d'évaluation
- Exposé Extraction Liq-LiqDocument5 pagesExposé Extraction Liq-LiqIch RakPas encore d'évaluation
- Thèse: Abdelghani MADANIDocument153 pagesThèse: Abdelghani MADANIBrahim ChakirPas encore d'évaluation
- Formation Bitume z10 PDFDocument32 pagesFormation Bitume z10 PDFFatima YahiaPas encore d'évaluation
- FDS Carbothane 133 HB - A - 10 2015Document11 pagesFDS Carbothane 133 HB - A - 10 2015Ayman JadPas encore d'évaluation