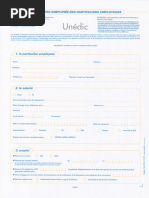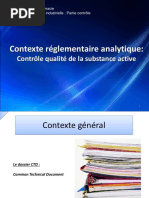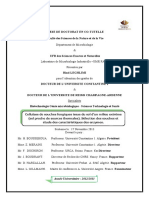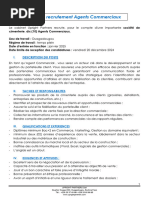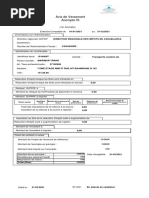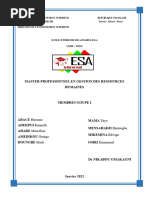Gestion: Application D'une Analyse AMDEC Au LBM
Gestion: Application D'une Analyse AMDEC Au LBM
Transféré par
mii moDroits d'auteur :
Formats disponibles
Gestion: Application D'une Analyse AMDEC Au LBM
Gestion: Application D'une Analyse AMDEC Au LBM
Transféré par
mii moDescription originale:
Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Gestion: Application D'une Analyse AMDEC Au LBM
Gestion: Application D'une Analyse AMDEC Au LBM
Transféré par
mii moDroits d'auteur :
Formats disponibles
gestion |qualité
Application d’une analyse AMDEC au LBM
La norme EN NF ISO 15189 comporte des exigences particulières quant à la qualité et la compétence à appliquer au
laboratoire de biologie médicale dont l’analyse de risque. Dans ce contexte, l’analyse des modes de défaillance, de leurs
effets et de leur criticité, dite analyse AMDEC, fondée sur la prévention, apporte une aide précieuse notamment lorsque
l’exigence client est forte : elle s’appuie sur une méthodologie qui détaille avec rigueur toutes les étapes. Tout risque de
défaillance est ainsi repéré et des actions correctives et préventives mises en place.
Méthodologie de l’analyse AMDEC
L’
AMDEC, analyse des modes de défaillance, débats, de veiller au respect de la méthode, de
de leurs effets et de leur criticité, consiste La méthodologie de notre étude AMDEC se rédiger l’AMDEC et d’organiser les réunions. La
en une analyse méthodique d’un sys- décompose en quatre phases : multidisciplinarité est une condition de réussite
tème ou d’un processus et du risque fondée sur Ř phase 1 : de l’analyse.
la prévention. – analyse des mécanismes de défaillance ;
– identification des modes de défaillance de Sélection du processus étudié
Pourquoi développer une analyse manière exhaustive et de leur effet ; L’analyse du processus étudié, validée par l’équipe,
de risques au LBM Ř phase 2 : consiste en une décomposition du processus en
L’analyse AMDEC est mise en place au sein du – évaluation de la criticité ; différentes tâches élémentaires et une identifi-
laboratoire pour les processus analytiques où – affectation d’un niveau de criticité à chaque cation des acteurs qui sont des clients internes
l’exigence client est forte et pour lesquels les effet du mode de défaillance ; (concernés par la prochaine étape du processus)
facteurs d’incertitude ne sont pas totalement – détermination des modes de défaillances criti- et des clients externes (patients, services clini-
maîtrisés par le laboratoire. Nous utiliserons dans ques par comparaison au seuil de criticité accep- ques, EFS) (figure 1).
ce travail l’AMDEC process qui permet d’identifier table prédéfini ;
les risques potentiels appliqués au processus de Ř phase 3 : Analyse qualitative des défaillances
réalisation des groupes sanguins. – proposition d’actions de réduction du risque ; L’analyse qualitative des défaillances corres-
Les buts de l’analyse sont de recenser les modes – diminution du niveau de criticité des défaillan- pond à une étape de recensement des modes
de défaillances à chaque étape du processus ces en agissant sur un ou plusieurs des critères de défaillance, c’est-à-dire la manière dont une
étudié, d’en évaluer l’impact ou la criticité et les (fréquence, détection) ; fonction est affectée (perte, altération, dérive...).
effets sur l’ensemble des séquences du proces- Ř phase 4 : Un mode de défaillance potentiel est défini par les
sus, et d’en analyser les causes ; il s’agit d’une – synthèse de l’étude, décisions ; dysfonctionnements potentiels associés à chaque
méthode inductive au sens où elle s’appuie, pour – effectuer un bilan et fournir les éléments per- étape du processus, ainsi que par son effet sur le
l’analyse des modes de défaillances, sur une logi- mettant de définir les actions à effectuer. client et par sa (ses) cause(s).
que de décomposition du processus en différentes Les causes potentielles qui ont entraîné la
étapes élémentaires. On s’intéressera alors aux Application pratique défaillance sont à rechercher dans les facteurs
défaillances liées au mauvais fonctionnement de Constitution d’un groupe de travail d’incertitude et trouvent leur origine dans les cinq
ces différentes étapes et à leurs répercussions Ces personnes ont un rapport avec le procédé grandes familles du diagramme d’Ishikawa (5M).
sur le client et la réglementation en contribuant analysé et ont une expérience significative au L’effet du mode de défaillance est constitué des
également à la capitalisation technique. niveau des différentes tâches décrites ; une des symptômes par lesquels est décelée l’altération.
personnes du groupe occupe la fonction d’ani- À chaque étape du processus, sont décrits les
Contexte normatif de la norme ISO mateur, a pour rôle de conduire et orienter les moyens de prévention des causes et de détection
CEI 15189
La norme NF EN ISO 15189 « Laboratoires d’ana-
lyses de biologie médicale. Exigences particulières
concernant la qualité et la compétence » (version
d’août 2007) contient plusieurs recommandations
dans lesquelles s’inscrit l’analyse de risque :
– 5.6 Assurer la qualité des procédures
analytiques ;
– 5.6.1 Le laboratoire doit concevoir des systèmes
de contrôles de qualité permettant de vérifier que
la qualité prévue des résultats est bien obtenue...
– 5.6.2 Toutes les composantes importantes de
l’incertitude doivent être prises en compte... | Figure 1. Décomposition du processus des tâches élémentaires.
24 OptionBio | Lundi 24 octobre 2011 | n° 461
qualité | gestion
des causes et modes de défaillance prévus, c’est- tage de l’AMDEC sont de deux types préventives actions qui améliorent la détectabilité (contrôles,
à-dire quelles sont les dispositions existantes : ou correctives. inspections, détrompeurs, etc.).
procédures, contrôles, détrompeurs, inspections, Les actions préventives planifiées à une fré- Les actions font l’objet d’un suivi avec un res-
tests, formation du personnel qui évitent l’appari- quence régulière sont destinées à éviter que la ponsable de l’action, un délai de réalisation, un
tion de la cause ou du mode de défaillance. défaillance se produise (formation, procédures, budget (le cas échéant). Une fois ces actions
maîtrise statistique du processus analytique, mises en œuvre, un nouvel indice de criticité est
Analyse quantitative des défaillances par exemple) ; les actions correctives sont des calculé : IPR’.
Pour chaque association mode de défaillance-
effet-cause, nous évaluons : la gravité (G), la
fréquence d’apparition de la cause (F), la proba- Tableau I. Échelle de cotation de la gravité ou de la sévérité d’une défaillance
pour le client.
bilité de non-détection (D) et le calcul de l’indice
Niveau de risque Intitulée Impact sur la satisfaction client en cas Nature des conséquences
de priorité des risques (IPR) ou la criticité, soit le Gravité (G) de la classe d’incident
calcul de G x F x D. 1-2 Mineure Pas d’effet sur le client final. Il n’y a pas Diminution acceptable de la disponibilité
de risque. ou de la qualité de service sans impact
Gravité de l’effet pour le client suivant (de 1 à 10) et sans conséquence pour le patient.
L’échelle de gravité ou de sévérité (G) est 3-4 Significative L’impact reste localisé au poste de Sans conséquence pour le patient.
travail ou à l’opérateur. Dégradation de la
une évaluation de l’importance de l’effet de la
disponibilité ou de la qualité de service a
défaillance potentielle sur le client (tableau I). priori acceptable/Non-respect partiel des
contraintes.
Fréquence d’occurrence de la cause (de 1 à 10) 5-6 Majeure L’impact se généralise aux clients Retard dans le rendu des résultats sans
L’échelle de fréquence (F) ou de vraisem- internes. Dégradation inacceptable des conséquences pour la prise en charge
blance permet de coter la probabilité d’appa- performances ou de la qualité du service. thérapeutique du patient.
7-8 Critique L’impact est visible par les clients Retard dans le rendu des résultats avec
rition de la cause de la défaillance à partir de
externes. des conséquences modérées pour la
l’expérience vécue sur des processus similaires prise en charge thérapeutique du patient.
(tableau II). 9-10 Catastrophique Retard dans le rendu des résultats
ou la qualité du résultat avec des
Échelle de détectabilité (de 1 à 10) conséquences très importantes pour la
Avec l’échelle de détectabilité, il s’agit de coter la prise en charge thérapeutique du patient.
probabilité de non-détection à une étape donnée
pour une cause donnée en tenant compte des dis- Tableau II. Échelle de cotation du risque d’apparition d’une défaillance.
positions de prévention et de détection en place Niveau de risque Estimation des risques Fréquence retenue dans l’étude
(tableau III). Fréquence (F) que le processus a de produire le défaut
1-2 Probabilité très faible : apparition ou Annuelle ou biannuelle.
occurrence quasi nulle.
Classification des modes défaillances
3-4 Probabilité faible : très peu de défaut ; 2 à 3 fois par an.
Après hiérarchisation des autres modes de occurrence improbable.
défaillances selon leur IPR, nous déterminons 5-6 Probabilité moyenne : défauts apparus 1 fois par mois.
le seuil au-dessus duquel il faut déclencher des occasionnellement ; occurrence peu probable.
mesures. Nous traiterons en priorité les causes 7-8 Probabilité élevée : défauts fréquents ; 1 fois par semaine.
des modes de défaillance présentant les plus for- occurrence très probable.
tes gravités puis les plus fortes criticités. Pour la 9-10 Probabilité très élevée : le défaut se produit 1 fois par jour.
très fréquemment ; occurrence maximale.
criticité, le seuil critique est fixé à 100 dans notre
étude. Les modes de défaillances dont l’effet est
coté 9 ou 10 sont traités en priorité : le but est de Tableau III. Échelle de cotation du risque de non-détection d’une défaillance..
hiérarchiser les actions à conduire sur un proces- Niveau de risque Détectabilité
sus en travaillant par ordre décroissant de criticité Détection D
pour réduire le risque de défaillance (figure 2). 1-2 Très facilement détectable ; très faible probabilité de ne pas détecter le défaut (par
exemple, contrôle systématique).
3-4 En général souvent facilement détectable ; faible probabilité de ne pas détecter
Les actions
le défaut (défaut évident).
La finalité de l’AMDEC après la mise en évidence 5-6 Détectable dans 50 % des cas, détection pas systématique ; probabilité modérée de ne
des différents modes de défaillance et l’estimation pas détecter le défaut.
des risques associés est de définir des actions 7-8 Beaucoup plus difficilement détectable ; probabilité élevée (contrôle subjectif ou
pour réduire ces risques. Les actions engagées contrôle par échantillonnage non adapté).
planifiées et enregistrées dans le tableau de pilo- 9-10 Quasiment jamais détectable (pas de contrôle prévu, critères non contrôlables, défaut
non apparent).
OptionBio | Lundi 24 octobre 2011 | n° 461 25
gestion |qualité
| Figure 2.
Hiérarchisation des
actions à conduire
sur un processus par
ordre décroissant de
criticité pour réduire le
risque de défaillance.
Conclusion L’analyse des modes de défaillance, de leurs effets FADIL NIMANBEG
Bien que logique, la méthode requiert une très et de leur criticité (AMDEC) fournit de plus une Consultant Qualité Laboratoires, évaluateur Qualité COFRAC,
bonne connaissance du processus étudié, une vision de synthèse sur un processus donné, une auditeur IRCA, auditeur IATF, Paris
grande rigueur, et sa mise en œuvre exige un tra- recherche exhaustive des sources d’incertitude
vail souvent important et fastidieux. Cette approche possibles, un échange actif entre les différents VÉRONIQUE LEMARQUIS
permet de détecter les étapes du processus les acteurs, un support de réflexion, de décision et Auditeur ICA, Biologiste, RAQ, LBM Billiemaz,
plus critiques et de déduire un plan d’action limité d’amélioration et enfin une base de capitalisation Toulon (83)
aux dysfonctionnements estimés les plus critiques du savoir qui sera actualisée à chaque événement
pour le client des résultats d’analyses. de la vie du processus analytique. |
26 OptionBio | Lundi 24 octobre 2011 | n° 461
Vous aimerez peut-être aussi
- attestation_france_travail_2024Document5 pagesattestation_france_travail_2024liladuribreuxPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Électromécanique Des Systèmes AutomatiséDocument43 pagesRapport de Stage Électromécanique Des Systèmes Automatiséيوزرسيف زعيم القوة83% (12)
- Controle PipetteDocument7 pagesControle PipetteAbdou Hababa100% (1)
- SH Gta 04Document168 pagesSH Gta 04sofianesedkaouiPas encore d'évaluation
- PFE 3 controle de qualité au laboratoire biochimie (Enregistré automatiquement) - ADIL (2)Document43 pagesPFE 3 controle de qualité au laboratoire biochimie (Enregistré automatiquement) - ADIL (2)fz626013Pas encore d'évaluation
- MéthodesDocument11 pagesMéthodesžï ŹÎPas encore d'évaluation
- Controle Qualite MP-PF - 2019-2020 5e Année PharmacieDocument7 pagesControle Qualite MP-PF - 2019-2020 5e Année Pharmaciezineb fellaPas encore d'évaluation
- Contrôle de Qualité Interne Partie II: Iche TechniqueDocument2 pagesContrôle de Qualité Interne Partie II: Iche TechniqueLaboratoire BiochimiePas encore d'évaluation
- Paramètres D'urgence en BCecole Inf2015Document17 pagesParamètres D'urgence en BCecole Inf2015Khaled LajmiPas encore d'évaluation
- SH Gta 14Document26 pagesSH Gta 14yassinePas encore d'évaluation
- SG1-04 Recommandations - Pour - La - Maitrise - de - Letape - de - Prelevement - Des - Echantillons - BiologiquesDocument36 pagesSG1-04 Recommandations - Pour - La - Maitrise - de - Letape - de - Prelevement - Des - Echantillons - BiologiquesErrk 5060Pas encore d'évaluation
- Guidlines Pour La StabilitésDocument33 pagesGuidlines Pour La Stabilitéscavalo2080Pas encore d'évaluation
- ASLO Test ImmunoturbidimétriqueDocument2 pagesASLO Test ImmunoturbidimétriquetararPas encore d'évaluation
- Fiche Infos BSF Humatem Automate À NumérationDocument4 pagesFiche Infos BSF Humatem Automate À NumérationNinoPas encore d'évaluation
- Lab Gta 26Document24 pagesLab Gta 26Neo MaximusPas encore d'évaluation
- 5 - Controle MPUPDocument8 pages5 - Controle MPUPSou RirePas encore d'évaluation
- Libération ParamétriqueDocument3 pagesLibération ParamétriqueInes SahraouiPas encore d'évaluation
- Validation Dune Méthode Analytique - 5e Année Pharmacie - 2019-2020Document3 pagesValidation Dune Méthode Analytique - 5e Année Pharmacie - 2019-2020zineb fellaPas encore d'évaluation
- BPL Version 1Document71 pagesBPL Version 1Na FesPas encore d'évaluation
- 20-Mirfendereski 2Document53 pages20-Mirfendereski 2skPas encore d'évaluation
- 30 QCM IpcDocument7 pages30 QCM IpcHamza ZabetPas encore d'évaluation
- Validation D'une Méthode D'analyse-Partie IDocument15 pagesValidation D'une Méthode D'analyse-Partie IRim AbouttiPas encore d'évaluation
- Rapport Groupe QualificationDocument65 pagesRapport Groupe Qualificationguomeile1998100% (1)
- Habilitation BiochimieDocument1 pageHabilitation BiochimieToto FollyPas encore d'évaluation
- Les Cartes de Contrôles Au Laboratoire D'environnementDocument22 pagesLes Cartes de Contrôles Au Laboratoire D'environnementYana ClementPas encore d'évaluation
- XN-31 Malaria Detail Aid Brochure FRDocument4 pagesXN-31 Malaria Detail Aid Brochure FRsarahloba100100% (1)
- ACB HDL Cholesterol DirectDocument2 pagesACB HDL Cholesterol Directmohamedilyes1431100% (1)
- Telecharger Le Plan Qualite Du Mali Globe Network - 5a35fc281723dd159ad44d8dDocument27 pagesTelecharger Le Plan Qualite Du Mali Globe Network - 5a35fc281723dd159ad44d8dToure ahmedPas encore d'évaluation
- Analyses en Microbiologie - AntibactériensDocument12 pagesAnalyses en Microbiologie - AntibactérienskaladdinoPas encore d'évaluation
- 2 Analyse MicrobiologiqueDocument16 pages2 Analyse Microbiologiquenanti martialPas encore d'évaluation
- 2890940691Document6 pages2890940691achrafPas encore d'évaluation
- ProcedFR LAB P 507 Microbiologie Incertitude de Mesure FRDocument9 pagesProcedFR LAB P 507 Microbiologie Incertitude de Mesure FRFATMA YOUCEFIPas encore d'évaluation
- 57FameckLStExuperyINNO2010 2 14Document3 pages57FameckLStExuperyINNO2010 2 14ayoub dahbi100% (1)
- Aide À La ValidationDocument20 pagesAide À La ValidationkmeriemPas encore d'évaluation
- TD Périodicité Méthode de La DériveDocument1 pageTD Périodicité Méthode de La DérivebenhalimaPas encore d'évaluation
- F Tech - UREE C311 V14 04 2022Document5 pagesF Tech - UREE C311 V14 04 2022bouabidPas encore d'évaluation
- HPLCDocument13 pagesHPLCnassima ghallabiPas encore d'évaluation
- Cours BPL Partie 1Document11 pagesCours BPL Partie 1Mohamed HamelPas encore d'évaluation
- BS240PRODocument2 pagesBS240PRODidi DinaPas encore d'évaluation
- Lab Gta 59Document20 pagesLab Gta 59FATMA YOUCEFIPas encore d'évaluation
- Qvpro003 Méthodologie Validation Nettoyage Éqts-06Document27 pagesQvpro003 Méthodologie Validation Nettoyage Éqts-06gora.diagne2019Pas encore d'évaluation
- Rouge de PyrogalollDocument5 pagesRouge de Pyrogalollmina ycPas encore d'évaluation
- Medical Taux de Prothrombine Temps de Quick INRDocument2 pagesMedical Taux de Prothrombine Temps de Quick INRarrachetoiPas encore d'évaluation
- Contrôle de Qualité Et Sources D'erreurs en Antibiogramme (MDocument5 pagesContrôle de Qualité Et Sources D'erreurs en Antibiogramme (MJ-Paul Déto100% (5)
- SG3-04 Recommandations - Concernant - La - Transmission - Des - Resultats - Dexamens - de - Biologie - MedicaleDocument30 pagesSG3-04 Recommandations - Concernant - La - Transmission - Des - Resultats - Dexamens - de - Biologie - MedicaleErrk 5060100% (1)
- Procédure HCG Version 1Document10 pagesProcédure HCG Version 1Houessinon Yves Socrate100% (1)
- Principes de Base Des Bonnes Pratiques de FabricationDocument41 pagesPrincipes de Base Des Bonnes Pratiques de Fabricationabderrahim asbbanePas encore d'évaluation
- Formation Vérification de Méthode ReduitDocument53 pagesFormation Vérification de Méthode ReduitAnonh AdikoPas encore d'évaluation
- Les BPFDocument8 pagesLes BPFfifi fifiPas encore d'évaluation
- SG2 06.incertitude MesureDocument9 pagesSG2 06.incertitude MesureAmine KOTTIPas encore d'évaluation
- 4-Procedures LABMDocument86 pages4-Procedures LABMOumar m GoudienkiléPas encore d'évaluation
- Cours 5ème Année Contrôle Qualité de La Substance Active.Document34 pagesCours 5ème Année Contrôle Qualité de La Substance Active.Paul Fathead100% (1)
- Abc-311259-Biologie Durgence Les Recommandations 2018 de La SFBCDocument22 pagesAbc-311259-Biologie Durgence Les Recommandations 2018 de La SFBCBeyond BordersPas encore d'évaluation
- POS de Nettoyage - Paillasse ReviseeDocument3 pagesPOS de Nettoyage - Paillasse Reviseeelphaz kankokoPas encore d'évaluation
- Chapitre III Qualité D'eau À Usages PharmaceutiquesDocument5 pagesChapitre III Qualité D'eau À Usages PharmaceutiquesWissam marwa HamdinePas encore d'évaluation
- Validation Du Procede de Fabrication Dans L'Industrie Pharmaceutique, Appliquee Aux Formes Solides OralesDocument150 pagesValidation Du Procede de Fabrication Dans L'Industrie Pharmaceutique, Appliquee Aux Formes Solides OralesKhouloud BougachaPas encore d'évaluation
- LEGHLIMI 2013 ArchivageDocument159 pagesLEGHLIMI 2013 ArchivageLina Safa0% (1)
- Validation D'une Méthode AnalytiqueDocument51 pagesValidation D'une Méthode AnalytiqueWàlid LàkehalPas encore d'évaluation
- Dosage de La Matière Grasse Dans Le Café VertDocument6 pagesDosage de La Matière Grasse Dans Le Café VertEssassi AmmarPas encore d'évaluation
- Procedure Evaluation CompetenceDocument4 pagesProcedure Evaluation CompetenceESSO100% (1)
- Sta Compact TraduitDocument391 pagesSta Compact Traduitأنور مازوز أبو يوسف0% (1)
- AmdecDocument1 pageAmdecHarold fotsingPas encore d'évaluation
- Contrat JoueurDocument8 pagesContrat Joueurmajanimouayadi13Pas encore d'évaluation
- Cours Droit AdministratifDocument11 pagesCours Droit AdministratifElvira KwamouPas encore d'évaluation
- CPA2 2005 CceDocument14 pagesCPA2 2005 CceSami Ayadi0% (1)
- Chef D'equipeDocument2 pagesChef D'equipehediriahi2017Pas encore d'évaluation
- Corrige 2016 Dcg Ue11 Controle de GestionDocument6 pagesCorrige 2016 Dcg Ue11 Controle de GestionRz Tsiry GaïtanPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document27 pagesChapitre 1Hajji Mohamed KarimPas encore d'évaluation
- Avis de recrutement Agents CommerciauxDocument2 pagesAvis de recrutement Agents Commerciauxmechant086Pas encore d'évaluation
- AcompteDocument1 pageAcompteABDELGHANI SOURAOUIPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 GRHDocument6 pagesChapitre 2 GRHcoraliedocoto15Pas encore d'évaluation
- Evaluation Appartement Debbiche - Résidense Carthage Ben KemlaDocument8 pagesEvaluation Appartement Debbiche - Résidense Carthage Ben KemlaLyesAnnabiPas encore d'évaluation
- DS 04 04 03 BadDocument1 pageDS 04 04 03 BadGédéon AkradjiPas encore d'évaluation
- 7 - Manager Le ChangementDocument71 pages7 - Manager Le ChangementRazik DjafriPas encore d'évaluation
- Avis D Impot 2023 Sur Les Revenus 2022Document3 pagesAvis D Impot 2023 Sur Les Revenus 2022ndesrochePas encore d'évaluation
- Cours de Programmation Urbaine2Document9 pagesCours de Programmation Urbaine2olo100% (1)
- Les 10 Etapes Pour Construire Votre Machine A VentesDocument5 pagesLes 10 Etapes Pour Construire Votre Machine A VentesPautot ManonPas encore d'évaluation
- Cahier de Charge Inspection Approfondie Juillet 2020-FinaleDocument34 pagesCahier de Charge Inspection Approfondie Juillet 2020-FinaleMed Hedi MestiriPas encore d'évaluation
- Corige Finale1Document41 pagesCorige Finale1kakeraPas encore d'évaluation
- AcreDocument4 pagesAcreabderrahim yacoubiPas encore d'évaluation
- EXPO FinalDocument17 pagesEXPO FinalKenneth AdekpuiPas encore d'évaluation
- Programme de Travail Du MFP 2022 2024Document29 pagesProgramme de Travail Du MFP 2022 2024Rachid ElPas encore d'évaluation
- Cas Pratique Choix Des Investissement Etcapital RisqueDocument16 pagesCas Pratique Choix Des Investissement Etcapital RisqueGantin Letchede100% (1)
- Management du developpement talent cours 1Document57 pagesManagement du developpement talent cours 1sirine.othman.rhPas encore d'évaluation
- CV Canadien SoudeurDocument3 pagesCV Canadien SoudeurGlory WabenoPas encore d'évaluation
- Fiche TPEDocument4 pagesFiche TPESenateu Ibrahima100% (1)
- (Reski) Guide ReskillingDocument10 pages(Reski) Guide ReskillingRafaPas encore d'évaluation
- Dossier Fiches GroupeDocument6 pagesDossier Fiches GroupeJirono Kano100% (1)
- Pont MoilouyaDocument42 pagesPont MoilouyaHôssñy ÖhädöüPas encore d'évaluation
- Resume Du Cours de Legislation en Matiere EconomiqueDocument20 pagesResume Du Cours de Legislation en Matiere EconomiqueObed Lumbrade100% (1)