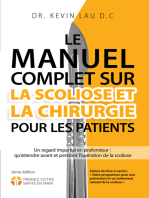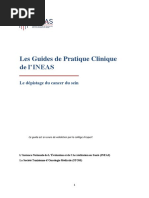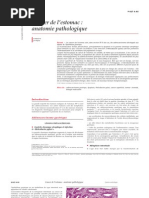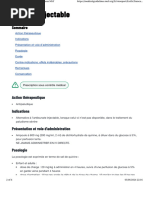Syndrome Orificiel Dans Les Cancers Gastriques en Chirurgie Generale Chu Gabriel Toure
Syndrome Orificiel Dans Les Cancers Gastriques en Chirurgie Generale Chu Gabriel Toure
Transféré par
Youssouf DIARRADroits d'auteur :
Formats disponibles
Syndrome Orificiel Dans Les Cancers Gastriques en Chirurgie Generale Chu Gabriel Toure
Syndrome Orificiel Dans Les Cancers Gastriques en Chirurgie Generale Chu Gabriel Toure
Transféré par
Youssouf DIARRATitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
Syndrome Orificiel Dans Les Cancers Gastriques en Chirurgie Generale Chu Gabriel Toure
Syndrome Orificiel Dans Les Cancers Gastriques en Chirurgie Generale Chu Gabriel Toure
Transféré par
Youssouf DIARRADroits d'auteur :
Formats disponibles
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DU MALI
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE UN PEUPLE UN BUT UNE FOI
SCIENTIFIQUE
Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie
Année : 2014-2015 N°……. /
TITRE
SYNDROME ORIFICIEL DANS LES
CANCERS GASTRIQUES EN
CHIRURGIE GENERALE CHU
GABRIEL TOURE
THESE
Présentée et Soutenue Publiquement le 12 Décembre 2015
Devant la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie
Par : Sékou Madou Sissoko
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat)
JURY
Président : Professeur Djibo Mahamane DIANGO
Membre : Docteur Thierno Madane DIOP
Co-directeur : Professeur Bakary Tientigui DEMBELE
Directeur : Professeur Gangaly DIALLO
1
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
DEDICACES
ET
REMERCIEMENTS
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Je rends Grâce :
A DIEU, le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. De
m’avoir donné la vie, la santé et l’opportunité de mené à terme cette thèse. Qu’il
nous accorde sa grâce.
Au prophète Mohamed(PSL) :
Prions DIEU qu’il nous donne la foi et votre amour afin que vous soyez à côte
de nous à tout moment de la vie.
Je dédie ce travail :
¾ A mon père Madou Sissoko
Chère père ; le moment est venu pour moi de vous remercier, la sagesse de vos
conseils, la confiance et l’attention avec lesquelles vous m’avez assisté me
resteront inoubliables. Jamais je ne saurai vous rendre un hommage à la hauteur
de vos efforts consentis. Je suis très fière d’être ton fils.
Trouvez ici toute ma gratitude. On aura toujours besoin de vos bénédictions et
conseils. Que DIEU vous donne longue vie.
¾ A ma mère Kadiatou Soucko
Chère mère ; ce travail est le couronnement de tes souffrances, de ta patience.
Nous avons bénéficié auprès de toi toute la tendresse qu’une mère doit à ses
enfants. Ton soutien moral et matériel ne nous a jamais fait défaut même à
distance. Puisse ALLAH le tout puissant te fasse bénéficier du fruit de ta
patience. Amen!
¾ A ma grande sœur Sira Demba
Je n’ai jamais manqué votre soutien moral et financier. Vous mérité une mention
Particulière. Merci
¾ A mon grand frère Aliou Sissoko
Merci, vous avez pleinement joué votre rôle dans l’élaboration de ce travail.
¾ A mes oncles et tantes
L’amour et l’attention particulière avec lesquels vous m’aviez traité depuis mon
3
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
enfance, resteront gravés dans ma mémoire. Je prie le tout puissant et
miséricordieux de vous garder le plus longtemps possible en vie et en bonne
santé.
¾ A mes frères et sœurs
Pour les efforts que vous avez toujours consenti pour l’équilibre de la famille et
la continuité de mes études jusqu’à ce jour.
¾ A mes cousins et cousines
¾ Aux familles Samaké, Diallo, Traoré , Sidikou
Vous m’aviez accueil avec de la tendresse, du respect et beaucoup
d’encouragement. Merci pour tout cela, je n’oublierais jamais.
Je remercie :
¾ A mon encadreur Pr Bakary Tientigui Dembélé
Merci pour vos conseils, la qualité de l’encadrement dont j’ai bénéficié de vous.
Qu’ALLAH le tout puissant vous donne longue vie dans la santé et le bonheur.
¾ A mes collègues du service
Seydou Pamatek, Maimouna Tolo, Amara Coulibaly, Aboubacar Diakité,
Mohamed Diabaté, Fatoumata Dicko, Sayon Diakité, Abasse Diaby…
Merci pour la bonne ambiance de travail, les marques de sympathie et les
nombreux services rendus.
A tous je souhaite très bonne carrière.
¾ A tout le personnel de la clinique COMED
Il ne serait pas juste de ma part de ne pas vous réserver une mention spéciale.
A vos côtés, j’ai appris beaucoup de choses; travailler avec vous a été un réel
plaisir, merci pour tout
¾ A tout ce que j’ai connu à travers l’école Mahamadou Fofana, Oumar
Diamouténé, Youssif Sinaba, Dr Sagara, Dr Traoré Bakary, Dr Traoré
Seydou …
¾ A tous mes Enseignants depuis l’école primaire jusqu’à la FMOS.
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Pierre Tangara, Djélifily, Tounkara, Aboubacar Sissoko, Sory Sidibé, Pr Tiéman
coulibaly, Pr Kalilou watara,…
¾ A mes amis du quartier
Malick Traoré, Djigui Diakité, Moctar Sylla, Yaya Traoré, Gaoussou Sissoko,
Arouna Samaké, Ama Nantoumè, Daouda Dembélé, N’faly Samaké, Moussa
Coulibaly, Koman Kéita …
¾ A tous ceux qui de près ou de loin m’ont aidé à la réalisation de ce
travail.
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
HOMMAGES
AUX JURY
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
HOMMAGES AUX HONORABLES MEMBRES DU JURY
A notre maitre et présidant du jury Pr Djibo Mahamane Diango
¾ Professeur titulaire en anesthésie-réanimation à la FMOS.
¾ Chef du département d’anesthésie-réanimation et médecine d’urgence du
CHU Gabriel Touré.
¾ Chef du service d’accueil des urgences du CHU Gabriel Touré
¾ Secrétaire général de la société d’anesthésie-réanimation et médecine
d’urgence du Mali.
¾ Membre de la société française d’anesthésie-réanimation(SFAR).
Cher maitre,
Vous nous faites un grand honneur en acceptant de siéger dans ce jury. Homme
de science, vous nous avez appris les gestes essentiels de la réanimation à la
faculté. Nous retenons de vous un maître modeste, simple, rigoureux au contact
facile et souriant. Vous êtes un modèle pour nous étudiants de cette faculté.
Veuillez agrée, cher maitre, l’expression de nos sincères remerciements pour
votre contribution à ce travail.
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
A notre maitre et juge Dr thierno Madane Diop
¾ Chef du service de réanimation au CHU Gabriel Touré.
¾ Praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré.
¾ Médecin commandant des forces armées du Mali.
¾ Membre des sociétés malienne et sénégalaise d’anesthésie- réanimation et
médecine d’urgence.
Cher maitre,
La spontanéité avec laquelle vous avez acceptée de juger ce travail ne nous a
guère surpris.
Nous apprécions en vous l’homme de sciences modeste et calme.
Votre expérience et votre dévouement envers vos patients traduit éloquemment
votre culture scientifique.
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
A notre maître et co-directeur Pr Bakary Tientigui Dembélé
¾ Maître de conférences à la FMOS
¾ Spécialise de chirurgie générale
¾ Praticien hospitalier au CHU Gabriel TOURE
¾ Chargé de cours à l’Institut National de Formation en Science de la Santé
¾ Membre de la Société de Chirurgie du Mali(SOCHIMA)
¾ Membre de l’Association des chirurgiens d’Afrique Francophone(ACAF)
Cher Maître,
L’étendue de vos connaissances, votre disponibilité constante et votre humilité
ont permis de nous sentir très à l’aise à vos cotés et d’améliorer nos
connaissances cliniques.
L’occasion nous est donnée ce jour, de vous réitérer toute notre reconnaissance
pour votre enseignement de qualité. Nous vous remercions pour votre
dévouement inébranlable à notre formation et nous vous assurons cher maître,
que vos conseils et recommandations ne seront pas vains.
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
A notre Maitre et Directeur de Thèse Pr Gangaly Diallo
¾ Pr titulaire en chirurgie viscérale à la FMOS.
¾ Chef du département de chirurgie du CHU GT.
¾ Chef de service de chirurgie générale du CHU Gabriel Touré.
¾ Général de Brigade des forces armées du Mali.
¾ Chevalier de l’ordre du mérite de la santé.
¾ Président de la Société de chirurgie du Mali(SOCHIMA).
¾ Secrétaire générale de l’ACAF.
Cher maitre,
Vous nous avez accueillis spontanément dans votre service dont nous garderons
un excellent souvenir. Les mots nous manquent pour exprimer tout le bien que
nous pensons de vous. Votre rigueur scientifique, votre assiduité, votre savoir-
faire et savoir être, votre ponctualité, font de vous un grand homme de science
dont la haute culture scientifique forge le respect et l’admiration de tous. C’est
un grand honneur et une grande fierté pour nous de compter parmi vos élèves.
Nous vous prions cher Maître, d’accepter nos sincères remerciements et
l’expression de notre infinie gratitude. Que le seigneur vous donne longue et
heureuse vie.
10
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
ABREVIATIONS
11
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
ABREVIATIONS
ACE : Antigène Carcinome Embryonnaire.
AEG: Altération de l’état Général.
ASA : Américain Society Anesthésiologiste.
CA 19-9 : Antigène utilisé comme marqueur tumoral.
CHU : Centre Hospitalier Universitaire.
ECF: Epirubicine + Cisplatine + fluoro-uracile.
FOGD: Fibroscopieoeso-gastro-duodénale.
GEA: Gastro-entéro-anastomose.
Gy: Gray.
HNPCC: Human no Polypose colorectal Cancer.
H. pylori: Helicobacterpylori.
IMC: Indice de Masse Corporelle.
IRM: Imagerie par Résonance Magnétique.
JRSGC: Japanese Research Society for gastric cancer.
L1 : Vertèbre lombaire numéro 1.
LIG: Ligament.
MALT: Mucosa Associated Lymphoïde Tissu.
MUI : Million Unité Internationale.
OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
R0: Résection sans résidus microscopique.
TDM: Tomodensitométrie.
TOGD: Transit oeso-gastro-duodénal.
T11 : Vertèbre thoracique numéro 11.
UICC : Union Internationale contre le Cancer.
5-FU: 5 fluoro-uracile.
12
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
SOMMAIRE
13
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION :……………………………….…………….………1
II. OBJECTIFS :………………………………………...……….…………5
III. GENERALITES :……………………………………………………7
IV. METHODODLOGIE :…………………………..…………………45
V. RESULTATS :…………………………………………………….……52
VI. COMMENTAIRES ET DISCUSSION :…………………..………72
VII. CONCLUSIONETRECOMMENDATIONS……………………..93
VIII. REFERENCES :……………………………………………………96
ANNEXES
14
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
I. NTRODUCTION
15
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
INTRODUCTION:
Le cancer de l’estomac est une Tumeur maligne développée aux dépens de la
paroi gastrique [1].On parle de syndrome orificiel sur la tumeur gastrique
lorsque la tumeur siège sur un orifice gastrique (cardia ou pylore) et provoque
une dysphagie ou des vomissements [2 ; 3].
Ce syndrome orificiel pose un problème diagnostique et thérapeutique aux
chirurgiens qui pratiquent dans les pays à ressources limitées et contribue
considérablement à une haute morbidité et mortalité [4].
En Tanzanie, une étude réalisée en 2013 a rapporté une fréquence hospitalière
de 184 cas soit 42,9% des cancers gastriques [4].
Au Japon, Okumura a retrouvé une fréquence hospitalière de 97 cas soit 6,3%
des cancers gastriques en 2014[5].
Au moyen orient, une étude Pakistanaise a rapporté 69 cas soit 50% des cancers
gastriques [6].
Aux états unis, une étude réalisée sur 6 ans a retrouvé 1181 cas en 2015 [7].
Il y a une diminution de l’incidence des cancers distaux corps et antre par contre
celle des cancers du cardia est en augmentation [8;9].
Dans 20% des cas les cancers siègent au niveau du cardia et 60% au niveau du
pylore [10].
Le syndrome orificiel est une complication fréquente et grave du cancer de
l’estomac, qui altère sévèrement la qualité de vie des malades en causant des
nausées, des vomissements, une déshydratation, un déséquilibre électrolytique,
une privation de nourriture et une perte de poids [11 ; 12 ; 13].
Ces vomissements non bilieux traduisent une tumeur distale avec sténose de la
partie pylorique [14 ; 15].
La dysphagie est l’apanage des localisations cardiales [16].
L’infection à l’H-Pilori et les facteurs alimentaires sont des grandes hypothèses
étiologiques retenues aujourd’hui [17 ; 18 ; 19].
16
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Le pronostic de ce syndrome peut être amélioré par l’institution précoce d’une
réanimation et d’une prise en charge chirurgicale précoce [4].
La majorité des cas est localement avancé ou métastatique avec un mauvais
pronostic [5 ; 7].Ce qui ne permet très souvent qu’un traitement palliatif.
Le principal objectif du traitement chirurgical palliatif dans cette situation est la
résolution de symptômes obstructifs et la reprise de la prise orale [20 ; 21].
Ce traitement chirurgical palliatif est de ce fait d’importance dans notre
contexte, non pas en termes de calcul de taux de survie, mais de qualité de vie
des patients (absence ou minimisation des douleurs et des vomissements,
éviction de la perforation et des hématémèses) [22 ; 23].
Il s’agit de résection gastrique palliative ou d’une dérivation digestive.
La prothèse endoscopique peut être offerte comme première ligne de traitement
ou comme une seconde ligne de traitement où la chirurgie ou autres traitement
oncologique a manqué de fournir le soulagement [12 ; 24]. En effet certains
auteurs ont démontré que l’exérèse gastrique même palliative améliore le taux
de survie par rapport aux gestes palliatifs sans exérèse [25,26].
Les bénéfices de la radio-chimiothérapie adjuvante sont de plus en plus
démontrés [27 ; 28].et surtout les anticorps anti HER2 dans les adénocarcinomes
gastriques ayant un récepteur HER2 [29 ; 30].
Aux Etats-Unis et en Allemagne les taux de survie sont respectivement 24 ,1%
contre 35% à 5 ans et 19,1% contre 31,7% à 10 ans [31].
La survie à 5 ans après chirurgie palliative est de 7,8% d’après Versus ; 51,2%
en cas de chirurgie curative d’après Zhang [32].
Elle était de 18,3% avec un taux de survie à 33,3% au Mali en 2007 [33].
La survie au cours du cancer gastrique localement avancé est meilleure à celle
des cancers gastriques avec des métastases à distance [34].
Au Mali, le cancer de l’estomac a fait l’objet de plusieurs travaux scientifiques,
mais aucune étude n’avait porté exclusivement sur le syndrome orificiel, ce qui
17
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
nous a incité à mener cette étude pour laquelle nous nous sommes fixés comme
objectifs :
18
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
II. OBJECTIFS
19
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
OBJECTIFS :
OBJECTIF GENERAL :
Etudier le syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie
générale du CHU-Gabriel Touré de Janvier 1999 au Décembre 2013.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
¾ Déterminer la fréquence du syndrome orificiel dans les cancers gastriques.
¾ Décrire les caractéristiques cliniques et para cliniques.
¾ Analyser les résultats.
¾ Déterminer le pronostic.
20
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
III. GENERALITES
21
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
GENERALITES:
1.1-Rappel anatomique :
Il porte essentiellement sur les points les plus importants, au plan de la chirurgie
d’exérèse du cancer de l’estomac, intéresse donc particulièrement les
vascularisations artérielles, veineuses et lymphatiques.
1-1-1-Anatomie descriptive [35, 36]
L’estomac est un réservoir mobile en forme de « J » situé entre deux points
fixes, le cardia, zone de jonction avec l’œsophage abdominal, et le pylore, zone
de jonction avec le duodénum. C’est un organe pourvu d’une musculature
puissante et d’une muqueuse sécrétant abondamment.
1-1-2-La situation : [37]
L’estomac est presque entièrement situé à gauche de la ligne médiane :
-Ses deux tiers supérieurs sont dans l’hypochondre gauche ;
-Son tiers inférieur est dans l’épigastre.
Il ne dépasse pas, en général, le plan subcostal.
22
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Figure 1 : Région supramésocolique. Crânial
1- diaphragme 10-lobe gauche du foie
2- lig. Falciforme 11-fundus Gauche
3- lig. Rond du foie droit 12-rate
4- lobe droit du foie 13-oesophaje abdominal
5- vésicule biliaire 14-corps de l’estomac
6-angle duodénal sup. 15-petit omentum
7- rein droit 16-partie pylorique de l’estomac
8- angle colique 17-angle colique gauche
9- gouttière paracolique 18-colon transverse couvert par le grand Omentum
23
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1-2- La forme : [35, 36]
Débout : La description la plus simple de l’estomac permet de le diviser en une
partie verticale et une partie horizontale.
La partie verticale constitue les deux tiers de l’organe ; il se projette à gauche de
la colonne vertébrale. Elle comprend la grosse tubérosité et le corps de
l’estomac.
La portion horizontale croise la ligne médiane et se dirige vers la droite.
1-3- Les parties de l’estomac : [36]
a) Du point de vue morphologique, on distingue à l’estomac quatre parties.
•La partie cardiale : Elle représente la jonction avec l’œsophage.
•Le fundus gastrique : Pôle supérieur de l’organe, il est séparé du cardia par
l’incisure cardiale (anciennement appelé l’angle de His). Il a pour limite
inférieure l’horizontal passant par le bord supérieur du cardia. Il correspond à la
poche d’air radiologique.
•Le corps : Il correspond à la partie moyenne, verticale.
•La partie pylorique : Elle comprend l’antre pylorique, point déclive de
l’estomac et le canal pylorique qui se dirige en haut, à droite et en arrière.
b) Du point de vue fonctionnel, on distingue.
• une partie proximale, plus statique, formée du fundus et de la partie supérieure
du corps, qui se dilate au cours du remplissage gastrique ;
• une partie Distale, plus dynamique, impliquée dans le brassage et l’évacuation
gastrique.
24
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Crânial
Figure 2: Subdivision de l’estomac. Gauche
1- incisure cardiale 6-partie cardiale
2- fundus 7- petite courbure
3- corps 8- incisure angulaire
4- grande courbure 9- pylore
5- antre pylorique 10-canal pylorique 11- duodénal
25
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1-4- Les dimensions: [36]
Elles sont variables en raison de la compliance importante de l’estomac.
Sa longueur est en moyenne de 25 cm ; sa capacité est d’environ 30 ml à la
naissance, et 1 à 2 litres chez l’adulte.
B- Configuration interne : [36]
A la fibroscopie, la muqueuse apparaît rose rouge avec de gros plis visibles sur
les radiographies dites « en couche mince » (plis parallèles à la direction de
l’estomac).
Le cardia présente un repli muqueux, en regard de l’incisure cardiale, la valvule
cardio-œsophagienne (anciennement appelé valvule de Gubarow).
Le pylore présente un repli muqueux annulaire, la valvule pylorique.
C- Moyens de fixité : [36]
Enveloppé de péritoine dans sa totalité, l’estomac est un organe mobile.
D’où la possibilité, mais rare, de volvulus gastrique.
Le cardia est la partie la plus fixe.
L’estomac est maintenue par : le ligament gastro-phrénique qui unit le fundus au
diaphragme, et accessoirement, les ligaments gastro-hépatiques,
gastro-splénique, gastro-colique et les pédicules vasculaires.
D- Rapports : [36]
L’estomac est un organe thoraco-abdominal qui présente :
Deux faces, antérieure et postérieure ; deux bords, la grande courbure et la petite
courbure ; deux orifices, le cardia et le pylore.
1-La face antérieure :
a) La face antérieure du fundus répond, au lobe gauche du foie et à son
appendice fibreux.
b) La face antérieure du corps répond, par l’intermédiaire du diaphragme, au
récessus pleural costo-diaphragmatique et au poumon gauche.
c) La face antérieure de la partie pylorique répond directement à la paroi
abdominale.
26
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2- La face postérieure :
Elle est croisée par la racine du mésocolon transverse.
a) La face postérieure du fundus est unie au diaphragme par le ligament gastro-
phrénique.
b) La partie supra-mesocolique répond, par l’intermédiaire de la bourse
omentale, de haut en bas, au pilier gauche du diaphragme, au corps et à la queue
du pancréas, et aux vaisseaux spléniques.
c) La partie infra-mesocolique répond, par l’intermédiaire du récessus omental
inférieur, à l’angle duodéno-jéjunal et aux premières anses grêles.
C’est la voie d’abord directe des anastomoses chirurgicales entre l’estomac et le
jéjunum à travers le mesocolon transverse.
3- La grande courbure :
Son segment fundique est fixé par le ligament gastro-phrénique.
Son segment vertical est uni à la rate, par le ligament gastro-splénique.
Son segment horizontal est uni au colon transverse par le ligament gastro-
colique qui se continue caudalement par le grand omentum.
4- La petite courbure :
Elle est unie au foie par le ligament gastro-hépatique. Elle circonscrit la région
cœliaque. Elle présente l’incisure angulaire qui sépare les segments vertical et
horizontal.
5- Le cardia :
Il est situé profondément, à 2 cm à gauche de la ligne médiane, au niveau du
corps de la vertèbre thoracique T11. Il se projette sur le 7ieme cartilage costal.
Il répond en arrière au pilier gauche du diaphragme, et en avant au lobe gauche
du foie.
6- Le pylore :
Il est situé légèrement à droite de la ligne médiane, à hauteur de la vertèbre
lombaire L1, dans le plan transpylorique.
•Sa face antérieure est recouverte par le lobe carré du foie
27
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
•Sa face postérieure répond au pancréas par l’intermédiaire de la bourse
omentale.
E- Anatomie fonctionnelle : [38]
L’estomac joue le double rôle de réservoir et de lieu de digestion par
transformation du bol alimentaire en chyme. Au niveau de sa muqueuse on
distingue deux zones de sécrétion : une zone de sécrétion acide au niveau de la
portion supérieure (fundus et corps), une zone alcaline représentée par la portion
inférieure pylorique.
F-Vascularisation : [35, 36]
Crânial
Figure 3 : Artères de l’estomac
1-artère gastrique gauche 9- artère omentale droite Gauche
2-artère phrénique inf 10- artère gastrique postérieure
3- artère pancréas 11- artère Courtes de l’estomac
4- artère hépatique commune 12- artère splénique (liénale)
5- artère gastrique droite 13- artère gastro-omentale gauche
28
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
6- artère gastrique droite 14- artère omentale gauche
7- artère gastro-duodénale 15- branches omentales
8- artère gastro-omentale 16- anastomose omentale
1-Artère :
La chirurgie gastrique, en particulier la chirurgie d’exérèse, implique une bonne
connaissance de la vascularisation de l’estomac et de la première portion du
duodénum.
L’irrigation artérielle de l’estomac provient du tronc cœliaque et se répartit en
quatre pédicules :
•deux au niveau de la petite courbure
•et deux au niveau de la grande courbure.
Ces pédicules se rejoignent au travers d’un riche réseau anastomotique,
permettant une suppléance vasculaire en cas d’oblitération ou de ligature d’un
des troncs principaux.
1-1) Vascularisation de la petite courbure :
Le petit épiploon (omentum) est un feuillet péritonéal, tendu en « pont » du
pédicule hépatique à la petite courbure gastrique, qui comporte trois zones.
La première est représentée par la pars vasculosa qui correspond au pédicule
hépatique et à l’arc artériel de la petite courbure.
La seconde est une zone intermédiaire et avasculaire : la pars flaccida.
La troisième est la pars condensa qui correspond à la partie supérieure du petit
épiploon (omentum), tendue entre le lobe gauche du foie et la portion verticale
de la petite courbure. Elle masque le lobe de Spiegel.
Le petit épiploon (omentum) forme la limite supérieure droite de l’arrière-cavité
des épiploons (omentums). Son ouverture permet d’aborder le tronc cœliaque.
Celui-ci vascularise le foie, l’estomac, le grand omentum, la rate et une partie du
pancréas. Il naît de la face antérieure de l’aorte au-dessus du bord supérieur du
pancréas, a une longueur de 1 à 3 cm et se termine en se divisant en trois
29
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
branches : l’artère gastrique gauche, l’artère hépatique commune et l’artère
splénique.
a) Artère gastrique gauche :
L’artère gastrique gauche naît dans 90 % des cas du tronc cœliaque, parfois
directement de l’aorte, d’une artère diaphragmatique inférieure, d’un tronc
gastrosplénique ou d’un tronc hépaticogastrique.
Elle se divise en deux branches, l’une antérieure et l’autre postérieure, qui
descendent appliquées le long de la petite courbure.
Elles se terminent en s’anastomosant avec les branches terminales de l’artère
gastrique droite ou artère pylorique. L’artère gastrique gauche donne plusieurs
branches : une artère hépatique inconstante et fonctionnelle dans 30 % des cas ;
des artères cardio-œsophagiennes antérieures et postérieures vascularisant le
cardia et l’œsophage abdominal.
b) Artère gastrique droite :
L’artère gastrique droite naît habituellement de l’artère hépatique propre, plus
rarement des artères hépatique commune, gastroduodénale ou hépatique gauche.
Elle rejoint le pylore en donnant une de ses principales branches terminales puis
se divise en branches gastriques antérieure et postérieure. Leurs portions
terminales s’anastomosent aux terminaisons de l’artère gastrique gauche au
niveau de l’angle de l’estomac, jonction des parties verticale et horizontale.
Les artères gastriques droite et gauche constituent ainsi l’arc vasculaire de la
petite courbure.
30
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Crânial
Gauche
Figure 4 : Vascularisation artérielle de la petite courbure.
1. Tronc cœliaque ; 6.Artère hépatique gauche accessoire ;
2. Artère hépatique propre ; 7.Artère cardiooesophagienne ;
3. Artère hépatique commune ; 8.Artère gastrique gauche ;
4. Artère gastrique droite ; 9.Artère splénique.
5. Artère gastroduodénale ;
1-2) Vascularisation de la jonction pyloroduodénale :
La réalisation d’une gastrectomie impose le plus souvent une section de
l’estomac en aval du pylore, sur le premier duodénum. Il est donc important de
préserver autant que possible sa vascularisation afin de limiter les risques de
fistule postopératoire.
Le duodénum mobile est vascularisé par des branches issues pour la plupart de
l’artère gastroduodénale.
La section duodénale s’effectue donc au contact de l’artère gastroduodénale en
veillant à préserver les rameaux directs entre celle-ci et le duodénum.
31
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
.
Crânial
Gauche
Figure 5 : vascularisation artérielle de la jonction pyloroduodénale.
1-3) Vascularisation de la grande courbure : Mutter D, Maresceaux J [35]
La grande courbure de l’estomac est bordée par le grand épiploon (omentum) et
le ligament gastrosplénique.
Le grand épiploon (omentum) représente les deux feuillets du péritoine viscéral
gastrique. Il s’étale sur le côlon transverse qu’il dépasse largement vers le bas au
niveau du corps et de la portion horizontale de l’estomac et constitue le ligament
gastrosplénique au niveau de la grosse tubérosité.
Le feuillet antérieur du grand épiploon (omentum) contient une arcade
vasculaire composée des vaisseaux gastro-omentaux droits, gauches et des
vaisseaux courts.
32
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
a)Artère gastro-épiploide (omentale) droite :
L’artère gastro-épiploide (omentale) droite naît de la division de l’artère
gastroduodénale au bord inférieur du duodénum en artères pancréatico
duodénale inférieure droite et gastro-épiploide (omentale) droite.
Elle chemine de droite à gauche le long de la grande courbure de l’estomac, dont
elle est toujours distante d’environ 1cm. Sur son trajet, elle donne des branches
aux deux faces de l’estomac et à l’omentum.
b) Artère gastro-épiploide (omentale) gauche :
L’artère gastro-omentale gauche est une branche de division de l’artère
splénique. Elle rejoint la grande courbure de l’estomac à sa partie moyenne,
chemine dans le ligament gastrocolique et s’anastomose avec les branches
terminales de l’artère gastro-omentale droite.
Les artères gastro-omentales droite et gauche constituent ainsi l’arc vasculaire
de la grande courbure.
33
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Crânial
Gauche
Figure 6: Vascularisation artérielle de la grande courbure
Mutter D, Marscaux J [35].
1-Artère gastroépiploïque droite
2-vaisseaux courts
3-fenêtre avasculaire
4-artère splénique
5-artère gastroépiploïque gauche.
c) Vaisseaux courts :
Les vaisseaux courts sont constitués de branches terminales de l’artère
splénique. Ils peuvent se détacher du tronc de l’artère splénique ou de ses
branches terminales. Au nombre de deux à six, ils cheminent du hile splénique à
l’estomac par l’épiploon.
L’un d’eux, plus volumineux, rejoint la face postérieure de l’estomac et se
ramifie de la grosse tubérosité au cardia : il s’agit de l’artère gastrique
postérieure ou artère cardio-tubérositaire postérieure.
Entre le dernier vaisseau court et l’origine de l’artère gastro-omentale gauche
34
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
existe une fenêtre avasculaire constituée uniquement de deux feuillets
péritonéaux. Leur effondrement permet d’entrer dans l’arrière-cavité des
épiploons en regard de l’artère splénique.
2-Veines : [35]
Le système veineux est satellite du réseau artériel, avec une veine pour une
artère. Le réseau veineux gastrique droit rejoint directement la veine porte.
Le réseau veineux gastro-épiploide (omental) droit rejoint la veine colique
supérieure droite pour former le tronc veineux gastro-colique (ou tronc de
Henle) et se jeter dans la veine mésentérique supérieure avant son abouchement
dans la veine porte.
Le réseau veineux gastrique gauche rejoint la veine splénique après son passage
dans le ligament gastro-splénique où il est satellite du réseau artériel.
3- Lymphatiques : [35, 36]
La connaissance du système lymphatique remonte à plusieurs siècles. Sa
description détaillée est réalisée par Rouvière dès 1932.
Les ganglions sont satellites des artères et un même organe peut se drainer dans
plusieurs chaînes ganglionnaires à la fois.
Les ganglions sont désignés sous le nom de l’organe auquel ils sont annexés, ou
bien sous le nom de l’artère à laquelle ils sont accolés. Il est ainsi possible d’en
effectuer une description topographique.
On distingue trois territoires lymphatiques principaux, gastrique gauche,
splénique et hépatique.
a) Le territoire gastrique gauche est constitué des deux tiers supérieurs de la
petite courbure de l’estomac, et du cardia. L’anneau lymphatique du cardia est
inconstant. Ce territoire est drainé par les lymphonœuds gastriques.
b) Le territoire splénique comprend le fundus et quelques centimètres
adjacents de la grande courbure de l’estomac. Il est drainé par les lymphonœuds
spléniques.
c) Le territoire hépatique, vaste, comprend la partie pylorique ; le tiers
35
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
inférieur de la petite courbure de l’estomac et les deux tiers inférieurs de la
grande courbure de l’estomac. Il se draine dans :
•les lymphonœuds gastro-omentaux et retro-duodénaux qui rejoignent les
nœuds supra-pyloriques, puis les lymphonœuds hépatiques.
•et les lymphonœuds gastriques droits qui rejoignent les lymphonœuds
hépatiques.
d) Les lymphonœuds cœliaques constituent le lymphocentre final de l’estomac.
Crânial
Figure 7 : Lymphatiques de l’estomac (vue antérieure).
Gauche
Kamina P [36]
1-lymphonœuds gastriques gauches 7-anneau lymphatique du cardia
2-lymphonœuds cœliaques 8-lymphonœuds pancréatiques sup.
3-lymphonœuds hépatiques 9-lymphonoeuds spléniques (linéaux)
4-lymphonœuds supra-pylorique 10-lymphonœuds gastro-omentaux gauches
5-lymphonœuds rétro-pylorique 11-lymphonœuds gastromentaux droits
6-lymphonoeuds infrapyloriques 12-lymphonoeuds gastriques droits
36
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
G- Innervation : [36]
Figure 8 : Nerfs de l’estomac. Kamina P. [36] Crânial
1- n. vague droit 7- tronc cœliaque
Gauche
2- œsophage 8- r. pylorique
3- branche hépato-pylorique 9- n. vague gauche
4- r. hépatique 10- branche cardio- fundique
5- n. grand splénique 11- branche gastrique
6- ganglion cœliaque 12- estomac.
37
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
L’innervation de l’estomac est assurée par des neurofibrilles sympathiques et
parasympathiques.
1-Les neurofibrilles sympathiques:
Elles sont issues du plexus cœliaque et accompagnent les artères de l’estomac en
formant les plexus gastrique gauche, hépatique et splénique.
2-Les neurofibrilles parasympathiques:
Elles proviennent des nerfs vagues.
Le nerf vague droit se divise en deux branches
•La branche cœliaque, volumineuse, rejoint les ganglions cœliaques
•La branche gastrique postérieure côtoie la petite courbure de l’estomac et se
termine à 7 cm du pylore. Elle donne des rameaux à la face postérieure de
l’estomac.
Le nerf vague gauche se divise en deux branches
•La branche cardio-fundique antérieure, pour la partie cardiale et le fundus de
l’estomac
•la branche gastrique antérieure, qui côtoie la petite courbure de l’estomac et se
termine à 7 cm du pylore. Elle donne : des rameaux gastriques antérieurs et une
branche hépatique qui parcourt le ligament gastro-hépatique. Elle se divise en un
rameau hépatique, qui pénètre la porte du foie, et un rameau duodéno-pylorique
(inconstant).
• Les variations sont nombreuses et expliquent les résultats variables de la
dénervation sélective de l’estomac :
-la branche gastrique droite peut être absente ou double ;
-la branche hépatique peut être multiple ou naître de la terminaison de la
branche gastrique antérieure ;
-le rameau duodéno-pylorique peut manquer.
38
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
H- Structure: [36]
Crânial
Gauche
Figure 9 : Structure de l’estomac (vue antérieure, coupe chanfreinée)
Kamina P [36]
1-cardia 10-fundus
2- petite courbure 11-séreuse
3-sphincter pylorique 12-couche longitudinale
4- partie mobile du duodénum 13-couche circulaire
5- orifice pylorique 14-fibres obliques
6-duodénum (partie descendante) 15-muqueuse
7-canal pylorique 16-grande courbure
8-œsophage 17-plis longitudinaux
9-incisure cardiale 18-antre pylorique
L’estomac est formé de cinq enveloppes qui sont de dehors en dedans :
1-La tunique séreuse : Elle correspondre au péritoine viscéral gastrique.
39
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-La sous-séreuse : Elle est constituée par du tissu conjoint lâche, contenant de
petits vaisseaux et nerfs.
3-La musculeuse : Très puissante, elle assure la fonction de brassage des
aliments par l’estomac.
Elle comporte trois couches de fibres musculaires lisses :
a) La couche longitudinale est superficielle avec des fibres parallèles aux
courbures gastriques
b) La couche circulaire, moyenne, est la épaisse.
Elle se prolonge au niveau du pylore, avec le sphincter pylorique. Celui-ci peut,
à l’état pathologique (sténose du pylore), empêcher la vidange gastrique.
c) Une couche oblique, interne, est constituée de fibres qui cravatent le cardia,
puis croisent l’incisure cardiale pour irradier sur les faces gastriques en direction
de la grande courbure.
4- La sous-muqueuse : C’est un tissu aréolaire lâche.
A son niveau cheminent les vaisseaux sanguins et lymphatiques, ainsi que les
nerfs destinés à la muqueuse.
5-La muqueuse : Epaisse et résistante, elle présente des plis dont le nombre et
la hauteur dépendent du degré de distension de l’estomac.
Sa surface présente de petites dépressions, les fossettes gastriques au fond
desquelles s’ouvrent les glandes gastriques.
C’est un épithélium de type prismatique simple qui repose sur une lamina
propria riche en glandes, de caractères différent selon les régions.
a) Au niveau du cardia, les glandes cardiales, peu nombreuses, sécrètent un
mucus.
b) Dans les régions fundique et corporéale, les glandes gastriques propres
sécrètent un précurseur de l’acide chlorhydrique.
c) Dans la région pylorique, les glandes pyloriques sécrètent du mucus.
40
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
II- ÉPIDÉMIOLOGIE MONDIALE :
L’incidence des cancers de l’estomac demeure élevée dans la plupart des pays
[37]. Il y a une diminution de l’incidence des cancers de l’estomac distal, corps
et antre [8] et une augmentation de l’incidence des cancers de la jonction
œsogastrique [8, 9] mais le cancer du cardia n’a été codé séparément dans les
registres que dans les années 1970 ce qui pourrait biaiser certaines études avec
une sous déclaration de cette localisation sur les périodes anciennes [37].
L’incidence mondiale du cancer de l’estomac était de 934.000 nouveaux cas en
2002, occupant ainsi le 4ième rang des cancers les plus fréquents et l’une des
principales causes de décès liés au cancer, 700.349 cas de décès à la même
année [17].
Au Japon se rencontre la plus haute prévalence, estimée à 80/100000 habitants
chez l’homme et 30/100000 habitants chez la femme [39].
L’Amérique du Nord est une zone à faible prévalence avec un taux de
9,9/100000 habitants chez l’homme et 4/100000 habitants chez la femme [40].
En Afrique l’incidence continentale en 2002 était estimée à 15/100000 habitants
chez l’homme contre 8,5/100000 habitants chez la femme [40].
III-FACTEURS ÉTIOLOGIQUES : [37]
Des facteurs environnementaux, génétiques, et un certain nombre d’affections
ont été incriminés dans le développement des cancers gastriques.
1- Facteurs environnementaux :
La responsabilité de facteurs environnementaux est suggérée par l’incidence
variable du cancer gastrique à l’intérieur d’un même pays et par des études chez
les migrants révélant que dès la deuxième génération, le risque de cancer
gastrique se rapproche de celui de la population d’accueil [37].
Parmi les facteurs environnementaux, les facteurs alimentaires jouent un rôle
important dans la carcinogenèse gastrique [17, 39].
41
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1-1- Facteurs alimentaires :
Une diète riche en sel provoque une gastrite atrophique et favorise la
carcinogenèse gastrique [17, 39].
Les nitrites ont été également incriminés. Ils proviennent essentiellement de
l’alimentation, soit du fait des procédés de fabrication (salaisons, fumaisons,
conserve), soit en raison de la conversion de nitrate en nitrite par les bactéries
(cette dernière réaction ne se produit pas à moins de 2°C) [37].
La diminution de la quantité de nitrites alimentaires dans les procédures de
stockage des aliments peut expliquer la diminution de l’incidence du cancer de
l’estomac dans les pays industrialisés [8, 9].
1-2- Helicobacter pylori :
L’Hélicobacter pylori a été découvert en 1982 par Marshall et Warren dans
l’antre gastrique humain [41].
Par la suite différents travaux ont suggéré le rôle de cette bactérie dans de
nombreuses maladies gastriques et duodénales (gastrite, maladie ulcéreuse,
lymphome, cancer gastrique) [40, 41].
Le taux de prévalence de l’infection à Helicobacter pylori est plus élevé d’autant
que le niveau socio-économique est bas [42].
Il est actuellement reconnu comme le principal facteur étiologique de cancer
gastrique depuis 1994 en raison d’études physiopathologiques et
épidémiologiques concordantes [41, 42].
Certaines souches d’Helicobacter pylori produisent des cytotoxines (CagA et
VacA) qui sont les facteurs de sa virulence.
2- Les pathologies précancéreuses :
Certaines pathologies telles que la gastrite chronique atrophique, l’ulcère
chronique de l’estomac, la gastrite hypertrophique de Ménétrier ou maladie de
Ménétrier, la maladie de Biermer et les polypes adénomateux ont un risque
significativement élevé de se dégénérer en un cancer gastrique.
42
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
-Après une gastrectomie il y a un risque de dégénérescence maligne du moignon
gastrique, ceci dans un délai de 15-20 ans [48].
Ce risque est majoré si la gastrectomie a été effectuée pour un ulcère gastrique et
si l’intervention était de type Billroth II [37].
-Achlorhydrie « iatrogène » secondaire à l’administration prolongée de
l’oméprazole au cours du traitement d’entretien de l’ulcère chronique de
l’estomac, augmente le risque de gastrite atrophique [37].
4-Facteurs socioéconomiques défavorables : Plusieurs études
épidémiologiques révèlent que l’incidence du cancer de l’estomac est plus
élevée dans les classes socioéconomiques défavorisées [43, 44].
5- Facteurs génétiques : La présence de facteurs génétiques influençant le
risque individuel de développer un cancer gastrique est suggérée, par l’existence
d’un risque multiplié par 2 ou 3 chez les apparentés au premier degré d’un sujet
atteint [37], les groupes sanguins A et O [40], le sexe masculin ont quelque fois
été considéré comme facteurs de risque du cancer de l’estomac.
6- Facteurs protecteurs :
De nombreuses études ont suggéré un rôle protecteur d’une alimentation riche
en fruits frais, en légumes crus ou en vitamines A et C [17, 39].
Les antioxydants contenus dans ces aliments inhibent les radicaux libres
potentiellement carcinogènes.
III-ANATOMIE PATHOLOGIQUE : [37]
1- Macroscopie :
Le cancer de l’estomac se présente sous trois formes :
-Le cancer bourgeonnant, qui est une tumeur polyploïde dans la lumière
gastrique à large pédicule et à contours irréguliers.
-Le type ulcéreux se présente comme une ulcération à bords taillés à pic, sans
bourrelet net, souvent mamelonnée.
-Le cancer infiltrant en longueur et en largeur, qui provoque un épaississement
de la paroi, une induration conjonctive. On parle de linite plastique lorsque tout
43
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
l’estomac est rétracté à paroi rigide épaisse et indilatable et ayant une couleur
blanche.
2- Microscopie :
Il existe plusieurs types histologiques.
L’adénocarcinome est le type le plus fréquent, 90 % des cas.
Le cancer colloïde avec des cellules produisant du mucus.
Les lymphomes malins de l’estomac sont hodgkiniens ou non. Ils représentent
3 % des cancers gastriques.
On distingue deux types :
les lymphomes gastriques de MALT (Mucosa Associated Lymphoïde Tissu) à
petites cellules de bas grade de malignité et les lymphomes gastriques à grandes
cellules de haut grade de malignité.
Les sarcomes, ils sont rares, le plus souvent il s’agit de léiomyosarcome ou
d’épithelio-sarcome.
Les schwanomes, les fibrosarcomes et les liposarcomes sont exceptionnels.
Les tumeurs carcinoïdes de l’estomac sont des tumeurs endocrines.
Elles peuvent être superficielles ne dépassant pas la muqueuse ou invasives.
Elles sont des tumeurs secondaires qui proviennent d’un cancer primitif du sein,
des bronches, du foie, de la peau (mélanome malin) ou du rein.
Les cellules tumorales peuvent être bien, moyennement ou peu différenciées.
3-Classifications : [37]
De nombreuses classifications ont été proposées, basées soit sur des critères
purement histo-cytologiques descriptifs, soit sur des critères de mode
d’extension, donc d’évolutivité.
3-1-Classification macroscopique de BORMAN :
Elle distingue 4 types de cancers.
¾ Type I : Végétant
¾ Type II : Ulcéré sans infiltration
¾ Type III : Ulcéré avec infiltration périphérique
44
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
¾ Type IV : infiltrant
Figure 10: Classification de Bormann
3-2- Classification histologique de LAUREN :
Elle distingue trois formes :
La forme intestinale, elle présente la structure d’un adénocarcinome tubulé ou
papillaire bien différencié à architecture compacte bien limitée en périphérie.
La forme diffuse, elle est surtout faite de cellules indépendantes
mucosécrétantes, elle est mal limitée.
La forme mixte, elle rassemble les cas inclassables dans les deux précédents.
3-3-Classification anatomopathologique UICC TNM 2010 [47]
T:Tumeur primitive :
Tx : Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive.
T0 : Pas de signes de tumeur primitive.
Tis : Carcinome in situ : tumeur intra-épithéliale sans invasion de la lamina
propria, dysplasie de haut grade.
T1 : Envahissement du chorion ou de la sous-muqueuse
T1a : Tumeur envahissant le chorion.
45
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
T1b : Tumeur envahissant la sous-muqueuse.
T2:Tumeur envahissant la musculeuse.
T3:Tumeur envahissant la sous-séreuse.
T4 T4a : Tumeur perforant la séreuse.
T4b : Tumeur envahissant les structures adjacentes.
N:Adénopathies régionales :
Nx : Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies.
N0 : Pas de signe d’atteinte des ganglions lymphatiques régionaux.
N1 : Envahissement de 1 à 2 ganglions lymphatiques régionaux.
N2 : Envahissement de 3 à 6 ganglions lymphatiques régionaux.
N3 N3a : Envahissement de 7 à 15 ganglions lymphatiques régionaux.
N3b : Envahissement de 16 ou plus ganglions lymphatiques régionaux.
M : Métastases :
Mx : Renseignements insuffisants
M0 : Pas de métastase à distance
M1 : Présence de métastase à distance
M1a : atteinte d’un seul organe atteint
M1b : plus d’un organe ou atteinte péritonéale
Pour la catégorie N, le stade N1c est introduit. Il indique l’existence de dépôts
tumoraux satellites dans la sous-séreuse ou les tissus périrectaux et péricoliques
non péritonéalisés, en l’absence de métastase ganglionnaire.
Si un nodule est considéré comme un ganglion lymphatique.
IV- ETUDE CLINIQUE :
1- Circonstances de découverte :
Les cancers de l’estomac sont habituellement asymptomatiques et rarement
détectés au stade précoce de la maladie, en dehors d’une politique de dépistage
ciblée [14].
Les cancers de l’estomac sont en général diagnostiqués chez des patients
présentant des formes évoluées [14, 45, 46].
46
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2- Les signes fonctionnels :
Les épigastralgies, les vomissements postprandiaux tardifs (syndrome orificiel)
et une perte de poids sont les principaux symptômes qui amènent les malades en
consultation [9, 14].
L’anorexie, l’hématémèse, le méléna, la sensation de satiété précoce et la
plénitude gastrique permanente sont parfois associés [37, 14].
La dysphagie est un symptôme des cancers du cardia alors que les vomissements
témoignent un envahissement du pylore [14].
Un syndrome de pseudoachalasie par envahissement des plexus d’Auerbach est
possible [37].
3- Les signes généraux :
Une altération de l’état général (OMS III ou IV), une anémie, une fièvre
inexpliquée et une asthénie sont fréquentes.
Des manifestations cutanées (kératose séborrhéique diffuse, acanthosis
nigricans), des microangiopathies, des néphropathies membranoprolifératives,
de syndromes d’hypercoagulation (syndrome de Trousseau) sont rares [37].
4- Indice de performance de l’OMS.
L’indice de performance de l’OMS est un indice simple et très efficace, cotés de
0 à 4 qui mesure la capacité d’un sujet à réaliser des activités de la vie courante
(travail, besoins personnels, vie à domicile, habillage…) C’est également un
indicateur de dépendance.
47
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Tableau I : Performance statut de l’OMS
Activité Score
Capable d’une activité à celle précédant la maladie 0
Activité physique diminuée, mais ambulatoire et 1
capable de mener un travail
Ambulatoire et capable de prendre soin de soi-même. 2
Incapable de travailler et alité moins de 50% du temps
Capable seulement de quelques activités. 3
Alité ou en chaise plus de 50% du temps
Incapable de prendre soin de soi-même. 4
Alité ou en chaise en permanence
5-Les signes physiques: [37]
L’examen physique est en général normal : La présence d’une masse
abdominale palpable, d’un ganglion de Troisier (ganglion sus-claviculaire
gauche), d’une ascite avec ou sans carcinose péritonéale palpable, d’une
hépatomégalie due à une localisation secondaire et d’une tumeur ovarienne
(tumeur de Krükenberg) suggère une forme évoluée de la maladie.
V- LES EXAMENS PARACLINIQUES :
1-Bilan du diagnostic :
1-1-La Fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD): [9,46]
La fibroscoscopie oeso-gastro-duodénale est l’examen fondamental.
Elle doit être systématique et associée à des biopsies multiples.
L’examen anatomopathologique des biopsies pose le diagnostic positif.
Elle permet de préciser la taille, la localisation et l’extension superficielle de la
tumeur.
1-2- Le Transit oeso-gastro-duodénal (TOGD): [9]
Il peut identifier une lésion infiltrante évocatrice d’une linite gastrique ou
48
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
préciser les données de l’endoscopie sur l’étendue de la lésion contribuant ainsi
au choix de la technique chirurgicale.
1-2-1- Les marqueurs tumoraux sérologiques : [37]
Ils n’ont pas d’intérêt à visée diagnostique.
L’Antigène Carcinome Embryonnaire (ACE) et le CA 19-9 sont élevés
respectivement chez 40 et 30 % des patients atteints de cancers métastatiques.
En revanche, ils peuvent être utiles dans le suivi après traitement curateur ou
l’évaluation de l’efficacité d’une chimiothérapie.
2- Bilan d’extension :
2-1- Le scanner abdominopelvien :
C’est l’examen de référence pour le bilan d’extension.
L’envahissement des organes de voisinage est suspecté par la perte du liseré
graisseux.
Les ganglions sont considérés comme envahis s’ils mesurent 1,5cm.
2-2- L’échoendoscopie :
Elle est performante pour la détermination de l’envahissement pariétal et de
l’extension ganglionnaire périgastrique.
L’ascite est détectée avec une sensibilité de 100 %.
L’échoendoscopie ne fait cependant pas partie du bilan d’extension
systématique de tous les cancers gastriques ; en revanche, il s’agit d’un examen
indispensable avant une tentative de résection endoscopique d’une lésion
superficielle.
2-3- L’imagerie par résonance magnétique (IRM) : [37]
Elle est légèrement plus sensible que le scanner pour préciser l’extension
pariétale, mais moins précise que celui-ci pour déterminer l’envahissement
ganglionnaire.
Elle peut être une alternative au scanner en cas de contre-indication de celui-ci.
2-4- La radiographie pulmonaire : [37]
Elle recherche les métastases pulmonaires.
49
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
VI- ASPECTS THERAPEUTIQUES :
1- Traitement préventif : [39, 48]
L’éradication de l’Helicobacter pylori, l’alimentation équilibrée, le dépistage
systématique en masse et le traitement des affections à risque peuvent être utile
à la prévention du cancer de l’estomac.
2- Traitement curatif : [9, 37, 40]
2-1- Buts : Exérèse de la tumeur, curage ganglionnaire
2-2- Moyens : Chirurgicaux et non chirurgicaux
2-3- Méthodes chirurgicales :
2-3-1- Chirurgie à visée curative :
Après un bilan d’extension n’ayant pas révélé de métastases, la résection
chirurgicale complète de la tumeur primitive et des adénopathies régionales
constitue la seule possibilité curatrice des cancers gastriques.
Le type de résection dépend de la localisation tumorale.
2-3-2- Installation du patient et voie d’abord [35]
L’incision est médiane allant vers le haut au-dessus du xiphoïde et vers le bas
2cm sous l’ombilic.
Une large incision bi-sous-costale étendue sur la gauche est également
réalisable.
L’intervention débute après un dernier bilan lésionnel qui doit confirmer les
possibilités d’exérèse.
2-3-3- Principes généraux [35]
La gastrectomie comprend toujours l’exérèse de l’épiploon.
Le premier temps doit séparer l’épiploon de ses attaches coliques et aborder
l’arrière cavité. La grosse tubérosité est mobilisée par une libération complète de
l’épiploon de l’angle colique droit à l’angle colique gauche, laquelle est
poursuivie jusqu’au hile splénique.
Les temps suivants sont successivement la ligature de l’artère gastroépiploide
droite à son origine, la ligature de l’artère gastrique droite, puis la libération et
50
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
section du duodénum.
La dissection du petit épiploon et la ligature de l’artère gastrique gauche
terminent le geste avant de réaliser la section de l’estomac.
Figure: 11
2-3-4-1- La gastrectomie polaire inférieure : elle est adaptée aux tumeurs
distales; elle résèque les deux tiers ou 4/5 de l’estomac, la partie mobile du
premier duodénum, le tablier épiploïque et les aires ganglionnaires
juxtagastriques ainsi que les ganglions coronaires stomachiques.
Le rétablissement de la continuité après gastrectomie subtotale :
Le rétablissement de la continuité se fait par une anastomose gastroduodénale
selon Péan ou Bilroyh I ou gastro-jéjunale (Finsterer ou Bilroth II) ou par le
procédé de l’anse en Y selon Roux.
51
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Figure 12 : Rétablissement après gastrectomie partielle inférieure (subtotale).
2-3-4-2- La gastrectomie totale :
Elle est destinée aux tumeurs de l’antre remontant sur la portion verticale de la
petite courbure, aux tumeurs du fundus ou de la grosse tubérosité ; elle résèque
la totalité de l’estomac, la partie libre du premier duodénum, la partie terminale
de l’œsophage, le grand épiploon et les chaînes ganglionnaires juxta-gastriques,
coronaires et hépatiques. Un examen extemporané de la tranche de section
œsophagienne est recommandé en cas de tumeur cardio-tubérositaire.
Rétablissement de la continuité digestive après gastrectomie totale :
Les modalités de rétablissement de la continuité sont multiples.
Elles ont longtemps fait appel à des montages simples : une anse jéjunale
montée en << Y >>, en << Oméga >> ou interposée entre l’œsophage et le
duodénum. Plus récemment ont été décrits différents montages ayant pour but la
création d’un réservoir qui reproduirait de façon plus fidèle la physiologie
gastrique. Ces réservoirs utilisent l’intestin grêle ou la jonction iléocæcale.
L’objectif de ces montages, outres le rétablissement de la continuité digestive,
est d’offrir au patient un confort maximal après gastrectomie.
52
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Figure13:Rétablissement de la continuité /Anastomose oesojéjunale sur anse
en « oméga
Figure 14: Rétablissement de la continuité par plastie iléocæcale.
A. Isolement et préparation de la jonction iléocæcale pédiculée sur l’artère
colique droite.
B. Rotation et passage du transplant en transmésocolique.
Réalisation des trois anastomoses: oesojéjunale, coloduodénale, et
rétablissement iléocolique.
53
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-3-1-3- La gastrectomie totale élargie :
Elle permet l’exérèse des ganglions de la chaîne splénique en effectuant une
spléno-pancréatectomie caudale. Elle est indiquée en cas d’envahissement de la
queue du pancréas ; de même que la colectomie transverse en cas
d’envahissement macroscopique.
2-3-2- Curage ganglionnaire :
L’envahissement ganglionnaire est un mauvais facteur pronostique.
Un curage ganglionnaire suffisant est recommandé aujourd’hui pour la qualité
carcinologique de l’exérèse et aussi pour la classification de la tumeur.
Les équipes japonaises ont précisément décrit 16 sites ganglionnaires répartis en
trois groupes (N1, N2, N3.). Ces regroupements sont modifiés en fonction du
siège primaire du cancer. Généralement, les ganglions péri-gastriques le long de
la petite courbure (sites 1, 3 et 5) et de la grande courbure gastrique (sites 2, 4 et
6) correspondent au groupe N1.
Les ganglions le long de l’artère coronaire stomachique (site 7), de l’artère
hépatique commune (site 8), du tronc cœliaque (site 9) et de l’artère splénique
(site 10 et 11) correspondent au groupe N2.
Figure 15 : Ganglions périgastriques :
54
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1 : paracardial droit ; 2 : paracardial gauche ; 3 : petite courbure;
4 : grande courbure ; 5 : suprapylorique ; 6 : infrapylorique
Crânial
Gauche
Figure 16 : Ganglions de la trifurcation cœliaque et ganglions distaux.
7: coronaire stomachique ou gastrique gauche ;
8 : hépatique commun ;
9 : Tronc cœliaque ;
10 : hile splénique ;
11 : artère splénique,
12 : ligament hépatoduodénal ;
13: rétropancréatique ;
14 : racine du mésentère ;
15 : colica média;
16 : para-aortique.
Figure 15-16 : Numérotation des différents sites ganglionnaires selon la
Japanese Research Society for Gastric Cancer, 1981.
55
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Trois types de curages ont été décrits :
¾ Le curage D1 correspond à l’exérèse du groupe N1
¾ Le curage D2 correspond à l’exérèse des groupes N1 + N2 et
¾ Le curage D3 correspond à l’exérèse des groupes N1 + N2 + N3.
Les recommandations actuelles chez un patient en bon état général sont la
pratique d’un curage D2 sans splénectomie sauf en cas d’adénopathies de
l’artère splénique ou de cancer de la grosse tubérosité atteignant la séreuse.
En cas de mauvais état général que le cancer soit superficiel ou avancé (stade I
ou IV), un curage plus limité est licite. Un minimum de 15 ganglions doit être
analysé pour un curage D1 et de 25 ganglions pour un curage D2
2-3-3- Soins et suivi postopératoire [35]
Après réalisation du rétablissement de la continuité, une sonde gastrique est
passée au travers de la suture et est maintenue en aspiration douce pendant
quelques jours.il faut toujours penser à refermer la brèche mésentérique
transmésocolique en fin de procédure pour éviter une incarcération d’anse.
Certains auteurs préconisent la mise en place d’une jéjunostomie d’alimentation
provisoire afin de pouvoir envisager une alimentation entérale précoce en cas de
fistule postopératoire.
2-3-2- Chirurgie palliative : [9,37, 39]
En cas de cancer métastatique, il n’est pas idéal de réaliser une gastrectomie
sous peine d’accroître la morbidité sans influencer la survie. Cependant, une
gastrectomie est discutable s’il existe des métastases hépatiques résécables.
La chirurgie palliative est indiquée dans les cancers évolués voire « dépassés ».
Lorsque la tumeur est inextirpable on peut réaliser :
• Une gastro-entérostomie ou poser une prothèse endoluminale si la tumeur
est distale et sténosante.
• Une stomie d’alimentation (gastrostomie ou Jejunostomie) si proximale.
• Les résections incomplètes avec résidu tumoral macroscopique (R2) ont
un très mauvais pronostic.
56
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-4- Méthodes non chirurgicales : [9, 37,39]
2-4-1- Traitement endoscopique :
Ce type de traitement s’adresse aux cancers superficiels dont le diagnostic est
établi par l’échoendoscopie.
La mucosectomie endoscopique est la technique usuelle, le plasma argon peut
être une alternative à la mucosectomie si celle-ci n’est pas réalisable.
En raison du pronostic médiocre des cancers gastriques après ou sans résection
curative, le recours à un traitement adjuvant ou néo-adjuvant apparaît nécessaire.
Les modalités et le bénéfice de celui-ci ne sont toujours pas clairement établis.
2-4-2- Chimiothérapie : [9,37, 39]
Les adénocarcinomes gastriques sont peu chimiosensibles, les réponses sont de
courte durée, les avantages au stade métastatique sont modestes.
Plusieurs schémas ont été testés, aucun ne s’est réellement imposé. L’association
de 5-FU en perfusion continue, épirubicine et cisplatine (ECF) est largement
utilisée comme protocole.
La survie après chimiothérapie est d’environ 6 mois.
Une chimiothérapie néoadjuvante est possible consistant à administrer en
préopératoire des anticancéreux, soit en cas11 de cancers a priori résécables
mais à haut risque de récidive (T3, N+), soit des cancers jugés non résécables
mais non métastatiques, soit enfin dans le but de réduire la taille tumorale pour
augmenter le taux de résection R0. Une chimiothérapie intrapéritonéale est
parfois utilisée par certains, elle est complexe et réservée aux centres
expérimentés.
2-4-3- Radiothérapie : [9, 37,39]
Actuellement, la radio-chimiothérapie postopératoire est recommandée.
Cela à cause de la fréquence élevée des récidives même après chirurgie
d’exérèse complète [37].
radio-chimiothérapie post-opératoire associant 5 fluoro-uracile, acide folinique
et une radiothérapie de 45 Gy augmente significativement la durée de vie sans
57
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
récidive et la durée de vie globale dans une étude randomisée contre la chirurgie
seule [43].
3- Dépistage et surveillance :
Au Japon, en raison de la forte incidence du cancer de l’estomac, le dépistage
systématique annuel des personnes de plus de 50 ans par endoscopie digestive a
permis de diagnostiquer des tumeurs à un stade superficiel et de diminuer la
mortalité spécifique due à la maladie [10].
En cas d’antécédents d’adénocarcinomes gastriques sporadiques familiaux, il est
simplement recommandé d’effectuer une endoscopie digestive avec biopsies à la
recherche de l’Helicobacter pylori chez les apparentés au premier degré suivie
d’éradication si positive [49]. En revanche, dans les rares cas d’anomalies
génétiques favorisantes responsables de formes familiales (syndrome HNPCC,
mutation de la E-cadhérine), le dépistage est recommandé.
Certaines mesures de prophylaxies après une gastrectomie totale :
-Une injection de vitamine B12, 1 mg i.m. tous les 3 mois est nécessaire en cas
de gastrectomie totale. Après une splénectomie, il faut faire une vaccination
contre le pneumocoque (rappel tous les 5 ans), Haemophilus influenzae B
(rappel tous les 3 ans) et le méningocoque A et C (rappel tous les 3 ans) ainsi
qu’une antibiothérapie par pénicilline V, 1 MUI, 2 fois par jour pendant au
moins 2 ans.
-La surveillance après résection à visée curatrice est largement empirique,
aucune étude n’ayant démontré l’utilité d’une modalité de surveillance pour
prolonger la survie.
-Il est recommandé, chez les patients capables de supporter une réintervention
ou une chimiothérapie, de pratiquer un examen clinique tous les 3 à 6 mois, une
échographie abdominale tous les 6 mois et une radiographie tous les ans pendant
5 ans.
58
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
IV. METHODOLOGIE
59
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
METHODOLOGIE
I-Matériels :
1-Cadre de l’étude :
Cette étude a été réalisée dans le service de chirurgie générale au CHU GT.
Situé au centre commercial de la ville de Bamako (commune 3) ; le CHU
Gabriel Touré est limité à l’est par le quartier populaire de Médinacoura, à
l’Ouest par l’Ecole Nationale d’Ingénieur (E.N.I.), au Nord le Quartier Général
de l’Etat-major de l’Armée de Terre, au Sud le TRANIMEX.
Ancien dispensaire National de Bamako, il a été érigé en hôpital le 17 février
1959. Il porte le nom d’un étudiant Malien, Gabriel Touré, mort de peste
contractée au chevet de son malade.
L’Hôpital est devenu un centre hospitalier universitaire depuis l’avènement de
l’université de Bamako en 1996.
C’est un hôpital de 3ième référence de notre système de santé.
Dans l’enceinte de l’hôpital, le bâtiment < Benitieni Fofana> situé du côté Nord
-Ouest abrite le service de chirurgie générale.
Ce pavillon regroupe toutes les spécialités chirurgicales à l’exception de L’ORL.
1-1 les locaux :
Le service comprend 33 lits d’hospitalisation repartis entre 9 salles :
Deux (2) salles de première catégorie (lit unique, toilette intérieure, climatisée)
Six (6) salles de deuxième catégorie (2 à 5lits)
Une (1) salle de troisième catégorie (8 lits)
Quatre (4) bureaux pour les chirurgiens maitres-assistants
Un (1) bureau pour le chef de service
Un (1) bureau pour le secrétaire du chef de service
Un (1) bureau pour l’infirmier superviseur des soins
Une (1) salle de pansement
Le bloc opératoire situé au rez-de -chaussée comprend 3 salles d’opération
partagé avec le service de traumatologie-orthopédie et le service d’urologie, une
60
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
salle de stérilisation, un vestiaire, une salle de réveil ou d’attente et un bureau
pour l’infirmier major du bloc.
Le service a une équipe permanente au service d’accueil des urgences (SAU) qui
s’occupe des urgences chirurgicales.
1-2 le personnel :
-le personnel permanent :
Deux(2) chirurgiens et cinq (5) professeurs dont un professeur titulaire en
chirurgie digestive qui est le chef du département de chirurgie.
Un technicien supérieur en santé, infirmier major du service.
Quatre agents techniques de santé et quatre aides-soignants.
Un secrétaire médical installé auprès du chef de service.
Deux techniciens de surface ou manœuvres.
- Le personnel non permanent :
Il est composé des médecins stagiaires, les médecins en formation de DES, des
internes, les thésards, les étudiants en stage de médecine ou d’infirmerie.
1-3- Les activités :
Le staff a lieu tous les jours ouvrables à partir de 7h 45mn.
La visite est effectuée tous les jours ouvrables après le staff du matin par les
différents maitres assistants et la visite générale dirigée par le chef du service à
lieu le vendredi.
Les consultations externes ont lieu du lundi au jeudi après la visite.
- Les interventions chirurgicales à froid se déroulent du lundi à jeudi.
- Les gardes se font tous les jours du lundi au dimanche.
- Un staff de programmation des interventions tous les jeudis à 13 h.
- la réunion des thèses à lieu les vendredis avec le chef du service, les maitres
assistants et les thésards.
- Les hospitalisations se font tous les jours ;
- Les soins aux malades hospitalisés sont effectués tous les jours.
Par ailleurs il faut noter la tenue d’un staff hebdomadaire, les vendredis à 8h,
61
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
auquel participent toutes spécialités chirurgicales et le service d’anesthésie et
réanimation.
2-Type et période d’étude :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective et prospective qui est déroulée du
Janvier 1999 au Décembre 2013 soit une période de 15 ans.
3-Population :
A été faite de tous les patients qui ont été hospitalisés au service pour cancer
gastrique avec syndrome orificiel.
-Critères d’inclusion :
Ont été inclus dans l’étude, tous les patients reçus dans le service pour cancer
gastrique avec syndrome orificiel, opérés ou non chez qui le diagnostic de
cancer gastrique a été confirmé par l’anatomie pathologie.
-Critères de non inclusion :
Les patients ayant d’autres types de cancers de l’estomac.
-Echantillonnage :
La collecte des données a été faite à l’aide d’un questionnaire sur une fiche
individuelle d’enquête comportant les données démographiques, les variables
qualitatives et quantitatives.
4-Méthodes :
4-1-déroulement de l’étude
Les données ont été colligées sur une fiche d’enquête individuelle.
Nous avons consulté les registres de compte rendu anatomo-pathologique pour
les résultats de biopsies apportés par les malades.
Les registres de compte rendu opératoire pour les traitements chirurgicaux dont
les malades ont bénéficié.
4-2 Paramètres étudiés :
→Aspects diagnostiques
Interrogatoire : a permis d’apprécier :
Le mode de vie : La consommation d’alcool, de tabac, de cola, de patte de mil
62
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
avec potasse « tôt », de fruits et légumes (régulière ou occasionnelle), le mode
de conservation de la viande et du poisson (fumaison, salaison, réfrigération).
Les antécédents : les antécédents personnels et familiaux des patients
notamment de cancer dans la famille, la notion de gastrite, d’ulcère gastrique ont
été recherchés.
Les symptômes digestifs et signes généraux : épigastralgie, dysphagie,
vomissements, hématémèse, méléna, amaigrissement, pesanteur épigastrique,
satiété précoce, plénitudes permanente et fatigabilité constipation, arrêt des
matières et arrêt des gaz.
Examen physique : a été complet, à la recherche d’une masse épigastrique, une
carcinose péritonéale, du clapotage de l’épigastre à jeun, des adénopathies
périphériques (ganglion de Troisier), au toucher rectal la recherche des écailles
de Brumer a été systématiquement faite chez tous les malades ainsi que le
toucher vaginal à la recherche d’une tumeur de Krukenberg.
Examens para Clinique : ont été d’une aide au diagnostic et au suivi du
patient.
L’endoscopie digestive haute a permis d’objectiver les tumeurs et la réalisation
des biopsies pour étude anatomo-pathologique.
L’échographie abdominale : a été réalisée pour la recherche des localisations
secondaires.
La radiographie : Elle a servi à la recherche des métastases pulmonaires.
L’examen d’anatomie pathologique de la pièce opératoire : a permis de
confirmer le diagnostic et de déterminer le type histologique.
→Aspects thérapeutiques : La méthode chirurgicale utilisée était à visée
curative ou palliative, les complications per opératoire ont été observées.
→le suivi post opératoire : les patients ont été suivis en péri opératoire et en
post opératoire. Nous avons tenu compte du mode de suivi, des méthodes para
cliniques employées ainsi que les suites opératoires.
Le suivi immédiat était basé sur les constantes du malade (la tension, le pouls, la
63
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
température, la fréquence respiratoire, l’indice de Karnofsky, le Glasgow), la
reprise du transit, l’aspect de la plaie opératoire et de l’abdomen.
Le suivi à moyen et à long terme était effectué grâce aux consultations sur
rendez-vous, aux appels téléphoniques, aux personnes contacts et aux visites. La
survie était évaluée à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans et en fonction
des résultats du suivi.
5-Méthodologie informatique
Le traitement de texte et les tableaux ont été réalisés sur le logiciel Microsoft
Word. Les données ont été saisies sur le logiciel Microsoft Excel et analysées
sur le logiciel Epi info (version 6.0) et les graphiques ont été réalisés grâce au
logiciel Microsoft Excel.
6-Méthodologie statistique
Les résultats ont été comparés avec le test statistique Chi2 de EPI6 (test
significatif si p< 0.05).
7-Définition opérationnelle
7-1-Chirurgie curative
Gastrectomie : elle consiste à une exérèse gastrique, elle peut être partielle ou
totale. Elle est considérée comme curative lorsqu’il n’y a pas de métastase
viscérale ou péritonéale, et quelle emporte un groupe ganglionnaire sain au-delà
d’un groupe envahi.
Gastrectomie Totale : c’est l’exérèse de tout l’estomac, de la partie terminale
de l’œsophage, du petit épiploon et du grand épiploon.
Gastrectomie subtotale : c’est l’exérèse des 3/4 ou 4/5 de l’estomac du grand
épiploon, des ganglions coronaires, stomachiques et de la faux de l’artère
hépatique.
Les curages ganglionnaires : Les atteintes ganglionnaires sont fréquentes dans
les cancers de l'estomac et peuvent siéger à différents niveaux.
Le curage des ganglions juxta-gastriques est dénommé D1.
Le curage emportant les ganglions péri gastriques est appelé D2.
64
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
En cas de spléno-pancréatectomie associée il s'agit d'un curage D3.
7-2-Chirurgie palliative
Gastro- entéro- anastomose : dans les cancers antropyloriques
Les stomies d’alimentation : gastrostomie et jéjunostomie.
65
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
V. RESULTATS
66
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
RESULTATS:
I-Fréquence :
De janvier 1999 au Décembre 2013, le service de chirurgie générale a réalisé
52378 consultations et 17969 hospitalisations.
Un total de 1256 cas de cancers digestifs a été hospitalisé.
Parmi ces cancers digestifs 698 cas étaient des cancers de l’estomac dont 372
cas présentaient un syndrome orificiel, qui font l’objet de notre étude.
Ces statistiques révèlent que ce syndrome orificiel est fréquent dans les cancers
de l’estomac dans notre service, soit 53,3% des cancers de l’estomac et 29,6%
des cancers digestifs.
II-Aspects sociodémographiques :
1-Frequence / Année :
Tableau I : Répartition selon l’année
L’année 2013 a été la plus représentée avec 71 cas soit 19,1%.
67
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-Tranche d’âge :
Tableau II : Répartition selon la tranche d’âge
Tranche d’âge Effectifs Pourcentage
20 – 39 58 15,6
40 – 59 166 44,6
60 – 79 143 38,5
80 - 90 5 1,3
Total 372 100
Moyenne : 56 ans Ecart type : 13,3 Extrêmes : 27 et 84 ans
3-Le sexe :
Figure 1 : Répartition selon le sexe
Le sexe ratio a été de 1,5.
68
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
4-Principale activité :
Tableau III : Répartition des malades selon la principale activité
Principale activité Effectifs Pourcentage(%)
Paysan 132 35,5
Ménagère 122 32,7
Ouvriers 46 12,4
Commerçant 38 10,3
Bergé 3 0,8
Gardien 6 1,6
Cadre moyen et sup 25 6,7
Total 372 100
83% de nos patients appartenaient aux groupes sociaux professionnels
défavorisés.
5-Catégorie d’hospitalisation :
Figure 2 : Répartition des patients selon la catégorie d’hospitalisation
Première catégorie : salles VIP individuelles 12.500Fcfa/journée.
Deuxième catégorie : salles de deux à quatre lits 1500Fcfa/journée.
Troisième catégorie : salles de cinq à huit lits 750Fcfa/journée.
69
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
II-Aspects cliques :
1-Mode de recrutement :
Figure 3: Répartition selon le mode de recrutement
2-Durée d’évolution du cancer gastrique:
Tableau IV : Répartition selon la durée d’évolution du cancer gastrique
Durée en Mois Effectifs Pourcentage
7-12 152 40,9
13-24 105 28,2
25-36 48 12,9
37-48 40 10,7
49-60 27 7,3
Total 372 100
Moyenne : 15 mois Minimum : 7 mois Maximum : 5 ans Ecart-type : 18
70
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
3-Durée d’évolution du syndrome orificiel dans cancer gastrique.
Tableau V : Répartition selon la durée d’évolution du syndrome orificiel
Durée en Semaines Effectifs Pourcentage
1–2 154 41,4
3–4 142 38,2
5–6 76 20,4
Total 372 100
Moyenne : 3,5 semaines Ecart-type : 5,2 Extrêmes : 1 à 6 semaines
4-Motif de consultation :
Tableau VI : Répartition selon le motif de consultation
Motifs Effectifs Pourcentage
Vomissements + Douleur 126 33,9
Vomissements + Masse 117 31,5
Vomissements + AEG 94 25,2
Dysphagie 35 9,4
Total 372 100
71
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
5-Signes fonctionnels :
Tableau VII : Répartition selon les signes fonctionnels
Signes fonctionnels Effectifs Pourcentage
Vomissements 372 100
Amaigrissement 364 97,8
Epigastralgie 228 61,3
Anorexie pour la viande 233 62,6
Constipation 214 57,5
Lourdeur épigastrique 206 55,4
Satiété précoce 80 21,5
Hématémèse 71 19,1
Méléna 65 17,5
Dysphagie 44 11,8
Hypersialorrhée 31 8,3
Régurgitation 50 13,4
Fièvre 94 25,3
Présence d’une toux 20 5,4
Les vomissements, l’amaigrissement, l’anorexie, l’épigastralgie ont été les
principaux signes fonctionnels retrouvés dans notre étude.
72
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
6-Signes généraux :
Tableau VIII : Répartition selon les signes généraux
Signes généraux Effectifs Pourcentage
Plis déshydratation 372 100
Plis dénutrition 372 100
Pâleur conjonctivale 130 34,9
Ictère 86 23,1
OMI 73 19,6
6-1-Indice de performance OMS :
Tableau IX : Répartition selon l’indice de performance OMS
Indice OMS Effectifs Pourcentage
OMS II 45 12,1
OMS III 292 78,5
OMS IV 35 9,4
Total 372 100
6-2-Indice de masse corporelle :
Tableau X : Répartition selon l’indice de masse corporelle (IMC)
IMC Effectifs Pourcentage
< 18 317 85,2
18 -25 55 14,8
Total 372 100
85,2% de nos malades avaient un IMC inférieur à la normale.
73
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
6-3-Intensité de la douleur en EVA
Tableau XI : Répartition des malades selon l’intensité de la douleur en EVA
EVA Effectifs Pourcentage
0 37 9,9
1-2 120 32,3
3-4 186 50
5-6 29 7,8
Total 372 100
La douleur est intense dans 57,8 % des cas.
6-4-Classification ASA :
Tableau XII : Répartition selon la classification ASA
Classe Effectifs Pourcentage
ASA II 28 7,5
ASA III 84 22,6
ASA IV 204 54,8
ASA V 56 15,1
Total 372 100
74
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
7-Signes physiques :
Tableau XIII : Répartition selon les signes physiques
Signes physiques Effectifs Pourcentage
Tumeur palpable 172 46,5
Clapotage à jeun 164 44,1
Ascite 92 24,7
Hépatomégalie 76 20,4
Adénopathies inguinales 64 17,2
Ganglion de Troisier 22 5,9
Splénomégalie 9 2,7
Ecailles de Brumer 4 1,1
8- Traitements reçus avant l’admission dans le service :
Tableau XIV : Répartition selon la nature du traitement reçu avant l’admission
dans le service.
Traitements Effectifs Pourcentage
Médical 149 40,1
Traditionnel 132 35,5
Médical + Traditionnel 91 24,5
Total 372 100
75
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
9-Antécédents de pathologies gastriques :
Tableau XV : Répartition selon les antécédents de pathologies gastriques
Pathologies Effectifs Pourcentage
Ulcère gastrique confirmé 114 30,6
Ulcère gastrique non confirmé 86 23,1
Gastrite chronique 35 9,4
RGO 24 6,5
Polype gastrique 7 1,9
Aucune 106 28,5
Total 372 100
10-Tares associées :
Tableau XVI : Répartition selon les tares associées
Tares Nombre de cas Pourcentage
HTA 34 9,1
Diabète 27 7,3
Drépanocytose 13 3,5
Asthme 4 1,1
76
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
11-Habitudes alimentaires :
Tableau XVII : Répartition selon les habitudes alimentaires
Habitudes alimentaires Effectifs Pourcentage
Tôt à la potasse 224 60,2
Poisson fumée 105 28,2
Tôt à la potasse + Poisson fumée 160 43
Poisson séchés 40 10,8
Tabac 182 49
Alcool 68 18,3
Tabac + Alcool 46 12,34
III-Examens Paracliniques :
1-Aspect macroscopique de la tumeur à la fibroscopie :
Figure 4 : Répartition selon l’aspect macroscopique à la fibroscopie
77
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2- Le siège de la tumeur à la fibroscopie :
Tableau XIX : Répartition selon le siège de la tumeur à la fibroscopie.
Siège Effectifs Pourcentage
Cardia 37 9,9
Antre et pylore 335 90,1
Total 372 100
3-Histologie :
Tableau XX : Répartition selon l’histologie
Histologie Effectifs Pourcentage
Adénocarcinome 351 94,4
Carcinome épidermoïde 15 4
Tumeurs stromales 6 1,6
Total 372 100
4-Bilans d’extension :
Tableau XXI : Répartition selon la présence de métastases lors du bilan
d’extension
Métastases Effectifs Pourcentage
Hépatiques 116 31,2
Pulmonaires 32 8,6
Péritonéales 56 15,1
Ascite 105 28,2
Absence de métastases 63 16,9
78
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
5-Biologie :
5-1-Repartition selon le groupe sanguin :
Tableau XXII : Répartition selon le groupe sanguin
Groupe sanguin Effectifs Pourcentage
A 150 40,3
B 55 14,8
AB 39 10,5
O 128 34,4
Total 372 100
5-2-Taux d’hémoglobine:
Tableau XXIII : Répartition selon le taux d’hémoglobine
Taux d’hémoglobine (Hb en g/dl) Effectifs Pourcentage
Inférieur ou égale à 6 194 52,1
7–9 97 26,1
10 – 12 51 13,7
Supérieur ou égale à 13 30 8,1
Total 372 100
79
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
5-3-Ionogramme sanguin :
Tableau XXIV: Répartition selon le résultat l’ionogramme sanguin
Ionogramme sanguin Effectifs Pourcentage
Non faite 224 60,2
Hypocalcémie 21 5,6
Hyponatrémie 38 10,2
Hypokaliémie 24 6,5
Hyponatrémie + Hypokaliémie 12 3,2
Hyponatrémie + Hypocalcémie 8 2,2
Normale 17 4,6
5-4-Protidémie :
Tableau XXV : Répartition selon le résultat de la protidémie
Protidémie Effectifs Pourcentage
Sup. ou égale à 60 g/L 6 1,6
< 60 g/L 39 10,5
Non faite 327 87,9
Total 372 100
10,5% de nos malades avaient une hypoprotidémie.
5-5-Albumunémie :
Tableau XXVI : Répartition selon le résultat de l’albuminémie
Albuminémie Effectifs Pourcentage
Sup ou égale à 35 g/L 12 3,2
< 35 g/L 25 6,7
Non faite 335 90,1
Total 372 100
6,7%de nos malades avaient une hypoalbuminémie.
80
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
6-Durée du séjour préopératoire :
Tableau XXVII : Répartition selon le séjour préopératoire
Séjour préopératoire en jour Effectifs Pourcentage
0-3 103 36,5
4-7 72 25,5
8-11 38 13,5
12-15 44 15,6
16-19 25 8,9
Total 282 100
Maximum : 18 Minimum : 0 Moyenne : 6,32 Ecart-type : 5,45
IV-Aspects thérapeutique :
1-Methode de traitement :
Tableau XXVIII : Répartition selon la méthode de traitement
Méthode de traitement Effectifs Pourcentage
Chirurgie 282 75
Médicale 90 24,2
Total 372 100
2-Techniques chirurgicales :
Tableau XXIX: Répartition selon la technique chirurgicale
Techniques chirurgicales Effectifs Pourcentage
Gastro-entéro-anastomose 184 65,3
Gastrectomie 46 16,3
Gastrostomie d’alimentation 31 11
Jejunostomie d’alimentation 2 0,7
Biopsie 19 6,7
Total 282 100
81
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
3-Lieu d’intervention chirurgicale :
Tableau XXX : Répartition selon le lieu d’intervention chirurgicale
Lieu d’intervention Effectifs Pourcentage
Bloc à froid 173 61,3
Bloc d’urgence 109 38,7
Total 282 100
4-Stadification :
Tableau XXXI : Répartition selon la stadification TNM de UICC
Stades Effectifs Pourcentage
III 58 25,6
IV 314 84,4
Total 372 100
Le stade IV a été le plus fréquent avec 314 cas soit 84,4%.
Les stades I et II n’ont été retrouvés.
5-Reanimation postopératoire :
Tableau XXXII : Répartition des malades selon la réanimation postopératoire
Réanimation post-op Effectifs Pourcentage(%)
Faite 181 64,2
Non faite 101 35,8
Total 282 100
82
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
6-Durée de la réanimation postopératoire :
Tableau XXXIII : Répartition des malades selon la durée de la réanimation
postopératoire.
Durée réanimation post-op (jours) Effectifs Pourcentage(%)
1-5 144 79,5
6-10 22 12,2
11-15 11 6,1
16-21 4 2,2
Total 181 100
Minimum : 1 Maximum : 21 Moyenne : 4,3 Ecart-type : 3,2
V-Evolution et suivi :
1-Morbité et Mortalité opératoire :
Tableau XXXIV : Répartition selon les suites immédiates de l’intervention
Suites immédiates Effectifs Pourcentage
Simples 169 59,9
Vomissements 33 11,7
Abcès de paroi 16 5,8
Fistule Digestive 9 3,2
Péritonite 6 2,1
Eviscération 8 2,8
Décédés 41 14,5
Total 282 100
25,6% de nos malades ont eu une complication dans les suites immédiates.
83
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-Durée d’hospitalisation :
Tableau XXXV: Répartition selon la durée d’hospitalisation en jour
Durée (jours) Effectifs Pourcentage
3-7 105 28,2
8-14 133 35,8
15-21 70 18,8
22-28 40 10,7
29-74 24 6,5
Total 372 100
Moyenne : 13 jours Minimum : 3 jours Maximum : 74 jours Ecart-type : 8
4-Survie globale en fonction du siège selon Kaplan-Meier :
Figure 2 : survie en fonction du siège selon Kaplan-Meier
Les taux de survie à :
84
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
‐ 6 mois 71% pour le pylore et nulle pour le cardia.
‐ 12 mois 50,5% pour le pylore.
‐ 24 mois 45% pour le pylore.
‐ 36 mois 8,4% pour le pylore.
5-la survie globale fonction des gestes effectués selon Kaplan-Meier :
Figure7 : survie en fonction des gestes effectués selon Kaplan-Meier
Les taux de survie à:
‐ 6 mois 68,5% pour la résection et 72% pour la dérivation.
‐ 12 mois 50% pour la résection et nulle pour la dérivation.
‐ 24 mois 44% pour la résection.
‐ 36 mois 8,4 % pour la résection.
85
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
VI. COMMENTAIRES
&
DISCUSSION
86
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
COMMENTAIRES ET DISCUSSION :
I-Méthodologie :
Notre étude rétrospective de janvier 1999 au décembre 2013 a porté sur 372
malades parmi lesquels nous avons participé à la prise en charge de 92 malades
soit 24,7% de façon prospective.
Nous avons été confrontés aux difficultés suivantes :
La non informatisation des dossiers médicaux qui faciliterait la recherche.
L’impossibilité de réaliser un examen histologique extemporané pour une
exérèse complète (R0) et un curage efficient.
En dépit de ces difficultés rencontrées, cette étude nous a permis de faire une
bonne analyse des données sur le syndrome orificiel dans le cancer gastrique.
II-Aspects épidémiologiques :
1-La fréquence hospitalière selon les auteurs :
Fréquence Cancers Syndrome P
Auteurs gastriques orificiel
Okumura Japon 2014 [5] 1531 97(6,3%) 0,0000
Mansoor Pakistan, 2013 [6] 138 69(50%) 0,5461
Kim TO Corée 2007 [50] 103 53(51,3%) 0,7554
Notre série 2014 698 372(53,3%)
Le syndrome orificiel survient très souvent dans le cancer gastrique au stade
avancé [5 ; 9].
Il n’existe pas de différence statistiquement significative entre la proportion du
syndrome orificiel de notre étude et celle des auteurs Coréen et Pakistanais
87
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
(51,3% et 50%) [6 ; 50], Par contre elle est supérieure à la proportion du
syndrome orificiel de la série Japonaise (6,3%) [5] ou P<0,05.
Cette différence avec l’auteur Japonais pourrait être liée : au diagnostic tardif et
au manque de moyen financier.
2-Sex-ratio selon les auteurs :
Auteurs Homme/Femme Sex-ratio
Jaka Tanzanie 2013 n=184 [4] 122/62 1,9
Okumura Japon 2014 n=97 [5] 61/36 1,7
Mansoor Pakistan 2013 n=69 [6] 37/32 1,2
Kim TO Corée 2007 n=53 [50] 35/18 1,9
Notre série 2014 n=372 226/146 1,5
Une plus grande représentativité des hommes a été retrouvée dans toutes les
séries avec un sex-ratio variant de 1,2 à 1,9.
Cette prédominance masculine serait liée à la consommation alcoolo-tabagique
plus fréquente chez les sujets de sexe masculin en Afrique en général et au Mali
en particulier [4 ; 64].
88
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
3- Age moyen selon les auteurs :
Auteurs Age moyen Extrêmes P
(année)
Jaka Tanzanie 2013 [4] 52 46-78 0,050794
Kim TO Corée 2007 [50] 64 43-85 0,257206
Moura Brésil 2012 [52] 61 32-80 0,754568
Çaglar Turquie 2013 [53] 65,7 35-90 0,548426
Notre série 2014 56 25-90
Autrefois considéré comme une maladie des personnes âgées, le cancer de
l’estomac est retrouvé chez les sujets de plus en plus jeunes [54 ; 55].
Il n’existe pas de différence statistiquement significative entre l’âge moyen de
notre série de 56 ans et celui retrouvé dans les différentes séries représentées
dans le tableau ci-dessus (52 ; 64 ; 61 et 65,7 ans) [4 ; 50 ; 52 ; 53].
89
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
III-Aspects cliniques :
1-Mode de recrutement selon les auteurs :
Recrutement Urgence C/externe
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013 n=184 [4] 42(22,8%) P=0,629 142(77,2%) P=0,574
Okumura Japon 2014 n=97 [5] 64(66%) P=0,000 33(34%) P=0,000
Manssoor Pakistan 2013 n=69[6] 14(20,3%) P=0,810 55(79,7%) P=0,972
Notre série 2014 n=372 75(20,2%) 297(79,8%)
Le syndrome orificiel est une complication du cancer gastrique qui altère
sévèrement la qualité de vie des malades par l’obstruction tumorale
d’où la nécessité de considérer ce syndrome comme une urgence
médicochirurgicale [11 ; 12 ; 13].
Nous avons reçu 20,2% de malades en urgence, ce taux ne diffère pas à celui des
auteurs Tanzanien et Pakistanais (22,8% et 20,3%) [4 ; 6], Cependant il est
inférieur à celui de la série Japonaise (66%) [5] avec une différence
statistiquement significative P>0,05.
Cette différence avec l’auteur Japonais s’expliquerait par l’organisation dans la
prise en charge du syndrome orificiel dans nos structures de santés.
90
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-Signes fonctionnels :
2-1-Vomissements selon les auteurs :
Vomissements Effectifs Pourcentage
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013 n=184 [4] 184 100
Okumura Japon 2014 n=97 [5] 97 100
Mansoor Pakistan 2013 n=69 [6] 69 100
Notre série 2014 n=372 335 100
Dans la littérature les vomissements sont constamment retrouvés dans le
syndrome orificiel [56 ; 57].
Ils traduisent une tumeur distale avec sténose du canal pylorique [14 ; 15 ; 58].
Ceci pourrait s’expliquée par la durée d’évolution des signes cliniques, le retard
diagnostique de la maladie et le siège de la tumeur.
Les vomissements ont été retrouvés dans toutes les séries dans 100% des cas.
91
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-2-Dysphasie selon les auteurs :
Dysphasie Effectifs Pourcentage
Auteurs
Martin USA 2015 n=1181 [7] 1181 100
Marrelli Italie 2015 n=438 [59] 438 100
Glaoui Rabat 2009 n=150 [51] 150 100
Notre série 2014 n=372 37 100
La dysphagie basse est un signe des tumeurs localisées dans la région cardiale
[27]. Ce symptôme est un facteur de mauvais pronostic [27 ; 49 ; 58].
Il s’agit d’une dysphasie, basse, progressive, permanente, d’abord pour les
solides puis pour les liquides, qui serait favorisée par des régurgitations.
Dans toutes les séries la dysphagie a été retrouvée dans 100% des cas [7;51;59].
Sa fréquence serait liée à la survenue des cancers du cardia.
92
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-3-Epigastralgie selon les auteurs :
Epigastralgie Effectifs Pourcentage P
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013 n=184 [4] 104 56,5 0,0354
Okumura Japon 2014 n=97 [5] 52 53,6 0,0734
Mansoor Pakistan 2013 n=69 [6] 41 59,4 0,1245
Kim TO Corée 2007 n=53 [50] 29 54,7 0,0874
Notre série 2014 228 61,3
L’épigastralgie est le principal signe de l’ulcère gastrique ainsi que du cancer de
l’estomac, mais dans ce dernier elle est fixe, non rythmée par les repas, d’horaire
de survenue invariable et tranfixiante [15 ; 22;62].
Elle est retrouvée dans une proportion importante chez les malades de notre
série et ainsi que dans la littérature [4 ; 5 ; 6 ; 50].
93
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-4-Amaigrissement selon les auteurs :
Amaigrissement Effectifs Pourcentage
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013 [4] 172 93,5
Okumura Japon 2014 [5] 92 94,9
Mansoor Pakistan 2013 [6] 53 76,8
Kim TO Corée 2007 [50] 44 83
Notre série 364 97,8
La perte de poids est retrouvée dans toutes les séries [4 ; 5 ; 6 ; 50] avec une
incidence moyenne de 76,8-97,8%.
Son importance est souvent corrélée au stade de la tumeur.
94
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
3-Signes généraux :
3-1-Classification ASA (Américain society of Anesthésiologiste) :
ASA III+IV+V P
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013 n=184 [4] 96 (52,2%) 0,000409
Guy Angleterre 2004 n=300 [63] 196 (65,3%) 0,128604
Martin USA 2015 n=1181 [51] 934(79,1%) 0,012796
Notre série 2014 n=372 267 (71,8%)
Le score ASA ou « Physical status score » a été mis au point en 1941 par
« American Society of Anesthesiologists » [65].
Le score ASA est utilisé pour exprimer l’état de santé pré-opératoire d’un
patient. Il permet d’évaluer le risque anesthésique et d’obtenir un paramètre
prédictif de mortalité et de morbidité péri-opératoire.
Plus de la moitié des malades des différentes séries avaient une classe ASA
supérieure ou égale à III (52,2 à 79,1%).
3-2-Dénutrition :
Dans notre série, le statut nutritionnel pré-opératoire des patients a été défini par
l’indice de masse corporelle et la perte de poids.
La dénutrition pré-opératoire a été définie selon la société Francophone de
nutrition clinique et métabolisme (SFNEP) ,Il s’agissait d’une perte de poids
préopératoire supérieure ou égale à 10 % du poids habituel, d’un indice de
masse corporel (IMC) inférieur ou égal à 18,5 kg/m2 ou inférieur à 21 kg/m2
chez un patient de plus de 70 ans [61;66].
Un indice de masse corporelle inférieur à la norme a été retrouvé chez la grande
majorité de nos malades.
Dans la littérature, l’immunonutrition préopératoire est recommandée avant
95
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
toute chirurgie digestive cancérologique [67]. Elle permet une diminution de la
morbidité infectieuse post-opératoire et de la durée d’hospitalisation [68].
4-Signes physiques :
4-1-Masse abdominale selon les auteurs :
Masse Effectifs Pourcentage P
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013 n=184 [4] 46 25 0,012723
Mounir Maroc 2009 n=75 [22] 14 18,7 0,000034
Luis Mexique 2007 n=132 [69] 22 17 0,011565
Notre série Mali 2014 n=372 172 46,5
La masse abdominale représente le signe physique le plus fréquent dans notre
étude, mais malheureusement lorsqu’elle est présente, elle reflèterait le caractère
avancé de la tumeur [22 ; 37].
La proportion des masses épigastriques palpables chez nos malades de 46,5%,
est largement supérieure à celle rapportée par les auteurs représentés dans le
tableau ci-dessus (25% ; 18,5% et 17%) [4 ; 22 ; 69] avec une différence
statistiquement significative (P<0,05).
Cette différence s’expliquerait par une durée d’évolution trop longue de la
maladie de notre étude.
96
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
4-3-Ascite selon les auteurs :
Ascite Effectifs Pourcentage P
Auteurs
Okumura Japon 2014 [5] 32 33 0,530252
Mansoor Pakistan 2013[6] 22 31,9 0,760561
Jaka Tanzanie 2013 [4] 44 24 0,656103
Notre série 2014 105 28,2
L’ascite maligne due à une carcinose péritonéale survient au cours d’un cancer
gastrique chez 5 à 20% des patients [70].
Elle a été longtemps considérée comme une situation définitivement palliative.
Sur ces 20 dernières années, des nouvelles approches de ce problème ont
émergé : L’aspiration de l’ascite, stagging laparoscopique, cytoreduction
chirurgicale de la carcinose péritonéale associée ou non à une chimio-
hyperthermie intra péritonéale [71 ; 72].
Dans toutes les séries l’ascite a été retrouvée dans 24 à 33%
97
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
IV-Aspects paracliniques :
1-Siège de la tumeur selon les auteurs :
Siège Effectifs Antre et Pylore Cardia
Auteurs
Mansoor Pakistan 2013[6] 69 45(65,2%) -
Robert Tours 2012 [61] 124 49(39,5%) 18(14,5%)
Kim TO Corée 2007[50] 53 40(75,5%) 13(24,5%)
Martin USA 2015 [7] 1181 - 1181(100%)
Notre série 2014 372 335(90,1%) 37(9,9%)
Chez la grande majorité de nos malades, la tumeur a siégé dans la région distale
antro-pylorique comme dans la littérature [6 ; 50 ; 7 ; 61].
La grande fréquence de la localisation antro-pylorique est liée à la prévalence de
l’infection à H. pylori [9 ; 73].
Ceci peut alors expliquer la prédominance de cette localisation en Afrique et en
Asie, pourvu que la prévalence de l’infection par cette bactérie est élevée dans
ces dites zones [19 ; 74 ; 44].
L’incidence du cancer du cardia est en augmentation dans les pays développés
depuis 1970 [8].
La proportion du cancer du cardia par rapport aux sièges est plus élevée dans les
séries Américaine, Coréenne, et Française (100% ; 24,5% et 14,5%)
[50 ; 7 ; 61] que dans notre série.
98
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2- Histologie selon les auteurs :
Histologie Adénocarcinome Carcinome Tumeurs
Auteurs épidermoïde stromales
Kim TO Corée 2007 [50] 44(83%) 9(17%) -
Glaoui Rabat 2009 [51] 150(100%) - -
Robert Tours 2012[61] 158(88,3%) - 15(8,4%)
Martin USA 2015 [7] 1181(100%) - -
Notre série 2014 351(94,4%) 15(4%) 6(1,6%)
La littérature rapportait que 95% des cancers de l’estomac sont des
adénocarcinomes ; le reste 5% incluent les lymphomes, les tumeurs stromales et
autres tumeurs rares [9].
Dans toutes ces séries [7 ; 50 ; 51 ; 61], l’adénocarcinome a été le type
histologique le plus fréquent de 83 à 100%, ce qui concorde avec les données de
la littérature.
99
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
3-Stade évolutive selon les auteurs :
Stade TNM Stade III+IV P
Auteurs
Okumura Japon 2014[5] n=97 84(86,6%) 0,000000
Mounir Maroc 2009[22] n=75 73(97,33%) 0,073642
Marrelli Italie 2015 n=438 [59] 247(56,4%) 0,000000
Martin USA 2015 n=3816 [7] 2415(63,3%) 0,000000
Notre série 2014 n=372 372(100)
Dans la littérature le syndrome orificiel est caractérisé par une haute probabilité
de stade IV de la maladie et un mauvais pronostic [2 ; 8].
Un taux élevé de stades évolutifs avancés a été retrouvé dans toutes les séries
avec une incidence moyenne de 56,4% à 100%.
100
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
V-Aspects thérapeutiques :
1-Méthodes chirurgicales selon les auteurs :
Méthodes chirurgicales Résection Dérivation
Auteurs
Jaka Tanzanie 2013[4] 22(13,1%) P=0,846 104(61,9%) P=0,532
Okumura Japon 2014[5] 49(53,3%) P=0,000 25(27,2%) P=0,000
Mounir Maroc 2009 [22] 25(34%) P=0,098 22(30,1%) P=0,002
Kaye USA 2007 [42] 3277(54%)P=0,000 1117(18,5%) P=0,000
Notre série 2014 n=372 46(16,3%) 184(65,2%)
Le traitement chirurgical palliatif est d’importance dans notre contexte, non pas
en termes de calcul de taux de survie, mais de qualité de vie des patients
(absence ou minimisation des douleurs et des vomissements, éviction de la
perforation et des hématémèses) [22 ; 23].
- Notre taux de résécabilité de 16,3% ne diffère pas de celui retrouvé dans les
séries Tanzanienne et Marocaine (13,1% et 34%) [4 ; 22], Cependant il est
inférieur à celui rapporté par ces auteurs Japonais et Américain
(53,3% et 54,2%) [5 ; 42] avec une différence significative P<0,05.
Cette différence avec les auteurs Japonais et Américain pourrait s’expliquer par
un manque de moyen financier car la réanimation des malades dénutris pour
l’intervention chirurgicale demande parfois beaucoup de moyens financiers.
- Une gastro-entéro-anastomose large postérieure latéro-latérale
transmesocolique iso péristaltique ; courte procédure a très souvent permis aux
malades ayant un cancer inextirpable une alimentation normale et un arrêt des
101
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
vomissements.
Notre taux de dérivation de 65,2% ne diffère pas de celui de la série Tanzanie
avec 61,9% [4], par contre il est supérieur à celui rapporté dans les séries
Japonaise, Américaine et Marocaine (27,2% ; 18,5% et 30,1%) [5 ; 42 ; 22] avec
une différence statistiquement significative P<0,05.
Cette différence s’expliquerait par le nombre élevé de stades évolutifs avancés
de notre série.
2-Morbidité postopératoire selon les auteurs :
Auteurs Morbidité P
Jaka Tanzanie 2013[4] (43)25,6% 0,944619
Mansoor Pakistan 2013[6] (20)29% 0,652357
Martin USA 2015 [7] (409)34,6% 0,006529
Kim TO Corée 2007[50] (17)32,1% 0,009475
Notre série n=372 (72)25,6%
La morbidité postopératoire est définit par la survenue de complication outre
que les décès dans les 30 jours qui suivent une intervention chirurgicale [75;61].
Le taux de morbidité postopératoire de notre série de 25,6% ne diffère pas de
celui retrouvé dans les séries Tanzanienne et Pakistanaise (25,6% et 29%) par
contre il est inférieur à celui rapporté par les auteurs Coréen et Américain
(32,1% et 34,6%) [7 ; 50] avec une différence significative P<0,05.
102
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Cette différence avec ces auteurs Coréen et Américain serait liée à la résection
multiviscérale et à la prothèse endoscopique, car ces techniques n’ont pas été
pratiquées chez nos malades.
3-Mortalité postopératoire selon les auteurs :
Auteurs Mortalité P
Jaka Tanzanie 2013 [4] (34)18,5% 0,723104
Okumura Japon 2014 [5] (8)8,2% 0,693226
Kim Corée 2007 [50] (10)18,9% 0,946936
Huang Taiwan 2010 [34] (36)9,9% 0,905177
Notre série 2014 (41)14,5%
La mortalité postopératoire immédiate est définie comme tout décès survenant
dans les 30 jours qui suivent une intervention chirurgicale [42;54].
La mortalité postopératoire est surtout liée à l’état nutritionnel et à la présence
de comorbidités telles que les infections pulmonaires, les problèmes cardio-
vasculaires en particulier chez le sujet âgé [44]
Notre taux de mortalité de 14,5% ne diffère pas de ceux rapportées par ces
auteurs représentées dans le tableau ci-dessus [4 ; 5 ; 34 ; 50].
103
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
4-Durée moyenne d’hospitalisation :
Auteurs Effectifs Durée en jours P
Jaka Tanzanie 2013 [4] 184 14 0,688520
Okumura Japon 2014 [5] 97 18 0,240601
Kim TO Corée 2007 [50] 53 16 0,659049
Notre série 2014 372 13
La durée moyenne d’hospitalisation dépend de la technique opératoire, de
l’apparition de complications.
Dans toutes les séries la durée moyenne d’hospitalisation varie de 13 à 18jours.
104
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
VI-Survie médiane selon les auteurs :
1-Survie médiane après résection selon les auteurs :
Résection Effectifs Survie médiane P
Auteurs (mois)
Okumura Japon 2014 n=97 [5] 49 8,3 0,782353
Mounir Maroc 2009 n=75 [22] 25 15 0,591411
Martin USA 2015 n=1181 [7] 214 21 0,052337
Notre série 2014 n=372 46 9,2
Dans la littérature, l’exérèse gastrique même palliative améliore le taux de
survie par rapport aux gestes palliatives sans exérèse [26 ; 27].
Il n’existe pas de différence statistiquement significative entre la survie médiane
au cours de la résection de notre étude de 9,2 mois et celle retrouvée dans les
séries Japonaise, Marocaine et Américaine (8,3 ; 15 et 21 mois).
105
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
2-Survie médiane après dérivation selon les auteurs :
Dérivation Effectifs Survie médiane P
Auteurs (mois)
Okumura Japon 2014 n=97 [5] 25 8,8 0,6565
Mounir Maroc 2009 n=75 [22] 22 7 0,5040
Jeurnink Hollande 2007 n=1046 [60] 297 5,5 0,9091
Notre série 2014 n=372 184 5,3
La survie médiane au cours de la dérivation de notre étude de 5,3 mois ne diffère
pas de celle rapportée par ces auteurs représentés dans le tableau ci-dessus
[5 ; 22 ; 60].
106
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
VII. CONCLUSION
ET
RECOMMANDATIONS
107
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
CONCLUSION :
Le syndrome orificiel est une complication fréquente et grave du cancer
gastrique qui altère sévèrement l’état général des patients d’où l’intérêt de lui
considérer comme une urgence chirurgicale.
Le traitement est palliatif pour la plupart c’est-à-dire une dérivation digestive,
mais la résection même palliative est préférable à la dérivation toutes les fois
qu’elle est techniquement possible.
Le pronostic du syndrome orificiel est extrêmement sombre.
La chimiothérapie après gastrectomie et l’institution d’une immunonutrition
préopératoire améliorent le pronostic.
108
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
RECOMMENDATIONS :
Aux autorités :
• L’instauration d’un programme de dépistage systématique de la
population à risque.
• L’instauration des programmes d’éducation alimentaires des scolaires et
de la population générale.
• La construction de blocs adaptés aux normes de la chirurgie
carcinologiques.
• La construction d’une unité d’anatomie pathologique au CHU Gabriel
Touré
Au corps professionnel :
• La création d’un service d’archivage médical informatisé.
• La reconnaissance de tout cas de syndrome orificiel comme une urgence
médico-chirurgicale.
• L’éradication d’H-pylori devant tout syndrome ulcéreux
• Référence aux structures spécialisées de tout ulcère gastrique rebelle au
traitement médical.
• Le suivi rigoureux de tout patient présentant une lésion précancéreuse.
A la population :
• L’abandon de la conservation des aliments par fumaison et par salaison.
• La pratique d’une conservation par frigidaire.
• L’augmentation de la consommation des fruits et de légumes.
• L’arrêt de l’automédication devant toute épigastralgie.
109
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
VIII. REFERENCES
110
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
REFERENCES
1-LAROUSSE Médical 2009; 1113p.
2-Sicard A, Mialaret, Patel J et al
Pathologies Chirurgical. Paris Masson 1975:587-593.
3-Moura N, Flejou J.F.
Cancer de l’estomac: anatomie pathologie.
EMC Gastro-entérologie 2001; 5 (9):9-027.
4-Hyasinta Jaka, Mabula D Mchembe, Peter F Rambau and al.
Gastric outlet obstruction at Bugando Medical Centre in Northwestern Tanzania:
a prospective review of 184 cases.
BMC surgery 2013; 13:41.
5-Yasuhiro Okumura, Hiroharu Yamashita, Susumu Aikou and al.
Palliative distal gastrectomy offers no survival benefit over gastrojé-junostomie
for gastric cancer with outlet obstruction: retrospective analysis of an 11 year
experience.
World journal of surgical oncology 2014; 12:364.
6-Hala Mansoor and Muhammed Asim Yusuf:
Outcomes of endoscopy pylori stenting in malignant gastric outlet obstruction: a
retrospective study.
BMC research notes 2013; 6:280.
7-Jeremiah T Martin, Angela Mahan, Joseph B Zwischenberger,et al.
Should Gastric Cardia Cancers Be Treated with Esophagectomy or Total
Gastrectomy. A Comprehensive Analysis of 4,996 NSQIP/SEER Patients
From the Department of Surgery, The University of Kentucky,Lexington, KY.
J Am Coll Surg 2015, 220:510-520.
8-Gill S, Shah A, Le N and al.
Asian Ethnicity Related Differences in Gastric Cancer Presentation and
Outcome Among Patients Treated at a Canadian Cancer Center.
Journal of clinical oncology 2003; 21(11):2070-76.
111
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
9-Layke JC, Lopez PP.
Gastric cancer Diagnosis and Treatment Options.
American Family Physician 2004; 69(5):1133-40.
10-Traoré CB, Kamaté B, Sanogo ZZ et al.
Epidémiologie et histopathologie des cancers au Mali.
Carcinol Prat Afrique 2008; 8(1):67-71.
11-Sabharwal T, Irani FG, Adam A.
Quality assurance guidelines for placement of gastroduodenal stents. Cardiovasc
Intervent Radiol 2007 (30):1–5.
12-Bessoud B, De Baere T, Denys A et al:
Malignant gastroduodenal obstruction: palliation with self-expanding metallic
stents. J Vasc Interv Radiol 2005 (16):247–253.
13-Piesman M, Kozarek RA, Brandabur JJ, and al:
Improved oral intake after palliative duodenal stenting for malignant
obstruction: a prospective multicenter clinical trial.
Am J Gastroenterol 2009, (104):2404 –2411.
14-Maconi G, Manes G, Porro GB.
Role of symptoms in diagnosis and outcome of gastric cancer.
World J Gastroenterol 2008; 14(8):1149-55.
15-Boutellier P.
Sémiologie chirurgicale. Paris: Masson 1999: 289-92
16-Michel Hujuier.
Cancer de l’estomac. Diagnostic, évolution et traitement. La revue du
praticien(Paris) 2011;996(46):1005-1009
17-Wang X, Terry PD, Yan H.
Review of salt consumption and stomach cancer risk: Epidemiological and
Biological evidence.
World Gastroenterol 2009; 15(18):2204-13.
112
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
18-Tsugane S and Sasazuki S.
Diet and the risk of gastric cancer: review of epidemiological evidence.
Gastric Cancer 2007(10):75–83.
19-Yamaoko Y, Kato M, Asaka M.
Geographic differences in gastric cancer incidence can be explained by
differences between Helicobacter pylori strains.
Inter Med 2008; 47:1077-83.
20-Kim JH, Song HY, Shin JH et al.
Metallic stent placement in the palliative treatment of malignant gastric outlet
obstructions: primary gastric carcinoma versus pancreatic carcinoma.
AJR Am J Roentgenol 2009; 193:241-247.
21-Maire F, Hammel P, Ponsot P, et al.
Long-term outcome of biliary and duodenal stents in palliative treatment of
patients with unresectable adenocarcinoma of the head of pancreas.
Am J Gastroenterol 2006; 101:735-742.
22-Mounir BN.
Cancer gastrique localement avancé à propos de 75 cas à l’hôpital IBN SINA de
Rabat. These de Medicine université Mohamed V de Rabat 2008; 43p.
23-Kikuchi S, Tsutsumi O, Kobayashi N:
Does gastrojejunostomy for unresectable cancer of the gastric antrum offer
satisfactory palliation.
Hepatogastroenterology 1999, 46:584–587.
24-Song HY, Yang DH, Kuh JH, Choi KC.
Obstructing cancer of the gastric antrum: palliative treatment with covered
metallic stents. Radiology 1993; 187:357-358.
25- Haugstvedt T, Visite A, Eide G.E, Soreide O.
The survival benefit of resection in patient whith advanced stomach cancer: the
norvegian multicenter experience.
World J Surg 1989; (13):617-622.
113
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
26-Hallissey MT, Allum WH, Roginski C and Fielddign JW.
Palliative surgery for gastric cancer. Cancer 1988; 62:440-444
27-Heemskerk V H, lentze F, Hulsewé KWE, et al.
Gastric carcinoma: review of treatment in a community teaching hospital.
World Journal of Surgical Oncology 2007; 5(81)1-7.
28-Bilimoria KY, Bentrem DJ, Feinglass JM, et al.
Directing Surgical Quality Improvement Initiative: Comparison of Perioperative
Mortality and long-Term Survival for Cancer Surgery.
Journal of Clinical Oncology 2009; 26(21):4626-33.
29-E. Van Cutsem, Y. Kang, H. Chung, L. Shen, and al.
Efficacy results from the ToGA trial: A phase III study of trastuzumab added to
standard chemotherapy (CT) in first line human epidermal growth factor
receptor 2 (HER2)- positive advanced gastric cancer (GC) Journal of Clinical
Oncology 2009; 27:18
30-Bouché O, Penault-Llorca F.
[HER2 and gastric cancer: a novel therapeutic target for trastuzumab].
Bull Cancer 2010; 97(12):1429-40.
31-Gondos A, Arndt V, Holleczek B, and al.
Cancer survival in Germany and the United States at the beginning of the 21st
century: An up-to- date comparison by period analysis.
Int J Cancer 2007; 121:395-400.
32-Zhang XF, Huang CM, Wu XY et al.
Surgical treatment and prognosis of gastric cancer in 2613 patients.
World J Gastroenterol 2004; 10(23): 3405-3408.
33-Sissoko D.
Cancer de l’estomac dans le service de chirurgie B du CHU du Point Thèse de
médecine FMPOS Bamako 2009 n°124.
114
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
34-Kuo-Hung-Hang, Wu Chew-Wun, Wen-Liang Fang.
Résection palliative chez les patients atteints de cancer gastric non curable.
J Surg mondiale 2010 ; 34 :1015-1021.
35-Mutter D, Marescaux J.
Gastrectomies pour cancer : principes généraux, anatomie vasculaire, anatomie
lymphatique, curages.
Encyclopédie Médico-chirurgicale 40-330-A 2004.
36-Kamina P.
Précis d’anatomie clinique tome III. Paris Maloine 2004 :239-50.
37- Aparicio T, Yacoub M, Karila-Cohen P, René E.
Adénocarcinome gastrique : notions fondamentales, diagnostic et traitement.
Encyclopédie Médico-chirurgicale 9-027-A-10 2004.
38- Maiga A.
Aspect thérapeutique du cancer de l’estomac au service de chirurgie générale
CHU Gabriel Touré.
Mémoire de fin de cycle CES chirurgie Bamako F.M.P.O.S 2008 ; No ,42p.
39-Bailey C.
Stomach cancer. Clinical Evidence 2008; 09:404-413
40-Roder D. M.
The epidemiology of gastric cancer.Gastric Cancer 2002; 5(1):5-11.
41-Correa P, Piazuelo MB.
Natural history of Helicobacter pylori infection. Dig Liver Is 2008; 40(7):490-6.
42-Kaye M, Lombardo R, Gay G et al.
Gastric Cancer Patient Care Evaluation Group from the Commission Cancer.
J Gastrointest Surg 2007; 11:410-20.
115
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
43-Ouattara H, Sawadogo A, D Ilboudo P et al.
Le cancer de l’estomac au centre hospitalier national Sanou Souro (CHNSS) de
Bobo Dioulasso Aspects épidémiologiques. A propos de 58 cas de janvier 1996
à juin 1999.
Médecine d’Afrique Noire 2004;51(7):423-425.
44- Bagnan KO, Padonou N, Kodjoh N, Houansou T.
Le cancer de l’estomac, à propos de 51 cas observés au CNHU de Cotonou.
Médecine d'Afrique Noire 1994; 41(1):39-43
45-Michel P, Di Fiore F.
Le traitement adjuvant du cancer gastrique. Hepato-Gastro 2005; 12(2):135-40.
46-Van de Velde CJH, Benson IIIAI B.
Accomplishments in 2007 in the Management of localized gastric cancer.
Gastrointestinal cancer Research 2007; 2(3):42-6.
47-Sobin LH, Gospodarowicz MA, Wittekind C.
TNM classification of malignant tumors. seventh edition
Heidelberg:Springer;2009.
48-Hartgrink HH.
Improving outcome for scirrhous gastric cancer.
Gastric Cancer 2009; 12:3-5.
49- Maré F.
Epidémiologie des cancers digestifs au service de chirurgie générale CHU
Gabriel Touré. Thèse de Méd. Bamako F.M.P.O.S 2005 ;162p N°140.
50-Kim TO, Kang DH, Kim GH, and al.
Self-expandable metallic stents for Palliation of patients with malignant gastric
outlet obstruction caused by stomach cancer.
World J Gastroenterol 2007 February 14; 13(6): 916-920.
51-M. Glaoui, S.Naciri, S. Ghanema, et al.
Le profil épidémiologique de l’adénocarcinome du cardia. Service de chirurgie
A, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc 2009.02.097.
116
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
52-Eduardo Juimaraes, Hourneaux Moura, Flavio Coelho Ferreira and al:
Duodenal stenting for malignant gastric outlet obstruction.
World journal gastroenterol 2012 March 7, 18(9):938-943.
53-Çaglar E and Dobrucali A.
Self-Expandable Metallic Stent Placement in the Palliative Treatment of
Malignant Obstruction of Gastric Outlet and Duodenum in Department of
Gastroenterology, Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul.
Clin Endosc 2013(46):59-64
54-Heise H, Bertran E, Marcelo E and al.
Incidence and survival of stomach cancer in a high-risk population of Chile.
World Gastroenterol. 2009; 15:1854-62.
55-Kanoute M.
Le cancer de l’estomac dans le service de chirurgie générale CHU Gabriel
Touré, Thèse de Med. Bamako F.M.P.O.S, 2010; 115p No 154.
56. Alonso-Larraga JO, Alvaro-Villegas JC, Sobrino-Cossio S, and al:
Self-expanding metal stents versus antrectomy for the palliative treatment of
obstructive adenocarcinoma of the gastric antrum.
Rev Esp Enferm Dig 2012; 104:185–189.
57-Khashab M, Alawad AS, Shin EJ and al:
Enteral stenting versus gastrojejunostomy for palliation of malignant gastric
outlet obstruction.
Surg Endosc 2013, (27):2068–2075.
58-BenHhamou Y.
Cancer de l’estomac.
Gastro-Entérologie. Editions ESTEM ET MEDLINE. 1998:95-104.
117
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
59-Daniele Marrelli, Paolo Morgagni, Giovanni de Manzoni, et al.
Italian Research Group for Gastric Cancer
External Validation of a Score Predictive of Recurrence after Radical Surgery
for Non-Cardia Gastric Cancer: Results of a Follow-Up Study
J Am Coll Surg 2015, 221:280-290.
60-Suzanne M Jeurnink, Casper HJ van Eijck, Ewout W Steyerberg et al.
Stent versus gastrojejunostomy for the palliation of gastric outlet obstruction: a
systematic review.
BMC Gastroenterology 2007; 7:18
61-Robert PE.
Gastrectomie pour adénocarcinome gastrique influence de l’étendue de la
lymphadénectomie, étude rétrospective unicentrique portant sur 124
patients .These Med. Université François-Rabelais de Tours 2012.
62-Sacko O, Soumaré, Camara A et al.
Prise en charge des tumeurs malignes gastriques dans le service de chirurgie A
du CHU POINT G à propos de 84 cas.
Mali Medical 2014; 29(4):49-52
63-Blackshaw GRJC, Stephens MR, Lewis WG et al.
Prognostic significance of acute presentation with emergency complications of
gastric cancer.
Gastric cancer 2004;7: 91-6.
64-Dembélé BT et al.
Cancers gastriques non résecables dans le service de chirurgie générale CHU
Gabrièl Touré Bamako.
Mali Médical 2012; 28(1):14-18.
65-Owens WD, Felts JA, Spitznagel EL Jr.
ASA physical status classifications: a study of consistency of ratings.
Anesthesiology 1978; 49: 239-243.
118
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
66-Chambrier C, Sztark F.
French clinical guidelines on perioperative nutrition.
Ann Fr Anesth Reanim 2011; 30:381-389.
67-Mariette C, Alves A, Benoist S, et al.
Perioperative care in digestive surgery. Guidelines for the French society of
digestive surgery (SFCD).
Ann Chir 2005; 130:108-24.
68-Gianotti L, Braga M, Nespoli L, et al.
A randomized controlled trial of preoperative oral supplementation with a
specialized diet in patients with gastrointestinal cancer.
Gastroenterology 2002; 122:1763-1770.
69-Luis F, Guadalupe Mendez-cruz, Roberto Hernandez-RAMOS,
L’expérience de la morbidité opératoire après chirurgie palliative chez les
patients souffrant de cancer gastrique.
Japanese Gastric cancer 2007; 10:215-220.
70-Glehen O, Gilly FN, Arvieux C, et al.
Peritoneal carcinomatosis from Gastric Cancer: A Multi-institutional Study of
159 Patients Treated by Cytoreductive Surgery Combined with Perioperative
Intraperitoneal Chemtherapy.
Ann Surg Oncol. 2010; 17:2370-7.
71-Facchiano E, Scaringi S, Kianmanesh R, et al.
Laparoscopic hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for the
treatment of malignant ascites secondary to unresectable peritoneal
carcinomatosis from advanced gastric cancer.
Eur J Surg Oncol. 2008; 34:154-8.
72-Guide sur le traitement de la carcinomatose péritonéale par cytoréduction
chirurgicale et chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale peropératoire
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie(CÉPO) Février 2006.
119
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
73-Faik M.
Mise au point sur l’infestation gastrique par l’Helicobacter pylores.
Médecine du Maghreb 2000; 79: 17-9.
74-Konate A, Diarra M, Soucko-Diarra A et al.
Gastrique chronique à l’ère d’Helicobacter pylori au Mali.
Acta endoscopica 2007; 37(3):315-320.
75-Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, et al.
The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five-year
experience.
Ann Surg 2009; 250:187-196.
120
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
ANNEXES
121
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
SYNDROME ORIFICIEL DANS LES CANCERS GASTRIQUES
EN CHIRURGIE GENERALE AU CHU GABRIEL TOURE
DE JANVIER 1999 AU DECEMBRE 2013
FICHE D’ENQUETE N° :
Identification du malade :
Q1 : N° du dossier du malade :…………………………………../_/_ /
Q2 : Nom :………………………………Prénom……………………/_/_/
Q3 : Age(Année) :……………../_/_/_/.
Q4 : Sexe :…………………………………………………………………/_/
1-Masculin 2-Féminin
Q5 : Résidence :………………………………………………………..../_/
Q6 : Contact à Bamako :…………………………………………../_/_/
Q7 : Région de provenance :……………………………………../_/_/
1-Kayes 2-Koulikoro 3-Sikasso 4-Ségou
5-Mopti 6-Tombouctou 7-Gao 8-Kidal
9-District de Bamako 10-autres 99-Indéterminée
Si Autres à préciser :…………………………………….…………/_/_/
Q8 : Ethnie :…………………………………………………..………./_/_/
1-Bambara 2-Malinké 3-Sarakolé 4-Khassonké 5-Peulh
6-Sonrhaï 7-Dogon 8-Sénoufo 10-autres 99-indéterminé
Si Autres à préciser…………………………………………………/_/_/
Q9 : Nationalité :……………………………………………………/_/_/
1-Malienne 10-autres 99-Indéterminée
Si Autres à préciser ……………………………………………………
Q10 : Principale occupation :…………………..………………/_/_/
1-Cadre Supérieur 2-Cadre moyen 3-Militaire
4-Commerçant 5-Cultivateur 6-Ouvrier
7-Éleveur 8-Ménagère 10-Autres 99-Indéterminée
Si Autres à préciser :………………… ………………………….…
122
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Q11 : Statut Matrimonial :…………………………………………/_/
1-Marié(e) 2-Célibataire 3-Veuf(e) 4-Divorcé(e) 10-Autres
SI Autres à préciser :……………………………………………….
Q12 : Mode de recrutement………………………………………/_/_/
1-Consultation ordinaire 2-Urgences 10-Autres
Si Autres à préciser ………………………………………………
Q13 : Date d’hospitalisation en chirurgie générale :……
Q14 : Catégorie d’hospitalisation :……………………………../_/
1-1ère catégorie 2-2ième catégorie 3-3ième catégorie
Q15 : Adressé(e) :…………………………………….………………/_/_/
1-Venu(e) de lui-même 2-Médecin 3-Infirmier 10-Autres
Si Autres à préciser :………………………………………………
Q16 : Durée d’hospitalisation en chirurgie générale :……../_/
Renseignements cliniques
Q17: Motif de consultation :…………………………………….../_/_/
1-Vomissements 2-Epigastralgie 3-Dysphagie 4- Hématémèse
5-Anorexie 6-Masse abdominale 7-Amaigrissement
8=1+2 9=1+3 10=1+4 11=1+5 12=1+6 13=1+7
Si Autres à préciser :……………………………………………………
Q18 : Délai entre le début de la Maladie et la 1ère consultation
Médicale :……………………………………………………………… /_/_/
1-inférieur à 1mois 2-1 à 6 mois 3-6 mois à 1 an
4-supérieur à 1an 10-Autres 99-Indéterminé
Si Autres à préciser :…………………………………………
Les signes fonctionnels
Q19 : Epigastralgie……………………………………………..…/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q20 : Vomissements …………………………………………..…/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
123
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Q21 : Si oui préciser les caractéristiques :
Horaire :……………………………………….………………………/_/_/
1-Postprandial précoce 2-Postprandial tardif
Fréquence :……………………………..……………………………/_/_ /
1-Une Fois/jour 2-Deux Fois/jour 3-Trois Fois/jour
4-Quatre Fois/jour 4-Incoercibles
Nature :……………………………………..…………………………/_/_/
1-Alimentaire 2-Bilieux 3-Fécaloïde
Q22 : Lourdeur gastrique……………..…………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q23 : Anorexie………………………………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q24 : Dégout de la viande…………………………………….…/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q25 : Hématémèse…………………………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q 26 : Dysphagie……………………………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q27 : Si oui préciser les caractéristiques :
Apparition :……………………………………………………………/_/_/
1-Progressive 2-Brutale
Fréquence :……………………………………………………………./_/_/
1-Permanente 2-Intermittente
Type :……………………………………………………………………/_/_/
1-Haute 2-Basse
Nature :…………………………………………………..……………/_/_ /
1-Aux solides 2-Aux liquides 3-1+2
Q28 : Sensation de plénitude……………….……………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
124
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Q29 : Amaigrissement………………..……………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q30 : Satiété précoce :………….…………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q31 : Mélénas :………………………………………………………./_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q32 : Signes pulmonaires :……………………….………………/_/_/
1-Toux 2-Hémoptysie 3-Non 10-Autres 99-Indéterminé
Si Autres à préciser :…………………………………………………
Q33 : Signes hépatiques :…………………………………………/_/_/
1-Ictère 2-Fetor 4-Non 10- autres 99-indéterminé
Si Autres à préciser :…………………………………………
Q34 : Autres symptômes :………………………………………../_/_/.
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Si autres à préciser :…………………………………………..
Antécédents
A/Personnels
Q35 : A-t-il consulté un Tradipraticien :……………………../_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q36 : Durée de cette consultation :……………………………/_/_/
1-Environ 1mois 2-2 à 6mois 3-6mois à 1an
4-Supérieur à 1an 10-Autres 99-Indéterminée
Q37 : A-t-il déjà consulté en Milieu Médical :…….…………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q38 : Ulcère Gastrique :……………………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminé
Q39 : Gastrite chronique atrophique :…………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q40 : RGO :……………………………………………………………/_ /_/
125
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q41 : Maladie de Ménétrier………………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q42 : Utilisation prolongé des inhibiteurs
des pompes à proton(IPP)………….……………………………./_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q43 : Anémie de Biermer…………..……………………………./_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Q44 : Autres :…………………………………………………………/_/_/
1-oui 2-Non 99-Indéterminée
Si Autres à préciser :…………………………………………
B/Familiaux :
Q45: Antécédents familiaux de cancer de l’estomac….… /_/_/
1-Oui 2-Degré de parenté 3-Non 99-Indeterminée
Q46 : Antécédent d’autre cancer dans la famille…………./_/_/
1-Oui 2-Non 3-Degré de parenté 99-Indéterminé
Q47 : Maladie héréditaire familiale……….…………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q48 : Autres maladies familiales………….……………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Si Autres à préciser :………………………………
C/Habitudes socio alimentaires :
Q49 : Consommation régulière de poisson fumé :………../_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q50 : Consommation régulière de poisson frais:…………./_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q51 : Consommation régulière de tabac à chiquer :……../_/_/
126
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q52 : Consommation régulière de cigarette :……………../_/_/
1=1paquet-année 2=2-5paquet-année 3=supérieur à 5
paquet-année 99-Indéterminée
Si Autres à préciser :………………………………………….
Q53 : Consommation de pâte d’arachide par semaine :…/_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q54 : Consommation de couscous par semaine :………../_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q55 : Consommation de viande rouge par semaine :…../_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q56 : Consommation d’épices par repas :………………..../_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q57 : Consommation de tô (potasse) par semaine :…..…/_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q58 : Consommation d’alcool (degré) :………………………. /_/_/
1- Alcool faible 2-Alcool fort 99-Indéterminée
Q59 : Consommation de cola :…………………………………../_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
Q60 : Consommation de conserves :………………..………/_/_/
1=1fois /semaine 2=1-4fois/semaine 3=supérieure à
4fois/semaine 99-Indéterminée
127
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Q61: Mode de conservation :………………………………… ../_/_/
1-Réfrigération 2-Salaison 3-Fumaison 4-Séchage
5-Fermentation
6-2+3 7-2+4 8-1+2+3 10-autres 99-Indéterminé
Si Autres à préciser :……………………………………
Q62 : Consommation de sel :……………………………………/_/_/
1-Salé 2-mi salé 3-sans 99-Indéterminée
Q63 : Consommation de fruits et légumes :……………..../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q64 : Groupe sanguin et rhésus :……………………………../_/_/
1-A (+) 2-B (+) 3-AB (+) 4-0(+) 5-A (-)
6-B (-) 7-AB (-) 8-0(-) 99-Indeterminée
D/Examen Physique
Signes généraux :
Etat général
Q65 : Indice de performance OMS
1=OMS I 2=OMS II 3=OMS II 4=OMS IV
Q66: EVA…/_/_/
1-0à3 2-4à6 3-7à 99- Indéterminé
Q67 : Classification ASA :………………………………………../_/_/
1-ASA I 2-ASA II 3-ASA III 4-ASA IV 5-ASA V
Q68 : Paramètres généraux :
Poids (kg):/_/_/ Taille (cm):/_/_/_/ TA (mm hg) Systole:/_/_/
Diastole/_/_/ Pouls/_/_/_/ FR:/_/_/ Température:/_/_/
Q69 : Indice de masse corporelle :……..…………………….. /_/_/
1=Inférieur à 18 2=De 18 à 25 3=Supérieur à 25
Q70 : Déshydratation :…………………………………………../_/_/
1=Oui 2=Non 99-Indéterminée
Si oui préciser le type :…………………………………………../_/_/
128
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1=Modérée 2=Sévère 99-Indéterminée
Q71 : Dénutrition :………………………………………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Si oui préciser le type :…………………………………………./_/_/
1-Modérée 2-Sévère 99-Indéterminée
Q72 : Conjonctives :………………………………………………/_/_/
1-Colorées 2-Pâles 3-Ictériques 99-Indéterminée
Q73 : OMI :………………………………………………………….../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q74 : Ascite :………………………………………………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Signes physiques
Q75 : Tumeur palpable :…………………………………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q76 : Hépatomégalie :……..…………………….………………./_/_ /
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q77 : Splénomégalie :………………………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q78 : Clapotage à jeun :……………………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indeterminée
Q79 : Nodules pariétaux :……………………………….…………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminé
Q80 : Ganglion de Troisier :………………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminé
Q81 : Toucher rectale :……………….……………………………/_/_/
1-Sans anomalie 2-Tumeur palpable 3-Ecailles de Brumer
4-Infiltration de la paroi rectale 5-Rectorragie
Si Autres à préciser :……..………………………………/_/_/
129
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
E/Examens Para cliniques :
Q82 : Fibroscopie faite :…………………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q83 : Biopsie faite :…………………………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q84 : Aspect macroscopique à la fibroscopie :……..………/_/_/
1-Tumeur bourgeonnante 2-Ulcération
3-Ulcérobourgeonnante 99- Indéterminé
Q85 : Résultat d’après l’anatomie pathologie :………….…/_/_/
1-Confirmé 2-Non confirmé
Q86 : Si confirmé à préciser le type de tumeur :…….……/_/
1-Carcinome épidermoïde 2-Adénocarcinome
3-Sarcome 4-lymphome 5-GIST
Q87 : Ganglion :………………………………………………………/-/
1-Envahi 2-Non 99-Indéterminée
Q88 : TOGD :…................................................................../_/_/
1-Addition 2-Amputation 3-Rigidité pariétale 4-Non fait
Q89 : Echographie Abdominale faite :………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q90 : Métastases Hépatiques :……………………………..…/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q91 : Adénopathies Profondes :………………….……………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q92 : Ascite :…………………………………………..……………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q93: Métastases Pulmonaires :…………………………..……/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q94 : NFS faite :………………………………………………..…/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
130
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Q95: Anémie :………………………………………………..……/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q96 : VS faite :……………………………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q97 : VS Accélérée :…………………………………………… /_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q98 : Biologie Hépatique :……………………………………/_/_/
1-Normal 2-Cholestase 3-Insuffisance Hépatique 4-Non faite
Q99: ACE :……………………………………………………...…/_/_/
1-élevé 2- Normal 3-Bas 99-Indéterminé
Q100 : Localisation de la tumeur :…………………….……/_/_/
1-Cardia 2-Antre et pylore
Traitements :
A /chirurgie curative:
Q101 : But :……………………………………………….……………/_/
1-Exérèse 2-Curage ganglionnaire 3-1+2
Q102 : Techniques :…………………………………..……………/_/_/
1-Gastrectomie totale 2-Gastrectomie 4/5 3-Oesogastrectomie
B/Chirurgie palliative
Q103 : But :…………………………………………..………………/_/_/
1-Dérivation 2-Exérèse 3-Biopsie 3-1+2 4-2+3
Q104 : Techniques :………………………………..………………/_/_/
1-Gastro-entéro-anastomose 2-Gastrostomie d’alimentation
3-Jejunostomie d’alimentation
Classification TNM (OMS 1998)
T : Tumeur N : Ganglion M : Métastase
Q105: Stade évolutif TNM (Stadification) :………………/_/_/
1=Stade IA 2=Stade IB 3=Stade II
4=Stade IIIA 5=Stade III 6=Stade IV
131
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Réanimation
Q106: Réanimation préopératoire :…………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q107: Réhydratation :…………………………………………… /_/_/
1-1L 2-1,5L 3-2L 4-2,5L 5-3L 6-3L et Plus
Q108 : Vitaminothérapie :……………………………………../_/_/
1-Vit A 2-Vit B 3-Vit C 4-Vit D 5-Non faite
Q109 : Transfusion sanguine :…………………………….…/_/_/
1-Sang total 3-PFC 2-Concentré globulaire
4-Concentré érythrocytaire 5-Non faite
Nombre de poches/jour :……………………………………..…/_/_/
1-1poche 2-2poches 3-3poches
Q110 : Durée de cette Réanimation /jour :…………….…/_/_/
1-1 à 7jours 2-8 à 15jours 3-Supérieure à 15 jours
Q111 : Réanimation post opératoire :……………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q112 : Durée en jour :……………………………………………/_/_/
1-1 à 7jours 2-8 à 15jours 3-Supérieur à 15jours
Q113 : Patient décédé après l’intervention :……………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Suivi Postopératoire
Q114 : Suites précoces :………………………….………………/_/_/
1-Simples 2-Abcès de la paroi 3-Eviscération 4-Péritonite
5-Fistule digestive 6-Décès 10-Autres 99- Indéterminée
Si Autre à préciser :………………………………………………………
Q115: Date de sortie:/_ _//_ _/ /_ _ _ _/
Q116 : Durée d’hospitalisation en jour :……………………………
Q117 : Mode de suivi à 1mois :………………………….………/_/_/
1-Venu de lui-même 2=Sur rendez-vous 3= Vu à domicile
132
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
4-Sur convocation Par Personne contact 6=Décédé 10=Autre
Si Autre à préciser :……………………………………………………
Q118 : Suites Opératoire à 1 mois :…………………….……/_/_/
1-Simples 2-Epigastralgie 3-Diarrhée 4-Vomissements
5-Amaigrissement 6-Anémie 7-Décédé 10-Autres
Si Autre à préciser :……………………………………………
Q119 : Mode de suivi à 3 mois :……………………………../_/
1-Venu de lui-même 2-Sus rendez-vous 3-Vu à domicile
Sur convocation Par personne contact 6-Decede 10-Autres
Si Autre à préciser :……………………………………………..
Q120 : Suites opératoires a 3 mois :…………………………/_ /
1-Simples 2-Epigastralgie 3-Diarrhee 4-Vomissements
5-Amaigrissement 6-Anemie 7-Décédé 10-Autres
Si Autre à préciser :………………………………………………/_/
Q121 : Mode de suivi à 6 mois :……………………….………/_/_/
1-Venu de lui-même 2-Sur rendez-vous 3-Vu à domicile
4-Sur convocation Par Personne contact 5-Décédé 10-Autres
Autres à préciser :………………………………………………
Q122 : ACE :…………………………………………………………/_/_/
1-Elevé 2-Normal 3-Non fait 4-Bas 99-Indéterminé
Q123 : Suites à 6 mois :…………………………………………/_/_/
1-Simples 2-Epigastralgie 3-Amaigrissement 4-Vomissements
5-Diarrhée 6-Anémie 7-Décédé 10-Autres 99-Indéterminé
Si Autres à préciser :……………………………………………
Q124 : Mode de suivi à 1 ans :…………………………………/_/_/
1-Venu de lui-même 2-Sur rendez-vous 3-Vu à domicile
4-Sur convocation par personne contact 10=Autres
Si Autres à préciser :……………………………………..…………/_/_/
Q125 : Suites à 1 an :……………………………………..………/_/_/
133
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
1-Simples 2-Epigastralgie 3-Vomissements 4-Amaigrissement
5-Diarrhée 6-Anémie 7-Décédé 10-Autres 99-Indéterminé
Autres à préciser :…………………………………………………/_/_/
Q126 : Fibroscopie faite à 1an :………………….……………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q127 : Résultat :……………………………………………………/_/_/
1- Récidive Tumorale 2- Pas de récidive 99- indéterminé
Q128: Echographie faite à 1an :………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q129: Résultat :……………………………………………..……/_/_/
1=Métastases Hépatiques 2=Pas de Métastases Hépatiques
99-Indéterminé
Q130: ACE :……………………………………………………..…/_/_/
1-Elevé 2-Normal 3 -Non fait 4- Bas 99-Indéterminé
Q131: Mode de suivi à 2ans :………………………..………/_/_/
1-Venu de lui-même 2-Sur rendez-vous 3-Vu à domicile
4-sur convocation par personne contact 10=Autres
Autres à préciser :………………………………………..………/_/
Q132 : Suites à 2 ans :……………………………..……………/_/_/
1=Simples 2=Epigastralgie 3=Vomissements
4=Diarrhée 5=Amaigrissement 6=Anémie
8-Troisier 9-Décédé 10=Autres 99=Indéterminé
Autres à préciser :……………………………….………………/_/_/
Q133: Fibroscopie faite à 2 ans :……………………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q134 : Résultat :…………………………………………………/_/_/
1- Récidive Tumorale 2- Pas de Récidive 99-Indéterminé
Q135 : TOGD faite à 2 ans :……………………………..……/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
134
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
Q136 : Résultat :…………………………………………………/_/_/
1-Récidive Tumorale 2-Pas de récidive 99-Indéterminé
Q137: Echographie faite à 2ans :………………………………….
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q138: Résultat :……………………………………………………/_/_/
1=Métastases Hépatiques 2=Pas de Métastases Hépatiques
99-Indéterminé
Q139 : ACE :…………………………………………………………/_/_/
1-Elevé 2-Normal 3 -Non fait 4- Bas 99-Indéterminé
Q140 : Mode de suivi à 5ans :…………………………………/_/_/
1-Venu de lui-même 2-Sur rendez-vous 3-Vu à domicile
4-Sur convocation Par personne contact 10=Autres
Autre à préciser :………………………………………………
Q141 : Suites à 5ans :…………………………………..………/_/
1=Simples 2=Epigastralgie 3-Vomissements
4=Diarrhée 5=Amaigrissement 6-Anémie
7-Troisier 8-Décédé 10=Autres 99-Indéterminée
Autres à préciser :…………………………………………….../_/_/
Q142 : Fibroscopie faite à 5ans :………………………………/_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q143 : Résultat :……………………………………………………/_/_/
1- Récidive Tumorale 2- Pas de récidive 99-Indéterminé
Q144: Echographie faite à 5ans :…………………………../_/_/
1-Oui 2-Non 99-Indéterminée
Q145: Résultat :………………………………………….………/_/_/
1=Métastases Hépatiques 2=Pas de Métastases Hépatiques
99-Indéterminé
Q146 : ACE :………………………………………………………/_/_/
1-Elevé 2-Normal 3-Non fait 4- Bas 99-Indéterminé
135
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
SERMENT D’HIPPOCRATE
En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant
l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’être suprême, d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire
au-dessus de mon travail.
Je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.
Admis à l’intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma
langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à
corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de
parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances
médicales contre les lois de l’humanité.
Respectueux et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants
l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.
Je le jure.
136
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
FICHE SIGNALITIQUE
Nom : Sissoko
Prénom : Sékou Madou
Adresse : Sissokosekoumadou@yahoo.fr Tel :(00223)76041167 /69538588
Date et lieu de naissance : 14 Janvier 1986 à Kita
Titre de la thèse : syndrome orificiel dans les cancers gastriques au service de
Chirurgie générale CHU Gabriel Touré
Secteur d’intérêt : Chirurgie
Pays d’origine : Mali Ville : Bamako
Année de soutenance : 2015
Lieu de dépôt : Bibliothèque FMOS.
RESUME :
Le syndrome orificiel survient très fréquemment dans le cancer de l’estomac.
Les objectifs de ce travail étaient d’étudiés les aspects épidémiologiques,
cliniques et thérapeutiques du syndrome orificiel dans les cancers gastriques.
Nous avons colligés 372 cas de syndrome orificiel, représentant 53,3% des
cancers de l’estomac, 29,6% des cancers digestifs et 2,1% des hospitalisations.
Le sexe ratio était de 1,5 ; l’âge moyen a été de 56 ans avec des extrêmes de 27
et 84 ans et un écart-type de 13,3.75(soixante-quinze) patients soit 20,2% ont été
admis en urgences.
Les principaux signes cliniques retrouvés ont été : vomissements, dysphagie
amaigrissement, tumeur palpable, clapotage à jeun, ascite.
192 malades étaient classés OMS grade III (78,5%) ; OMS II 45 cas (12,1%) et
OMS IV 35 cas (9,4%).
Une grande majorité de nos malades 267 (71,8%) avaient une classe ASA
supérieure ou égale à III.
Le siège antro-pylorique a été le plus représenté 335 cas (90,1%).
L’adénocarcinome a été le type histologique le plus fréquent 351(94,4%).
Le taux d’opérabilité a été de 75% (282malades) : 46 malades (16,3%) ont subi
137
Sékou Madou Sissoko
Syndrome orificiel dans les cancers gastriques en chirurgie générale CHU Gabriel Touré.
une résection gastrique ; 184 cas (65,3%) de gastro-entéro-anastomose ; 32 cas
(11,3%) de stomie d’alimentation ; 90 malades (24,2%) n’ont pas été opéré.
La morbidité a été de 25,6% et la mortalité 14,5%.
Le pronostic est très sombre avec une survie à 3 ans de 4, 3%.
Mots clés : cancers, orifices, estomac.
138
Sékou Madou Sissoko
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Bizarre Incident Du Chien Pendant La NuitDocument655 pagesLe Bizarre Incident Du Chien Pendant La Nuitgil86% (14)
- Urgence Pediatrique SenegalDocument120 pagesUrgence Pediatrique SenegalCliff Daniel DIANZOLE MOUNKANAPas encore d'évaluation
- La Ou Il N'y A Pas de DocteurDocument602 pagesLa Ou Il N'y A Pas de Docteurarminius100% (2)
- Livret Plantes Sauvages ComestiblesDocument30 pagesLivret Plantes Sauvages ComestiblesCharlotte GuilbautPas encore d'évaluation
- Syndrome NeurotypiqueDocument2 pagesSyndrome Neurotypiquediogène11310Pas encore d'évaluation
- Le manuel complet sur la scoliose et la chirurgie pour les patients: Un regard impartial en profondeur : qu’attendre avant et pendant l’opération de la scolioseD'EverandLe manuel complet sur la scoliose et la chirurgie pour les patients: Un regard impartial en profondeur : qu’attendre avant et pendant l’opération de la scoliosePas encore d'évaluation
- Les cancers de l'utérus: Une brochure de la Fondation contre le CancerD'EverandLes cancers de l'utérus: Une brochure de la Fondation contre le CancerPas encore d'évaluation
- Les cancers du sein: Une brochure de la Fondation contre le CancerD'EverandLes cancers du sein: Une brochure de la Fondation contre le CancerPas encore d'évaluation
- Epreuve de Préparation de L'examen Final SP3 D'obstétrique Et Gynécologie Fmsb/Uyi Questions À Choix MultiplesDocument19 pagesEpreuve de Préparation de L'examen Final SP3 D'obstétrique Et Gynécologie Fmsb/Uyi Questions À Choix MultiplesayissiPas encore d'évaluation
- 2.la Chambre Implantable Indications Technique de Pose Et Surveillance PDFDocument26 pages2.la Chambre Implantable Indications Technique de Pose Et Surveillance PDFOumayma TarouaPas encore d'évaluation
- 15M252 PDFDocument82 pages15M252 PDFSebzi TraorePas encore d'évaluation
- DU Gynécologie de L'infertilité Et AMPDocument4 pagesDU Gynécologie de L'infertilité Et AMPdjakoune adlenePas encore d'évaluation
- Drepanocytose Chez L'enfantDocument18 pagesDrepanocytose Chez L'enfantLeyla IbrahimPas encore d'évaluation
- Item 287 Et 309 Cancer Du Sein - IKB Gynéco 19Document33 pagesItem 287 Et 309 Cancer Du Sein - IKB Gynéco 19Jomana FullaPas encore d'évaluation
- Chap6 Pharyngite Et AmygdaliteDocument4 pagesChap6 Pharyngite Et AmygdaliteCristina LupascoPas encore d'évaluation
- Avortement HMCDocument41 pagesAvortement HMCWillson Peter Dungu businessPas encore d'évaluation
- 1 - Examen CardiaqueDocument49 pages1 - Examen Cardiaquebelsem djellaliPas encore d'évaluation
- Cas Clinique MédecineDocument4 pagesCas Clinique MédecineMohamed TouatiPas encore d'évaluation
- Profil Epidemiologique Et Evolutif Des Insuffisances Renales Aigues GravidiquesDocument208 pagesProfil Epidemiologique Et Evolutif Des Insuffisances Renales Aigues GravidiquesSana GuedaouraPas encore d'évaluation
- (C1) Place de L'anatomie Pathologique en MédecineDocument50 pages(C1) Place de L'anatomie Pathologique en Médecinewalid htutPas encore d'évaluation
- Cat Devant Un GoitreDocument49 pagesCat Devant Un GoitreFethi SerayaPas encore d'évaluation
- Grosses Bourses PDFDocument47 pagesGrosses Bourses PDFAchref BrsPas encore d'évaluation
- Semiologie FrancaiseDocument70 pagesSemiologie FrancaiseGabriel DominguezPas encore d'évaluation
- Guide Neonatologie Version Du 30.11.20Document324 pagesGuide Neonatologie Version Du 30.11.20olivePas encore d'évaluation
- Prise en Charge Globale Du VIH Guide de Formation ParamedicauxDocument146 pagesPrise en Charge Globale Du VIH Guide de Formation ParamedicauxNJEBARIKANUYE Eugène100% (2)
- Chambre ImplantableDocument7 pagesChambre ImplantableSAIDI Mohammed AlaeddinePas encore d'évaluation
- 98 787Document10 pages98 787hizballah27Pas encore d'évaluation
- Intégrale MEDI G-4060Document249 pagesIntégrale MEDI G-4060Islam ShakhabovPas encore d'évaluation
- La Maladie de EalesDocument9 pagesLa Maladie de EalesChahid LATOUNDJIPas encore d'évaluation
- Anesthesie Peri BulbaireDocument74 pagesAnesthesie Peri BulbairemechackPas encore d'évaluation
- ToxoplasmoseDocument48 pagesToxoplasmosemkdqhp8rwdPas encore d'évaluation
- 6 Cancer Du SeinDocument93 pages6 Cancer Du Seinchristian omgbaPas encore d'évaluation
- Aji NewDocument32 pagesAji NewkhunleangchhunPas encore d'évaluation
- Guide de Stage Fmos 2022 VDDocument43 pagesGuide de Stage Fmos 2022 VDpvfbszf9mtPas encore d'évaluation
- Motifs de Consultation en Gynécologie Au CHU Gabriel Touré: TheseDocument126 pagesMotifs de Consultation en Gynécologie Au CHU Gabriel Touré: Thesefefago7978100% (1)
- 9) CAT Devant Une Ingestion de Caustique.Document3 pages9) CAT Devant Une Ingestion de Caustique.AHMED Dahhouki100% (1)
- Infections Cutanées À Staphylocoques Et Streptocoques - InfectiologieDocument98 pagesInfections Cutanées À Staphylocoques Et Streptocoques - Infectiologiejanvier_89Pas encore d'évaluation
- DesignDocument93 pagesDesignJude EmmanuelPas encore d'évaluation
- La Pyélonéphrite Aigue Chez L'enfant-Blida-2014 PDFDocument17 pagesLa Pyélonéphrite Aigue Chez L'enfant-Blida-2014 PDFHanane KouidriPas encore d'évaluation
- Drepanocytose Et GrossesseDocument14 pagesDrepanocytose Et Grossesseaminouamadououmarou418Pas encore d'évaluation
- Guide Pratique Du ResidentDocument134 pagesGuide Pratique Du ResidentJocelyne OuedraogoPas encore d'évaluation
- Accouchement. Nouvelles Recommandations de La Haute Autorité de SantéDocument47 pagesAccouchement. Nouvelles Recommandations de La Haute Autorité de SantéAnonymous fqa7PO8oPas encore d'évaluation
- Fiii 311Document1 pageFiii 311Marian Ioan-LucianPas encore d'évaluation
- Chirurgie Infantile A Broca Broca Auguste Bpt6k6136746jDocument1 158 pagesChirurgie Infantile A Broca Broca Auguste Bpt6k6136746jAbir Fatiha HassainePas encore d'évaluation
- Cardiologie Pratique: PédiatriqueDocument35 pagesCardiologie Pratique: PédiatriqueJael Wiyi Mundemba100% (1)
- EL15:AFUPDocument66 pagesEL15:AFUPRaly MbayePas encore d'évaluation
- Depistage Cancer Du Sein Janvier 2020Document121 pagesDepistage Cancer Du Sein Janvier 2020Dorra Bouras EP JerjirPas encore d'évaluation
- Hge PDFDocument30 pagesHge PDFjuniorebinda100% (2)
- Examens Cliniques (Hamza Abidi)Document14 pagesExamens Cliniques (Hamza Abidi)chaimaa el amriPas encore d'évaluation
- RPP Urgences obstetricalesSFMU 2022Document33 pagesRPP Urgences obstetricalesSFMU 2022LaryPas encore d'évaluation
- 4eme Annee Carnet de Stage CliniqueDocument26 pages4eme Annee Carnet de Stage Cliniquezouaoui kaoutherPas encore d'évaluation
- Cancer de L'estomac Anatomie PathologiqueDocument9 pagesCancer de L'estomac Anatomie Pathologique12855198686% (7)
- Meno MetrorragiesDocument50 pagesMeno MetrorragiesshobirinPas encore d'évaluation
- Livre Protocoles 2013 (14!06!13)Document745 pagesLivre Protocoles 2013 (14!06!13)ion epurePas encore d'évaluation
- Guide DrepanocytoseDocument23 pagesGuide DrepanocytoseMarevaPas encore d'évaluation
- Cas Cliniques PruritDocument139 pagesCas Cliniques PruritNoella CHATUEPas encore d'évaluation
- 4.15.5 Irradiation Et GrossesseDocument18 pages4.15.5 Irradiation Et Grossessejavi_de_garciaPas encore d'évaluation
- Hémorragie Digestive PDFDocument6 pagesHémorragie Digestive PDFkoPas encore d'évaluation
- Echographie Cervicale en PédiatrieDocument68 pagesEchographie Cervicale en PédiatrieNguyen Tran CanhPas encore d'évaluation
- Anémies Hémolytiques Congénitales (2) - Drépanocytose (DR AHMIDATOU)Document24 pagesAnémies Hémolytiques Congénitales (2) - Drépanocytose (DR AHMIDATOU)Feriel AePas encore d'évaluation
- 3) DiuDocument24 pages3) DiuIsmail MoumenPas encore d'évaluation
- Semio Pediatrie Nourisson BourillonDocument93 pagesSemio Pediatrie Nourisson Bourillonirène matulaPas encore d'évaluation
- Revue HyperacousieDocument32 pagesRevue Hyperacousierodolphe.brugnoliPas encore d'évaluation
- Reins Et Myã© LomeDocument16 pagesReins Et Myã© Lomefara.jbeli24Pas encore d'évaluation
- Guide Ortho PDFDocument89 pagesGuide Ortho PDFIuly ManacPas encore d'évaluation
- Radiottt QEDocument5 pagesRadiottt QEidouPas encore d'évaluation
- Atrophie MultisystématiséeDocument6 pagesAtrophie MultisystématiséeCédric APas encore d'évaluation
- OnyxisDocument3 pagesOnyxisAlberto GeorgePas encore d'évaluation
- Interpretation GazometrieDocument1 pageInterpretation GazometrieAsmae OuissadenPas encore d'évaluation
- Rougeole CATDocument18 pagesRougeole CATAnonymous nzEFPlPvxJPas encore d'évaluation
- PAMME04Document8 pagesPAMME04Mouad DahPas encore d'évaluation
- Tamarindus IndicaDocument1 pageTamarindus IndicaPatrick Eba100% (1)
- Anatomi de La RateDocument61 pagesAnatomi de La Ratehouria100% (1)
- Cancer de L'hypopharynx CorrigéDocument25 pagesCancer de L'hypopharynx CorrigéMAHAMAT ABAKAR SALEHPas encore d'évaluation
- CB Biostats CorrectionDocument5 pagesCB Biostats Correctionfati.28janviPas encore d'évaluation
- Cours 2 Réactions InflammatoiresDocument5 pagesCours 2 Réactions InflammatoiresAmina Feriel KadriPas encore d'évaluation
- MasivetDocument9 pagesMasivetvetideoPas encore d'évaluation
- Validation Analytique de DosagDocument33 pagesValidation Analytique de DosagAnonymous Vqj0OJWQKKPas encore d'évaluation
- Quinine InjectableDocument2 pagesQuinine InjectableChrist LionelPas encore d'évaluation
- Qi Ecn 2022Document123 pagesQi Ecn 2022Bons PlanPas encore d'évaluation
- BELGH1RBI 2éme Année Atteintes Des Tissus Durs de La Dent DDocument12 pagesBELGH1RBI 2éme Année Atteintes Des Tissus Durs de La Dent DChaima RehamniaPas encore d'évaluation
- CHAP7 Affection Du Systeme NerveuxDocument17 pagesCHAP7 Affection Du Systeme Nerveuxoummibagui2024Pas encore d'évaluation
- QCM 20bacteriologieDocument15 pagesQCM 20bacteriologiesôù tililaPas encore d'évaluation
- Les Antalgiques en OdontostomatologieDocument7 pagesLes Antalgiques en OdontostomatologieÝøů Çěf Gherras0% (1)
- 116636-Article Text-323874-1-10-20150506Document8 pages116636-Article Text-323874-1-10-20150506sallsmartPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument20 pagesIntroductionsalma harratiPas encore d'évaluation
- TMS Elements de Cardiologie Description Fonctionnement Défaillance Les Plus Rencontrée en TMSDocument51 pagesTMS Elements de Cardiologie Description Fonctionnement Défaillance Les Plus Rencontrée en TMSBenoît MoreauPas encore d'évaluation
- Guide de L'externe en Service de PsychiatrieDocument16 pagesGuide de L'externe en Service de PsychiatriehounleyieudesPas encore d'évaluation