Books by Nicolas L J Meunier

PUL (Presses Universitaires de Louvain), 2019
Lorsque Quintus Ennius rédige ses Annales, entre 179 et 168 av. J.-C. environ, Rome est en pleine... more Lorsque Quintus Ennius rédige ses Annales, entre 179 et 168 av. J.-C. environ, Rome est en pleine expansion, déjà maîtresse de la Méditerranée occidentale et occupée à prendre le contrôle de la Grèce et de la Macédoine. En revanche, sur le plan littéraire, et historiographique en particulier, elle n’en est qu’à ses balbutiements. Quelques précurseurs (Livius Andronicus et Naevius en particulier) avaient donné aux Romains leurs premières épopées, recourant à l’antique vers saturnien. D’autre part, quelques patriciens découvrant sur le tard, au contact du monde hellénistique, la nécessité de conserver trace de l’histoire de leur cité, avaient livré les premières Annales, écrites en prose et en langue grecque. Ennius, poète ambitieux originaire de Rudies (Italie du Sud), mais bien introduit dans les cénacles de la plus haute aristocratie romaine, décide de donner à l’Vrbs son premier grand chef-d’œuvre de langue latine, une épopée en dix-huit livres retraçant l’histoire de la Ville depuis ses origines jusqu’aux événements les plus récents. Il introduit à cette occasion l’hexamètre dactylique, rencontre un immense succès auprès des Romains, et restera insurpassé jusqu’à la création de l’Énéide de Virgile.
Books (Editor) by Nicolas L J Meunier

Locvm Armarivm Libros propose une approche singulière pour aborder la circulation des livres et l... more Locvm Armarivm Libros propose une approche singulière pour aborder la circulation des livres et le rôle des biblio-thèques durant l'Antiquité gréco-romaine, en croisant les données archéologiques, historiques et philologiques. Par son objet de recherche, ce volume se veut multidisciplinaire et rassemble en effet les contributions de plusieurs spécia-listes et de jeunes chercheurs portant sur des thématiques variées telles que les archives mycéniennes, les biblio-thèques d'Athènes, d'Alexandrie et de Rome, la production de livres en Égypte tardoantique, les littératures grecque et étrusque ou encore la réception des auteurs anciens dans les bibliothèques humanistes. Par conséquent, ce livre ne re-présente pas uniquement une synthèse approfondie mais il constitue aussi un véritable essai critique de reconstruction du monde classique à travers le prisme d'une « civilisation de l'écriture » au sein de laquelle les livres et les bibliothèques pouvaient exprimer une pluralité de significations culturelles, idéologiques et de propagande politique. À défaut de se référer à un modèle interprétatif unique et standardisé, la dimension globale des analyses rassemblées dans cet ouvrage met bien évidence la réalité d'une mare magnum pour une culture commune du livre déclinée dans la diversité des contingences historiques et culturelles de la civilisation méditerranéenne. Le titre du volume illustre bien la complexité fonctionnelle et significative des « biblio-thèques » antiques en déclinant trois aspects fondamen-taux et intrinsèquement liés qui structurent l'ensemble des contributions : des lieux, des espaces (de rangement) et des livres.

Dans le présent volume le lecteur prendra connaissance des contributions présentées à l’occasion ... more Dans le présent volume le lecteur prendra connaissance des contributions présentées à l’occasion d’un colloque international organisé à l’Université catholique de Louvain les 12 et 13 juin 2014 par le Centre d’étude des Mondes Antiques en collaboration avec le Centre d’Histoire des Religions Cardinal Julien Ries et les Actions de Recherche Concertées « A World in Crisis? ». Le thème se focalisait sur la corrélation des notions de « culte » et de « crise », dont les acceptions particulières se trouvent sensiblement modifiées et enrichies par leur mise en rapport. Le concept supérieur ainsi formé peut lui-même être mis en relation avec l’expression anglo-saxonne « Crisis Cults », originellement un des produits de la recherche ethno-anthropologique américaine des années 1970. Les auteurs ont ainsi été invités à réfléchir sur la différence qu’ils pourraient éventuellement identifier, en se basant sur leur propre domaine de spécialisation, entre des cultes subissant une crise (ce que représente l’expression française « cultes en crise ») et des cultes issus d’une crise, autrement dit des cultes qui sont une réponse à une situation de crise (ce que traduit l’expression anglaise « Crisis cults »).
Par son sujet même, ce volume se veut interdisciplinaire et subséquemment transversal aux thématiques abordées. Dans ces pages en effet on est parvenu à rassembler des intervenants provenant des domaines de l’archéologie, de la numismatique, de la philologie, de l’histoire et de la philosophie, autant de spécialistes de sujets aussi variés que le monde minoen, l’Égypte ancienne, les institutions de la Grèce classique, les civilisations anatoliennes, la philosophie platonicienne, la Rome aussi bien républicaine qu’impériale et l’époque tardo-antique.
Finalement, ce livre, non seulement constitue un avancement de la recherche dans différentes disciplines, mais ouvre aussi la voie à une étude phénoménologique et transversale des notions de « crise » et de « culte » et a ainsi posé quelques jalons en vue d’études ultérieures sur un sujet qui est loin d’être épuisé.
Book Chapters by Nicolas L J Meunier
published in Assenmaker P. (ed.), "Tite-Live, une histoire de livres", Namur: Presses universitaires de Namur, 2017

Les premiers temps de Rome: VIe-IIIe s. av. J.-C., La fabrique d'une histoire
Les dettes apparaissent dans l’historiographie romaine comme l’un des problèmes les plus précoces... more Les dettes apparaissent dans l’historiographie romaine comme l’un des problèmes les plus précoces des plébéiens et la demande de leur allégement comme l’une des revendications les plus insistantes de ceux-ci. Une étude globale de l’ensemble des mentions relatives à l’affaire de aere alieno des Ve et IVe siècles av. J.-C. montre que cette dernière a fait l’objet d’une évidente reconstruction narrative. L’objet de cette communication sera d’identifier plus précisément la manière dont le récit historiographique a élaboré la présentation des faits, mais aussi les sources d’inspiration qui furent les siennes. Si la situation de la République finissante est la première hypothèse qui vient à l’esprit, il est impossible de ne pas songer non plus à l’Athènes de Solon et aux schémas narratifs grecs. In fine, une identification plus précise des processus d’élaboration narrative pourra peut-être permettre de discerner plus efficacement la réalité historique sous-jacente à l’affaire dite de aere alieno.

ABSTRACT: The beginning of the fifth century BC was a period of major crisis in the Roman history... more ABSTRACT: The beginning of the fifth century BC was a period of major crisis in the Roman history. To the institutional crisis (the Tarquins were indeed being expelled at the end of the previous century, while the republican system struggled to be implemented), were added a social crisis (the famous struggle of the orders) and another crisis in the relations with neighboring peoples (especially with the Latins, the Romans had to face during the tough battle of Lake Regillus). Interestingly, during the same period was displayed significant religious activity in terms of consecration of temples and establishment of worships. In this paper, I revisit the issue of two new temples consecrated in this time of crisis: that of the Dioscuri on the one hand, that of Ceres, Liber and Libera on the other hand. It appears that these two sanctuaries are much more closely related than tradition admits not only to the recovery of power in Rome and Latium, by the Latins over the Etruscans, but also to the formation of a new Latin league subsequent to this change in the political situation. Thus the erection of a temple to Castor and Pollux, far from celebrating any Roman victory, would rather be a renewed assertion of belonging to the community of the Latins; because at least until 338 BC, the twin gods were most probably assimilated to the Penates Publici, the latter actually and originally being nothing else than the Penates nominis Latini. As for the temple of Ceres, Liber and Libera, it should be understood as a federal sanctuary directly involved in the functioning of the Latin League, the instigator of the foedus Cassianum, Spurius Cassius, also happening to be - and this is not a coincidence - the dedicatee of the sanctuary. Later, the scheme of the struggle of the orders was clearly of use to the Romans for concealing a posteriori the part played by the Latins in the history of this early period, so that the temple of Ceres was assigned a central role in the plebeian activity, a role it clearly did not have originally.
RÉSUMÉ : Le début du Ve siècle av. J.-C. fut à Rome une période de crise importante. À la crise institutionnelle (les Tarquins venaient en effet d’être expulsés à la toute fin du siècle précédent, tandis que le régime républicain peinait à se mettre en place), s’ajoutaient une crise sociale (le célèbre conflit patricio-plébéien) et une crise des relations avec les peuples voisins (en particulier avec les Latins, que les Romains durent affronter lors de la difficile bataille du Lac Régille). Or durant cette même période se déploya une activité religieuse importante en termes de consécration de sanctuaires et d’instauration de cultes. Dans la présente contribution, nous reviendrons sur deux des nouveaux temples qui furent consacrés en cette période de crise : celui des Dioscures d’une part, celui de Cérès, Liber et Libera d’autre part. Il apparaît que ces deux sanctuaires sont bien plus étroitement liés encore que ne l’admet la tradition non seulement à la reprise du pouvoir, à Rome et dans le Latium, des Latins sur les Étrusques, mais aussi à la formation d’une nouvelle Ligue latine consécutivement à ce changement dans la situation politique. Ainsi l’érection d’un temple aux Dioscures, loin de célébrer une quelconque victoire romaine, serait plutôt une affirmation renouvelée de l’appartenance à la communauté des Latins ; car au moins jusqu’en 338 av. J.-C., les dieux jumeaux auraient bien été assimilés aux Penates Publici, ces derniers étant en réalité à l’origine les Penates nominis Latini. Quant au temple de Cérès, Liber et Libera, il serait à comprendre comme un sanctuaire fédéral directement impliqué dans le fonctionnement de la Ligue latine, l’instigateur du foedus Cassianum, Spurius Cassius, se trouvant être aussi – et ce n’est pas un hasard – le dédicataire du sanctuaire. Plus tard, la thématique du conflit patricio-plébéien servit manifestement aux Romains à dissimuler a posteriori la part prise par les Latins dans l’histoire de cette haute époque, ce qui amena à attribuer au temple de Cérès un rôle central dans l’activité plébéienne, un rôle qu’il ne possédait manifestement pas à l’origine.
Papers by Nicolas L J Meunier

Les Études Classiques, 2021
EN - This article reopens the debate on the main cause of the first secession of the plebs – name... more EN - This article reopens the debate on the main cause of the first secession of the plebs – namely the first crisis of the “indebted” (495-493 BC) – and returns to the meaning of the word nexi, proposing to see in those to whom this term was initially applied, not “debt slaves” (the conventional interpretation), but rather clan dependents. In other words, a category of people whose social status can only be understood within the framework of the clans and whose only “debts” were, like those of the hektemores in Athens, the regular dues they had to pay to the patres of their clans in order to be allowed to continue to cultivate the land they were occupying. The interpretation of the first secession is, then, fundamentally modified: the issue thus seems to have been, as suggested by the too often underestimated edict of Servilius, to integrate the clan dependents into the original plebeian core to form a powerful social body holding the privilege of enlisting in the civic army (to the detriment of the gentilicial warbands) which became a major stage in the transition from a clan model to a civic model.
FR - Cet article rouvre le dossier de la principale cause de la première sécession de la plèbe-à savoir la première crise des « endettés » (495-493 av. J.-C.)et revient sur la signification du mot nexi, en proposant de voir en ceux auxquels fut initialement appliqué ce qualificatif, non des « esclaves pour dettes » pour reprendre l'appellation usuelle, mais plutôt des dépendants gentilices. Autrement dit une catégorie de personnes dont on ne peut comprendre le statut social que dans le cadre des clans et dont les seules « dettes » furent, à l'instar de celles des hektémores à Athènes, les redevances régulières qu'ils devaient verser aux patres de leurs clans afin de pouvoir continuer à cultiver les terres qu'ils occupaient. L'interprétation de la première sécession s'en trouve dès lors fondamentalement modifiée : l'enjeu paraît ainsi avoir été, comme le suggère l'édit de Servilius trop souvent sous-estimé, d'intégrer les dépendants gentilices au noyau plébéien originel pour former un corps social puissant détenteur du privilège de s'enrôler dans l'armée civique (au détriment des milices gentilices). Une étape majeure dans la transition d'un modèle clanique vers un modèle civique.

MEFRA 131-1, 2019
Marcus Manlius Capitolinus between Rome and Latium: questions of identity definition and narrativ... more Marcus Manlius Capitolinus between Rome and Latium: questions of identity definition and narrative distortion. The sedition of
Marcus Manlius Capitolinus in 385 BC has already been the subject of many studies, most of them related to the intervention
of this character in the social conflict relating to the debt of the plebeians. The present contribution has been devoted
to the study of the global context in which the sedition took place. In doing so, I highlighted the fact that this sedition, far to
be limited to a stereotypical episode of the struggle of the orders, could be understood in the context of the first “civil” wars
within the Latin League. The event would thus illustrate the interconnection of Roman and Latin societies and the complex
issue of the Roman identity, via the example of the clan of the Manlii, whose network stretched out far beyond Rome and
whose heart was even originally located in the Tusculum area. The episode of Capitolinus’ seditio as it is told, undeniable
result of a narrative reconstruction, would actually reflect the defectio of a significant part of the gens Manlia, for the defense
of their interests in Latium as well as of their power of influence in Rome.
En numismatique, la question des débuts du système monétaire à Rome constitue l’un des sujets les... more En numismatique, la question des débuts du système monétaire à Rome constitue l’un des sujets les plus polémiques. Les numismates se retrouvent devant une situation complexe, caractérisée par plusieurs types de « médias monétaires » différents, tandis que les sources écrites sont tardives, peu prolixes et nous livrent des informations confuses. Cette conférence a eu pour objectif d’une part de revenir sur les différentes hypothèses modernes de reconstruction des origines du système monétaire romain, d’autre part de replacer le développement de ce système dans son contexte géopolitique, en prenant garde à ne plus sous-estimer les événements majeurs du dernier tiers du IVe s. avant notre ère (abolition de la Ligue latine et intégration de la Campanie dans le système civique, politique et militaire romain).

This paper approaches the question of the federal army of the Latin League in the time of the Ear... more This paper approaches the question of the federal army of the Latin League in the time of the Early Republic of Rome. The argument is divided into two parts. The first one reviews the various clues that prompt to see in the original tribunes (that is to say the tribunes prior to 367 BCE) the commanders of the federal army in question. The paper will more particularly be concerned with the different evaluations of the size of the so-called “Roman” archaic army, which end in too important figures so that they can refer to the army of Rome alone. Will also be considered some interesting connections between the first secession of the plebs (at the end of which the tribunes were established), the foedus Cassianum (the conclusion of which coincides with the end of the secession of the plebs) and the feriae Latinae (to which one more day was added precisely to celebrate the return of harmony between patricians and plebeians after the secession). Having reconsidered these various clues, this paper will leave in search of the tracks of the Latin federal army with the objective to put them into perspective. On the basis of several quantified data transmitted under reshaped forms by the historiographical tradition, the second part of the argumentation will focus then on the likely structure of the federal army, which would have consisted of ten contingents of 800 men, every contingent being itself divided into two smaller units of 400 men.

RPh (Revue de Philologie, de littérature et d'histoire anciennes)
EN: This paper aims to reconsider one of the longest fragments preserved from Ennius’ Annales, na... more EN: This paper aims to reconsider one of the longest fragments preserved from Ennius’ Annales, namely the famous passage where Romulus and Remus take the auspices presiding over the founding of Rome. Two problems will more particularly be addressed. The first one is about the mention sol albus (v. 84): a certain amount of arguments – be it lexicological (the opposition in Ennius between the words albus and candidus, as well as their relation with Greek λευκός), stylistical (the metaphor of the circus games and the transition of the celestial bodies as suggestive patterns for “era change”) or historical ones (the conditions for auspice-taking by night) – prompt us to go back to the initial hypothesis identifying sol albus with the moon. The second problem addressed concerns the phrase radiis icta lux that can be read in the following line. If the global significance of the passage can be easily understood (bright appearance of the light at dawn), nevertheless we are at least puzzled by Ennius’ lexical and grammatical choices. This article argues that a comparison with ancient theories of vision (and more specifically with its Pythagorean variant, known as “extramissionist”) sheds new light on the fragment and allows us to improve its translation.
FR: Cet article se propose de revenir sur l’un des plus longs et des plus célèbres fragments que nous ayons conservés des Annales d’Ennius : la prise d’auspices de Romulus et Rémus citée par Cicéron dans son De diuinatione. Deux problèmes seront plus particulièrement abordés. Le premier concerne la mention du sol albus au vers 84 : un certain nombre d’arguments – qu’ils soient d’ordre lexicologique (l’opposition chez Ennius des mots albus et candidus ainsi que leur rapport avec le grec λευκός), stylistique (la métaphore des jeux du cirque et la transition des astres comme schémas suggestifs du « changement d’ère ») ou historique (les conditions de la prise d’auspices nocturnes) – nous poussent à revenir à l’interprétation initiale du sol albus comme astre lunaire. Le second problème abordé est relatif au syntagme radiis icta lux que l’on retrouve au vers suivant. Si la signification globale du passage se comprend aisément (apparition éclatante et radieuse de la lumière à l’aube), en revanche les choix lexicaux et grammaticaux opérés par Ennius laissent pour le moins perplexe. Or une étude des théories anciennes de la vision (et notamment de sa variante pythagoricienne dite « extramissionniste ») permet de résoudre le problème et de proposer une meilleure traduction.
Res Antiquae (RANT), 2013
This paper deals with the narrative construction of the agrarian laws in the Early Roman Republic... more This paper deals with the narrative construction of the agrarian laws in the Early Roman Republic (5th-4th centuries BC). According to Livy and Dionysius of Halicarnassus, the legislative corpus comprises 38 laws, but only five of them have been well studied by modern scholarship, for a simple and understandable reason: they are the only ones on which we can find more extensive information. Nevertheless, the study of the whole corpus makes it possible to distinguish two levels of narrative hierarchy in the traditional account. The first one (called “primary framework”) consists of five episodes, which serve as a basis for the historical reconstruction. The other (called “secondary framework”) is made up of six occasional literary patterns, which present each of the agrarian laws in a well defined way.

Les Études Classiques (LEC), 2011
This paper gives a whole new insight into the tribunate of the plebs before the Licinian Sextian ... more This paper gives a whole new insight into the tribunate of the plebs before the Licinian Sextian reform (367-366 BC).
According to the tradition transmitted by the narratives of Livy and Dionysius of Halicarnassus, Rome was, in the 5th and 4th centuries BC, a young Republic, the main characteristic of which was to be the duality of its society. Moreover, this social dualism patriciate/plebs would have been coupled with an institutional dualism consuls/tribunes of the plebs. Now recent studies (in particular those of T.P. Wiseman) tend to show that the consulate would definitively have been established only during the licinian-sextian reforms (367 BC). Under these conditions, the traditional representation of the tribunate makes no sense anymore. The present study aims at redefining the identity of the original tribunes, which in all probability would have been military leaders until consuls were definitely created. The various arguments tackled are the famous testimony of Varro (LL, 5, 81), the cases of opposition to the dilectus (military recruitment), the second secession of the plebs, the progressive increase of the tribunes number in a political and military perspective and, the last but not the least, a fundamental testimony of Dionysius of Halicarnassus (X, 43 and 45), which has often been forgotten.
Si l’on en croit la tradition que nous ont transmise les récits de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse, Rome était, aux Ve et IVe siècles av. J.-C., une jeune république, dont la caractéristique principale se trouvait être la dualité de sa société. Ce dualisme social patriciat/plèbe se serait en outre doublé d’un dualisme institutionnel consuls/tribuns de la plèbe. Or de récentes études (notamment celles de T. P. Wiseman) tendent à montrer que le consulat n’aurait été définitivement instauré que lors des réformes licinio-sextiennes (367 av. J.-C.). Dans ces conditions, la représentation traditionnelle du tribunat perd tout son sens. La présente étude vise à redéfinir l’identité du tribunat originel, qui selon toute probabilité, aurait été une magistrature militaire jusqu’à la date de création définitive du consulat. Les différents arguments abordés sont le célèbre témoignage de Varron (LL, 5, 81), les cas d’opposition au dilectus (recrutement militaire), la deuxième sécession de la plèbe, la remise en perspective de l’augmentation progressive du nombre de tribuns dans son contexte politique et militaire et surtout un témoignage fondamental et oublié de Denys d’Halicarnasse (X, 43 et 45).
"This article is a critical analysis of the livian account, a prerequisite to any use of it in th... more "This article is a critical analysis of the livian account, a prerequisite to any use of it in the context of historical inquiry. The approach implemented in this paper is twofold. The first applies the principles of the criticism of "accuracy" in order to review the elements influencing the historicity of the Livy's narrative (special attention is given to the reserves of the Paduan historian himself on this matter). The second step is the criticism of "sincerity", which aims to highlight the peculiarities of Livy's view of history (diverse notions are so considered: exemplarity, anachronism, literary reconstruction of characters and narrative cycles, as well as the use of speech and portraits)."
Conference announcements by Nicolas L J Meunier

L'Italie centrale antique à l’époque dite « préromaine » (jusqu’au IIIe s. av. J.-C. inclus) se p... more L'Italie centrale antique à l’époque dite « préromaine » (jusqu’au IIIe s. av. J.-C. inclus) se présente comme un tableau particulièrement riche. Or il est très difficile de tracer des frontières nettes entre ces communautés, tout autant que d’en définir les caractéristiques identitaires. En adoptant une approche résolument multidisciplinaire (philologique, historique, archéologique, anthropologique…), cet atelier vise à questionner les rapports entre les différentes méthodologies (dont les divergences ne sont pas sans contribuer au caractère très discuté de la problématique de l’identité ethnique des peuples italiques). L’objectif en est d'évaluer l'applicabilité du concept d'identité ethnique dans le contexte de l'Italie péninsulaire archaïque jusqu’à la guerre d’Hannibal (IIIe s. av. J.-C.), et d’aboutir à une compréhension plus fine et nuancée de cette problématique, en cherchant une voie qui évite les deux extrêmes que sont d’une part la surestimation du sentiment identitaire, voire la création d'identités fictives par la réification de la diversité, d’autre part le risque d'aplatir sur un gradient unique des identités perçues comme discontinues dans l'Antiquité.

Journée d’étude DETTE & CONSTITUTION
organisée par le séminaire « Constitutions mixtes » (Stavrou... more Journée d’étude DETTE & CONSTITUTION
organisée par le séminaire « Constitutions mixtes » (Stavroula Kefallonitis, HiSoMA C3), en collaboration avec le programme « Républicanisme et économie politique » (Michel Bellet, Nicolas Eyguésier, Philippe Solal, GATE L-SE).
Mercredi 12 décembre 2018
Université Jean Monnet – Campus Tréfilerie – Bât. G – Salle du conseil G05
33, rue du Onze novembre – 42023 Saint-Étienne
http://syn.hypotheses.org
8h30-9h00 Accueil
9h00-9h15 INTRODUCTION
Stavroula Kefallonitis (UJM Saint-Étienne, HiSoMA), « En guise d’introduction – La dette comme ressort historiographique »
9h15-10h20 SESSION 1 – DETTES ET COMMUNAUTÉS
9h15 Marie Durnerin (ENS Lyon, HiSoMA), « Les dettes des chefs dans le paiement de la solde aux mercenaires de l’Anabase de Xénophon : facteur de la constitution ou de la décomposition de la communauté des Dix Mille ? »
9h45 Louise Fauchier (Université Lyon 2, HiSoMA), « Kapèloi et vente à crédit dans l’Athènes classique »
10h25-10h40 Pause
10h40-12h30 SESSION 2 – DETTES ET CORPS POLITIQUES
10h40 Nicolas MEUNIER (Université Saint-Louis Bruxelles, CRHIDI ; Université catholique de Louvain, CEMA), « "Dettes" et formes de dépendances dans la Rome alto-républicaine : pouvoir et société entre le clan et la cité »
11h20 Marie-Rose GUELFUCCI (Université de Franche-Comté, ISTA), « Dette et "signes extérieurs de richesse" : l’importance de la perception dans les affrontements politiques d’un corps social (IVe-IIe s. a.C.) »
11h50 Virginie HOLLARD (Université Lyon 2, HiSoMA), « Argent, morale et politique à Rome à la fin de la République. Étude du corpus cicéronien »
12h20-14h00 Pause
14h00-15h00 SESSION 3 – DETTES ET RÉGIMES POLITIQUES
14h00 Pierre PONCHON (PHIER Université Clermont Auvergne), « Dettes et changements constitutionnels chez Platon »
14h30 Emmanuèle CAIRE (Aix-Marseille Université, CPAF-TDMAM), « Dette et constitution chez Aristote »
15h00-15h20 Pause
15h20-16h40 SESSION 4 – DETTE ET LIBERTÉ
15h20 Nicolas EYGUÉSIER (Université Lille 1, GATE L-SE)
« Dettes et constitutions mixtes chez Sismondi »
16h00 Catherine PSILAKIS (Université Lyon 1, STL)
« Une nouvelle seisachtheia, solution à la dette grecque ? Appropriations d’une mesure solonienne au XXIe siècle »
16h40-17h00 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’opera di Tito Livio è fondamentale per qualsiasi studio di storia romana sull’epoca regia e rep... more L’opera di Tito Livio è fondamentale per qualsiasi studio di storia romana sull’epoca regia e repubblicana. Ma, più che un resoconto storico, essa è anche un’opera letteraria a pieno titolo.
In occasione del bimillenario della morte di Tito Livio, questa giornata di studio ha come scopo di contribuire a questo rinnovamento degli studi liviani invitando alla discussione sull’opera del Padano in questa doppia prospettiva, storica e letteraria.
Sul piano tematico, la prima decade – che copre il periodo della Roma arcaica, epoca regia e alto-repubblicana – sarà privilegiata, perché è
probabilmente lì che si pone nel modo più pertinente la questione della necessaria combinazione degli approcci, ed è anche lì che si trovano le più importanti questioni da rimettere in discussione e le tendenze al rinnovo le più pronunciate.
Le comunicazioni si articoleranno intorno tre assi: la questione dei rapporti tra Tito Livio e gli altri testimoni della Roma arcaica; l’identificazione dei principi di costruzione narrative ed ideologiche;
lo studio del contesto latino ed italico di fronte al romano-centrismo liviano.
Panel at the 9th Celtic Conference in Classics (Dublin, 22-24 June 2016)
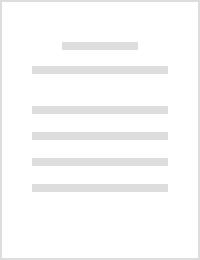
Conference organised by Marco Cavalieri et alii
The term crisis stems from the Greek word which,... more Conference organised by Marco Cavalieri et alii
The term crisis stems from the Greek word which, among others, means ‘to distinguish, to separate’ and hence in a related sense means ‘to decide’. Seen from this angle, a crisis can be perceived as a time of decision or as the moment when a decision is needed. A critical situation is hence also a decisive moment. The history of crises suggests that this substantive is used with a variety of adjectives: political crisis, economic, social, environmental, ideological….A crisis is rarely simple and is often characterized by a conjunction of different components, involving different domains. In the frame of this conference, we aim to explore the problem of crisis in relation to the religious sphere taken in its widest sense. Our aim is not only to investigate the meaning of a crisis as such but also from what moment onwards one can talk about a crisis. A crisis is essentially defined by its consequences or even more by its responses or the absence of the latter. The characterization of its causes (punctual, recurrent; external; internal) likewise opens a vast area for assessment.
More in particular, we want to examine a religious crisis, which is already a very large field of investigation since it implies all kinds of religions, in the traditional sense, as philosophies and systems of representation. In this frame, we are interested in the link between crisis situations and the religious world: does a crisis favour the emergence, development or modification of religious practices or philosophical systems? And inversely, can the creation, development or transformation of practices or beliefs cause a crisis that is evident in other domains? Attempts to answer this question will be given by specialists of the world of Minoan and Mycenaean palace societies of the 2nd millennium BC and of the world of the Mediterranean cities (Greek and Roman) (8th c. BC to 5th c. AD) who will exchange their views especially where the problem and the methodology are concerned. By using specific case studies, special attention will not only be given to historiography, but also to epistemological questions. The papers will also deal with the birth and development of religions in periods of crisis and will attempt to clarify some points e.g. to what degree the appearance of a cult in a particular context an answer or a reaction is to a prior situation? What are the responses and reactions to such appearances? How did the actors deal with difficult situations? Are the causes of a crisis cults usually punctual or can we identify a recurrent pattern? These are the themes this conference wants to explore.
Book Reviews by Nicolas L J Meunier
THE BUDÉ APPIAN VOL. 12. (M.) Étienne-Duplessis (ed., trans.)Appien: Histoire Romaine. Tome XII, ... more THE BUDÉ APPIAN VOL. 12. (M.) Étienne-Duplessis (ed., trans.)Appien: Histoire Romaine. Tome XII, Livre XVII: Guerres Civiles, Livre V. (Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé 498.) Pp. ccxxxv + 199.Paris:Les Belles Lettres,2013. Paper, €83. ISBN:978-2-251-00583-6.











Uploads
Books by Nicolas L J Meunier
Books (Editor) by Nicolas L J Meunier
Par son sujet même, ce volume se veut interdisciplinaire et subséquemment transversal aux thématiques abordées. Dans ces pages en effet on est parvenu à rassembler des intervenants provenant des domaines de l’archéologie, de la numismatique, de la philologie, de l’histoire et de la philosophie, autant de spécialistes de sujets aussi variés que le monde minoen, l’Égypte ancienne, les institutions de la Grèce classique, les civilisations anatoliennes, la philosophie platonicienne, la Rome aussi bien républicaine qu’impériale et l’époque tardo-antique.
Finalement, ce livre, non seulement constitue un avancement de la recherche dans différentes disciplines, mais ouvre aussi la voie à une étude phénoménologique et transversale des notions de « crise » et de « culte » et a ainsi posé quelques jalons en vue d’études ultérieures sur un sujet qui est loin d’être épuisé.
Book Chapters by Nicolas L J Meunier
RÉSUMÉ : Le début du Ve siècle av. J.-C. fut à Rome une période de crise importante. À la crise institutionnelle (les Tarquins venaient en effet d’être expulsés à la toute fin du siècle précédent, tandis que le régime républicain peinait à se mettre en place), s’ajoutaient une crise sociale (le célèbre conflit patricio-plébéien) et une crise des relations avec les peuples voisins (en particulier avec les Latins, que les Romains durent affronter lors de la difficile bataille du Lac Régille). Or durant cette même période se déploya une activité religieuse importante en termes de consécration de sanctuaires et d’instauration de cultes. Dans la présente contribution, nous reviendrons sur deux des nouveaux temples qui furent consacrés en cette période de crise : celui des Dioscures d’une part, celui de Cérès, Liber et Libera d’autre part. Il apparaît que ces deux sanctuaires sont bien plus étroitement liés encore que ne l’admet la tradition non seulement à la reprise du pouvoir, à Rome et dans le Latium, des Latins sur les Étrusques, mais aussi à la formation d’une nouvelle Ligue latine consécutivement à ce changement dans la situation politique. Ainsi l’érection d’un temple aux Dioscures, loin de célébrer une quelconque victoire romaine, serait plutôt une affirmation renouvelée de l’appartenance à la communauté des Latins ; car au moins jusqu’en 338 av. J.-C., les dieux jumeaux auraient bien été assimilés aux Penates Publici, ces derniers étant en réalité à l’origine les Penates nominis Latini. Quant au temple de Cérès, Liber et Libera, il serait à comprendre comme un sanctuaire fédéral directement impliqué dans le fonctionnement de la Ligue latine, l’instigateur du foedus Cassianum, Spurius Cassius, se trouvant être aussi – et ce n’est pas un hasard – le dédicataire du sanctuaire. Plus tard, la thématique du conflit patricio-plébéien servit manifestement aux Romains à dissimuler a posteriori la part prise par les Latins dans l’histoire de cette haute époque, ce qui amena à attribuer au temple de Cérès un rôle central dans l’activité plébéienne, un rôle qu’il ne possédait manifestement pas à l’origine.
Papers by Nicolas L J Meunier
FR - Cet article rouvre le dossier de la principale cause de la première sécession de la plèbe-à savoir la première crise des « endettés » (495-493 av. J.-C.)et revient sur la signification du mot nexi, en proposant de voir en ceux auxquels fut initialement appliqué ce qualificatif, non des « esclaves pour dettes » pour reprendre l'appellation usuelle, mais plutôt des dépendants gentilices. Autrement dit une catégorie de personnes dont on ne peut comprendre le statut social que dans le cadre des clans et dont les seules « dettes » furent, à l'instar de celles des hektémores à Athènes, les redevances régulières qu'ils devaient verser aux patres de leurs clans afin de pouvoir continuer à cultiver les terres qu'ils occupaient. L'interprétation de la première sécession s'en trouve dès lors fondamentalement modifiée : l'enjeu paraît ainsi avoir été, comme le suggère l'édit de Servilius trop souvent sous-estimé, d'intégrer les dépendants gentilices au noyau plébéien originel pour former un corps social puissant détenteur du privilège de s'enrôler dans l'armée civique (au détriment des milices gentilices). Une étape majeure dans la transition d'un modèle clanique vers un modèle civique.
Marcus Manlius Capitolinus in 385 BC has already been the subject of many studies, most of them related to the intervention
of this character in the social conflict relating to the debt of the plebeians. The present contribution has been devoted
to the study of the global context in which the sedition took place. In doing so, I highlighted the fact that this sedition, far to
be limited to a stereotypical episode of the struggle of the orders, could be understood in the context of the first “civil” wars
within the Latin League. The event would thus illustrate the interconnection of Roman and Latin societies and the complex
issue of the Roman identity, via the example of the clan of the Manlii, whose network stretched out far beyond Rome and
whose heart was even originally located in the Tusculum area. The episode of Capitolinus’ seditio as it is told, undeniable
result of a narrative reconstruction, would actually reflect the defectio of a significant part of the gens Manlia, for the defense
of their interests in Latium as well as of their power of influence in Rome.
FR: Cet article se propose de revenir sur l’un des plus longs et des plus célèbres fragments que nous ayons conservés des Annales d’Ennius : la prise d’auspices de Romulus et Rémus citée par Cicéron dans son De diuinatione. Deux problèmes seront plus particulièrement abordés. Le premier concerne la mention du sol albus au vers 84 : un certain nombre d’arguments – qu’ils soient d’ordre lexicologique (l’opposition chez Ennius des mots albus et candidus ainsi que leur rapport avec le grec λευκός), stylistique (la métaphore des jeux du cirque et la transition des astres comme schémas suggestifs du « changement d’ère ») ou historique (les conditions de la prise d’auspices nocturnes) – nous poussent à revenir à l’interprétation initiale du sol albus comme astre lunaire. Le second problème abordé est relatif au syntagme radiis icta lux que l’on retrouve au vers suivant. Si la signification globale du passage se comprend aisément (apparition éclatante et radieuse de la lumière à l’aube), en revanche les choix lexicaux et grammaticaux opérés par Ennius laissent pour le moins perplexe. Or une étude des théories anciennes de la vision (et notamment de sa variante pythagoricienne dite « extramissionniste ») permet de résoudre le problème et de proposer une meilleure traduction.
According to the tradition transmitted by the narratives of Livy and Dionysius of Halicarnassus, Rome was, in the 5th and 4th centuries BC, a young Republic, the main characteristic of which was to be the duality of its society. Moreover, this social dualism patriciate/plebs would have been coupled with an institutional dualism consuls/tribunes of the plebs. Now recent studies (in particular those of T.P. Wiseman) tend to show that the consulate would definitively have been established only during the licinian-sextian reforms (367 BC). Under these conditions, the traditional representation of the tribunate makes no sense anymore. The present study aims at redefining the identity of the original tribunes, which in all probability would have been military leaders until consuls were definitely created. The various arguments tackled are the famous testimony of Varro (LL, 5, 81), the cases of opposition to the dilectus (military recruitment), the second secession of the plebs, the progressive increase of the tribunes number in a political and military perspective and, the last but not the least, a fundamental testimony of Dionysius of Halicarnassus (X, 43 and 45), which has often been forgotten.
Si l’on en croit la tradition que nous ont transmise les récits de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse, Rome était, aux Ve et IVe siècles av. J.-C., une jeune république, dont la caractéristique principale se trouvait être la dualité de sa société. Ce dualisme social patriciat/plèbe se serait en outre doublé d’un dualisme institutionnel consuls/tribuns de la plèbe. Or de récentes études (notamment celles de T. P. Wiseman) tendent à montrer que le consulat n’aurait été définitivement instauré que lors des réformes licinio-sextiennes (367 av. J.-C.). Dans ces conditions, la représentation traditionnelle du tribunat perd tout son sens. La présente étude vise à redéfinir l’identité du tribunat originel, qui selon toute probabilité, aurait été une magistrature militaire jusqu’à la date de création définitive du consulat. Les différents arguments abordés sont le célèbre témoignage de Varron (LL, 5, 81), les cas d’opposition au dilectus (recrutement militaire), la deuxième sécession de la plèbe, la remise en perspective de l’augmentation progressive du nombre de tribuns dans son contexte politique et militaire et surtout un témoignage fondamental et oublié de Denys d’Halicarnasse (X, 43 et 45).
Conference announcements by Nicolas L J Meunier
organisée par le séminaire « Constitutions mixtes » (Stavroula Kefallonitis, HiSoMA C3), en collaboration avec le programme « Républicanisme et économie politique » (Michel Bellet, Nicolas Eyguésier, Philippe Solal, GATE L-SE).
Mercredi 12 décembre 2018
Université Jean Monnet – Campus Tréfilerie – Bât. G – Salle du conseil G05
33, rue du Onze novembre – 42023 Saint-Étienne
http://syn.hypotheses.org
8h30-9h00 Accueil
9h00-9h15 INTRODUCTION
Stavroula Kefallonitis (UJM Saint-Étienne, HiSoMA), « En guise d’introduction – La dette comme ressort historiographique »
9h15-10h20 SESSION 1 – DETTES ET COMMUNAUTÉS
9h15 Marie Durnerin (ENS Lyon, HiSoMA), « Les dettes des chefs dans le paiement de la solde aux mercenaires de l’Anabase de Xénophon : facteur de la constitution ou de la décomposition de la communauté des Dix Mille ? »
9h45 Louise Fauchier (Université Lyon 2, HiSoMA), « Kapèloi et vente à crédit dans l’Athènes classique »
10h25-10h40 Pause
10h40-12h30 SESSION 2 – DETTES ET CORPS POLITIQUES
10h40 Nicolas MEUNIER (Université Saint-Louis Bruxelles, CRHIDI ; Université catholique de Louvain, CEMA), « "Dettes" et formes de dépendances dans la Rome alto-républicaine : pouvoir et société entre le clan et la cité »
11h20 Marie-Rose GUELFUCCI (Université de Franche-Comté, ISTA), « Dette et "signes extérieurs de richesse" : l’importance de la perception dans les affrontements politiques d’un corps social (IVe-IIe s. a.C.) »
11h50 Virginie HOLLARD (Université Lyon 2, HiSoMA), « Argent, morale et politique à Rome à la fin de la République. Étude du corpus cicéronien »
12h20-14h00 Pause
14h00-15h00 SESSION 3 – DETTES ET RÉGIMES POLITIQUES
14h00 Pierre PONCHON (PHIER Université Clermont Auvergne), « Dettes et changements constitutionnels chez Platon »
14h30 Emmanuèle CAIRE (Aix-Marseille Université, CPAF-TDMAM), « Dette et constitution chez Aristote »
15h00-15h20 Pause
15h20-16h40 SESSION 4 – DETTE ET LIBERTÉ
15h20 Nicolas EYGUÉSIER (Université Lille 1, GATE L-SE)
« Dettes et constitutions mixtes chez Sismondi »
16h00 Catherine PSILAKIS (Université Lyon 1, STL)
« Une nouvelle seisachtheia, solution à la dette grecque ? Appropriations d’une mesure solonienne au XXIe siècle »
16h40-17h00 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
In occasione del bimillenario della morte di Tito Livio, questa giornata di studio ha come scopo di contribuire a questo rinnovamento degli studi liviani invitando alla discussione sull’opera del Padano in questa doppia prospettiva, storica e letteraria.
Sul piano tematico, la prima decade – che copre il periodo della Roma arcaica, epoca regia e alto-repubblicana – sarà privilegiata, perché è
probabilmente lì che si pone nel modo più pertinente la questione della necessaria combinazione degli approcci, ed è anche lì che si trovano le più importanti questioni da rimettere in discussione e le tendenze al rinnovo le più pronunciate.
Le comunicazioni si articoleranno intorno tre assi: la questione dei rapporti tra Tito Livio e gli altri testimoni della Roma arcaica; l’identificazione dei principi di costruzione narrative ed ideologiche;
lo studio del contesto latino ed italico di fronte al romano-centrismo liviano.
The term crisis stems from the Greek word which, among others, means ‘to distinguish, to separate’ and hence in a related sense means ‘to decide’. Seen from this angle, a crisis can be perceived as a time of decision or as the moment when a decision is needed. A critical situation is hence also a decisive moment. The history of crises suggests that this substantive is used with a variety of adjectives: political crisis, economic, social, environmental, ideological….A crisis is rarely simple and is often characterized by a conjunction of different components, involving different domains. In the frame of this conference, we aim to explore the problem of crisis in relation to the religious sphere taken in its widest sense. Our aim is not only to investigate the meaning of a crisis as such but also from what moment onwards one can talk about a crisis. A crisis is essentially defined by its consequences or even more by its responses or the absence of the latter. The characterization of its causes (punctual, recurrent; external; internal) likewise opens a vast area for assessment.
More in particular, we want to examine a religious crisis, which is already a very large field of investigation since it implies all kinds of religions, in the traditional sense, as philosophies and systems of representation. In this frame, we are interested in the link between crisis situations and the religious world: does a crisis favour the emergence, development or modification of religious practices or philosophical systems? And inversely, can the creation, development or transformation of practices or beliefs cause a crisis that is evident in other domains? Attempts to answer this question will be given by specialists of the world of Minoan and Mycenaean palace societies of the 2nd millennium BC and of the world of the Mediterranean cities (Greek and Roman) (8th c. BC to 5th c. AD) who will exchange their views especially where the problem and the methodology are concerned. By using specific case studies, special attention will not only be given to historiography, but also to epistemological questions. The papers will also deal with the birth and development of religions in periods of crisis and will attempt to clarify some points e.g. to what degree the appearance of a cult in a particular context an answer or a reaction is to a prior situation? What are the responses and reactions to such appearances? How did the actors deal with difficult situations? Are the causes of a crisis cults usually punctual or can we identify a recurrent pattern? These are the themes this conference wants to explore.
Book Reviews by Nicolas L J Meunier
Par son sujet même, ce volume se veut interdisciplinaire et subséquemment transversal aux thématiques abordées. Dans ces pages en effet on est parvenu à rassembler des intervenants provenant des domaines de l’archéologie, de la numismatique, de la philologie, de l’histoire et de la philosophie, autant de spécialistes de sujets aussi variés que le monde minoen, l’Égypte ancienne, les institutions de la Grèce classique, les civilisations anatoliennes, la philosophie platonicienne, la Rome aussi bien républicaine qu’impériale et l’époque tardo-antique.
Finalement, ce livre, non seulement constitue un avancement de la recherche dans différentes disciplines, mais ouvre aussi la voie à une étude phénoménologique et transversale des notions de « crise » et de « culte » et a ainsi posé quelques jalons en vue d’études ultérieures sur un sujet qui est loin d’être épuisé.
RÉSUMÉ : Le début du Ve siècle av. J.-C. fut à Rome une période de crise importante. À la crise institutionnelle (les Tarquins venaient en effet d’être expulsés à la toute fin du siècle précédent, tandis que le régime républicain peinait à se mettre en place), s’ajoutaient une crise sociale (le célèbre conflit patricio-plébéien) et une crise des relations avec les peuples voisins (en particulier avec les Latins, que les Romains durent affronter lors de la difficile bataille du Lac Régille). Or durant cette même période se déploya une activité religieuse importante en termes de consécration de sanctuaires et d’instauration de cultes. Dans la présente contribution, nous reviendrons sur deux des nouveaux temples qui furent consacrés en cette période de crise : celui des Dioscures d’une part, celui de Cérès, Liber et Libera d’autre part. Il apparaît que ces deux sanctuaires sont bien plus étroitement liés encore que ne l’admet la tradition non seulement à la reprise du pouvoir, à Rome et dans le Latium, des Latins sur les Étrusques, mais aussi à la formation d’une nouvelle Ligue latine consécutivement à ce changement dans la situation politique. Ainsi l’érection d’un temple aux Dioscures, loin de célébrer une quelconque victoire romaine, serait plutôt une affirmation renouvelée de l’appartenance à la communauté des Latins ; car au moins jusqu’en 338 av. J.-C., les dieux jumeaux auraient bien été assimilés aux Penates Publici, ces derniers étant en réalité à l’origine les Penates nominis Latini. Quant au temple de Cérès, Liber et Libera, il serait à comprendre comme un sanctuaire fédéral directement impliqué dans le fonctionnement de la Ligue latine, l’instigateur du foedus Cassianum, Spurius Cassius, se trouvant être aussi – et ce n’est pas un hasard – le dédicataire du sanctuaire. Plus tard, la thématique du conflit patricio-plébéien servit manifestement aux Romains à dissimuler a posteriori la part prise par les Latins dans l’histoire de cette haute époque, ce qui amena à attribuer au temple de Cérès un rôle central dans l’activité plébéienne, un rôle qu’il ne possédait manifestement pas à l’origine.
FR - Cet article rouvre le dossier de la principale cause de la première sécession de la plèbe-à savoir la première crise des « endettés » (495-493 av. J.-C.)et revient sur la signification du mot nexi, en proposant de voir en ceux auxquels fut initialement appliqué ce qualificatif, non des « esclaves pour dettes » pour reprendre l'appellation usuelle, mais plutôt des dépendants gentilices. Autrement dit une catégorie de personnes dont on ne peut comprendre le statut social que dans le cadre des clans et dont les seules « dettes » furent, à l'instar de celles des hektémores à Athènes, les redevances régulières qu'ils devaient verser aux patres de leurs clans afin de pouvoir continuer à cultiver les terres qu'ils occupaient. L'interprétation de la première sécession s'en trouve dès lors fondamentalement modifiée : l'enjeu paraît ainsi avoir été, comme le suggère l'édit de Servilius trop souvent sous-estimé, d'intégrer les dépendants gentilices au noyau plébéien originel pour former un corps social puissant détenteur du privilège de s'enrôler dans l'armée civique (au détriment des milices gentilices). Une étape majeure dans la transition d'un modèle clanique vers un modèle civique.
Marcus Manlius Capitolinus in 385 BC has already been the subject of many studies, most of them related to the intervention
of this character in the social conflict relating to the debt of the plebeians. The present contribution has been devoted
to the study of the global context in which the sedition took place. In doing so, I highlighted the fact that this sedition, far to
be limited to a stereotypical episode of the struggle of the orders, could be understood in the context of the first “civil” wars
within the Latin League. The event would thus illustrate the interconnection of Roman and Latin societies and the complex
issue of the Roman identity, via the example of the clan of the Manlii, whose network stretched out far beyond Rome and
whose heart was even originally located in the Tusculum area. The episode of Capitolinus’ seditio as it is told, undeniable
result of a narrative reconstruction, would actually reflect the defectio of a significant part of the gens Manlia, for the defense
of their interests in Latium as well as of their power of influence in Rome.
FR: Cet article se propose de revenir sur l’un des plus longs et des plus célèbres fragments que nous ayons conservés des Annales d’Ennius : la prise d’auspices de Romulus et Rémus citée par Cicéron dans son De diuinatione. Deux problèmes seront plus particulièrement abordés. Le premier concerne la mention du sol albus au vers 84 : un certain nombre d’arguments – qu’ils soient d’ordre lexicologique (l’opposition chez Ennius des mots albus et candidus ainsi que leur rapport avec le grec λευκός), stylistique (la métaphore des jeux du cirque et la transition des astres comme schémas suggestifs du « changement d’ère ») ou historique (les conditions de la prise d’auspices nocturnes) – nous poussent à revenir à l’interprétation initiale du sol albus comme astre lunaire. Le second problème abordé est relatif au syntagme radiis icta lux que l’on retrouve au vers suivant. Si la signification globale du passage se comprend aisément (apparition éclatante et radieuse de la lumière à l’aube), en revanche les choix lexicaux et grammaticaux opérés par Ennius laissent pour le moins perplexe. Or une étude des théories anciennes de la vision (et notamment de sa variante pythagoricienne dite « extramissionniste ») permet de résoudre le problème et de proposer une meilleure traduction.
According to the tradition transmitted by the narratives of Livy and Dionysius of Halicarnassus, Rome was, in the 5th and 4th centuries BC, a young Republic, the main characteristic of which was to be the duality of its society. Moreover, this social dualism patriciate/plebs would have been coupled with an institutional dualism consuls/tribunes of the plebs. Now recent studies (in particular those of T.P. Wiseman) tend to show that the consulate would definitively have been established only during the licinian-sextian reforms (367 BC). Under these conditions, the traditional representation of the tribunate makes no sense anymore. The present study aims at redefining the identity of the original tribunes, which in all probability would have been military leaders until consuls were definitely created. The various arguments tackled are the famous testimony of Varro (LL, 5, 81), the cases of opposition to the dilectus (military recruitment), the second secession of the plebs, the progressive increase of the tribunes number in a political and military perspective and, the last but not the least, a fundamental testimony of Dionysius of Halicarnassus (X, 43 and 45), which has often been forgotten.
Si l’on en croit la tradition que nous ont transmise les récits de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse, Rome était, aux Ve et IVe siècles av. J.-C., une jeune république, dont la caractéristique principale se trouvait être la dualité de sa société. Ce dualisme social patriciat/plèbe se serait en outre doublé d’un dualisme institutionnel consuls/tribuns de la plèbe. Or de récentes études (notamment celles de T. P. Wiseman) tendent à montrer que le consulat n’aurait été définitivement instauré que lors des réformes licinio-sextiennes (367 av. J.-C.). Dans ces conditions, la représentation traditionnelle du tribunat perd tout son sens. La présente étude vise à redéfinir l’identité du tribunat originel, qui selon toute probabilité, aurait été une magistrature militaire jusqu’à la date de création définitive du consulat. Les différents arguments abordés sont le célèbre témoignage de Varron (LL, 5, 81), les cas d’opposition au dilectus (recrutement militaire), la deuxième sécession de la plèbe, la remise en perspective de l’augmentation progressive du nombre de tribuns dans son contexte politique et militaire et surtout un témoignage fondamental et oublié de Denys d’Halicarnasse (X, 43 et 45).
organisée par le séminaire « Constitutions mixtes » (Stavroula Kefallonitis, HiSoMA C3), en collaboration avec le programme « Républicanisme et économie politique » (Michel Bellet, Nicolas Eyguésier, Philippe Solal, GATE L-SE).
Mercredi 12 décembre 2018
Université Jean Monnet – Campus Tréfilerie – Bât. G – Salle du conseil G05
33, rue du Onze novembre – 42023 Saint-Étienne
http://syn.hypotheses.org
8h30-9h00 Accueil
9h00-9h15 INTRODUCTION
Stavroula Kefallonitis (UJM Saint-Étienne, HiSoMA), « En guise d’introduction – La dette comme ressort historiographique »
9h15-10h20 SESSION 1 – DETTES ET COMMUNAUTÉS
9h15 Marie Durnerin (ENS Lyon, HiSoMA), « Les dettes des chefs dans le paiement de la solde aux mercenaires de l’Anabase de Xénophon : facteur de la constitution ou de la décomposition de la communauté des Dix Mille ? »
9h45 Louise Fauchier (Université Lyon 2, HiSoMA), « Kapèloi et vente à crédit dans l’Athènes classique »
10h25-10h40 Pause
10h40-12h30 SESSION 2 – DETTES ET CORPS POLITIQUES
10h40 Nicolas MEUNIER (Université Saint-Louis Bruxelles, CRHIDI ; Université catholique de Louvain, CEMA), « "Dettes" et formes de dépendances dans la Rome alto-républicaine : pouvoir et société entre le clan et la cité »
11h20 Marie-Rose GUELFUCCI (Université de Franche-Comté, ISTA), « Dette et "signes extérieurs de richesse" : l’importance de la perception dans les affrontements politiques d’un corps social (IVe-IIe s. a.C.) »
11h50 Virginie HOLLARD (Université Lyon 2, HiSoMA), « Argent, morale et politique à Rome à la fin de la République. Étude du corpus cicéronien »
12h20-14h00 Pause
14h00-15h00 SESSION 3 – DETTES ET RÉGIMES POLITIQUES
14h00 Pierre PONCHON (PHIER Université Clermont Auvergne), « Dettes et changements constitutionnels chez Platon »
14h30 Emmanuèle CAIRE (Aix-Marseille Université, CPAF-TDMAM), « Dette et constitution chez Aristote »
15h00-15h20 Pause
15h20-16h40 SESSION 4 – DETTE ET LIBERTÉ
15h20 Nicolas EYGUÉSIER (Université Lille 1, GATE L-SE)
« Dettes et constitutions mixtes chez Sismondi »
16h00 Catherine PSILAKIS (Université Lyon 1, STL)
« Une nouvelle seisachtheia, solution à la dette grecque ? Appropriations d’une mesure solonienne au XXIe siècle »
16h40-17h00 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
In occasione del bimillenario della morte di Tito Livio, questa giornata di studio ha come scopo di contribuire a questo rinnovamento degli studi liviani invitando alla discussione sull’opera del Padano in questa doppia prospettiva, storica e letteraria.
Sul piano tematico, la prima decade – che copre il periodo della Roma arcaica, epoca regia e alto-repubblicana – sarà privilegiata, perché è
probabilmente lì che si pone nel modo più pertinente la questione della necessaria combinazione degli approcci, ed è anche lì che si trovano le più importanti questioni da rimettere in discussione e le tendenze al rinnovo le più pronunciate.
Le comunicazioni si articoleranno intorno tre assi: la questione dei rapporti tra Tito Livio e gli altri testimoni della Roma arcaica; l’identificazione dei principi di costruzione narrative ed ideologiche;
lo studio del contesto latino ed italico di fronte al romano-centrismo liviano.
The term crisis stems from the Greek word which, among others, means ‘to distinguish, to separate’ and hence in a related sense means ‘to decide’. Seen from this angle, a crisis can be perceived as a time of decision or as the moment when a decision is needed. A critical situation is hence also a decisive moment. The history of crises suggests that this substantive is used with a variety of adjectives: political crisis, economic, social, environmental, ideological….A crisis is rarely simple and is often characterized by a conjunction of different components, involving different domains. In the frame of this conference, we aim to explore the problem of crisis in relation to the religious sphere taken in its widest sense. Our aim is not only to investigate the meaning of a crisis as such but also from what moment onwards one can talk about a crisis. A crisis is essentially defined by its consequences or even more by its responses or the absence of the latter. The characterization of its causes (punctual, recurrent; external; internal) likewise opens a vast area for assessment.
More in particular, we want to examine a religious crisis, which is already a very large field of investigation since it implies all kinds of religions, in the traditional sense, as philosophies and systems of representation. In this frame, we are interested in the link between crisis situations and the religious world: does a crisis favour the emergence, development or modification of religious practices or philosophical systems? And inversely, can the creation, development or transformation of practices or beliefs cause a crisis that is evident in other domains? Attempts to answer this question will be given by specialists of the world of Minoan and Mycenaean palace societies of the 2nd millennium BC and of the world of the Mediterranean cities (Greek and Roman) (8th c. BC to 5th c. AD) who will exchange their views especially where the problem and the methodology are concerned. By using specific case studies, special attention will not only be given to historiography, but also to epistemological questions. The papers will also deal with the birth and development of religions in periods of crisis and will attempt to clarify some points e.g. to what degree the appearance of a cult in a particular context an answer or a reaction is to a prior situation? What are the responses and reactions to such appearances? How did the actors deal with difficult situations? Are the causes of a crisis cults usually punctual or can we identify a recurrent pattern? These are the themes this conference wants to explore.
À défaut de se référer à un modèle interprétatif unique et standardisé, la dimension globale des analyses rassemblées dans cet ouvrage met bien évidence la réalité d’une mare magnum pour une culture commune du livre déclinée dans la diversité des contingences historiques et culturels de la civilisation méditerranéenne. Finalement, le titre du présent volume illustre bien la complexité fonctionnelle et significative des « bibliothèques » antiques en déclinant ainsi trois aspects fondamentaux et intrinsèquement liés qui structurent l’ensemble des contributions : des lieux, des espaces (de rangement) et des livres.