UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Deux scènes de cannibalisme dans la peinture de Francisco de
Goya y Lucientes: essai pictural sur la nature humaine
par
Bianca Laliberté
Département d’histoire de l’art et études cinématographiques
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
En vue de l’obtention du grade de
Maître ès arts (M.A.) en Histoire de l’art
2016
© Bianca Laliberté, 2016
�UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
CE MÉMOIRE INTITULÉ :
Deux scènes de cannibalisme dans la peinture de Francisco de Goya y Lucientes: essai
pictural sur la nature humaine
PRÉSENTÉ PAR :
Bianca Laliberté
A ÉTÉ ÉVALUÉ PAR UN JURY COMPOSÉ DES PERSONNES SUIVANTES :
Denis Ribouillault
Président-Rapporteur
Johanne Lamoureux
Directrice de recherche
Olivier Asselin
Membre du jury
�I
Résumé
Ce mémoire vise à élargir, à l'aune d'une approche herméneutique jaussienne,
l’interprétation de deux tableaux de Goya portant des titres qui leur ont été donnés a
posteriori : Cannibales montrant des restes humains (1800-1808?) et Cannibales
préparant leurs victimes (1800-1808?). Notre analyse se fonde en premier lieu sur une
description de la matérialité des œuvres ; nous fournissons la première lecture de la
relation entre ces tableaux et en défendons par ailleurs le statut de diptyque. Nous
proposons ensuite une analyse critique de la réception des deux tableaux. Puis, dans la
mesure où ces œuvres sont les premiers exemples où apparaissent en peinture des
« sauvages » cannibales, nous explorons l'horizon iconographique du cannibalisme afin
d'y chercher des images comparables. Cette tradition figurative paraît se réduire à trois
catégories, à savoir: l’image coloniale, la caricature et la peinture mythologique. Ensuite,
en partant de l'hypothèse répandue et héritée du romantisme que ces œuvres constituent
des représentations de la nature humaine, nous tentons de les réinscrire dans l'horizon
historique et philosophique dont est issue cette notion. Nous nous penchons tout
spécifiquement sur les pensées philosophiques de Thomas Hobbes et de Jean-Jacques
Rousseau, qui articulent des conceptions contraires de la nature humaine : si pour l’un,
celle-ci est cruelle, pour l’autre elle est fondamentalement bonne. Ainsi, pourrons-nous
mieux situer ces deux tableaux par rapport à cette notion à l’aune de son contexte
d’émergence spécifique, notion que Goya a certainement découvert à travers les
Ilustrados qui incarnent la philosophie des Lumières en Espagne. Nous désirons
démontrer de quelle manière ces œuvres pensent et comment, par l'entremise de leurs
propres moyens, elles en viennent à se distancier, en les dépassant, les horizons
iconographique et philosophique dont elles participent.
Mots clés
Francisco de Goya y Lucientes
XIXe siècle – Espagne
Cannibalisme
Thomas Hobbes
Jean-Jacques Rousseau
�II
Abstract
The present research project aims to broaden the interpretations of two paintings
of Francisco de Goya, whose titles were attributed to them a posteriori: Cannibals
Gazing at their Victims (1800-1008?) and Cannibals Preparing their Victims (18001008?). The analysis begins with a description of the materiality of the paintings. This
section represents the first reading of the works’ structural connections, and suggests that
the two images are in fact two parts of a diptych. We will then delve into a critical
exploration of their reception. Since these images are the two first examples of cannibal
figures inspired by colonial imagery to appear in the Western art historical tradition of
painting, we explore the iconographical horizon of cannibalism in order to find
comparable images, the likes of which are divided into three categories: colonial images,
caricature, and mythological paintings. Afterwards, considering the widespread and
romantic interpretation of these paintings as representations of human nature, we will
attempt to reinscribe them within the historical and philosophical spheres from which this
notion derives. We focus on the ideas of Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau,
whose conceptions of human nature are contradictory towards each other. While Hobbes
suggests that the nature of humanity is cruel, Rousseau deems it fundamentally good.
This notion is one that Goya probably encountered himself while frequenting the
Ilustrados – or, the more prominent figures of the Spanish Enlightenment. As a result, we
will be able to situate the two paintings with respect to their specific context of
emergence. Through the examination of these horizons, we aim to demonstrate the ways
in which these two paintings think, and how, through their own resources, they deviate
from – or even surpass – the iconographical and philosophical situations from which they
hail, and to which they respond.
Key Words
Francisco de Goya y Lucientes
19th Century – Spain
Cannibalism
Thomas Hobbes
Jean-Jacques Rousseau
�III
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire..............................................................................................................................i
Abstract ...............................................................................................................................ii
Table des matières .............................................................................................................iii
Liste des illustrations .........................................................................................................iv
Remerciements ................................................................................................................viii
Introduction ......................................................................................................................1
1. L’objet mis-à-nu : histoire d’un diptyque.................................................................14
1.1 Histoire matérielle des tableaux …………………………………………………..…...….....14
1.2 L’objet mis-à-nu : la structure du diptyque………..…...............................................16
1.3 Le Goya nationaliste de Charles Yriarte ……………….….......................................27
1.4 La curieuse mise en rapport entre le mythe des Saints Martyrs canadiens et le
diptyque avec Cannibales……………………………...……...........................................31
1.5 Un nouveau paradigme historiographique : le cannibale comme métaphore de la
nature humaine ………..……………………………………….…...................................37
2. Une iconographie du cannibalisme du XVIe au début du XIXe siècle ..................44
2.1 L’Autre cannibale : une figure coloniale …………....................................................45
2.2 Le cannibale dans la caricature : contre la France révolutionnaire…..........................53
2.3 L’image mythologique : un cannibalisme de l’hybris ……………............................61
3. La nature humaine : entre le même et l’autre chez Hobbes, Rousseau et Goya....71
3.1 Le refoulement du sauvage ou la nature humaine chez Hobbes……………..............72
3.2 Le mythe du bon sauvage ou la nature humaine chez Rousseau…………………....79
3.3 Goya chez les Ilustrados .............................................................................................85
3.4 Une manifestation picturale de la nature humaine…………………….....……......…87
Conclusion ........................................................................................................................99
Bibliographie ...................................................................................................................105
�IV
Liste des illustrations
Figure 1. Francisco de Goya y Lucientes, Cannibales montrant des restes humains,
1800-1808?, huile sur bois, 31 x 50 cm, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de
Besançon.
Source : L’ange du bizarre : Le romantisme noir de Goya à Max Ernst, Catalogue
d’exposition, Francfort-sur-le-main, Städel Museum, 26 septembre 2012 – 20 janvier
2013 ; Paris, Musée d’Orsay, 5 mars – 9 juin 2013, Ostfildern : Hatje Cantz, p. 75.
Figure 2. Francisco de Goya y Lucientes, Cannibales préparant leurs victimes, 18001808?, huile sur bois, 31 x 45 cm, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
Source : L’ange du bizarre : Le romantisme noir de Goya à Max Ernst, Catalogue
d’exposition, Francfort-sur-le-main, Städel Museum, 26 septembre 2012 – 20 janvier
2013 ; Paris, Musée d’Orsay, 5 mars – 9 juin 2013, Ostfildern : Hatje Cantz, p. 74.
Figure 3. Grégoire Huret, Preciosa mors quorumdam Patrum é Societ. Iesu in nova
Francia, 1650, estampe, Réserve, Collection Hénin, tome 40.
Source : LAFLÈCHE, Guy (1988). Les Saints Martyrs Canadiens, vol. 1, « Histoire du
mythe », Laval : Les Éditions du Singulier Ltée., Planche 1.
Figure 4. Gravure tirée de l’œuvre de Théodore de Bry, « Discipline militaire d’Outtina
pour aller au combat », Grands Voyages, 1613, Deuxième partie, planche XIV, Eau forte
colorié.
Source : DUCHET, Michèle et coll. (1987). L’Amérique de Théodore de Bry : une
collection de voyages protestante du XVIe siècle : quatre études d’iconographie, Paris :
Éditions du Centre national de la recherche scientifique, p. 157.
Figure 5. Chaussure anglaise.
Source : PEACOCK, John (2005). Un répertoire des modèles de la chaussure de
l’antiquité à nos jours, Paris : Éditions de la Martinière, p. 57.
Figure 6. Un chapeau anglais.
Source : AMPHLETT, Hilda (1974). Hats : A History of Fashion in Headware,
Meneola : Dover Publications, pp. 125-126.
Figure 7. Francisco de Goya y Lucientes, Automne, 1786, huile sur toile, 33,8 x 24 cm,
Musée du Prado, Madrid.
Source : Musée du Prado, Paris. Du site : https://www.museodelprado.es/. Consulté le 13
avril 2016.
Figure 8. Gravure tirée de l’ouvrage de Lorenz Fries, « Boucherie de cannibales à tête de
chien », Uselegung der Mercarthen oder Carta Marina, Strasbourg, Vers 1525, Bois
gravé, 10,5 x 14,4 cm.
Source : LESTRINGANT, Frank (1994). Le cannibale: grandeur et décadence, Paris :
Perrin, p. 48.
�V
Figure 9. Gravure tirée de l’ouvrage d’André Thévet, « Équarissage de la victime », Les
Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs
terres et isles découvertes de nostre tems, 1575, eau-forte.
Source: LESTRINGANT, Frank (1994). Le cannibale: grandeur et décadence, Paris :
Perrin, p. 108.
Figure 10. Gravure tirée de l’œuvre de Théodore de Bry, « Trois Espagnols suppliciés
sont mutilés par leurs compagnons affamés », Grands Voyages, 1618, Septième partie,
planche IV, eau forte.
Source : DUCHET, Michèle et coll. (1987). L’Amérique de Théodore de Bry : une
collection de voyages protestante du XVIe siècle : quatre études d’iconographie, Paris :
Éditions du Centre national de la recherche scientifique, p. 225.
Figure 11. James Gillray, Un Petit souper à la Parisienne or a famille de sans culottes
refreshing after the fatigues of the Day, 20 septembre 1792, eau-forte coloriée, 24,13 x
34,93 cm.
Source : http://www.artstor.org/. Consulté le 13 avril 2016.
Figure 12. Anonyme, L’Ogre dévorateur du genre humain, 1814 ou 1815, eau-forte
coloriée, 15,7 x 12,9 cm.
Source : CLERC, Catherine (1985). La caricature contre Napoléon. Paris: Promodis,
p.153.
Figure 13. Anonyme. Sans titre, 1814, eau-forte, 1,8 x 2,3 cm.
Source : CLERC, Catherine (1985). La caricature contre Napoléon. Paris: Promodis,
p.152.
Figure 14. Pieter-Paul Rubens, Saturne dévorant son fils, 1632, huile sur toile, 180 x 87
cm. Musée du Prado, Madrid.
Source : Musée du Prado, Madrid. Du site : https://www.museodelprado.es/. Consulté le
13 avril 2016.
Figure 15. Attribué à Abraham Bosse, King and Kingdom, 1651, Frontispice de Thomas
Hobbes, Léviathan, estampe en taille douce, 51 x 63 mm.
Source : BREDEKAMP, Horst (2003). Stratégie visuelles de Thomas Hobbes. Le
Léviathan, archétype de l’État moderne. Illustrations des œuvres et portraits. Paris :
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, p. 6.
Figure 16. Jean Mattheus, Frontispice du De Cive, 1642, estampe en taille-douce.
Source : BREDEKAMP, Horst (2003). Stratégie visuelles de Thomas Hobbes. Le
Léviathan, archétype de l’État moderne. Illustrations des œuvres et portraits. Paris :
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, p. 160.
Figure 17. Jean Mattheus, Détails du frontispice du De Cive. 1642.
Source : Agrandissement fait par l’auteur.
�VI
Figure 18. Frontispice du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi
les hommes, 1755, estampe en taille douce.
Source : http://gallica.bnf.fr. Consulté le 13 avril 2016.
Figure 19 : Frontispice du Contrat social, 1762, estampe en taille douce.
Source : http://gallica.bnf.fr. Consulté le 13 avril 2016.
Figure 20 : Francisco de Goya y Lucientes, No se convienen, 18010-1815, estampe, eauforte et aquatinte.
Source : LAFUENTE FERRARI, Enrique (1962). « Goya’s Graphic Work », Goya :
Complete Etching, Aquatints and Lithographs, Londres : Thames and Hudson, p. 102.
Figure 21 : Francisco de Goya y Lucientes, Lo mismo en otras partes, 18010-1815,
estampe, eau-forte et aquatinte.
Source : LAFUENTE FERRARI, Enrique (1962). « Goya’s Graphic Work », Goya :
Complete Etching, Aquatints and Lithographs, Londres : Thames and Hudson, p. 108.
�VII
À Paul et Denise.
�VIII
Remerciements
Je tiens d’abord à remercier ma directrice de recherche Johanne Lamoureux pour
m’avoir mise sur la piste de ces énigmatiques tableaux et pour m’avoir permis de
découvrir un certain rapport à l’image, un certain sens du voir. C’est avec une grande
sensibilité et une intelligence passionnée qu’elle m’a donné à voir l’indéniable pertinence
de la discipline de l’histoire de l’art. Je la remercie de m’avoir poussée à me surpasser.
Je souhaite exprimer ma gratitude envers Daniel Blémur pour son écoute et ses
précieux conseils, ses pensées et son regard. C’est avec amitié et amour que je lui dis
merci, de m’avoir soutenue tout au long de ce projet, de me soutenir encore et toujours
dans les flots d’un devenir indéterminé.
Merci à tous ceux, amis, qui ont pris le temps de me lire et le soin de me corriger :
Daniel Blémur, Isabelle Boucher, Jolianne Bourgeois, Ianik Marcil, Carolyn Murray,
Marc-André Towner et Hermann Pottey. Merci à Sarah Blémur pour nos merveilleux
échanges sur les œuvres. Merci à Maria Blanque pour sa contagieuse fascination envers
Goya.
Je remercie tous ceux sans qui la vie intellectuelle, au-dedans comme au-dehors
de l’université, n’aurait aucun sens : Nicolas Berzi, Jolianne Bourgeois, Isadora de Burgh
Galwey, Maxime G. Langlois, Salma Ketari, Dominic Marion, Sophie Mauzerolle, Léa
Medzwiecki, Teddy Tabet, Francis-Thibault Ménard, Marc-André Towner et Adam
« Trotsky » Szanyi. Je tiens à remercier tout particulièrement Isabelle Boucher et Manuel
Bourget pour l’écoute attentive et passionnée dont ils ont fait preuve tout au long du
procès de ce mémoire. Un merci spécial à toi, Bassem Ghorayeb, pour le spectacle
éblouissant de ta brillante folie et pour l’amitié insatiable dont tu me fais le cadeau.
Enfin, à chacun de mes frères et sœurs, Sarah, Sandrine, Anouk, Geneviève, Antoine et
Alexandre, merci. Vous êtes mon souffle. Je dédie aussi ce mémoire à ma mère. Je la
remercie de son support et de sa présence.
Et bien sûr, merci à l’irremplaçable Martin et à son jeu de Parcheesi.
�IX
Ils parlaient de l’homme sauvage, et ils peignaient l’homme civil.
Jean-Jacques Rousseau
�1
INTRODUCTION
Francisco de Goya y Lucientes a grandi dans une famille modeste à Fuendetodos,
au nord de l’Espagne1. Incarnant peut-être une version précoce du « self-made man »2, il
s’intègre progressivement avec fougue et énergie dans les milieux qui s’ouvrent à lui, ces
milieux de grands pouvoirs (clergé, aristocratie et haute bourgeoisie). La reconnaissance
dont il jouit en tant qu’artiste nous est révélée par le nombre impressionnant de
commandes de portraits et autres œuvres, particulièrement de portraits3. Mais nous nous
intéresserons surtout à un autre pan de l’œuvre du peintre, lequel émerge plus
tardivement et parallèlement à nombre de commandes. Sans que Goya ne cesse
d’entretenir les relations nécessaires à la réalisation de tableaux pour les puissants4, il se
met à produire cette part autre – la plus obscure de son œuvre – à laquelle il est convenu
d’associer les tableaux que nous analyserons dans ce mémoire : Cannibales montrant des
restes humains (Figure 1) et Cannibales préparant leurs victimes (Figure 2)5. Du point
de vue de la représentation picturale de l’époque de Goya, ces deux tableaux mettent en
scène des figures marginales et qui, en ceci, s’apparentent à d’autres figures goyesques
qui sont fort différentes des figures propres aux œuvres de commandes6 : des fous, des
créatures ou des monstres. Cette part tardive explore de multiples variantes de la violence
humaine ou non humaine. Goya a peint, dessiné et gravé des corps morcelés, éventrés,
1
Jacques Soubeyroux (2011 : 26-27) récuse l’idée selon laquelle Goya viendrait d’une famille prospère. En
effet, son analyse sociologique de l’ascension du peintre et de la transformation esthétique de son œuvre, se
fonde sur la démonstration que Goya vient d’une famille pauvre.
2
C’est Nigel Glendinning (1989 : lxiv) qui présente une telle interprétation de la vie du peintre : « Goya
rose above his father by pursuing an honorable rather than a « mechanical » profession and by making
money and investing it in bank shares, insurance policies, houses and lands ». Voir également le mémoire
de Raphaëlle Occhietti (2012), qui analyse l’œuvre La Junte des Philippines (1815) de Goya à titre de
contribution artistique dans le contexte de la naissance du capitalisme financier et de la domination
espagnole des territoires des Philippines. Goya était lui-même un actionnaire. Sa correspondance avec
Zapater en fournit plusieurs preuves. Voir notamment : (Goya 1988 : 110).
3
Nous savons d'ailleurs, que nul facteur n’a découragé cette reconnaissance. Les portraits « [...] ne
disparaissent ni pendant la guerre, ni après » (Soubeyroux 2011 : 18). La récente exposition de la National
Gallery de Londres, Goya : The Portraits (2015-6), présente d’ailleurs le peintre tel qu’il fut reconnu en son
temps, en tant que célèbre portraitiste. Cette exposition vise par ailleurs à détacher Goya de sa période
« noire », laquelle fonde son prestige depuis l’époque romantique.
4
Du moins jusqu’à son départ pour Bordeaux en 1824.
5
Les œuvres ici mentionnées n'ont été ni titrées, ni datées par le peintre lui-même. Il semble que ce soit
Juliet Wilson Bareau qui ait proposé ces titres. Ils apparaissent pour la première fois dans son livre Goya:
Truth and Fantasy: the Small Paintings (1994 : 288-289).
6
Il faut évidemment mentionner une exception, soit les six tableaux commandés par les Osunas (1797-8)
où prolifèrent sorcières et créatures étranges.
�2
pendus, violés, etc7. C’est là d’ailleurs l’une des singularités de cette partie plus privée de
son œuvre ; très peu de tableaux de commande exhibent ainsi une violence sanguinaire8.
De manière générale, il existe une séparation à même le grand œuvre de Goya, entre les
cadres où apparaissent des figures marginales et ceux où se présentent des figures nobles
ou bourgeoises. Or, comme nous le verrons plus loin, dans l’un des deux tableaux qui
nous intéressent, ces deux types de figures se mélangent, ainsi que que nous le révèlent
les accessoires jonchant sur le sol.
Dans ce diptyque9, des corps sont ouverts, prêts à être dévorés ; des êtres en
écorchent d'autres. Pourtant, il nous est difficile de dire ce qui se passe réellement, de dire
qui sont ces êtres ? Quel est donc le monde qu'ouvrent ces tableaux ? Où, dans l'espacetemps, se situent ces figures ? Goya a mis en scène des figures humaines à chaque pas de
sa démarche artistique ; l'homme est sans nul doute le sujet prédominant de son œuvre.
Or, contrairement, par exemple, aux quelques centaines de portraits que le peintre a
produits, ici les figures ne portent pas de nom, ni peut-être même de visage. Elles
présentent une identité générique (et ambigüe) plutôt que singulière. Par-delà l'évidence
de leur violence, ces œuvres semblent d'emblée nous laisser aux prises avec plusieurs
questions abstraites.
7
Une série de six tableaux apparaît en 1793-1794, parmi lesquels le Préau des fous et L’attaque de la
diligence. Celle-ci constitue la première manifestation d’une violence frappante dans l’œuvre de Goya
(Wilson Bareau 1994 : 200-209). Ces tableaux sont environ tous de la même taille que les deux tableaux
avec Cannibales et qu’une importante part des scènes de genre de Goya. Ces six œuvres seront cependant
exposées par Goya à l’Académie (Ibid. : 200). Ce n’est qu’au début du XIXe siècle qu’il se mettra à
peindre par ses propres moyens, à l’abri des regards du monde. Parmi les gravures, il faut mentionner les
Désastres de la guerre, où la violence joue un rôle important. Les Peintures Noires constituent certes
l’apogée des expérimentations picturales de la violence et de la monstruosité (1819-1823).
8
Certaines œuvres historiques, comme Le 2 mai (1814) et Le 3 mai (1814), sont aussi des tableaux où
s’exprime une violence plus convenue et apparentée à la peinture d’histoire.
9
Les œuvres ont toujours été déplacées, étudiées et exposées comme une paire.
�3
Figure 1. Francisco de Goya y Lucientes, Cannibales montrant des restes humains, 1800-1808?
Figure 2. Francisco de Goya y Lucientes, Cannibales préparant leurs victimes, 1800-1808?
�4
L’état du savoir actuels sur ces œuvres10 nous permet de dire qu’elles n’ont pas
été vues avant que le fils de Goya, Javier, ne les mette en vente11. Au même titre que les
Peintures noires, les tableaux avec Cannibales appartiennent à cette part de l’œuvre qui
n’a pas été produite pour être vue, du moins immédiatement, et qui se trouve ainsi exclue
du régime marchand des œuvres d’art12. Bien plus qu’une rupture à même son œuvre,
Goya crée donc un espace pictural autre dans lequel habite un nombre impressionnant de
figures qui ne sont pas humaines ou encore qui confronte l’homme aux limites de son
humanité. Ainsi, nous pourrions considérer le fou, le monstre, le cannibale et voire même
le serf comme des figures comparables de l’altérité. Ces figures ont ceci de familier
qu’elles tendent à intensifier les traits de la cruauté. Nous pensons que les tableaux avec
Cannibales offrent un vue singulière sur cette exploration parallèle de Goya dans la
mesure où les figures qui s’y découvrent portent, pour les Européens de la fin du XVIIIe
siècle, des traces d’un langage qui les caractérisent comme l’Autre de l’homme : le dit
« sauvage »13. Alors que nous voyons dans cette part autre un travail complexe sur la
notion l’altérité et ses masques instables, la majorité des auteurs de l’historiographie dont
nous présenterons des fragments de discours se réfèrent à la violence de l’œuvre de Goya
comme l’expression d’une nature humaine universelle.
10
Il est possible que ces œuvres comptent parmi l’inventaire recensé en 1812 et publié par Sanchez Canton
(1946 : 33-34), mais cet inventaire est trop imprécis pour le garantir (Wilson Bareau 1996 : 166-7). Ces
tableaux ne correspondent à aucune commande. Nous tenons pour seule preuve de l’achat de ces tableaux
le catalogue de Charles Yriarte (1867), lequel renferme leur titre sous le nom de leur propriétaire immédiat,
Jean Gigoux (1806-1894). Mais quand en a-t-il fait l’acquisition? Peut-être après la mort de Javier (1854),
parce qu’il n’avait cette année-là que 28 ans.
11
Il est difficile de dire quand ces tableaux furent exposés pour la première fois au regard du monde.
« After Goya’s death if not earlier, […] Xavier began to dispose of his father’s work » (Wilson Bareau
1996 : 160).
12
Parmi les œuvres que contient cette part, notons : L’attaque de la diligence, Intérieur de prison, Le Préau
des fous, L’incendie, La lampe monstrueuse, Exorcisme, Hôpital des pestiférés, Brigands fusillant leurs
prisonniers, Brigands dépouillant une femme, Brigand assassinant une femme Scène de rapt et de meurtre,
Fusillade dans un camp militaire. Voir l’ensemble de la liste de ces illustrations dans le livre de Todorov
(2011 : 136).
13
De fait, le terme de « sauvage » renvoie normalement au XIXe siècle aux Amérindiens d’Amérique et
dissocié de l’être humain. Il semble que son sens tend cependant à l’époque à vaciller, notamment dans le
discours de certains penseurs, dont Rousseau (Rey 1998 : 3400). Or, si toute l’historiographie fait usage de
ce terme de façon systématique pour parler des figures de ces tableaux, nous en faisons un usage critique et
circonstancié
�5
Afin de pouvoir réfléchir ce problème que pose l’historiographie, nous souhaitons
étudier les relations entre l’homme, sa nature et la violence cannibale à même la
configuration picturale des deux tableaux en question, en tant qu’elle est historiquement
déterminée. Pour ce faire et dans la mesure où les premiers spectateurs de ce diptyque ne
sont pas contemporains de Goya, nous proposons d’utiliser une approche herméneutique
afin de questionner le mode d'expérience entre l’œuvre, le créateur et le récepteur « dans
et par la distance » (Ricœur 1986 : 114). Le point de vue herméneutique considère
l'œuvre en tant qu'œuvre, pouvant opérer une distanciation par rapport au monde (Ibid. :
111). Ceci dit, c'est la perspective singulière de Hans Robert Jauss qui nous intéresse14,
telle qu'elle est élaborée dans Pour une esthétique de la réception (1978), où l’objet est
l’œuvre d’art (surtout littéraire).
D'entrée de jeu, Jauss prend position face à la pensée de Hans Georg Gadamer.
Essayons d'abord de comprendre la contribution de Gadamer à l'herméneutique
philosophique pour mieux comprendre la démarche de Jauss. « Nous devons à Gadamer
cette idée très féconde que la communication à distance entre deux consciences
différemment situées se fait à la faveur de deux horizons, c'est-à-dire du recoupement de
leurs visées sur le lointain et sur l'ouvert » (Ricœur 1986 : 110). En ce qui concerne
l’interprétation d’une œuvre du passé, le problème se pose toujours en termes de distance
entre deux horizons historiquement déterminés. C’est que l'œuvre du passé pose une
question que la lecture herméneutique se doit de reconstituer. La démarche de Jauss
consiste à questionner la « vérité de la question » ainsi posée par un texte, une œuvre,
alors que Gadamer la présente en tant que « vérité intemporelle », c’est-à-dire fixée une
fois pour toutes dans son horizon historique. « Chez Gadamer l'acte de comprendre est
conçu […] comme insertion dans un processus de tradition où le présent et le passé sont
dans un rapport de médiation réciproque permanente » (Jauss 1978 : 69). La fusion entre
les horizons propres au créateur et au récepteur, pour Gadamer, permettrait de dévoiler la
réactualisation de la pertinence et de la permanence d’une question posée jadis. Tandis
14
Cependant, nous avons emprunté les parcelles explicatives d'une herméneutique à Paul Ricœur, lequel
s'est donné pour tâche de faire une histoire de l'herméneutique afin de mieux situer la pertinence actuelle et
le renouvèlement de cette approche philosophique. Nous avons considéré son explication comme la plus
éclairante pour une présentation de l’herméneutique gadamérienne.
�6
que pour Jauss, « la tradition artistique présuppose un rapport dialectique entre le présent
et le passé, et donc l'œuvre [ne] peut […] nous dire quelque chose aujourd'hui que si nous
avons posé la question qui abolira son éloignement » (Ibid. : 69). L’expérience esthétique
ne lie pas seulement le créateur et le récepteur, mais aussi l’œuvre et la réception. Jauss
ne s’intéresse pas uniquement à la question intentionnelle d’origine, mais aux questions
présentes dans l’œuvre qui se dévoilent historiquement et qui, elles, ne sauraient être
ramenées strictement à la volonté du créateur. Cette différence d’accent « abolit
l’éloignement historique » qui gît entre le passé de l’œuvre comme écart dans un horizon
historique déterminé et un présent dans lequel un nouvel écart peut surgir, qui appartient
néanmoins toujours à l’horizon de l’œuvre. C’est ainsi que nous pouvons aborder les
tableaux de Goya à partir d’une question nouvelle.
Or, la question qu’il s’agit de poser à l’œuvre, pour Jauss, ne s’invente pas ex
nihilo. Elle est en quelque sorte déterminée par le rapport dialectique entre l’œuvre et
« l’horizon d’attente » dont elle participe. Non seulement l'histoire de la réception
rétablit-elle le lien entre les horizons du présent et du passé et permet ainsi de « […]
remettre en question [...] la fausse évidence d'une essence poétique intemporelle », mais
elle cherche aussi à rétablir le lien entre le créateur et le récepteur d’un temps donné. La
reconstitution de ce que Jauss appelle « l'horizon d'attente » immédiat d'une œuvre
permet la découverte « […] des questions auxquelles [elle] répondait et de découvrir ainsi
comment le lecteur du temps peut l'avoir vue et comprise » (Ibid. : 64). Pour Jauss, la
valeur artistique d’une œuvre dépend d’ailleurs de « l’écart esthétique » qu’elle induit, de
la « distance entre l’horizon d’attente préexistant et l’œuvre nouvelle dont la réception
peut entraîner un « changement d’horizon » (Ibid. : 58). La réception qui a lieu à la même
époque historique que la création de l’œuvre peut aider à constater le fait d’un tel écart.
Or, la distance herméneutique jaussienne permet de reconnaître la valeur esthétique d’une
œuvre, même si de son temps elle fut ignorée, sans pour autant contraindre le récepteur à
faire reposer cette valeur sur une question induite par le contexte dont l’œuvre émerge,
par l’horizon d’attente dans lequel il s’inscrit15.
15
D’autant plus que la valeur d’une œuvre « […] n’est pas nécessairement perceptible au moment où elle
apparaît, selon l’horizon littéraire [ou artistique] de cet instant […] » (Jauss 1978 : 73).
�7
Plusieurs œuvres de Goya ne furent jamais montrées de son vivant, faute d’un
cadre institutionnel permettant leur exposition. Leur réception immédiate fut différée et il
demeure difficile de déterminer le contexte de leur premier public16. Cette part autre du
travail du peintre se fait en vase clos, en circuit fermé, dans la propriété même de Goya,
où ce dernier choisit de produire majoritairement des scènes de genre et des sujets à la
limite de l’acceptable du point de vue de l’horizon d’attente artistique dans lequel ils
s’inscrivent. Goya crée un écosystème fondé sur une économie de la mort et de la
violence qui affirme la valeur esthétique de configurations liant genres, lieux et figures
qui sont étrangers ou du moins en marge du système des « Beaux-Arts »17. L’art de Goya
s’affirme donc dans la négation des valeurs effectives de ce système : cela participe selon
nous à expliquer pourquoi ces œuvres ne furent pas montrées de son temps. Si l’on se
fonde d’ailleurs sur la majorité des scènes de genre que Goya a produite, notamment pour
le roi, on peut dire sans peine que les tableaux avec Cannibales, qui sont des scènes de
genre, risquaient d’aller à l’encontre des « […] orientations du goût régnant » (Ibid.: 59).
Les premières critiques favorables aux aspects monstrueux et fantastiques de
l'œuvre de Goya remontent au milieu du XIXe siècle. Dans un court texte de 1846
consacré aux « caricatures » de l’artiste, Charles Baudelaire (2011 : 228) qualifie de
moderne « l'amour de l'insaisissable, le sentiment des contrastes violents, des
épouvantements de la nature et des physionomies humaines étrangement animalisées par
les circonstances ». Théophile Gautier (1981 : 202), lui, écrit : « L'imagination des poètes
16
L’isolement de certaines œuvres de Goya peut s’expliquer par le fait du déploiement de l’inquisition.
Malgré le succès de son travail, l’artiste prend bientôt conscience du danger d’exposer certaines œuvres
publiquement « [...] pour avoir déjà essuyé les feux de la censure inquisitoriale lors de la publication des
Caprices [...] » (Soubeyroux 2004 : 158). Les gravures, les tableaux et les dessins16 « […] qu’il crée, qui
sont beaucoup plus engagés politiquement que ses œuvres antérieures, ont peu de chances d'être publiées
dans un contexte politique de plus en plus répressif » (Ibid.). Soubeyroux parle de ces images si pleines de
violences, habitées par cette facette horrifiante de l’homme. D’ailleurs, Goya a lui-même « […] mis fin à la
vente des Caprices, pour se protéger de l’Inquisition » (Cabanis 1985 : 171).
17
Jacques Soubeyroux ira jusqu’à concevoir cette part tardive de l’œuvre de Goya comme le résultat d'une
« conquête d'autonomie » acharnée au nom de laquelle il s'est positionné à la fois « pour et contre » le
champ avec lequel il s'est fait. Ce champ est décrit par Bourdieu (2004 : 15), ci-haut cité par Soubeyroux,
comme l'embryon du champ artistique constitué au XIXe siècle, « [...] encore déterminé par les règles de la
société d'Ancien régime et traversé par les oppositions entre la dynamique des ordres et celles des classes,
entre les réseaux de mécénat et la revendication d'une propriété intellectuelle liée au travail » (Ibid. : 25).
Les règles de la société d’Ancien régime, dans le domaine des arts, sont précisément déterminées par le
système des « Beaux-Arts ».
�8
et des peintres n'a jamais produit de cauchemar plus horrible »18. Une identification de
ces artistes à l’œuvre de Goya s’institue ; le peintre est absorbé dans le procès du
fondement d’une nouvelle esthétique associée au courant du romantisme noir19. Le
catalogue de l’exposition L'ange du bizarre. Le romantisme noir de Goya à Max Ernst
(2013) va même jusqu’à positionner Goya comme premier artiste de ce filon du
romantisme.
Dans ce catalogue, Annie Le Brun (2013 : 15) pense l'invention du noir comme
« indissociable du raz-de-marée de liberté à l'origine de la Révolution de 1789 », laquelle
affecte brutalement l'Espagne quelques années plus tard. Le désir de liberté chez les
artistes romantiques ne saurait cependant se lire comme une stricte aspiration politique
dans la mesure où il est explicitement en action au sein même de leurs pratiques
artistiques. L’œuvre devient le lieu d’une affirmation résistante à l’esthétique classique,
mais aussi et surtout celui de la plongée dans l’inconnu qu’oblige une telle résistance. En
effet, par-delà l'exploration esthétique de la noirceur en lien avec une situation politique
de la terreur, les artistes du romantisme noir aspirent à une insatiable quête esthétique de
« l'origine des choses » (Le Brun 2013 : 19). Il n’est pas étonnant que les images de Goya
images produites hors commande, une fois qu’elles furent vues par les romantiques, aient
suscité leur intérêt en tant que Goya a, à travers elles, ouvert « de nouveaux horizons »
(Baudelaire 2011 : 227).
Cette quête originelle a tout à voir avec le romantisme qui, comme l’explique
Baudelaire (2011 : 81) cherche à « connaître les aspects de la nature et les situations de
18
Gautier a voyagé en Espagne et connu quelques tableaux de Goya. En ce qui concerne la lecture de
Baudelaire, il est avant tout question des Caprices, qui sont parmi les rares œuvres de Goya connues en
France, jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle (Mena Marqués 2013 : 64). La victoire des Espagnols
contre les invasions napoléoniennes provoqua en France une véritable fascination pour l’Espagne (Cabanis
1985 : 70). Louis-Philippe voit un grand intérêt à ouvrir le Musée Espagnol (ou Galerie espagnole) du
Louvre (1838) affirmant ainsi la gloire de ceux qui ont participé à causer la ruine de son opposant politique.
Avec l’aide du Baron Isidore Taylor qui voyage en Espagne afin d’amasser quelques œuvres pour la
collection, Louis-Philippe peut dorénavant exposer onze tableaux de Goya (Ibid. : 81 et Lerner 2014 : 101).
Voir l’ouvrage Le Musée espagnol de Louis-Philippe. Goya de José Canabis (1985) pour une description
détaillée de la réception de Goya en France, laquelle aura surtout dépendu des artistes et des auteurs
romantiques.
19
Voir l’article de Paul Guinard intitule Baudelaire, le Musée espagnol et Goya (1967), lequel offre un
panorama intéressant de la réception de l’œuvre Goya chez les romantiques français.
�9
l'homme, que les artistes du passé ont dédaignés ou n'ont pas connus ». Il remarque dans
les Caprices de Goya « toutes ces contorsions, ces faces bestiales, ces grimaces
diaboliques [...] pénétrées d'humanité » et voit la manière dont les prouesses du peintre
« tiennent le milieu entre l'homme et la bête » (Ibid. : 230). Les figures à l’identité
brouillée et incertaine des Caprices annoncent l'art romantique, tel que commenté par
Baudelaire, dans la mesure où elles mettent l’homme et sa nature en question. Plus
encore, elles font voir des vérités de l’homme qui avaient selon lui été jusque-là
occultées.
Si chez Baudelaire la fascination pour cette facette violente de l’œuvre de Goya
repose avant tout sur les images gravées20, pour la fortune critique qui prolonge cette
fascination, elle relève également de son œuvre peint. Les auteurs de l’historiographie de
nos tableaux reconduisent systématiquement l’évidence romantique qui fait de la cruauté
de l’œuvre du peintre « visionnaire » la révélation d'une nature humaine. Nous notons ici
quelques citations qui montrent bien l'insistance de ce topos de la théorie : « Soulevé par
une sorte de force mystique, une volonté acérée de venger les martyrs des crimes de
guerre, [Goya] aspire à faire entendre « par le moyen du pinceau » le cri de révolte de
l'humanité opprimée en conférant une valeur universelle à un épisode particulier qui, sans
lui, n'aurait jamais eu le même retentissement », écrit Jeannine Baticle (1986 : 112) en
parlant des tableaux commémorant les événements du 2 et 3 mai 1789. Si la violence
chez Goya « […] n'est jamais gratuite ; c’est précisément pour dénoncer avec plus de
force la violence et la folie humaine » (Soubeyroux 2011 : 162). « Les travaux de Goya,
influencés par les Lumières, illustrent sa fascination pour les folies et les erreurs de
l'homme, ses passions et désirs secrets qui nourrissent le meurtre, les atrocités, les
souffrances et l’humiliation de l'autre » (Vibolt Knudsen 2000: 46). Par les gravures,
Goya fait plus que le « témoignage d'événements historiques — il fait, dans son travail,
une condamnation sans pitié de la condition humaine. [...] Son œuvre réfléchit [...] la
20
« Quant aux précieuses peintures de Goya, reléguées malheureusement dans des recoins obscurs de la
Galerie [du Musée de Louis-Philippe], Baudelaire ne les mentionne qu’en 1857, dans une note jointe à son
étude sur les Caprices . Mais leur trace est restée vivante dans sa mémoire. [Selon Paul Guinard], il faut en
tenir compte au même titre que des Caprices, lorsqu’on veut définir le « goyisme » baudelairien » (Guinard
1967 : 321).
�10
nature de l’homme lui-même » (Lafuente Ferrari 1962 : I)21. Les tableaux à l'étude, eux,
montrent des violences des sauvages d’Amérique, reflet de la sauvagerie que voit Goya
en Espagne : « il sait maintenant qu’elle peut se tapir à l’intérieur de chacun d’entre
nous » (Todorov 2012 : 166). Goya utilise la figure du cannibale dans ces œuvres comme
une « […] métaphore du caractère irrationnel et prédatorial des rapports humains »
(Singletary 2004 : 50). « [Ces] scènes de cannibalisme [représentent] des sauvages nus,
métaphore de l'être humain universel » (Mena Marqués 2013 : 63). Ces auteurs montrent
Goya en tant que « peintre de la nature humaine » (Wilson Bareau 1994 : 289)22, bien
qu’ils s’accordent pour reconnaître au peintre une posture critique face à la cruauté de
cette nature. Notons que jamais les portraits ou les premières scènes de genre réalisées
par le peintre n’ont suscité une telle interprétation.
Nous ne souhaitons pas reconduire l’évidence selon laquelle les deux œuvres avec
Cannibales seraient des représentations de la nature humaine. Nous désirons creuser à
même le monde que ces tableaux ont à offrir. Il s’agit des premiers exemples en peinture
qui mettent en scène des « sauvages cannibales », figures inspirées par des images
gravées produites à partir du XVIe siècle23
24
. Dans la mesure où ces deux tableaux
constituent bel et bien un écart par rapport à la tradition de la scène de genre25, nous
souhaitons étudier l’horizon iconographique du cannibalisme, lequel était jusqu’alors
étranger à ce genre pictural, ainsi que l’horizon philosophique ayant fait de la nature
humaine son objet, horizon qui est contemporain à Goya. Nous considérons que les deux
21
Notre traduction du passage suivant: « [...] he did more than testify to historical events-- he was to make
in his work a pitiless condemnation of the human condition. [...] His work mirrored [...] the very nature of
Man himself. »
22
La mise en italiques est la nôtre
23
Pour une histoire de la figure du cannibale mise en image à partir du XVIe siècle, voir Le cannibale.
Grandeur et décadence de Frank Lestringant (1994). Ce texte qui rend manifeste un important nombre de
représentations du cannibalisme du « sauvage » et permet de le penser comme objet de la construction de
l’identité de l’Autre, du colonisé, dans les discours occidentaux.
24
Il existe également une peinture coloniale où une scène de cannibalisme apparaît. Il s’agit de l’œuvre de
Jan Van Kessel, Indians as cannibals (Brazil) (1664-1666). Dans la mesure où celle-ci fut produite au
XVIIe siècle, donc après l’époque de production des gravures coloniales qui nous intéressent et dans la
mesure où elle déploie un monde qui leur est de trop près similaire, nous la considérons comme étant un
prolongement du projet des images gravées.
25
Jauss propose de penser l’horizon d’attente d’une œuvre à l’aune de la « série littéraire » ou du genre
auquel il répond, suggérant par ailleurs de rompre avec la tradition littéraire qui fait de la série un objet
situable au sein d’une histoire évolutive et continue de la littérature et ouvrant plutôt sur la découverte « du
rapport d’évolution dialectique entre les fonction et les formes » (Tynianov cité par Jauss 1978 : 70).
�11
œuvres de Goya participent précisément de ces deux horizons spécifiques. En présentant
le cannibalisme en peinture, quel est l’écart que Goya fait surgir dans l’horizon
esthétique, historique et philosophique qui lui est contemporain? Quel legs pouvons-nous
tirer de cet écart en termes de redéfinition des normes de présentations esthétiques ; d’un
positionnement à l’intérieur de la question de la nature humaine ; du rapport de
l’Occident avec l’Autre, qu’il s’agisse ou non du « sauvage », ou encore avec Dieu? Le
but de ce mémoire est de dévoiler la force critique de ces images en tant qu’elles font
reposer sur la figure du « cannibale » (cet Autre cannibale que l’Occident a « découvert »
et inventé à la fois au gré d’interprétations auxquelles Goya n’échappe pas et qu’il s’agit
précisément de critiquer par le biais d’une nouvelle lecture) le vacillement de l’homme à
l’image de Dieu en le confrontant aux limites de sa nature, telle que conceptualisées et
fantasmées du temps de Goya. Dans la réception différée que nous suggérons, se posent
de nouvelles questions qui permettront d’interroger de manière critique la façon dont
l’écart s’est manifesté dans les deux œuvres de Goya.
Dans le premier chapitre, nous procéderons à une présentation descriptive de la
matérialité des tableaux afin de comprendre les actions représentées et d’analyser les
traits formels des images. Nous fournirons ensuite la toute première analyse de leur
fortune crique. Nous nous attarderons d’abord à l’étude approfondie de l’ouvrage de
Charles Yriarte, soit le premier auteur à avoir commenté et catalogué une partie
considérable de l’œuvre peint de Goya, parmi lequel compte le diptyque à l’étude.
Ensuite, nous verrons que les premières interprétations du diptyque l'associent au mythe
des saints martyrs canadiens. Nous éclaircirons cette association en nous fondant sur la
lecture critique du mythe articulée par Guy Laflèche et l’écarterons enfin à titre de
construction iconique et discursive proprement occidentale du cannibalisme. Puis nous
verrons comment le diptyque en vient à être identifié comme représentation de la nature
humaine. Notre contribution repose d’une part sur la première description complète des
tableaux, sur l’analyse jamais faite des rapports entre les temporalités des deux tableaux
et, d’autre part, sur l’identification de l’acteur de la violence cannibale (fondée sur la
matérialité du diptyque). La bibliographie de ce chapitre est majoritairement constituée
de textes ayant pris les deux tableaux pour objet d’étude. En nous y référant
�12
explicitement, nous pouvons ainsi préciser la contribution que nous proposons d'apporter
aux recherches préalables sur ces œuvres au sein du champ de l'histoire de l'art.
Une fois que les contenus des œuvres auront été mis en lumière, nous ferons, dans
le deuxième chapitre, une enquête à caractère anthropologique afin de cerner diverses
fonctions de la représentation du cannibalisme en Occident. C’est précisément cet
horizon que Goya déplace. Ainsi, nous proposerons une révision des images du
cannibalisme datant de l’époque coloniale, soit du XVIe au début du XIXe siècle. Nous
chercherons des « comparables » parmi les trois grandes catégories d’images où apparaît
la figure du cannibale : l’image coloniale, la caricature politique et, à un moindre degré,
l’image mythologique. Afin de penser l’image coloniale, nous nous baserons en grande
partie sur le travail de Frank Lestringant qui a concentré ses recherches sur la
construction discursive et iconique du cannibalisme telle qu'elle s'est constituée à partir
de l'époque coloniale. Nous pourrons ainsi comprendre les tableaux de Goya à l'aune
d’un savoir sur la propagande liée à la colonisation, entreprise qui a marqué l'Espagne en
tant que pays colonialiste. Nous puiserons également dans l'imaginaire de la caricature
anglaise et française, où le cannibalisme a plutôt servi d'instrument satirique et politique
dénonçant la barbarie du civilisé et du révolutionnaire, notamment avec l'aide des
réflexions de Mike Goode et de Catherine Clerc sur la caricature contre Napoléon.
Finalement, nous articulerons une analyse approfondie de l’un des seuls tableaux avec
figure cannibale ayant été produite avant les tableaux de Goya, soit Saturne dévorant son
fils (1636) de Pieter-Paul Rubens. En effet, comme nous voulons le montrer, la gravure,
avec son potentiel d’illustration de textes, de récits, de mémoires de voyage etc.,
constitue autrement le lieu privilégié de la représentation du cannibalisme.
Dans le troisième et dernier chapitre, nous souhaitons penser la notion de nature
humaine à la lumière du sens qui lui était assigné du temps de Goya. Il sera question
d’analyser, et ce en restant au plus près de ce que les tableaux de Goya nous y donnent à
voir, les œuvres philosophiques de Thomas Hobbes et de Jean-Jacques Rousseau,
lesquels articulent de deux manières très différentes le concept en question : alors que
pour le premier, la nature humaine est cruelle, pour le deuxième, elle est
�13
fondamentalement bonne. Les ouvrages Léviathan (Hobbes : 1651) et Le discours sur
l’origine de l’inégalité parmi les hommes (Rousseau : 1755), sur lesquels nous
concentrons notre commentaire, étaient par ailleurs tous deux ornés, au moment de leur
parution, de frontispices éloquemment illustrés. Ainsi, souhaitons-nous non seulement
réfléchir la singularité des tableaux de Goya par rapport à ces images, mais également par
rapport aux figures de pensée qu’introduisent les textes philosophiques. Notre étude
s’articule autour de deux concepts spécifiques : la nature humaine et l’état de nature. La
fin de ce chapitre vise une récapitulation des rapports importants entre les tableaux avec
Cannibales et les horizons iconographique et philosophique. Ainsi, pourrons-nous
démontrer de quelle manière ces œuvres pensent.
Pendant ses dernières années en Espagne, Goya joue avec règles instituées des
« Beaux-Arts », les refusant ou les mettant à l’épreuve. En effet, les tableaux étudiés n’en
sont pas moins des produits de l’Occident. L’indéniable présence de l’Autre ainsi que sa
manifestation singulière au sein des tableaux ne suffisent pas à extraire de leur matérialité
picturale toute entière les traces d’une culture proprement occidentale. L’Autre opère
donc une fonction dans l’œuvre picturale de Goya ainsi que dans la culture dont elle est
issue. Nous souhaitons reconstituer les horizons iconographique et discursif dans lesquels
s’inscrivent les tableaux avec Cannibales afin de pouvoir évaluer leur valeur critique et
afin de permettre à ce mémoire d’en prolonger le travail de pensée.
�14
CHAPITRE 1
L’objet mis à nu : histoire d’un diptyque
On ne peut parfois dire la chose la plus essentielle qu’en
décrivant les contours de ce qui la contient.
- Samuel Beckett
Que donnent à voir ces deux tableaux ? Une étude approfondie de leur dimension
matérielle et de leur fortune critique devrait nous fournir le commencement d'une
réponse. Ce chapitre vise à rendre palpable la valeur d'une méthode où l'image joue une
fonction structurante. Au-delà des savoirs sur l'objet que nous fournira dans un deuxième
temps la fortune critique des tableaux, nous désirons, dans ce premier chapitre, savoir
voir26 l'objet. Cette méthode nous apparaît d’autant plus pertinente que les œuvres de
Goya n’ont été ni titrées, ni datées par Goya lui-même; ce sont elles qui nous servent de
traces et renferment à la fois le problème qui dirige et informe ce mémoire et la
possibilité de faire émerger la question qui nous lie à elles, à travers le temps.
Nous comptons donc procéder en premier lieu à l’analyse des deux tableaux à titre
d’objet à part entière ; à leur mise-à-nu. Nous consacrons la deuxième partie de ce
chapitre à la mise en lumière du sens attribué au diptyque par les historiens de l’art et à
un exercice de décryptage des tendances discursives qui émanent de la fortune critique.
Cette perspective critique nous permettra de constater comment l’objet s’est cristallisé en
tant qu’objet d’un discours institutionnel.
1.1 Histoire matérielle des tableaux
Avant d’étudier la matérialité des tableaux avec Cannibales, nous souhaitons
rappeler les diverses hypothèses concernant leur datation, lesquelles nous permettront de
mieux situer nos réflexions. Ces œuvres n’ont sûrement pas quitté la Maison du sourd
26
Nous empruntons cette expression à Johanne Lamoureux (2007 : 44). « […] Le travail de l'historien de
l'art commence par un savoir-voir, mais [...] ce savoir-voir lui-même exige l'acceptation et le
renouvellement, de plus en plus ardu à mesure que « l'expertise » s'installe, d'un voir-sans-savoir. » C’est
ainsi que nous envisageons le processus de déconstruction historiographique que nous articulons dans ce
chapitre.
�15
avant que Javier Goya, le fils du peintre, ne les vende à Jean Gigoux (1806-1894), donc
avant la mort du jeune Goya, laquelle a lieu en 185427. Ainsi, les tableaux furent gardés
secrets du vivant de Goya, contrairement à d’autres œuvres libérées des contraintes de la
commande, comme celles que Goya a présentées à l’Académie le 11 juillet 1793.
La majorité des historiens acceptent la datation 1800-1808 qu’annonce le Musée
de Besançon, musée où se trouvent actuellement les tableaux. Les causes de cette
datation nous sont données par Gérald Powell. Il insiste sur les ressemblances stylistiques
des tableaux avec quelques scènes de meurtre et de rapt peintes par Goya vers 1798-1800
pour le marquis de la Romana et les « […] similitudes avec certains Caprices gravés
(1797-1798) [qui] ont conduit les spécialistes à dater les Cannibales des années 18001808, donc avant les Désastres de la guerre, qui reprennent avec un force d’autant plus
grande le récit de la cruauté humaine qu’il s’agit, cette fois, de scènes historiques réelles
et contemporaines » (1998 : 202). Seuls quelques historiens ont défendu l’hypothèse
d’une datation plus tardive. Pierre Gassier (1981 : 262) note une ressemblance avec deux
représentations de sauvages créées entre 1808 et 1814. Singletary considère ces tableaux
comme une critique de la dissipation de la raison et de la libération de la propension
prédatoriale de l’homme provoquée par la guerre dont Goya fut le témoin (2004 : 56).
Selon nous, cette fenêtre de datation est plus probable puisque toutes les traces de
violences que nous voyons à l’œuvre dans le diptyque apparaissent également dans les
Désastres de la guerre (pendaison, pénectomie, morcellement etc.), gravures réalisées
entre 1810 et 181528. La datation pourrait être plus tardive encore, et correspondre ainsi
au moment d’une tension qui oppose Goya et Ferdinand VII et mène ultimement ce
dernier à exiler l’artiste en 182429. Enfin le diptyque est presque bichrome, tout comme
les œuvres des murs de la Maison du Sourd, que Goya achète en 1819 et où il peint dans
27
Cette date apparaît dans la biographie de Goya produite par Jeannine Baticle (1992 : 434).
Wilson Bareau (1998 : 288) défend plutôt une ressemblance entre les œuvres avec Cannibales et les
Caprices.
29
Le rapport entre Ferdinand VII et Goya s’avéra fort complexe. C’est pourquoi l’exil ne se fit pas de façon
officielle, mais officieuse, lorsque Goya obtint la permission du roi de prendre quelques mois de « vacances
» au spa Plombières-les-Bains. Cela donna à Goya l’opportunité de quitter l’Espagne devenue dangereuse
pour lui.
28
�16
une liberté totale, soit « pour lui-même». Une datation plus tardive permet de lier les
contenus des œuvres au contexte politique, soit un contexte de censure artistique30.
Goya a peint un nombre considérable d’œuvres à l’huile sur support de bois, soit
au moins trente-huit, dont vingt-cinq ont été produites pendant ou après la guerre31. Étant
surtout affairé à peindre des commandes jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Goya fait un
usage minimal du bois. Ce support ayant parfois servi à des études et esquisses pour la
production d’œuvres plus grandes, comme Le 2 mai 1808 (1814) et Le Christ au Mont
des Oliviers (1819), il est possible que Goya ait voulu faire aboutir au moins quelquesunes des œuvres sur bois en des formats plus grands, sur toile. Il nous apparaît toutefois
plus pertinent d’insister sur le fait que Goya a certainement profité de ce support pour
faire des expérimentations plus libres, sans devoir acheter des toiles au prix beaucoup
plus élevé. Yriarte dit d’ailleurs que Goya « […] n’accordait aucune espèce d’importance
à la matière sur laquelle il peignait. Le premier carton venu, une toile grossière et mal
tendue fixée aux angles à l’aide de quatre clous, du papier très-fort et préparé à l’essence,
des couleurs mal broyées et un couteau à palette, c’était plus qu’il ne lui fallait pour
assouvir sa rage, car il peignait avec furie […] » (1867 : 6).
1.2 L’objet mis à nu : la structure du diptyque
Nous partons de l’hypothèse que les deux œuvres avec Cannibales de Goya
constituent un diptyque, leurs dimensions étant presque équivalentes. Ces œuvres, certes,
se ressemblent sur le plan formel, mais c’est sur le plan structurel que se joue davantage
leur relation. Ce point de départ nous permet de laisser les divers rapports qui lient ces
tableaux orienter notre analyse, rapports qui ont été jusqu’ici entièrement négligés32. Les
notions d’espace, de temporalité et d’objet nous serviront ici d’outils à l’analyse de ces
30
Lors de son retour sur le trône en 1814 (rappelons qu’il avait été remplacé par le frère de Napoléon,
Joseph Bonaparte, depuis l’insurrection espagnole), et donc « après la période du Trienio liberal qui avait
instauré une relative liberté de la presse, Ferdinand VII tente d’interdire tout écrit qu’il juge subversif grâce
à la censure préalable à toute impression et à la vigilance aux frontières » (Journeau 1988 : 212).
31
Nous tenons ces chiffres d’un effort de comptabilisation des tableaux sur support de bois faite à partir des
informations données dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint de Goya (Gassier : 1990).
32
Si ces œuvres ont fait l’objet de plusieurs études et qu’elles sont exposées en paire, elles ont toujours été
analysées et décrites séparément.
�17
divers rapports qui, rappelons-le, se fonde sur l’herméneutique. D’un point de vue de
l’histoire de l’art, nous entendons donc réfléchir l’œuvre en tant qu’elle suspend la
référence au monde qui l’a vu naître pour déployer son monde propre. Les mondes que
déploient ces tableaux demeurent profondément énigmatiques. Ils sont traversés de
tensions qui engendrent, pour leur lecteur, une expérience dynamique et complexe. Nous
ne prétendons pas résoudre cette énigme. Nous souhaitons cependant nous tenir au plus
près de ce qui se donne à voir dans les œuvres. Nous dirons d’abord qu’ils sont des
tableaux de petits formats et que cela participe de leur caractère de scènes de genre.
Plusieurs des auteurs qui ont contribué à alimenter la fortune critique de ces
tableaux en ont fourni une description. Ceux-ci font consensus : le paysage abstrait
(Gérald Powell 1998 : 203, Wilson Bareau 1994 : 289) ou du moins imprécis (Gudiol
1984 : 293)33 de Cannibales montrant des restes humains contraste avec la netteté des
traits des corps des figures. Or, cette tension entre les corps et les paysages relève selon
nous de la spatialité de la représentation que les deux tableaux font émerger. Les
paysages qui en constituent les fonds occupent par ailleurs une part considérable de ces
espaces. Si on peut les qualifier d’abstraits, c’est certes dans la mesure où ces paysages
sont indéterminés si on les compare aux corps et aux accessoires, qui eux, tendent
davantage vers une précision figurative. Cette qualité, cependant, s’estompe lorsque les
frontières entre les paysages et les figures se brouillent. Voyons comment, dans ces deux
tableaux, sont structurés les espaces et comment s’y joue de façons distinctes la
représentation des figures
Les deux tableaux donnent à voir d’odieuses violences que certaines figures
infligent à d’autres. Dans Cannibales montrant des restes humains, neuf figures (si l’on
compte la figure démembrée) se trouvent fortement concentrées dans la partie droite de la
toile. Au sein de cette scène, les figures sont regroupées et s’en prennent à une seule
victime. Trois figures assises en demi-cercle, à l’avant-plan, observent passivement
l’eunuque, au centre, qui concentre l’attention à l’intérieur du tableau comme pour le
33
Notons que Gudiol reconnaît également « […] une simplicité de la représentation […] » et « […] une
imprécision de toutes les formes […] » dans Cannibales préparant leurs victimes.
�18
spectateur. Ce dernier brandit une tête coupée de sa main gauche et une main tranchée de
sa main gauche. Le corps du bourreau, assis sur une roche, les jambes écartées, est
résolument affirmatif : il s’accapare une grande part d’espace. Devant la roche, gisent
d’autres morceaux de corps (des côtes, une jambe). Deux autres figures, sur un plan plus
reculé, regardent également dans la direction de l’eunuque, offrant une expression
similaire aux autres spectateurs. C’est qu’en effet tous semblent abasourdis, éblouis et
désirants. L’un d’eux a d’ailleurs la bouche grande ouverte ; et un autre, la tête penchée,
le corps relâché, se montre docile à la vue de la tête coupée. Qu’attendent tous ces
spectateurs? Nous ne pouvons que tenter de le deviner. Et que font les deux autres figures
en arrière-plan, placées cette fois de dos? Nous ne voyons pas ce qu’ils font; nous
comprendrons bientôt mieux pourquoi.
Dans Cannibales préparant leurs victimes, bourreaux et victimes sont en nombre
plus égal : on ne trouve ici que trois agresseurs pour deux dépouilles. Un homme, debout,
plonge son bras droit dans le corps d’un pendu, au niveau du sexe, en direction de ses
organes intestinaux. Une autre figure fouille dans la chair ouverte de la victime couchée
sur le sol, toujours au niveau de l’entrejambes: elle semble, comme son congénère,
chercher à vider l’intérieur du cadavre. Un troisième bourreau est assis de dos au
spectateur ; son action, elle, est non identifiable. Dans les deux tableaux nous constatons
une même pudeur relative : nudité sans sexes discernables ; corps démembrés sans
cannibalisme ; bourreaux aux actions ambigües : ces tableaux ne montrent pas tout et ce
faisant, ils suggèrent une violence plus grande, outrepassant les actions mises en scène.
Au même titre que les bourreaux, malgré leur caractère stérile et minéral, les
paysages agissent à titre de forces transformatrices sur certains corps. Présentant tous
deux une composition bichromatique, ces tableaux rappellent ainsi quelques gravures de
Goya et tout particulièrement celles des Désastres de la guerre34. Les fonds de ces deux
œuvres dévoilent toutefois des organisations distinctes. Dans Cannibales montrant des
restes humains, le paysage est divisé presque de moitié entre un lavis de taches brossées,
34
Nous nous opposons donc au rapprochement de ces tableaux avec les Caprices que suggère Wilson
Bareau (1992 : 288) où les fonds sont presque toujours noircis. C’est dans les Désastres qu’apparaissent
des fonds blancs. Cela renforce la possibilité d’une datation tardive, telle qu’énoncée précédemment.
�19
obscures, aux teintes verdâtres et bleutées, situées au côté droit et un blanc parsemé de
taches légèrement grisâtres couvrant la partie gauche. La profondeur du paysage est pour
ainsi dire double : profondeur de l’horizon à travers laquelle la lumière se réalise
pleinement ; profondeur du boisé ainsi suggérée par la couleur verte et la branche qui se
distingue du tas de taches. L’enfoncement de la composition génère un espace incurvé,
convexe, et dont la rondeur est accentuée par la disposition des corps. Au sein de cette
organisation, l’amas foncé garde son autonomie et sa relative opacité par rapport à la
lumière du tableau. En effet, il ne constitue pas un continuum de l’action de la lumière35 :
il empiète sur le fond clair lumineux ou s’y dissout. Même l’intensité du feu situé en bas
à droite — si l’on s’en tient objectivement aux effets lumineux que devraient produire ses
flammes – est étouffée par les taches foncées. Ces dernières ne sont point subordonnées à
la logique d’une représentation objective, au gré de laquelle l’ombre serait obstruction de
la lumière par un objet. Le noir coloré, qui est lui-même habité de tensions entre le bleu,
le vert et le brun, nuit à la visibilité de certaines parties de la scène. Ces taches brouillent
par ailleurs les contours de certains corps36. L’homme situé complètement à droite se
mélange avec le fond sombre et coloré. Au niveau de sa tête, de sa hanche et de son
coude droit, son traitement en volume est compromis. La figure située directement à
gauche, est carrément bidimensionnelle, composée d’un brun qui suggère, tout-au-plus,
les traits de son visage et de son corps. Même les contours des deux hommes situés près
d’eux se brouillent. L’amas de couleurs qui constitue cette part de paysage se présente
ainsi comme une force dévorante agissant sur les corps qui s’en trouvent rapprochés ; elle
les rend indiscernables. Cette force est la nature même : un boisé toutefois confus, au
caractère onirique. Les corps, qui tous ensemble, avec la branche, forment un triangle,
articulent les lignes cadencées du tableau et les dirigent vers cet amas sombre. Notons
que la branche forme le signe évident de l’analogie que Goya met ici en scène, liant la
nature et les figures. Elle longe, de par ses courbes et sur un plan plus élevé qu’elles, les
courbes des bras étendus de l’eunuque. La bichromie organise tout le tableau : la pilosité
35
Voir Payant (1987 : 210) sur la lumière comme agent et sur la description du « […] travail de l’agent sur
l’objet visé » afin de cerner la technicité de l’approche descriptive appliquée ici par rapport à la lumière.
36
Les traces des contours du dessin sont pour ainsi dire niées par le jeu bichromatique, bien qu’elles soient
conservées au premier plan ; elles ne disparaissent pas absolument. Goya, bien qu’il soit un coloriste,
n’évacue pas pour autant le dessin de son processus de création picturale. L’étude technique de Portrait
équestre de Ferdinand VII (1808) de Miriam Bueso (2008 :27-28) permet en effet de constater les traces de
dessins à même le tableau.
�20
foncée, contraste avec la chair pâle, laquelle occupe une place dominante dans l’espace
du tableau, au même titre que le blanc jaunâtre du fond. Lorsque les corps sont obscurcis
par le fond sombre, ce sont eux qui font ressortir les corps aux chairs claires. Les figures
se manifestent alors comme une part intrinsèque de la nature.
Dans Cannibales préparant leurs victimes, la composition est beaucoup plus
élémentaire, plus dépouillée. La profondeur est moindre. Une ligne ondulée et
transversale délimite le cadre avec d’un côté, une zone blanche jaunâtre et de l’autre, un
plan suggérant une surface rocheuse. Les figures forment un triangle virtuel qui englobe
jusqu’au tas de vêtements jonchant le sol et dont l’un des sommets donne sur une zone
ombragée, en bas à droite. La zone foncée occupe ici une fraction minime de la toile. Elle
présente en effet une ombre, effet de la lumière ainsi bloquée par le corps du bourreau
situé debout. À partir de ce point d’ombre, le regard en vient rapidement à longer ensuite
les corps et les vêtements suivant la forme triangulaire, puis le fond rocheux, et plonge
enfin dans l’extrême blancheur jaunâtre situé à droite. Si les accessoires sont dispersés
jusque dans cette zone vide, les corps, eux, demeurent confinés du côté de la paroi
rocheuse. Cette composition est plus épurée que celle du tableau précédemment analysé
et le jeu bichromatique qu’elle met en scène est beaucoup plus subtil. Le paysage ne s’en
prend d’ailleurs ici qu’aux victimes. Ce ne sont pas ici les contours et les lignes du corps
qui sont affectés, mais la chair même. Voyons comment cela s’opère.
Il est facile de constater, dans Cannibales préparant leurs victimes, le procès des
effets de la lumière sur la surface rocheuse : celle-ci produit une blancheur sur l’extrémité
gauche, décroit à mesure qu’elle rencontre des obstacles et se transforme en zone plus
ombragée. Remarquons qu’à mi-chemin, se produit un phénomène indépendant des effets
de la lumière et que l’on pourrait qualifier d’inexplicable. Les couleurs de la chair
cadavérique du pendu se révèlent presque identiques à celles de la surface rocheuse : seul
le rouge du sang marque une distinction évidente entre la chair et le fond. De la même
manière, le corps blanc rappelle fortement la zone gauche du tableau. Ce premier blanc
est toutefois légèrement différent : il est d’une blancheur de chair. La similitude liant les
tons des corps et ceux des paysages fait écho à la bichromie du paysage. Les corps des
victimes, symétriques, entretiennent avec le paysage une analogie frappante : ils sont
�21
ainsi mis en emphase. Ici, les corps deviennent paysage et tendent vers l’abstraction :
autrement dit, un paysage fait corps au sein même de l’espace visible. Afin de bien voir
en quoi ce travail de la bichromie est singulier au sein de la représentation, remarquons
que Goya semble avoir usé d’une même palette pour les trois êtres vivants. Les corps des
bourreaux sont plus rouges, jaunes ou bronzés que les autres, ce qui suggère à la fois une
vitalité et l’exposition au soleil. Ils ont l’habitude de la nudité, de l’état naturel que sousentend leur nudité dans un tel contexte. Les victimes sont plutôt déterminées par les
paysages de façon immédiate : leur relation avec la nature les intègre radicalement dans
l’espace de la représentation.
Dans Cannibales montrant des restes humains, un amas de taches de couleurs
institue, au sein de la représentation, un espace ambigu et évocateur. La bichromie
produit ici une profondeur qui appelle à l’abstraction d’un monde imaginaire quoique
naturel, s’opposant à une scène de jour réaliste. Les figures se ressemblent : leur couleurs
sont indistinctes, sauf lorsque la chair de certaines d’entre elles est altérée par la présence
de l’amas sombre et rêvé. Dans Cannibales préparant leurs victimes, l’action est toute
entière donnée dans l’espace visible de l’image. Ainsi, le caractère imaginaire de ce
tableau est-il moindre. L’action libre de la bichromie produit ici une réciprocité
immédiate entre la nature et les deux victimes. De plus, les lieux sont tout aussi
indistincts, sinistres et angoissants. Ils sont soustraits à toute information relative à leur
situation géographique, nationale – ils sont des lieux fantasmés.
Ce caractère fantasmatique a pour effet de brouiller le temps historique de ces
œuvres. Quand l’action de ces œuvres se produit-elle ? Leur temps est-il déterminé
historiquement? Peut-on dire que l’action de ces deux tableaux se joue dans un temps
partagé ? Dans les deux cas, la durée des actions est floue et les éléments qui forment leur
environnement ne donnent presque aucuns repères historiques. Seuls les objets jonchant
leurs sols sont susceptibles de nous situer et d’apporter quelques précisions sur une
possible représentation datée. Dans Cannibales montrant des restes humains, se trouvent
un feu et une lance. Bien que cette dernière « […] connut une vogue nouvelle en Europe
Occidentale lorsque Napoléon l’adopta pour sa Grande Armée » (Diagram Group 1982 :
�22
57)37, elle est reconnue comme une arme archaïque au moins depuis le XVIe siècle.
Comme le prouvent notamment les représentations coloniales de Théodore de Bry
(Figure 3), elle était également utilisée par les sociétés dites « primitives », au même titre
que le feu en pyramide. La lance est ici grossière, peu détaillée, contrairement à nombre
de lances européennes, raffinées au gré d’un procès de sophistication de l’arme d’hast
(Ibid.: 56-59). Cela nous permet d’associer ce tableau à un monde primitif,
historiquement indéterminé, et ce, d’autant plus, si on le compare à Cannibales préparant
leurs victimes, où l’apanage est constitué d’objets européens contemporains à Goya.
D’abord, l’objet situé en bas à droite du tableau, lequel ne ressemble à rien vu de loin, a
de près l’apparence et la forme d’une arquebuse ou d’une escopette38. La chaussure, de
semelle fine, qui semble être de cuir, parée d’une boucle de métal, est soit une
importation ou l’imitation d’un modèle anglais inventé en 1780 et produit au moins
jusqu’en 1795 (Figure 4). Le chapeau ressemble également à un modèle anglais
couramment qualifié de chapeau à la charbonnière (Figure 5). Ces divers accessoires,
ainsi disposés dans les tableaux, indiquent deux temps distincts dont un seul paraît
relever de l’histoire alors que l’autre ne donne à voir aucun marqueur de temps.39
L’espace onirique de Cannibalisme montrant des restes évoque le fantasme d’un espace
37
La lance apparaît d’ailleurs dans nombre d’œuvres néoclassiques, comme dans Le Serment des Horaces
de Jacques-Louis David. La lance, dans le Serment des Horaces, rappelle davantage la lance grécoromaine, alors qu’ici, étant moins détaillée, elle rappelle une lance primitive. Le passé classique de David
semble ici s’opposer au passé primitif de Goya. Carol Doyon (1991) a bien démontré que David et Goya
sont tous deux reconnus comme des artistes emblématiques de la Révolution. Alors qu’on reconnaît à
David un académisme très fortement critiqué, Goya est plutôt compris comme l’artiste ayant inventé
l’intériorité romantique. Cette distinction doit cependant être relativisée : « La situation de David nous
paraît foncièrement ambigüe. Parce qu’on le présente en opposition à Goya, on le juge en fonction des
nouvelles normes instaurées par le peintre espagnol. Il se trouve alors victime d’une sorte d’anachronisme »
(Doyon 1991 : 217).
38
Goya possède certainement une escopette, non seulement parce qu’il chasse, mais aussi parce qu’il dit
tenter de faire réparer celle de Martin Zapater dans leur correspondance et ne confirme jamais avoir réussi à
le faire. « Hier j’ai été chez l’arquebusier voir ce qu’il en était pour l’escopette ; personne ne veut l’acheter
sous prétexte qu’elle est trop grande. Ici personne n’utilise de grande escopette et en plus, le canon est
endommagé à l’intérieur comme je te l’ai déjà dit » (Goya 1988 : 85). Il tente ensuite de la faire réparer, n’y
parvient pas et ne laisse pas de traces d’un renvoi de l’arme à son propriétaire (Ibid. : 88).
39
Goya a produit, à quelques reprises, des tableaux formant des séries et fonctionnant de manière évidente
sur le mode de la narration, comme Le Bandit de Maragato. Dans cette série en six tableaux, le bandit tente
de commettre un vol, mais sa victime parvient à le déjouer et le ligote ; les diverses actions sont effectuées
dans un temps très bref ; l’environnement des tableaux ne laissent nullement douter que l’anecdote se
déroule dans une temporalité plus ou moins actuelle par rapport à leur production. Jeannine Baticle (1986 :
94) dira de cette série « moderne », que son développement se présente comme une « séquence
cinématographique ».
�23
atemporel alors que celui de Cannibales préparant leurs victimes suggère plutôt le
fantasme d’un temps contemporain hanté par la cruauté à titre d’invariant d’une nature de
l’homme.
Figure 3. Gravure tirée de l’ouvrage de Théodore de Bry, « Discipline militaire d’Outtina pour aller au
combat », Grands Voyages, 1613.
Figure 4. Chaussure anglaise, v. 1780-1795.40
Figure 5. Chapeau anglais, v. la fin du XVIIIe.41
L’idée d’une nature humaine cruelle dont le cannibalisme serait l’expression
ultime et originaire suffit-elle à rendre compte de l’objet de ce diptyque? Mais qui donc
mange ? Et qui est mangé ? Personne ne l’est; le diptyque suggère plutôt un cannibalisme
virtuel. Pourquoi dire que l’objet de ce tableau est la nature cruelle de l’Homme, ou
encore sa violence originaire, alors que seules certaines des figures sont ici coupables de
cette violence que d’autres se doivent de subir ? Dans Cannibales montrant des restes
humains, les figures n’ont pas d’identité assignable autre que celle de « sauvages »,
40
« Anglaise, v. 1780-1795. Semelle fine en cuir, bout pointu, tige en cuir fin, lanières avec une grosse
boucle sur une languette courte » (Peacock 2005 : 57). 40
41
« In England the tricorne was, at least in some quarters, losing favour, and most of the young men in
George Morland’s pictures are painted with a round beaver hat having a brim of medium width, firm flat
crown, and buckled bands placed one above the other » (Amphlett 1974: 125-126).
�24
puisqu’elles sont nues. Dans Cannibales préparant leurs victimes, cependant, et ce même
si toutes les figures restent nues, les habits confusément disposés à l’avant-plan indiquent
la présence d’un tout autre genre de figures, à l’identité, cette fois, parfaitement
reconnaissable. Ces vêtements, en effet, ne sauraient appartenir qu’à des nobles ou à des
bourgeois – autrement dit à des membres de l’élite sociale42. Or, si la vision de ces
vêtements renvoie bel et bien à l’invisible présence de telles figures dans la scène
cannibale, elle ne nous dit rien quant au rôle joué par ces dernières dans l’acte
anthropophage à proprement parler : c’est bien plutôt la différence des couleurs de peaux
des figures qui nous informe quant à leur identité, quant à leur différence de classe. Si les
bourreaux ont la peau foncée, une des victimes, elle, a une carnation très claire.
Sous l’Ancien Régime et encore dans la première moitié du XIXe siècle, les personnes
appartenant à l’aristocratie ou à la « bonne société » se doivent d’avoir la peau plus claire et
la plus unie possible afin de ne pas être confondues avec les paysans. Ces derniers,
travaillant au grand air et au soleil, ont en effet un teint cuivré, une peau rubiconde, parfois
semée de taches foncées […]. Être bien né, c’est alors avoir « le sang bleu », c’est-à-dire
avoir la peau si pâle et si translucide qu’elle laisse deviner les veines (Pastoureau 2008 :
196-197).
Les couleurs de peau indiquent que ce sont les « sauvages » qui mangent les
nobles43. Or que dire de l’autre victime dont la peau est visiblement foncée ? Selon nous,
la chair du pendu incarne le devenir de la victime blanche vers un stade plus avancé de
décomposition. Ainsi, les couleurs des peaux des victimes ont-elles au moins deux
fonctions. D’abord, elles permettent l’identification de leur classe sociale. De plus, elles
indiquent, en se fondant dans le paysage, un souci d’atténuer le scandale de la violence
représentée, en affaiblissant la distinction entre la figure et son fond. Les cadavres, dans
ce tableau, n’attendent nul tombeau, nulle sépulture « civilisée » : leur chair est tout au
plus promise à l’estomac des bourreaux et leurs os, à la terre. Ainsi, il s’agit d’une mort
précise, celle que réserve l’anthropophagie en contexte « sauvage ». Dépossédés de leurs
42
Cet apparat, dont seuls deux éléments sont clairement identifiables, appartient hors de tous doutes à un
ou des membres de classes privilégiées. Nombre de portraits de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe
le prouvent. La chaussure est portée par Luis Maria de Borbon (Goya, 1793), Charles IV (Goya, 1800),
Don Gaspar de Jovellanos (Goya, 1798) mais également par Antoine-Laurent Lavoisier (David, 1788) et
Napoléon (David, 1812), pour ne nommer que ces quelques exemples. Malgré les diverses possibilités
ouvertes par cet éventail d’exemples, nous employons le mot « noble » en nous référant aux figures en
question par souci de concision.
43
Malgré l’indétermination de l’identité exacte des victimes causées par un manque de détails, nous ferons
dorénavant usage du terme « noble » à titre d’équivalent sémantique de « homme d’élite ».
�25
vêtements, de leur statut social, les hommes d’élite sont ici réduits à de la viande
consommable. Puisqu’il y a cannibalisme virtuel, il y a assimilation métaphorique de la
noblesse déclassée par la sauvagerie. La question de la classe sociale est donc essentielle
à la compréhension de l’objet de ce tableau.
Notons cependant que le rapport qui lie les figures ne relève pas uniquement d’un
rapport de classe ; il se traduit également dans les termes d’une relation liant l’homme
civilisé au sauvage. Or comme le paysage, les différentes figures sont anonymes : nous ne
saurions dire si ces scènes se produisent en Espagne ou sur une terre colonisée. Leur lieu
réel est à proprement parler indéterminé et donc sans importance. Nous retenons par
ailleurs le caractère métaphorique du rapport de force des figures qui est mis en scène, en
un lieu fantasmé, hors de la civilisation. Le rapport de force met la notion de nature
humaine en tension, laquelle sous-entend plutôt une universalité du genre humain. La
fusion entre le noble, le plus civilisé d’entre les hommes, et le « cannibale », le plus
sauvage d’entre eux, est d’autant plus significative que la notion même d’« humanité » a
longtemps marqué le terme de leur séparation, de leur différence de nature44.
S’adjoignent ici deux conceptions de la naturaleza données dans le Diccionario de la
Real Academia Española de 1803 (579) : la nature comme relevant de l’espèce, du genre,
de la classe et la nature que partagent tous les hommes (la naturaleza humana). Le
tableau Cannibales montrant des restes humains ouvre sur une nature originelle et
universelle de l’homme et Cannibales préparant leurs victimes ramène des hommes
44
Éric Michaud (2015) a bien montré comment cette dite différence de nature est constitutive de la
légitimation de la colonisation, mais aussi de la production des discours racistes portant sur la concordance
entre constitution physionomique et production artistique. L’œuvre de Goya ne rend certes pas compte de
la beauté supérieure de l’homme d’élite blanc. Elle le mêle à la chair foncée, à la surface rocheuse brune et
grisâtre. Elle nie l’idée selon laquelle l’infériorité des races à peau foncée relève d’une infériorité de nature
alors que « […] la civilisation supérieure de la race blanche n’est le produit d’aucune circonstance
extérieure, ni d’aucun hasard heureux ; elle résulte donc de sa nature, elle vient de la supériorité de sa
conformation » (Dunoyer cité par Michaud 2015 : 111). Michaud (2015 : 106) se fonde notamment sur les
textes de Wincklemann, lequel louait l’absolue supériorité physique et donc raciale et artistique des grecs,
mais aussi sur les textes de Lavater chez qui la nature belle dépendrait plutôt « […] de l’imitation du Christ,
du Dieu fait homme […] ». Goya a probablement bien connu les idées du physionomiste, car ses textes
étaient lus par les Ilustrados d’Espagne, que le peintre a fréquentés. « […] Plusieurs d’entre eux, dont
Moratin, faisaient partie d’une curieuse société madrilène, celle des Acalophiles, ou amants de la laideur.
[…] Ils connaissaient comme Debucourt, comme Gillray et Rowlandson, les gros volumes de la
Physiognomie de Lavater, et les étudiaient. […] Les Caprices ont [d’ailleurs] été approuvés et même
apostillés par les acalophiles » (Adhémar 170).
�26
d’élite, figures sans visages, à cette nature. Car, la rencontre fusionnelle entre « noble » et
« sauvage » ne se joue pas sur la seule scène des Cannibales préparant leurs victimes,
mais dans la mise en relation des deux tableaux aux mangeurs d’hommes. À elles deux,
ces œuvres portent l’hypothèse en miroir d’une origine naturelle de l’homme, dont
témoigne le primitif ou le sauvage ainsi fantasmé, et d’une nature originaire de l’homme,
toujours à même de resurgir. Ici, elle s’en prend à l’homme civilisé lui-même, homme
d’élite en l’occurrence.
Ce n’est certes pas la première fois que Goya peint des figures provenant de
diverses classes sociales au sein d’un même tableau. Mais ce diptyque n’a rien à voir
avec les œuvres à teneur propagandiste de la chambre à diner du roi, où la mixité sociale
est expérimentée dans la joie, du moins par le noble, puisque la distinction de classe n’en
est pas affectée (Figure 6). D’ailleurs, les deux tableaux avec Cannibales sont peut-être,
dans l’œuvre de Goya, les seuls exemples en peinture où des nobles sont victimes d’une
telle violence45. L’objet de ce diptyque repose donc sur le renversement du pouvoir
social par le pouvoir de la nature46. Au-delà d’un jeu formel confrontant l’homme et sa
nature, ce diptyque met en scène une métaphore d’ordre social et politique.
45
Même dans certaines des gravures de la série des Caprices, les figures que l’on peut associer à l’élite,
grâce à des signes reconnaissables (vêtements, coiffures etc.) sont tout au plus tournées en dérision. Parmi
les nombreuses gravures qui nous servent d’exemples, en voici quelques-unes : Qual la descañonan
(Planche 21), Pobrecitas (Planche 22), Duendecitos (Planche 49), Unos a otros (Planche 77).
46
Rappelons que chez Freud, l’acte cannibale primitif correspond à une appropriation symbolique du
pouvoir de l’être mangé par le mangeur. « Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le
père, ce qui a mis fin à l’existence de la horde paternelle. […] Par l’acte d’absorption, ils réalisaient leur
identification avec lui, s’appropriaient chacun une partie de sa force » (Freud 1965 : 213). Cet exemple,
tiré de Totem et tabou, est d’autant plus significatif pour notre analyse qu’il concerne l’absorption du père
par les enfants et donc du grand par le petit. Un tel rapport se traduit ici par une relation d’ordre symbolique
liant le social et l’en-deçà.
�27
Figure 6. Francisco de Goya y Lucientes, Automne, 1786.
1.3 Le Goya nationaliste de Charles Yriarte
La description des tableaux qui précède butait contre la difficulté de déchiffrer
certains aspects et certains éléments des scènes représentées. Il sera donc intéressant de
constater le sort que l’historiographie réserve à ce diptyque et les explications qu’elle en a
proposées. L’étude de la fortune critique des tableaux en question nous permet de
constater que les auteurs qui l’ont produite ne s’accordent pas sur l’identité des figures
qui commettent la violence cannibale. Nous distinguons, au sein de cette fortune critique,
deux grands schémas interprétatifs, lesquels proposent une lecture différente de la
dynamique de la violence dans ces tableaux. Le premier fait de l’Autre, de l’Indien, le
bourreau de la violence cannibale alors que le deuxième y reconnait le cannibale comme
figure de la nature humaine universelle. Avant d’étudier plus avant ces interprétations,
nous souhaitons « revisiter » l’ouvrage de Charles Yriarte où apparaissent pour la
première fois les tableaux en question afin de faire émerger le fondement nationaliste de
la fortune critique avec laquelle nous travaillons et d’illustrer ensuite, le déploiement de
ses échos.
Charles Yriarte, Espagnol d’origine et homme de lettre français, a consacré une
partie considérable de ses efforts à la transmission de savoirs sur la culture et l’art
�28
espagnols. Après Laurent Matheron (1858), il écrit Goya (1867)47, soit la deuxième
biographie jamais rédigée sur le peintre. Dans le même ouvrage, il présente la première
tentative d’un catalogue général de l’œuvre peint de l’artiste48, et où figure pour la
première fois le diptyque à l’étude. Ces savoirs nouveaux visent la découverte plus
complète de la « personnalité artistique de Goya » (Yriarte 1867 : I), laquelle est
jusqu’alors avant tout connue à travers ses gravures et plus exactement les Caprices, du
moins auprès des populations non espagnoles d’Europe49. Yriarte affirme vouloir
dépasser l’étude de Matheron et la perspective qu’elle ouvre sur l’œuvre de Goya. Ce
dépassement est motivé par l’accès à certains lieux et documents dont Yriarte a bénéficié
lors de son voyage en Espagne50. Il est le premier auteur à rédiger sur l’œuvre peint de
Goya un commentaire général fondé sur une connaissance détaillée de son œuvre
plastique et il est sans doute, à ce jour, le plus cité des auteurs ayant commenté cet œuvre.
Yriarte sépare d’emblée l’œuvre de Goya en deux, entre les grandes et les petites
toiles51:
Si Goya néglige parfois la forme, casse les mouvements et commence un geste qu’il ne
finit pas, défaillances trop nombreuses dans son œuvre, ce n’est point dans ses grandes
peintures qu’il faut chercher des exemples de ce manque de conscience, que nous
accuserons sans faiblesse, dans l’étude des tableaux de chevalet (Ibid.: 5).
À l’aune d’un tel schéma, il nous paraît évident que le diptyque appartient à la
deuxième catégorie, son contenu et ses caractéristiques répondant aux idées que
développe l’auteur des toiles mineures. Si Yriarte fait sans peine l’éloge des grandes
toiles, il s’efforce de justifier les faiblesses des autres. Cette justification se décline en
47
Le titre complet de l’ouvrage de Yriarte sur Goya est: Goya: Sa biographie, les fresques, les toiles, les
tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l’œuvre avec cinquante planches inédites”.
48
La période couverte dans le catalogue d’Yriarte est très large, soit de 1756 à 1828.
49
Jean-Louis Augé (2014 : 78) écrit à ce sujet : « ³[…] Le maître espagnol va jouir grâce aux Caprices,
édités en 1799, d’une notoriété teintée d’une aura sulfureuse. Le fameux recueil des quatre-vingts planches
sera vite connu en France, apprécié par ses qualités techniques et ses propos philosophiques mais aussi
anticonformistes ».
50
Ce privilège fut probablement facilité par le fait que le grand-père de Charles Yriarte a été secrétaire de
l’Académie des Beaux-Arts de Madrid (Soubeyroux 2011 : 11). « Nous avons parcouru les cathédrales, les
couvents, les palais, les quintas de toute l’Espagne depuis Saragosse jusqu’à Valence, et nous avons choisi
les toiles qui pouvaient donner l’idée la plus juste de l’originalité et de la variété de ce singulier artiste »
(Yriarte 1867 : I). Il en va de même en ce qui concerne l’accès de l’auteur aux « […] archives du palais de
Madrid, celles du duc d’Albes et celles d’Osuna » (Ibid. : I) et de l’octroi des multiples permissions de
photographier les œuvres cataloguées.
51
Cette catégorisation n’est pas à chercher dans le catalogue, lequel organise les œuvres en identifiant leurs
divers propriétaires. Elle s’inscrit plutôt dans le déploiement du texte même.
�29
trois temps. D’abord, il affirme que chez Goya, les égarements plastiques découlent du
fait que l’idée a le primat sur la peinture; elle dicte le trait souvent effectué « sans grand
effort artistique » (Ibid. : 2). L’auteur insiste en ce sens davantage sur le lien
d’appartenance de Goya au projet des encyclopédistes français que sur la proximité
plastique de son œuvre à celle d’artistes de renom comme Rembrandt et Velasquez, dont
Goya revendique l’influence au premier chef. Ensuite, la vitesse, la rage et l’intensité
avec lesquelles Goya peint sont, pour l’auteur, les principaux facteurs de déformation
d’éléments picturaux et d’une dilettante plastique. Il reconnaît toutefois que si le peintre
« [...] se fut attardé dans l’exécution, il aurait perdu sa fougue et son génie » (Ibid. : 83).
Enfin, Yriarte défend la vigueur nationale de Goya et excuse par là l’étrangeté de ses
formes. Goya, peintre « libéral », peintre emblématique de la « Révolution » en Espagne,
est présenté avant tout comme « peintre national ». « [...] Comment aurait-il pénétré le
sens intime des choses nationales, sans s’en imprégner comme il l’a fait? Un grand artiste
ne se mêle pas impunément à la vie populaire, il incarne en lui le génie d’une nation et
devient un type » (Ibid. : 29). Nous comprenons bien en quoi ces trois facteurs se
renvoient les uns aux autres pour Yriarte. Goya affairé à rendre compte de la réalité d’un
peuple dut se livrer en vitesse à l’exécution d’œuvres qui reflètent la question nationale.
La violence cannibale ne trouve d’autre raison d’être, en cet ouvrage, que la cause
nationale. Or, Yriarte élabore un discours qui prend rarement en considération la
matérialité d’œuvres peintes ou de gravures en particulier ; il parvient ainsi à défendre
une lecture à teneur idéologique de l’œuvre de Goya. De façon générale, ce sont la
déformation picturale et la violence, typiques de l’œuvre tardive de Goya et fortement
influencées par l’exercice de la gravure « nationale » (Ibid. : 103)52 qui, pour Yriarte,
contribue à élever la peinture de l’artiste au rang de l’art.
52
Yriarte commente ainsi les gravures, lesquels porte la même « indépendance » que celle qu’il constate
dans son œuvre peint (1867 : 102) : « […] lorsque quelques traits gravés à la hâte par un génie fortement
imbu du mouvement, des passions et des idées de son époque viennent à tomber sous les yeux de celui qui
étudie l’histoire politique, morale ou religieuse d’une nation, et la lui révèlent sous un jour particulier, la
feuille gravée devient archive […]. Souvent, presque toujours, le cri poussé par Goya est le cri national ;
c’est pour ainsi dire un cri symbolique, c’est tout un ordre d’idées qui demande à trouver sa formule, et on
connaît mal l’histoire des époques tourmentées que Goya a traversées, de 1766 à 1828, si on n’a pas
feuilleté son œuvre gravée » (Ibid. : 103). Plus loin, Yriarte ajoute : « […] Goya n’a point ce tempérament
léger qui sourit à l’échafaud et aux restaurations sanglantes ; il déchire, il enfonce le trait jusqu’au cœur »
(Ibid. : 104).
�30
L’ouvrage de Yriarte est adressé à l’Académie Royale des Nobles Arts de San
Fernando et vise à démontrer que Goya, « [...] sans mériter qu’on associe son nom à celui
des grands maitres de la Renaissance [...] a assez fait pour mériter cependant une belle
place dans l’école » (Ibid.: 2). L’étude de l’auteur participe d’un jeu institutionnel ;
Yriarte souligne le caractère nationaliste de l’œuvre de Goya dans une visée stratégique.
Il entend faire reconnaître Goya « peintre » par l’Académie régulatrice des savoirs sur
l’art, alors en cours de transformation53.
Les réflexions de Éric Michaud nous aident à mieux saisir, a posteriori, la valeur
épistémologique de la proposition de Yriarte, laquelle date de 1867, époque où se
manifeste « […] la brutalité avec laquelle chacun des pays d’Europe s’appropriait et
naturalisait ses héros [répondant] évidemment au désir d’établir la continuité historique
du génie national. Mais on escomptait surtout que les grandes figures, qui devaient
incarner ce génie, seraient les mieux capable de susciter l’identification populaire »
(Michaud 2005 : 69). Yriarte fait de Goya un « génie national » et de la figure du peuple,
celle devant laquelle l’artiste est responsable en droit, s’accordant ainsi avec une tradition
discursive productrice de tels génies. D’ailleurs, au sein de ces constructions discursives
et institutionnelles, l’Espagne fait pâle figure. En effet, Yriarte s’intéresse à une nation
qui peine alors à être reconnue comme puissance mondiale par le reste de l’Europe.
Lorsque Ferdinand VII décède en 1833 et que l’absolutisme tombe avec lui, un regain
d’intérêt envers l’Espagne se manifeste en Europe, mais avant tout pour ses productions
littéraires et artistiques. En de telles circonstances, parler de Goya apparaît comme une
occasion favorable de faire valoir la richesse nationale du pays54. Or, nous avons bien
53
Nous savons que Goya ne fut pas immédiatement reconnu par les institutions artistiques espagnoles après
sa mort. « Les milieux académiques tenant de l’art officiel ne l’estimaient guère, en particulier la famille
Madrazo qui a régné durant la quasi-totalité du XIXe siècle sur le musée royal (le musée du Prado) et
l’Académie des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid. Ceci s’explique par le fait que Goya, par sa facture
picturale, se démarquait du système des Beaux-arts sans être véritablement un préromantique. De plus, son
attachement aux idées des Lumières, très affirmée dans ses gravures et en premier lieu Les Caprices n’a pas
favorisé cette reconnaissance […] dans son propre pays fortement marqué par l’absolutisme jusqu’à la fin
du règne de Ferdinand VII » (Augé 2014 : 78).
54
Nous tirons les informations concernant le regard que l’Europe porte sur l’Espagne du livre Napoleon
and the Birth of Modern Spain de Gabriel H. Lovett (1965 : 844). « By 1824 the Spanish American
colonies were lost with the exception of Cuba and Puerto Rico, and Spain was beginning to be regarded
more as an object of curiosity than as a world power. By the time Fernando died (1833) European interest
in Spain had revived, but it was more the interest of the literary and artists than that of a statesmen ».
�31
montré que le sens associé aux tableaux avec Cannibales ne peut que difficilement
contribuer à une telle configuration discursive. En ce qui concerne le reste du corpus
historiographique qui nous intéresse, le lien entre nationalisme, violence et les œuvres
étudiées n’est pas analysé. On n’y mentionne d’ailleurs Yriarte que pour souligner le fait
qu’il fut le premier à cataloguer le diptyque.
1.4 La curieuse mise en rapport entre le mythe des Saints Martyrs canadiens
et le diptyque avec Cannibales55
Dans le catalogue produit par Yriarte (1867 : 151), les deux œuvres qui nous
intéressent portent les titres J’en ai mangé et L’archevêque de Québec56. Sánchez Cantón
(1946) modifie ces titres quelques années plus tard, donnant ainsi naissance à une
mystérieuse association des tableaux à un événement historique, association qui se ne
sera pas démentie avant 1994, soit l’année de publication du catalogue d’exposition
Goya : Truth and Fantasy : The Small Paintings. Sánchez Cantón identifie en effet les
tableaux en tant que représentation de l’assassinat par des Iroquois de Jean de Brébeuf et
Jérôme Lallemant, événement qui se produit sur les territoires de la Nouvelle-France en
1649 (Gérald Powell 202 : 38)57. Alors que le passage d’une identification à l’autre se
fonde sur un malentendu, des traces de la première hypothèse, elle-même erronée, sont
maintenues58; les deux interprétations suggèrent que des figures ecclésiastiques sont
présentes dans le diptyque de Goya. Nous commençons à voir agir la subtile progression
55
L’expression « Saints martyrs canadiens » ne sera pas officialisée avant 1930, au moment de la
proclamation de leur canonisation, puisqu’avant cette époque, « [...] il n’y avait jamais eu de canonisation
de groupe de saints » (Laflèche 1988: 305). Cela participe à expliquer pourquoi le terme « saint » ne figure
pas dans la fortune critique des œuvres qui nous intéressent.
56
Il est fort probable qu’il s’agit des titres qu’avait donné ou retenu Jean Gigoux, l’artiste qui possédait le
diptyque avant d’en faire la donation au Musée de Besançon en 1896 (Gérald Powell 1998 : 202). Puisque
ces titres ne sont pas accompagnés d’images, il nous est impossible de connaître leur attribution respective.
57
Sanchez Canton aurait prouvé qu’il n’y eu pas d’archevêque en Nouvelle-France et au Canada avant
1819, fait qui entrait en contradiction avec la datation que proposait l’historien de l’art, soit celle de 18001808. Il suggère donc, en guise d’alternative à cette impasse, d’associer le diptyque à un événement en lien
avec la « Grande Guerre Iroquoise » (1642-1666). N’ayant pas eu accès au document original, nous nous
fions aux informations données par Marie-Geneviève de La Coste-Messelière (1967 : 29), Wilson Bareau
(1994 : 289) et Véronique Gérald Powell (1998 : 202).
58
Cette interprétation n’a pas complètement cessé d’être évoquée depuis et ce, dans certains textes où est
élaborée une pensée générale sur l’œuvre de Goya. Par exemple, Sarah Symmons écrit « Deux tableaux
représentant des scènes de cannibalisme dont les victimes seraient deux missionnaires jésuites qui furent
torturés et assassinés par des indiens iroquois près du Québec en 1649 […] » (2002 : 224).
�32
d’une fortune critique autonome, qui s’alimente elle-même de ses propres croyances.
L’interprétation de Sánchez Cantón nous permet cependant d’ouvrir un champ de
réflexion de grand intérêt. Cette dernière fut remise en doute59, voire rejetée60, mais ce ne
fut jamais qu’en réponse au manque de preuves fournies par les œuvres mêmes. Nous
constatons la pertinence d’un détour du côté des recherches et réflexions critiques sur
l’histoire des Saints Martyrs, laquelle fut jusqu’ici entièrement négligée dans la fortune
critique des tableaux qui nous intéressent. Ainsi pouvons-nous examiner la valeur
symbolique et la raison d’être de cette association et de ses échos. Nous abordons cette
association non pas comme interprétation valide aujourd’hui, mais comme trace d’une
construction discursive et symbolique, voire idéologique.
Brébeuf et Lallemant, tous deux jésuites de haut rang61, ont comme mission de
convertir le peuple Huron à la foi chrétienne. Ils sont tués et dévorés dans la foulée d’une
guerre qui oppose les Hurons et les Iroquois. Les détails sont racontés pour la première
fois par Paul Ragueneau, alors qu’il occupe la fonction de “supérieur de la mission”
coloniale (Laflèche 1990: 10). Ainsi s’articulent quelques bribes de son récit (Ibid.:
pp.58-61):
Dès le moment qu’ils furent pris captifs, on les dépouilla nuds, on leur
arracha quelques ongles [...] Ils coupent à l’un les mains, ils percent l’autre
d’alaines aiguës, et de pointes de fer [...] et leur en mettent un collier à l’entour
du col, en sorte que tous les mouvements de leur corps leur donnoient un
nouveau supplice [...]. En dérision du Sainct Baptesme, que ces bons Pères
avoient administré si charitablement mesme à la brèche, et au plus chaud de la
meslée, ces malheureux, ennemis de la Foi, s’advisèrent de baptiser d’eau
59
Pierre Gassier est le premier auteur de la fortune critique qui nous intéresse à affirmer un doute quant à
cette interprétation, sans pour autant l’expliciter : “There is no real proof that the first two represent the
martydom of Jesuit missionaries by the Iroquois in Canada” (Gassier 1981 : 262). Juliet Wilson Bareau
fournit l’explication suivante: “The only shred of evidence on which to hang an identification of the two
victims are the clothes scattered on the ground, but these are so freely painted that, apart from the hat and
buckled shoe and the suggestion of a blue sash, it is difficult to arrive at a precise definition, although the
hat may be that of a Jesuit priest” (1994 : 289).
60
Pour Suzanne M. Singletary, ces œuvres ne sauraient être vues comme une représentation d’un incident
historique. «Rather, the artist transcended both (anthropological theory and documented historical incident)
to evoke abstract meanings and to enter an ambiguous world of directly transcribed human motivation”
(2004 : 69). Elle accorde plutôt au diptyque une valeur métaphorique.
61
Jean de Brébeuf fut le premier missionnaire à se rendre au Québec en 1626 avec la responsabilité
d’administrer la mission coloniale, laquelle est transférée à Jérôme Lallemant plus d’une décennie plus tard
(Laflèche 1990: 9).
�33
bouillante [...]. Avant leur mort, on leur arracha le coeur à tous deux, leur ayant
fait une ouverture au dessus de la poictrine, et ces barbares s’en repeurent
inhumainement, beuvant leur sang tout chaud, qu’ils puisoient en sa source d’une
main sacrilège. Estans encore tous pleins de vie, on enlevoit des morceaux de
chairs de leurs cuisses, du gras des jambes et de leurs bras, que ces bourreaux
faisoient rostir sur des charbons et mangeoient à leur veuë62.
Les similitudes entre ce fragment de texte et la gravure de Grégoire Huret
(Figure 7) sont frappantes. Or, ces représentations textuelles et visuelles ne concordent
pas avec le contenu des œuvres de Goya. C’est bien parce que la description de
l’assassinat par Ragueneau et la gravure de Huret s'associent de manière convergente
dans la volonté d’illustrer une “martyrologie” des missionnaires et de mettre en valeur les
détails et les “faits” des événements. Ces documents constituent les textes fondateurs du
mythe et « [...] le point de départ de l’iconographie des saints martyrs canadiens »
(Laflèche 1988 : 48). De ces productions textuelles nombre d’autres découlèrent, toutes
fondées sur une même « volonté objective ». Pour Guy Laflèche, s’il est juste de douter
de la véracité du double assassinat par les Iroquois (1990 : 21), il le serait tout autant de
ne pas remettre en doute la fonction idéologique des textes et des images qui la racontent.
Le chercheur les présente toutes en « mosaïque », sous la forme de séries commentées,
offrant ainsi la première étude exhaustive du mythe des Saints Martyrs canadiens. Cette
méthode lui permet de constater qu’il n’existe pas « [...] d’histoire des Saints Martyrs
canadiens en dehors des textes littéraires qui la racontaient magnifiquement [...] » (Ibid.:
14). Laflèche déconstruit ce « mythe », lequel se fonde tout entier sur l’exclusion des
Iroquois, c’est-à-dire sur le refus de saisir « [...] la nature, le sens et les fonctions du
supplice amérindien [...] » (Ibid.: 12). Ce constat lui permet de sonder de façon inédite
l’histoire de cet assassinat. Laflèche se positionne, face à l’historiographie de l’épisode
des Saints Martyrs canadiens, en effectuant une distanciation analogue à celle proposée
par Jauss, en montrant que l’historiographie toute entière ignore la posture des
Amérindiens face au cannibalisme. Toute la thèse de Laflèche tient dans la démonstration
que les Indiens ont traité les Pères comme ils traitaient toutes les victimes de guerre et
qu’en conséquence, ceux-ci n’ont pas été ciblés ou traités différemment à cause de leur
religion : donc les Pères ne sont pas des martyrs au sens strict du terme (des gens ayant
62
L’italique est de nous.
�34
donné leur vie pour une cause), mais des missionnaires. Laflèche casse ainsi la chaîne
d’un prolongement aveugle du mythe des saints martyrs canadiens tel qu’il avait été
jusqu’alors raconté. En ce qui concerne la fortune critique du diptyque de Goya, tous les
auteurs qui ont proposé ou reconduit cette association ont fait de ces œuvres l’expression
d’une glorification des Martyrs canadiens, qu’ils en aient connu ou non les détails.
Figure 7. Grégoire Huret, Preciosa mors quorumdam Patrum é Societ. Iesu in nova Francia, 1650.
Dans certains textes composant la fortune critique des tableaux, la reconduction
du mythe est explicite. Geneviève de La Coste-Messelière (1967) et Robert Hollier
(1966) ont tous deux commenté le lien entre le diptyque et l’événement canadien,
approfondissant ainsi la recherche dans le sens d’une connaissance de l’histoire en
question. Selon la première, « l’expression (par Goya) d’un intérêt insolite pour un
épisode alors oublié de l’histoire du Canada et de son évangélisation » (1967 : 29) tient
de l’évidence, tout comme « […] les violences auxquelles se livrent [ici] les Iroquois »
(Ibid. : 31) tiennent de l’habitude. Elle survole des écrits de missionnaires, comme ceux
de Théodore de Bry et du Père Latifau, qu’elle considère être des preuves de la violence
“sauvage” de peuples colonisés. Elle réfléchit l’événement comme un écho « hors du
temps » à la guerre que connaît Goya, aux « […] atrocités qui déchirent l’Espagne […] »
(Ibid. : 31). De son côté, Hollier (1966 : 43) confirme que le changement de titre a été
�35
officialisé par le musée de Besançon (à une date non précisée). Il reconnaît le caractère
mystérieux de cette association et doute que Goya ait pu connaître l’histoire canadienne,
mais « […] il n’est que d’examiner les deux tableaux pour s’en convaincre […]. Goya, en
ces années sombres où l’horrible le fascinait (1820), ne pouvait qu’être séduit par la
brutalité de la scène, qui n’avait rien d’exceptionnel pour les Indiens du XVIIe siècle
puisqu’ils croyaient que la chair d’un homme très courageux donnait des vertus similaires
à celui qui l’ingérait » (1966 : 43).
Selon Frank Lestringant (1994), la valeur singulière du cannibalisme incarnée par
le cas du meurtre de Brébeuf et Lallemant, d’un point de vue de l’historiographie Jésuite,
est tout autre. Lestringant explore l’idée popularisée au XVIIe siècle, entre autres par le
père Jean-Baptiste du Tertre, selon laquelle l’Indien63 aime la chair du Français
contrairement à la chair espagnole qu’il ne mange que par vengeance (1994 : 211). S’y
manifeste la « […] préférence politique, ethnique et religieuse que [le Cannibale] accorde
au premier » (Ibid. : 214). L’Indien, qu’il s’agit de sauver, « […] trouve les français à son
goût, et en sens inverse, le Français parvient à imposer sa religion, ses mœurs et sa
tutelle » (Ibid. : 217). Mais ceci n’est que la première étape de la construction d’une
symbiose symbolique rêvée par les colonisateurs ésuites. Selon Lestringant, leur réussite
tient au fait qu’ils « […] deviennent, lors de leurs agonies exemplaires, les partenaires
consentants des Iroquois anthropophages » (Ibid. : 218). Les « pauvres Indiens »
s’abreuvent de leur sang, mêlé à celui du Christ, confirmant par là la sainteté de Brébeuf
et Lallemant (Ibid. : 223). L’histoire des missionnaires canadiens aboutit en l’expérience
d’une communion eucharistique qui participera éventuellement à justifier la victoire
évangélique et coloniale française sur le territoire canadien.
Laflèche montre comment, dans le procès de l’historiographie de l’événement
canadien, ce dernier en vient à être investi comme outil de propagande en faveur du
projet nationaliste canadien-français, entre autres par l’entremise des travaux d’HenriRaymond Casgrain et François-Xavier Garneau. Il insiste sur le fait que ce projet a
63
Dans le présent mémoire, l’usage du terme « Indien », au même titre que le terme « sauvage » se dit d’un
usage pragmatique qui tend vers sa déconstruction critique.
�36
favorisé la dépréciation des Iroquois et des Amérindiens (Laflèche 1988 : 329), lesquels
sont présentés comme des ennemis muets de l’état et du clergé:
Le sens premier du mythe des saints Martyrs canadiens est de vider le
nationalisme de tout contenu libéral, qu’il soit progressiste ou révolutionnaire, et
de réaliser en conséquence l’identification de la nation et de la religion; l’épisode
est placé au centre de l’Épopée mystique dont le commencement est l’origine
religieuse de la nation et la fin, son messianisme évangélisateur et civilisateur en
Amérique (Ibid. : 335).
En aval, comme l’a avancé Laflèche, le mythe cannibalique des missionnaires
canadiens apparaît comme instrument sacré et ethnocentrique ayant favorisé, par
l’entremise des discours, la constitution singulière de la nation canadienne-française,
mais cela nous éloigne de Goya. L’hypothèse du lien entre les œuvres avec Cannibales et
l’histoire canadienne permettait toutefois d’identifier les différents personnages du
diptyque. Les Iroquois commettent les violences et les missionnaires canadiens les
subissent. Suzanne M. Singletary, qui n’est pas favorable à l’association du diptyque au
mythe jésuite, entrevoit plutôt les tableaux comme une critique métaphorique des
fantasmes utopiques du salut chrétien et d’un nouvel idéalisme social façonné par la
raison des Lumières. Elle n’analyse qu’un seul tableau : Cannibales montrant des restes
humains, qu’elle présente comme une parodie de la communion eucharistique et,
parallèlement, du sacrement profane que constitue la guillotine. « Similaire à la messe
catholique, l’exécution par la guillotine a évolué en un rituel à l’intérieur duquel la tête
décapitée […] était levée pour le plaisir du public, comme le prêtre levait l’hostie pour le
communiant »64. Elle joint la représentation de figures ecclésiastiques et politiques sous
une même interprétation critique qu’elle considère être inhérente au diptyque de Goya.
Les bourreaux sont, selon elle, des représentants du pouvoir sociopolitique. Mais cette
conception confond, la notion de primitif, la notion de sauvage et la notion d’homme
universel. Hollier avait lui aussi confondu l’Iroquois et l’homme universel (1966 : 43).
Dans la fortune critique des tableaux, la nature humaine opère souvent une fonction
discursive contradictoire puisque, alors que cette notion renvoie à l’humanité dans son
64
Notre traduction de : « Similar to the Catholic mass, execution by guillotine evolved into a communal
ritual in which the decapitated head […] was lifted for the delectation of the crowd, much like a priest
raising a host to communicants » (Singletary 2004 : 78).
�37
ensemble, son instanciation par l’illustration passe le plus souvent par une figure
singulière : figure du primitif (Iroquois) ou figure du pouvoir (prêtre, tyran).
Désormais, l’association des œuvres à l’histoire des missionnaires canadiens
paraît obsolète. Notre analyse des œuvres nous permet d’évacuer complètement cette
association. Mais nous pouvons constater que celle-ci a permis temporairement à deux
œuvres non titrées de Goya d’être envisagées comme une apologie idéologique et
politique du clergé et de la colonisation.
1.5 Un nouveau paradigme historiographique : le cannibale comme
métaphore de la nature humaine
Il ne faudrait pas croire que l’enthousiasme de Yriarte pour Goya était chose
répandue à l’époque où il publie son catalogue, ni d’ailleurs la volonté de faire de ce
dernier un peintre de la nation espagnole. Ce n’est qu’en 1900, avec l’exposition
d’Aureliano de Beruete, que l’on procède, au Musée du Prado (Augé 2014 : 78), à une
« révision de l’échelle des valeurs », révision qui « […] obéit à des motifs complexes où
se mêlent les modes, l’influence des valeurs esthétiques contemporaines, le progrès de la
recherche érudite et les intérêts marchands » (Moulin 1997 : 19) et qu’ainsi, on en vient à
investir l’œuvre peint de Goya à la hauteur de la reconnaissance que nous lui accordons
encore aujourd’hui. Cette exposition encourage notamment la naissance de l’enquête
théorique de l’univers morbide et terrifiant de Goya en Espagne. Ainsi, les œuvres aux
Cannibales, bien qu’elles se trouvent en France depuis 1867 au moins, participent alors à
alimenter la fascination envers la part morbide de l’œuvre du peintre nouvellement
légitimé institutionnellement. Les commentaires sur les deux tableaux de Goya sont tirés
exclusivement de catalogues d’expositions, d’un catalogue raisonné de l’œuvre de
l’artiste (Gassier 1990) et d’un article de journal spécialisé (Singletary 2004). Ainsi, la
fortune critique de ces tableaux s’est presque entièrement constituée à l’intérieur du
réseau des musées. Cette partie du mémoire a pour objectif de découvrir comment le
diptyque aux Cannibales de Goya a été réfléchi dans ces divers textes et, plus
spécifiquement, comment la violence qui s’y joue a été interprétée. Nous pourrons ainsi
�38
constater comment s’articule le prolongement de la fortune critique que nous avons
étudiée.
L’apparition des titres Cannibales préparant leurs victimes et Cannibales
montrant des restes humains coïncide avec le renoncement à leur association à l’histoire
des missionnaires canadiens (Wilson Bareau 1994). Dorénavant, les figures des tableaux
ne sont plus identifiées comme des Jésuites dévorés et des Iroquois dévorants, mais de
façon plus universelle, comme cannibales dévorants et victimes dévorées. Toutefois,
l’identité des bourreaux est cristallisée en des termes que nous considérons comme
partiellement dérivés de l’association démentie: les termes « sauvages » et « primitifs ».
En effet, nous remarquons que, là où l’association des deux œuvres aux événements
canadiens du meurtre de deux missionnaires n’est pas remise en question de façon
systématique, le terme sauvage renvoie directement aux Indiens d’Amérique, comme on
les appelait à l’époque. Par exemple, Juan Antonio Gaya Nuño (1958 : 177) catalogue
l’une des œuvres en en donnant la description suivante : « […] trois sauvages assis autour
d’un autre, assis à califourchon sur une pierre, qui brandit un avant-bras et la tête d’un
archevêque; quatre autres sauvages au fond »65. José Gudiol (1992 : 293) écrit : « dans la
seconde peinture, trois sauvages, un debout et les deux autres assis, se livrent au travail
macabre de compléter le martyre des deux jésuites ». De La Coste-Messelière (1967 : 31)
qualifie le geste des Iroquois de « vandalisme sauvage »66. À partir de 1994, on ne
reconnaît plus des
Iroquois, ni de figures ecclésiastiques dans les descriptions des
tableaux. On identifie des « sauvages », des « primitifs » ou des « cannibales » (ces trois
mots sont employés de manière équivalente). Rappelons toutefois que le texte Dystopia :
Goya’s Cannibals de Singletary fait exception, car, comme nous l’avons mentionné,
l’auteur affirme voir dans Cannibales montrant des restes humains un prêtre ou un tyran
métaphorique et ainsi, la monstration d’une dénonciation des violences tyranniques de
65
Notre traduction de : »[…] tres salvajes sentados alrededor de otro, a horcajadas sobre une piedra, que
blande un antebrazo y la cabeza del arzobispo; otros cuatro salvajes al fondo » (1958 : 178).
66
Notons également que Pierre Gassier (1981), qui est le premier à douter de l’association des œuvres à
l’affaire canadienne en raison d’un manque de preuves (mais sans pourtant l’invalider), souligne la
similitude entre le diptyque et deux autres tableaux (fig. 4). Il fait ainsi naître ce qu’il nomme dans un autre
ouvrage (1990) la série des « scènes de sauvagerie » Nous considérons que les ressemblances entre ces
œuvres et le diptyque sont réelles. Ces œuvres appartiennent toutes deux au Prado et cette distance entre les
tableaux concernés a probablement rendu plus difficile ce rapprochement.
�39
l’Église et de la Révolution française. Malgré le fait qu’elle déplace ainsi la
problématique, Singletary fait usage des termes mentionnés afin de dénoter les figures
des tableaux tout au long de son article, et ce, sans en approfondir l’usage.
Primitif et sauvage : il n’est pas un seul texte de la fortune critique des tableaux
qui n’utilise, l’un ou l’autre de ces substantifs, si non les deux. La valeur de ces usages
sémantiques, tel qu’elle s’est constituée dans le discours occidental, pose plusieurs
problèmes. Nous voulons réfléchir ces termes plutôt que de les reconduire
inconsidérément. Les mots sauvage et primitif sont joints par un lien de proximité.
« [...] Avec l’élaboration d’une pensée sociologique et ethnologique, l’adjectif entre dans
l’expression peuple primitif (1794, Condorcet), dans une opposition alors conceptualisée
(après Rousseau et d’autres) entre nature originelle et société civilisée. Malgré les critiques,
cet emploi, venu remplacer en partie celui de sauvage, s’est maintenu en recevant des
définitions de plus en plus scrupuleuses, de Durkheim à Lévi-Strauss » (Rey 2006 : 2941).
Si l’un en vient à remplacer l’autre, c’est dans la mesure où ces termes jouent une
fonction discursive similaire, c’est-à-dire qu’ils désignent tous deux celui qui est hors de
la civilisation67. On ne saurait réduire ces termes à une fonction stricte pour la tradition
discursive occidentale, mais il est clair que dans la fortune critique du diptyque, les mots
sauvages et primitifs excluent d’emblée la figure du civilisé de la réflexion sur la violence
du diptyque. Seule Singletary note l'ambiguïté que provoque la présence des vêtements
occidentaux sur le sol dans Cannibales préparant leurs victimes, lesquels évoquent, selon
elle, la « […] collision entre des civilisations […] » (2004 : 85)68. Cependant, Singletary
ne pose pas la question « qui mange et qui est mangé » ? Quelqu’un est-il même mangé?
C’est là, selon nous, que repose la réelle ambiguïté soulevée par les deux œuvres à
l’étude.
67
« Dès la fin du XIIe siècle (v. 1196), sauvage qualifie des êtres humains, des peuples, considérés comme
étrangers à toute civilisation […]. Il est aujourd’hui senti comme indûment péjoratif et il est proscrit » (Rey
1998 : 3400).
68
Notre traduction d’une fraction du passage suivant: « By pitting the unselfconscious nakedness of the
cannibals with the clothing of their hapless victims, Goya implicitly questioned the collision between
civilization, represented by the clothing remnants, and unbridled nature in the guise of the conspicuously
naked primitives » (Singletary 2004 : 69)
�40
En ne clarifiant pas ce qu’ils entendent par sauvage ou primitif, les auteurs de la
fortune critique des tableaux, comme Wilson Bareau (1994) et Gérald Powell (1998),
tendent à renforcer le caractère péjoratif de ces mots qui dénotent historiquement des
êtres humains en chair en os. En effet, ils font du primitif celui qui, nécessairement, selon
eux, incarne la violence cannibale. Ils projettent dans l’imaginaire de Goya une peur du
primitif, cet être maudit du monde colonisé, « […] monde coupé en deux » (Fanon 2002 :
41). Cette compréhension des œuvres nous apparaît calquée sur la définition de
l’Encyclopédie des Lumières, où les sauvages sont dits être :
« […] des peuples barbares qui vivent sans lois, sans police, sans religion, & qui n'ont point
d'habitation fixe […]. Une grande partie de l'Amérique est peuplée de sauvages, la plûpart
encore féroces, & qui se nourrissent de chair humaine […]. La liberté naturelle est le seul
objet de la police des sauvages » 69.
Très tôt dans son texte, Singletary affirme son opposition à la posture de WilsonBareau selon qui les deux tableaux confèrent à l’homme le statut de “sauvage innocent”
(1994 : 289)70. Singletary, sans se soucier du caractère universalisant de ce dernier
propos, l’associe au topos répandu au XVIe siècle en Europe (lequel s’est constitué en
marge des découvertes coloniales) du cannibale comme figure d’un « paradis utopique ».
« De manière à le rendre moins repoussant, le cannibale était imaginé comme un agresseur
enfantin avec une faible capacité à réprimer ses pulsions71. [...] Cet argument était utilisé pour
justifier l’agenda colonial des envahisseurs, incluant non seulement la conquête, mais
également la prise d’esclaves, engageant le cannibalisme comme outil de rationalisation de
l’impérialisme » (Singletary 2004: 61)72.
69
Nous tirons cette citation de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une société de Gens de lettres, publiée en ligne sous la direction de Glenn Roe de l’Université
de Chicago :
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.13:2515.encyclopedie0513.7741292
70
La phrase exacte de Wilson-Bareau va comme suit : « If these two paintings are another of Goya’s
allegories on human nature, they suggest the ambiguity of his vision of man as innocent savage or
irremediably primitive beast […] » (1994 : 289).
71
Cette lecture, qui se veut une interprétation de la compréhension du cannibalisme selon André Thévet,
trouve un écho dans la théorie psychanalytique de Melanie Klein, pour qui la pulsion enfantine de
dévoration est entendue comme un phénomène fondamental du développement du moi. Elle insiste sur la
violence de la tété, acte correspondant aux stades sadiques-oraux qui « expriment une envie de posséder le
sein de la mère, d’en vider et d’en aspirer le contenu ; grâce à leur caractère bien défini, ils semblent
constituer un lien avec le stade oral de succion et le stade oral de morsure » (Klein 2001 : 142).
72
Cette interprétation, qui se fonde majoritairement sur les idées de Frank Lestringant, rejette des idées
emblématiques du XVIe siècle, formulées par plusieurs auteurs tels que André Thévet, Jean de Léry et
Théodore de Bry. Il s’agit de notre traduction d’une part de la citation suivante: « Viewed as less repellent,
the cannibal was imagined as a childlike agressor with poor impulse control. [...] This argument was used
�41
Singletary se situe dans une posture critique quant au discours colonial auquel
appartient dans ce contexte le terme primitif pour y opposer l’idée d’un cannibalisme
« dystopique ». L’auteur note que l’appui à l’instrumentalisation coloniale de la figure du
cannibale commence déjà à se disloquer au XVIIIe siècle chez certains penseurs des
Lumières, et même avant cela chez Montaigne, pour qui le cannibalisme peut faire l’objet
de diverses interprétations. Selon Singletary, les interprétations de Voltaire (1759) et de
Diderot (1772) se rapprochent de celle de Goya, dans la mesure où les cannibales y sont
également projetés comme des prédateurs antihéroïques, aux postures et aux expressions
« désidéalisées » (Ibid. : 65). Cette vision s’exprime dans le Candide de Voltaire sous la
forme de la parodie73 alors que pour Diderot, le cannibalisme sert d’allégorie politique et
critique de la tyrannie (Ibid. : 65 et 67)74. Les idées de ces auteurs, tout comme
l’expression picturale de Goya, laquelle sabote les idéaux picturaux néoclassiques,
marquerait pour Singletary la naissance d’un rejet du positivisme des Lumières, d’où la
notion de « dystopie ».
Pour Gérald Powell (1998 : 203), la technique de Goya est également habitée par
le contenu de la représentation. « En brossant les visages plutôt qu’en les dessinant, Goya
montre que ces hommes sont avant tout des primitifs ». Cette phrase, tirée d’une
description des œuvres pour le catalogue de l’exposition Goya: un regard libre, nous
offre le trait embryonnaire d’une réflexion sur la dilapidation partielle de la forme en tant
qu’effet de l’objet de représentation sur la forme même et inversement. Singletary insiste
en ce sens sur la dérision du corps héroïque néoclassique, dont le jeu ironique sur la
nudité et les codes picturaux ne nous permettent pas de douter (2004 : 65). Cette idée
d’un rapport entre objet et forme, qui prolonge la pensée de Yriarte, ne nous informe pas
to justify the colonial agenda of European invaders, including not only conquest, but also the taking of
slaves, thereby enlisting cannibalism as rationalization for imperialism ».
73
Dans l’œuvre de Voltaire, c’est Candide qui, au milieu de son grand voyage, sera le témoin de la nature
telle qu’elle est en elle-même, c’est-à-dire cannibale. Alors qu’il est ligoté et menacé d’être bientôt dévoré,
il lui vient à l’esprit de questionner la doctrine raisonnable de Pangloss le philosophe, son mentor, dont il
avait appris que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », d’où l’aspect humoristique et
parodique du cannibalisme ici joué car en effet, dans ce passage, c’est bien plutôt la raison « sauvage » qui
est mise en scène. Afin d’avoir accès au passage original du texte voir : (Voltaire 2004 : 71-75).
74
Chez Diderot (2003 : 39-40), l’anthropophagie « sauvage » a une fonction démographique, permettant de
limiter l’élargissement de la population.
�42
de ce qu’est l’objet de représentation, mais elle permet de problématiser le caractère
indécidable de certains aspects iconographiques et picturaux du diptyque.
Nous considérons que les recherches de Singletary sont particulièrement
pertinentes pour le présent mémoire. Elles se basent à la fois sur des points marquants de
l’histoire du discours sur le cannibalisme en Europe, sur les éléments picturaux de
l’œuvre de Goya et sur la réalité politique particulière qu’a connue l’Espagne autour de la
charnière du XIXe siècle. Nous constatons avec elle que les figures de ces tableaux
incarnent la cruauté. Cependant, son travail laisse une contradiction irrésolue. Comment
Goya peut-il à la fois fournir une critique si radicale de figures du pouvoir et une
métaphore de l’irrationalité intrinsèque à la nature humaine dont la dimension
« sauvage » historiquement réprimée serait l’ultime expression ? D’autant plus que
Singletary affirme que “la sauvagerie instinctive” de l’homme, précisément, est « un
ingrédient actif dans les rapports sociaux et menacent de saboter même les plus grands
idéaux réformateurs » (Ibid. : 80). La « dystopie » serait le renversement des idéaux des
Lumières, mais aussi celui des idéaux en général (chrétiens, politiques, etc.). Il nous
apparaît que la proposition de Singletary confond ledit sauvage, le tyran et la nature
humaine. Alors que la nature humaine renvoie à une humanité universelle, le sauvage et
le tyran supposent des catégories restreintes. Singletary prolonge une contradiction qui
appartient à la tradition même et que la « dystopie » ainsi articulée ne saurait résoudre.
De plus, l’auteur ne fournit pas d’analyse de Cannibales préparant leurs victimes, tableau
sur lequel repose l’éclaircissement d’une telle contradiction.
La fortune critique des tableaux laisse, en guise d’héritage, diverses formes de
racismes, nous informant de ce que voit le regard de ceux qui la constituent, mais
également de leur tentative de retracer l’intention picturale de Goya. Dans le cas de cette
fortune critique spécifique, il nous est généralement difficile de discerner ce qui
appartient aux différents horizons que pose la distance entre l’artiste et les auteurs. Nous
croyons qu’il est plus pertinent de chercher à comprendre quelle est la fonction de la
représentation des « sauvages » violents dans les tableaux de Goya. Si nous maintenons,
dans ce mémoire, l’usage des termes sauvage et primitif, sans pour autant nier leur charge
�43
idéologique, c’est en tant que nous souhaitons ouvrir le champ de leur « déconstruction ». Nous entendons la poursuivre à l’aune d’une connaissance plus
approfondie des horizons dont participent ces oeuvres75.
Dans ce chapitre, nous en sommes venus à articuler une lecture nouvelle des deux
tableaux avec Cannibales, laquelle favorise une distance critique par rapport au corpus
qui a fait de ce diptyque un objet de savoir. Nous avons découvert qu’au sein de la
représentation que mettent en jeu les deux tableaux, la bichromie ainsi que la temporalité
auxquelles renvoient les accessoires produisent une rencontre entre la notion d’une
nature cruelle universelle et l’assimilation de la nature noble des hommes d’élite à cette
nature fondamentale. Cette lecture nouvelle nous garantit, pour l’ensemble de ce
mémoire, un point d’ancrage important. Dans les deux prochains chapitres, nous
analyserons l’horizon iconographique et philosophique auquel ce diptyque participe.
Ainsi, pourrons-nous progressivement configurer sa singularité et comprendre comment
le cannibale et le « sauvage » en sont peut-être venus, avec Goya, à exprimer l’idée d’une
nature humaine.
75
« Or l’ethnologie-- comme toute science -- se produit dans l’élément du discours. Et elle est d’abord une
science européenne utilisant, fût-ce à son corps défendant, les concepts de la tradition. Par conséquent, qu’il
le veuille ou non et cela ne dépend pas d’une décision de l’ethnologue, celui-ci accueille dans son discours
les prémisses de l’ethnocentrisme au moment même où il le dénonce. Cette nécessité est irréductible, elle
n’est pas une contingence historique; il faudrait en méditer toutes les implications. Mais si personne ne peut
y échapper, si personne n’est donc responsable d’y céder, si peu que ce soit, cela ne veut pas dire que toutes
les manières d’y céder soient d’égale pertinence. [...] Il s’agit là d’un rapport critique au langage des
sciences humaines et d’une responsabilité critique du discours. Il s’agit de poser expressément et
systématiquement le problème du statut d’un discours empruntant à un héritage lui-même » (Derrida 1967 :
414).
�44
CHAPITRE 2
Une iconographie du cannibalisme du XVIe au début du XIXe siècle
Dans ce deuxième chapitre, nous cherchons à retracer une histoire du
cannibalisme en images. Nous souhaitons situer les insituables tableaux de Goya au sein
d’une iconographie occidentale du cannibalisme couvrant la période du début du XVIe au
début du XIXe siècle, laquelle nous mène à constater la récurrence de la représentation
du cannibalisme à l’intérieur de trois catégories : l’image coloniale, la caricature et
l’image mythologique (à travers laquelle nous aurons par ailleurs l’occasion de nous
pencher sur la singularité de ce thème en peinture)76. Par le biais de cette iconographie,
nous pourrons reconstituer l’horizon iconographique du cannibalisme en Occident et
examiner les divers usages de sa représentation, car en effet, celle-ci n’a pas eu comme
seules fonctions l’invention et la monstration de la violence du « primitif », même si la
période couverte coïncide avec le début et le déploiement du projet colonial européen.
La division de ce chapitre est élaborée à partir des catégories d’images avec
cannibale énumérées précédemment. À chacune des catégories, nous souhaitons poser les
questions suivantes : à quels systèmes ou régimes de production et de circulation
iconiques appartiennent ces images? Quelles fonctions joue la violence cannibale dans
ces diverses catégories d’images ? Nous informent-elles sur les tableaux de Goya?
La figure du cannibale apparaît de façon sporadique dans l’histoire, mais ses
apparitions sont toujours historiquement déterminées. Nous ne chercherons donc pas à
prouver l’universalité de sa récurrence, à travers les images de tout temps et de toutes
époques, ainsi que l’entend Jeanette Zwingenberger (2011 : 9) dans l’édition d’artpress
76
Le choix du XVIe siècle n’est certes pas aléatoire. C’est l’époque où commence la période coloniale et
où naît le terme « cannibale » en Occident, résultat d’un détournement involontaire. En effet, « le nom des
Cannibales a pour origine l’arawak caniba, qui serait l’altération de cariba, mot par lequel les Indiens
Carib des Petites Antilles se désignaient eux-mêmes, et qui, dans leur langue, aurait signifié « hardi ». Dans
la bouche de leurs ennemis au contraire, les paisibles Arawak de Cuba, le terme comportait une valeur
nettement péjorative, pour connoter une férocité et une barbarie extrême. C’est par cet intermédiaire que
Christophe Colomb, lors du voyage inaugural de 1492, recueillit le mot » (Lestringant 1994 : 43).
�45
dédiée à l’exposition Tous Cannibales (2011), laquelle est présentée comme
prolongement du texte éponyme de Claude Lévi-Strauss (2013)77. Nous souhaitons plutôt
découvrir, par le biais de cette iconographie, les contextes qui ont favorisé son
émergence. Celle-ci coïncide d’abord avec un contexte politique colonial et connaît un
développement continu jusqu’à la Révolution française. Nous souhaitons identifier les
grandes lignes de la périodisation qui marquent la représentation du cannibalisme afin de
mieux comprendre la progression au gré de laquelle ce sujet participe à interroger et à
brouiller les frontières d’une humanité occidentale ainsi qu’à corrompre une vision de
l’homme à l’image de Dieu. Ainsi pourrons-nous mieux saisir comment, dans l’œuvre de
Goya, le cannibalisme en est venu à exprimer une certaine conception de la nature
humaine.
Précisons que lorsque nous employons la notion de contexte, nous n’entendons
pas nous restreindre aux domaines de l’histoire et du politique. Dans la mesure où nous
parlons d’images, nous envisageons aussi le contexte comme ce qui détermine les
conditions de possibilité de leur production et de leur visibilité. C’est pourquoi le médium
doit également être entendu faisant partie du contexte, en tant que lieu d’émergence de
l’image spécifique. Or, du XVIe au XIXe siècle, c’est presque toujours la gravure qui sert
de support à la figure cannibale.
2.1 L’Autre cannibale : une figure coloniale
L’image de l’allélophage78 du Nouveau Monde est celle qui, parmi les
représentations avec cannibale, a été produite en plus grand nombre. Le lieu d’émergence
de l’image coloniale est généralement le livre et plus précisément, la gravure79. En effet,
77
Zwingenberger propose en effet une approche anthropologique universalisante qui aborde le
cannibalisme comme invariant plutôt que selon ses modalités historiques et géographiques. Elle écrit, en
guise de prologue à l’exposition : « L’anthropophagie traverse la mythologie de toutes les époques et de
toutes les cultures, des textes bibliques jusqu’aux auteurs classiques : depuis Dante, Shakespeare, Goethe,
et jusqu’à James Joyce, des contes jusqu’aux films d’horreur actuels » (2011 : 10).
78
L’allélophagie est le seul synonyme véritable de cannibalisme, dans la mesure où ce terme se dit de la
« […] manducation du semblable » (Vandenberg 2014 : 19).
79
Notons que l’essor du livre a été particulièrement prolifique en Europe du Nord à l’époque coloniale
« […] comme le prouve l’essor des foires aux livres de Francfort » (Wallerick 2010 : 36).
�46
les gravures coloniales s’inscrivent presque toujours à l’intérieur de productions
livresques savantes rédigées ou illustrées par des explorateurs, ou du moins des
voyageurs qui ont connu l’Amérique80. Les écrits y prennent en compte le cannibalisme
du « sauvage » et en suggèrent diverses interprétations, alors que les illustrations le
donnent à voir81. Nous observons qu’au sein des diverses images coloniales, les scènes de
cannibalisme « sauvage » ont pour particularité d’être presque toujours montrées comme
des scènes sans repères européens et isolées de tout regard, excepté bien sûr du regard
caché du graveur qui en procure les représentations82. Les images sont donc les
gardiennes du regard occidental porté sur le cannibalisme du Nouveau Monde. Nous
souhaitons, dans ce chapitre, étudier deux usages distincts de l’image coloniale avec
cannibale : d’abord, en tant que lieu de représentation pré-ethnographique du
« sauvage »83, puis, en tant que lieu de représentation métaphorique de la barbarie de
l’ennemi catholique espagnol d’Europe. Ce type particulier d’image coloniale peut certes
être réfléchi à l’aune des effets de la guerre des religions sur la colonisation et nous
verrons, en effet, qu’il a parfois été le lieu explicite d’une guerre par l’image illustrant
cette conjoncture.
Les Grands Voyages sont envisagés et présentés comme la possibilité de
perpétuer l’expansion espagnole suite à la Reconquista, mais aussi de réaliser une
découverte à teneur utopique dont la représentation imaginaire est nourrie par l’idée
80
Il existe également une peinture coloniale où une scène de cannibalisme apparaît. Il s’agit de l’œuvre de
Jan I Van Kessel, Indians as cannibals (Brazil) (1664-1666). Dans la mesure où celle-ci fut produite au
XVIIe siècle, donc après l’époque de production des gravures coloniales qui nous intéressent et dans la
mesure où elle déploie un monde qui leur est de trop près similaire, nous la considérons comme étant un
prolongement du projet des images gravées.
81
Puisque Singletary a fait un compte-rendu satisfaisant du corpus discursif sur le cannibalisme à partir du
XVIe jusqu’au début du XIXe dans Dystopia :Goya’s Cannibals afin de situer les deux tableaux de Goya et
ce, en se fondant en grande partie sur les nombreux ouvrages de Frank Lestringant, ici nous insistons sur
l’iconographie coloniale afin de parvenir à cette même fin.
82
Il faudra toutefois noter quelques exceptions, parmi lesquelles une image de Hans Staden appartenant à
l’édition de la Warhaftige Historia und Beschreibung publiée à Marbug en 1557 (Lestringant 1987 : 87.) Il
apparaît d’ailleurs, nu, à droite, et semble être un membre de la communauté cannibale, quand bien même il
apparaît « […] contristé à la vue d’un pareil carnage » (Ibid.). Notons également que certains frontispices
des livres de Théodore de Bry mélangent, sur le mode de la métaphore, cannibalisme sauvage et imaginaire
occidental.
83
L’image coloniale précède l’invention de l’ethnographie. C’est pourquoi Michèle Duchet (1987)
l’adresse comme une de ses traces « dont le sens à l’époque n’était pas perceptible » (35). Or, il n’en
demeure pas moins que ce type d’images a d’abord pour but de montrer l’Autre du Nouveau Monde : elles
sont « pré-ethnographiques ».
�47
religieuse d’un paradis terrestre84. Ainsi, le Nouveau Monde est préalablement projeté
comme le reflet d’idéaux prélevés directement de l’horizon culturel de l’ancien85. D’un
point de vue colonial, la découverte du cannibale, qui aurait eu lieu le 3 novembre 1493
en Guadeloupe (Kirkpatrick 1990 : 66), s’inscrit dans une construction fantasmatique.
Cette découverte ne manqua pas d’ébranler les savoirs théologiques. « […] En ce siècle
chrétien par excellence, était-il possible de laisser supposer que la Genèse ait omis un
rameau de l’humanité? » (Dorigny 2013 : 24)86. Cette question, qui sous-tend une remise
en doute critique des fondements du christianisme, ne fut posée comme telle qu’a
posteriori. Christophe Colomb, ne perçoit pas l’effet de la découverte du cannibale en
tant que renversement des savoirs chrétiens87. Plutôt, cherchant à identifier, à reconnaître
ce nouveau visage, il établit une forte association entre le cannibale d’Amérique et la
figure antique et humaniste du Cynocéphale, telle que décrite dans les Livres des
Etymologies d’Isidore de Séville (Lestringant 1994 : 44). Ainsi, dans la première
représentation de cannibales inspirée des découvertes de l’Amérique, ceux-ci
apparaissent avec des têtes de chiens. Cette image reprend un motif occidental que
Lestringant considère clé dans le procès d’exclusion de la perception du cannibale
comme « […] monstre plausible et vaguement répugnant [afin qu’il ne soit pas] rejeté
84
« Christophe Colomb, face à l’embouchure de l’Orénoque, lors de son troisième voyage, écrivit au roi
d’Espagne : « Je suis convaincu que le paradis terrestre se trouve là […]. Le site correspond en tout point à
la description qu’en font les saints et les savants théologiens » (Dorigny 2013 : 13). Cela participe à
expliquer la récurrence de la représentation du jardin d’Éden dans les livres coloniaux.
85
Suzanne M. Singletary (2004) esquisse un très bon résumé des emprunts des premiers explorateurs à
diverses œuvres de la culture littéraire et chrétienne, savoirs qu’elle tire majoritairement des recherches de
Frank Lestringant (60).
86
L’appartenance des Indiens à la descendance de Noé a fait l’objet de grands débats théologiques.
Notamment, une conférence fut imposée par Charles Quint en 1550 à Valladolid afin de penser cette
question et ses conséquences sur le traitement même des Indiens. Bartolomé de las Casa, leur pourfendeur,
était favorable à leur évangélisation alors que Juan Gines de Sépulvada défendait la nécessité du massacre
des Indiens (Dorigny 2013 : 25).
87
Tel que le révèle la suivante citation, tirée de la lettre de Colomb à Luis de Santángel (1493),
l’explorateur envisage les divers peuples comme un tout homogène. « En toutes ces îles, je n’ai pas vu
grande diversité dans le type des habitants ni dans leurs coutumes ni dans leur langue, mais qu’au contraire
tous se comprennent, ce qui est une chose très singulière et dont j’espère qu’elle déterminera Leurs Altesses
à entreprendre leur conversion à notre sainte foi, ce à quoi ils sont fort disposés » (1992 : 209). Colomb
insiste sur la pertinence de l’évangélisation : la menace que représentent ces peuples semble reposer sur la
fluidité de leur langage et de leurs échanges. La foi chrétienne est pour ainsi dire réaffirmée par le désir
dogmatique du procès d’évangélisation. Or c’est l’évangélisation qui, pouvait-on espérer, rendrait possible
l’effacement de l’Autre, de sa vie spirituelle, et de la contradiction même que cet Autre représente pour les
fondements chrétiens.
�48
dans les marges du savoir géographique » (Ibid. : 55). L’imagerie du cannibale s’inscrit
dans un univers iconographique et discursif préexistant88.
Dans cette image (Figure 8) tirée d’un ouvrage de Fries (1525), chaque
cynocéphale opère une fonction spécifique dans la chaîne des opérations, laquelle
structure une trame narrative qui se déroule de gauche à droite. Sur fond de paysage
naturel, le graveur choisit de montrer un chasseur à dos de lama, armé d’un bâton et du
butin. Une bête, au centre, découpe la pâture avec un large couteau sur une structure qui
semble être de bois. Une autre figure paraît soit occupée à disposer des morceaux de
viande ou à les passer au cynocéphale dévorant un membre, sans tabou. S’articule, dans
cette image, une polarisation générale entre la nature du paysage et de la tête de chien et
l’humanité des corps et du dispositif technique servant l’anthropophagie. On ne saurait
par ailleurs dire où se produit cette scène.
Figure 8. Gravure tirée de l’ouvrage de Lorenz Fries, Artiste inconnu, « Boucherie de cannibales à tête de
chien », USelegung der Mercarthen oder Carta Marina, Strasbourg, vers 1525.
88
Le livre de Vincent Vandeberg (2014) De chair et de sang : images et pratiques du cannibalisme de
l’Antiquité au Moyen âge rend compte de la présence et de l’importance de la figure du cannibale au sein
de la culture occidentale et ce, en un temps qui précède le temps de la colonisation.
�49
Le rituel anthropophage en vient rapidement, dans les images produites
subséquemment, à être mis en scène sans que ne soient mobilisées des références
littéraires occidentales apparentes. Les représentations des cannibales deviennent
symptomatiques d’une volonté de montrer la violence de l’autre peuple, comme relevant
d’une objectivité factuelle et descriptive. Par exemple, la représentation des cannibales
d’André Thévet (Figure 9), apparaissant dans la Cosmographie Universelle (1575), met
en scène une temporalité qui condense les dernières étapes de l’anthropophagie : le
morcèlement, la cuisson et la dévoration. Le cannibalisme s’inscrit dans une économie
spatiale restreinte ; son processus est donné en une seule planche. Cette image
s’apparente en ceci à la gravure de 1525 puisqu’elle présente une même polarité entre
paysage naturel et dispositif technique. Quand bien même Thévet a voyagé en Amérique,
la parenté de cette gravure avec la première donne à penser qu’il a peut-être cherché à
reconduire partiellement la structure iconographique suggérée par l’image précédente.
Cela dit, il faut noter les différences qui séparent ces images. Les figures, ici, sont
multiples et rassemblent au moins deux sexes et deux générations (femme, hommes,
adultes et enfants). Elles paraissent ainsi former une collectivité entière. Toutes ces
figures sont affairées à une suite d’actions qui consolident une composition circulaire.
Les corps sont d’abord morcelés à la hache à même le sol, puis vidés de leurs tripes par la
seule femme. Les enfants à droite ne déploient pas beaucoup d’efforts. L’un d’entre eux
semble déjà se régaler. Des hommes disposent les parties de corps sur le feu alors que les
trois autres s’occupent de la cuisson. L’un des hommes au grill se lèche un doigt, pressé
de goûter le repas. Étrangement, une tête est installée au bout d’un bâton. Celle-ci se
présente peut-être à titre de trophée de guerre ou elle est peut-être simplement en attente
d’être fumée. Les corps des victimes ne se distinguent pas ici des corps des bourreaux. Ce
sont des « sauvages » qui mangent des « sauvages ».
La hache apparaît comme l’instrument de la violence. Elle se trouve également
dans quelques planches de Théodore de Bry et de Hans Staden. Bien que Lestringant ait
brillamment prouvé que la hache a été acquise par les « sauvages » pendant la
colonisation et que celle-ci a modifié l’économie du rituel, le rendant plus brutal, il s’agit
�50
là d’une étude récente89 et ce détail matériel qui concerne « les outils de la conquête »
n’est pas une évidence pour le premier illustrateur du sujet. Il est cependant essentiel de
noter que la hache a pour effet de modifier l’expérience traditionnelle du cannibalisme,
mais aussi d’amplifier l’aspect terrifiant du cannibale et en conséquence, d’accroître
l’urgence de l’évangélisation et de massacres auxquels serviront des armes plus
dévastatrices encore que la hache (Lestringant 1987 : 96). Rappelons, en effet, que la
population autochtone des Amériques diminue radicalement en moins de deux siècles.
Elle passe d’environ 100 millions en 1492 à moins de 5 millions à la fin du XVIIe siècle
pour causes d’épidémie et de massacres (Dorigny 2013 : 23-25). Le reste de la population
est évangélisée et soumise à l’esclavage. Mais la colonisation est avant tout l’histoire
d’une extermination, laquelle n’est pas mise en images par les premiers illustrateurs90. La
violence cannibale du « sauvage » est la seule sur laquelle insiste l’image du temps des
Découvertes. Ces faits historiques nous aident à comprendre comment l’image du
cannibale s’inscrit dans le procès de légitimation du projet colonial. En effet, ces images,
au même titre que les cartes et les nouveaux savoirs géographiques, trouvent leur place en
des livres dont la diffusion, facilitée par les progrès de l’imprimerie, influencèrent les
diverses puissances d’Europe à envisager l’appropriation d’une part du gâteau colonial91.
89
« Par le biais de la hache, le cérémonial anthropophage glisse vers la scène d’abattoir. L’introduction du
coin de fer tend à désymboliser une pratique traditionnelle et fortement connotée. L’efficacité de
l’instrument tient de la stupéfiante rapidité d’exécution qu’il autorise, brouillent irrévocablement le chiffre
d’un rituel. En télescopant les moments successifs qui l’ordonnaient, l’outil d’importation annihile le
contenu religieux et social qui lui était implicite » (Lestringant 1987 : 81).
90
Le cas d’Hispaniola et des Grandes Antilles est particulièrement frappant. À la fin du XVIe siècle, la
population des Grandes Antilles « s’était effondrée dans des proportions de 80 à 95 % sur le continent »
(Dorigny 2013 : 23).
91
À cet égard, voir l’œuvre de Marc Ferro (1994 : 8-9), qui adresse par ailleurs la colonisation non comme
la cause d’une culpabilité à nourrir, mais plutôt comme une série d’évènements opposants multiples
puissances occidentales et non occidentales.
�51
Figure 9. Gravure tirée de l’ouvrage d’André Thévet, « Équarissage de la victime », Les
Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs terres et isles
découvertes de nostre tems, 1575.
Environ cent ans plus tard, en 1598, on voit apparaître la première image
coloniale où figurent des Européens anthropophages. Il s’agit de la gravure Théodore de
Bry : Trois Espagnols suppliciés sont mutilés par leurs compagnons affamés92 (Figure
10). Cette gravure s’insère dans une série d’images représentant les Espagnols massacrant
impitoyablement les autochtones d’Amérique93. Non seulement De Bry inscrit-il les
Espagnols dans un espace de violence réservé jusqu’ici aux autochtones, mais suivant un
renversement inédit, il leur fait occuper le rôle des cannibales.
Cette planche présente, une fois de plus, plusieurs moments d’un seul récit.
Remarquons d’abord le paysage dévasté, que nous devinons être l’effet de la violence des
Espagnols. La nécessité du cannibalisme pour ces « Espagnols affamés » serait imputable
à la destruction des ressources naturelles, mais aussi à la dévoration de la dernière bête
habitant les environs. Sur le sol, un chemin de terre esquisse pour nous l’itinéraire de la
narration. Au fond de la scène, trois hommes armés marchent. L’un s’apprête à fustiger
un cheval. Ce même cheval est, sur le plan central, découpé à la hache. Juste à côté, un
92
Cette image s’inscrit dans l’ouvrage Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam devastatarum
verissima (1598),ouvrage fortement influencé par l’œuvre de Bartolomé de las Casas, L’Historia de las
Indias (1552).
93
Voir les planches 89 à 92 dans L’Amérique de Théodore de Bry (Duchet 1987 : pp. 216-219).
�52
homme sous une tente, près d’un feu, attend le bétail pour le cuire. À l’avant-plan, quatre
hommes s’organisent pour dévorer leurs compères : trois Espagnols pendus. L’un des
bourreaux coupe des morceaux, toujours à la hache. Ce dernier est relayé par deux
compagnons; l’un ramasse les découpes et l’autre les transporte. Il se dirige visiblement
vers la tente située complètement à droite, où se trouve un homme, un pied à la bouche,
qui surveille la marmite, où gisent divers morceaux, dont un autre pied. Ayant épuisé les
dernières ressources en viande du territoire, les Espagnols n’ont d’autre choix que de
s’entre-dévorer. De Bry a ainsi superposé deux scènes analogues, lui permettant de
représenter le passage de la bête à l’homme. L’Espagnol devient le « sauvage », la bête.
Ce déplacement est métaphorique et non pas factuel. Cependant, il renvoie aux faits de la
colonisation, quand bien même son auteur paraît influencé par une position idéologique
protestante.
Figure 10. Gravure tirée de l’œuvre de Théodore de Bry, « Trois Espagnols suppliciés sont
mutilés par leurs compagnons affamés », Grands Voyages, 1618.
La filiation de de Bry au protestantisme est indéniable94. Exilé de sa ville natale
en 1570, Liège, il trouve d’abord refuge à Strasbourg, où il parfait son éducation. Mais
c’est à Francfort, ville qui « attire les éditeurs-libraires de la réforme » (Bücken cité par
94
Duchet résume ainsi le dessein de l’œuvre de De Bry : « […] publier l’ensemble des textes écrits par les
voyageurs protestants, tous violemment anti-hispaniques et anti-catholiques, mettre en évidence les
atrocités commises dans le Nouveau Monde au nom du pape, servir ainsi la cause des nations protestantes,
qu’il s’agisse des Hollandais ou des Anglais » (1987 : 10).
�53
Wallerick 2010 : 37), que sont publiés ses livres de voyage. Selon Wallerick, les images
tardives de de Bry ont deux fonctions majeures : la première consiste à dénoncer les
violences des catholiques, qui se comportent comme des monstres sanguinaires outremer, mais aussi celles qui eurent lieu au Nord de l’Europe, et qui engendrèrent la mort de
plus de deux mille protestants (Wallerick 2010 : 35). La deuxième exprime la volonté
des protestants « […] de s’implanter dans un nouveau territoire, pour vivre leur religion »
(Ibid. : 40). Ces deux volontés s’inscrivent pour l’auteur non seulement dans la guerre
des religions, mais dans la guerre des images que celle-ci a engendrée.
L’image du cannibale résulte de la découverte d’un homme nouveau, dont on
peine, au moins jusqu’au XVIIIe siècle, à accepter la pleine humanité. Cette partie de
l’iconographie nous permet de constater des différences notables du traitement visuel de
cet homme qui fut l’objet d’une grande fascination. Bien que ces diverses images varient,
leur fonction demeure toujours associée à un procès de légitimation du projet colonial.
2.2 Le cannibale dans la caricature : contre la France révolutionnaire
Le renversement iconographique de Théodore de Bry est réinvesti par les
caricaturistes du XVIIIe siècle. Les événements de la fin de ce siècle génèrent un regain
d’intérêt pour la caricature laquelle, comme cela s’est produit du temps des guerres de
religion, devient le vecteur d’attaques métaphoriques à partir de faits sociaux et politiques
(Poletto 1990 : 175). Alors qu’au XVIe siècle, la pratique de la caricature sert notamment
la guerre entre protestants et catholiques, elle est souvent employée, au XVIIIe siècle,
pour dénoncer les positions et bouleversements politiques d’une nation ou, au sein d’une
seule nation, pour ridiculiser un ou plusieurs opposants politiques. Car, la caricature a
pour fonction première d’initier une attaque par l’image95. Comme le démontre Mike
Goode (2010 : 127), maints spécialistes de la caricature insistent pour présenter leur objet
comme outil « rationnel » visant à altérer l’opinion publique en concentrant leur analyse
sur l’identification du public en question. Goode s’attarde sur les limites des effets de la
caricature comme outil de persuasion. Ainsi, parvient-il à l’envisager comme un médium
95
De fait, le mot caricature vient du verbe caricare, qui veut dire « charger ».
�54
qui constitue une ouverture nouvelle sur la notion de public96. En tant que la caricature
s’adresse à un public large, elle rend possible, notamment par l’entremise d’une mise en
dérision du corps du sujet représenté, « […] l’ajout et la soustraction de plus de types de
personnages et de situations où ils peuvent agir » (Ibid. : 122) et ce, en fonction des types
de personnages déjà existants dans les domaines iconiques en vigueur97. Ainsi, Goode
identifie des fonctions qui concernent la caricature en général. Afin de situer la fonction
singulière de la caricature avec cannibale, nous lui empruntons l’idée du primat de la
caricature comme attaque au corps, afin de pouvoir insister sur ce médium comme lieu
possible d’une décomposition, d’un démembrement et de la déformation des corps
représentés. Nous concentrons cette part de l’analyse sur des gravures anglaises et
françaises, parmi lesquelles des images avec cannibales ont vu le jour, toujours en lien
avec la Révolution française. La caricature a pris un tournant très politique à la fin du
XVIIIe siècle, et Victor I. Carlson (1984) parle de cet essor comme étant concomitant de
la montée de la propagande politique « négative » contre la Révolution française (12). La
constellation des déplacements de ces images en Europe, au même titre que le contrôle de
leur production, sont autant d’éléments qui structurent les réflexions de cette section de
notre mémoire.
Les attaques contre la France par l’image ont été particulièrement nombreuses en
Angleterre, en raison de la guerre qui oppose les deux pays à partir de 1793 (Loussouarn
2015 : 2), mais également en raison du fort mouvement de résistance à la possibilité d’un
renversement de la monarchie anglaise identique à celui que la France a entamé en
178998. En ce qui concerne le domaine de la caricature, le plus connu des défenseurs
96
Goode va dans le sens de Todd Porterfield (2010 : 6) qui, dans l’introduction de l’ouvrage The
Efflorescence of Caricature, 1758-1838, insiste sur la difficulté que pose la mesure des effets réels de la
caricature et de son efficacité politique.
97
Notre traduction d’un passage de la citation suivante : « What I am suggesting is that to the extent that
caricatures functioned to install a sense of the public as itself a kind of caricature collection moving through
calendrical time, they further implied that the main formal […] possibilities for change lay in adding and
subtracting character types and kinds of situations in which they might perform ».
98
Une exposition des divers affronts par la caricature à la Révolution française a eu lieu à Londres dans la
galerie de Hollande en février 1790, réunissant le travail de caricaturistes français, mais aussi anglais,
comme Gillray et Rowlandson (Adhémar 1979 : 167). Les Anglais ne sont pas les seuls à avoir exploité la
caricature contre les Français. Le cas de la Russie, bien que nous ne nous y attardions pas, est
particulièrement intéressant : « A 200 year-old ban on personal caricature was lifted specifically so that
Napoleon could be attacked » (Bryant 2006 : 59).
�55
d’une Angleterre parlementaire et conservatrice est James Gillray. Il consacre une part
importante de sa production à ridiculiser la France républicaine. Un Petit souper à la
Parisienne or a famille de sans culottes refreshing after the fatigues of the Day (Figure
11) constitue un parfait exemple de sa prise de position politique, laquelle a été
grandement commentée (voir notamment Bryant 2006 ; Loussouarn, 2015).
Figure 11. James Gillray, Un Petit souper à la Parisienne or a famille de sans culottes refreshing after the
fatigues of the Day, 20 septembre 1792.
Les personnages de cette gravure, s’ils ne gisent pas morts ou morcelés, prêts à
être ingurgités, sont montrés en plein acte de cannibalisme. L’identité des sans-culottes
est mise en évidence de manière littérale. Ce sont évidemment eux, les bourreaux. Du
temps de la Révolution française, par ailleurs, on ne manquait pas de traiter le peuple
« […] ces amis fidèles de la liberté, de cannibales » (Robespierre cité par Arasse 1987 :
190)99. À demi nus, les cannibales logent ici dans un espace en décomposition. L’un de
ces prétendus révolutionnaires est assis sur un grand sac d’objets précieux, dite la
99
Châteaubriand écrira, au sujet de la guillotine dans son témoignage de juillet 1789: « J’ai horreur de ces
festins de cannibales » (cité par Arasse 1987 : 40).
�56
« propriété de la nation », alors que d’autres objets pillés alimentent le feu ou parent les
enfants. Ici, c’est le pauvre qui mange le puissant, qui jouit de ses richesses et de sa chair.
Sophie Loussouarn affirme, au sujet de ce cannibalisme, qu’il s’agit d’une « […]
métaphore de la folie autodestructrice ou du parricide constitutionnel qui anéantit toute
forme de tradition et de hiérarchie » (2015 : 5)100. Nous ajoutons à cet égard que cette
gravure, où les valeurs de la nouvelle République française inscrites sur le mur partagent
l’espace visuel avec les terribles violences cannibales et la décapitation, renvoie à la
contradiction inhérente de ces mêmes valeurs, de liberté et d’égalité. Il n’est pas étonnant
que cette scène de Gillray se joue à même l’espace civil. Le cannibalisme se présente
comme une remise en question métaphorique de la nouvelle civilisation française et de
ses fondements, dans la mesure où elle est ici représentée comme violant les limites de ce
que l’on nomme civilisation101 ; elle s’en prend au corps social de la monarchie.
Rappelons que cette planche a été produite un jour avant que le Congrès national français
ne décrète l’abolition de la royauté (21 septembre 1792). Ainsi, l’heure de la mort du roi
ne tarderait pas à sonner.
La tête sur la table ainsi que les multiples têtes accrochées, visibles à travers la
fenêtre, sont d’évidents débris de la décapitation. Ici, le « Peuple en corps » dévore non
seulement le symbole d’une noblesse que la Révolution cherche dorénavant à éradiquer,
c’est-à-dire sa tête, mais aussi ses membres et ses entrailles, œuvrant ainsi à la disparition
du corps entier de l’Ancien Régime. Daniel Arasse (1987) a certes su démontrer que la
guillotine constitue non seulement l’emblème de la Révolution française, mais l’image
sociale de la nouvelle République. La tête du roi, détaché de son corps, produit le peuple
uni.
« […] avec le renversement de la monarchie dans le corps de son roi, se dessine l’émergence
d’une catégorie et d’une image fondamentales dans l’idéologie républicaine, celle du
« Peuple en corps ». C’est en son nom que ses représentants ont voté la mort du roi […]. En
conduisant le peuple à se rassembler autour d’elle pour être témoin de la mort de son tyran, la
guillotine doit contribuer aussi à balayer l’image du peuple-populace de cannibales pour en
manifester l’unité grandiose et digne. La guillotine métamorphose symboliquement le nom
100
Notre traduction du passage suivant: « The cannibalism of the sans-culottes is a metaphor of selfdestructive madness or of constitutional parricide which swept away all tradition and hierarchy ».
101
Gillray illustre d’ailleurs ironiquement, quelques mois plus tard, soit le 17 décembre de la même année,
la liberté française, à l’aide d’une figure affamée.
�57
même du peuple : par son calme, le peuple manifeste jusqu’en son nom sa régénérescence; il
devient le Peuple (Arasse 1987 : 80).
Gillray détruit complètement cette image républicaine d’un peuple digne. Ainsi, le
caricaturiste participe d’une violence contre le peuple en en faisant un acteur terrifiant, et
ce, au nom de l’idéologie royaliste et contre l’idéologie républicaine102. L’histoire de la
Révolution française est l’histoire d’une classe qui en renverse une autre. Mais alors que
cette image met en scène la violence d’un « peuple sauvage », elle rend invisible la
violence des deux autres classes impliquées dans la Révolution française. D’abord, celle
de la monarchie, la classe renversée, mais aussi celle de la bourgeoisie qui a
instrumentalisé le peuple au profit de cette révolution, qui est en réalité garante de son
émancipation propre. Plus que la violence réelle du peuple, c’est la terreur de son
émancipation dévastatrice, telle quelle imaginée, qui traverse cette caricature.
La production et la circulation des gravures de Gillray ont été facilitées d’une part,
par la popularité grandissante de la presse et de la gravure comme médium, mais
également par l’appui de la monarchie anglaise et le financement d’un « […] comité
d’hommes de droite nommé Association for preserving Liberty and Property against
Republicains and Levellers » (Adhémar 1979 : 167)103. Ainsi, Gillray a pu produire
d’innombrables caricatures contre les Français sans craindre la censure, contrairement
aux Français qui eux, s’ils s’en prenaient aux républicains ou plus tard à l’Empire
napoléonien, risquaient beaucoup. Gillray signera librement quarante estampes qui
ridiculisent Napoléon suite à l’arrivée en Angleterre, en 1796, des premières caricatures
produites en France de façon anonyme et mettant en scène le consul104. Les services
officiels de censure, sous le régime de Napoléon, interdirent la libre circulation de la
presse et, en conséquence, de la caricature105. Pourtant, comme le prouve le livre de
102
Le peuple est un acteur essentiel dans la construction discursive entourant la guillotine, tant du côté des
républicains que de celui des royalistes. Le peuple est le principal spectateur, celui au nom duquel on
décapite. Ainsi, ses prétendues réactions sont-elles mobilisées dans des constructions idéologiques. Voir
notamment le chapitre « La mort du roi » dans (Arasse 1987 : 65-93).
103
Soulignons cependant que plusieurs Anglais ont espéré voir advenir une « révolution anglaise ». Thomas
Paine est d’ailleurs l’un des plus importants défenseurs d’une telle révolution.
104
Rappelons en effet que Napoléon n’est pas sacré empereur avant 1804.
105
Clerc souligne la difficulté à identifier le public exact de ces caricatures et tente d’en élucider les
diverses composantes, à l’aune de la complexité du langage caricatural. Si les royalistes sont les principaux
�58
Catherine Clerc où sont imprimées 178 gravures contre Napoléon, les caricatures
françaises opposées à Napoléon sont loin d’être rares. Même si « […] peu de
caricaturistes [oseront] sous l’Empire revendiquer la paternité de leurs œuvres » (Ibid. :
29). C’est d’ailleurs le cas des illustrateurs des images de Napoléon représenté en
cannibale.
Nous présentons deux caricatures où Napoléon est montré en allélophage. La
première (Figure 12), non titrée, est diffusée le 15 novembre 1813. Elle fait allusion à la
campagne d’Allemagne (Clerc 1985 : 152), au cours de laquelle Napoléon perd non
seulement la bataille, mais également de nombreux hommes et généraux. La gravure
montre un Empereur épris d’une véritable faim de bœuf dévorant des soldats, dont la mort
est en réalité provoquée par ses décisions militaires. Et les « rois » déféqués, encore par
ce même homme, montrent l’autre versant de la dénonciation qui habite cette caricature,
lequel concerne les politiques impériales de Napoléon. De fait, la caricature dénonce les
effets de ces politiques : elles n’ont pas répandu la démocratie, mais engendré et renforcé
un nouveau régime impérial. À en lire le texte manuscrit en haut à gauche, cette
dénonciation touche le projet napoléonien de façon beaucoup plus large106.
L’autre caricature porte le titre L’Ogre dévorateur du Genre humain (Figure 13),
date de 1814. Ce titre métaphorise le désir dévorant de Napoléon en ciblant des enjeux
géopolitiques spécifiques que la bannière en haut de l’image énumère : la guerre
d’Espagne et la campagne de Moscou. Des membres humains à la bouche, Napoléon
affirme sa domination sur deux hommes, parmi lesquels se trouve un Français, comme le
suppose la feuille qu’il tient en main, où est inscrite la phrase : « Je soutiens ma mère »
(ma patrie). Dans ces deux dernières gravures, la caricature sert d’arme au caractère
conquérant de l’entreprise napoléonienne. Le cannibalisme illustre un rapport
disproportionné entre une figure qui incarne une puissance absolue et de piètres sujets qui
la subissent, puissance actualisée par le biais de la conquête européenne.
utilisateurs de la caricature contre Napoléon (Ibid. : 42), les membres du peuple qui ne maîtrisent pas le
langage écrit sont investie comme leur premier public (Ibid. : 33).
106
Voici ce que dit le texte en manuscrit en haut à gauche de l’image : « L’Ogre corse sous qui nous
sommes, Cherchant toujours nouveaux explois (sic) : Mange par an deux cent mille hommes, Et va partout
chiant des rois » (Clerc 1985 : 152).
�59
Figure 12. Anonyme. Sans titre, 1814, Eau-forte, 1,8 x 2,3 cm.
Figure 13. Anonyme, L’Ogre dévorateur du genre humain, 1814 ou 1815.
�60
Pour Catherine Clerc (1985), les attaques contre Napoléon sont indissociables des
enjeux politiques en lisse et démontrent que « des déceptions accumulées et le sentiment
diffus d’une trahison manifeste de l’acquis révolutionnaire provoquent au gré des crises
et des événements une opposition sourde et bientôt générale de la population française »
(Ibid. : 46). L’auteur insiste également sur le fait que la caricature contre Napoléon
constitue une attaque à l’art officiel qui « […] participe, en définitive, d’une stratégie de
sacralisation (de son pouvoir), élaborée, en ses détails les plus infimes par l’empereur luimême », dans la mesure où elle « […] compromet l’efficacité des représentations
officielles du régime impérial » (Ibid. : 19). Ce régime est d’ores et déjà traversé par les
contradictions qui habitent ces diverses représentations. Il est en effet fondé sur le
renversement d’une monarchie dont la structure agit encore, si ce n’est de façon
spectrale, au gré de l’instauration institutionnelle de la République favorisée par la
légitimation idéologique, mais aussi par la légitimation du peuple désirant voir ses
conditions améliorées. C’est ainsi que Clerc conçoit le corps de l’Empereur comme un
corps déchiré entre le corps impérial représenté, corps unique, et le corps réel, corps du
peuple ou multiple. La caricature attaque le corps même de Napoléon comme lieu d’une
déchirure. Elle s’en prend à l’image « […] divine, image intouchable, corps éternellement
jeune, courbes physiques régulières et sans prise possible, visage harmonieux et
digne […] » (Ibid. : 62) que portent les représentations officielles. Comme Arasse, Clerc
souligne la persistance d’une métamorphose du corps social incarnée par le corps du
dirigeant. Dans ces dernières caricatures, Napoléon est mis à nu. Il ingurgite ces corps qui
le constituent, qui constituent son Empire.
La catégorie de la caricature montre pour la toute première fois un cannibalisme
qui implique directement des nobles et des puissants attaqués dans et par l’image, qu’ils
soient les bourreaux ou les victimes. Mais alors que Gillray met en scène la violence faite
au noble pour la dénoncer, les graveurs français anonymes dénoncent la virulence de
l’empereur qui prétend leur apporter le salut et celui de l’Europe entière. Dans les deux
cas, le cannibalisme renvoie à de nouvelles puissances politiques engendrées par la
Révolution française, par un changement de régime politique. Ainsi, le cannibalisme ne
�61
se produit plus dans le lointain, mais au sein même de l’Ancien Monde, de la société
civile et politique.
2.3 L’image mythologique : un cannibalisme de l’hybris
Bien que la gravure s’avère être le lieu privilégié de représentation du
cannibalisme, il faut noter quelques exceptions qui toutes, relèvent de la production
d’images mythologiques et, plus spécifiquement, de la figure de Saturne montrée en plein
acte de dévoration. La figure de Saturne mangeant un de ses fils apparaît rarement au sein
de l’iconographie mythologique avant Goya. Parmi ses rares représentations, on ne
compte que deux tableaux peints, parmi lesquels celui de Pieter-Paul Rubens107 : Saturne
dévorant son fils (Figure 14)108.
Ce tableau, commandé en 1636 par le célèbre mécène Philippe IV, roi d’Espagne
de 1621 à 1665, nous mène au plus près de notre problématique, car le cannibalisme qui
s’y révèle ne concerne pas que les dieux représentés109. Saturne, en effet, peut être
envisagé comme une exemplification du pouvoir royal, ainsi que nous allons le rappeler.
Contrairement à la caricature et à l’image coloniale où le cannibale sert à la
représentation d’un ennemi, ici, le sujet du tableau a pour fonction la production d’un
imago politique à l’intérieur duquel le roi se projette avec hybris. La représentation des
aristocrates en dieu mythologique était certes commune à l’époque et particulièrement
107
L’autre tableau est une huile sur toile de Giulia Lama (1681-1747). La date exacte de sa production est
inconnue.
Voir : http://arte.cini.it/sicap/opac.aspx?WEB=CINI&OPAC=ALTS&TBL=OA&ID=496888. Consulté le
13 avril 2016.
108
Parmi les représentations de Saturne dévorant, notons certains dessins du Parmesan et d’Andrea Sacchi,
et une sculpture de Simon Hurtrelle (1699). À partir de la Renaissance, l’usage pluriel des médiums pour la
production des représentations mythologiques n’est pas rare, que ces médiums servent de lieu de pratique,
de modèles de copies pour les artistes, ou encore d’ornementation aux églises, aux domaines princiers et
autres. Nous considérons ainsi que les exemples italiens ne sauraient être entièrement écartés de l’horizon
de références sur lequel Rubens a pu s’appuyer pour produire cette œuvre, d’autant plus que son succès, en
tant qu’artiste clé de la Contre-Réforme, se fonde sur un style fortement nourri par son éducation en Italie,
où il passa environ huit ans.
109
Il faut distinguer le cannibalisme de l’anthropophagie, qui fait nécessairement référence à « […] tout
animal mangeant un homme […] » (Vandenberg 2014 : 19), mais aussi de la théophagie. « […] Dionysos
n’est pas seulement le dieu du vin, il est le vin. En le consommant, on devient non pas anthropo- mais
théophage. Mais cette théophagie n’est pas du cannibalisme. Cannibale est seulement le dieu qui mange un
dieu, ou l’homme qui goûte aux chairs ou au sang de l’être humain » (Nagy 2009 : 101).
�62
chez les rois110. Cela dit, Philippe IV ne saurait s’être projeté en Saturne comme Louis
XIV en Apollon, ce dernier ayant étayé sur cette figure, de son jeune âge à ses vieux
jours, une extravagante construction de lui-même111. La figure monstrueuse de Saturne ne
saurait répondre à un simple fantasme de gloire et de prestige; aucun monarque n’a
intérêt à être identifié à un dieu qui dévore ses enfants. Si le roi s’y peut projeter, c’est
dans la mesure où il y a rencontre entre l’histoire de Saturne et la situation politique qu’il
se doit d’endosser.
Figure 14. Pieter-Paul Rubens, Saturne dévorant son fils, 1632.
110
Notons toutefois que la peinture mythologique de Rubens n’intéressait pas seulement les rois. « Pour de
multiples tableaux non religieux, surtout les paysages, les scènes de genre et allégories mythologiques, les
commanditaires ne sont pas connus, mais un nombre considérable d’entre eux furent sans aucun doute
exécutés pour la haute bourgeoise, qu’elle fût ou non anversoise » (Devisscher 2004 : 68).
111
Voir l’excellent article de Stanis Perez (2003) : Les rides d’Apollon : l’évolution des portraits de Louis
XIV.
�63
Le Saturne de Rubens a été peu commenté. Il ne fait l’objet que d’une brève
mention dans l’excellente analyse de Svetlana Alpers (1971), portant sur les œuvres de
La Torre de la Parada, qui est son lieu premier d’exposition. Nous souhaitons, au gré des
prochaines pages, comprendre comment Rubens en est venu à produire un tel sujet en
peinture qui, au moment de son apparition, relève de l’inédit. Le caractère en quelque
sorte aberrant de ce tableau nous invite à interroger le contexte de sa production qui, seul,
nous permet de saisir les conditions de possibilité de son émergence et une valeur
d’unique précédent pour la compréhension du cannibalisme chez Goya.
Le sujet saturnien s’inscrit dans une série inspirée des Métamorphoses d’Ovide
entièrement composée par Rubens lui-même, comme le prouvent les esquisses
cataloguées par Alpers (1971 : 34). Le fait que le Saturne ne soit pas une création
autonome participe à expliquer sa raison d’être ; sa légitimation est avant tout littéraire.
Les Métamorphoses ont fait l’objet d’un nombre impressionnant de créations en peinture
chez les artistes baroques112. Or Ovide, comme le note Alpers, ne raconte pas le
cannibalisme du dieu (Ibid. : 98)113. La série de Rubens comprend de fait des références
ovidiennes et non ovidiennes114. On ne saurait donc saisir son sens sur une base
strictement littéraire ; le peintre se permet une liberté par rapport au texte d’Ovide en
choisissant de peindre la scène de cannibalisme. Il est à cet égard intéressant de noter que
c’est Rubens lui-même (et non les artistes de son atelier) qui peint cet épisode115. Cela
112
Les Métamorphoses ont fait l’objet d’un nombre impressionnant de créations en peinture chez les
artistes baroques Voir à cet égard les deux volumes Les Métamorphoses : illustrées par la peinture baroque
(2003).
113
Ovide ne retient pas cet évènement du texte d’Hésiode, contrairement au mythe des origines auquel
Saturne appartient. « The Hesiodic character of the Metamorphoses is one of the least discussed aspects of
Ovid’s epic, although the importance of Hesiod declares itself in the opening lines. Ovid starts with Chaos
(Met. 1. 5-7) and to begin with Chaos is to begin with Hesiod’s Theogony […]. Ovid effects a transition
from the Theogony to the Works and Days by revisiting the Hesiodic myth of the five ages (Op.109-201;
Met.1.89-150). As a result of the human race’s moral decadence, Jupiter causes a deluge and the universe
returns to its chaotic form (Met.1.244-312) (Ziogas 2011: 249-50) ». Le passage sur Saturne dans Les
Métamorphoses paraît dans le Livre 1(Ovide 2010 : 52-58).
114
Svetlana Alpers insiste cependant pour dire que cette série doit être considérée dans son ensemble
comme une version autonome d’une série ovidienne (1971 : 78).
115
Au sujet des divers artistes ayant participé à la création des tableaux de la série ovidienne de Rubens,
voir Alpers (1971 : 34).
�64
dit, le tableau ne semble pas occuper une place privilégiée dans la série, même si cette
œuvre représente la plus violente des 63 scènes mythologiques.
Nadeije Laneyrie-Dagen (2003 : 267) insiste pour dire qu’il ne faut pas chercher
un programme cohérent pour comprendre les œuvres de la série ovidienne de Rubens,
lesquelles forment selon elle « […] un ensemble assez hétéroclite », alors que Svetlana
Alpers (1971) y voit une tendance générale, qu’elle articule comme l’illustration
volontaire de la proximité entre les figures divines et les figures humaines116. Elle pense
cette caractéristique comme relevant de l’œuvre d’Ovide lui-même, bien que cette
proximité ait été selon elle intensifiée par Rubens, puisque les actions des dieux soustendent des sentiments plus humains que divins117. Cette intensification de l’affect
proprement humain passe par une « déshéroïsation » des figures divines (Ibid. : pp.153157). Nous considérons que cette désacralisation opère deux fonctions majeures. La
première, brièvement mise en lumière par Alpers, consiste à harmoniser la mythologie
avec l’esprit chrétien, à éviter toute confusion entre la représentation des dieux antiques
et l’idolâtrie. La deuxième, affirme un principe de transcendance liant dieux et
hommes118.
Il est évident que le caractère humain des dieux gréco-romains favorise
l’identification des hommes à ces figures antiques. Cette interprétation nous mène sur la
voie de la question qui nous intéresse : dans quelle mesure Philippe IV aurait-il pu
s’identifier à l’abominable figure de Saturne dévorant? Voire à celle de son fils?
116
Notons en effet que Svetlana Alpers traque les emprunts iconiques qu’a effectués Rubens aux
illustrations gravées des Métamorphoses (1971 : 79-100). « About half of the narrative works based on
Ovid’s Metamorphoses in the Torre series derive from the tradition of Ovid illustrations ». De la même
manière, elle insiste sur la proximité de la série avec les contenus du texte antique (Ibid. : 155). Ainsi, bien
qu’Alpers ne reconnaisse pas de programmation spécifique pour la série (Ibid. : 99), elle parvient à
identifier ses similitudes avec l’horizon iconique et textuel dont elle découle. Mais le Saturne de Rubens ne
relève pas de l’illustration.
117
Alpers s’appuie sur l’analyse littéraire de Brooks Otis dans Ovid as an Epic Poet (1966). Selon ce
dernier, une tension d’ordre générique habite l’œuvre antique, entre le désir de faire une œuvre épique et
celui de maintenir la structure poétique. Ce conflit se traduit dans la difficulté à rendre à la fois l’idéalité
héroïque des dieux et l’expérience des passions humaines (Alpers 1971 : 155).
118
Cette proximité est d’autant moins chrétienne que, si les chrétiens ont forgé l’homme à l’image de Dieu,
les Grecs, puis les Romains après eux, ont plutôt forgé des Dieux à leur image. Cette automimesis
deviendra clé dans la conception de la beauté idéale antique de Winckelmann (Michaud 2015 : 87-94).
�65
Une des causes pourrait reposer sur le fait que le roi d’Espagne est un fervent
chasseur. Le tableau se trouve d’ailleurs à la Torre de la Parada, « […] dans les réserves
giboyeuses du Pardo, où [il] aime à chasser » (Laneyrie-Dagen 2003 : 266). C’est la
raison pour laquelle plusieurs tableaux de cette série, parmi lesquels le Saturne, peuvent
être interprétés comme des allégories de la chasse (Ibid.), qui constitue alors un loisir
noble :
En faisant figurer la guerre, la chasse, la musique profane et la danse, théoriquement
interdites du clergé, dans les livres de prières, l’aristocratie laïque, mais aussi plus d’un
membre du haut clergé, définissent leur statut à l’aide des plaisirs profanes (Wirth 2011 :
277).
Jean Wirth et Georges Sabatier (2010) démontrent comment, au XVIe siècle,
commence à se manifester un langage artistique qui fait concurrence aux représentations
religieuses, langage auquel il s’agit de rattacher la chasse et ses allégories. Ce nouveau
langage est, dans le cas de la série ovidienne, réservé avant tout à la contemplation du roi
et de son entourage proche. « Situé […] dans le Palace du Pardo, le site de la Torre de la
Parada est complètement inaccessible aux visiteurs »119
(Alpers 1971 : 29).
Contrairement au dispositif de visibilité des possessions artistiques du roi120, dispositif
indispensable à la propagation et au maintien de sa puissance par l’image à l’intérieur de
ses territoires comme à l’international, la série ovidienne appartient au domaine privé du
roi. « Le « public » visé serait dans ce cas la postérité » (Sabatier 2010 : 42). Ainsi, la
fonction de la violence dans le tableau de Rubens ne concerne immédiatement que le roi,
son premier destinataire.
Au détour d’une partie de chasse, Philippe IV voit le Saturne dans la Torre de la
Parada, cet endroit retiré du monde où il circule plutôt solitairement121. Saturne en ce
119
Notre traduction de: “Situated as it is near Generalissimo Franco’s official residence in the Pardo Palace,
the site of the Torre de la Parada is completely inaccessible to visitors”.
120
Ce dispositif se doit de rejoindre un public assez large. Au sujet des cinq grands groupes de destinataires
de la production royale de peinture ainsi catégorisé par Georges Sabatier voir Le Prince et les arts,
stratégies figuratives de la monarchie de la Renaissance aux lumières (2010 : 42).
121
Plusieurs témoignages de l’époque adresse la tendance du roi à la solitude. Par exemple, il fut dit qu’en
Espagne, la réception des ambassadeurs étrangers et la tenue d’audiences a été favorisée par « […] la
sédentarisation de la cour […] à Madrid avec Philippe II » (Ibid. : 382), mais du temps de Philippe IV
« […] La cour d’Espagne paroît déserte au prix de cette nombreuse quantité de gens de qualité qui
offusquent celle du Roi [de] France et qui la remplissent » (Motteville cité par Sabatier 2010 : 410).
�66
tableau de Rubens, au corps vieilli, courbé, croque l’enfant sans défense et lui dévore le
cœur. La violence est montrée sans tabou, ce qui relève l’intensité de la scène malgré ses
teintes grisâtres. Ces gris sont les gris des nuages, teintés de bleu, sur lesquels le dieu
sévit, dans l’isolement le plus total. Rappelons que Saturne mange ses enfants afin de
n’avoir pas à céder son règne à aucun d’entre eux. Ce plan échoue amèrement, car sa
femme Rhéa sauve leur fils Jupiter en le remplaçant par une pierre dissimulée sous des
langes qu’elle donne à manger à Saturne, ainsi trompé (Salles 2007 : 54). Philippe IV
contemple donc l’acte de dévoration qui est à la fois une stratégie de maintien et la
promesse de la chute du pouvoir de ce dieu. Car Jupiter en effet, le lui dérobera.
L’isolement du Saturne et du roi qui le regarde, au même titre que le mythe
hésiodique, lui confère une valeur mélancolique, voire tragique. D’ailleurs, notons qu’au
moins depuis le Siècle d’or, les rois d’Espagne sont perçus comme des êtres
mélancoliques122, d’humeur noire123. Le tableau de Rubens porte par ailleurs l’empreinte
de certaines images qui, à partir de la Renaissance, représente un Saturne mélancolique
dans une posture qui s’apparente à certains égards seulement à celle de la figure peinte.
Celui-ci est en effet généralement courbé, positionné en angle au niveau des hanches, le
regard vers le sol, souvent assis124. L’aspect mélancolique est, dans le cas précis qui nous
intéresse, intensifié par la relation violente entre le père et le fils et donc, par le fait même
de la dévoration.
122
Philippe II, le grand-père de Philippe IV était certes considéré comme un grand mélancolique (Parke
2006 : 56). Ainsi, Rubens, comme Velasquez, produit des portraits de Philippe IV qui révèle de lui ce
caractère mélancolique.
123
Une telle conception concerne également le tempérament du peuple espagnol. Celle-ci était justifiée,
d’une part, par certaines interprétations de textes religieux et scientifiques, mais aussi par le fait que
l’Espagne est située dans la région méridionale, où règne Saturne (Bodin 1986 : 27). Cette construction est
renchérie à la fois par les Espagnols eux-mêmes et par les étrangers, notamment à travers les écrits des
voyageurs venus d’Europe (Orobitg 1995).
124
Or, le Saturne de Rubens n’a pas la tête appuyée sur un bras replié, contrairement au Saturne des
représentations de la Renaissance. Klibansky, Panofsky et Saxl démontrent que le traitement
« délibérément » classique du dieu de la Renaissance produit un écart par rapport aux représentations de la
fin du Moyen âge qui le figuraient plutôt en paysan ou en dévorateur d’enfants (1989 : 342). Ainsi, en
peignant l’acte cannibale, Rubens reprend un motif qui avait été écarté au courant de cette période. Parmi
les images de la Renaissance analysées par les trois auteurs, compte le Saturne de Giulio Campagnola
datant du XVe siècle, dont les motifs furent par ailleurs grandement reproduits, où l’on peut constater
Saturne dans la pose classique (Ibid. : 336).
�67
Rappelons que Philippe IV n’a que 16 ans lorsque s’éteint son père, Philippe III,
et qu’il devient roi (1621). Il est très jeune et doit rapidement répondre à de périlleux
impératifs. Parmi ceux-ci, il faudra nommer une crise économique, l’épuisement
progressif des ressources coloniales (métaux précieux) et la guerre de Trente Ans.
Philippe IV hérite d’une situation politique complexe et d’un territoire difficile à
entretenir. Il a été souvent reconnu, même en son temps, comme celui qui a favorisé
l’affaiblissement de l’autorité espagnole sur les vastes territoires que Charles Quint et
Philippe II s’étaient appropriés, déclin qu’il parvint à compenser en quelque sorte par le
biais du mécénat, en devenant le plus fervent acheteur d’art de son temps (Camp 1943 :
23). Un débat existe cependant parmi des historiens concernant la responsabilité du roi
quant à la chute de la monarchie espagnole et à sa succession aux Bourbons qui suit de
peu le siècle d’or (Hume 1912 ; Hugon 2014). Quoi qu’il en soit, l’art peut certes être
pensé comme le domaine qui a servi de compensation à ses faiblesses politiques, voire à
ceux de ses prédécesseurs. Ainsi dirons-nous que le Saturne porte l’expression même de
la puissance royale en tant que l’existence du tableau dépend de celle-ci.
Ce tableau est commandé dans un contexte de nécessité de réaffirmation du
pouvoir politique espagnol sur la Flandre. Si le roi fait appel à Rubens, c’est non
seulement parce que l’art de Rubens est grandement prisé et parce que son style incarne
les idéaux italianisants de la Contre-Réforme, mais c’est également parce que ce choix
est, pour le roi, politiquement stratégique125. La Flandre ou plutôt, ce que l’on nomme
alors les Pays-Bas espagnols (Alpers 1995 : 28), est sous la domination de l’Espagne
depuis 1581, soit le moment où est entamée « […] la reconquista des Pays-Bas par
Alexandre Farnèse […] » (Freedberg 1970 : 133) sous les ordres de Philippe II126. C’est
lui qui avait ordonné « […] la restauration du service catholique […] » (Ibid.), la
réparation des églises et la production d’images nouvelles pour pallier aux désastres de
l’iconoclasme et de la Réforme. Au moment de la commande de la série ovidienne, c’est
125
Dabvid Freedberg (1970) insiste sur le caractère déterminant des normes établies par le décret sur la
peinture du Concile de Trente de 1563 (Freedberg 1970 : 131) sur le travail des artistes flamands de
l’époque, notamment sur Rubens.
126
Notons toutefois que c’est « dès la fureur iconoclaste de 1566 […] [que] Philippe II se lance dans une
lutte contre les calvinistes, qui exigeaient la liberté de culte, chose impensable pour la puissante monarchie
catholique » (Wallerick 2010 : 34).
�68
le Cardinal-infant Ferdinand, frère de Philippe IV et gouverneur général des Pays-Bas,
qui assume la gestion de la production d’images sur les territoires flamands. Lors de son
arrivée à Anvers en 1635, c’est à la demande de ce dernier que « […] Rubens dirigea les
travaux de décoration que la municipalité fit réaliser à cette occasion, et Ferdinand
confirma son statut de peintre de cour, maintenant les liens étroits entre le peintre et la
cour hispano-habsbourgeoise » (Devisscher 2004 : 147-48). Cette commande concentre
donc la domination du roi sur la production artistique flamande et sur sa circulation.
Le travail de Sabatier nous permet de comprendre dans quelle mesure la
production de l’œuvre de Rubens—parce qu’elle est œuvre mythologique— s’inscrit dans
un processus d’affirmation de la gloire du roi d’Espagne que l’imaginaire mythologique
pouvait assumer, à l’instar de l’imaginaire chrétien :
En ces temps de bouleversements sociaux (de la première modernité), d’avènement
de nouveaux dirigeants, de modification des processus de gouvernement, la mythologie
fournissait aux pouvoirs princiers le langage spécifique qui leur manquait pour expérimenter
l’absolu de force auquel ils aspiraient et prétendaient. Elle permettait, contrairement au
discours historique, de les arracher à la contingence, de les situer au-delà de la condition
humaine, d’exprimer leur essence, et donc de leur fournir, outre des possibilités
encomiastiques infinies, un outil de légitimation absolu. Le registre religieux chrétien avait
été utilisé par les élites médiévales sur le mode du voisinage, […] mais aucun souverain
chrétien ne pouvait se faire représenter en Christ, alors qu’il pouvait parfaitement l’être en
Jupiter, Apollon, Mars ou Hercule » (Sabatier 2010 : 34).
Bien que, contrairement au portrait, l’œuvre mythologique n’ait pas toujours pour
fonction de représenter le roi, elle lui permet du moins de s’abreuver à même le domaine
symbolique qu’elle déploie, de s’y projeter. La production des portraits « naturels »
historiques du roi accompagnait toujours la production d’œuvres aux contenus
mythologiques, « […] le premier trouvant dans le second l’amplification héroïque dont la
contingence des faits manquait, le second recourant au premier pour sortir du générique
et justifier l’éminence » (Ibid.). Si l’on ne peut dire que le Saturne est une représentation
du roi lui-même, on peut du moins dire qu’il y permet l’identification d’une figure du
pouvoir à une figure mythologique et donc, la construction d’un imago politique qui,
dans le cas du Saturne, porte l’angoisse mélancolique de la décadence politique. C’est
ainsi que nous résumons la fonction de la figure cannibale dans ce contexte, c’est-à-dire
comme véhicule iconique et symbolique de la puissance royale qui est d’un point de vue
�69
politique, vacillante. Saturne dévorant son fils ne quittera jamais l’Espagne et demeurera
pendant longtemps en la possession des rois.
Du temps de Goya, ce tableau de Rubens se trouvait dans la collection royale.
L’espagnol a sans aucun doute connu cette œuvre : le dessin qu’il produit en 1796-97
titré Saturne dévorant son fils en est la preuve (Morgan 2001 : 40). C’est seulement en
1819, au moment de l’ouverture officielle du musée, que le tableau de Rubens est déplacé
dans l’une des salles à l’accès restreint du Prado. Pour Ferdinand VII, alors roi
d’Espagne, il valait mieux le cacher, comme les autres œuvres mythologiques d’ailleurs,
la cour absolutiste étant « […] menacée par les [attaques] des libéraux, a introduit une
forme de pensée progressiste dans la promotion de la culture »127. Ainsi, la stratégie de
Philippe IV avait-elle perdu sa pertinence pour le maintien du pouvoir de Ferdinand VII.
Avant Goya, la tradition figurative du cannibalisme, telle que nous venons de la
présenter, se résume ainsi : d’abord naissent, au XVIe siècle, les images coloniales. En
1632 apparaît une peinture au sujet relativement inédit de Rubens. Du temps de la
Révolution française, Gillray produit une caricature royaliste (1792) et enfin, peu de
temps après, naissent quelques caricatures contre Napoléon et son entreprise politique
(1814-1815). Alors que l’image mythologique et l’image coloniale avec cannibale
avaient pour principale fonction la cristallisation d’un pouvoir politique ou religieux,
mais aussi de légitimer l’expansion territoriale, la caricature dénonce, par le biais de la
métaphore, des pouvoirs politiques nouveaux. Notons cependant que les caricatures
contre Napoléon critiquent par ailleurs les conquêtes de territoires, d’où la représentation
d’une gloutonnerie extrême dont le cannibalisme est le symptôme. Or, seule la peinture
127
Notre traduction d’un passage de la citation suivante: « The Museo del Prado opened in 1819 and, in the
late 1820’s, was being greatly expanded as the huge Spanish royal collection was cleaned, catalogued and
put on public display. The expansion project was in part a public relation exercise on behalf of Ferdinand
VII’s reactionary regime, a signal that the absolutist court regularly threatened by liberal coups, had
introduced somewhat progressive thinking in the state promotion of culture. Wilkie found himself trying to
view the collections in the midst of all this work, and both his and the authorities patience were tried as a
result. Wilkie complained about what he perceived as excessive cleaning of the pictures, and prompted a
minor international diplomatic incident when he was unable to gain entry to the Salas reservadas to which
nude subjects by Peter Paul Rubens, Titian and others were confined » (Tromans 2007: 326-7).
�70
mythologique fait du cannibalisme un sujet noble, et ce au sein d’un tableau d’histoire,
catégorie en tête de la hiérarchie des genres.
L’iconographie du cannibalisme nous permet de constater que la gravure a
constitué un médium d’expérimentation privilégié pour la représentation de l’homme
cannibale et ce, en raison de ses fonctions d’illustration de texte et de son caractère
d’image multiple, à plus grande circulation. Mais elle nous permet également de
confirmer que le cannibalisme n’a, avant Goya, jamais servi à représenter la nature
cruelle de l’homme. Il a plutôt eu pour fonction l’affirmation d’un pouvoir politique que
la violence de l’image elle-même masque et dévoile à la fois. Nous ne souhaitons pas
faire la liste des rapports de l’œuvre de Goya aux images étudiées dans ce dernier
chapitre, bien que nous constations une série d’éléments qui marquent la possibilité
d’emprunts iconiques de la part du peintre. Nous nous intéressons derechef à ce que ces
tableaux font subir à la peinture dans le cadre de son inscription dans le système des
Beaux-Arts. Ils le font à partir d’images qui elles, n’appartiennent pas exclusivement à un
tel système. Dans quelle mesure peut-on, de fait, affirmer que l’horizon de références qui
constitue l’iconographie du cannibalisme travaille le diptyque de Goya? L’ambiguïté,
c’est-à-dire la suspension du cadre général d’appréhension de la peinture propre à l’âge
classique, se donne comme interruption. Toute la tradition interprétative qui aura cherché,
comme nous l’avons démontré dans le premier chapitre, à nommer, à classer les deux
tableaux de Goya, s’exprime comme refoulement du caractère énigmatique des œuvres
ici peintes. Nous chercherons, dans le troisième chapitre, à élucider plus avant l’énigme
que proposent ces œuvres, et ce, en menant une recherche qui nous extirpe
temporairement du domaine de l’image. Nous souhaitons étayer le rapport entre
l’expérimentation iconographique de Goya et sa filiation philosophique aux Ilustrados, à
travers lesquels il découvre et explore la notion de nature humaine. Ainsi pourrons-nous
peut-être enfin comprendre ce que le diptyque de Goya fait subir à cette notion, au gré
d’un contexte philosophique et politique, mais aussi au gré des éléments que ces scènes
de cannibalisme convoquent des antécédents que nous venons de présenter.
�71
CHAPITRE 3
La nature humaine : entre le même et l’autre chez Hobbes, Rousseau et Goya
Ce qui s’annonce dans l’immédiat de l’originaire, c’est donc que l’homme est séparé de l’origine qui le
rendrait contemporain de sa propre existence : parmi toutes les choses qui naissent dans le temps et y
meurent sans doute, il est, séparé de toute origine, déjà là128.
‐
Michel Foucault
Dans quelle mesure peut-on dire que le diptyque de Goya est le lieu d’une
conjoncture singulière réunissant la figure du cannibale et la notion de nature humaine,
en introduisant ainsi des personnages n’ayant jusqu’ici point figuré dans le grand jeu
classique des représentations? Cette question doit être abordée avec prudence ; rappelons
que la perception de Goya comme peintre de la nature humaine constitue l’un des
aprioris les plus répandus de sa fortune critique129. Nous avons en effet constaté que la
violence de l’œuvre du peintre en est venue à être comprise comme l’évidence
indisputable de la vérité intemporelle de notre nature. Ce dernier chapitre a pour objectif
de mettre à jour l’historicité du concept de nature humaine et de délier ainsi le réseau des
discours qui le mettent en tension suivant divers usages : soit l’usage qu’en fait
l’historiographie, soit en tant qu’énoncé des tableaux, ou en tant que concept
philosophique dont il s’agit d’étudier l’émergence singulière du temps de Goya.
Ce chapitre explore dans un premier temps le sens qu’octroient Thomas Hobbes et
Jean-Jacques Rousseau au concept de nature humaine et ce, en restant au plus près de la
piste sur laquelle nous engage le diptyque de Goya130. Nous cherchons ensuite, à même le
contexte charnière qui lie le XVIIIe et le début du XIXe siècle, les preuves d’un contact
128
Foucault 1966 : 343.
Certains auteurs ont fait le lien entre l’œuvre de Goya et la notion de nature humaine articulée par
Rousseau. Cela dit, cette mise en rapport n’a jamais été approfondie. « In Discourse on the Origin of
Inequality philosophe Jean-Jacques Rousseau offered the noble savages an antidote to the evils of European
society. In his view, people living in benevolent nature had been free and equal » (Singletary 2004: 66).
Cette réflexion, Singletary la tire non pas d’une lecture de Rousseau, mais d’une lecture de Franck
Lestringant. Voir également : (Todorov 2011 : 168-169 et Baticle 1992 : 354-5).
130
Ce choix repose sur le fait que les articulations hobbesienne et rousseauiste du concept de nature
humaine nous permettent de le mettre en tension suivant l’opposition binaire que leurs différences
imposent. Ce concept fut également envisagé par les deux philosophes comme fondement théorique à un
nouveau contrat social qui, chez Hobbes, se déploie sous la forme d’une monarchie et chez Rousseau, sous
la forme d’une démocratie parlementaire. Nous verrons dans quelle mesure ces projets politiques
concernent de près la situation politique qu’a connue Goya.
129
�72
possible de Goya avec les discours autour de cette notion. Puis, dans la mesure où les
deux tableaux de Goya ne constituent pas un simple reflet de textes philosophiques — la
peinture pense – il sera question de chercher le sens singulier du concept de nature
humaine qu’engendrent deux œuvres picturales par rapport aux articulations
philosophiques du même concept. En d’autres mots, nous souhaitons alors situer les deux
tableaux de Goya par rapport à des pratiques discursives qui leur sont d’emblée
étrangères ; la philosophie et la peinture constituent deux langages différents.
3.1 Le refoulement du sauvage ou la nature humaine chez Hobbes
Hobbes et Rousseau articulent l’un et l’autre une conception opposée de la nature
humaine. Alors que pour Hobbes, celle-ci serait cruelle et mauvaise, pour Rousseau, elle
serait plutôt bonne. Malgré les voix opposées sur lesquelles nous engage leur thèse, nous
souhaitons étudier leurs textes afin d’y trouver les clés de leur possible rapport au
diptyque de Goya.
Nous ne prétendons pas apporter un nouvel éclairage sur ces textes
philosophiques en dehors de leur possible résonance avec le diptyque à l’étude. Nous
admettons ainsi que les deux tableaux peuvent infléchir notre lecture des textes, qu’ils
nous indiquent la voie même de notre recherche exégétique. Rappelons qu’apparaissent
dans les tableaux en question dix corps qui se ressemblent toutes. Ces figures ont été
assimilées par tous les auteurs de l’historiographie comme représentation de l’Autre, du
« sauvage ». Or, en disant également que ces tableaux sont une représentation de la
nature de l’homme, certains de ces auteurs ont reconduit une confusion que l’œuvre nous
fait voir et que portent également les discours de Rousseau et de Hobbes. Mais alors que
ces derniers produisent, sur le mode d’un classement discursif, une frontière entre d’une
part, l’homme et le non-humain et d’autre part, l’homme primitif et l’homme civilisé, les
tableaux de Goya, eux, montrent des espaces analogues convoquant différemment le
temps et habités par des figures presque identiques entre elles, quoiqu’à l’identité
ambigüe. Ce diptyque détruit
les frontières que maintiennent, du moins
conceptuellement, les discours philosophiques. Ainsi, nous ferons jouer les notions de
�73
l’autre et du même afin de penser, dans leur différence, les œuvres philosophiques et
picturales qui font l’objet de ce chapitre.
La notion d’une nature humaine chez Hobbes entre en tension avec les
fondements de la théologie de son époque. L’ennemi premier de l’œuvre Léviathan
(1651), nous dit Gérard Mairet dans son introduction à l’ouvrage, est le pouvoir
ecclésiastique comme « pouvoir spirituel » qui s’arroge le pouvoir temporel (Hobbes
2000 : 18). Hobbes s’en prend à la prétention à la souveraineté dont font preuve les
institutions religieuses. Le Christ, rappelle-t-il, affirme que son monde est ailleurs
qu’ici131. L’œuvre de Hobbes est radicalement matérialiste dans la mesure où elle pense
l’État comme un ensemble composite de corps où Dieu est tout au plus un mot qu’il
s’agit d’honorer, mais qu’on ne peut concevoir (Ibid. : 93). Puisque tout ce que l’homme
imagine est fini, Dieu est inconcevable pour l’imagination (Hobbes 2000 : 92). Tout au
plus l’homme a-t-il su, par « l’art », imiter la nature, ou l’œuvre de Dieu, création qui
fonde l’imposture du pouvoir divin sur terre. Hobbes, lui, oppose une création lucide
quant à l’imagination de l’homme et son rapport à Dieu et propose le LÉVIATHAN, un
homme artificiel en qui « […] la souveraineté est une âme artificielle, car elle donne vie
et mouvement au corps tout entier […] » (Ibid. : 64)132. Il ne s’agit plus de l’homme à
l’image de Dieu, mais un homme à l’image de lui-même. Cette vision matérialiste
causera beaucoup d’ennuis à Hobbes. Il fut accusé d’athéisme et soumis à l’exil. Son
œuvre articule pourtant avec un effort soutenu le lien entre sa philosophie politique et
morale et les fondements chrétiens.
La philosophie politique et morale de Hobbes prolonge la pensée de Jean Bodin
selon laquelle l’avènement de la volonté souveraine dépend de la perte des libertés
individuelles de chacun (Mairet 2000 : 36)133. Mais là où Bodin fait de la domination par
la force la condition de possibilité de la souveraineté, Hobbes la fait reposer derechef sur
le consentement des sujets et donc, sur leur jugement. Pour Hobbes, la chute adamique a
131
La critique de Hobbes concerne notamment l’interprétation biblique. Son œuvre cherche en partie à en
démentir certains traits. Il dédie à cette question la partie III du Léviathan (Hobbes 2010 : 539-809).
132
À ce sujet, voir le magnifique chapitre « La théorie de l’art comme fondement » dans l’ouvrage
Stratégies visuelles de Hobbes de Horst Bredekamp (2003).
133
Bodin articule sa pensée politique sur la souveraineté dans le livre Les six livres de la République
(1576).
�74
eu pour conséquence l’autonomie du jugement de l’homme qui, comme Adam, en est
venu à devoir discerner pour lui-même le bien du mal. Ainsi le consentement des sujets
au contrat social est-il affaire d’un jugement comme conséquence de la chute. La
désobéissance adamique révèle à la fois l’essence et la finitude de l’homme qui n’a
d’autre avenue, pour sa survie propre, qu’une obéissance civile à un souverain. Car la
force pure de Bodin est pour Hobbes figure d’un état de nature, où « […] chacun [y] est
l’ennemi de chacun […] il [y] règne une peur permanente [...] » (Ibid. : 225). L’état de
nature est un ailleurs étranger à l’état civil, un état de guerre qui n’en finit pas. Dans les
prochaines pages, nous nous attarderons sur l’état de nature en tant qu’il donne lieu à la
figuration d’un espace autre où l’actualité de l’homme et celle du pouvoir du Léviathan
sont suspendues. Nous ne nous soucions pas seulement de dire que le Léviathan « […]
fonde l’imago de la puissance étatique sans l’aide du ciel […] (Bredekamp 2003 :
115) »134, mais nous insistons sur le fait qu’y est dévoilée à même les filets du discours,
l’image de la force que le contrat efface, soit celle de la nature de l’homme. L’état de
nature où s’exerce cette force autre nous intéresse parce qu’il ressemble beaucoup plus à
ce que peint Goya dans les tableaux avec Cannibales que l’image du frontispice du
Léviathan (Figure 15), qui vise la représentation de l’espace civil absolutiste.
Figure 15. Attribué à Abraham Bosse, King and Kingdom, Frontispice de Thomas Hobbes, Léviathan,
1651.
134
Dans cet ouvrage, Horst Bredekamp concentre son analyse sur l’image du pouvoir.
�75
L’état civil tel que l’a représenté Abraham Bosse135 est un espace fermé.
L’horizon qu’ouvre le paysage fait converger l’ensemble des lignes du bas de la gravure
en direction du souverain. Le paysage est déjà toujours écrasé par la démesure de ce
corps composite. En lui, la volonté souveraine et l’obéissance consentie des membres
s’amalgament pour produire une gigantesque figure du même. Ce corps apparaît comme
le résultat d’un assemblage de trois cents figures qui se ressemblent, comme un corps où
le peuple est dévoré et contenu, où l’altérité s’efface rapidement derrière la fabulation et
le langage du Léviathan.
Pourtant, Hobbes nous donne à penser que l’état de nature est un lieu où le corps
unifié des hommes est fragmenté. C’est la « nature de la guerre ». Autrement dit, c’est un
« temps de guerre », un temps d’avant les lois136. Puisqu’il n’y a pas de lois en cet état, il
n’y a donc pas de conception du péché ni de sens du bien et du mal. Le jugement de
l’homme n’opère que pour garantir sa survie. L’état de nature est un espace où le corps
social est toujours déjà fragmenté, où « […] chacun a un droit sur toute chose, y compris
sur le corps des autres » (Ibid. : 231). Chacun se déploie au gré des passions et jouit
également de la jus naturale, de la liberté de chacun « […] d’user de sa propre puissance,
comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa
propre vie et, par conséquent, de faire selon son jugement et raison propres, tout ce qu’il
concevra être le meilleur moyen adapté à cette fin » (Ibid. : 229). La connaissance du
bien et du mal, de la civilité et de la morale est conditionnelle à l’existence d’un état où le
péché est proscrit par la rigidité des lois. Si le pouvoir du Léviathan doit être ainsi absolu,
c’est bien parce que même en temps de paix, la nature humaine subsiste à l’état latent et
donc ses forces naturelles doivent être en tout temps tenues en laisse. L’homme ne peut
être conçu comme étant absolument mauvais qu’a posteriori ou de façon hypothétique.
Malgré la clarté avec laquelle Hobbes en vient à décrire l’état de nature, la
provenance du concept est incertaine. Si l’on porte attention à la manière dont se déroule
l’entrée en scène de ce concept dans l’ouvrage, on remarque qu’il se déploie dans une
135
Un doute règne en ce qui concerne l’identité de celui qui a gravé le frontispice. Bredekamp formule une
démonstration très convaincante attribuant à Wenzel Hollar l’exécution du dessin original et à Bosse, celle
de la gravure qui ne fut exécutée qu’en 1651.
136
« Tout autre temps est la paix » (Hobbes 2000 : 225). Ainsi, ce que l’homme achète par le contrat n’est
pas le salut, mais un état où la protection de sa vie est garantie par l’État.
�76
zone trouble entre le moment où Hobbes tente de « […] déchiffrer le genre humain […] »
(Ibid. : 67) en ses expressions actuelles (la géométrie de sa pensée, son langage, ses
passions) et le moment où il essentialise la nature de l’homme en dépeignant ses plus
horripilantes manifestations. Doit-on comprendre l’état de nature comme objet de
l’imagination, comme une « sensation dégradée » d’une chose vue que le temps même a
obscurcie?
C’est que Hobbes affirme que toute pensée a pour origine une sensation :
« l’esprit humain ne conçoit rien qui n’ait d’abord été, en totalité ou en partie, engendré
par les organes du sens. Tout le reste est dérivé de cette origine. « […] La cause de la
sensation réside dans le corps extérieur (Ibid. : 72) ». L’imagination est faculté qui, par
des mots et d’autres signes volontaires, engendrent des images, mais aussi la
compréhension « […] des conceptions et des pensées qu’il forme par la série et la liaison
[…] » (Ibid. : 84) donnant lieu à des formes de discours, parmi lesquels, le discours
mental. Celui-ci, également nommé « suite de pensées », comporte deux aspects.
D’abord, il y a le discours mental qui mélange les rêves, les superstitions et les images. Il
est dit désordonné ou, plutôt, il est organisé par les passions. Ce discours est une suite
arbitraire de pensées. L’ordre continu de pensées que décrit Hobbes s’articule au
contraire comme une véritable géométrie mentale. Il s’agit d’une zone « ordonnée à un
dessein » (Ibid. : 88) qui est toujours à la recherche soit, des causes et des moyens par
lesquels l’image de l’effet a été produit137, soit des effets que produisent une chose
imaginée. Cette chose peut très bien être l’objet d’une perte qu’il s’agit de rechercher par
l’effort de la réminiscence (Ibid. : 89). Le caractère organisé de ce deuxième type de
discours mental n’empêche pas qu’il soit lui-même affecté par le rêve et autres images
fausses. La différence est que ce type de discours sait les reconnaître et les disqualifier.
Où Hobbes inscrit-il l’état de nature dans le discours mental qu’il a lui-même produit?
Donc l’état de nature est une hypothèse qu’on ne peut faire qu’à rebours. Par
contre, ce n’est pas qu’une pure fabulation puisque Hobbes trouve tout de même, dans le
monde extérieur, la sensation de l’état de nature afin d’en produire l’image. Ce lieu, quoi
137
Cette recherche est considérée commune aux hommes et aux bêtes (Hobbes 2000 : 88).
�77
qu’il n’ait jamais existé sous sa forme absolue, « de façon générale », a bel et bien dû
connaître une forme d’existence, ne serait-ce que relative ou particulière :
Incidemment, on peut penser qu’il n’y eut jamais un temps comme celui-ci, non plus qu’un
semblable état de guerre. Et je crois que, de façon générale, il n’en a jamais été ainsi à travers le
monde, mais qu’il y a beaucoup d’endroits où l’on vit ainsi. En effet, chez les sauvages de
nombreux endroits de l’Amérique, à l’exception du gouvernement des petites familles dont la
concorde dépend de la lubricité naturelle, il n’y a pas de gouvernement du tout, et ils vivent en ce
moment même à la manière des animaux, comme je l’ai dit plus haut (Ibid. : 227)138.
Cette association entre l’état de nature et la manière de vivre des « sauvages » n’a
pas seulement fait l’objet du discours du philosophe. Elle est d’ailleurs, à ce titre, encore
plus explicite sur le frontispice, c’est-à-dire sur l’image qui introduit le De Cive (Figure
16), autre œuvre de Hobbes, où l’état de nature, le domaine de la libertas, est représenté
par le monde des « sauvages ». Cette image de Jean Mattheus trouve des comparables
dans les gravures du Nouveau Monde du XVIe et du XVIIe siècle que nous avons
étudiées dans le précédent chapitre.
Figure 16. Jean Mattheus, Frontispice du De Cive, 1642.
138
Nous croyons pertinent d’inscrire ici la citation telle qu’elle apparaît dans la version originale, étant
donné l’ambiguité de son sens : « It may peradventure be thought, there was never such a time, nor
condition of warre as this; and I believe it was never generally so, over all the world : but there are many
places, where they live so now. For the savage people in many places of America, except the government of
small Families, the concord whereof dependeth on naturall lust, have no government at all; and live at this
day in that brutish manner, as I said before » (1985: 187).
�78
Le détail de cette gravure (Figure 17) nous permet de remarquer « […] des
cannibales préparant les restes démembrés d’un être humain » (Bredekamp 2003 : 144).
Nous avions donc eu tort; là est la première image dans laquelle convergent un
cannibalisme virtuel et l’idée d’une nature humaine. Cependant, dans ce contexte, le
cannibalisme comme expression de la nature humaine se conçoit à l’aune d’une mise à
distance de l’autre dans la mesure où elle préserve l’identité de l’homme occidental alors
que chez Goya, se perd l’intégrité de celui-ci ; l’altérité l’attaque.
Figure 17. Jean Mattheus, Détails du frontispice du De Cive. 1642.
Si l’état de nature et le monde du « sauvage » sont mis à distance par Hobbes, le
rapport entre l’homme civil artificiel et ce même état de nature est beaucoup plus flou ;
car, comme nous l’avons vu, ce rapport relève surtout d’une potentialité. Le sauvage et
son monde, ou l’état de nature qui lui est analogue, sont des figures qui servent davantage
à fonder le discours du philosophe139 qu’à y poser une nouvelle origine de l’homme
émancipé de la chute adamique.
Les figures du sauvage et de son monde ont
certainement affecté l’image même de l’état de nature hobbesien. Mais malgré cela et
malgré le fait que la frontière entre l’état de nature hypothétique et l’état civil nous
apparaît trouble, il nous faut insister sur le soin que Hobbes prend pour la consolider.
Ainsi, la forteresse qui divise l’humanité et le monde de Dieu trouve un analogue dans le
schéma d’une humanité dédoublée, laquelle oscille entre sa nature sauvage et la réalité du
citoyen.
139
Rappelons qu’une importante part de l’œuvre de Hobbes est habitée par cette ambiguïté : « The
Elements of Law, le De Cive et, enfin, le Léviathan justifient […] que le politique ne peut être pensé que par
opposition à un état dans lequel il fait totalement défaut » (Bredekamp 2003 : 116).
�79
3.2 Le mythe du bon sauvage ou la nature humaine chez Rousseau
Rousseau reconduit le schéma hobbesien d`une humanité dédoublée tout en en
réfutant les fondements, tels qu’ils ont été posés par le philosophe anglais. La critique
qu’il lui adresse concerne directement la notion de l’état de nature140. Dans Le Discours
sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes (1755), ouvrage sur lequel porte ce segment
de notre analyse, Rousseau présente le « sauvage » de l’état de nature comme un être de
nature bonne parce qu’il n’a pas d’amour propre141. L’homme est devenu, avec
l’avènement de la société, sujet à une dégénérescence dont le temps n’est pas la seule
cause.
Rousseau présente d’emblée l’état de nature comme raisonnement hypothétique et
conditionnel : « […] plus propre à éclaircir les choses qu’à en montrer la véritable
origine. […] La religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même [a] tiré les hommes
de l’état de nature, immédiatement après la création […] » (1992 : 162). Ainsi, nous ne
saurions facilement affirmer, avec Annie Le Brun (2010), que Rousseau dévoile « la
véritable jeunesse du monde » (137). Il serait cependant injuste de ne pas souligner
l’ambiguïté avec laquelle Rousseau fait parfois usage de la notion d’origine. Il n’hésite
pas à parler de la nature humaine et du lieu où elle opère comme d’une « condition
originaire » (Ibid. : 184). Or, l’état de nature de Rousseau, contrairement à celui de
Hobbes, trouve un proche comparable dans la conception utopique de l’Éden plutôt que
dans la chute entraînée par la consommation du fruit défendu. Comme Hobbes cependant,
Rousseau n’écarte pas intégralement l’origine de l’homme de l’ordre chrétien de la vérité.
140
Cela dit, Hobbes n’est pas le seul philosophe auquel répond Rousseau. Un siècle plus tard, plusieurs
auteurs avaient, pour examiner les fondements de la société, « […] senti le besoin de remonter jusqu’à
l’état de nature […] » (Rousseau 1992 : 168). Il suit notamment les traces de Cumberland et Puttendorff
(Ibid. : 176). Le passage adressé directement à Hobbes dans le Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes s’étend sur moins sur deux pages (210-211).
141
« Hobbes n’a pas vu que la même cause qui empêche les sauvages d’user de leur raison, comme le
prétendent nos jurisconsultes, les empêche en même temps d’abuser de leur facultés, comme il le prétend
lui-même; de sorte qu’on pourrait dire que les sauvages ne sont pas méchants précisément, parce qu’ils ne
savent ce que c’est d’être bons; car ce n’est ni le développement des lumières, ni les freins de la loi, mais le
calme des passions, et l’ignorance du vice qui les empêchent de mal faire; tanto plus in illis proficit
vitiorum ignoratio, quàm in his cognitio virtutis » (Rousseau 1992 : 211).
�80
Mais, de Hobbes à Rousseau, l’effritement progressif de la vérité de leur rapport est
indéniable.
Si chez Hobbes l’usage du terme « homme » participe à brouiller les frontières
discursives qui séparent l’espace civil de l’espace naturel, Rousseau se réfère presque
toujours à l’homme et au « sauvage » distinctement142. Dans le Léviathan, le terme
« sauvage » n’apparaît qu’au moment où Hobbes mentionne la vie des êtres d’Amérique.
Chez Rousseau, la confusion tient plutôt à l’usage qu’il fait du terme même de
« sauvage ». Ce dernier sert, ici à dénoter celui qui habite paisiblement l’état de nature, et
là les peuples « […] qui nous sont connus […] » (Ibid. : 228). Par le biais de cette
différenciation, Rousseau nous apprend que l’état qui fut le « meilleur à l’homme » n’est
pas l’état de nature, mais c’est bien plutôt un état charnière, qu’il observe chez les
peuples « […] sauvages de différentes contrées du monde » (Ibid.). Ainsi, il distingue
deux types de sauvages : le sauvage idéel et le sauvage ethnographique.
En effet, il y a dans le discours de Rousseau, une nouvelle répartition des figures
et des espaces, entre l’habile sauvage de l’état de nature, l’homme affaibli de la société et
le sauvage qui se situe à la charnière de ces mondes. En dépit de l’apparente rigidité de ce
classement, nous souhaitons insister sur les fissures que Rousseau lui-même y produit, en
prenant bien soin de ne pas aller au-delà des limites que le savoir de son temps lui
imposent. Si l’état de nature est assumé comme hypothèse, c’est notamment en raison
d’une insuffisance scientifique : le naturalisme et l’anatomie « […] ont fait encore trop
peu de progrès […]» (Ibid. : 172). Rousseau reconnaît cependant la valeur de vérité du
savoir engendré par ces sciences, parmi lesquels des savoirs à caractère préethnologiques143. L’investissement qu’il en fait, principalement dans les notes de bas de
pages de l’ouvrage, en fournit la preuve. L’auteur rapporte, par exemple, les habiletés
142
« Gardons-nous donc de confondre l’homme sauvage avec les hommes que nous avons devant les yeux.
Lévi-Strauss (1970) va jusqu’à affirmer que Rousseau « […] ne s’est pas borné à prévoir l’ethnologie : il
l’a fondée. D’abord de façon pratique, en écrivant ce Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes qui pose le problème des rapports entre nature et culture, et où l’on peut voir le premier
traité d’ethnologie générale ; et ensuite sur le plan théorique, en distinguant, avec une clarté et une
concision admirables, l’objet propre de l’ethnologie de celui du moraliste et de l’historien » (Lévi-Strauss
1973 : 45-46).
143
�81
objectives des Hottentots en tant que pêcheurs, lesquelles dépassent celles des
« Européens du Cap », malgré que les premiers ne fassent usage en guise d’instruments ni
de filets, ni d’hameçons, mais de leurs mains uniquement (Ibid. : 175). Rousseau ne
manque pas de signaler la forte impression que lui ont laissée les histoires rapportant
l’incroyable force dont sont doués les corps des « sauvages », par exemple l’histoire d’un
« Indien de Buenos Aires » qui a racheté sa liberté en attaquant, avec l’aide d’une seule
corde, le taureau le plus furieux de Cadix (Ibid. : 176). Ces arguments renforcent certes
d’importants éléments de la thèse de Rousseau. Parmi ces éléments, notons le constat de
l’inégalité physique ou naturelle entre les hommes (Ibid. :168), et celui de la perte
d’habileté et de la faiblesse de l’homme contemporain. De manière générale, les savoirs
pré-ethnologiques servent de fondement discursif et argumentatif à l’hypothèse sur
l’origine des sociétés144.
L’image située à gauche du frontispice du Discours sur l’origine (Figure 18)
renforce la construction rousseauiste du « sauvage » heureux. Sur le sol à gauche se
trouve un amas d’accessoires, parmi lesquels un chapeau, qui suggère la nature de
l’interaction entre les figures. Ce sac donne en effet à imaginer qu’il fut offert par les
colons et aussitôt refusé par le « sauvage ». Ce dernier pointe d’un doigt le paysage
colonial et de l’autre main, il présente un monde qui est inaccessible à notre regard. Cela
dit, les quelques mots situés en bas de la gravure ne nous permettent pas de douter : « Il
[le sauvage] retourne chez les égaux », affirmant son désintérêt pour l’univers colonial,
voire la supériorité de son mode de vie que défend par ailleurs Rousseau. Sur l’image de
droite du frontispice, une femme assise et décontractée tient un bâton au bout duquel est
suspendu un chapeau semblable à celui que l’on retrouve dans l’image de gauche.
144
D’ailleurs, l’article de Gilbert Chinard (1911), selon qui l’homme naturel rousseauiste doit beaucoup
aux récits de voyages en Amérique, abonde de preuves en ce sens.
�82
Figure 18. Nicolas Delaunay, Frontispice du Discours sur l’origine et les fondements
de l’inégalité parmi les hommes, 1755.
Ce n’est pas à la seule fin de penser l’origine que la vie des « peuples sauvages »
est étudiée; il s’agit avant tout pour Rousseau de penser le maintenant. Les trois
catégories évoquées plus haut servent à dévoiler la dégénérescence de l’espace contaminé
du présent des sociétés occidentales où l’homme est devenu le « […] tyran de lui-même
et de sa nature » (Ibid. : 184). C’est que l’intelligence de l’homme s’est déployée, nous
indiquent l’histoire du langage et celle des progrès techniques, de façon conjoncturelle
avec le perfectionnement de l’industrie. Selon Janine Chanteur, chez Rousseau :
L’intelligence, l’humanité en l’homme, c’est d’abord la raison technicienne à la recherche de nouveaux
moyens économiques, pour des besoins dont la satisfaction est indispensable. C’est par le travail que
l’homme va survivre, c’est par lui qu’il va se mesurer à l’homme (Chanteur 1982 : 200)145.
145
Rousseau constate en ces mots, non pas sans tristesse, le destin auquel le progrès a mené l’homme :
« […] l’homme sauvage et l’homme policé diffèrent tellement par le fond du cœur et des inclinations que
ce qui fait le bonheur suprême de l’un réduirait l’autre au désespoir. Le premier ne respire que le repos et la
liberté […]. Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s’agite, se tourmente sans cesse pour chercher des
occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu’à la mort, il y court même pour se mettre en état de
vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l’immortalité » (Rousseau 1992 : 255).
�83
Rousseau envisage la raison comme étant au service de l’amour propre en
participant de ce fait à alourdir le fardeau de l’homme du XVIIIe siècle. Il ne considère
pas les sauvages du Nouveau Monde comme étant dénués de capacités réflexives. Bien
au contraire, selon lui ces « sauvages » pensent. « En effet, après quelques observations il
leur est aisé de voir que tous nos travaux se dirigent sur deux seuls objets, savoir, pour soi
les commodités de la vie, et la considération parmi les autres » (1992 : 230). Dans la note
d’où est tirée cette dernière citation, Rousseau évoque le refus des « sauvages »
contemporains de vivre à la manière de l’Occidental ainsi que la fascination de certains
Européens pour ces derniers, fascination qui les pousse dans certains cas à ne plus quitter
ce mode de vivre en nature. Ainsi, nous comprenons que si Rousseau distingue l’homme
du sauvage, c’est notamment afin de reconnaître ce qui marque la singularité de l’un et de
l’autre, mais plus encore, pour montrer la nature des rapports réels qu’entretiennent les
membres de mondes opposés et d’inverser, un peu comme l’avait fait Montaigne, ce
même rapport alors qu’il ordinairement exprimé comme rapport de force. En effet,
Rousseau réinvestit des parcelles des discours, des traces des pensées et des manières de
vivre des dits « sauvages » afin de formuler une critique du progrès et de la raison à la
dérive. Nous ne nous étonnons pas d’ailleurs, de remarquer la ressemblance entre les
dernières phrases du Discours et les termes qu’employaient les sauvages de Montaigne
(1965) dans Des Cannibales. Voici ce que ces derniers affirment avoir trouvé de plus
admirable dans le royaume du monarque Charles IX, après que celui-ci leur eût demandé
ce qu’ils en pensaient :
Ils dirent qu’ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant
barbe, forts et armés, qui étaient autour du Roi [….], se soumissent à obéir à un enfant, et
qu’on ne choisisse plutôt quelqu’un d’entre eux pour commander; secondement […] qu’ils
avaient aperçu qu’il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de
commodités et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de
pauvreté; et trouvaient étrange comment ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir
une telle injustice, qu’ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons
(314)146.
Rousseau, de son côté, écrit :
146
Rousseau rapporte d’ailleurs une histoire similaire à celle ici racontée par Montaigne dans un note de
bas de page (1992 : 230) et y parle du fait d’étaler « […] notre luxe, nos richesses et tous nos art les plus
utiles et les plus curieux » (Ibid.) comme d’une habitude.
�84
Il suit encore que l’inégalité morale, autorisée par le seul droit positif, est contraire au droit
naturel, toutes les fois qu’elle ne concourt pas en même proportion avec l’inégalité
physique; distinction qui détermine suffisamment ce qu’on doit penser à cet égard de la
sorte d’inégalité qui règne parmi les peuples policés; puisqu’il est manifestement contre la
loi de nature, de quelque manière qu’on la définisse, qu’un enfant commande à un vieillard,
qu’un imbécile conduise un homme sage et qu’une poignée de gens regorge de superfluités,
tandis que la multitude affamée manque du nécessaire (1992 : 257)147.
La ressemblance entre ces deux citations est frappante. Rousseau cependant, ne
retient pas la dernière pensée des « sauvages » de Montaigne poussant les opprimés à la
révolte. La Révolution française se chargera de prendre littéralement à la gorge les
« hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités ». Rousseau nous met plutôt
sur la piste ambigüe des possibilités de la raison morale par la critique même de son
déploiement, ouvrant par là sur la possibilité de transformations politiques fondées sur la
raison même et sur l’idée d’une nature humaine fondamentalement bonne. Ainsi, sur le
frontispice du Contrat social (Figure 19) ouvrage de Rousseau visant l’articulation de
son projet politique, le motif de la justicière équipée d’une balance que l’on retrouve sur
le frontispice du De Cive de Hobbes se voit réinvestit. Cependant, l’épée est ici
remplacée par un bâton raccordé d’un chapeau, symbole moderne de la citoyenneté. On
retrouve un autre élément : un petit chat assis, que Rousseau considérait d’ailleurs être
« […] l’animal le plus indépendant et le plus ennemi de la servitude » (Viroli 1988 :
122)148. Cette figure s’inscrit dans un paysage naturel qui s’ouvre, dans le lointain, sur un
espace civil. Cette image rompt avec l’image précédente en ne séparant pas l’état de
nature et l’état civil. Elle en propose une certaine réconciliation.
147
Il est évident que Rousseau avait lu Montaigne, car, en effet, il le cite dans le Discours (1992 : 185).
148
Dans ses journaux de voyage de 1762-1795, James Boswell (1991 : 117-8) relate une conversation entre
Rousseau et lui : « ROUSSEAU : « Do you like cats? ». Boswell : « No. ». ROUSSEAU : « I was sure of
that. It is my test of character. There you have the despotic instinct of men. They do not like cats because
the cat is free and will never consent to become a slave. He will do nothing to your order, as the other
animals do […] » ». Ainsi, le chat semble pour Rousseau constituer un symbole politique de la plus haute
importance.
�85
Figure 19 : Frontispice du Contrat social, 1762.
Si Rousseau nomme et cherche à connaître le « sauvage », ce n’est pas sans lui
accorder une place que la tradition philosophique occidentale lui concéda rarement. Le
philosophe critique explicitement l’injustice et l’oppression. Il se fait solidaire de la cause
des opprimés et il trouve dans le discours de l’autre, du « sauvage », l’expression même
de cette solidarité. Le même, chez Rousseau, est envisagé au gré de la fiction que lui
inspire l’autre, comme l’idéal d’une réconciliation et d’une joie perdue.
3.3 Goya chez les Ilustrados
Nous avons vu, avec Hobbes et Rousseau, et plus spécifiquement à travers la
notion d’état de nature en tant que lieu où s’exprime la nature humaine en son essence,
émerger le récit encore incertain d’une origine autre, inspirée par la réalité des êtres
d’Amérique. Le lien entre le « sauvage » des origines, l’homme civil contemporain et la
�86
nature humaine n’est certes pas exclusif aux tableaux de Goya. Mais comme nous l’avons
vu, ceux-ci sont produits à un moment où ce lien resurgit en force,
L’amitié que Goya a partagée avec les philosophes de l’entourage de la cour
d’Espagne a certainement ouvert la possibilité de la découverte des idées philosophiques
de Rousseau. Le catalogue d’exposition Goya and the Spirit and Enlightenment (1992) ne
nous permet pas de douter que le peintre ait connu et fréquenté les « Ilustrados », un
groupe qui, comme l’indique son nom, suivait avec un grand intérêt la pensée
philosophique des Lumières en France. Un grand nombre de portraits exécutés par le
peintre présente ses membres, parmi lesquels Jovellanos, auteur et dramaturge,
responsable de la traduction du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau et qui, comme
Mariano Luis de Urquijo, fut emprisonné après l’invasion de Napoléon (Baticle 1989 :
lxii). Ce traitement est analogue à celui que subit la majorité des membres des Lumières
espagnoles, qui sont forcés à l’exil (Ibid.), à faire taire leur désir d’une nation moderne et
du renversement du système monarchique. Avant que les basculements politiques qui
provoquèrent cette série d’exils ne se produisent et avant que Goya ne soit trop sourd
pour bénéficier des réflexions des Ilustrados, il « […] a sûrement assisté à des
discussions portant sur les besoins d’une réforme constitutionnelle, prônant l’équité des
lois et une meilleure justice en général, l’élimination de la torture et l’amélioration des
prisons, la préservation des droits de l’homme et la garantie de la validité de la preuve »
(Glendinning 1989 : lxix)149. Goya connaît les questions politiques qui hantent son
époque, mais aussi probablement leur lien avec la philosophie de Rousseau puisque les
ouvrages du philosophe, comme ceux de Voltaire, se trouvent alors dans la majorité des
bibliothèques de la noblesse espagnole, en dépit des restrictions de l’Inquisition (Baticle
1989 : l).
Le rapport entre Goya et la philosophie de Hobbes est plus difficile à établir. Si un
tel rapport pouvait s’avérer, il contribuerait peut-être à expliquer le caractère cruel de
149
Notre traduction de la citation suivante : « Goya must surely have attended discussions about the need
for constitutional reform, for equity before the la and greater justice in general in the legal system, for the
elimination of torture and the improvement of prisons in order to preserve the rights and human status of
the accused and ensure the validity of evidence ».
�87
l’homme goyesque tel qu’il apparaît dans certains de ses tableaux, ainsi qu’à expliquer
ces propos issus de sa correspondance à Martin Zapater :
Et quoi maintenant ? Je te laisserai savoir que je n’ai peur ni des sorcières, ni des esprits,
des fantômes, des géants vantards, des escrocs, des canailles, etc., ni aucune sorte d’être ne
m’effraie à l’exception des êtres humains… non seulement ils griffent et se battent, ils
mordent et crachent, ils piquent et percent ; de ces autres le plus gros se nourrit, et ils sont
pires150… il n’y a pas de remède si ce n’est de savoir comment se mettre au-delà de
l’atteinte de leur cruauté (Goya 1982 : 123)151.
Il existe une proximité entre ces propos de 1789, donc du temps où Goya
fréquentait les Ilustrados, et la vision hobbesienne de la cruauté humaine selon laquelle
« l’homme est un loup pour l’homme » (Hobbes 2010 : 65). Cependant, le diptyque, qui
reconduit selon nous un schéma comparable à celui que l’on retrouve dans le discours du
philosophe, ne reconduit pas pour autant l’image « de ces autres [dont] le gros se
nourrit», c’est-à-dire ces autres dont le souverain représenté sur le frontispice du
Léviathan se trouve constitué. Il ne reconduit pas non plus la vision binaire du frontispice
du De Cive. Seule est maintenue l’idée de la cruauté intrinsèque à l’homme.
Supposons que Goya ait connu, voire, qu’il ait bien connu et compris les enjeux
philosophiques et politiques sur le fond desquels repose la notion d’une nature humaine,
cela implique-t-il que le diptyque repose sur une base plus conceptuelle que sensible ?
C’est ce que nous souhaitons analyser avant de conclure, à la lumière de ce qui précède à
savoir, les traditions iconographiques du cannibalisme et les deux thèses philosophiques
sur la nature de l’homme.
3.4 Une manifestation picturale de la nature humaine
Le diptyque de Goya ne constitue ni un reflet de concepts tirés de textes
philosophiques ni une répétition des motifs de l’iconographie du cannibale, quand bien
même il recoupe certains aspects de ces éléments. C’est par une autre voie que la peinture
de Goya pense ; c’est-à-dire, celle-là même que lui confèrent ses propres moyens. À la
150
L’italique est de nous.
Traduit de l’espagnol par Danielle Auby (Goya 1988) à partir du texte original publié dans l’ouvrage :
de GOYA, Francisco (1982). Cartas a Martin Zapater, Madrid : Ediciones Turner.
151
�88
limite de la peinture, Goya en vient à produire des formes bien différentes que ce que le
concept de nature humaine lui aurait autrement dicté s’il avait simplement cherché à
l’illustrer. Selon nous, le diptyque de Goya fait subir un basculement critique à la notion
de nature humaine telle qu’elle avait été articulée avant lui. Comment peut-on voir les
aspects de la pensée picturale à l’œuvre?
En décrivant les tableaux dans le premier chapitre, nous avons été en mesure de
voir que leur composition et leur organisation présentent une bichromie qui rappelle la
gravure. Ceci est particulièrement visible dans Cannibales préparant leurs victimes, où la
bichromie se joue entre un clair extrême sans figuration, lequel occupe près de la moitié
de la superficie du tableau et une zone plus foncée à laquelle se superposent les figures.
On rencontre dans les gravures No se convienen (Figure 20) et Lo mismo en otras partes
(Figure 21), produites par Goya lui-même, des compositions analogues. On constate dans
ces deux images un contraste tout aussi prononcé entre un fond blanc laissé vide et
l’espace de figuration qui, dans ces deux cas, se déploie en un fond plus foncé. Cette
proximité formelle nous incite d’ailleurs à penser que la relation entre ce diptyque et la
gravure, et tout particulièrement les gravures pré-ethnographiques et la caricature, appelle
à être creusée plus avant.
Figure 20. Francisco de Goya, No se convienen, 1810-1815.
�89
Figure 21. Francisco de Goya, Lo mismo en otrsa partes, 18010-1815.
Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que Goya a connu la figure du
« sauvage » par les illustrations des récits de voyage. Cela ne nous empêche pas
d’identifier certaines connivences entre le diptyque et ces images pré-ethnographiques.
Rappelons que dans l’image coloniale, l’acte cannibale se déroule dans un espace naturel
conformément au caractère communautaire du rite anthropophage. Comme nous l’avons
démontré dans le deuxième chapitre, la figure du « sauvage » ainsi représentée tend à
légitimer le rapport colonial entre l’Occidental et les peuples du Nouveau Monde. Ainsi,
les images coloniales avec cannibales mettent en scène ces êtres qui, du temps de Goya,
sont encore considérés comme étant en marge de l’humanité. Cet élément précis renvoie
tout particulièrement à la scène de Cannibalisme montrant des restes humains : ne s’y
présentent que des « sauvages ». Toutefois, notons que les images de de Bry font
exception au sein de ce corpus iconographique, car elles présentent des Espagnols se
dévorant entre eux. Dans ce dernier cas, l’ébranlement d’une séparation entre l’homme
civilisé et l’Autre repose sur le fait que les soldats européens soient ainsi métamorphosés
en sauvages, sans pour autant, faut-il le préciser, se « mélanger » avec les êtres du
Nouveau Monde. Cannibales préparant leurs victimes fait plutôt apparaître des
« sauvages » qui s’en prennent à des Européens. De plus, mise à part la gravure de de
Bry, l’image coloniale ne présente jamais la dévoration en tant que telle. De la même
�90
manière, comme nous l’avons mentionné au deuxième chapitre, le diptyque suggère un
cannibalisme virtuel : ne s’y montre aucune dévoration in actu.
Nous ne pouvons pas non plus prouver que Goya ait vu les caricatures avec
cannibales, même si elles lui sont contemporaines. Comme nous l’avons défendu dès le
premier chapitre, le diptyque a d’ailleurs probablement été produit durant la période
révolutionnaire en Espagne, ce qui augmente les chances d’un contact du peintre avec les
images satiriques. Il nous apparaît toutefois évident que le diptyque, de par un jeu de
contiguïté avec la caricature, déplace les rapports qui relevaient jusque-là de la catégorie
de la race vers la catégorie de la classe. Il renverse, en effet, les rapports de force entre
dirigeants et dirigés. Sa composition extirpe les figures représentées de leur cadre social
attendu (ce que Goode, rappelons-le, considérait être une caractéristique propre à la
caricature) 152. La sensibilité de Goya pour cet aspect de l’image satirique se manifeste
par ailleurs dans la série des Caprices153. Le caractère tragique du diptyque l’éloigne
cependant de la caricature et de son ton de dérision. Si, dans le diptyque, les « sauvages »
rappellent davantage l’iconographie pré-ethnographique, la nature de la relation entre les
figures, elle, évoque plutôt une stratégie propre à la caricature. L’inversion du rapport de
force, c’est-à-dire le déclassement des figures d’élite provoqué par la violence des
protagonistes participe d’une négation de certaines conventions de la peinture.
La seule image avec cannibale dont nous ne pouvons douter qu’elle soit connue
de Goya est le Saturne de Rubens. Ainsi, le diptyque succède à cet inédit en peinture et
précède la production du Saturne dévorant son fils que Goya peindra lui-même entre
1819 et 1823. Ce dernier ne retiendra par ailleurs pour cette œuvre que l’aspect de la
152
Nous rappelons ici l’hypothèse de Mike Goode (2010: 122) : « What I am suggesting is that to the extent
that caricatures functioned to install a sense of the public as itself a kind of caricature collection moving
through calendrical time, they further implied that the main formal […] possibilities for change lay in
adding and subtracting character types and kinds of situations in which they might perform ».
153
Baudelaire fait des Caprices une série de caricatures tout en disant que c’est Goya qui a élevé la gravure
au statut de l’art (2011 : 228). André Malraux s’est efforcé de montrer des ressemblances entres les
gravures de Goya et la caricature. Il va d’ailleurs jusqu’à mentionner l’influence de cette gravure traversée
par la caricature sur sa peinture même. Malraux insiste surtout sur l’emprunt d’un éclairage à la caricature,
laquelle il oppose à la lumière, puis sur le noir de la gravure « Le fond noir de l’aquatinte appelle ce dessin
anguleux que la peinture n’avait pas connu » (1978 : 64). Nous nous intéressons davantage à l’emprunt de
l’aspect bichromique de la gravure, de la caricature.
�91
chute du dieu qui relève avant tout du mythe lui-même, mais qui traverse également
l’œuvre de Rubens. Rappelons que le premier Saturne a été produit pour signifier la
puissance d’un roi du passé. Présentant à l’époque de Goya une menace pour le pouvoir
du roi, le Saturne de Rubens est enfermé en une salle du Prado qui est inaccessible aux
visiteurs. Cela participe à expliquer le ton du Saturne de Goya, lequel, présentant des
figures divines en décomposition, est plus cauchemardesque que dramatique – ton
symptomatique de la réalité révolutionnaire qui augmente le risque de la chute de la
monarchie. Si le diptyque tient également du cauchemar, il est traversé d’une angoisse
sourde, latente, là où le Saturne de Goya suscite une épouvante aux couleurs criardes.
Cette différence de ton s’appuie sur une autre différence, à savoir celle qui affecte la taille
des figures : le diptyque, se détachant de l’horizon mythologique et antique, présente une
anthropophagie à échelle humaine plutôt qu’un cannibalisme de la démesure divine.
Le diptyque instaure une nouveauté par rapport aux domaines iconographiques où
avaient jusqu’alors figuré des cannibales. Pour la première fois dans la tradition
figurative picturale occidentale, des Européens sont morcelés par des sauvages, voire
menacés d’être dévorés par eux. Or, cette nouveauté fait fond sur une différence médiale
essentielle. Le nouveau langage pictural qu’invente Goya n’est compréhensible qu’à la
lumière de la hiérarchie médiale et générique qui l’informe. Le seul tableau qui avait
accueilli jusqu’alors une figure cannibale, soit le Saturne de Rubens, fondait sa légitimité
sur une tradition littéraire et mythologique. Goya peint des figures qui n’avaient jusqu’ici
figuré qu’en gravure, c’est-à-dire des « sauvages » cannibales. Or, contrairement à ce
qu’on voit dans le Saturne de Rubens et dans les caricatures, et comme on le constate
dans l’illustration des missions coloniales, on ne voit dans le diptyque aucun mangeur. La
violence du démembrement est délibérément montrée ; celle de la dévoration ne l’est pas.
L’accent est donc mis sur une cruauté sauvage, mise en scène sur fond de cannibalisme
virtuel. Or, comme nous l’avons vu, nous ne saurions réduire les œuvres de Goya à une
représentation des figures coloniales. La reprise en tant que telle de ces figures entre en
dialogue avec une certaine tradition philosophique qui avait elle-même fait reposer sur la
figure du sauvage le concept d’état de nature. Qu’en est-il de la relation entre le diptyque
et ce concept?
�92
Contrairement à l’ensemble des images que nous avons croisées jusqu’ici, la
cruauté du diptyque ne se produit ni dans l’espace extérieur exotique des colonies, ni
dans l’espace civil européen propre à l’image pré-ethnographique et à la caricature, mais
en un lieu à proprement parler indéterminé. L’état de nature chez Hobbes comme chez
Rousseau, en tant qu’il est hypothétique, renvoie également à un espace indéterminé,
flou, imprécis. L’état de nature se situe pour ainsi dire hors de l’histoire. La question de
l’espace croise ici celle du temps. Il semble que ce soit précisément ce schéma
anhistorique et atopique que Goya produise en peinture. Le caractère onirique de
Cannibales montrant des restes humains devient d’ailleurs pleinement visible à la
lumière de ce repère philosophique. Cela dit, le diptyque ne constitue pas pour autant une
illustration du concept de nature humaine. Il nous faut chercher plus loin.
Rappelons que Hobbes et Rousseau dissocient l’état de nature de l’état civil.
Autrement dit, ils séparent l’espace atemporel que constitue l’état de nature de l’espace
civil qui, lui, s’ancre dans le temps de l’histoire. Dans le diptyque, cette distinction fait
l’objet d’une véritable relecture : le pendant atemporel de la nature humaine montré dans
Cannibales montrant des restes humains rencontre le pendant contemporain du temps de
l’énonciation de cette même nature, qui se donne à voir dans Cannibales préparant leurs
victimes. En faisant apparaître des accessoires à titre d’indices de la contemporanéité
dans le deuxième tableau (chapeau, chaussure, escopette, etc.), Goya favorise la
perception du passage d’un état de nature atemporel philosophique à un état de nature
historicisé et contemporain. En fait, de par un recoupement entre des espaces séparés –
état civil et état de nature – ce diptyque fait émaner une réelle tension entre l’atemporalité
et l’histoire ; il inscrit le comportement violent de l’homme à la fois dans l’histoire et en
deçà de l’histoire. L’état de nature que Hobbes et Rousseau avaient conçu comme étant
en deçà de la couche de l’histoire apparaît ici à la fois comme potentialité historique et
originaire. Les deux paysages du diptyque se fondant l’un dans l’autre, deviennent
presque indissociables et contribuent à universaliser l’état de nature. Or, dans les textes
philosophiques, c’est justement le caractère hypothétique et anhistorique de l’état de
nature qui rend possible la conceptualisation d’une nature humaine qui n’entre pas en
contradiction avec les savoirs chrétiens des origines. Goya met fin au caractère
�93
hypothétique de l’état de nature en l’historicisant. Voire même, en passant par l’image, le
peintre radicalise la remise en doute des fondements de l’homme à l’image de Dieu déjà
en germe dans la pensée de Hobbes et Rousseau.
Dans ce diptyque, le doute concernant l’origine divine de l’homme repose
également sur l’ambigüité qui articule les figures de l’homme et du sauvage. Si Hobbes
comme Rousseau les distinguaient clairement, ce diptyque les joint : il est le lieu de leur
rencontre. L’image fait d’ailleurs voir l’extrême ressemblance qui lie les corps nus,
humains ou sauvages, à un tel point qu’aucun des auteurs ayant participé à consolider la
fortune critique de ces tableaux n’a su jusqu’ici les distinguer. L’identité respective des
victimes et des bourreaux repose sur une subtile différence : la couleur de leur peau. Les
êtres de natures sont nus et leur chair est de couleurs plus soutenues. Leur nudité est pour
ainsi dire atemporelle, comme l’est leur cadre. Les hommes d’élite, civilisés, ne le sont
plus. Dévêtues, ces figures nous permettent de constater la blancheur de la peau de l’un,
puis l’aspect foncé et cadavérique de la chair de l’autre. Il en va donc de deux types de
nudités : sauvages nus et hommes civilisés dévêtus. Pourtant, ces deux nudités se
confondent en une seule. Nudité des chairs, fusion des fonds : l’homme social à l’image
de Dieu est assimilé par le pouvoir de la nature, du paysage, du sauvage. Le même devient
l’autre et l’autre, le même.
Or cette assimilation ne s’accomplit que par l’acte qui, au sens strict, assimile,
incorpore, ingère, à savoir l’acte de dévoration. Notons par ailleurs que ce diptyque fait
émaner deux types d’anthropophagie : anthropophagie au naturel (celle-ci se veut
atemporelle) et anthropophagie de classe (celle-là est contemporaine et historique). Le
second type d’anthropophagie rejoint l’autre, établissant par là une nature de l’homme
dont les comportements cruels sont un invariant. Une telle vision de l’homme rejoint
certes bien davantage celle de Hobbes que celle de Rousseau. La valeur historique et
contemporaine d’une telle énonciation tient du fait que, bien que ce diptyque ne présente
probablement pas la violence cannibale comme fait de la guerre, il incarne une peur
cauchemardesque certainement exacerbée par les effets de la Révolution et des invasions
�94
napoléoniennes. Nous verrons dans quelle mesure le contexte historique participe à
expliquer la proximité entre la vision hobbesienne et la vision goyesque de l’homme.
Lorsque Goya peint ce diptyque, il se trouve alors à Madrid, au cœur de la
capitale politique dont il est néanmoins coupé, n’ayant plus de liens avec les Ilustrados
disséminés ou exilés depuis 1800154. Les désastres de la guerre ont déjà frappé de plein
fouet le corps social d’une Espagne monarchique, laquelle subit sans doute depuis la
Révolution française, la peur profonde de sa chute. Démantelée, la société espagnole
subit à rebours les effets du triomphe républicain. En Espagne, des partisans militent déjà
en faveur du nationalisme naissant avant la conquête napoléonienne. Mais c’est elle qui
précipite les changements sociaux dans le pays. La résistance des Espagnols contre
l’invasion de l’Empire s’avère particulièrement efficace155. L’insurrection contre
Napoléon fait près de 607 000 morts.
154
« Napoleon Bonaparte’s rise to the Consulate in November 1799 and Gdoy’s return to power in 1800
(after which Godoy was entirely submissive to the First Consul’s wishes) led to a complete eradication of
the group of enlightened Spaniards who has sponsored Goya in his beginnings. Jovellanos and Urquijo
were imprisoned, Meléndez Valdés and Ceán Bermúdez exiled, and Cabarrúz banished to Barcelona;
finally, Bernardo de Yriarte and the Condesa de Montijo were also banished. No one escaped » (Baticle
1989 : lxii).
155
L’insurrection espagnole est reconnue comme l’un des principaux freins des conquêtes napoléoniennes.
Nourri par des sources essentiellement espagnoles (Lafranque 2004 : 1), fournit à cet égard une intéressante
explication. En se basant sur le démantèlement progressif des affaires politiques espagnoles, il démontre
que l’efficacité des guérillas contre les invasions de l’Empire repose sur une monarchie absolutiste
décentralisée. « Thus it happened that Napoleon, who, like all his cotemporaries, considered Spain as an
inanimate corpse, was fatally surprised at the discovery that when the Spanish State was dead, Spanish
society was full of life, and every part of it overflowing with powers of resistance. By the treaty of
Fontainebleau he had got his troops to Madrid; by alluring the royal family into an interview at Bayonne he
had forced Carlos IV to retract his abdication, and then to make over to him his dominions; and he had
intimidated Ferdinand VII into a similar declaration. Carlos IV, his Queen and the Prince of Peace
conveyed to Compiègne, Ferdinand VII and his brothers imprisoned in the castle of Valençay, Bonaparte
conferred the throne of Spain on his brother Joseph, assembled a Spanish junta at Bayonne, and provided
them with one of his ready-made constitutions. Seeing nothing alive in the Spanish monarchy except the
miserable dynasty which he had safely locked up, he felt quite sure of this confiscation of Spain. But, only
a few days after his coup de main he received the news of an insurrection at Madrid. Murat, it is true,
quelled that tumult by killing about 1,000 people; but when this massacre became known, an insurrection
broke out in Asturias, and soon afterward embraced the whole monarchy. It is to be remarked that this first
spontaneous rising originated with the people, while the “better” classes had quietly submitted to the
foreign yoke. »
�95
La Révolution française avait cru à une conception rousseauiste de la nature
humaine bonne. Mais elle avait néanmoins donné lieu à d’insoutenables violences156. Le
diptyque apparaît répondre de cette contradiction. Là où Rousseau croyait voir en
l’homme une bonté naturelle à rétablir dans la société civile par l’instauration d’une
démocratie et donc, par la dissolution de la monarchie, Goya, qui a connu la guerre et les
violences provoquées par un désir de transformation sociale, découvre plutôt un homme
cruel157. D’ailleurs, la remise en doute des fondements rousseauistes par Goya nous est
donnée par un indice iconique : l’amas de vêtements que l’on retrouve dans le diptyque
semble faire immédiatement référence à celui que l’on retrouve sur le frontispice du
Discours sur l’origine. Or, pour Goya, le sauvage ne « retourne [point] chez les égaux ».
Il resurgit comme force dévorante.
À renverser Rousseau, Goya ne retrouve-t-il pas les sentiers de Hobbes?
Rappelons que c’est d’ailleurs en un contexte de Révolution et de guerre civile que
Hobbes rédige son traité politique (1651). C’est la guerre qui sous-tend l’extrême
nécessité de la création d’une monarchie hobbesienne (laquelle, nous croyons l’avoir
démontré, se déploie comme un nouveau contrat)158. On peut donc penser que Goya
marche dans les pas de Hobbes. Il nous faut toutefois relever les limites de l’hypothèse
selon laquelle ce diptyque serait intégralement hobbesien. Comme nous l’avons
156
Il est important de ne pas confondre la pensée de Rousseau et sa réception, du temps de la Révolution.
« Le Contrat s’adosse au [second] discours, en tant que celui-ci a créé sa condition de possibilité : on ne
peut fonder l’ordre politique en nature puisque le passage à l’état civil est dénaturation » (Bernardi 2001 :
18). Or, Rousseau est compris par les premiers Révolutionnaires, parmi lesquels Robespierre, comme un
être profondément sensible, comme « un être de la nature ». Selon Nathalie-Barbara Robisco (1992 : 127),
avec le Contrat social, naît une figure : celle du « législateur ». C’est elle que le révolutionnaire doit par
ailleurs incarner et ce, dans une visée éthique et politique, voire esthétique. « Le législateur doit « connaître
à fond la nature humaine » et « Rousseau est celui qui sent son cœur et connaît les hommes ». La
connaissance que Rousseau rend possible est une connaissance sensible de la nature humaine qu’il faut
instituer […] ».
157
La réalité politique, est souvent interprétée comme ayant fortement affecté l’œuvre du peintre, et avec
raison. Dans la mesure où les discours des Lumières, et tout particulièrement ceux de Rousseau, ont
participé à influencer les acteurs du renversement de l’Ancien Régime (Bernardi 2001 : 7-8), ses effets sur
l’Espagne et sur Goya sont souvent traités comme ayant engendré une conception critique des Lumières,
puis, en lien avec elle, la vision d’une nature humaine cruelle (Baticle 1992 : 354- 355 ; Todorov 2011 :
168-169).
158
Selon Gérard Mairet (2000 : 13), « […] montrer à la faveur de la crise anglaise de 1640-50 que la
question de la moralité se pose et surtout en formuler les termes, telle est la signification de Léviathan ». Le
contrat social est donc bel et bien un projet politique et moral répondant de la guerre. Or, nous ne saurions
réduire l’œuvre de Hobbes à son contexte d’apparition.
�96
démontré, Goya fait apparaître la nature humaine comme constante anthropologique et
ce, en faisant advenir les figures du noble et du sauvage non pas seulement comme
incarnations respectives de la civilisation et de l’en deçà, mais comme des forces, des
types qui rendent visible la victoire de la violence originaire au détriment de la
civilisation. Au contraire, chez Hobbes, la monarchie l’emporte sur la nature humaine.
Ainsi, le frontispice du Léviathan a pour fonction de représenter la victoire de l’ordre
monarchique sur la société civile. Le roi y apparaît comme un gigantesque contenant du
peuple sous contrat. Goya mobilise plutôt les sauvages à échelle cette fois humaine, à
titre de force apte à anéantir l’ordre social, voire l’homme social lui-même. Le problème
esthétique et philosophique que pose ce diptyque débouche sur une vision aporétique de
l’homme social et rationnel, de l’homme à l’image de Dieu, ici projeté en un dehors de
tout projet politique, vers sa mort symbolique.
C’est que Goya semble être en quête d’une cause fondamentale de la violence
humaine en deçà de toutes ses justifications et déterminations rationnelles et politiques.
On pourrait parler du diptyque comme d’une opération d’irrationalisation de la violence
en réponse aux violences révolutionnaires159. L’invasion impériale, qui prétendait
répandre la démocratie et la liberté a mené à une guerre sans précédent. Les supplices de
la guillotine en France et du garrot en Espagne, fondent leur pertinence sur une
rationalisation médicale et humaniste160. Jean Clair soutient d’ailleurs que la guillotine se
manifeste comme une machine rationnelle en tant qu’elle sert de médiation permettant au
bourreau de trancher la tête sans entrer en contact avec le corps de la victime (Clair
2012 : 120)161. Le cannibalisme tel que Goya le dépeint manifeste au contraire une
159
Antonio Lázaro-Reboll (2004) insiste d’ailleurs pour dire que la raison contre-rationnelle de Goya
s’exprime dans la déformation même des corps incarnant un idéal raisonnable.
160
Daniel Arasse a bien montré que l’invention de la guillotine se fonde sur une légitimation médicale et
technique (1987 : 32). Elle fut défendue en Assemblée en tant que « machine humaniste ». Ce n’est que
plus tard, au gré de son déploiement, qu’elle deviendra machine gouvernementale et officiellement
révolutionnaire (Ibid. : 36). En Espagne, le garrot occupe une fonction similaire. Renvoyant lui-même à
Arasse, Lafon montre qu’au gré de la création des Juntes Criminelles extraordinaire, Joseph Bonaparte
instaure le garrot à titre de peine capitale humaniste.
161
« La machine à tuer est devenue un automate, actionné à distance, qui supprime le contact physique
direct, sinon visuel, avec le malheureux. […] Elle est la première machine des Temps modernes à pouvoir
donner la mort avec le maximum d’efficacité, de rapidité et de précision. Durant la terreur, deux mille
Parisiens environ furent guillotinés environ furent guillotinés, dix-huit mille, et plus sans doute, sur
l’étendue du pays ».
�97
violence sans médiation où le corps est pleinement impliqué. C’est d’abord le corps de
l’homme social qui est affecté par la violence, mais c’est aussi le corps même de la
peinture dont l’organisation était fondée sur la rationalité de l’ordre social.
Hors des circuits de la commande, Goya se sert de l’image pour faire retour sur
des enjeux propres à la philosophie, mais le projet philosophique l’amène à interroger les
limites établies par le système des Beaux-arts. C’est que le détour par la philosophie
conduit Goya à brouiller par ailleurs le caractère anecdotique associé à la scène de genre.
Le choix du tableau de genre est à cet égard significatif, dans la mesure où il s’agit d’une
catégorie elle-même située en deçà de la peinture d’histoire d’un point de vue de la
hiérarchie des genres. Ces deux constituent même des catégories contraires puisque le
tableau d’histoire vise à commémorer des actions exemplaires. La scène de genre incarne
l’en deçà de l’histoire sur un plan générique. Elle est en mesure de recevoir le monde
sans Dieu que peint Goya, monde que même les philosophes qui ont imaginé l’état de
nature n’osaient pas admettre. En un tel monde, il n’y a pas que l’homme qui perd ses
repères. La peinture elle-même – sa nature, sa hiérarchie – est ébranlée. Ce qui advient à
l’homme bientôt dévoré par le sauvage, advient analogiquement à la peinture historique
dévorée par la scène de genre – comme scène du contre-exemple – et ce, au gré d’une
relation elle-même iconophage entre la peinture et la gravure162. Choc de la peinture
provoqué par l’emprunt de la bichromie propre à un médium « bas » ou « vil » ;
subversion d’un médium noble par le biais d’une stratégie iconique propre à la
caricature ; apparition picturale d’un sujet autrement réservé à la gravure : les médiums,
les genres sont dénaturés. Goya rompt avec une séparation entre l’homme et le sauvage,
entre le monde civil et la nature, mais aussi entre les moyens et les conventions de la
peinture et les ressources techniques de la gravure. L’élite responsable de l’entretien et de
la prospérité de la peinture, la noblesse qui vacille en ce début de XIXe siècle, voit son
162
Le peintre investie d’ailleurs ce médium au profit de la peinture à une époque où la vente de « gravures
originales » est en croissance et encouragée, notamment, par les penseurs des Lumières. Rousseau était
d’ailleurs lui-même un grand collectionneur de gravures (Levitine 1984 : 10). Les auteurs des Lumières
auraient insisté sur la valeur unique de la gravure (Ibid. : 11) en un contexte où celle-ci est achetée par un
public de plus en plus large et de plus en plus variée (Ibid. : 13). George Levitine insiste d’ailleurs pour dire
que la fin du XVIIIe siècle coïncide avec la naissance d’un intérêt pour la gravure « originale », sans pour
autant nier qu’elle demeure alors inférieure à la peinture (Ibid. : 17).
�98
corps trois fois détruit sur un plan symbolique – corps social, corps de chair, corps de
peinture.
�99
CONCLUSION
Le topos qui avait fait de Cannibales montrant des restes humains et Cannibales
préparant leurs victimes deux représentations de la nature humaine — topos dont nous
croyons avoir assumé pleinement la valeur et les conséquences — se dévoile désormais
comme négation de l’historicité de ce concept et, donc, de la singularité de l’énonciation
qu’en produisent ces œuvres. Notre démarche a mis au jour comment ces tableaux
introduisent une signification sans précédent de la figure du « sauvage » cannibale pour la
culture occidentale en tant qu’elle y incarne, et ce pour la première fois, la nature
humaine, c’est-à-dire le même et non l’Autre. Le caractère de nouveauté propre à la
configuration picturale du diptyque liant homme, sauvage et nature humaine ne pouvait
être compris qu’à travers une remise en contexte des tableaux au sein d’un horizon de
références relevant de l’époque dont ils émergent, et par rapport auquel ils font
aujourd’hui événement.
La description iconographique du diptyque nous a donné l’occasion de
comprendre ce qui constitue leur sujet véritable, à savoir : le renversement du pouvoir
social par le pouvoir de la nature. Un tel constat nous a conduit à sortir ces tableaux du
réseau restreint et insatisfaisant à l’intérieur duquel leur fortune critique les avait
confinés. L’étude de leur réception nous a cependant permis de démontrer que de
multiples interprétations de ces œuvres ont vu le jour à travers les époques et que, par
conséquent, leur objet n’a jamais pu être fixé une fois pour toutes. La compréhension de
ce processus historique nous est devenue accessible grâce à l’approche herméneutique
jaussienne : les œuvres ne sont pas soumises à une « vérité intemporelle de la question »
qui constitue leur origine, dans la mesure où se dévoilent au fil du temps d’autres
questions que les œuvres elles-mêmes font émerger. Ainsi, en 1867, Yriarte identifiait la
profondeur de la cohérence, dans l’œuvre de Goya, entre le sujet de la représentation et le
travail de la forme ; il la faisait toutefois reposer sur une détermination politique
nationaliste à laquelle les tableaux avec Cannibales pouvaient, sur la base d’une telle
lecture de l’œuvre du peintre, que difficilement répondre. Plus tard, l’association de ces
œuvres à l’événement du meurtre et de la dévoration des missionnaires Canadiens a pu
�100
les assigner à une fonction de représentation d’un fait historique. L’historiographie et
l’iconographie de cet épisode de l’histoire coloniale en ont favorisé la sacralisation en en
faisant un mythe du jésuitisme, tout en entretenant son caractère factuel et historique ; or,
comme nous l’avons vu, les tableaux ne présentent aucun signe d’une telle intention.
Enfin, l’interprétation la plus récente et la plus répandue de ces tableaux en fait une
représentation d’un concept atemporel : la nature humaine. Singletary, par exemple, la
seule qui, parmi les auteurs de cette dernière phase de la fortune critique des œuvres, en
ait formulé une analyse approfondie, ignore pourtant la différence historique qui articule
dans l’Europe du XVIIIe siècle la notion d’homme et celle de sauvage. En conséquence,
elle demeure aveugle à ce qui constitue précisément l’enjeu même du diptyque : à savoir
la troublante rencontre de deux catégories qui avaient été jusque-là tenues séparées. À
rebours de cette lecture admise, nous sommes parties de cette séparation même que les
œuvres remettent en jeu : là où la figure du sauvage cannibale nous a amené à
réinterroger une certaine iconographie du cannibalisme, la notion de nature humaine, elle,
nous a conduit sur les sentiers d’une certaine tradition philosophique. Ainsi, avons-nous
pu non seulement reconnaître l’écart esthétique que ces œuvres sont parvenues à produire
au sein de la catégorie de la scène de genre, mais aussi l’écart double qu’elles constituent
par rapport à ces deux horizons, exprimant ainsi leur caractère d’œuvres pensantes : elles
emploient des caractéristiques propre à certaines images avec cannibales et déplacent la
compréhension occidentale de la nature humaine.
L’émergence de l’acte anthropophage dans l’image, entre le XVIe et le début du
XIXe siècle, se fait plutôt rare. La tradition figurative du cannibalisme que nous avons
étudiée ne comptait que trois catégories d’images : l’image coloniale, la caricature
politique et l’image mythologique. Or, en étudiant cette iconographie, nous avons pu
constater que s’y jouait déjà l’effritement progressif de la séparation entre l’homme et le
sauvage. Les images pré-ethnographiques se voulaient factuelles : elles devaient faire
voir la violence de l’Autre, au bénéfice d’une légitimation de la colonisation. Là, le
sauvage est isolé, présenté comme une figure complètement étrangère à la civilisation.
Bientôt, l’acte anthropophage en vient à n’être plus attribué au « sauvage » seul, mais à
des Européens. Si dans l’œuvre gravée de de Bry, la monstration de la barbarie des
�101
colonisateurs espagnols a toujours pour fonction la légitimation du projet colonial, cette
fois protestant, la caricature vise la dénonciation satirique du pouvoir d’opposants
politiques : d’une part, le peuple cannibale et d’autre part, l’Empereur glouton ; la
sauvagerie cannibale a ainsi traversé les frontières de la civilisation qui, désormais, est
digne de l’incarner. Dans l’ensemble de ces exemples cependant, nous ne voyons que des
Européens se dévorer entre eux. Enfin, à travers le contexte d’apparition du Saturne de
Rubens, se traduit une certaine tension liant un homme — le monarque — au
cannibalisme d’un dieu : cette tension est nourrie par le rapport entre la réalité politique
du roi, le mythe et l’œuvre littéraire qui fonde la raison d’être de cet inédit pictural.
Jamais, avant Goya, n’était apparu en peinture, un « sauvage » cannibale, et jamais
n’avaient été montrés en une même image un « sauvage » cannibale et un homme
civilisé. Une telle rencontre resurgit aujourd’hui comme le fait d’un refoulement
iconographique que les œuvres de Goya nous permettent de constater.
L’iconographie du cannibalisme révèle que certaines des images qui la
composent, à l’instar du diptyque de Goya, ne donnent littéralement pas à voir l’acte
anthropophage, soit les images pré-ethnographiques. De façon tout à fait étonnante,
aucun des auteurs de la fortune critique des deux tableaux, bien que tous persuadés qu’il
s’agissait de deux scènes de cannibalisme, n’a su percevoir que ceux-ci ne présentent
aucun acte de dévoration au sens strict ; en effet, ne s’y montre que la seule violence du
morcèlement. Le cannibalisme semble quant à lui faire l’objet d’une projection
fantasmatique, comme phase ultime de la violence que les images de Goya permettent
tout au plus d’anticiper. Ce cannibalisme virtuel, latent, suggéré plutôt que montré, et qui
fait fond dans son absence même sur la présentation brutale du morcèlement, attise
l’imaginaire du spectateur et suscite, dans cette mise en scène de l’horreur, un inavouable
désir de voir qui rend d’autant plus violente la représentation d’une cruauté humaine pour
laquelle l’homme est un loup pour l’homme.
C’est également par le biais de la confrontation des œuvres de Goya aux pensées
philosophiques de Thomas Hobbes et de Jean-Jacques Rousseau que nous avons été en
mesure de montrer que le diptyque présente une violence originaire, en devenant le lieu
�102
d’une rencontre entre des domaines de pensée qui sont d’emblée étrangères l’une à
l’autre. L’image, ici, déploie un monde qui admet une part de l’imaginaire conceptuel. Ce
n’est pas que Goya ait peint un concept ; c’est plutôt que, par les tableaux aux
Cannibales, la peinture se montre capable de penser avec le concept. Il serait même
possible de soutenir que la notion d’état de nature amenait déjà avec elle, et ce dès les
textes philosophiques, une valeur d’image, en tant qu’espace hypothétique et imaginaire
où l’homme n’existe que théoriquement. Cet homme de l’état de nature est, pour Hobbes,
cruel. Goya maintient certes, dans ces œuvres, une conception de la nature humaine qui
était déjà hobbesienne ; mais, dans le contexte révolutionnaire des guerres impériales, il
n’en reconduit pas les visées d’ordre politique : ici, sur ces surfaces peintes, la nature
violente l’emporte sur l’ordre social. La figure du « sauvage » avait nourri l’image
hobbesienne de l’état de nature, c’est-à-dire le fondement même du contrat social qui,
une fois instauré théoriquement, refoule le sauvage et sa violence ; dans l’œuvre de Goya,
le sauvage resurgit comme force anéantissant l’homme d’élite, voire la civilisation que
cet homme incarne. Ainsi, Goya, par un détour par la pensée hobbesienne, renverse la
vision rousseauiste de l’homme bon qui, au fond, est le sauvage du Second Discours,
celui dont la bonté incite Rousseau à défendre la possibilité d’un monde sans
oppression – ce monde qui a inspiré la Révolution. Dans le diptyque de Goya, l’homme,
confronté au sauvage, découvre en lui et pour lui-même une nouvelle nature, une origine
tout autre que chrétienne : une nature sauvage qui le ronge.
En ceci, ces deux petites scènes de genre revêtent un caractère tout à fait
surprenant, puisqu’elles sous-tendent un enjeu d’ordre historique, creusant en deçà même
de l’histoire de l’homme. Ce n’est point seulement l’homme anthropophage, mais la
violence de l’homme nouvellement découverte qui se présente comme une force s’en
prenant à toute forme d’ordre rationnel : elle agit en dépit de la conception chrétienne de
l’ordre du monde et de sa genèse ; contre la logique philosophique du Même et de
l’Autre ; contre l’ordre des Beaux-arts et ses hiérarchies établies. Les auteurs de la
fortune critique qui ont porté leur regard sur ces œuvres ont manqué de reconnaître la
transgression générique et médiale qu’elles constituent ; leur lecture se fondait à l’inverse
sur une organisation classique de la peinture. La peinture devient pourtant ici le lieu de
�103
nouvelles possibilités. Ces œuvres accueillent des caractéristiques médiales qui sont
propres à un médium moins noble, la gravure : la bichromie, l’emprunt de la figure du
Sauvage propre à l’image pré-ethnographique et les motifs caricaturaux de l’attaque au
corps et du déclassement des figures de l’élite. Or, cette appropriation ne se fait pas sans
une certaine violence envers la peinture elle-même, qui signe peut-être la performativité
du sujet de la représentation sur sa mise en forme picturale. Comment ne pas penser que
c’est la forme picturale elle-même au contraire, de par un jeu de croisements médiaux et
génériques, qui a organisé le sujet de la représentation pensante ? Nous pourrions même
aller jusqu’à dire que la peinture devient un médium intégralement pensant du moment
où elle assume son autonomie par rapport à un ordre raisonnable qui lui serait extérieur.
Elle exprime son désir de penser, à titre de corps autonome, du moment où elle nie la
rationalité supposée de l’ordre social, celui-là même qui lui assigne sa place et ses codes.
Sa pensée se déploie et découvre sa propre énonciation. Celle-ci ne passe pas par le
concept, mais par la matière peinte elle-même. Elle n’est pas structurée logiquement –
elle devient expérience vécue, ou plutôt perçue. Elle devient corps.
L’effet de la conception de la nature humaine sauvage et cruelle sur la peinture
nous paraît aujourd’hui bien plus important que la valeur d’universalité de cette nature
humaine. Comment peut-on en effet reconduire cette prétendue évidence, sachant que
celle-ci repose d’une part sur un concept anachronique et d’autre part, sur une vision
violente de l’Autre, laquelle rappelle par ailleurs l’image pré-ethnographique avec
cannibales ? Nous dirons que l’apport de Goya doit être envisagé suivant une logique
critique double et dialectique : la figure du « sauvage » ainsi comprise aura participé à
renverser la conception occidentale de l’homme créé à l’image de Dieu et donc, à
troubler le rapport de l’homme à lui-même ainsi qu’à la peinture, bien que ce
renversement dépende d’une vision occidentale dudit sauvage. Par l’entremise des
tableaux, l’Autre se présente à nous aujourd’hui non pas comme force intégralement
refoulée, mais comme être susceptible de transformer notre compréhension de nousmêmes et de l’histoire de la pensée et de l’art d’Occident.
�104
À la lumière d’un même désir de décentrement de la pensée occidentale, Claude
Lévi-Strauss suggère, dans son texte Nous sommes tous des cannibales (2013), un
déplacement de la conception du cannibalisme, qu’on tend à associer aux peuples
d’Amérique et qui, insiste-t-il, recouvre une grande diversité de types (politique,
magique, rituel, etc.). Ce déplacement repose sur deux éléments importants. D’abord, il
lui permet de critiquer le caractère ethnocentrique d’une conception de l’anthropophagie
qui limite généralement l’acte à sa fonction alimentaire. Or cette forme spécifique de
cannibalisme n’en est qu’une parmi d’autres. Lévi-Strauss découvre par exemple une
forme médicale de l’anthropophagie, laquelle est proprement occidentale, à savoir la
transplantation d’organes. Ce renversement substitue à la séparation entre les hommes
d’Occident et les peuples cannibales, un lien de proximité. Ils répondent tous deux à la
nouvelle description du cannibalisme que fournit l’auteur :
Sous des modalités extraordinairement diverses selon les temps et les lieux, il s’agit toujours
d’introduire volontairement, dans le corps d’êtres humains, des parties ou des substances
provenant du corps d’autres humains (2013 : 173).
Nous ne saurions conclure que Lévi-Strauss propose une vision universelle du
cannibalisme, mais bien plutôt une complexification du phénomène, suivant ses diverses
manifestations, et qui récuse la condamnation occidentale de l’Autre cannibale. Cet
élargissement de la notion d’anthropophagie pourrait faire l’objet d’un nouveau
redoublement. Car si les œuvres aux Cannibales ne représentent pas, à proprement parler,
d’anthropophagie, elles alimentent leur propre corps selon une logique qu’on pourrait
qualifier d’iconophage : une logique qui est au cœur même de la pensée dans et par la
peinture. Ces œuvres auront dévoré des éléments propres à la gravure : la bichromie, la
figure de sauvage de l’image pré-ethnographique, la stratégie de défiguration des corps
de la caricature. Or n’est-ce pas ainsi que fonctionnent les images de façon générale, soit
par phagocytose et dévoration d’autres morceaux d’images, de traditions figuratives, etc.,
nobles et moins nobles? Au-delà du caractère générique d’un tel constat, l’histoire de ces
phénomènes et de leurs effets déformants pour la peinture, suivant
métamorphoses et modalités de subversions, reste à faire.
diverses
�105
BIBLIOGRAPHIE
ADHÉMAR, Jean (1979). La gravure des origines à nos jours, Paris : Somogy.
ALPERS, Svetlana (1971). The Decoration of the Torre de la Parada, New York :
Phaidon.
ALPERS, Svetlana (1995). La création de Rubens. Paris : Gallimard.
AMPHLETT, Hilda (1974). Hats : A History of Fashion in Headware, Meneola : Dover
Publications.
ARASSE, Daniel (1987). La guillotine et l’imaginaire de la terreur, Paris : Flammarion.
AUGÉ, Jean-Louis (2014). « Les Caprices de Goya », De Goya à Delacroix : les
relations artistiques de la famille Guillemardet, Autun : Musée Rolin.
BATICLE, Jeannine (1986). Goya d’or et de sang, Paris : Gallimard.
BATICLE, Jeannine (1989). « Goya and the Link with France at the End of the Old
Regime », Goya and the Spirit of Enlightenment, Catalogue d’exposition, Museo del
Prado, Madrid, 6 octobre – 18 décembre 1988, Museum of Fine Arts, Boston, 18 janvier
– 26 mars 1988, The Metropolitain Museum of Art, 9 mai – 16 juillet, 1989, Boston:
Museum of Fine Arts.
BATICLE, Jeannine (1992). Goya, Paris : Librairie Arthème Fayard.
BAUDELAIRE, Charles (2011). Critique d’art ; suivi de Critique musicale, Paris :
Gallimard.
BAUDRY, Marie-Thérèse (2001). « Ton », Connaissance de la peinture. Courants,
genres et mouvements, Paris : Larousse.
BELFIORE, Jean-Claude (2003). Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine,
Paris : Larousse.
BELTING, Hans (2005). Pour une anthropologie des images, Paris : Gallimard.
BERNARDI, Bernard (2001). « Introduction », Du contrat social, Paris : Flammarion.
BODIN, Jean (1986). Les six livres de la République, Paris : Fayard.
BOSWELL, James (1991). The Journals of James Boswell. 1762-1795, New Haven et
Londres : Yale University Press.
�106
BOURDIEU, Pierre (2004). Esquisse pour une auto-analyse, Paris : Raisons d’agir
éditions.
BRAY, Xavier (2015). Goya. The Portraits, Catalogue d’exposition, Londres, The
National Gallery, 7 octobre 2015 – 10 janvier 2016, New Haven : Yale University Press.
BREDEKAMP, Horst (2003). Stratégie visuelles de Thomas Hobbes. Le Léviathan,
archétype de l’État moderne. Illustrations des œuvres et portraits. Paris : Éditions de la
Maison des sciences de l’homme.
BRETON, André (2003). L’art magique, Paris : Phébus.
BRYANT, M. (2006). “The Scourge of Napoleon”, History Today, Vol. 56(8). pp.58-59.
BUESO, Miriam et coll. (2008). « Estudio tecnico de Ferdinand VII a caballo » in Bienes
culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, numéro 8, pp.117-132.
CAMP, Jean (1968). La littérature espagnole, Paris: Presses universitaires de France.
CABANIS, José (1985). Le Musée espagnol de Louis-Philippe. Goya, Paris : Gallimard.
CHANTEUR, Janine (1982). « Nature humaine et pouvoir politique chez Hobbes et
Rousseau », Revue européenne des sciences sociales, Vol. 20(61), pp.191-208.
CHINARD, Gilbert (1911). « Influence des Récits de Voyages sur la philosophie de
Jean-Jacques Rousseau », PMLA, Vol. 26, numéro 3, pp. 476-495.
CLAIR, Jean (2012). Hubris. La fabrique du monstre dans l’art moderne. Homoncules,
Géants et Acéphales, Paris : Gallimard.
CLERC, Catherine (1985). La caricature contre Napoléon. Paris: Promodis.
COLOMB, Christophe (1992). Journal de bord. 1492-1493. Paris : Imprimerie
Nationale.
D. MULLER, Sheila (2011). Dutch Art : An Encyclopedia, New York: Routledge.
DE LA COSTE-MESSELÈRE, Marie-Geneviève (1967), « Deux tableaux "canadiens"
de Goya », L’œil, n° 148, pp.28-21.
DEL CASTILLO, Michel (2010) Goya en noir et blanc, Paris : Plon.
DEL CASTILLO, Michel (1964). Les louves de l’Escurial, Paris : Robert Laffont.
DERRIDA, Jacques (1967). L’écriture et la différence, Paris : Éditions du Seuil.
�107
DEVISSCHER, Hans (2004) Rubens, Catalogue d’exposition, Palais des Beaux-Arts de
Lille, 6 mars-14 juin 2004, Paris : Éditions de la Réunion des Musées Nationaux.
DIAGRAM GROUP (1982). Les armes du monde entier : de 5000 avant J.-C. à 2000
après J.-C. : une encyclopédie, Paris : Albin Michel.
DIDEROT, Denis (2003). Supplément au voyage de Bougainville, Paris : Flammarion.
DIDI-HUBERMAN, Georges (1992). Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris :
Les Éditions de Minuit.
DORIGNY, Marcel (2013). Atlas des premières colonisations : XVe-début du XIXe siècle
des conquistadores aux libérateurs, Paris : Éditions Autrement.
DOYON, Carol (1991). « David et Goya », Les histoires générales de l’art. Quelle
histoire!, Laval : Trois.
DUCHET, Michèle (1987). L’Amérique de Théodore de Bry : une collection de voyages
protestante du XVIe siècle : quatre études d’iconographie, Paris : Éditions du Centre
national de la recherche scientifique.
EISENSTEIN, L. Elizabeth (1971). « L’avènement de l’imprimerie et la Réforme : une
nouvelle approche au problème du démembrement de la chrétienté occidentale »,
Annales. Histoire, sciences sociales. No. 6 (Nov. – Dec.), pp. 1355-1382.
ENGELBERT ENENKEL, Karl Alfred (2014). Zoology in Early Modern Culture :
Intersections of Science, Theology, Philology, and Political and Religious Education,
Leiden: Koninklijke Brill.
ESTIGNARD, Alexander (1895). Jean Gigoux, sa vie, ses œuvres, ses collections,
Besançon : Delagrange-Louys.
FANON, Frantz (2002). Les damnés de la terre, Paris : Éditions La découverte & Syros.
FOUCAULT, Michel (1972). Histoire de la folie à l’âge classique, Paris : Gallimard.
FOUCAULT, Michel (1966). Les mots et les choses, Paris : Gallimard.
FREEDBERG, David (1970). « Peinture et contre-réforme à l’époque de Rubens », La
peinture flamande au siècle de Rubens, Bruxelles : Meddens.
FREUD, Sigmund (1965). Totem et tabou, Paris : PUF.
FREUD, Sigmund (2010). Malaise dans la civilisation, Paris : Éditions Payot et Rivages.
�108
GADAMER, Hans-Georg (1996). Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une
herméneutique philosophique, Paris : Éditions du Seuil.
GARIN, Eugenio (1990): Astrology in the Renaissance. The Zodiac of Life. Londres:
Arkana.
GASSIER, Pierre (1990). Tout l’oeuvre peint de Goya, Paris : Flammarion.
GASSIER, Pierre et coll. (1981). The Life and Complete Work of Francisco de Goya,
New York: Harrison House.
GAUTIER, Théophile (1981). Voyage en Espagne ; suivi de España, Paris : Gallimard.
GAYA NUŇO, Juan Antonio (1958). La pintura española fuera de España; historia y
catálogo, Madrid : Espasa-Calpe.
GÉRALD POWELL, Véronique et coll. (1998). Goya : un regard libre, Catalogue
d’exposition, Lille, Palais des Beaux-Arts, 12 décembre 1998-14 mars 1999 ;
Philadelphie, the Philadelphia Museum of Art, 17 avril 1999-11 juillet 1999, Lille : Palais
des Beaux-Arts, Paris : Réunion des Musées Nationaux.
GLENDINNING, Nigel (1989) « Art and Enlightenment in Goya’s Circle », Goya and
the Spirit of Enlightenment, Catalogue d’exposition, Museo del Prado, Madrid, 6 octobre
– 18 décembre 1988, Museum of Fine Arts, Boston, 18 janvier – 26 mars 1988, The
Metropolitain Museum of Art, 9 mai – 16 juillet, 1989, Boston: Museum of Fine Arts.
GOODE, Mike (2010). « The Public and the Limits of Persuasion in the Age of
Caricature », The Efflorescence of Caricature, 1759-1838, Farnham: Ashgate Publishing
Limited.
GOYA Y LUCIENTES, Francisco de (1988). Lettres à Martin Zapater, Thonon-lesBains, Alidades.
GUDIOL, José (1992). Goya. Paris: Éditions Cercles d’art.
GUINARD, Paul (1967). « Baudelaire, le Musée espagnol et Goya », Revue d’histoire
littéraire de la France, Vol 67 (2), pp. 310-328.
HARDT, Michael et NEGRI, Antonio (2000). Empire, Paris : Éditions Exils.
HÉSIODE (1999). La théogonie; Les travaux et les jours; Le bouclier; Le catalogue des
femmes (fragments); Autres fragments; suivis de La dispute d’Homère et d’Hésiode,
Paris : Librairie générale française.
HOBBES, Thomas (2010). Du citoyen. Paris : Flammarion.
�109
HOBBES, Thomas (2000). Léviathan ou Matière, forme, et puissance de l’État chrétien
et civil, Paris : Gallimard.
HOBBES, Thomas (1985). Leviathan, or The Matter, Form and Power of a CommonWealth Eccleiasticall and Civill, Londres: Penguin Books Ltd.
HOLLIER, Robert (1966). « Goya inspiré par l’histoire du Canada », Vie des Arts, n° 42,
p. 42-43.
HUGON, Alain (2014). Philippe IV. Le siècle de Vélasquez, Paris : Éditions Payot et
Rivages.
HUME, Martin Andrew Sharp (1912). La cours de Philippe IV et la décadence de
l’Espagne, 1621-1665, Paris : Perrin et cie.
JAUSS, Hans Robert (1978). Pour une esthétique de la réception, Paris : Gallimard.
JOURNEAU, Brigitte (1988). « Église et censure en Espagne au milieu du XIXe siècle »,
Mélanges de la Casa de Velásquez, Tome 24, pp.209-233.
KIRKPATRICK, Sale (1990). The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the
Columbian Legacy, New York : Knopf : Distributed by Random House.
KLEIN, Mélanie (2001). La psychanalyse des enfants, Paris : PUF.
KLIBANSKY, Raymond, PANOVSKY, Erwin et SAXL, Fritz (1989). Saturne et la
mélancolie. Études historiques et philosophiques : nature, religion, médecine et art,
Paris : Gallimard.
LAFFRANQUE,
Marie
(2004).
Marx
et
l’Espagne,
[En
ligne],
http://www.plusloin.org/plusloin/IMG/pdf/laffranque_marx_espagne.pdf. Consulté e 12
avril 2016.
LAFLÈCHE, Guy (1988). Les Saints Martyrs Canadiens, vol. 1, « Histoire du mythe »,
Laval : Les Éditions du Singulier Ltée.
LAFLÈCHE, Guy (1990). Les Saints Martyrs Canadiens, vol. 3, « Le martyre de Jean de
Brébeuf selon Paul Ragueneau », Laval : Les Éditions du Singulier Ltée.
LAFONT-COUTURIER, Hélène et coll. (2003). Vénus et Caïn : Figures de la
préhistoire, 1830-1930, Catalogue d’exposition, Musée d'Aquitaine, Bordeaux, 13 mars 15 juin 2003, Museo Nacional y Centro de Investigacion, Altamira, 1er juillet - 7
septembre 2003 et au Musée du Québec, 8 oct. 2003 - 4 janv. 2004, Paris : Réunion des
Musées Nationaux.
LAFUENTE FERRARI, Enrique (1962). « Goya’s Graphic Work », Goya : Complete
Etching, Aquatints and Lithographs, Londres : Thames and Hudson, p. I à XXXIV.
�110
LAMOUREUX, Johanne (2007). Profession, historienne de l’art, Montréal : Presses de
l’Université de Montréal.
LANEYRIE-DAGEN, Nadeije (2003). Rubens. Paris : Hazan.
LAZARO-REBOLL, Antonio (2004), « Counter-rational reason : Goya’s instrumental
negociations of flesh and world », History of European Ideas, Vol.30(1), p.109-119.
LE BRUN, Annie (2010). Si rien avait une forme, ce serait cela, Paris : Gallimard.
LE BRUN, Annie (2013). « La révolution la nuit », L’ange du bizarre : Le romantisme
noir de Goya à Max Ernst, Catalogue d’exposition, Francfort-sur-le-main, Städel
Museum, 26 septembre 2012 – 20 janvier 2013 ; Paris, Musée d’Orsay, 5 mars – 9 juin
2013, Ostfildern : Hatje Cantz, pp.15-25.
LE RIDER, Jacques (1998), « Ligne et couleur : histoire d’un différend », Revue
germanique internationale, Issue 10, pp.173-184.
LERNER, Bettina (2014). « Collecting for Clio : Louis-Philippe’s Musée Epagnol or the
Louvre as National History”, L’Esprit créateur, 54 (2), pp.101-114.
LESTRINGANT, Frank (1987). « L’automne des cannibales ou les outils de la
conquête », L’Amérique de Théodore de Bry : une collection de voyages protestante du
XVIe siècle : quatre études d’iconographie, Paris : Éditions du Centre national de la
recherche scientifique.
LESTRINGANT, Frank (1994). Le cannibale: grandeur et décadence, Paris : Perrin.
LEVITINE, George (1984). « French Eighteenth-Century Printmaking in Search of
Cultural Assertion », Regency to Empire: French Printmaking 1715-1814, Baltimore:
Baltimore Museum of Art: Minneapolis Institute of Art.
LÉVI STRAUSS, Claude (1962). « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de
l’homme », Jean-Jacques Rousseau, ouv. Coll. Publié par l’Université ouvrière et la
faculté des lettres de l’Université de Genève, Neuchâtel, La Baconnière, p.240. Article
repris dans LÉVI-STTRAUSS (1973). Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973,
pp.45-46.
LÉVI-STRAUSS, Claude (2013). Nous sommes tous des cannibales: Précédé de Le
Père-Noël supplicié, Paris : Éditions du Seuil.
LÉVI-STRAUSS, Claude (2007). Race et histoire, Paris : Gallimard.
LOUSSOUARN, Sophie (2015). « Gillray and the French Revolution », National
Identities, Routledge, pp.1-17.
�111
LOVETT, Gabriel H. (1965). Napoleon and the Birth of Modern Spain, New York: New
York University Press.
MAIRET, Gérard (2000). « Introduction », Léviathan ou Matière, forme, et puissance de
l’État chrétien et civil, Paris : Éditions Gallimard.
MALRAUX, André (1978). Saturne, le destin, l’art et Goya, Paris : Gallimard.
MARX, Karl (1854). « Revolutionary Spain I. Survey of the Revolutionary History of
Spain prior to the XIXth Century », The New York Daily Tribune, [En ligne],
https://www.marxists.org/archive /marx/works/1854/revolutionary-spain/. Consulté le 11
avril 2016.
MATHERON, Laurent (1858). Goya, Paris: Schulz et Thuillié.
MENA MARQUÉS, Manuela B. (2013), « Goya et l’obscure beauté », L’ange du
bizarre : Le romantisme noir de Goya à Max Ernst, Catalogue d’exposition, Francfortsur-le-main, Städel Museum, 26 septembre 2012 – 20 janvier 2013 ; Paris, Musée
d’Orsay, 5 mars – 9 juin 2013, Ostfildern : Hatje Cantz, p.63 à 67
MICHAUD, Éric (2005). Histoire de l’art. Une discipline à ses frontières, Paris : Hazan.
MICHAUD, Éric (2015). Les invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art.
Paris : Gallimard.
MONTAIGNE, Michel de (1965). Essais I, Paris: Gallimard.
MORGAN, Jay Scott (2001). « The Mystery of Goya’s Saturn », New England Review,
Vol. 22, No. 3, p.39-43.
MOULIN, Raymonde (1997). L’artiste, l’institution et le marché, Paris : Flammarion.
MUSSAPI, Roberto, ROSENBERG, Pierre et FALCIANIL, Carlo (2003). Les
Métamorphoses : illustrées par la peinture baroque, Paris : Diane de Selliers.
NAGY, Agnès A. (2009). Qui a peur du cannibale?: récits antiques d’anthropophages
aux frontières de l’humanité, Turnhout : Brepols.
OCCHIETTI, Raphaëlle (2012). La Junte des Philippines de Goya : regard sur le
pouvoir colonial espagnol et le capitalisme financier, mémoire de maîtrise, Montréal :
Université de Montréal.
OROBITG, Christine (2015). « La face noire de l’âme : la mélancolie « religieuse » dans
les textes spirituels et médicaux de l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles », Études
Epistémè. Revue de littérature et de civilisation (XVIe – XVIIIe siècles), numéro 28.
�112
OVIDE (2010). Les Métamorphoses, Paris : Librairie générale française.
PARKE, Geoffrey (2006). « Philippe II, le roi mélancolique », Les collections de
l’histoire, avril, numéro 31, p.56.
PASTOUREAU, Michel (2008). Noir, histoire d’une couleur, Paris : Éditions du Seuil.
PAYANT, René (1987). Vedute. Pièces détachées sur l’art (1976-1987), Laval : Trois.
PEACOCK, John (2005). Un répertoire des modèles de la chaussure de l’antiquité à nos
jours, Paris : Éditions de la Martinière.
PEREZ, Stanis (2003). « Les rides d’Apollon : l’évolution des portraits de Louis XIV »,
Revue d’histoire moderne et contemporaine, Vol 50(3), pp.62-95.
POLETTO, Christine (1990). Arts et pouvoirs à l’âge baroque : crise mystique et crise
esthétique au XVIe et au XVIIe siècle, Paris : L’Harmattan.
PORTERFIELD, Todd (2011). « Introduction. The Efflorescence of Caricature », The
Efflorescence of Caricature, 1759-1838, Farnham: Ashgate Publishing Limited.
RANCIÈRE, Jacques (2010). La parole muette. Essai sur les contradictions de la
littérature, Paris : Fayard.
REY, Alain et coll. (1988). Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Le
Robert-Sejer.
RICOEUR, Paul (1986). Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris : Éditions
du Seuil.
ROBISCO, Nathalie-Barbara (1992). « Jean-Jacques Rousseau et la Révolution
française : une esthétique de la politique », Annales historiques de la Révolution
française, Vol. 291, Numéro 1, pp.124-135.
ROSENBLUM, Robert (1989). L’art au XVIIIe. Transformations et mutations, Brionne :
G. Monfort.
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1992). Discours sur les sciences et les arts ; suivi de
Discours sur l’origine des fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris :
Flammarion.
ROUSSEAU, Jean-Jacques (2001). Du contrat social, Paris : Flammarion.
SABATIER, Georges (2010). Le prince et les arts: stratégies figuratives de la monarchie
française, de la Renaissance aux Lumières, Seyssel : Champ Vallon.
�113
SALHINS, Marshall (2009). La nature humaine. Une illusion occidentale, Paris :
Éditions de l’éclat.
SALLES, Catherine (2013). La mythologie grecque et romaine, Paris : Pluriel.
SAURA, Antonio (1996). Le chien de Goya, Paris : L’Échoppe.
SCHMIDT, Marie-France (2009). Goya, Paris : Gallimard.
SINGLETARY, Suzanne M. (2004), « Dystopia : Goya’s cannibalism », The Journal of
History of Art, Vol. 5, p.56 (26).
SOUBEYROUX, Jacques (2011). Goya politique, Cabris: Éditions Sulliver.
STONE-FERRIER, Linda A. (1983). Dutch Prints of Daily Life: Mirrors of Life or
Masks of Morals ?, Lawrence Kan.: Spencer Museum of Art, University of Kansas.
SYMMONS, Sarah (2002). Goya, Londres : Phaidon.
THÉVET, André (1575). La cosmographie universelle d’André Thévet cosmographe du
roy: illustrée de diverses figures des choses les plus remarquables veues par l’auteur, &
incogneuës de nos anciens & modernes, Paris : Chez Guillaume Chandière.
TODOROV, Tzvetan (2011), Goya à l’ombre des lumières. Paris : Flammarion
TROMANS, Nicholas (2007). “Between the Museums and the Mausoleum : Showing
Spain to Britain”, La circulation des oeuvres d’art. The Circulation of Works of Art in
the Revolutionary Era, 1789-1848, Rennes : Presses universitaires de Rennes ; Paris :
Institut national d'histoire de l'art ; [Los Angeles] : Getty Research Institute, pp.323-330.
TYNIANOV, Iouri (1967). Die literarischen Kunstmittel und die Evolution in der
Litteratur, Francfort, cité par JAUSS, Hans (1978). Pour une esthétique de la réception,
Paris : Gallimard.
VANDENBERG, Vincent (2014). De chair et de sang : images et pratiques du
cannibalisme de l’Antiquité au Moyen Âge, Rennes : Presses universitaires de Rennes.
VIBOLT KNUDSEN, Vibeke (2000). Goya’s realism, Copenhague: Statens Museum for
Kunst.
VIROLI, Maurizio (1988). La théorie de la société bien ordonnée chez Jean-Jacques
Rousseau, Berlin : Walter de Gruyter et Co.
VOLTAIRE (2004). Candide ou l’Optimiste, Paris : Pocket.
�114
WALLERICK, Grégory (2010). « La guerre par l’image dans l’Europe du XVIe siècle :
Comment un protestant défie les pouvoirs catholiques », Archives de sciences sociales
des religions, Issue 1, pp.33-53.
WILSON BAREAU, Juliet (1996). “Goya and the X Numbers: The 1812 Inventory and
Early Acquisitions of "Goya" Pictures”, Metropolitain Museum Journal, Vol.31, pp.159174.
WILSON BAREAU, Juliet et MENA MARQUEZ, Manuela B. (1994). Goya: Truth and
Fantasy: The Small Paintings, Catalogue d’exposition, Musée du Prado, Madrid, 18
novembre 1993 - 27 février 1994, Royal Academy of Arts, Londres, 17 Mars - 12 juin
1994, the Art Institute of Chicago, 16 juillet - 16 Octobre 1994, New Haven, Conn. : Yale
University Press, London.
WIRTH, Jean (2011). L’image à la fin du Moyen-Âge. Paris : Les Éditions du Cerf.
YRIARTE, Charles (1867). Goya : Sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries,
les eaux-fortes et le catalogue de l’œuvre avec cinquante planches inédites, Paris : H.
Plon.
ZIOGAS, Ioannis (2011). « Ovid as an Hesiodic Poet : Atlanta in the Catalogue of
Women (fr.72-6 M-W) and the Metamorphoses (10.560-707)”, Mnemosyne, Vol.64(2),
pp.249-270.
ZWINGENBERGER, Jeanette (2011). « Tous cannibales », Artpress, trimestriel, Numéro
20, pp.9-14.
�
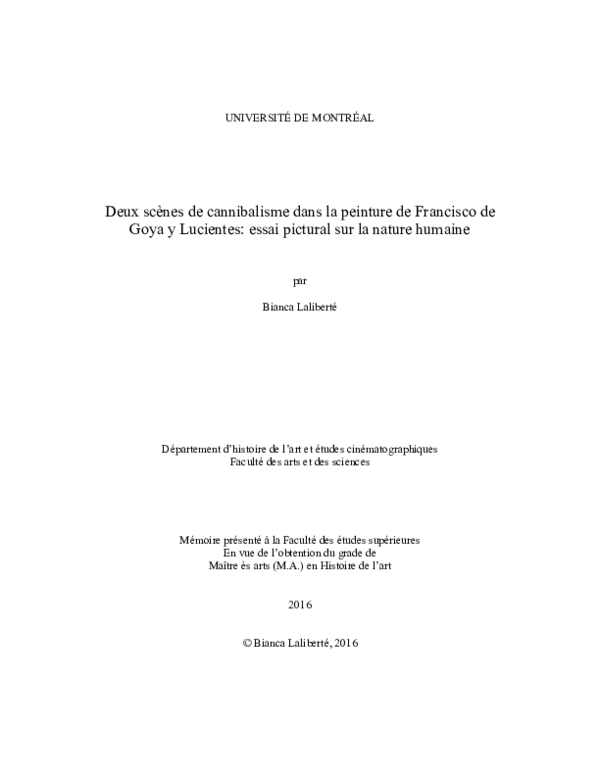
 Bianca Laliberté
Bianca Laliberté