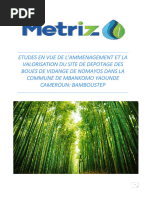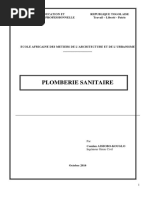VRD ASSAINISSEMENT
VRD ASSAINISSEMENT
Transféré par
Ousseynou ThiandoumDroits d'auteur :
Formats disponibles
VRD ASSAINISSEMENT
VRD ASSAINISSEMENT
Transféré par
Ousseynou ThiandoumTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Droits d'auteur :
Formats disponibles
VRD ASSAINISSEMENT
VRD ASSAINISSEMENT
Transféré par
Ousseynou ThiandoumDroits d'auteur :
Formats disponibles
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
I. ACCES ET USAGES DE L’EAU.
La couverture du réseau SONES.
La consommation moyenne toute source d’alimentation confondue est de 55 litres par
personne et par jour (54l/hab./j).
La consommation aux branchements, suivant la légère augmentation
constatée (1% par an en moyenne depuis 2003), seront prises égales à 67 litres par
personne et par jour en 2025, ce qui correspond à la valeur couramment adoptée par
l’ONAS.
D’après les données de l’année 2008 communiquées par la SDE, les 189 plus gros
consommateurs (y/c administration) consomment plus de 485 000 m3.
Années 2008 Nombre d'abonnés Consommation annuelle
Particuliers 96% 73%
Gros consommateurs 2% 11%
Administration 2% 16%
Total 105 410 abonnés 1 758 099 m3
Nombre et consommations respectives des différents types de clients de la SDE
II. DEFINITION DES TYPES D’ASSAINISSEMENT
II.1. Les principes de base
Suivant les axes majeurs de la stratégie, le Plan D’assainissement sera élaboré sur les
principes de base suivants:
Offrir au plus grand nombre de ménage une couverture adéquate en service de gestion
des excrétas et des eaux usées ;
Utiliser pleinement le potentiel offert par l’assainissement autonome dans la zone.
Ainsi, sur cette base, les systèmes d’assainissement suivants peuvent être retenus :
Un système collectif séparatif
Un système autonome
Un système semi collectif dans la zone non couverte par le système collectif et, où
l’assainissement autonome n’est pas très adapté (zone à nappe peu profonde).
II.2. Assainissement des eaux usées
II.3.Les solutions d'assainissement des eaux usées
L’assainissement autonome
L’aissainissement semi-collectif
L’assainissement collectif
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
II.3.1. L’assainissement Autonome
L’assainissement autonome fait partie de la politique sénégalaise d’assainissement. Une
grande partie de la population sénégalaise est en dehors d’une zone de raccordement à un
système d’assainissement collectif. C’est le cas pour 20 à 30 % de la population rurale. Même
si l’assainissement collectif va continuer à progresser, on estime qu’à l’avenir 10 % des
sénégalais resteront concernés par l’assainissement autonome du fait de leur lieu d’habitation.
Ce système d’assainissement préserve efficacement le milieu aquatique au même titre que
l’assainissement collectif
Dispositif d’assainissement autonome
Comme tout dispositif d’assainissement, l’assainissement autonome doit être entretenu. Ainsi,
les matières qui s’accumulent dans la fosse toutes eaux doivent être vidangées, environ tous
les 3 ans.
La composition de ces matières de vidange est proche de celle des boues d’épuration.
Plus chargées que celles-ci en pollution microbiologique, elles contiennent normalement peu
de polluants chimiques du fait de leur origine purement domestique. Cette qualité tend à se
dégrader du fait des activités de nettoyage et de bricolage qui mettent en jeu de plus en plus
de produits polluants souvent déversés dans l’évier par des particuliers insouciants ou mal
informés.
Réussir un bon dispositif d’aissainissement autone passe forcement par :
- la gestion des excréta
- la gestion des eaux usées.
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
1 Gestion des excréta
Remarques générales
Les technologies de gestion des excréta peuvent être classées en fonction de leur degré
d’utilisation d’eau en quatre grandes catégories: les latrines, les toilettes à chasse manuelle,
les fosses septiques et les réseaux d’égout couplés à une station d’épuration collective. Outre
la disponibilité de l’eau, d’autres facteurs, financiers, urbanistiques et technologiques peuvent
influer sur le choix du système. Pour les systèmes d’assainissement autonomes, I’OMS
recommande leur implantation à au moins 15 m des sources d’alimentation en eau potable –
en cas d'alimentation autonome.
a- Latrines à fosse ventilée (VIP)
Schéma d’une latrines à fosse ventilée (VIP)
Les latrines traditionnelles se composent en général d’une dalle perforée d’un trou de
défécation et posée sur une fosse simple (non ventilée). Elles présentent par conséquent
beaucoup d’inconvénients dont la diffusion de mauvaises odeurs, la prolifération de mouches,
vecteurs de maladies et les risques d’éboulement. Les latrines améliorées à fosse ventilée
constituent une alternative avantageuse à ces latrines traditionnelles.
Les latrines améliorées à fosse ventilée se composent de la fosse, de la dalle, du tuyau de
ventilation et de la superstructure. La dalle est munie d’un trou de ventilation et d’un trou de
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
défécation. Le tuyau de ventilation permet l’évacuation des gaz, contenus dans la fosse. Il
joue aussi le rôle de piège pour les insectes qui arrivent à rentrer dans la fosse: ils sont attirés
par la luminosité de l’extrémité du tuyau qui est obturée avec un grillage anti-insecte et restent
prisonniers.
En milieu urbain, vu l’espace limité des parcelles d’habitation, la fosse peut être construite
avec deux compartiments, utilisés alternativement tous les trois à cinq ans. Le
dimensionnement des latrines tient compte du nombre d’usagers, de la périodicité de vidange
d’au moins trois ans et du taux d’accumulation des boues de 0,03 m3/usager/an. Le contenu de
la première fosse remplie se décompose en matière minérale pendant la période d’utilisation
de la seconde. Au bout des trois à cinq ans, le contenu de la fosse, précédemment remplie, est
transformé en compost, exempt de germe pathogène. Cette fosse peut ainsi être vidée
manuellement par le bénéficiaire sans risque sanitaire.
Les dalles sont plates ou en dôme. La dalle plate peut être réalisée en béton armé ou avec du
bois résistant aux termites et enrobé dans du banco. La dalle en dôme, dans sa version
originale, est non armée, mais requiert des matériaux de construction (sable, ciment) de bonne
qualité et correctement dosés. Ces contraintes ne sont pas garanties avec certitude lorsque l’on
procède à un transfert de technologies vers les populations. Pour augmenter la sécurité, une
amélioration a été apportée en incorporant une armature
Les latrines VIP conviennent parfaitement aux quartiers pauvres. Les matériaux locaux
conviennent parfaitement à la réalisation des latrines et peuvent constituer une partie
importante du coût total. Ces latrines sont réalisables par les ouvriers locaux et elles sont
améliorables en fonction de l’évolution du standing des bénéficiaires.
CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE Unité Quantité P-Unitaire Total
AUTONOME(Toilette VIP)
1 Terrassement ff 1 10 000 10 000
2 Fer de HA8 barres 6 4 500 27 000
3 Ciment sacs 15 6 500 97 500
4 Agglos pleins voutés de 15 m2 30 6 000 180 000
5 Gravier m3 0,5 15 000 7 500
6 Sable m3 0,25 3 000 750
7 Eau m3 0,60 2 500 1 500
8 Agglos creux de 15 m2 25 6 000 150 000
9 Chevron en bois fraqué de 6x8 u 4 1 500 6 000
10 Lattes pour portes ml 8 1 200 9 600
11 Plancher 12+4 m3 3 14 000 42 000
12 Chaise anglaise en porcelaine u 1 45 000 45 000
13 Tuyau PVC en 110 ml 7 2 500 17 500
14 T PVC 110 u 2 4 000 8 000
15 Bouchon PVC 110 u 1 4 000 4 000
TOTAL GENERAL 605 850
Devis quantitatif et estimatif d’une Toilette VIP
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
b- Toilette à chasse manuelle
Schéma d’une toilette à chasse manuelle, double fosse
La toilette conventionnelle coûte cher et nécessite une quantité importante d’eau ainsi qu’un
raccordement aux fosses septiques ou au réseau d’égout. Les toilettes à chasse manuelle
sont une technologie qui présente tous les avantages des WC classiques. Elles coûtent
beaucoup moins cher à la construction et nécessitent beaucoup moins d’eau de chasse. Leur
système de fermeture hydraulique empêche les remontées d’odeurs ou d’insectes depuis la
fosse et assure en conséquence un fonctionnement aussi hygiénique que les WC
conventionnels.
Dans une fosse de toilette à chasse manuelle, les eaux de chasse et la partie liquide des excréta
sont évacuées par infiltration dans le sol. Les matières solides y sont digérées biologiquement,
ce qui réduit sa vitesse de remplissage. Les composantes solubles ainsi que les gaz résultant
de la digestion sont également diffusés dans le sol. Le volume utile de la fosse est fonction du
nombre d’usagers, de la durée de remplissage et du taux d’accumulation des boues (0,04
m3/usager/an).
Les toilettes à chasse manuelle sont réalisables par des ouvriers locaux, peu spécialisés. Leur
entretien peut être assuré par le bénéficiaire. Des matériaux locaux peuvent aussi être utilisés
jusqu’à un taux important.
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
N° Désignation des ouvrages Unités Quté P-Unitaire P-Total
CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE
AUTONOME(Toilette à chasse
manuelle)
1 Terrassement ff 1 10 000 10 000
2 Fer de HA8 barres 3 4 500 13 500
3 Ciment sacs 15 6 500 97 500
4 Agglos pleins voutés de 15 m2 12,80 6 000 76 800
5 Gravier m3 0,5 15 000 7 500
6 Sable m3 0,25 3 000 750
7 Eau m3 0,60 2 500 1 500
8 Agglos creux de 15 m2 25 6 000 150 000
9 Chevron en bois fraqué de 6x8 u 4 1 500 6 000
10 Lattes pour portes ml 8 1 200 9 600
11 Plancher 12+4 m3 3 14 000 42 000
12 Chaise turque en porcelaine u 1 45 000 25 000
13 Tuyau PVC en 110 ml 7 2 500 17 500
14 T PVC 110 u 2 4 000 8 000
15 Bouchon PVC 110 u 1 4 000 4 000
TOTAL GENERAL 469 650
Devis quantitatif et estimatif d’une Toilette à chasse manuelle
c- Fosse septique
Schéma de fonctionnement d’une fosse septique
Une fosse septique est un ouvrage d’assainissement destiné à collecter et à stocker les
excréments, véhiculés par l’eau de chasse qui, avec les autres eaux usées domestiques
(vaisselle, cuisine), transitent dans l’ouvrage pour être traitées ou évacuées par des dispositifs
annexes.
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
La fosse septique convient bien aux habitations disposant de branchement interne au réseau
d’eau potable. Elle coûte plus cher et requiert beaucoup plus d’eau que les ouvrages
précédents. Son fonctionnement nécessite un système centralisé de collecte et de traitement
des boues ainsi que des dispositifs d’épuration des effluents liquides, contrairement aux
toilettes à chasse manuelle et aux latrines ventilées.
Une fosse septique doit permettre de supprimer presque toutes les matières solides en
suspension et doit décomposer une bonne partie des matières organiques par voie
anaérobique. Pour cela:
Le temps de séjour du liquide dans la fosse doit être d’au moins 24 heures et deux
tiers du volume sont réservés au stockage de boues. Ces contraintes sont respectées
si le volume de la fosse permet une rétention de la quantité totale d’eau rejetée en 3
jours par les usagers.
Les dispositifs d’alimentation et d’évacuation doivent être tels que les matières
flottantes et les boues décantées ne se retrouvent pas dans l’effluent. Les tuyaux en
té et un compartimentage tel que le premier compartiment soit deux fois plus
volumineux que le second permettent de satisfaire à cette exigence.
Une fosse septique est réalisable par des ouvriers locaux, mais son exploitation nécessite le
recours aux entreprises de vidange. Elle coûte nettement plus cher que les systèmes
précédents.
Dispositifs épurateurs des effluents de fosses septiques
Dans les zones où les habitations sont équipées de fosses septiques, les effluents peuvent être
traités en exploitant le pouvoir auto-épurateur du sol. Diverses technologies peuvent être
utilisées, dépendant des conditions géologiques, hydrogéologiques et topographiques.
Epandage souterrain
L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de canalisations PVC de 80 à 100 mm de
diamètre, placées dans des tranchées de 70 à 80 cm de profondeur sur 30 à 60 cm de largeur.
Ces canalisations sont perforées tous les 20 à 30 cm de trous de 4 à 6 mm de diamètre. Les
drains reposent sur un lit de gravier de 15 cm d’épaisseur. Les tranchées d’épandage sont
réalisables par des ouvriers et avec des matériaux locaux. Dans certaines villes, le tuyau en
PVC constitue l’unique élément à importer. L’entretien de ce dispositif peut être assuré par le
bénéficiaire.
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Dispositif d’épandage
Lorsque les conditions hydrologiques sont défavorables pour l’implantation d’une tranchée,
les techniques suivantes peuvent être utilisées.
Tertre filtrant
Le tertre filtrant est une alternative de l’épandage quand l’épaisseur de la couche de sol est
inférieure à 60 cm, si la nappe est à moins de 60 cm de profondeur ou, lorsque la perméabilité
du sol est inférieure à 15 mm par heure.
Cette technique consiste en l’édification sur le terrain naturel d’un tertre de sable de 1 m de
haut et dans lequel sont disposés les drains de dispersion. L’installation requiert en amont un
décolloïdeur et une pompe de refoulement.
8
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Dispositif de tertre filtrant
Filtres à sable
Les filtres à sable (lits filtrants) sont des procédés qui reproduisent les processus de
l’épuration par le sol. On distingue les lits à flux vertical avec ou sans collecte inférieure de
l’effluent et les lits à flux horizontal et drainés.
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Plateau absorbant
Le plateau absorbant est un ouvrage destiné à recueillir, épurer et évacuer l’effluent de la
fosse septique, après avoir traversé un filtre bactérien et un décolloïdeur. L’effluent s’y répand
uniformément grâce à un agencement judicieux de drains répartiteurs. Epurées par oxydation,
les eaux sont absorbées par des plantes ou des arbustes hydrophiles puis évacuées par
évapotranspiration.
Ainsi, vu le sol argileux dans la zone d’étude, ces technologies ne peuvent pas etre réalisées.
Elles sont plutôt conseillées dans des zones ou l’infiltration est bien assurée.
d- Gestion des eaux usées Puisard
Schéma de la gestion des eaux usées Puisard
10
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Le puisard est un dispositif d’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. C’est
généralement une fosse cylindrique de 2 à 3 m de profondeur, selon la nature du terrain. Elle
peut être remplie de gros gravier qui assure un double rôle de soutènement des parois et du
support de biofilm comme pour les lits bactériens.
Dans les quartiers pauvres, le dispositif peut être utilisé pour l’évacuation des eaux de lessive,
de vaisselle et de douche. Dans les quartiers de standing plus élevé, ne disposant pas de réseau
d’égout, les puisards peuvent être placés en aval des fosses septiques pour infiltrer les eaux
usées dans le sol, si les conditions hydrogéologiques le permettent.
Le puisard est réalisable par des ouvriers locaux et peut largement utiliser des matériaux
locaux. Son coût peut être plus faible lorsque le sol est suffisamment stable pour ne pas
nécessiter une paroi en parpaings.
Procédure de calcul :
Nombre de personne estimé par ménage: 06 personnes
1,3 ménages par concession :
Ce qui nous donne 1,3x6=7,8 personnes
La consommation journaliére d’une personne est en moyenne de 55 litres/pers/jour avec 80%
de rejet.
⇒7,8x55x0,8=343,2 litre par jour par concession
Avec un taux d’infiltration d’un sol argileux non gonflant de 10 litres/m2/jour, nous avons
34,32m2 de surface de diffusion.
Si nous fixons un diamétre de puisard d=1,5m ; la surface des parois sera égale à πdh avec
h la profondeur du puisard ; et la surface de base sera de (ππd2)/4 ; ce qui nous donne une
πdh + (π
surface totale de (π πd2)/4) qui doit etre au minimum égale à la surface de diffusion qui
est de 34,32m2.
πdh + (π
Donc après résolution de l’équation (π πd2)/4) = 34,32 ; on trouve une profondeur de
puisard qui est égale à 7m.
En conclusion, cette profondeur est énorme, difficilement réalisable et on sera obligé de le
faire en voile. En outre, l’entretien comme la mise en œuvre d’un tel puisard va nécessiter
forcément une grue de levage ; ce qui sera très couteux pour les familles.
11
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
LAVOIR-PUISARDS
1 Terrassement ff 1 17 500 17 500
2 Fer de HA8 barres 7 4 500 9 000
3 Ciment sacs 21 6 500 136 500
4 Agglos pleins voutés de 15 m2 24,5 6 000 147 000
5 Gravier m3 1,05 15 000 15 750
6 Sable m3 0,525 3 000 1 575
7 Eau m3 10,5 2 500 26 250
8 Agglos creux de 15 m2 10,5 6 000 63 000
9 Tuyau PVC en 110 ml 10,5 2 500 26 250
10 T PVC 110 u 7 4 000 28 000
11 Bonde de sol PVC 110 u 7 4 000 28 000
12 Moellons ff 1 42 000 42 000
TOTAL GENERAL 510 825
Devis quantitatif et estimatif minimum d’un puisard
II.3.2. L’assainissement semi-collectif
1.1.1 L’assainissement semi-collectif consiste au traitement des eaux usées domestiques
d’un nombre d’habitants largement supérieur à celui d’une habitation individuelle,
mais qui n’est pas raccordé au réseau public.
L’assainissement non-collectif individuel, ou assainissement autonome, traite les eaux usées
domestiques d’une habitation individuelle. L’assainissement collectif, qui repose sur des
stations d’épuration collectives, traite en général les effluents d’un minimum de 2.000 EH
(équivalents-habitants). Entre les deux se glisse l’« assainissement semi-collectif »,
également dénommé « petit collectif » ou « assainissement non collectif regroupé ». Un
dispositif d’assainissement semi-collectif épure les effluents regroupés de plusieurs
habitations, appartements ou bâtiments qui y sont raccordés – immeuble, hôtel, camping,
usine, centre commercial, hameau, petit village,…
Dans cette catégorie aussi vaste que floue, les configurations sont nombreuses : entre autre,
l’exploitant peut aussi bien être un particulier qu’un groupement de particuliers, une société
privée comme une commune et ses services technique.
Par exemple on peut citer les égouts de petits diamètres qui sont un système collectif après
des systèmes individuels de "prétraitement".
Malgré les avantages parfois très probables, les systèmes de petits diamètres étant le système
d'une autre culture technique, mais des expériences sont en train de se faire à Ngor village et à
la cité Ousmane DIOP à Thiaroye.
Dans les zones densément peuplées, avec des habitations disposant de branchements internes
au réseau d’eau potable et de fosses septiques, le réseau d’assainissement de petits diamètres
constitue une alternative au réseau d’égout classique qui coûte tellement cher que de
nombreuses habitations ne peuvent s’y raccorder (c’est le cas à Dakar, à Thiès, à Louga, à
Saint-Louis et à Kaolack, grandes villes du Sénégal).
Les réseaux de faibles diamètres présentent tous les avantages des systèmes classiques. En
plus, ils sont moins chers à la réalisation comme à l’exploitation. En effet, la plupart des
12
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
matières solides étant décantées dans les fosses intermédiaires des habitations, il n’est pas
nécessaire de nettoyer ces égouts aussi soigneusement que les égouts classiques. Cela permet
en plus d’avoir des canalisations beaucoup plus petites et des pentes plus faibles.
Ce systéme nécessite une épuration des eaux ; c'est-à-dire la réalisation de stations
d’épuration soit par lagunage soit par boue activée.
Schéma d’habitations raccordées à un réseau à faible diamètre
II.3.3. Assainissement collectif
On parle d'assainissement collectif dans le cas où le bâtiment est relié au réseau local
d'assainissement. Ce système est le plus souvent appliqué dans les milieux urbanisés.
Les réseaux de collectes ou égouts ont pour fonction de recueillir les eaux usées de toute
origine et de les acheminer vers les stations d'épuration où elles sont traitées. Le réseau peut
être unitaire, c'est-à-dire qu'il reçoit de manière commune les eaux pluviales et les eaux
usées domestiques. S'il existe deux collecteurs séparés, on parle alors de réseau séparatif.
Il peut aussi exister des réseaux d'assainissement mixtes.
Dans les stations d'épuration, on dégrade et sépare les polluants de l'eau pour ne restituer au
milieu naturel (mer, cours d'eau...) que les eaux dites « propres ». Dans le cadre de
l'assainissement collectif, le raccordement des immeubles aux égouts est obligatoire dans un
délai de 2 ans à partir de la mise en service du réseau de collecte des eaux usées. Ce service
d'assainissement collectif donne lieu à la perception d'une redevance dite « d'assainissement »
dont le montant est fixé par la ville.
13
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
II.4.Systèmes collectifs d’épuration des eaux usées
En lieu et place des technologies classiques d’épuration collective des eaux usées qui ont fait
preuve d’inefficacité dans le contexte africain, le lagunage et le traitement des boues de
vidange constituent des technologies alternatives plus appropriées.
(En cas de l'intérêt à la réutilisation dans l'agriculture – surtout maraîchère – il faut
néanmoins prévoir des technologies plus efficaces.)
II.4.1. Système de traitement par lagunage
Le lagunage est une technique biologique d’épuration des eaux usées, où le traitement est
assuré par une combinaison de procédés aérobies et anaérobies impliquant un large éventail
de microorganismes (essentiellement des algues et des bactéries). Les mécanismes épuratoires
et les microorganismes qui y participent sont fondamentalement les mêmes que ceux
responsables du phénomène d’autoépuration des lacs et des rivières.
Le lagunage consiste en une succession de bassins (minimum 2) peu profonds et généralement
rectangulaires. L'eau s'écoule gravitairement de lagune en lagune. Dans un système de
lagunage, la surface et la profondeur des bassins influencent le type de traitement (aérobie ou
anaérobie) et confèrent un rôle particulier à chaque bassin. L'action naturelle du soleil, qui
fournit chaleur et lumière, favorise une croissance rapide des microorganismes aérobies et
anaérobies qui consomment la DBO.
La demande biochimique en oxygène (DBO) est la quantité d'oxygène nécessaire pour
oxyder les matières organiques (biodégradables) par voie biologique (oxydation des matières
organiques biodégradables par des bactéries).Elle permet d'évaluer la fraction biodégradable
de la charge polluante carbonée des eaux usées.
Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables
d’une eau (toute matière organique biodégradable polluante entraîne une consommation de
l'oxygène) au cours des procédés d’autoépuration. La DBO permet de mesurer la qualité
d'une eau (eaux superficielles : rivières, lacs..., eaux usées : stations d'épuration, rejets
industriels...). L'eau analysée contient une quantité de matières organiques biodégradables,
rejetées dans le milieu naturel, ces matières organiques vont être dégradées par voie
biologique ce qui va entraîner un développement de micro organismes aérobies. Cette
prolifération provoquera une chute de l'oxygène dissous dans le milieu récepteur et conduira à
l'asphyxie des espèces présentes. Cette analyse permet donc de connaître l'impact du rejet
dans le milieu récepteur.
II.4.2. Principe de l'analyse de la DBO
La DBO est mesurée au bout de 5 jours (=DBO5), à 20 °C (température favorable à l’activité
des micro-organismes consommateurs d’O2) et à l’obscurité (afin d’éviter toute photosynthèse
parasite). Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration
initiale en O2, le second à la mesure de la concentration résiduelle en O2 au bout de 5 jours. La
DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Les mesures seront effectuées sur un même
volume et le second échantillon sera conservé 5 jours à l’obscurité et à 20 °C.
14
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Afin de mesurer la totalité de la demande, l’O2 ne doit pas devenir un facteur limitant de
l’activité microbienne. En effet, une eau abandonnée à elle-même dans un flacon fermé
consommera rapidement le dioxygène dissous : il faut donc s’assurer au préalable que ce
dioxygène suffira largement à la consommation des micro-organismes. On utilise pour cela la
méthode des dilutions, ou l’échantillon à doser est dilué dans une quantité d’eau telle qu’à
l’issue de la mesure le taux d’O2 résiduel reste supérieur à 50 % du taux initial. Une quantité
réduite du mélange micro-organismes + substrat est ainsi mise en présence du dioxygène d’un
important volume d’eau dépourvu de demande propre*
(*L'eau pure ne consomme effectivement pas d'oxygène)
Le processus épuratoire qui s'établit dans une lagune est particulièrement intéressant car c'est
un phénomène vivant, un cycle naturel qui se déroule continuellement.
II.4.3. Avantages du système de traitement par lagunage :
Les systèmes de lagunage sont faciles à construire, peu coûteux, tolérants et performants.
• Faciles à construire :
L'excavation du sol représente le gros du travail. La mise en place de traitements
préliminaires, l'installation des conduites d'entrée et de sortie et la protection des remblais ne
font appel qu'à des notions de base du génie civil. Si le terrain est perméable, il peut
également s'avérer indispensable de poser un revêtement étanche sur le fond de chaque bassin.
• Peu coûteux :
La simplicité du lagunage explique les faibles coûts de la technique. Il n'y a pas besoin
d'équipement électromécanique et la consommation annuelle d'électricité est nulle voire très
faible. Les opérations de maintenance peuvent en général être accomplies par une main œuvre
peu qualifiée. Le coût d'un système de lagunage varie essentiellement en fonction du prix du
terrain et de la nature du sol.
• Tolérants :
Les lagunes sont capables de d'absorber de soudaines variations de charges organiques et
hydrauliques.
• Performants :
Cette technique offre de bons rendements épuratoires. Elle permet en général de diminuer la
DBO de 90%, l'azote de 70-90% et le phosphore de 30-50%. Par rapport aux autres
techniques existantes, le lagunage se distingue par son efficacité dans l'élimination des
pathogènes. Il n'est pas rare qu'un système de lagunage correctement dimensionné abaisse le
nombre de bactéries fécales d'un facteur 105.
II.4.4. Types de lagunes
On rencontre trois types de bassins :
15
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
• les bassins anaérobies ;
• les bassins facultatifs ;
• les bassins de maturation.
Le but premier des bassins anaérobies et facultatifs est d'éliminer la DBO; quant aux bassins
de maturation, leur but est d'éliminer les pathogènes.
Les bassins anaérobies sont très utilisés pour recevoir des eaux usées très chargées en
matières organiques et contenant de grandes quantités de solides en suspension. Comme son
nom l'indique, un bassin anaérobie est un bassin dépourvu d'oxygène dissout et qui ne
contient pas (ou très peu) d'algues. Les bassins facultatifs et de maturation possèdent de
grandes populations d'algues qui jouent un rôle important dans le traitement.
Les bassins facultatifs peuvent se subdiviser en deux grandes catégories :
Les bassins facultatifs primaires et les bassins facultatifs secondaires. Les primaires reçoivent
directement l'eau usée brute, alors que les secondaires reçoivent un effluent décanté
(généralement l'effluent d'un bassin anaérobie).
Ces trois types de bassins sont arrangés en série, plusieurs séries peuvent également
fonctionner en parallèle. Classiquement, ces séries se composent d'un bassin facultatif
primaire suivi d'un ou plusieurs bassins de maturation, ou bien d'un bassin anaérobie suivi
d'un bassin facultatif secondaire et finissant par un ou plusieurs bassins de maturation. De
telles séries sont très avantageuses, elles permettent aux différents bassins d'accomplir leur
différentes fonctions au sein du traitement et elles produisent un effluent de grande qualité.
16
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE
COLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Schéma d’une coupe transversale d’un système classique de lagunage. La partie à
l’entrée du bassin anaérobie est plus profonde pour permettre une meilleure
accumulation des boues sur une petite surface
17
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
II.4.5. Mécanismes épuratoires :
Les différents mécanismes épuratoires associés au lagunage sont :
1. L'effet tampon : la relative grande taille des bassins leur permet d'absorber des
variations soudaines de charge et de volume.
2. La sédimentation qui permet aux matières décantables de se déposer sur le
fond et de contribuer à la formation des boues.
3. Le traitement de la matière organique par oxydation aérobie (en présence
d'oxygène) et par digestion anaérobie (en absence d'oxygène).
II.4.6. Avantages et inconvénients :
Le lagunage est fortement dépendant des conditions climatiques (essentiellement de la
température) et la qualité des rejets peut donc varier selon les saisons. L’emprise au sol est de
10 à 15m² par équivalent habitant. Les coûts d’investissement sont non seulement dépendants
du prix du terrain mais aussi de la nature du sol. Sur un sol perméable, il sera indispensable
d’ajouter un revêtement imperméable et dans ce cas, l’investissement peut s’avérer onéreux
voire difficilement abordable. Malgré ces défauts, le lagunage reste une technique efficace
(également pour l’azote, le phosphore et germes pathogènes) bon marché, ne nécessitant pas
de construction en dur (génie civil simple) et s’intégrant parfaitement au paysage. De plus,
aucun apport d’énergie n’est requis si le terrain est en pente.
II.5.Elaboration de réseau d'égout
Pour pouvoir bien définir une stratégie d'assainissement des eaux usées il faut voir les
différentes solutions, et les comparer du côté financier et du côté d'exploitation. La solution de
base peut être toujours le système collectif d'égout classique avec une station d'épuration.
Cette solution est alors toujours une solution à étudier. Le résultat d'étude peut
déterminer le délai utile de réalisation du système ou des conditions nécessaires pour
que cette solution puisse être économique ou à réaliser d'autres raisons. (L'économie
des différentes solutions n'est jamais très exacte, comme il y a toute une série de
facteurs qui ne peuvent pas être évalués précisément.)
Parmi les conditions climatiques et environnementales du Sénégal il s'agit bien évidemment
des systèmes séparatifs d'eaux usées et d'eaux pluviales.
II.5.1. Critères de dimensionnement, principes et la méthode de calcul
Les principaux critères et paramètres de dimensionnement du réseau d’eau usée sont présentés
dans le tableau suivant. L'élaboration des variantes du réseau d'égout est déroulée selon ces
critères.
18
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Tableau Critères techniques de canalisation EU
Dénomination Valeurs
Collecteurs
Coefficient de pointe (débit) 1,5 + 2,5/Qm1/2
Qm = débit moyen (en
m3/h)
Rugosité absolue pour la méthode Colebrook-White en cas de 0,4
PVC [mm]
Diamètre de tuyau, min. [mm] 250
Vitesse de flux, min. [m/s] 0,6 (0,4)
Vitesse de flux, max. [m/s] 3,0
Remplissage de tuyau DN ≤ 300 mm 0,5DN
DN = 350-600 mm 0,7DN
DN > 600 mm 0,8DN
Pente min.-max. [‰] 3 - 30
Couverture min. [m] 0,80
Profondeur maximale du fil d'eau (en général) [m] 3,50
Regards de visite
Distance entre les regards max. [m]
DN ≤ 300 mm 35
300 < DN ≤ 500 mm 45
DN > 500 mm 60
Dimension minimale intérieure- regard visitable 800
[mm]
400
- regard non visitable [mm]
Cunette du regard - hauteur [m] DN≥500 → Hmin=0,5m
19
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Dénomination Valeurs
DN<500 → Hmin= DN
- pente [%] 10±2
Angle de raccordement dn/DN≥0,5 → <67,5o
dn/DN<0,5 → ≤90o
Branchement domiciliaire
Diamètre de tuyau min. [mm] DN150 (PVC D160)
Pente min. [‰] 30
Raccord domiciliaire au-dessus du niveau d’eau usée au 20
collecteur [cm]
Les principes les plus importants utilisés au cours de l'élaboration des variantes sont les
suivants:
La localisation prévue de la station d'épuration assure:
* l'utilisation optimale des conditions gravitaires du terrain pour les
collecteurs,
* la possibilité économique de la réutilisation éventuelle des eaux usées
épurées,
* la possibilité optimale de rejet des eaux usées épurées au milieu récepteur
naturel,
* l'accès routier simple,
* la distance convenable des zones d'habitation actuelles et futures.
II.5.2. Les zones d'extension
La solution pratique d'élaboration du réseau est identique à la solution utilisée
pour les zones spontanée.
Le taux de branchement à un système collectif ne peut jamais atteindre 100 %, alors
les systèmes individuels ne peuvent pas être complètement supprimés et changés à un
système collectif: les systèmes individuels demeurent en parallèle du développement
20
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
éventuel d'un système collectif: Les cas ne sont jamais propres. On peut néanmoins
aboutir un taux élevé, et que seulement les quartiers très peu denses restes sans
canalisation collective. Mais le problème de traitement des boues de vidange des
fosses reste à résoudre en parallèle la réalisation d'une STEP pour le réseau collectif.
Les autres principes et les méthodes utilisés sont les règles générales de l'art.
Le débit de projet d’eau usée est calculé sur la base de la population des bassins versants
appartenant aux sections des collecteurs et aux sections des stations de pompage. On n'a pas
définit de taux de raccordement au réseau pour l'horizon, comme la consommation en eau
potable se rapporte aussi à toute la population.
II.6.Système de traitement par les boues de vidange :
L’enfouissement sauvage des matiéres fécales issues des fosses septiques et latrines constitue
un grand probléme de santé publique et d’environnement, notamment dans la banlieue
dakaroise ou prés d’un ménage sur deux opte ce type de comportement.
Cette pratique est justifiée dans la plupart des cas, par des raisons économiques, ou/et par
l’inaccessibilité des zones d’habitation.
Ce fléau est a l’origine de nombreux affections respiratoires, gastriques et autres maladies de
la peau, sans compter les multiples dangers liés a la pollution de la nappe phréatique par
exemple. Les enfants sont les premiers victimes de l’enfouissement de ces déchets, appelé
vidange manuelle, dans les cours des maisons ou leur voisinage immédiat.
Cette politique d’amélioration du service et de son accessibilité poursuit les objectifs suivants:
• Convaincre les ménages à recourir systématiquement à la vidange mécanique ;
• Inciter les ménages à abandonner la vidange manuelle ;
• Rentabiliser l’exploitation des boues de vidange.
Les boues liquides produites dans les latrines à fosse simple, les toilettes à chasse manuelle et
les fosses septiques doivent être régulièrement vidangées et traitées. La vidange se fait avec
des camions vidangeurs appartenant à des sociétés privées.
Bien souvent les boues sont rejetées dans la nature alors que selon la législation, la commune
doit obligatoirement identifier un site de traitement des boues.
Quand les camions vidangeurs ne sont pas disponibles ou lorsque la vidange mécanique est
jugée trop chère, la vidange est réalisée par des vidangeurs manuels. Il ne faut pas les ignorer
mais plutôt les aider à s'organiser (équipement, formation). La commune doit également
identifier et aménager des lieux de dépôt.
Le procédé de traitement des boues de vidange le plus utilisé consiste à épaissir les boues et
ensuite à les déshydrater. Cela se fait dans des bassins de grandes dimensions permettent aux
boues de s'épaissir et de se déshydrater. L'effluent est évacué et traité (par lagunage) alors que
la boue épaissie peut être séchée ou compostée. Un personnel qualifié est requis pour assurer
l'exploitation et l'entretien pour un fonctionnement approprié.
En milieu rural ou lorsqu'il n'existe pas encore de station de traitement des boues, un terrain
clôturé peut être identifié et réservé à l'épandage des boues de vidange en surface ou en
21
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
tranchées. Il faut s'assurer de ne pas polluer les eaux souterraines ou les eaux de surface par
ruissellement.
La valorisation de boues peut être faite par co-compostage (mélange avec les ordures
ménagères organiques).
Ainsi, le partenariat doit etre développé avec les acteurs institutionnels, nationnaux et locaux,
le secteur privé, les organisations sociales de base, les institutions de recherche, etc.
Cette dynamique va sans nulle doute offrir un nouvel environnement institutionnel ou l’état,
les communes, le secteur privé et les usagers seront dans une compétition constructive et
salutaire en faveur des populations encore privées de ces services de base.
En outre, les innondations récurrentes dans certaines zones ont accentué les problémes
d’assainissement en privant l’accés aux installations domestiques pour bon nombre de
ménages.
Ce systéme de traitement des boues de vidange s’appuie sur trois volets essentiels pour la
valorisation des produits dérivés de l’assainissement autonome :
• La collecte et le stockage efficients des boues avec l’utilisation de toilettes adaptées et
innovantes a moindre cout, notamment pour les zones innondables et innondées.
• Le transport propre et organisé avec notamment les camions Omni-ingestor (vidange,
curage et traitement).
• Le traitement avec la construction de station supplémentaire.
L’exploitation par le secteur privé des boues de vidange, ouvre la voie à la valorisation du
processus de traitement pour une production de biogaz en tant qu’énergie domestique ou
industrielle, et la génération de fertilisants pour l’agriculture.
Traitement des boues de vidange Schéma d’un bassin de sédimentation et
d’épaississement
22
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Station de traitement des boues de vidange
STATION DE TRAITEMENT DES
BOUES DE VIDANGE
1 Ouvrage de réception u 1 5 721 731 5 721 731
2 Canal dégrilleur u 1 5 714 358 5 714 358
3 Canal de distribution u 1 15 521 100 15 521 100
4 Lits de séchage u 1 132 660 052 132 660 052
5 Bache tampon de pompage u 1 18 665 247 18 665 247
TOTAL GENERAL 178 282 488
Devis quantitatif et estimatif d’une Station de traitement des boues de vidange
II.7.STATIONS D’EPURATION
Afin de stopper la propagation des risques sanitaires dans l’environnement immédiat des
zones habitées, la STEP devra garantir un niveau de traitement suffisant des eaux usées et des
sous-produits du traitement (boues séchées).
Les rejets des eaux usées dans le milieu récepteur et la réutilisation des eaux usées épurées
sont réglementés par :
Les normes relatives aux rejets d’effluents domestiques dans le milieu récepteur et non
domestiques dans les réseaux d’assainissement ;
Les conditions de réutilisation pour l’agriculture des eaux traitées (type de cultures,
modalités et les conditions particulières).
Les effluents qui sont rejetés dans le milieu récepteur doivent être traités de manière à
respecter les valeurs indiquées par la norme sénégalaise NS 05-061
23
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
III. IMPACTS DU PROJET
Les impacts des systèmes sont à évaluer.
Avant la décision définitive de la solution à réaliser, il faut examiner les impacts de tous les
investissements possibles.
III.1. Impacts de la réalisation du réseau
La construction des collecteurs et les ouvrages engendrent de nombreux impacts désagréables
et des nuisances (bruit causé par des engins, etc.), mais ils ne durent pas longtemps sur les
différents tronçons et peuvent être minimalisés grâce à une bonne organisation de travaux.
La mise en service et l’utilisation du réseau d’eau usée peuvent occasionner des changements
fondamentaux. La vie des ménages raccordés à l’égout sera plus agréable, plus confortable et
surtout plus saine.
Grâce à un réseau d'assainissement, la zone serait libérée partiellement des contraintes de
vidange des fosses septiques. L’exploitation des camions citernes diminuera ainsi que le trafic
de ce type de véhicules.
Les conditions d’hygiène s’améliorent et les maladies liées à ces circonstances d’hygiène
diminuent.
Le réseau d’assainissement fonctionnant n'est pas bruyant et ne pollue pas l’air. Le seul
désagrément éventuel est l'odeur qui peut être évité par le bon fonctionnement de l'aération du
réseau ou par de nettoyages réguliers des tronçons.
Le réseau d’assainissement bien fonctionnant ne représente aucun danger pour
l’environnement et il ne cause pas de risques ni pour la nature, ni pour l’homme.
III.2. Impacts de la réalisation d'une station d'épuration
La station d'épuration étant normalement implantée à bonne distance de la zone construite du
site, ses impacts sur l'environnement urbain et ainsi les nuisances engendrées vis à vis des
populations seront réduits à leur plus simple expression, ce qu’une analyse des différents
facteurs environnementaux a montré sans ambiguïté.
Les facteurs analysés ont été les suivants :
• perturbation du site
• risques de pollution de la nappe
• risques de prolifération des moustiques
• risques d'émanation de mauvaises odeurs
• risques d'émanation d'aérosols
• risque d'émanation de bruits
• risques de développement de mousses
• risques corporels pour les personnes étrangères non averties.
24
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
Les risques de nuisance étant particulièrement réduits, la station ne pourra donc apporter que
des effets bénéfiques lesquels découleront de la réutilisation possible des eaux usées épurées
en agriculture.
III.3. Impacts de la réalisation d'un système d'assainissement individuel
Même si la nappe phréatique est assez profonde, la collecte des eaux usées dans un système
de fosse (septique) - puits perdu cause la pollution du sol. Cette pollution aboutit normalement
à un état équilibré dynamique par la capacité d'épuration naturelle du sol.
Par les branchements au réseau, on peut mettre terme à la pollution du sol et de la
nature causée par les camions citernes qui vidangent leurs charges d’eau usée dans la
nature – en manque d'une solution plus appropriée.
Les systèmes d'assainissement individuels peuvent être jugés complets en cas de la réalisation
bien conçue de décharge des camions citernes de vidange. Dans le cas des systèmes bien
conçus et bien fonctionnant, la pollution de la nature n'est pas plus élevée qu'en cas des
stations d'épuration des systèmes collectifs.
Les impacts du trafic des camions citernes et de l'action de vidange de fosse peuvent être
néanmoins jugés comme nuisances réelles, mai très supportables par rapport à la dispersion
actuelle des eaux usées.
Dans tous les cas, la réutilisation des boues de vidange (ou des boues devenues de compostes
automatiquement - VIP) serait très importante pour la fertilisation des sols.
III.4. Impacts socio-économiques
III.4.1. Environnement et santé
Les phases précédentes de l'étude ont analysé la situation et les conséquences néfastes des
rejets des déchets liquides par les populations, elles ont montré que l'essentiel des effluents de
cuisine et de lessive sont évacués dans la rue, la cour et la nature. Même les déchets de toilette
ne sont pas convenablement évacués vers des fosses appropriées.
L'étude a montré que ces pratiques causent des détériorations et sont peu propices pour
assurer un environnement sain.
Les conséquences néfastes sur la santé des populations sont confirmées par la prédominance
des maladies hydriques. Les statistiques du Ministère de la Santé montrent la prédominance
des maladies hydriques dans les causes de morbidité aussi.
Les causes liées aux maladies hydriques, accès palustres et les maladies diarrhéiques
représentent respectivement 55 et 21 % des cas déclarés, soit les 3/4 des causes de morbidité.
Les accès palustres vont être diminués en fonction de succès d'évacuation des eaux pluviales.
L'aménagement des zones d'habitation par canalisation des eaux pluviales a pour but de
diminuer les dégâts causés par les inondations et de diminuer la surface des flaques d'eau
stagnant. Ce dernier est aussi bien en fonction d'un aménagement urbain plus général
(terrassement des surfaces, revêtement des surfaces, branchement des concessions au réseau
25
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
ECOLE SUPERIEURE PLYTECHNIQUE DAKAR Cours de VRD
de drainage, etc.). L'établissement du réseau d'évacuation élaboré assure le développement
vers ces buts.
Par le drainage direct des zones régulièrement inondées, doit être un axe important, et aura
pour résultat la diminution importante de la surface des eaux stagnantes, donc la diminution
forte de la prolifération des moustiques.
Il faut noter que l'on ne peut jamais éliminer le danger paludéen par la "dessiccation
des surfaces urbaines". Le résultat de ces efforts n'atteint jamais un taux suffisamment
élevé et l'aménagement hydraulique urbain ne peut jamais être assez bien étendu aux
environs d’une ville. Le résultat de diminution de nombre des accès palustres sera
quand même représentatif.
Les maladies diarrhéiques sont plutôt en fonction de l'hygiène générale, dont un facteur très
important est l'assainissement des eaux usées. L'importance de ce facteur ne peut pas être
définit précisément, et la valeur financière d'amélioration de l'hygiène non plus.
On peut déclarer que la situation actuelle de l'assainissement des eaux usées est à
améliorée "sans limite". Les résultats du développement au niveau de la santé publique
seront évidents.
III.4.2. Assainissement et environnement
La gestion des eaux usées ménagères, telle qu'elle ressort des enquêtes auprès des ménages
montre que les pratiques ménagères causent des nuisances importantes au niveau des milieux
physique, biologique et humain.
L'établissement des matrices d'impact doit permette à tout projet de se traduire par des
impacts positifs au niveau du milieu physique et biologique
2 CONCLUSION
Les progrès attendus du futur réseau d'assainissement sont importants pour redresser cette
situation, réduire les nuisances, les pertes économiques et améliorer la qualité de vie des
populations.
Dans les projets, la composante sociale doit etre grandement améliorée par les impacts
positifs sur la santé et les conditions d'hygiène. Par ailleurs, les infrastructures, les voiries, les
conditions de circulation doivent voir une amélioration sensible du fait de la canalisation des
eaux usées et pluviales vers le réseau d'assainissement. Sur le plan économique, les
populations pourront bénéficier de la réutilisation éventuelle des eaux épurées et de la
réutilisation de composte fertilisant des sols d'origine assainissement en fonction du type qui
sera choisi.
26
Ndiouga CAMARA ESP 2013/2014
Vous aimerez peut-être aussi
- BAMBOUSTEPDocument19 pagesBAMBOUSTEPInes LarissaPas encore d'évaluation
- Plomberie Pour GU3Document28 pagesPlomberie Pour GU3parfaitPas encore d'évaluation
- Eaux Usees MarocDocument37 pagesEaux Usees MarocNoureddine ait el haj100% (1)
- Rapport de StageDocument20 pagesRapport de Stagerian kaPas encore d'évaluation
- Lagunage Aéré ISMADocument4 pagesLagunage Aéré ISMAAnas BENCHIKHPas encore d'évaluation
- Step Cambéréne (ENDSS)Document9 pagesStep Cambéréne (ENDSS)Khalil Diallo100% (2)
- Note Descriptive AssainissementDocument6 pagesNote Descriptive AssainissementOlivierObamePas encore d'évaluation
- Eaux Usees Lac 15 Hydranet PDFDocument16 pagesEaux Usees Lac 15 Hydranet PDFkdsessionsPas encore d'évaluation
- VonRoll Hydro Rohre Formstuecke Preisliste EUR FRDocument148 pagesVonRoll Hydro Rohre Formstuecke Preisliste EUR FRNicolas POUPETPas encore d'évaluation
- ProjetDocument14 pagesProjetCac FstPas encore d'évaluation
- Chap3-Assain AutonomeDocument72 pagesChap3-Assain AutonomeCheick SawadogoPas encore d'évaluation
- Rikutec France Broschuere Eaux de Pluie AnsichtDocument20 pagesRikutec France Broschuere Eaux de Pluie AnsichtRichard ThiolierePas encore d'évaluation
- Chap Vi AssainDocument11 pagesChap Vi Assaindanieldon873Pas encore d'évaluation
- I Texte Prettt TTT IDocument12 pagesI Texte Prettt TTT IDoha ChemsPas encore d'évaluation
- récuperation eaux de pluieDocument10 pagesrécuperation eaux de pluiejoojul77Pas encore d'évaluation
- AssainssementDocument45 pagesAssainssementrachidPas encore d'évaluation
- A19 - Les Décanteurs-Digesteurs Et Les Bacs DégraisseursDocument3 pagesA19 - Les Décanteurs-Digesteurs Et Les Bacs DégraisseursBraised.Mountains-Association AssociationPas encore d'évaluation
- Projet SenegalDocument12 pagesProjet Senegaldjeinasy19Pas encore d'évaluation
- STEP SkhirateDocument19 pagesSTEP SkhirateYoussef AfPas encore d'évaluation
- Dim Fs Ine 2022 Master 1 HyasDocument13 pagesDim Fs Ine 2022 Master 1 HyasNadiaa AdjoviPas encore d'évaluation
- Cours VRD Assainissement Eaux UseesDocument71 pagesCours VRD Assainissement Eaux Useeskabebern100% (1)
- Fndae 26Document54 pagesFndae 26ARGYOUPas encore d'évaluation
- Depliant Ecoflo PparP 1Document4 pagesDepliant Ecoflo PparP 1Manie3Pas encore d'évaluation
- traitement-des-eaux-uséesDocument12 pagestraitement-des-eaux-uséesMeriemPas encore d'évaluation
- Dimensinnement STEP Et Station Traitement Cours Et Exercices ZOUITADocument31 pagesDimensinnement STEP Et Station Traitement Cours Et Exercices ZOUITAnada nadoucha100% (1)
- Guide de Bonnes Pratiques Pour Les Hébergeurs Et Restaurateurs - CCIR Nord de France FTC 2014Document53 pagesGuide de Bonnes Pratiques Pour Les Hébergeurs Et Restaurateurs - CCIR Nord de France FTC 2014guillaumePas encore d'évaluation
- Pimab Fiche Irrigation WebDocument4 pagesPimab Fiche Irrigation WebMamadou NdiayePas encore d'évaluation
- Uxellesenvironnement - Be Guide Batiment Durable (S (Borkggyb1akn05455cppvk55) ) Docs EAU03 FRDocument33 pagesUxellesenvironnement - Be Guide Batiment Durable (S (Borkggyb1akn05455cppvk55) ) Docs EAU03 FRdavidoffPas encore d'évaluation
- OKI - PLAQUETTE INFORMATIVE 2023.zeendocDocument16 pagesOKI - PLAQUETTE INFORMATIVE 2023.zeendocjulienjbstudio.frPas encore d'évaluation
- Assainissement Individuel Finale PDFDocument13 pagesAssainissement Individuel Finale PDFRaid BoukeffaPas encore d'évaluation
- Kepwater France Lit Filtrant Vetiver.16.12Document6 pagesKepwater France Lit Filtrant Vetiver.16.12Zakaria ToufikPas encore d'évaluation
- MANUEL1 PretraitementDocument26 pagesMANUEL1 PretraitementsophiePas encore d'évaluation
- Chap 8Document8 pagesChap 8brice mouadjePas encore d'évaluation
- Corrigé Examen2008Document3 pagesCorrigé Examen2008محمد الزراريPas encore d'évaluation
- Les Canalisations P.V.C.: 1 J-M R. D-BTPDocument55 pagesLes Canalisations P.V.C.: 1 J-M R. D-BTPrenaud jaffre100% (1)
- Sujet BTS-E62Document8 pagesSujet BTS-E62seymoursyn666Pas encore d'évaluation
- 2 Traitement Des EauxDocument8 pages2 Traitement Des EauxIkram MjjanPas encore d'évaluation
- La Recuperation D'Eau de PluieDocument23 pagesLa Recuperation D'Eau de PluieJérôme MathiéPas encore d'évaluation
- Lit BactérienDocument2 pagesLit BactérienImane EddohaPas encore d'évaluation
- Polycopie - Prettt TTT I Ttts Intensfis - EUUDocument52 pagesPolycopie - Prettt TTT I Ttts Intensfis - EUUChicha AsmaePas encore d'évaluation
- Cuve Beton 2021Document4 pagesCuve Beton 2021fisipisPas encore d'évaluation
- RamsaDocument36 pagesRamsaHasna GourramPas encore d'évaluation
- AssainissementDocument73 pagesAssainissementBilaal Djaneye BoundjouPas encore d'évaluation
- Que Faire de Mes Eaux UsesDocument28 pagesQue Faire de Mes Eaux UsesOmar El WahabiPas encore d'évaluation
- Cours Vitival Gag 15.11.22Document29 pagesCours Vitival Gag 15.11.22ifiousPas encore d'évaluation
- Lassainissement Ecologique Des Eaux Usees DomestiquesDocument51 pagesLassainissement Ecologique Des Eaux Usees Domestiquesl.komlan03Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage: Station D'épuration Step El-KermaDocument17 pagesRapport de Stage: Station D'épuration Step El-KermaGenie des procede Promotion 2022Pas encore d'évaluation
- Decanteur DigesteurDocument14 pagesDecanteur DigesteurparfaitPas encore d'évaluation
- Boue Nord CamDocument4 pagesBoue Nord CamACIDPas encore d'évaluation
- Montpellier Mediterranee Metropole - Pierre AnselmeDocument49 pagesMontpellier Mediterranee Metropole - Pierre AnselmeIssam EL AMRIPas encore d'évaluation
- Fosse Septique - WikipédiaDocument32 pagesFosse Septique - Wikipédiabssouleymane2001Pas encore d'évaluation
- Traitement Des EauxDocument8 pagesTraitement Des Eauxjudjean17Pas encore d'évaluation
- Brochure Sechage Solaire Fourrage PDFDocument20 pagesBrochure Sechage Solaire Fourrage PDFTor La sagessePas encore d'évaluation
- L'hydro Économie EN QUESTION HAMERDocument9 pagesL'hydro Économie EN QUESTION HAMERsignoret.patrice.nadjimaPas encore d'évaluation
- Mostaganem-Arzew-Oran_FR_A4-2Document4 pagesMostaganem-Arzew-Oran_FR_A4-2moctarsenou8Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document77 pagesChapitre 2chedi grissaPas encore d'évaluation
- Assassin 0Document92 pagesAssassin 0FarahPas encore d'évaluation
- Traitement Des Eaux UséesDocument42 pagesTraitement Des Eaux UséesMinhTrangNguyễnPas encore d'évaluation
- Télédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauD'EverandTélédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauPas encore d'évaluation
- 1 Interaction ÉlectriqueDocument14 pages1 Interaction Électriquejurassiquepark100% (1)
- Quiz Digital Skils 1Document8 pagesQuiz Digital Skils 1ouzidouh.lahcen.95Pas encore d'évaluation
- Larynx NormalDocument22 pagesLarynx NormalabdoulePas encore d'évaluation
- P14-Cheminair NoticeDocument14 pagesP14-Cheminair NoticeFranck LormeauPas encore d'évaluation
- SatanDocument353 pagesSatanjmlb0123Pas encore d'évaluation
- Cours Hydraulique 84 Viscosite Huile 1Document4 pagesCours Hydraulique 84 Viscosite Huile 1Nestor ChiantsePas encore d'évaluation
- 6 GemmaDocument5 pages6 GemmaSerge RINAUDOPas encore d'évaluation
- ThrombectomieDocument7 pagesThrombectomiesara laadamiPas encore d'évaluation
- Dossier Eleve E32Document29 pagesDossier Eleve E32pasyfionPas encore d'évaluation
- Cour 03Document5 pagesCour 03Aziz MarsalPas encore d'évaluation
- Guide Ford Focus 2005 PDFDocument248 pagesGuide Ford Focus 2005 PDFJean-Sébastien CouturePas encore d'évaluation
- IDR-2017-BOU-CARDocument98 pagesIDR-2017-BOU-CARdasenabouPas encore d'évaluation
- Les Bio-Indicateurs de La Pollution: M1. PE Hammouda.R Département EE FSB, UsthbDocument13 pagesLes Bio-Indicateurs de La Pollution: M1. PE Hammouda.R Département EE FSB, UsthbTwin KilePas encore d'évaluation
- NV NVDocument21 pagesNV NVmadjid laidiPas encore d'évaluation
- Amélioration de La Performance Le ProcessusDocument5 pagesAmélioration de La Performance Le ProcessusIssam HosniPas encore d'évaluation
- Plan de Fertilisation LeroidugazonDocument6 pagesPlan de Fertilisation LeroidugazonJean-Michel LabbePas encore d'évaluation
- Outils de MaintenanceDocument16 pagesOutils de MaintenanceDuran MounouPas encore d'évaluation
- Fiche 6 ÈmeDocument12 pagesFiche 6 ÈmeMeriem MezaouiPas encore d'évaluation
- 05 MerboldDocument44 pages05 MerboldLaurent LefebvrePas encore d'évaluation
- Prospecto - InvestimentoDocument4 pagesProspecto - InvestimentoAlex SilvaPas encore d'évaluation
- Alimentation Du Jouer PDFDocument24 pagesAlimentation Du Jouer PDFBelkacem YesguerPas encore d'évaluation
- Supply ChainDocument25 pagesSupply Chainmehdiana15100% (1)
- Cours Pathologie PeintureDocument5 pagesCours Pathologie Peinturedleroy470Pas encore d'évaluation
- Tests Maths + DictéeDocument4 pagesTests Maths + DictéeMorgan MaraisPas encore d'évaluation
- Output 9Document8 pagesOutput 9walidghezaial16Pas encore d'évaluation
- Hidaoa 2eme Serie ADocument34 pagesHidaoa 2eme Serie AMaissem DjemmalPas encore d'évaluation
- Sujets de Preparation Maths Bacc D & Ti 2020Document11 pagesSujets de Preparation Maths Bacc D & Ti 2020naimangamsouPas encore d'évaluation
- TP N°1 ComplexitéDocument10 pagesTP N°1 Complexitéa.dimrociPas encore d'évaluation
- Béatrice A Salma 5Document7 pagesBéatrice A Salma 5i kPas encore d'évaluation