Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts UZH
der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich
Qu’est-ce qu’une image ?
Les notions de présence artificielle et de pure visibilité
dans la phénoménologie de l’image de Lambert Wiesing
Verfasser: Adrien Bordone
Matrikel-Nr.: 07-420-230
Referent: Prof. Dr. Peter Schulthess
Philosophisches Seminar
Abgabedatum: 19.05.2017
�Table des matières
Introduction : La question de l’être de l’image .......................................................... 4
Remarques méthodologiques ..................................................................................... 6
Liste des abréviations ................................................................................................. 7
I. Les deux propriétés de l’image
Artifizielle Präsenz
1. Présentation de Artifizielle Präsenz ....................................................................... 8
2. Vers une philosophie de l’image
2. 1. Vers une science de l’image.................................................................... 9
2. 2. D’une image à toutes les images ............................................................. 10
2. 3. De toutes les images au concept d’image ............................................... 11
3. Une tripartition originale
3. 1. Trois concepts d’image ........................................................................... 14
3. 2. Des critères aristotéliciens ...................................................................... 15
4. L’anthropologie de l’image
4. 1. Le genus de l’image d’un point de vue anthropologique ........................ 18
4. 2. Image, représentation et conscience chez Hans Jonas ............................ 19
4. 3. Image, mémoire et culture chez Hans Belting ........................................ 21
5. La sémiotique de l’image
5. 1. Le genus de l’image d’un point de vue sémiotique ................................ 25
5. 2. La sémiotique mimétique de l’image ...................................................... 27
5. 3. La sémiotique conventionnaliste de l’image ........................................... 28
6. Les problèmes des approches anthropologiques et sémiotiques
6. 1. Trois problèmes liés à l’approche anthropologique ................................ 32
6. 2. Deux problèmes liés à l’approche sémiotique ........................................ 34
7. La phénoménologie de l’image
7. 1. Le genus de l’image d’un point de vue phénoménologique ................... 38
7. 2. Les trois sens du mot « image » .............................................................. 39
7. 3. Les deux propriétés de l’image ............................................................... 42
II. Qu’est-ce qu’une présence artificielle ?
Das Mich der Wahrnehmung
1. Présentation de Das Mich der Wahrnehmung
1. 1. La notion de présence artificielle dans l’œuvre de Wiesing ....................... 46
1. 2. Fonder la philosophie (de l’image) ............................................................. 47
2
�2. Vers une phénoménologie de la perception
2. 1. Mythes, modèles et médias ......................................................................... 49
2. 2. Un fondement dans la tradition : Descartes ................................................ 50
2. 3. La structure logique de la perception : Husserl .......................................... 53
3. De la perception à la participation
3. 1. Perception et présence ................................................................................ 57
3. 2. Présence et participation ............................................................................. 58
4. La pause de participation
4. 1. Les trois paradigmes de la Bildtheorie ....................................................... 61
4. 2. Vers une ontologie et une physique de l’image : das Bildobjekt ................ 62
4. 3. Vers une psychologie du spectateur : das Bildrezipient ............................. 64
4. 4. Vers une phénoménologie de l’image : die Bildwahrnehmung .................. 66
4. 5. Un paradis métaphysique ............................................................................ 68
III. Qu’est-ce qu’une pure visibilité ?
Sehen lassen
1. La notion de pure visibilité dans l’œuvre de Lambert Wiesing ............................. 72
2. Montrer en général
2. 1. L’approche évolutionnaire de la monstration ............................................. 74
2. 2. L’approche phénoménologique de la monstration...................................... 76
2. 3. Les quatre conditions de la monstration ..................................................... 77
2. 4. Monstration, action et intention : trois problèmes ...................................... 79
3. Montrer avec des images
3. 1. Le langage commun de l’action et de la monstration (1er problème) ......... 82
3. 2. La mythologie de l’image : ce qu’elle est (2ème problème)......................... 84
3. 3. La mythologie de l’image : trois critiques ................................................. 87
3. 4. La théorie de l’illusion : ses deux thèses (3ème problème) .......................... 90
3. 5. La théorie de l’illusion : deux critiques ...................................................... 93
4. L’être de l’image
4. 1. Heidegger et l’« a-référentialité » des phénomènes.................................... 98
4. 2. Heidegger et l’« an-utilité » des phénomènes ............................................. 102
4. 3. La désinstrumentalisation de l’image au musée ......................................... 106
4. 4. Qu’est-ce qu’une pure visibilité ? ............................................................... 110
Bibliographie.............................................................................................................. 113
3
�Introduction
La question de l’être de l’image
Lorsque je présente ce travail à des gens qui s’y connaissent peu en philosophie ou
qui ne l’ont simplement pas étudiée, je leur dis qu’il a pour thème : « l’image en
général ». Mais cette information ne satisfait la curiosité de personne. J’ajoute alors
que j’essaie d’y répondre à la question suivante : « qu’est-ce qu’une image ? ». Ce qui
provoque à son tour deux genres principaux de réactions : certains se résignent assez
rapidement à ne jamais comprendre où je veux en venir (auquel cas je m’empresse
d’ajouter pour clore la discussion que j’y commente l’œuvre d’un philosophe
allemand), alors que d’autres, moins prompts à se décourager, se mettent à ce stade à
me poser une avalanche de questions : « Les images, mais quelles images ? », « Quel
genre d’images ? », « Toutes les images ? », « Ou celles que l’on a dans la
tête ? », « Ou celles qui sont dans les musées ? », « Les images fixes ou les images en
mouvement ? », « Les images sonores aussi ? », « Et les images qui sont dans les
rêves ? », « D’ailleurs, quel rapport avec l’imagination ? », etc. J’essaie alors de
désemmêler ces multiples interrogations, mais la discussion se termine la plupart du
temps sur une forme d’insatisfaction partagée : mon interlocuteur n’a au final toujours
pas vraiment compris ce qu’était mon intention dans ce travail. Or, loin de nourrir un
quelconque mépris à l’encontre des auteurs de ces questions « naïves », j’estime
qu’elle sont révélatrices de plusieurs problèmes importants.
Premièrement, ces questions me semblent être le fruit assez naturel du doute (qui
reste souvent informulé) suivant : un tel thème aussi large est-il même cohérent ?
Autrement dit, existe-t-il bel et bien un ensemble défini de choses qui serait
« l’ensemble de toutes les images » ? N’y a-t-il pas plutôt toutes sortes d’images,
toutes sortes de contextes dans lesquels on parle d’images, sans que pour autant ce
mot n’ait, dans chacun de ces contextes, toujours le même sens ni ne désigne les
mêmes choses ?
Ce doute me semble lié à un deuxième problème, qui est que l’image, n’est-ce pas
précisément ce qui n’est pas ? L’image n’est-elle pas avant tout un artifice, peut-être
même une illusion ? Mais alors, à quoi bon se demander précisément ce qu’elle est ?
À quoi bon vouloir définir l’être de quelque chose qui n’est en réalité « pas
vraiment » ?
Enfin, ce deuxième problème en appelle un troisième, qui est que si l'image est un
artifice, n'est-elle pas aussi un artefact, à savoir quelque chose qui n’a pas d’être
propre mais qui est une pure création de l’homme ? En effet, si mon travail portait sur
ce qu’est une race spécifique de grenouille en Amazonie, il me semble que ma
démarche déclencherait moins de suspicions. Or, l’image, contrairement à une telle
espèce de grenouille, n’est-elle pas plutôt une invention de l’homme, et donc un outil
à propos duquel celui-ci n’a rien à découvrir mais qu’il peut seulement plus ou moins
bien apprendre à fabriquer et à utiliser ?
4
�C’est de cette situation un peu déconcertante que je propose de partir ici. C’est
conscient de ces doutes et de ces réticences que je propose néanmoins, dans ce travail,
de se poser la question de l’être de l’image. Cela car quand bien même on n’arriverait
pas ici à une réponse définitive, il se pourrait qu’en se posant la question de savoir ce
qu’est une image en général, on apprenne tout de même des choses intéressantes à
propos des images et de l’usage que l’on en fait. Mais cela également parce que cette
question de l’être de l’image, je propose (fort heureusement) de ne pas la poser seul,
mais à l’aide de la lecture attentive du travail d’un philosophe qui a fait de l’être de
l’image le centre de ses préoccupations : Lambert Wiesing. Il s’agit ainsi, dans ce
travail, de chercher à reconstruire l’argumentation qui conduit Lambert Wiesing à
définir l’image de la manière dont il le fait. Il s’agit de comprendre, grâce à ce qu'en
dit Lambert Wiesing, ce qu'est une image – ce qui devrait du même coup nous
permettre de comprendre pourquoi, selon Wiesing, se poser la question de l’être de
l’image a bel et bien un sens.
Cette philosophie de l’image propre à Wiesing, je propose de la puiser dans trois de
ses ouvrages majeurs. Tout d’abord, dans Artifizielle Präsenz (2005), un livre court et
condensé, à l’intérieur duquel les deux premiers chapitres me fourniront la matière
nécessaire afin de poser de manière moins approximative la question principale qui
anime ce travail. Artifizielle Präsenz me permettra alors d’esquisser l’originalité d’une
méthode phénoménologique afin de tenter de répondre à cette question. De cet
ouvrage, j’extrairai ainsi deux thèses qui constituent selon moi le cœur de la pensée de
Wiesing à propos des images : premièrement la thèse selon laquelle l’image a pour
propriété d’être une présence artificielle, et deuxièmement la thèse selon laquelle
l’image a pour propriété d’être une pure visibilité. Ceci constituera la première partie
de ce travail.
Je tenterai ensuite d'approfondir le sens de ces deux thèses concernant l'image grâce
à deux ouvrages postérieurs à Artifizielle Präsenz, dans lesquels Wiesing prolonge sa
réflexion sur les images et prend probablement plus de temps pour fonder la
pertinence de son propos : Das Mich der Wahrnehmung (2009) et Sehen Lassen
(2013). À la lecture de Das Mich der Wahrnehmung, j’essaierai de déterminer, en
m’appuyant principalement sur la lecture que fait Lambert Wiesing du travail sur
l’image d’Edmund Husserl, quelles sont les raisons qui le poussent à défendre que
l’image est une présence artificielle ; présence artificielle qui permet à son tour aux
spectateurs de vivre, on le verra, une pause de participation. Ceci constituera la
deuxième partie de ce travail.
Alors qu’à la lecture de Sehen Lassen, je tenterai de déterminer les arguments plus
précis qui mènent Wiesing à affirmer que l’image est une pure visibilité. Il s’agira
ainsi de comprendre pourquoi l’image n’est ni un être animé, ni un simple outil
servant à montrer, mais pourquoi elle est avant tout un phénomène au sens où, selon
Wiesing, Martin Heidegger comprend ce terme ; un phénomène auquel d’ailleurs
seule une certaine expérience muséale peut nous donner véritablement accès. Ceci
constituera la troisième et dernière partie de ce travail.
5
�Remarques méthodologiques
J’ai lu le travail de Lambert Wiesing dans le texte allemand original. Lorsque j’en cite
des passages, j’ai donc préféré le faire en allemand. Toutefois, comme ce travail est
en français et pour la bonne compréhension du lecteur francophone, je traduis
toujours les passages ainsi cités dans des notes de bas de page. Ces traductions en
français sont originales.
Les passages de l’œuvre de Wiesing ainsi cités le sont généralement en retrait et en
italique. Cependant, lorsqu’il s’agit de simples mots ou de notions importantes et non
de phrases complètes, il m’arrive de mentionner celles-ci directement dans le corps du
texte.
Lorsque ce que je dis est directement emprunté aux différents ouvrages de Wiesing,
ceci est toujours signifié de manière explicite. De même que, lorsque j’invente moimême des exemples ou me permets d’ajouter des commentaires plus personnels, j’en
avertis le lecteur.
Enfin j’ai décidé, pour plus de clarté et pour mieux départager certaines positions
philosophiques différentes, d’énoncer à part quelques thèses succinctes. Pour référer à
ces thèses, j’emploi des abréviations dont j’ai pensé qu’il serait utile de rappeler le
sens dans la petite liste qui suit, organisée de manière alphabétique. Celle-ci devrait
permettre au lecteur de s’y reporter s’il ne sait plus à quelles thèses réfèrent ces
abréviations.
6
�Liste des abréviations
AA1 Approche Anthropologique 1
L’image est nécessairement un
artefact.
AA2 Approche Anthropologique 2
Être un homme, c’est produire des
images – et vice-versa.
AA3 Approche Anthropologique 3
Une image, c’est toujours une image
pour un individu détenteur d’une
mémoire et d’une culture donnée.
AP1 Approche Phénoménologique 1
L’image est nécessairement quelque
chose de visible.
AS1 Approche Sémiotique 1
L’image est nécessairement un signe.
AS2 Approche Sémiotique 2
L’image est toujours le signe de ce à
quoi elle ressemble.
AS3 Approche Sémiotique 3
L’image réfère toujours à son objet
grâce à des conventions.
CM4 Condition au Montrer 4
Il faut être un homme pour montrer.
DF1 Distinction Fondamentale 1
Ce qu’est une chose est radicalement
différent de ce à quoi elle peut servir.
DF2 Distinction Fondamentale 2
Il y a deux types de sujets : les sujets
agents réels et les sujets seulement
grammaticaux.
MI1 Mythologie de l’image 1
Il est littéralement vrai que l’image
montre elle-même des choses.
PA1 Prémisse Anthropologique 1
Seul l’homme a des intentions.
PA2 Prémisse Anthropologique 2
Seul l’homme agit.
TC1 Thèse Centrale 1
L’image est une pure visibilité.
TC2 Thèse Centrale 2
L’image est une présence artificielle.
TI1 Théorie de l’Illusion 1
Ce que l’image montre est une illusion.
TI2 Théorie de l’Illusion 2
L’image est toujours un signe du réel.
7
�I. Les deux propriétés de l’image
Artifizielle Präsenz
1. Présentation de Artifizielle Präsenz
Artifizielle Präsenz (2005)1 est un livre relativement court (162 pages), plus court que
les deux autres ouvrages qui nous occuperont aux chapitres deux et trois de ce travail,
que sont Das Mich der Wahrnehmung (2009) 2 et Sehen Lassen (2013) 3 . Or la
réflexion de Wiesing y est, me semble-t-il, particulièrement dense. Elle y est aussi, en
quelque sorte, annonciatrice de beaucoup de choses qu’approfondira Wiesing dans ses
travaux postérieurs. On peut en effet lire AP comme une espèce de petit ouvrage
programmatique, dans lequel la majorité des idées de Wiesing concernant les images
sont peut-être déjà exprimées, mais parfois plus sous la forme d’intuitions que sous la
forme de véritables énoncés théoriques fondés. Or bien qu’assez court, cet ouvrage se
divise en huit chapitres au thématiques diverses. Chapitres qui sont en partie des
contributions originales, écrites à l’occasion de la parution d’Artifizielle Präsenz
(dorénavant AP), en partie des articles déjà parus dans des revues scientifiques et
remaniés à l’occasion.4
Parmi ces chapitres, deux joueront un rôle primordial pour établir plus précisément
le problème qui nous occupe ici et y apporter des premières pistes de réponses. Ce
sont les deux premiers chapitres de l’ouvrage, intitulés respectivement « Science de
l’image et concept d’image » (Bildwissenschaft und Bildbegriff), et « Les courants
principaux de la philosophie de l’image contemporaine » (Die Hauptströmungen der
gegenwärtigen Philosophie des Bildes). Le contenu de ceux-ci nous permettra de
commencer par poser plus adéquatement la question de l’image, puis de distinguer
(selon des critères que Wiesing emprunte à Aristote) trois manières possibles
aujourd’hui de faire de la philosophie de l’image. Ces trois approches sont, selon
Wiesing, l’anthropologie de l’image, la sémiotique (ou sémiologie) de l’image, et la
phénoménologie de l’image.
Il s’agira alors de dire succinctement, avec Wiesing, les mérites et les manques de
chacune de ces approches, afin d’établir finalement en quoi c’est seulement la
dernière qui permet, selon lui, de détecter dans l’image les deux propriétés suivantes :
celle d’être une présence artificielle et celle d’être une pure visibilité. Ces deux
propriétés de l’image n’auront alors été qu’assez brièvement présentées. Mais cette
présentation devrait fournir la matière nécessaire afin de chercher à établir, dans les
deux parties suivantes, ce que sont leurs fondements et ce que ces thèses ont a leur
tour comme implications.
1
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz : Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 2005.
2
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung : Eine Autopsie, Frankfurt am Main :
Suhrkamp, 2009.
3
Lambert Wiesing, Sehen lassen : Die Praxis des Zeigens, Berlin : Suhrkamp, 2013.
4
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 164.
8
�2. Vers une philosophie de l’image
2. 1. Vers une science de l’image
Ce n’est pas directement avec la question « qu’est-ce qu’une image ? » que s’ouvre
AP, mais c’est bien à celle-ci que le premier chapitre de l’ouvrage, intitulé « Science
de l’image et concept d’image » (Bildwissenschaft und Bildbegriff) 5 aboutit. Il vaut
donc la peine, pour commencer, de tenter de voir quelles sont les raisons pour
lesquelles Lambert Wiesing en vient à se poser précisément cette question. Il vaut la
peine de tracer ici la genèse de cette question. Car Wiesing commence en fait, dans
AP, par demander explicitement la chose suivante : qu’est-ce que la science de
l’image (die Bildwissenschaft) aujourd’hui ?
Or on peut déjà noter une première chose ici, qui est qu’il semble selon lui assez
difficile d’apporter une réponse positive et claire à cette question. Peut-être l’idée
même d’une telle science est-elle, dans le contexte scientifique actuel, encore plutôt
au stade de projet. En effet, et Wiesing commence AP par cette phrase :
Ein derzeit mit vielen Erwartungen und Hoffnungen verbundenes
wissenschaftliches Vorhaben trägt den Namen „Bildwissenschaft“.6
Pourquoi cela ? Parce que, poursuit Wiesing, nul ne semble véritablement savoir si
cette « science de l’image » peut prétendre aujourd’hui au statut de nouvelle
discipline autonome, au même titre par exemple que la sociologie (qui a justement
acquis, à un moment donné de son histoire, ce statut de discipline autonome au sein
du monde universitaire) ; ou alors si elle n’est qu’une sous-discipline, s’inscrivant
dans une discipline plus large et déjà existante (par exemple dans l’histoire de l’art) ;
ou encore, si cette prétendue « science de l’image » ne serait en fait pas plutôt qu’une
sorte d’outil conceptuel, outil qu’il serait dès lors possible de monopoliser dans de
multiples disciplines différentes (au même titre par exemple que la sémiotique). Car il
se pourrait même, nous dit Wiesing, que ce nom de « science de l’image », ce ne soit
en fait qu’une étiquette apposée à une collection plus ou moins aléatoirement
déterminée de disciplines différentes que l’on aurait ainsi librement décidé de réunir
sous ce même nom. Ce titre de « science de l’image », ce ne serait alors, dans ce
dernier cas de figure, rien d’autre qu’un :
Sammelbegriff [...], der viele
inhaltlich und methodisch heterogene
Überlegungen über Bilder, die aus unterschiedlichen Disziplinen entstammen,
aufgrund einer Art losen Familienähnlichkeit zusammenfasst.7
5
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 9-16.
« Un projet actuellement liée à beaucoup d’attentes et d’espoirs porte le nom de "science de
l’image". » (Ibid., p. 9.)
7
« Terme collectif […] qui résume [ou : contient] beaucoup de raisonnements
méthodologiquement hétérogènes à propos des images, provenant de différentes disciplines,
et que l’on a ainsi rassemblés en raison d’un vague air de famille. » (Ibidem.)
6
9
�Alors face à ce que Wiesing considère, à l’intérieur du vaste champ de la recherche
à propos des images, comme une situation peu claire (ungeklärten Situation), il refuse
de trancher trop vite. Il invite plutôt, dans un deuxième temps, à opérer quelques
distinctions de base (Grundunterscheidungen) qu’il propose de baser sur un critère
assez original : c’est le nombre d’images dont s’occupent les divers genres de science
de l’image (Arten von Bildwissenschaften).8
2. 2. D’une image à toutes les images
Wiesing propose ainsi, dans un deuxième temps (mais toujours dans ce même premier
chapitre d’AP), de tenter de déterminer quel genre de science de l’image on fait cette
fois selon l’extension plus ou moins large donnée à la classe d’images considérées. Il
en arrive alors à la tripartition originale suivante : soit on s’occupe, lorsque l’on fait
(ou dit faire) de la science de l’image, d’une image individuelle, soit on s’occupe d’un
ensemble d’images, soit on s’occupe de toutes les images. Il ne semble en effet pas y
avoir (à un niveau purement extensionnel donc) d’autres possibilités que ces trois là.
Dans le premier genre de science de l’image, nous dit Wiesing, c’est ainsi une
image individuelle qui sera l’objet de la recherche, qui en constituera le thème. La
question que se posera alors notre scientifique de l'image, en pareil cas, qui est bien
de savoir : « qu’est-ce qu’une image ? », s’entendra comme une question portant sur
une (et une seule) image. Autrement dit, le terme « une » y sera alors compris comme
un adjectif numéral, désignant un objet (et pas plus). Cette image déterminée, on aura
alors tendance à lui donner une certaine importance historique ou une signification
singulière, et ce sont aux particularités de cette image que l’on s’intéressera (par
exemple aux particularités d’un tableau comme La Joconde).9
Ce qui est une tâche sensiblement différente, écrit Wiesing, de celle que se donne
un deuxième genre de science de l’image qui porte cette fois sur un groupe d’images.
Dans ce genre de recherche, ce sont en effet plutôt les points communs entre
différentes images sélectionnées pour former un corpus d’images cohérent qui
constitueront le centre de l’attention. Or le risque de ce genre de travaux, que
pratiquent par exemple, selon Wiesing, certains historiens d’art, c’est qu’alors les
critères de sélection des images étudiées (c’est-à-dire les critères de formation de ces
corpus d’images) ne soient trop contingents.10 En effet, si l’individualité inhérente à
une image unique semble suffire à légitimer le fait que l’on s’intéresse précisément à
celle-ci, en quoi de multiples images iraient-elle forcément « bien ensemble » ?
8
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 9.
On pourrait toutefois, me semble-t-il, émettre ici un léger doute quant à la possibilité même
d’une telle science qui ne porterait que sur un seul objet. Celle-ci impliquerait en effet de faire
de la « science du particulier », alors que l’on aurait plutôt tendance à penser, comme le fait
Aristote (auquel nous reviendrons), qu’il n’y a de science que du général. Voir : Aristote,
Secondes Analytiques, Livre 1, §31, Paris : Vrin, 1979, p. 146-148.
10
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 12.
9
10
�Qu’est-ce qui justifie que l’on réunisse certaines images afin de se demander, pour
reprendre un exemple de Wiesing ici, ce qu’est la peinture à Florence et à Sienne
après la grande peste ?11
Mais d’un autre côté, écrit Wiesing, la grande chance que représente également ce
genre de travaux, c’est qu’en invitant à se focaliser sur les points communs entres des
images multiples plutôt que sur des images individuelles, ceux-ci permettent
d’apercevoir la possibilité d’un troisième genre encore de travail scientifique à propos
de l’image : un genre de travail dans lequel on s’intéressera aux points communs qui
existent entre toutes les images. Ainsi, dans la recherche portant sur un corpus limité
d’images :
[...] ist der erste notwendige Schritt zur Reflexion über alle Bilder angelegt.12
Car si l’on peut bien regrouper certaines images entre elles pour étudier les points
qu’elles ont en commun, on peut alors logiquement aussi se demander ce que toutes
les images ont en commun. À partir d’une manière plutôt thématique de regrouper
certaines images selon des critères variés, on peut ainsi en arriver à ce troisième
projet, qui ne vient peut-être pas tout-de-suite à l’esprit (et qui n’est en tout cas pas le
plus répandu) de se demander ce qui définit la classe d’image la plus large possible,
celle qui constitue le groupe de toutes les images existantes (die Gruppe aller
existierenden Bilder).13
2. 3. De toutes les images au concept d’image
En concevant de cette manière la classe de toutes les images et en se demandent ce
qu’elle est, c’est-à-dire ce qui relie entre eux tous les objets lui appartenant, on entre
donc dans un troisième genre possible de démarche scientifique à propos de l’image.
Or en faisant cela, nous dit Wiesing, on fait quelque chose de nouveau et de
radicalement différent puisque, dans ce troisième cas, on ne peut plus se permettre de
démarche empirique – on ne peut donc plus non plus prétendre adopter là une
démarche à proprement parler scientifique. En effet, et sans que Wiesing n’évoque
explicitement cet argument, il semble assez indéniable qu’il est impossible d’étudier
empiriquement l’ensemble de toutes les images existantes. Mais de plus, si un tel
genre de démarche n’est plus empirique (ni donc véritablement scientifique),14 c’est
selon Wiesing parce qu’il s’agit là avant tout d’un travail définitionnel, qui s’effectue
grâce à des arguments. Autrement dit, il s’agit là d’un travail, selon Wiesing,
proprement philosophique. Or en admettant que tout travail intellectuel définitionnel,
11
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 12.
« […] est accompli le premier pas nécessaire en direction d’une réflexion sur toutes les
images. » (Ibidem.)
13
Ibid., p. 13.
14
Par « scientifique » j’entends ici (comme Wiesing) avant tout ce qui relève des sciences
expérimentales de l’homme et de la nature.
12
11
�argumentatif et coupé d’une démarche véritablement empirique soit le propre du
travail philosophique, pourquoi devrait-on plus exactement ne travailler ici plus
« que » grâce à des définitions et des arguments ?15
Parce qu’en s’intéressant à toutes les images et non plus à des images individuelles
ou à des groupes d’images, on effectue selon Wiesing un pas dans le catégoriel (ein
Schritt ins Kategoriale).16 On ne s’intéresse plus à des images déterminées, ni à un
ensemble d’images, mais tout bonnement à la catégorie image elle-même. La tâche ne
peut alors plus être remplie de manière empirique, ni historique, puisqu’elle est de
définir l’image, c’est-à-dire l’ensemble de toutes les images, c’est-à-dire le concept
« image » lui-même. Comme il le dit lui-même :
Es geht nicht um die Erforschung dessen, was schon kategorisiert ist, sondern
um die Erforschung der Kategorisierung: eben um den Begriff des Bildes.17
Le thème d’un tel genre de travail donc proprement philosophique de théorisation
de l’image (Bildtheorie), c’est le concept d’image.18 Son but, c’est de définir, par des
arguments, l’image en général. La question qui anime un tel travail de philosophie de
l’image peut ainsi bien se laisser formuler au travers de la question : « qu’est-ce
qu’une image ? » mais on y entendra cette fois le terme « une » comme portant sur ce
qu’est toujours une image. Cela de la même manière que lorsque l’on se demande par
exemple de manière traditionnelle en philosophie : qu’est-ce qu’un homme ? Or c’est
bien dans ce dernier sens que Wiesing propose, dans AP, de poser la question :
« qu’est-ce qu’une image ? ». Mais alors comment déterminer maintenant ce qu’est
toujours une image, c’est-à-dire ce que signifie le concept d’image ? Et comment
déterminer, en retour, l’extension plus précise de ce concept ? Autrement dit, à partir
de cette préoccupation pour l’image en général, comment déterminer les critères qui
feront qu’un objet est une image et un autre non ?
Ce que l’on rangera dans la catégorie « image », écrit Wiesing afin de conclure ce
premier chapitre, dépendra principalement d’une chose : de la position philosophique
à partir de laquelle on élaborera son concept d’image. C’est cette position et le
concept d’image qu’elle défend qui dictera alors si, parmi tout ce que l’on appelle
15
On reviendra plus amplement dans la deuxième partie de ce travail sur le point de savoir ce
qu’est exactement la philosophie pour Wiesing. On remarquera alors que celle-ci s’intéresse
en fait également à la réalité empirique, mais en tant que réalité phénoménale immédiate.
16
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 13.
17
« Il ne s’agit plus là d’étudier ce qui est déjà dans des catégories, mais d’étudier la
catégorisation elle-même : c’est-à-dire le concept d’image. » (Ibid., p. 14.) Notons que
Wiesing emploie ici de manière synonyme les expressions de « concept de l’image » et de
« catégorie de l’image » : elles réfèrent à chaque fois à l’ensemble de toutes les images et
constituent l’objet de la théorie de l’image (Bildtheorie).
18
Wiesing à réédité en 2008 un ouvrage datant de 1997, intitulé Die Sichtbakreit des Bildes,
et y a à cette occasion intégré un nouvel avant-propos dans lequel il évoque l’histoire de cette
notion de Bildtheorie (qu’il a mis un certain temps à véritablement s’approprier) et revient
sous un autre angle à ce concept de Bildwissenschaft. Voir : Lambert Wiesing, « Vorwort zur
Neuausgabe 2008 », in : Die Sichtbarkeit des Bildes : Geschichte und Perspektiven der
formalen Ästhetik (1997), Frankfurt : Campus Verlag, 2008.
12
�« image », une image mentale, une ombre, un diagramme, une peinture, une carte ou
une photographie abstraite, appartiendront ou non à la catégorie « image ». Ainsi :
Es hängt von der jeweiligen philosophischen Position ab, ob ein Sternenbil,
Spiegelbild, Schattenbild, Kalligramm, Diagramm, Abstrakte Fotografie, der
Cyberspace, die Landkarte oder der Fussabdruck zur Gruppe der Bilder
gerechnet wird.19
Or, des différentes positions philosophiques qui tentent ainsi, aujourd’hui, de
définir ce qu’est la catégorie image en général et de déterminer du même coup ce
qu’elle contient plus exactement, Wiesing en repère trois. Ce sont ce qu’il appelle au
deuxième chapitre d’AP les trois principaux courants de la philosophie de l’image
contemporaine (Die Hauptströmungen der gegenwärtigen Philosophie des Bildes). Ils
correspondent aux trois façons principales de répondre philosophiquement
aujourd’hui à la question : « qu’est-ce qu’une image ? ». Ce sont donc là les trois
philosophies de l’image qu’il nous faut maintenant présenter afin de trouver quelques
premières pistes de réponses philosophiques à la question (elle aussi philosophique)
« qu’est-ce qu’une image ? ».
19
« Cela dépendra à chaque fois d’une position philosophique, si l’on inscrit ou non dans le
groupe des images une constellation, une image dans un miroir, une silhouette, un
calligramme, un diagramme, des photographies abstraites, le cyberespace, une carte ou une
empreinte de pied. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 14.)
13
�3. Une tripartition originale
3. 1. Trois concepts d’image
En partant d’une description des différents manières plutôt conventionnelles (mais
toutes problématiques) de concevoir la science de l’image aujourd’hui, nous avons été
amené ici à une tripartition originale entre trois genres possibles de science de
l’image : celle qui s’occupe d’une image seulement, celle qui s’occupe d’un groupe
limité d’images, et celle qui s’occupe de toutes les images. Nous avons alors vu en
quoi, selon Wiesing, parce que la science qui s’occupe de toutes les images n’a plus
les moyens d’être empirique, alors elle n’est plus à proprement parler scientifique,
mais se donne pour tâche de définir, par des arguments, le concept d’image. La
science des images en général, si elle veut avoir un sens et un objet, nécessite avant
tout une définition philosophique du concept d’image. Car comme l’écrit Wiesing :
Da diese Reflexion auf den Begriff des Bildes gar nicht anders als
philosophisch geschehen kann, kommt man zu dem Ergebnis, dass die
Philosophie des Bildes ein Teil der Wissenschaft ist, oder umgekehrt, dass die
Bildwissenschaft einer Philosophie des Bildes bedarf.20
Nous aurons l’occasion d’approfondir considérablement, au début de la deuxième
partie de ce travail,21 ce qu’est selon Wiesing la nature du lien qu’entretiennent
science et philosophie. Mais la question principale qui va nous occuper maintenant est
donc la suivante : que défendent, selon Wiesing, ces trois principales philosophies
contemporaines de l’image qu’il nomme ainsi l’approche anthropologique de l’image
(der anthropologischer Ansatz), l’approche sémiotique de l’image (der semiotischer
Ansatz),
et
l’approche
perceptivo-théorétique
de
l’image
(der
wahrnehmungstheoretischer Ansatz)
ou,
plus
simplement :
l’approche
phénoménologique de l’image ?22 Comment s’y prend chacune de ces approches,
selon Wiesing, afin de définir l’image ?
Or avant de répondre dans le détail à cette question, j’aimerais ouvrir ici une courte
parenthèse afin de considérer la manière dont Wiesing s’y prend pour distinguer ces
approches. Car il distingue celles-ci grâce à des critères plutôt originaux et qui jouent
selon moi un rôle décisif dans la manière même dont Wiesing pose le problème de
l’image : grâce à des critères qu’il emprunte explicitement à la tradition
aristotélicienne. Ce sont ceux du genus (genre, Gattung) et de la differenzia spezifica
20
« Comme cette réflexion à propos du concept d’image ne peut s’effectuer autrement que
philosophiquement, on arrive à ce résultat que la philosophie de l’image est une partie de la
science ou inversement, que la science de l’image a besoin d’une philosophie de l’image. »
(Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 16.)
21
Aux pages 49 à 56.
22
En l’absence d’une traduction adéquate en français du terme wahrnehmungstheoretischer,
nous
référerons
par
la
suite
à
cette
approche
grâce
à
l’étiquette
d’ « approche phénoménologique de l’image ». Comme on le verra, celle-ci convient
également.
14
�(différence spécifique, spezifisches Unterschiedsmerkmal). 23 En effet, il est selon
Wiesing possible de distinguer aujourd’hui trois approches philosophiques différentes
du concept d’image selon le genre et la différence spécifique qu’elles attribuent
chacune à l’image. Mais qu’est-ce qui justifie plus exactement cette idée d’employer
ici ces critères aristotéliciens traditionnels pour distinguer ces approches ? Et que
permet plus précisément à Wiesing cette tripartition opérée, pour ainsi dire, « sous le
signe d’Aristote » ? Wiesing se permet d’un peu ironiser au sujet de cet héritage
aristotélicien lorsqu’il écrit que celui-ci ne correspond peut-être pas à ce qui se fait de
plus neuf en matière de théorie de la définition.24 Mais alors pourquoi décide-t-il de
tout-de-même l’utiliser ?
3. 2. Des critères aristotéliciens
La première raison (et la plus évidente) pour Wiesing, de référer ainsi à Aristote en
ouverture du deuxième chapitre d’AP, c’est que ces outils conceptuels traditionnels de
genre et de différence spécifique se laissent selon lui très bien utiliser afin de décrire
de manière idéal-typique (idealtypisch) les directions dominantes (dominanten
Richtungen) de la philosophie de l’image actuelle.25 Ils permettent de formuler de
manière peut-être un peu simplifiée mais qui a l’avantage d’être claire les trois
réponses principales qu’apportent à la question « qu’est-ce qu’une image ? » les
diverses approches qui structurent aujourd’hui le vaste champ de la théorie de
l’image. Ils permettent d’arriver plus aisément à formuler les trois définitions
philosophiques actuelles différentes de l’image. Mais ce n’est là pas la seule raison.
Car la deuxième raison, me semble-t-il, de déterminer de la sorte ce que sont ces
approches philosophiques de l’image (raison moins explicite mais qui me semble
aussi avoir son intérêt), c’est peut-être de justifier en fait dès le départ l’idée qu’il y a,
selon Wiesing, une hiérarchie entre ces trois approches philosophiques. On pourrait
avoir l’impression, au travers d’une lecture trop rapide de ce chapitre (ou si l’on en
reste simplement au titre de celui-ci), que Wiesing se propose simplement d’y décrire
les différentes approches philosophiques existantes de l’image. On pourrait ainsi être
amené à croire qu’il se contente là d’y proposer un simple panorama « historicoconceptuel » des différentes philosophies de l’image actuelles. Mais c’est mal
comprendre le projet qui anime Wiesing dans AP puisqu’il s’agit plutôt, comme il le
dit lui-même, d’y présenter des sortes de philosophie de l’image concurrentes
(konkurrierenden Arten der Bildphilosophie).26 Sortes de philosophies parmi lesquels
une seulement, selon Wiesing, sort « vainqueur » : c’est l’approche
phénoménologique. Alors ce qui me semble assez habile ici de la part de Wiesing (ou
du moins mériter que l’on le remarque), c’est que l’appareil conceptuel aristotélicien
employé implique en fait de lui-même cette idée qu’il doive exister une hiérarchie
23
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 17.
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
24
15
�entre ces approches. En effet, Aristote n’a jamais prétendu que pour caractériser
adéquatement l’essence d’une même chose pouvaient convenir plusieurs différences
spécifiques et plusieurs définitions.27 L’utilisation même de ces notions de genre et de
différence spécifique afin de distinguer ces trois manières de définir le concept
d’image aujourd’hui me semblent ainsi implicitement n’autoriser qu’une seule
définition adéquate du concept d’image – il ne s’agit alors plus que de déterminer
laquelle.28
Mais il me semble que, par cette utilisation assez insolite (et à ma connaissance
unique dans l’œuvre de Wiesing) d’Aristote, Wiesing sous-entend encore une
troisième chose intrigante (et à laquelle on aura la possibilité de revenir à plusieurs
endroits de ce travail) : il nous incite par là à commencer par appréhender l’image
d’un point de vue essentialiste. En effet, comme on vient juste de l’évoquer, selon
Aristote, le genre et la différence spécifique d’une chose nous donnent la définition de
son essence. Or ceci n’est pas anodin puisque, premièrement, Wiesing cherchera
explicitement, dans Das Mich der Wahrnehmung (comme on va le voir dans notre
deuxième partie), à déterminer ce qu’est l’essence d’une perception d’image, mais
aussi parce que le fait même de laisser entendre ici qu’il pourrait exister quelque
chose comme une « essence de l’image » peut en fait apparaître comme
problématique. En effet, selon une certaine anthropologie de l’image (comme on va le
voir tout-de-suite) l’image n’a justement pas d’essence puisque son appréhension est
toujours relative à une culture. Or ceci me semble en quelque sorte rejoindre ce que
dirait Aristote lui-même ici puisque selon lui un artefact tel que l’image ne possède en
aucun cas une essence. C’est pour catégoriser les diverses choses appartenant au
domaine de la nature (par exemple les espèces de plantes ou d’animaux) que
l’approche aristotélicienne traditionnelle revendique une approche essentialiste –
jamais afin de définir ce qu’est une table, un marteau, ou encore une image.29 Alors si
Wiesing se propose bien, dans son travail, de déterminer ce qu’est l’« essence de
l’image », en quel sens innovant (et nécessairement non traditionnel) s’emploie-t-il à
faire cela ?
27
Pour saisir les enjeux de la notion de « définition » chez Aristote, on lira par exemple
l’introduction que propose Richard Bodéüs aux Catégories, in : Aristote, Catégories, Paris :
Les belles lettres, 2002, XI-CLXXVII. Notons ici que Bodéüs préfère au terme de définition,
lorsqu’il traduit et commente Aristote, celui de formule définitionnelle.
28
Mais cette idée, que me semble défendre Wiesing dans le deuxième chapitre d’AP selon
laquelle il existe une définition de l’image qui soit « meilleure » que les autres, est-elle
conciliable avec cette autre idée, énoncée un peu plus tôt en se référant cette fois au premier
chapitre d’AP, selon laquelle la manière dont on définit la catégorie image découle
prioritairement d’un choix pour un genre de philosophie ? On reviendra sur ce point mais on
pourrait simplement supposer ici que ce sont là deux moments dans la pensée de Wiesing, au
travers desquels il pose d’abord le problème de manière neutre, puis propose de tout-de-même
établir une hiérarchie entre les différentes réponses qu’il envisage.
29
À propos de ce vaste sujet qu’est la distinction qu’opère Aristote (et avant lui Platon) entre
êtres naturels et artefacts, on lira par exemple : Jacques Brunschwig, « Aristote, Platon et les
formes d’objets artificiels », in : Aristote et la notion de nature, Pierre-Mariel Morel (éd.),
Bordeaux : Presses univ., 1997, p. 45-68.
16
�Ces remarques sur la tradition aristotélicienne et sur l’existence d’une hypothétique
« essence de l’image » devraient faire écho au troisième problème que j’évoquais en
introduction et elles se verront développées de manière ponctuelle le long de ce
travail. Mais il est temps de clore maintenant cette parenthèse, afin de passer dans
plus de détails à ce que sont, selon Wiesing, les trois approches philosophiques
actuelles de l’image. Nous commencerons ici, comme il le fait, par l’approche
anthropologique de l’image, à l’intérieur de laquelle nous dégagerons trois thèses
principales en ce qui concerne l’image, avant de passer à l’approche sémiotique, puis
à l’approche phénoménologique.
17
�4. L’approche anthropologique de l’image
4. 1. Le genus de l’image d’un point de vue anthropologique
Comment Wiesing présente-t-il l’approche anthropologique de l’image ? Comment
répond celle-ci, selon lui, à la question : « qu’est-ce qu’une image ? ». Dans un
langage aristotélicien donc : quel genre et quelle différence spécifique l’approche dite
anthropologique attribue-t-elle à l’image ? Pour l’approche anthropologique de
l’image, écrit Wiesing :
[…] sind Bilder zuerst einmal Artefakte des Menschen; die Gattung der vom
Menschen hergestellten Dinge ist das genus proximum.30
Le concept d’image, compris en son sens anthropologique, c’est donc tout d’abord un
catégorie ne regroupant que des productions humaines concrètes et matérielles : des
artefacts. Ce qui nous permet de poser ici une première thèse propre à l’approche
anthropologique, que nous appellerons AA1 (comme Approche Anthropologique 1)
selon laquelle : l’image est nécessairement un artefact. J’ai déjà rapidement évoqué
cette idée plus tôt et celle-ci peut paraître assez triviale : l’image semble être une
chose nécessairement produite par un humain. Seul les hommes produisent des
images alors que les animaux ne semblent, eux, pas en être capable, de même qu’il ne
semble pas y avoir « déjà » d’images dans la nature. Or de cette première thèse
concernant le genre de l’image selon l’approche anthropologique de l’image, on peut
déjà tirer deux observations décisives quant à la manière dont cette même approche
envisage l’image.
La première, c’est que cela exclut de la catégorie de l’image proprement dite tout ce
qu’il peut nous arriver de nommer « image » mais qui n’a pas été concrètement et
matériellement fabriqué par l’homme, comme : les souvenirs, les images mentales, les
rêves, etc. L’anthropologie de l’image, bien qu’elle s’intéresse aussi (on le verra) aux
représentations mentales grâce auxquelles on produit des images (ainsi qu’aux
représentations que semblent produire en nous les images), propose cependant de
partir de ce seul fait tangible : il y a, autour de nous, ces artefacts que l’homme
appelle des images.
Or la deuxième chose cruciale à noter ici au sujet du genre de l’image selon
l’approche anthropologique (et qu’il nous faut maintenant mieux explorer), c’est que
cette approche va déduire de ce constat de l’existence de ces artefacts que sont images
un lien fort entre ce qu’est, selon elle, un homme, et ce qu’est une image. Ce lien fort
qu’observe l’approche anthropologique entre les hommes et les images, Wiesing va le
présenter principalement grâce à sa lecture de deux auteurs : Hans Jonas et Hans
Belting. Nous ferons de même ici.
30
« [… ] les images sont avant tout des artefacts créées par l’homme ; le genre des choses
fabriquées par l’homme en est le genus proximum. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz,
op. cit., p. 17.)
18
�4. 2. Image, représentation et conscience chez Hans Jonas
Wiesing se base sur un article célèbre de Hans Jonas, intitulé : « La liberté par
l'image : Homo Pictor et la différence de l'homme » (Die Freiheit des Bildens : Homo
pictor und die differentia des Menschen) paru pour la première fois 1961, afin de
présenter une première facette de l’approche anthropologique de l’image.31 Dans
celui-ci, Jonas part en effet de cette évidence factuelle selon laquelle il y a des images.
C’est-à-dire qu’il existe autour de nous ces artefacts que l’on appelle des images, ces
objets que l’on peut regarder, acheter et vendre, peindre, parfois accrocher au mur, et
qui sont toujours le produit de l’activité humaine. Comme le dit Jonas au début de cet
article, dans lequel il commence par imaginer une équipe de chercheurs trouvant
justement des images préalablement existantes :
Unsere Forscher betreten eine Höhle und bemerken an ihren Wänden Linien
oder sonstige Konfigurationen, die künstliche Ursprungs sein müssen […]32
Or Hans Jonas, à partir de ce fait tangible qu’il présente là sous la forme d’un récit,
se pose la question originale suivante : comment se fait-il qu’il y aie des images ?
Autrement dit, quelles sont les conditions qui doivent être réunies en un individu pour
que celui-ci soit capable de fabriquer ces images ? De manière plus générale, et
comme le reformule Wiesing ici, Jonas se demande : quelles sont les conditions de la
possibilité de la production d’image (Bedingungen der Möglichkeit des
Bildmachens) ? 33
Or à cette question, Hans Jonas répond la chose suivante : pour qu’il y ait des
images, c’est-à-dire pour que soit, en un individu, réunies les conditions suffisantes à
la création d’images, il faut qu’en ce quelqu’un se trouve la capacité à représenter
(darstellen) des choses. En effet, si l’on comprend les images comme des artefacts qui
représentent des choses (et cela semble aller de soi),34 alors il faut que l’individu qui a
produit ces représentations soit capable d’en produire. Or de quoi dépend, à son tour,
cette capacité à produire des représentations ? Selon Jonas, d’une autre capacité que
l’on pourrait être tenté de qualifier d’encore plus fondamentale : celle d’être capable
de se représenter (sich vorstellen) des choses. La différence entre le sens de ces deux
31
Je me suis pour ma part basé sur la version de cet article éditée dans les œuvres complètes
de Hans Jonas. Voir : Hans Jonas, « Homo Pictor : Von der Freiheit des Bildens », in :
Kritische Gesamtausgabe der Werke von Hans Jonas, Band I/1, Dietrich Bühler / Michael
Bongardt / Holger Burckhart / Christian Wiese / Walter Ch. Zimmerli (éds.), Freiburg / Berlin
/ Wien : Rombach Verlag KG, 2010, p. 277-303.
32
« Nos chercheurs pénètrent dans une caverne et remarquent sur ses murs des lignes et
d’autres configurations, qui doivent provenir d’une origine artificielle […] ». (Lambert
Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 280.)
33
Ibid., p. 18.
34
Cela semble seulement aller de soi car comme on le verra plus particulièrement dans la
troisième partie de ce travail, il est aussi possible de ne pas concevoir l’image comme une
chose qui représente d’autres choses. Or c’est un peu, me semble-t-il, comme si Jonas
présupposait là une forme de « sémiotique minimale » de l’image afin de produire ensuite sa
propre théorie anthropologique de l’image.
19
�emplois du verbe représenter, une fois sous sa forme pronominale réfléchie (avec le
« se ») et une fois sous sa forme transitive directe (sans le « se »), est plus claire en
allemand puisqu’elle fait appel à deux verbes différents. Ainsi, sich vorstellen, se
représenter, c’est cet acte mental par lequel je me représente quelque chose dans mon
esprit, dans ma conscience. Alors que darstellen, c’est ici cet acte concret, pratique,
par lequel je produis concrètement une représentation de quelque chose, par exemple
une maison sur un bout de papier. Or selon Jonas, cette capacité à se représenter (sich
vorstellen) des choses, c’est ce qui rend possible, chez l’homme, cette capacité à
produire des images, mais c’est aussi ce qui définit l’homme : c’est ce qui le distingue
des autres animaux. La capacité, pour l’homme, de façonner dans sa conscience des
représentations (des Vorstellungen), semble en effet rendre possible la production de
représentations concrètes, d’images (de Darstellungen) – et cette capacité le distingue
également, selon Jonas, des autres êtres vivants. L’image serait ainsi, à l’intérieur de
la catégorie des artefacts, celui dont la spécificité est de « révéler » ce que l’homme
est. Elle est ce qui dévoile au reste du monde le fait qu’il se représente des choses. Car
comme l’écrit Wiesing :
Nur ein Subjekt mit Vorstellungen kann auch Darstellungen erzeugen [...]35
Or dire cela, c’est plus que de faire remarquer que l’homme, contrairement aux
animaux, a de tout temps produit des images. C’est dire avec Jonas (et c’est AA2
comme Approche Anthropologique 2) que : être un homme, c’est produire des images
– et vice-versa. Être un homme, c’est selon Jonas être un homo pictor.
On pourrait aller dans bien plus de détails ici à propos de cette idée, en se
demandant par exemple ce que c’est plus exactement que cette capacité à se
représenter des choses. On pourrait aussi se demander quel est le lien plus exact entre
cette capacité à se représenter des choses et le fait même de produire avec son corps
des représentations perceptibles pour autrui de ces mêmes représentations. 36 On
pourrait enfin débattre de cette idée selon laquelle les animaux seraient incapables de
produire des images. Mais une chose me semble cruciale à relever ici, c’est que cette
manière de considérer l’homme comme étant « le seul être qui représente des choses »
est en fait une idée plus vieille et plus répandue que l’on ne pourrait a priori le penser.
En effet, comme le montre Wiesing, Sartres définit également l’homme comme le
seul être à disposer d’une force de représentation (Vorstellungskraft) grâce à laquelle
il est en mesure d’entretenir une distance par rapport au monde (Abstand zur Welt).37
Le cogito cartésien peut lui aussi s’interpréter, du moins selon Sartres, comme un acte
par lequel la conscience se retire du monde et prend de la distance avec lui, pour
35
« Seul un sujet doué de représentations peut aussi produire des représentations concrètes. »
(Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 19)
36
Wiesing défend à ce sujet une idée intéressante, selon laquelle l’approche anthropologique
n’implique en fait aucun dualisme entre l’image mentale et l’image fabriquée. Voir : Ibid., p.
22.
37
Ibid., p. 21.
20
�ensuite mieux le penser.38 Mais on pourrait même remonter bien plus loin ici, en
faisant remarquer que définir l’homme, comme le fait la tradition antique et
scholastique, comme un « animal rationnel », donc comme un être doué de langage,
c’est aussi d’une certaine manière mettre le doigt sur cette capacité qu’à l’homme
d’entretenir un rapport symbolique donc distancié au monde. Définir l’homme comme
cet être qui, par sa conscience (ou son langage, ou sa raison, ou son esprit), est
capable de mettre de la distance entre lui et le monde sensible afin d’exprimer, de
symboliser, ou de représenter ce monde sensible – ce n’est pas une idée nouvelle.
L’originalité de l’approche anthropologique de l’image, c’est néanmoins que, selon
Hans Jonas (mais toujours dans les mots de Wiesing) :
[…] die spezifische menschliche Tätigkeit nicht das Sprechen, sondern die
Fähigkeit zur Bildproduktion ist.39
Ce qui fait ainsi conclure Wiesing à propos de l’approche anthropologique de
l’image sur le fait que poser un tel lien de nécessité entre « être un homme » et «
fabriquer des images » encourage à adopter une démarche philosophie et scientifique
dans laquelle on aura toujours à l’esprit qu’en étudiant les images, on étudiera aussi
les hommes – et réciproquement. Ce qu’il exprime dans le passage suivant (et par
lequel, on le verra, il prépare en fait déjà un peu la critique qu’il formulera ensuite de
cette approche anthropologique) où il déclare que, pour un anthropologue de l’image :
Das Bild wird weder erforscht, weil es ein Kunstwerk ist, noch weil es ein Bild
ist, sondern weil es hilft, Fragen zu beantworten, die eigentlich eine ganz
andere Wissenschaft gehören, nämlich die Anthropologie.40
Or cette idée d’étudier l’homme en étudiant l’image et vice-versa, on la trouve
également exprimée mais d’une manière différente chez un auteur dont Wiesing fait
le deuxième principal représentant de l’approche anthropologique de l’image : Hans
Belting.
4. 3. Image, mémoire et culture chez Hans Belting
La troisième thèse principale défendue par l’approche anthropologique de l’image
permet elle aussi d’insister, mais d’une autre manière, sur le lien fort existant entre
l’homme et l’image. Elle est un peu, elle aussi, un prolongement possible de cette idée
juste énoncée selon laquelle l’homme, c’est l’animal qui a pour spécificité de produire
38
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 21.
« […] l’activité spécifiquement humaine n’est pas la parole, mais la capacité à produire des
images. » (Ibid., p. 20.)
40
« L’image n’est pas étudiée parce qu’elle est une œuvre d’art, pas non plus parce qu’elle
est une image, mais parce que cela aide à répondre à des questions qui appartiennent en fait à
une toute autre science, l’anthropologie. » (Ibid., p. 23.)
39
21
�des images. Or elle consiste à dire cette fois-ci que ceci n’est pas le cas seulement à
cause de la capacité qu’aurait l’homme à représenter les choses, mais aussi parce que
l’homme est le seul être à disposer d’une mémoire et d’une culture qui rendent
possible la perception d’images. Elle défend en effet que l’image ne se laisse
appréhender que lorsque l’on considère celle-ci dans sa relation à des hommes ayant
une mémoire et une culture donnés. Dans cette optique, c’est alors parce que
l’homme a telle mémoire et telle culture que, en face d’un certain artefact, il voit une
image.
Pour tenter de préciser le sens de cette idée ici (que Wiesing ne fait que rapidement
évoquer et à laquelle il me semble en fait ne pas accorder spécialement de crédit) on
peut utiliser l’exemple suivant. Imaginons (cet exemple est de moi) qu’un individu
qui n’a jamais vu de photographies, ni d’ordinateurs, voie une photographie d’un
ordinateur. Il y verra une chose tellement différente de moi et entretiendra un rapport
tellement différent du mien à cet objet, qu’il deviendrait en fait assez discutable de
prétendre qu’il voie bien là « une image d’ordinateur ». 41 D’où précisément la
nécessité, lorsqu’on étudie les images, d’étudier avant tout leur mode de
consommation et de production dans un cadre historiquement et culturellement
déterminé. Car comme le dit Wiesing, qui reprend ici une idée de Hans Belting :
Keine Betrachtung eines äusseren Bildes kommt ohne die Mitwirkung von
„Erinnerung und Vorstellung“ aus.42
On peut dès lors, me semble-t-il, formuler de manière succincte une troisième thèse
propre à l’approche anthropologique, selon laquelle (et c’est AA3, comme Approche
Anthropologique 3) : une image, c’est toujours une image pour un individu détenteur
d’une mémoire et une culture données. Mais quels sont alors, brièvement, les liens et
les différences entre cette idée et ce que nous avons précédemment dit au travers du
travail de Hans Jonas ?
Le point commun principal entre ces deux optiques, me semble-t-il, c’est le fait que
dans chacune d’elles il s’agisse bien de chercher à établir ce qu’est le lien indissoluble
qui unit l’homme à l’image. D’où ce titre que propose Wiesing d’anthropologie de
l’image. D’où aussi cette idée que le propre de l’image c’est, selon l’approche
anthropologique, qu’afin d’en produire une :
[...] bedarf der Mensch spezifisch menschlicher Fähigkeiten, weshalb die
Bildwissenschaft als Kunde vom Menschen verstanden und betrieben werden
sollte.43
41
On pourrait également, me semble-t-il, trouver des exemples qui vont dans le sens inverse,
c’est-à-dire dans lesquels un individu appartenant à une culture tout-à-fait étrangère à la
mienne voie dans un objet déterminé une image de quelque chose, et moi non.
42
« Aucune contemplation d’une image extérieure n’est possible [ou : ne vient] sans la
participation du "souvenir et de la représentation". » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz,
op. cit., p. 23.)
22
�Toutefois, au moins deux différences importantes me semblent subsister entre les
approches de Belting et de Jonas. Deux différences que je me permettrai encore
d’évoquer ici avant de passer à l’approche sémiotique de l’image.
La première, c’est qu’alors que chez Jonas, c’est la relation qu’entretient l’image
avec le fonctionnement de notre conscience qui constitue l’objet d’étude de
l’anthropologue de l’image, chez Belting, ce sont plutôt les relations pratiques (par
exemple sociales ou cultuelles) qu’entretiennent les hommes d’une culture donnée
avec ce qu’ils considèrent comme des images qui sera au centre de l’attention.
L’approche de Belting implique en effet d’étudier des situations quotidiennes dans
lesquelles des hommes interagissent avec des images – non pas l’image en tant que
révélateur de l’âme humaine ou en tant que fruit d’une Darstellung.44 Il s’agit, si l’on
prend le programme de Hans Belting (ou d’un anthropologue de l’image comme
Alfred Gell)45 au sérieux, d’observer par exemple des individus vouer un culte à un
dieu par l’intermédiaire d’images, ou encore d’observer des visiteurs déambuler dans
un musée d’art contemporain – pas d’étudier le fonctionnement de la conscience de
l’homme.
Or la deuxième différence, me semble-t-il, entre l’approche que défend Jonas face
aux images et celle que préconise les anthropologues se revendiquant de Belting, c’est
que seule cette dernière optique implique (et l’on en revient ici une première fois à ma
parenthèse sur la question de l’essence de l’image) une certaine attitude « antiessentialiste » ou, ce qui revient au même, un certain relativisme. En effet, si l’on en
croit cette idée, selon laquelle le statut de l’image est absolument relatif à la manière
dont on la perçoit et dont on l’investit de ses propres souvenirs et de sa propre culture,
alors un objet peut apparaître comme image à des individus appartenant à une culture
w et ayant une mémoire x, mais comme autre chose à des individus appartenant à une
culture y et ayant une mémoire z. L’« essence » de l’image devient alors, pour ainsi
dire, « multiple » et relative à des cultures – et il semble du même coup inadéquat de
persister à vouloir parler de l’essence de l’image. Mais alors une telle approche
anthropologique et plus précisément AA3 permettent-elles véritablement de constituer
une philosophie de l’image qui attribue un genre et une différence spécifique au
concept d’image, tel que le prétend Wiesing ? Ou doit-elle au contraire plutôt être
conçue comme une approche qui remet en question le projet même de chercher ce
43
« […] l’homme a besoin [ou : monopolise] des capacités spécifiquement humaines, et c’est
la raison pour laquelle la science de l’image doit être comprise et s’exercer comme une étude
de l’homme. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 17.)
44
C’est justement pour se distinguer d’une approche philosophique traditionnelle que partage
dans une certaine mesure Jonas que Hans Belting écrit, dans son avant propos à Pour une
anthropologie des images : « Je me propose d’examiner l’image comme phénomène
anthropologique. Mais qu’est-ce qu’une image ? Les philosophes ont abordé l’image comme
un concept en soi et universel, sans prendre en considération les diverses conditions
historiques et médiales de son avènement. » Voir : Hans Belting, Pour une anthropologie des
images (2001), traduit de l’allemand par Jean Torrent, Paris : Gallimard, 2004, p. 9.
45
Pour se faire une idée plus précise de ce que propose une anthropologie de l’image
passionnante, je recommande la lecture de : Alfred Gell, L’art et ses agents : une théorie
anthropologique (1998), traduit de l’anglais par Sophie & Olivier Renaut, Dijon : Les presses
du réel, 2009.
23
�qu’est l’image en général ? J’aurai l’occasion de revenir à cette question. Mais il est
temps maintenant de passer à la présentation que fait Wiesing d’une deuxième
approche philosophique de l’image : c’est l’approche sémiotique (ou sémiologique)
de l’image 46 , à l’intérieur de laquelle nous repérerons à nouveaux trois thèses
principales.
46
J’emplois ici ces deux termes de « sémiologie » et de « sémiotique » de manière strictement
synonyme. Il désignent tous deux la science des signes.
24
�5. La sémiotique de l’image
5. 1. Le genus de l’image d’un point de vue sémiotique
L’approche sémiotique (ou sémiologique) ou encore « significo-théorique » de
l’image (der zeichentheoretische Ansatz), écrit Wiesing, est étrangère aux questions
que se pose l’anthropologie de l’image.47 Elle ne s’intéresse en effet pas directement à
la relation entre l’image et l’homme, ni ne considère celle-ci comme déterminante,
que ce dernier soit décrit comme conscience ou comme individu détenteur d’une
mémoire et d’une culture données. Elle s’intéresse plutôt à l’image en tant que signe.
Elle repose sur l’idée que la philosophie de l’image doit se présenter avant tout
comme une discipline appartenant à la philosophie des signes en général, autrement
dit comme s’inscrivant dans une théorie générale des symboles (allgemeine
Symboltheorie).48 Elle donne ainsi comme genus au concept d’image, selon Wiesing,
celui de signe :
Der semiotische Ansatz stellt hingegen den Bildbegriff unter einen anderen
Oberbegriff: Bilder sind zuerst einmal notwendigerweise Zeichen.49
La première thèse commune à toute l’approche sémiotique de l’image telle que la
présente Wiesing me semble donc être la suivante (et c’est AS1, comme Approche
Sémiotique 1) : l’image est nécessairement un signe. Le tout est alors de tenter de
répondre à l’intérieur de cette approche à deux questions principales. Premièrement,
pourquoi l’image est-elle nécessairement un signe ? D’où vient cette idée (somme
toute assez banale) selon laquelle l’image appartiendrait nécessairement à la catégorie
des signes ? 50 Deuxièmement, de quel type de signe particulier s’agit-il ? Autrement
dit, et comme l’écrit Wiesing : quelle forme particulière du signifier ou du désigner
(besondere Form des Zeichens) permettent donc les images ?51 Qu’est-ce qui fait la
spécificité des signes que seraient nécessairement les images ?
47
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 26.
Ibidem.
49
« L’approche sémiotique classe en revanche le concept d’image sous un autre concept plus
général [ou : lui attribue un autre genre] : les images sont avant tout des signes. » (Ibid., p.
18.)
50
Il me semble en effet que l’on comprend assez communément l’image comme étant un
signe de quelque chose. On parle aussi la plupart du temps « d’images de … ». Enfin, le petit
ouvrage Philosophische Grundbegriffe für Dummies de 2012 consacre étonnamment un
article au concept d’image, qui commence ainsi : Auf lateinisch heißt Bild imago, was den
gleichen Wortursprung hat wie „imitieren“. Ein Bild ist zunächst einmal eine Darstellung,
die dem Original ähnlich ist: zum Beispiel ein Porträt (außer es stammt von Picasso) oder
eine Fotografie. « En latin, image se dit imago, terme qui a la même racine que « imiter ».
Une image, c’est avant tout une représentation qui ressemble à l’original : par exemple un
portrait (à part s’il est peint par Picasso) ou une photographie. » Voir : Christian Godin,
Philosophische Grundbegriffe für Dummies, Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2012, p. 2728.
51
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 26.
48
25
�Afin de répondre à ces questions, Lambert Wiesing se base presque exclusivement
sur l’ouvrage fondamental de Nelson Goodman paru en 1968 intitulé Langages de
l’art.52 L’argumentation que déploie l’approche sémiotique contemporaine de l’image
ne se trouverait nulle part ailleurs autant clairement, selon Wiesing, que dans cet
ouvrage.53 C’est donc principalement du travail de Goodman qu’il sera question ici.
Toutefois, Wiesing retrace rapidement la genèse de cette approche sémiotique et
donne alors comme point de départ à celle-ci la théorie des signes qu’élabore plus tôt
Charles Sanders Peirce, qu’il nomme d’ailleurs le « père de la sémiotique moderne »
(Vater der Modernen Semiotik).54 Mais plutôt que de commencer par présenter le
travail de Peirce ici, il me semble que l’on peut encore, pour des raisons
principalement historiques et didactiques, essayer de retracer la genèse de l’approche
sémiotique des images en remontant encore bien plus loin : en cherchant son origine
chez Platon. Je sais bien que je commettrais un anachronisme flagrant en prétendant
qu’il existe une véritable « approche sémiotique platonicienne de l’image », mais il
me semble justifié pour au moins deux raisons de repartir de Platon ici.
La première de ces raisons, c’est que dans Sehen lassen (l’ouvrage sur lequel porte
la troisième partie du présent travail), Wiesing retrace la genèse de ce qu’il nommera
cette fois la théorie de l’illusion en partant justement de Platon. Or ce qu’il appellera
alors la « théorie de l’illusion », on le verra, est très étroitement liée à ce que Wiesing
appelle ici la sémiotique de l’image.55 Mais deuxièmement, s’il me semble pertinent
de commencer par brièvement esquisser le rapport de Platon aux images ici, puis celui
de Peirce, et enfin celui de Goodman, c’est que bien que les buts que poursuivent ces
auteurs ne soient évidemment pas les mêmes, Platon comme Peirce me semblent
néanmoins défendre une même idée traditionnelle à laquelle Goodman entend
justement s’opposer : c’est l’idée selon laquelle l’image réfèrerait toujours aux choses
par mimétisme.
52
Nelson Goodman, Langages de l’art (1968), traduit par Jacques Morizot, Nîmes : J.
Chambon, 2011.
53
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 26.
54
Ibidem.
55
Pour le dire assez simplement ici, disons que ces deux approches partagent selon Wiesing
un même fondement (c’est-à-dire, on le verra, une même erreur) : elles partagent toute deux
cette même idée, selon laquelle l’image est toujours un signe de quelque chose. Or cette
prétention, comme on va le voir tout-de-suite, se trouve déjà chez Platon et me semble
traverser toute la longue histoire du débat entre iconoclastes et iconophiles, dont on peut se
faire une idée en consultant par exemple : Marie-France Auzépy, L’iconoclasme, Collection :
Que sais-je ?, Paris : Presses univ. de France, 2006.
26
�5. 2. La sémiotique mimétique de l’image
D’où vient cette idée, propre à l’approche sémiotique, selon laquelle les images
seraient nécessairement des signes de choses ? Si l’on en croit Platon, du fait que les
images ressemblent toujours à des choses. C’est à cause de cette ressemblance
qu’entretiennent toujours les images aux choses que justement elles y réfèrent,
qu’elles en sont des signes. On trouve cette idée principalement dans le livre X de La
République, par exemple dans le passage qui ouvre celui-ci, lorsque le personnage de
Socrate y défend qu’il faut bannir l’art de la cité idéale au nom de « tout ce qui en elle
est poésie mimétique ».56 Il s’agit alors d’y condamner, entre autres arts, celui que
l’on peut produire au travers d’images, parce qu’il procèderait essentiellement par
ressemblance ou même : par imitation. En effet, si l’on en croit Socrate dans ce
passage, l’image imite toujours le monde réel. L’art et les images procèdent donc
essentiellement par mimesis : c’est ce qui fait leur spécificité en tant que signe.
Or Peirce, même s’il n’en déduit pas qu’il faut bannir les images, ne dit au fond pas
autre chose à leur propos. La différence, principalement terminologique, c’est qu’au
lieu de considérer l’art, la poésie ou les images en général, Peirce parle explicitement
des icones. 57 Mais ce terme d’icône recouvre précisément le domaine des arts
mimétiques au sens platonicien (et donc aussi des images) puisqu’une icône c’est
selon Peirce un signe particulier en ce qu’il réfère aux choses auxquelles il ressemble.
C’est d’ailleurs ce qui distingue, pour Peirce, l’icône des deux autres sortes de signes
que sont le symbole et l’index. Comme le dit Wiesing :
Peirce tritt dafür ein, dass sich ein Ikon von Symbolen und Indexen durch die
Ähnlichkeit des Ikons mit dem Bezeichneten bestimmen lässt.58
Alors dans cette optique que l’on pourrait être tenté de qualifier ici, pour aller vite,
de « platonico-piercienne » ou encore d’« approche sémiotique mimétique de
l’image » (ces étiquettes sont de moi), une image (ou, dans le langage de Peirce : une
icône) de maison est bel et bien une image de maison parce que la maison dans
l’image ressemble visiblement à une maison réelle. Dans cette optique, c’est ainsi la
ressemblance visible que les images entretiennent aux choses qui fonde le fait qu’elles
soient avant tout considérées comme des signes de ces mêmes choses. On peut dès
lors, me semble-t-il, poser ici un deuxième thèse propre à l’approche sémiotique telle
que la présente Wiesing dans AP, selon laquelle (et c’est AS2 comme Approche
Sémiotique 2) : l’image est toujours le signe de ce à quoi elle ressemble.
56
Platon, La République, Livre X, 595a, Paris : Gallimard, 1993, p. 491.
Voir : Charles Sanders Peirce, « D’une nouvelle liste de catégories » [On a New List of
Categories] (1867), 1.545-1.560, in : Textes fondamentaux de sémiotique, traduit par Berthe
Fouchier-Axelsen et Clara Foz, Paris : Klicksieck, 1987, p. 21-42.
58
« Peirce soutient qu’une icône, contrairement aux symboles et aux indexes, se laisse
déterminer par sa ressemblance avec ce qu’elle désigne. » (Lambert Wiesing, Artifizielle
Präsenz, op. cit., p. 27)
57
27
�Toutefois cette thèse, si elle est propre à l’approche sémiotique et si elle peut
également sembler pleine de bon sens, n’est en fait pas défendue par tout le monde au
sein de cette même approche dite sémiotique. En effet, Wiesing ajoute directement
après le passage juste cité (et ce sont les raisons de cette remarque qu’il nous faut
maintenant tenter de comprendre) :
Hingegen Goodman [...] macht sich dafür stark, dass Bilder gerade nicht
mittels der Ähnlichkeit von anderen Formen des Symbolisierens unterscheiden
können. 59
Car alors que, pour Platon puis pour Peirce, la référence qui existe entre une image et
ce à quoi elle réfère est nécessairement le fruit d’une ressemblance, selon Goodman,
celle-ci est le fait des conventions à l’œuvre dans la manière dont les images dénotent
leur objet.
5. 3. La sémiotique conventionnaliste de l’image
En quoi Goodman se distingue-t-il de ce que nous avons appelé ici l’approche
sémiotique mimétique de l’image ? Pour quelles raisons, s’il s’inscrit dans l’approche
sémiotique de l’image, désire-t-il toutefois analyser tout-à-fait différemment le
fonctionnement référentiel de l’image ? Autrement dit, comment fonde-t-il sa propre
approche sémiotique de l’image ? En faisant tout d’abord remarquer qu’une image ne
réfère justement pas (ou en tout cas pas toujours) à la chose qu’elle représente en
raison d’une ressemblance. Comme le dit Goodman dans un passage de Langages of
Art (que cite Wiesing) :
Tastsache ist, dass ein Bild, um einen Gegenstand repräsentieren zu können,
ein Symbol für ihn sein kann, für ihn stehen, auf ihn Bezug nehmen muss; und
dass kein Grad von Ähnlichkeit hinreicht, um die erforderliche Beziehung der
Bezugnahme herzustellen. Ähnlichkeit ist für Bezugnahme auch nicht
notwendig, fast alles kann für fast alles andere stehen.60
Or comment Goodman s’y prend-il pour établir que la mimesis n’est ni suffisante,
ni même nécessaire pour rendre compte de la manière dont les images réfèrent à leur
59
« En revanche Goodman […] soutient clairement que les images ne se différencient
justement pas des autres formes de symbolisation en raison d’une supposée ressemblance »
(Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 27)
60
Jacques Morizot traduit ce passage comme ceci : « Le fait est qu’une image, pour
représenter un objet, doit en être un symbole, valoir pour lui, y faire référence ; mai aucun
degré de ressemblance de suffit à établir le rapport requis de référence. La ressemblance n’est
d’ailleurs nullement nécessaire pour la référence ; presque tout peut valoir pour presque
n’importe quoi d’autre. » (Nelson Goodman, Langages de l’art, op. cit., p. 35.) Ce passage se
trouve cité ici dans AP : Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 27.
28
�objet ? En prenant (entre autres)61 deux exemples qu’il me semble valoir la peine de
restituer ici.62
Supposons tout d’abord, nous dit Goodman, une image d’un château déterminé.
Cette image, par exemple ce tableau, ressemble en fait plus à n’importe quel tableau
qu’au véritable château auquel elle réfère (ne serait-ce que par la taille respective de
ces objets). Or c’est bien un château que l’image représente – et pas le reste des
tableaux existants. Donc le fait qu’une certaine image représente un certain château
(et pas une autre image) ne peut se trouver uniquement dans la ressemblance qu’elle
entretient à ce château : elle doit donc se trouver ailleurs. Or Goodman va même plus
loin ici puisqu’il défend, dans le passage cité, que le fait de ressembler à la chose
qu’une image représente n’est pas même nécessaire au fait qu’elle réfère précisément
à cette chose. Alors comment argumente-t-il cette fois ? En prenant (entre autres)
l’exemple qui suit.
On peut voir représentée, dans une image, de la tristesse. Mais, se demande-t-il,
quelles couleurs ou quels traits « ressemblent-ils », dans l’image, à de la tristesse ? La
réponse est simple : aucun.63 C’est donc qu’une image, comme le dit Goodman, peut
représenter à peu près tout, sans même avoir besoin de ressembler en quoi que ce soit
à ce qui est représenté. Il faut dès lors, et pour cette raison, élaborer une approche
sémiotique décidément « anti-mimétique » de l’image – et c’est entre autre à cela que
s’attèlera Goodman dans Langages de l’art.
Car ce qui me semble véritablement décisif ici, ce n’est pas vraiment la critique
qu’opère Goodman vis-à-vis de l’approche sémiotique traditionnelle. Comme on l’a
dit, il s’agit surtout, en passant par Platon puis par Peirce, de retracer à grands pas la
genèse de l’approche sémiotique de l’image d’aujourd’hui. Ce qui est décisif, c’est
plutôt l’idée qui vient en fait juste après le passage juste cité, dans lequel Goodman
(que cite Wiesing) poursuit de la sorte :
Ein Bild, das einen Gegenstand repräsentiert – ebenso wie eine Passage, die
ihn beschreibt –, nimmt auf ihn Bezug und, genauer noch: denotiert ihn.64
Au-delà de la critique de cette idée du rôle fondamentale de la ressemblance dans le
fonctionnement d’une image, ce que Goodman propose ainsi comme projet original,
61
Dans Langages de l’art, Nelson Goodman produit une critique radicale de cette idée selon
laquelle une image réfèrerait toujours à ce à quoi elle ressemble. Dans ce cadre, il commence
par analyser de manière particulièrement éclairante le concept même de ressemblance, voir :
Nelson Goodman, Langages de l’art, op. cit, p. 34.
62
Wiesing ne mentionne que le premier de ces exemples, voir : Lambert Wiesing, Artifizielle
Präsenz, op. cit., p. 48-49. Cet exemple se trouve ici chez Goodman : Nelson Goodman,
Langages de l’art, op. cit., p. 34-35. Tandis que l’exemple concernant la tristesse comme
résultante d’une « dénotation métaphorique » se trouve présenté et développé ici : Ibid., p. 79125.
63
Ibid., p. 80.
64
Jacques Morizot traduit ce passage dans l’édition française comme ceci : « Une image qui
représente un objet – ou une page qui le décrit – y fait référence et, plus particulièrement, le
dénote. » (Nelson Goodman, Langages de l’art, op. cit, p. 35.) Ce passage se trouve ici dans
AP : Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 27.
29
�c’est de considérer que l’image représente toujours un objet parce que, tout comme un
passage qui le décrit, c’est-à-dire tout comme le langage verbal, elle dénote cet objet.
Il faut dès lors, selon Goodman, pour comprendre pourquoi les images sont
nécessairement des signes et pour comprendre le fonctionnement particulier de ces
signes que sont les images, comparer (voir assimiler) leur fonctionnement à celui du
langage verbal. L’image, selon Goodman, tout comme le langage verbal, dénote
toujours son objet ou, pour être plus précis : le « dépicte » (de l’anglais to depict).65
Ce qu’il faut alors faire, c’est observer les conventions et les règles de lecture66 des
images qui font que celles-ci permettent de dépicter un objet et non un autre.67
Comme le dit Wiesing, selon Goodman :
[…] Bilder aufgrund von gelernten Konventionen und nicht aufgrund einer
sichtbaren Ähnlichkeit Bilder derjenigen Dinge sind, von denen sie Bilder
sind.68
On peut ainsi poser ici une thèse qui résume un peu l’originalité de l’approche
goodmanienne à l’intérieur de l’approche sémiotique de l’image, selon laquelle (et
c’est AS3 comme Approche Sémiotique 3) : l’image réfère toujours à son objet grâce
à des conventions. La spécificité du signe qu’est l’image, dans cette perspective, c’est
ainsi de référer à des objets grâce à des conventions spécifiques, c’est-à-dire distinctes
de celles que monopolise le langage verbal : des conventions « dépictives ». Mais
alors qu’est-ce maintenant plus précisément que la dépiction pour Goodman ? Et si
celle-ci fonctionne essentiellement grâce à des conventions, alors lesquelles ? En quoi
65
Le terme anglais de depiction est central à tout un courant philosophique plutôt influencé
par la théorie anglo-saxonne analytique et par la philosophie du langage, que l’on a pris
l’habitude de regrouper sous le terme de theory of depiction. Pour une introduction à ce
courant (que Wiesing situerait certainement à l’intérieur de ce qu’il appelle l’approche
sémiotique de l’image), on lira avant tout Langages de l’art de Goodman, qui y joue un rôle
de référence fondatrice, mais aussi : E. H. Gombrich, Art and Illusion (1960), Princeton
University Press, 2000, ou encore un livre plus récent et explicitement introductif : John V.
Kulvicki, Images, Abingdon : Routledge, 2004. Je reviens à cette theory of depiction aux
pages 90 à 97 de ce travail.
66
Comme le dit Wiesing , qui cite ici Langages de l’art : Für Goodman ist die Art der
Bildrezeption in jedem Fall ein Lesen : „Perspektivistisch gemalte Bilder müssen wie alle
anderen gelesen werden ; und die Fähigkeit zu lesen muss erworben werden.“ « Pour
Goodman, la manière dont on reçoit [ou : perçoit] une image est dans tous les cas une
lecture : "les images en perspectives doivent être lues comme toutes les autres ; et la capacité
à lire doit s’acquérir." » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 34.)
67
On peut noter au passage que cette idée selon laquelle ce sont des conventions qui nous
permettent d’utiliser et de comprendre les images, c’est en fait une idée qui me semble
rapprocher l’optique goodmanienne d’une anthropologie de l’image. Il s’agit en effet, dans les
deux cas, d’accorder de l’importance à quelque chose de proprement humain : les conventions
socialement acquises aux travers desquelles on appréhende des images.
68
« C’est en raison de conventions apprises et non en raison d’une ressemblance visible que
les images sont des images des choses dont elles sont les images ». (Ibid., p. 27.)
30
�la manière dont les images réfèrent-elles aux choses est-elle cependant distincte de la
manière dont le langage verbal peut référer à ces mêmes choses ?69
Autant de questions en ce qui concerne l’approche sémiotique « conventionnaliste »
(cette étiquette est de moi), à propos desquelles nous n’aurons malheureusement pas
la possibilité de chercher de réponse ici. Cela par manque de temps, mais aussi parce
faire cela au travers de ce qu’en dit Wiesing me semblerait particulièrement délicat.
En effet, Wiesing ne va pas véritablement dans le détail de la théorie des symboles de
Goodman. Il ne parle pas même de ce concept (pourtant central chez Goodman) de
dépiction. Pourquoi cela ? Parce que Wiesing se veut certes bref et synthétique, mais
peut-être également parce que quand bien même il désirerait dresser un portrait fidèle
de l’approche goodmanienne de l’image, il me semble que ce qu’il souhaite peut-être
avant tout ici, c’est préparer le terrain à la critique de type phénoménologique qui
suivra. L’image, selon Wiesing, ne fonctionne justement pas nécessairement comme
un signe : il devient dès lors secondaire de chercher à déterminer si la nature de ce
signe est mimétique ou conventionnelle. Autrement dit, ce qui est important pour
Wiesing ici, c’est que :
Zeichentheoretische Philosophien des Bildes mögen sich in der Tat bei der
Frage nach der Ähnlichkeit des Bildes unterscheiden, doch die Ansicht, dass
Bilder überhaupt Zeichen sind, ist innerhalb dieser Richtung gänzlich
unstrittig.70
Et ce sont ainsi les (mauvaises) raisons de ce consensus entre sémioticiens de l’image
qu’il faut, selon Wiesing, remettre en question. Or avant de faire précisément cela,
puis de passer à l’approche phénoménologique de Wiesing, commençons par voir tout
d’abord ce que sont les problèmes principaux que repère Wiesing à l’intérieur de
l’approche dite anthropologique de l’image.
69
À ce sujet, voir : Nelson Goodman, Langages de l’art, op. cit., p. 64-67.
« Les philosophies significo-théoriques [ou : sémiotiques] de l’image peuvent en effet se
distinguer les unes des autres en ce qui concerne la question de la ressemblance de l’image,
mais l’idée même selon laquelle les images sont des signes y demeure tout-à-fait
incontestée. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., 27.)
70
31
�6. Les problèmes des approches anthropologiques et sémiotiques
6. 1. Trois problèmes liés à l’approche anthropologique
Quelles sont les raisons qui font que, à l’approche anthropologique, Wiesing préfère
une autre approche, qu’il nommera l’approche phénoménologique de l’image ? En
plus des raisons qui font que, on le verra, la phénoménologie semble particulièrement
appropriée afin de dire ce qu’est une image, quels sont les problèmes principaux que
rencontre sa première concurrente : l’approche anthropologique de l’image ? Ceux-ci
me semblent être au nombre de trois, que j’évoquerai succinctement ici.
Le premier de ces problèmes me semble surtout toucher l’approche défendue par
Hans Jonas. Il réside dans le fait que, selon Wiesing, l’« anthropologie
philosophique » de celui-ci ne semble en fait pas véritablement permettre d’ouvrir de
réelles perspectives scientifiques. La question qui reste, selon Wiesing, encore sans
réponse dans ce cadre théorique est en effet la suivante :
Wie kann man die anthropologische
bildwissenschaftlich nutzen? 71
Bedeutung
des
Bildes
En effet, chercher à décrire la manière dont fonctionne le lien entre des
représentations d’images dans ma conscience et ces artefacts que sont les images, cela
devrait nous pousser, me semble-t-il, à adopter une démarche introspective dans
laquelle on se demandera, à l’intérieur de mes représentations, comment celles-ci sont
liées à des images concrètes. Mais quelles perspectives scientifiques nous ouvrirait
une telle démarche si peu objectivable ? Or on doit rappeler ici que ceci est un
véritable problème puisque, comme on l’a vu un peu plus tôt, la philosophie, en
définissant le concept d’image, devrait ensuite permettre de proposer une démarche
scientifique à propos des images qu’elle a ainsi regroupées dans une même catégorie.
Mais ceci ne me semble néanmoins n’être que le moindre des problèmes que décèle
Wiesing à l’intérieur de cette approche dite anthropologique. Car il est possible de
relever maintenant une deuxième difficulté dans la manière dont l’approche
anthropologique envisage l’image au travers de la simple question suivante : d’où
vient au fait cette idée de vouloir lier aussi intimement ce qu’est une image à ce qu’est
un homme ? On s’en rappelle, nous avons dit assez tôt que l’approche
anthropologique explore la nature du « lien fort » qu’elle observe entre ce qu’est un
homme et ce qu’est une image. Mais pourquoi vouloir au fait considérer à ce point
l’image, pour ainsi dire, comme « humaine » et l’humain comme « imaginant » ? Au
lieu d’estimer que ce rapprochement constitue une hypothèse fructueuse, on pourrait
plutôt considérer ici, comme semble le faire Wiesing, que ce rapprochement est en
fait le fruit d’une confusion entre deux choses tout-à-fait distinctes : l’homme et
l’image. Constater l’existence de ce soi-disant « lien fort » pourrait ainsi nous
71
« Comment peut-on utiliser scientifiquement la signification anthropologique de
l’image ? » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 23.)
32
�apparaître comme une analogie trompeuse, comme une sorte d’anthropomorphisation
de l’image. Autrement dit, ce rapprochement pourrait n’être le fruit que d’une
équivoque entre deux concepts pourtant fondamentalement différents : le concept
d’homme et le concept d’image. Car Wiesing va jusqu’à dire ici que :
[…] der anthropologische Ansatz in bedenklichem Masse davon lebt,
Äquivokationen und Analogien als Identitäten zu behandeln.72
Or l’exposition plus complète de cette critique à l’encontre d’une certaine approche
anthropologique anthropomorphisante et mystificatrice de l’image constitue
précisément le thème de tout un passage de la troisième partie de ce travail73 – je
m’arrêterai donc ici à ce sujet.74 Remarquons simplement encore que ce deuxième
problème est fort proche d’un troisième problème que l’on peut formuler au travers de
la question suivante : pourquoi, quand on veut comprendre ce qu’est une image,
s’attarder autant sur l’homme, sur sa conscience, sur sa mémoire, sur sa culture, et
non sur les images elles-mêmes ? En effet, pourquoi, quand on dit faire de la
philosophie de l’image, au lieu de s’intéresser à l’homme, ne pas plutôt s’intéresser
aux images ?
Pour éclaircir un peu ce point, reprenons le début d’un passage déjà cité, à propos
duquel nous disions (page 21) qu’il préparait en fait déjà la critique
phénoménologique de Wiesing à l’encontre de l’approche anthropologique. Dans
celui-ci, Wiesing écrivait que, pour un anthropologue de l’image (je souligne) :
Das Bild wird weder erforscht, weil es ein Kunstwerk ist, noch weil es ein Bild
ist [...]75
Il me semble que l’essentiel de ce troisième problème s’y trouve. C’est-à-dire qu’il
s’y trouve déjà formulé, de manière particulièrement concise, ce troisième reproche
selon lequel à l’intérieur de l’approche anthropologique l’image n’est en fait pas
étudiée parce qu’elle est une image – elle y est donc étudiée pour autre chose que ce
qu’elle est. Autrement dit, en défendant tout d’abord cette première idée selon
laquelle l’image appartient à la catégorie des artefacts, l’approche anthropologique de
72
« L’approche anthropologique vit de manière inquiétante du fait qu’elle traite certaines
équivoques et analogies comme des identités » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op.
cit., p. 24.)
73
Aux pages 84 à 90.
74
On peut à ce sujet simplement noter ici que cette idée selon laquelle il s’agit en fait à
l’intérieur de l’approche anthropologique, en confondant l’homme et l’image, de fabriquer
une « mythologie de l’image », est déjà explicite dans AP lorsque Wiesing y écrit que
l’anthropologie de l’image encourage une : […] Form der Mystifikation des Bildes zum
eigentlichen Ort einer absoluten Wahrheit, des Todes oder eigentlichen Daseins. « […] une
forme de mystification de l’image qui nous fait considérer celle-ci comme le lieu d’une vérité
absolue, comme le lieu de la mort, ou encore comme le lieu de notre être véritable. » (Ibid.,
p. 26.)
75
« L’image ne sera pas étudiée parce qu’elle est un œuvre d’art, ni parce qu’elle est une
image […] » (Ibid., p. 23.)
33
�l’image ne commet certes pas véritablement d’erreur mais elle place dès le départ
l’image dans la mauvaise catégorie et essaie alors de l’expliquer par autre chose que
ce qu’elle est, c’est-à-dire par autre chose que par ses propriétés (Eigenschaften).
Toutefois, avant de voir maintenant ce que sont, selon Wiesing, ces « propriétés de
l’image », passons brièvement à la critique que produit cette fois Wiesing à l’encontre
de l’approche dite sémiotique de l’image.
6. 2. Deux problèmes liés à l’approche sémiotique
Il me semble que Wiesing repère, à l’intérieur de l’approche sémiotique de l’image,
deux problèmes. Le premier (et principal) problème concerne l’approche sémiotique
en général (que l’on parle de Platon, de Peirce, de Goodman ou encore de ceux qui
s’en réclament), tandis que le deuxième est plus spécifique à Goodman et à la manière
dont celui-ci semble parfois réduire les images à leur support matériel.
Le premier de ces problèmes donc, que nous avons déjà brièvement évoqué, réside
dans ce fait qu’il est tout simplement faux, selon Wiesing, de défendre AS1, c’est-àdire d’estimer que l’image est nécessairement un signe. Cela car on peut, selon
Wiesing, utiliser une image comme un signe, elle peut avoir comme fonction de
signifier quelque chose, de référer à quelque chose – mais elle n’a jamais pour
propriété, selon lui, d’être un signe. Même si elle peut servir en tant que signe
l’image n’est pas un signe. Autrement dit, la thèse AS1 est fausse selon Wiesing parce
que, et il reprend ici une formule de Reinhard Brandt :
Bilder können, sie müssen jedoch nicht als Zeichen fungieren.76
Mais à nouveau, on verra les raisons de cela dans le détail seulement dans la
troisième partie de ce travail, qui porte précisément sur cette distinction fondamentale
entre propriété et fonction de l’image, que l’on établira alors plus solidement grâce la
lecture que propose Wiesing du travail de Heidegger. On peut toutefois déjà se
permettre de citer ici dans son entier un passage à mon sens tout-à-fait crucial d’AP
qui ouvre le troisième chapitre de l’ouvrage, dans lequel Wiesing essaie (à ma
connaissance pour la première fois) d’élaborer clairement cette distinction entre
propriété et fonction de l’image. Passage dans lequel Wiesing écrit :
Wenn man sich mit der Frage befassen möchte, ob Bilder Zeichen sind, dann
ist die folgende Unterscheidung von Bedeutung: Es gibt auf der einen Seite
Fragen, die werden durch die Bestimmung von Eigenschaften beantwortet;
auf der anderen Seite stehen die Fragen, welche durch die Angabe von
Funktionen beantwortet werden. Ein Musterbeispiel für den ersten Fall dürfte
76
« Les images peuvent fonctionner comme des signes, mais elles ne le doivent pas. »
(Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 39.) Sur Reinhard Brandt, Wiesing donne
ici la référence suivante : Reinhard Brandt, Die Wirklichkeit des Bildes, München / Berlin :
Hanser, 1999, p. 132.
34
�Sind Delphine Fische? sein. Diese Frage wird ausschliesslich durch den
Nachweis von bestimmten, empirischen Eigenschaften beantwortet; Delphine
müssen biologisch daraufhin untersucht werden, ob sie die Eigenschaften
eines Fisches haben. Da sie diese bekanntlich nicht haben, weiss man, dass sie
keine Fische sind. Bei dem zweiten Fragetyp ist dies anders, wie beispielhaft
die Frage Sind Blumen Geschenke? zeigen kann. Diese Frage wird nämlich
nicht mit Eigenschaften von Blumen beantwortet; das wäre ganz abwegig. Ein
Gegenstand wird ausschliesslich durch die Erfüllung einer bestimmten
Funktion zu einem Geschenk. Deshalb muss untersucht werden, was mit
konkreten Blumen gemacht wurde, um wissen zu können, ob diese Blumen ein
Geschenk sind.77
Ce passage me semble fondamental parce que c’est bien là que Lambert Wiesing
exprime peut-être pour la première fois la distinction fondamentale qui existe selon
lui entre ce que quelque chose est et ce qu’après coup on peut faire de cet être.78 Mais
ce passage me semble également assez passionnant parce qu’il fait assez directement
écho à ce que nous disions de l’éventuel essentialisme wiesingien.
Rapidement : nous avons vu plus haut que, selon Aristote, il n’y a que les êtres
naturels (les plantes, les animaux, etc.) qui détiennent une essence. Nous en avons
conclu que, selon Aristote, un être artificiel (un artefact) tel qu’un marteau ou tel
qu’une image ne pouvaient pas avoir d’essence ; ils auront par contre une utilité, ils
auront une finalité. Ce qui revient à dire que l’on ne se posera pas, au sujet de tels
objets artificiels, la question de savoir : « qu’est-ce que c’est ? », on se demandera
plutôt : « à quoi cela sert-il ? », « qu’est-ce que cela permet-il de faire ? ». Or il me
semble assez frappant que cette distinction peut sembler très proche de ce que nous
dit Wiesing ici à propos des fleurs et des dauphins. Dans les deux cas, il s’agit en
deux mots d’opérer une distinction entre ce qu’est une chose et ce à quoi elle peut
servir. Mais alors quelle est la différence dans la manière dont ces deux distinctions
sont posées ? Elle est simplement que Wiesing souhaite la rendre opérante également
77
« Si l’on désire traiter de la question de savoir si les images sont des signes ou non, alors la
distinction suivante est importante : il y a d’un côté les questions auxquelles on apporte des
réponses en exprimant des propriétés ; et il y a de l’autre les questions auxquelles on répond
en déterminant des fonctions. Un exemple emblématique pour le premier cas pourrait être les
dauphins sont-ils des poissons ? On répondra à cette question uniquement en détectant des
[ou : en prouvant l’existence de] propriétés empiriques déterminées ; les dauphins doivent
être étudiés biologiquement afin de dire s’ils ont oui ou non les propriétés d’un poisson. Vu
qu’ils n’ont, comme chacun sait, pas ces propriétés, on sait qu’ils ne sont pas des poissons.
Dans le deuxième type de question c’est différent, comme le montre de manière exemplaire la
question les fleurs sont-elles des cadeaux ? On ne répondra en effet pas à une telle question
en donnant les propriétés des fleurs, ce serait tout-à-fait absurde. Un objet n’est un cadeau
qu’à condition de remplir une certaine fonction. C’est pourquoi, pour savoir si ces fleurs sont
un cadeau, on devra plutôt observer ce que l’on a concrètement fait de ces fleurs. » (Lambert
Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 37.)
78
C’est là une idée à laquelle nous réfèrerons plus tard par l’abréviation de DF1 (comme
Distinction Fondamentale 1), selon laquelle : ce qu’est une chose est radicalement différent
de ce à quoi elle peut servir.
35
�afin de parler d’images. Il désire en effet distinguer, dans l’image, ce qu’elle est de ce
à quoi elle peut servir, son être de son usage, ses propriétés des ses fonctions
possibles. Or on peut, me semble-t-il, déduire de cette observation deux choses
possibles. Soit, et premièrement, on peut estimer que Wiesing entretient là
simplement une certaine confusion entre deux genres de choses : les êtres naturels, qui
ont une essence et une définition, et les artefacts, qui en sont privés – et un élément
qui me semble clairement aller dans ce sens c’est le fait que pour exemplifier la
différence qui existe entre les propriétés et les fonctions d’une image, Wiesing fait ici
intervenir exclusivement des choses appartenant au domaine de la nature : ce sont les
dauphins et les fleurs. Ou alors, et deuxièmement, on peut aussi (et c’est ce que je
ferai par la suite) tenter de montrer en quoi Wiesing, s’il semble, dans AP, partir
d’une perspective essentialiste afin de poser son problème, s’en détache en fait dans
une mesure qui reste à déterminer, pour finalement ne proposer plus qu’une
conception strictement phénoménologique de l’image, dans laquelle il s’agit non pas
véritablement du concept d’image, ni de sa catégorie, ni de sa définition abstraite
(comme pourrait au contraire nous le faire croire le premier chapitre d’AP), mais de
ce à quoi elle correspond en tant que phénomène déterminé dans un cadre déterminé.
Ce n’est toutefois qu’à la fin de la troisième partie de ce travail, et donc après un
itinéraire considérable, que l’on en arrivera au sens plus précis cette idée que je ne
fais ici que trop rapidement esquisser. Car avant d’en arriver là, il nous reste encore
plusieurs choses à voir, à commencer par le deuxième problème que repère, à
l’intérieur de l’approche sémiotique de l’image, Lambert Wiesing.
Wiesing formule sa deuxième critique de l’approche sémiotique goodmanienne en
la basant plus précisément sur un des exemples qu’utilise Goodman et que l’on a déjà
exposé : c’est celui de l’image de château. Par cet exemple, comme on l’a vu,
Goodman entend montrer qu’une image ressemble en fait plus à n’importe quelle
autre image qu’à un véritable château et que donc l’image ne ressemble en fait pas
particulièrement à ce qu’elle représente. Or qu’est-ce qui permet en fait à Goodman,
selon Wiesing, de défendre cela ? C’est le fait, nous dit Wiesing, que celui-ci réduise
dans cet exemple, et sans vraiment le dire, l’image à son support matériel. En effet,
un cadre en bois à l’intérieur duquel on aura fixé une toile en lin ressemble plus à
n’importe quel autre cadre en bois (de plus ou moins même taille) dans lequel on aura
fixé une toile en lin – qu’à un véritable château.79 Mais, ajoute Wiesing, l’image de
château « elle-même », c’est-à-dire ce que je vois « dans » l’image, ce que je vois
lorsque précisément je regarde l’image (et non son support), ressemble-t-elle
effectivement plus à n’importe quelle autre image (par exemple à La Joconde) qu’au
château réel duquel elle s’inspire ? Rien ne semble moins sûr. C’est donc que
Goodman, écrit Wiesing, confond ici « l’objet dans l’image », ou encore « ce que je
vois lorsque je vois une image » et son support matériel. Selon Wiesing, Goodman
entretient ainsi (consciemment ou non) une confusion entre le support matériel de
l’image et l’image « dans » l’image. Il opère une forme de « réduction matérialiste »
(l’expression est de moi) de l’image à son seul support. Cela car, insiste Wiesing,
79
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 48.
36
�quand je regarde une image de château, je ne regarde pas le cadre du tableau, je ne
regarde pas même des taches de couleurs ou de simples traits ou encore un ensemble
de formes : je regarde bel et bien une image. Mais alors quelle est la nature, selon
Wiesing, de « ce que je vois quand je vois une image », la spécificité de ce qu’il y a
« dans » une image ? C’est précisément à ces questions que tente de répondre
l’approche phénoménologique de l’image.
37
�7. La phénoménologique de l’image
7. 1. Le genus de l’image d’un point de vue phénoménologique
Nous avons commencé par voir ici pourquoi toute connaissance scientifique à propos
des images en général nécessitait une définition du concept d’image, c’est-à-dire une
philosophie de l’image. Nous avons ensuite présenté deux premières approches
philosophiques candidates à ce statut de philosophie de l’image. Nous avons alors
rapidement vu pourquoi, selon Wiesing, toute deux échouaient à donner une bonne
définition de l’image. Toutes deux semblaient en effet placer dès le départ l’image
dans la mauvaise catégorie (soit dans la catégorie des artefacts, soit dans la catégorie
des signes), pour ensuite lui attribuer diverses caractéristiques qui ne semblaient pas
vraiment mettre en lumière la spécificité de l’image, ni ce que Wiesing appelle les «
propriétés de l’image ». Mais alors comment s’y prend la phénoménologie, selon
Wiesing, pour réussir là où les autres ont échoué ? Comment l’approche
phénoménologique nous donne-telle accès à ces propriétés de l’image et que sontelles ? Pour répondre à ces interrogations, procédons ici de la même manière que nous
l’avons fait dans les cas précédents, c’est-à-dire en commençant par nous poser la
question suivante : quel est le genus de l’image d’un point de vue phénoménologique
? À quelle catégorie de choses appartient l’image selon la phénoménologie que
défend Wiesing (ou encore, selon l’approche « perceptivo-théorique ») ?
Elle appartient à la catégorie des choses visibles. C’est-à-dire que l’approche
phénoménologique ne considère pas l’image avant tout comme un artefact, ni ne la
traite comme quelque chose qui serait nécessairement un signe (ni non plus comme un
simple objet matériel), mais comme une chose que l’on voit. En effet :
Demgegenüber baut der wahrnehmungstheoretische Ansatz auf dem
Gedanken auf, dass alle Bilder zuerst einmal sichtbare Gegenstände sind.80
Or cela peut à nouveau sembler trivial : l’image, c’est quelque chose de visible,
c’est un objet visible. Mais cela pourrait même sembler, pour ainsi dire, encore plus
trivial (et donc peut-être encore un peu plus indubitable) que ce que l’on a vu
jusqu’ici à propos des images en général car si l’on peut, me semble-t-il, assez
facilement concevoir une image qui ne réfère à rien (et qui ne soit donc pas un
signe),81 tout comme on peut concevoir qu’un grand singe soit peut-être un jour
capable de produire une image sans que cela ne fasse de lui l’équivalent d’un
humain,82 il semble toutefois impossible (ou profondément paradoxal) de concevoir
80
« En revanche, l’approche perceptivo-théorique [ou : phénoménologique] de l’image part
de l’idée selon laquelle les images sont avant tout des objets visibles. » (Lambert Wiesing,
Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 18.)
81
Il suffit pour se faire une idée de ce problème de considérer le cas de l’art abstrait.
82
Fait assez amusant (ou sinistre, c’est selon), on trouve sur internet des vidéos d’animaux
qui peignent, principalement des éléphants. Il suffit, pour les trouver, de taper elephant
painting dans la barre de recherche de son navigateur. Mais il n’est pas évident de savoir ce
38
�une image que l’on ne puisse pas voir, une image invisible. Il semble ainsi
convaincant de poser ici, avec Wiesing, la thèse selon laquelle (et c’est AP1 comme
Approche Phénoménologique 1) : l’image est nécessairement quelque chose de
visible. Or que dit de plus, et à partir de cette thèse finalement assez banale, la
phénoménologie de Wiesing ? Elle dit tout d’abord, de manière plutôt implicite, deux
choses qu’il me semble valoir la peine de brièvement expliciter ici.
Elle détermine premièrement par là comme n’appartenant pas à la catégorie image
proprement dite tout ce que l’on n’aura que imaginé, que pensé, que conçut, etc. Un
peu comme l’approche anthropologique et l’approche sémiotique avant elle,
l’approche phénoménologique ne s’intéresse au départ pas vraiment aux images
purement mentales ou à l’imagination stricto sensu. Elle s’intéresse avant tout aux
images visibles.83
Or elle dit aussi, de manière plutôt implicite, une deuxième chose quant à la
manière dont Wiesing élabore son concept d’image, qui est que ce concept n’intégrera
pas non plus ce que l’on peut appeler les « images sonores », les « images verbales »,
les métaphores, etc. Wiesing s’intéresse aux images visibles, donc aux tableaux, donc
aux photographies, donc aux films, aux dessins – pas aux « images poétiques », ni aux
« images auditives », voire « musicales », ou encore « olfactives » (quelque soit
d’ailleurs ce que l’on entend plus précisément par là).84 Mais maintenant, et en plus
de ce que l’on a présenté ici plutôt à titre de limitations catégoriques, que défend plus
positivement l’approche phénoménologique quant à la visibilité de l’image ? Qu’estce c’est au juste que l’on voit, quand on voit une image ?
7. 2. Les trois sens du mot « image »
Pour répondre à ces questions, Wiesing commence, dans la courte partie qu’il
consacre explicitement à définir l’approche phénoménologique de l’image dans AP,
encore une fois par opérer une tripartition conceptuelle. Cette tripartition est cette fois
opérée entre ce qu’il appellera les trois sens du mot image (drei Bedeutungen von
que nous disent de telles images. L’animal détient-il effectivement une représentation dans
son esprit, qu’il imprime ensuite sur la toile ? Ou cette prouesse n’est-elle que le fruit du
dressage de l’animal ?
83
Il vaut toutefois peut-être la peine de nuancer un peu cette première remarque, car le fait de
concevoir, comme le fait l’approche phénoménologique, l’image comme quelque chose de
toujours visible, c’est-à-dire comme quelque chose de toujours perceptible, et donc en fin de
compte comme quelque chose qui dépend toujours d’un certain « accès subjectif » à elle (on
aura à expliquer mieux, dans la deuxième partie de ce travail, ce que l’on entend par là), c’est
une idée qui me semble la rapprocher d’une entité mentale. Pour le dire en deux mots ici : il
s’agit, dans la perspective phénoménologique, de parler de l’image telle qu’elle m’apparaît.
84
On peut cependant également nuancer un peu cette deuxième remarque car l’image comme
visibilité telle que l’entend Wiesing n’est toutefois pas sans entretenir un certain rapport avec
les type d’images qui font appel à d’autres sens qu’à la vue. Toutes semblent en effet
impliquer un rapport particulier à ce que l’on pourrait appeler la « quasi-présence » de l’objet
perçu : toutes semblent impliquer que l’objet de la perception ne soit, d’une certaine manière
(on y reviendra dans le détail) « pas réellement là ».
39
�„Bild“)85 ou les trois « couches dans la structure ontologique de l’image » (Schichten
in der ontologischen Struktur des Bildes) 86 ou encore, et plus simplement : les trois
aspects (Aspekte) de l’image. 87 Il les nommes ainsi das Darstellendes, die
Darstellung, et das Dargestelltes, termes que l’on peut traduire en français par le
représentant, la représentation et le représenté. Mais que signifie ces termes ?
Le premier, c’est-à-dire le représentant (ou Darstellendes), nous dit Wiesing, c’est
le support matériel sur lequel on voit une image : c’est par exemple un bout de papier,
un cadre, un écran, etc. Alors que la représentation (ou Darstellung), pour Wiesing,
c’est ce que nous avons appelé plus tôt l’image « dans » l’image, l’image « en tant
qu’image » : c’est la représentation à part entière comme objet visible de notre
perception. Là où le représenté (ou Dargestelltes), écrit Wiesing, c’est la chose
réellement existante à laquelle une image peut référer : c’est par exemple un château
réel auquel référerait un tableau, ou encore un individu que l’on aurait photographié.
Mais qu’est-ce qui justifie une telle distinction entre ces divers éléments de l’image et
que permet-elle de penser ?
Une première chose qui justifie cette distinction c’est, me semble-t-il, un certain
soucis de clarté qui peut sembler le bienvenu à ce stade de ce travail. Le fait est que
nous avons peut-être parlé jusqu’ici de manière relativement confuse des images,
mélangeant ces diverses couches dans la structure ontologique de l’image ainsi que
ces différents sens du mot image. Nous avons eu tendance à parler assez
indistinctement de l’image en tant que support à la représentation, en tant que
représentation « tout court » et en tant que chose réelle représentée dans une image.
C’est peut-être même ce rapport un peu confus aux différentes composantes de
l’image qui est à l’origine de certains des problèmes que l’on vient juste de repérer
dans les approches anthropologiques et sémiotiques de l’image, qui semblent toutes
deux avoir tendance à réduire l’image à un seul et unique objet sans forcément faire
attention au fait que ce que l’on voit, quand on voit une image, ce n’est ni l’objet réel
auquel celle-ci peut référer, ni le support matériel réel sur lequel on voit quelque
chose, mais c’est bien ce « quelque chose » lui-même. Il peut ainsi s’avérer approprié
de commencer par soigneusement distinguer ces trois aspects de l’image.
Mais ce qui justifie aussi (et principalement) cette distinction, c’est le fait qu’elle
détienne son origine dans la tradition philosophique phénoménologique. En effet,
Wiesing n’invente pas cette tripartition puisqu’elle s’inspire directement de celle
qu’élabore celui que l’on a pris l’habitude de désigner comme « le père de la
phénoménologie » : Edmund Husserl. C’est-à-dire qu’elle recoupe très exactement,
comme le montre Wiesing, la tripartition proposée par Husserl à propos des images
dans ses Recherches logiques de 1901 entre der Bildträger, c’est-à-dire das
Darstellendes, c’est-à-dire le support matériel de l’image ; das Bildobjekt, c’est-à-dire
die Darstellung, c’est-à-dire l’image en tant que visibilité ; et der Bildsujet, c’est-à-
85
C’est le titre d’une partie du troisième chapitre d’AP, voir : Lambert Wiesing, Artifizielle
Präsenz, op. cit., p. 44-47.
86
Wiesing emprunte en fait cette expression à Hans Jonas, voir : Ibid., p. 27.
87
Ibid., p. 46.
40
�dire das Dargestelltes, c’est-à-dire la chose concrète et existante représentée.88 Mais
alors, et au-delà de ces justifications, qu’est-ce que cela apporte-t-il d’opérer cette
tripartition originairement phénoménologique ?
Cela n’a pas comme intérêt majeur (j’espère que l’on l’aura pressenti) de dégager le
statut à part entière de l’image comme support matériel, comme Bildträger. Cela n’a
pas non plus pour principal mérite de permettre de penser la chose réelle à laquelle
une image peut représenter, en tant que Bildsujet. Cela a avant tout pour fonction
d’introduire cette notion centrale à l’ensemble du travail Wiesing de Bildobjekt,
d’objet-image, d’objet-de-l’image – concept totalement absent de la sémiotique et de
l’anthropologie de l’image tels que nous les avons présentés jusqu’ici. Car s’il arrive
aux sémioticiens et aux anthropologues de l’image de parler de l’image en tant que
signe, ou en tant qu’artefact, ou en tant qu’objet matériel, ou encore de ce que l’on
peut voir dans une image, jamais toutefois elles n’évoquent clairement l’existence ni
les propriétés de cette entité distincte qu’est la représentation « elle-même », c’est-àdire qui est précisément ce que l’on voit lorsque l’on voit une image. Comme le
remarque Wiesing à propos du travail de Husserl :
Entscheidend ist sein Vorschlag, wie die im Bild sichtbar erscheinende
Darstellung genannt werden sollte: Husserl spricht seit 1901 von
„Bildobjekt“ – und dies ist ein dezidiert anti-semiotischer Gegenbegriff.89
Or plutôt que de nous attarder sur les raisons précises qui font que ce concept est
« anti-sémiotique »90 demandons-nous maintenant plutôt la chose suivante : qu’est-ce
exactement qu’un Bildobjekt selon Wiesing ? Nous avons dit successivement que le
Bildobjekt, c’est la représentation visible elle-même, que c’est ce que l’on voit lorsque
l’on voit une image, mais aussi que c’est l’image en tant qu’image ou encore l’image
dans l’image. Or ces formulations peuvent sembler un peu redondantes. Comment
être à la fois plus précis et plus informatif ?
En commençant par insister sur le fait que cet objet-image, étant une visibilité, ne
prend de sens et n’a d’existence que dans une démarche phénoménologique. En effet,
ce n’est pas par hasard ni simplement par mégarde si la sémiotique et l’anthropologie
88
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 30. Wiesing donne la sur Husserl la
référence suivante : Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, Bd. 2/1 : Untersuchungen
zur Phänomenologie und Theorie des Erkenntnis (1901), in : Husserliana, Bd. XIX/I, U.
Panzer (éd.), Den Haag / Boston / Lancaster : Martinus Nijhoff Publishers, 1984, V.
Untersuchung, Beilage zu den §§ II und 20, p. 438.
89
« La proposition faite par Husserl de nommer, dès 1901, la représentation visible
apparaissant dans l’image comme un "objet-image" est décisive – et ce concept est
décidément anti-sémiotique. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 30)
90
Toute une partie d’AP porte précisément sur les raisons pour lesquelles la phénoménologie
de l’image est un peu une « anti-sémiotique de l’image », voir : Ibid., p. 33-36 ainsi que tout
le chapitre intitulé : « Quand les images sont des signes : l’objet-image comme signifiant »
(Wenn Bilder Zeichen sind : das Bildobjekt als Signifikant) (Ibid., p. 37-80.) Mais Wiesing
espère en même temps, on le verra, fonder quelque chose comme une phénoménologie
sémiotique de l’image (phänomenologische Semiotik des Bildes) (Ibid. p. 51.) Le rapport
entre phénoménologie et sémiotique de l’image n’est donc pas de simple opposition.
41
�de l’image passent « à côté » du Bildobjekt mais c’est parce que celui-ci n’est bel et
bien que visible, n’est que perceptible – c’est-à-dire qu’il n’a d’existence que
phénoménale. Comme le dit Wiesing :
Das Bildobjekt ist deshalb immer ein Objekt für jemanden; man kann sagen:
Es ist ein Phänomen im Bild.91
L’objet-image ne peut être l’objet que d’une approche qui prend la peine de distinguer
la réalité phénoménale de l’image : il ne peut être l’objet que de la phénoménologie.92
Mais alors qu’est-ce exactement que la phénoménologie ? Comment décrit-elle ses
objets ? Et en quoi le phénomène qu’est la perception d’une image se distingue-t-il
d’autres phénomènes ? Répondre à ces questions constitue l’enjeu majeur de toute la
suite de ce travail. Or on peut déjà donner ici, de manière préliminaire, deux réponses
à ces questions dont il s’agira dans les parties suivantes de mieux explorer les raisons
et les implications précises.
7. 3. Les deux propriétés de l’image
La première de ces réponses consiste, en deux mots, à dire que cet objet-image n’a
pas seulement pour propriété d’être visible, mais a plutôt pour propriété et pour
particularité d’être seulement visible. En effet, remarque Wiesing, lorsque je regarde
une image (et non son cadre, ni ce à quoi elle réfère), je ne la vois pas de la même
manière que n’importe quel objet visible normal qui m’entoure et cela pour une raison
simple qui est que l’image, je ne fais que la voir, je ne peux que la voir : elle est donc
une pure visibilité. Or il s’agit là de ce que je propose d’appeler par la suite la
première thèse centrale de Wiesing à propos de l’image en général (c’est TC1 comme
Thèse Centrale 1)93 : l’image est une pure visibilité. Thèse que Wiesing exprime pour
la première fois dans AP lorsqu’il écrit, en parlant cette fois de la production d’une
image de maison, que :
Wer ein Bild herstellt, schafft nicht ein Zeichen, sondern eine besondere Art
von Gegenstand: ein Bildobjekt, ein imaginäres Haus – oder wie Fiedler
91
« C’est pourquoi l’objet-image est toujours un objet pour quelqu’un ; on peut dire : c’est un
phénomène dans l’image. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 31.)
92
Wiesing qualifie ainsi le Bildobjekt principalement de phénomène, mais régulièrement
aussi d’apparition (Erscheinung), une fois également d’Anschauung (Ibid., p. 36.), terme
difficilement traduisible mais qui me semble proche dans ce contexte de celui d’intuition.
Toutes des choses sur lesquelles ne porte pas la sémiotique, ni l’anthropologie, mais qui
constituent bien l’objet traditionnel de la phénoménologie.
93
J’opte ici pour l’expression de « thèse centrale » parce que Wiesing revient régulièrement à
celle-ci dans ses ouvrages postérieurs, mais aussi parce qu’il tentera, comme on va le voir, de
mieux les fonder, et parce qu’il en tirera plusieurs conséquences. Elles sont donc dans
plusieurs sens « au centre » de sa réflexion sur les images.
42
�sagen würde: ein „Sichtbarkeitsgebilde“. Er schafft ein nursichtbares Haus,
einen Gegenstand aus reiner Sichtbarkeit.94
Mais alors en quel sens est employé ici ce terme de « pur » ? Et que signifie
exactement, pour Wiesing, que d’être visible ? Qu’est-ce qui est visible et qu’est-ce
qui ne l’est pas ? Enfin, en quoi quelque chose qui n’est que visible ne peut-il pas être
un signe ? Répondre à ces questions constitue l’enjeu de la troisième partie de ce
travail. On peut toutefois encore citer ici un passage du troisième chapitre d’AP qui
donne l’une des raisons les plus simples et les plus convaincantes de défendre que
l’image est une pure visibilité, c’est celui où Wiesing écrit :
Es [das Bildobjekt] erscheint dem Betrachter in seiner Art der Existenz nicht
wie eine reale Sache, weil es ausschliesslich sichtbar ist, aber nicht gehört,
gerochen, getastet oder geschmeckt werden kann.95
L’image est une pure visibilité parce que contrairement à ce qu’il se passe lorsque je
perçois habituellement des objets, le seul sens au travers duquel je peux percevoir une
image, c’est la vue. Je ne peux ni entendre une image, ni la sentir, ni la toucher, ni la
prendre, ni la goûter : elle n’est donc que visible, elle est purement visible. Mais
Wiesing dit encore une autre chose dans ce passage, qui est que cela fait du Bildobjekt
quelque chose qui n’apparaît pas au spectateur comme une chose réelle. Pourquoi
cela ?
Parce que, et c’est là la deuxième thèse centrale de Wiesing (c’est TC2 comme
Thèse Centrale 2), selon lui : l’image est une présence artificielle. C’est-à-dire que
selon Wiesing (à nouveau en deux mots), l’image n’est pas réelle, elle n’a pas de
substance, elle n’est pas non plus présente à moi au même titre que le sont les objets
normaux de ma perception, elle m’est donc présente de manière artificielle. Comme
l’écrit Wiesing :
Der Begriff der realen Präsenz spezifiziert die Präsenz auf die weltliche Art
einer Gegenwärtigkeit mit substantieller Anwesenheit, weshalb es auch eine
nicht reale, eine artifizielle Präsenz geben kann. Denn Bilder sind keine
Fenster, aber ihre besondere Weise des Zeigens lässt sich doch durch
Vergleiche mit anderen Weisen des Zeigens näher beschreiben. Im Gegensatz
94
« Celui qui produit une image ne crée pas un signe mais une sorte particulière d’objet : un
objet-image, une maison imaginaire – ou comme dirait Fiedler : une "structure de visibilité".
Il crée une maison seulement visible, un objet fait de pure visibilité. » (Lambert Wiesing,
Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 31.) Sur Konrad Fiedler, Wiesing donne ici la référence
suivante : Konrad Fiedler, Vom Ursprung der künstlerischen Tätigkeit (1887), in : Schriften
zur Kunst, Bd. I, G. Boehm (éd.), München : Wilhelm Fink, 1991, p. 192.
95
« Il [l’objet-image] apparaît au spectateur dans sa manière d’exister non comme une chose
réelle puisqu’il est seulement visible mais ne peut pas être entendu, ni senti, ni touché, ni
goûté. » (Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 70.)
43
�zu Schaufenstern präsentieren Bilder Dinge, die keine realen Dinge sind
[...].96
Or sans entrer tout-de-suite dans un commentaire plus approfondi de ce passage,
cette idée me semble reposer dans AP en partie sur un argument précis qui vaut
encore la peine d’être rapidement évoqué ici. C’est l’argument selon lequel l’image
est artificielle parce qu’elle n’obéit pas aux lois de la physique. En effet, Wiesing
écrit également dans AP que :
Bilder zeigen prinzipiell immer etwas Unwirkliches, denn sie zeigen immer
etwas, was nicht älter wird; sie zeigen immer etwas, was der Physik enthoben
ist. Hingegen könnte man ohne Bilder nur Dinge sehen, die den Gesetzen der
Physik unterliegen. Deshalb eröffnet das Bildmedium eine Welt neuer
sichtbarer Dinge: Es wird etwas sichtbar, das sich nicht nach den Gesetzen
verhält, welche die Physik beschreibt; jedes Bild erlaubt den Blick in eine
physikfreie Zone.97
Une maison réelle obéit aux lois de la physique : si je détruis les murs de cette
maison, elle s’écroulera, obéissant de la sorte à ces mêmes lois. Or je peux peindre
une image de maison sans murs, une image de maison qui flotte, de même qu’il peut y
avoir une tempête dans l’espace où se trouve le support matériel de cette image de
maison – le toi de la maison dans l’image ne s’envolera pas pour autant. C’est donc
que les objets-images n’obéissent pas aux lois de la physique et ne se trouvent pas à
proprement parler dans le même monde que moi mais dans une zone libérée de la
physique.
Mais alors qu’est-ce plus exactement, pour Wiesing, que « la physique » ? Ce
dernier me semble utiliser dans AP de manière vaguement synonyme les termes
« physique » (Physik), « physiologique » (physiologisch), « matériel » (materiel),
« réel » (real), « substantiel » (substanziell), « causal » (kausal), ainsi que cet attribut
d’être « dans le monde » (innerweltlich) ; termes qu’il oppose alors à ce qualificatif
d’« artificiel », mais aussi à « a-physique » (physiklos), « immatériel » (stofflos),
96
« Le concept de présence réelle spécifie à un niveau mondain la manière d’être d’une
contemporanéité avec substantialité, et c’est pourquoi il peut aussi exister une présence non
réelle, artificielle. Car les images ne sont pas des fenêtres mais la manière dont elles montrent
se laisse décrire de plus près grâce à cette comparaison. Au contraire de vitrines, les images
présentent des choses qui ne sont pas des choses réelles. » (Lambert Wiesing, Artifizielle
Präsenz, op. cit., p. 31-32.)
97
« Les images montrent par principe toujours quelque chose d’irréel, qui ne vieillit pas ;
elles montrent toujours quelque chose qui échappe à la physique. En revanche, sans images
on ne pourrait voir que des choses qui obéissent aux lois de la physique. C’est pourquoi le
medium de l’image ouvre un monde de nouvelles choses visibles : quelque chose devient
ainsi visible qui n’obéit pas aux lois que décrit la physique ; chaque image rend possible un
regard dans une zone libérée de la physique. » (Ibid., p. 69.)
44
�« incorporel » (entkörperlichte), imaginaire (imaginär).98 Comment distinguer mieux
le sens de tous ces termes apparemment opposés et réussir ainsi à poser plus
clairement la distinction que semble opérer Wiesing dans AP entre « êtres réels » et
« êtres artificiels » ? Et comment trouver un fondement sur lequel cette distinction
s’appuierait de manière stable ? En se plongeant dans Das Mich der Wahrnehmung.
98
Tous ces termes se trouvent ainsi opposés dans un passage clé d’AP qui porte précisément
sur la notion de présence artificielle, voir : Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p.
30-33.
45
�II. Qu’est-ce qu’une présence artificielle ?
Das Mich der Wahrnehmung
1. Présentation de Das Mich der Wahrnehmung
1. 1. La notion de présence artificielle dans l’œuvre de Wiesing
Lambert Wiesing emploie pour la première fois en 2004 l’expression de présence
artificielle afin de caractériser l’image. Cela dans un article intitulé « Philosophie des
médias de l’image » (Medienphilosophie des Bildes) qu’il retravaillera et intégrera
ensuite dans l’ouvrage de 2005 auquel nous avons consacré la première partie de ce
travail, intitulé justement Artifizielle Präsenz. Cet article sera donc désormais un
chapitre d’AP, intitulé cette fois : « Les courants principaux de la philosophie de
l’image contemporaine » (Die Hauptströmungen der gegenwärtigen Philosophie des
Bildes).99 Mais que signifie au juste cette notion de « présence artificielle » et quelle
propriété de l’image en général désigne-t-elle exactement ? Au moins trois raisons
justifient, me semble-t-il, le fait que l’on aille maintenant chercher une réponse plus
approfondie à cette question non pas en poursuivant notre lecture d’AP, mais en se
plongeant dans un ouvrage postérieur de Wiesing, qui s’intitule Das Mich der
Wahrnehmung.100
Premièrement, la raison la plus évidente (que nous avons déjà évoquée à la page 8),
c’est qu’Artifizielle Präsenz est un ouvrage relativement court, composé de chapitres
qui portent tous sur les images mais dont les thématiques précises sont diverses, et
dans lequel seul les chapitres deux et trois portent (entre autres) sur cette notion de
présence artificielle. Il me semble ainsi ne pas se trouver dans AP l’entièreté du
raisonnement menant à cette idée que l’image présente au spectateur quelque chose
d’artificiel, mais plutôt l’expression d’une intuition dont Wiesing développera toutes
les raisons et les conséquences plus tard, entre autres dans Das Mich der
Wahrnehmung.
Deuxièmement, l’approche phénoménologique de l’image telle que présentée dans
AP propose en fait, comme on vient de le voir, deux thèses centrales sur l’image : la
première résidant dans cette idée selon laquelle l’image est une présence artificielle et
la deuxième dans cette idée selon laquelle l’image serait aussi une pure visibilité. Or
quel lien y-a-t-il entre ces deux thèses ? Wiesing ne propose pas réellement de
hiérarchie ou d’articulation précise entre ces deux thèses dans AP : il faut donc aller
les chercher ailleurs.
Troisièmement, Wiesing emploie, toujours dans AP, un argument crucial pour
défendre cette idée de présence artificielle de l’image : celui que l’on a déjà esquissé,
selon lequel l’image n’est pas soumise aux lois de la physique, ce qui ferait d’elle
quelque chose d’artificiellement présent. Mais à nouveau, cet argument est énoncé
99
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 17-36.
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit.
100
46
�dans AP sans vraiment que Wiesing n’en approfondisse la nature ni ne développe ce
qu’il entend exactement par « la physique ». Comment combler ce manque ?
En lisant maintenant Das Mich der Wahrnehmung (dorénavant MW), ouvrage dans
lequel il faudra tenter d’aller chercher, tout d’abord, une théorie de la présence, puis
une description plus précise de ce qu’est une présence artificielle, et enfin des
explications en ce qui concerne ce lien particulier que Wiesing observe entre présence
artificielle et libération du dictat de la physique. Toutefois, et avant d’entrer plus
précisément dans cette théorie « wiesingienne » de la présence, commençons ici par
tenter de répondre à la question introductive suivante : quels sont les enjeux propres à
MW ? Quel est, en deux mots, le projet de Wiesing dans MW ?
1. 2. Fonder la philosophie (de l’image)
L’ouvrage de 2009 me semble détenir un premier but clair pour : il s’agit avant tout
pour Wiesing d’y fonder de manière absolue sa pensée. Cela pourrait passer pour un
projet un peu démesuré mais le fait est que Wiesing, dans ce livre, désire proposer une
véritable fondation à la connaissance philosophique en général, qui lui permette
ensuite d’élaborer sur cette fondation. Wiesing désire commencer par trouver, dans
MW, comme il le dit lui-même, un fundamentum inconcussum (expression
originairement cartésienne que l’on pourrait traduire en français par : fondement
inébranlable). Fondement qu’il repérera, on le verra, dans la réalité de la perception,
plus précisément dans la certitude de l’existence de ma perception.
Mais ce premier objectif (le plus apparent) est lié selon moi à un autre objectif,
peut-être moins évident à premier abord, qui est de fonder par là non seulement sa
philosophie en général, puis sa philosophie de la perception, mais aussi sa philosophie
de l’image. En effet, si sa philosophie de l’image pouvait se fonder sur une
philosophie de la perception qui elle-même se fonderait sur quelque chose de certain
et d’absolu, alors Wiesing aurait fait d’une pierre deux coups : il aurait fondé une
méthode philosophique – c’est sa phénoménologie de la perception – et aurait du
même coup fondé quelques uns des résultats de cette méthode, soit ceux portant sur le
thème de prédilection du travail philosophique de Wiesing : l’image. Il s’agit donc
aussi dans MW, d’appuyer sur un fondement philosophique solide les thèses centrales
sur lesquelles nous concluions la première partie de ce travail (et tout particulièrement
TC2).
Or comment s’y prend Wiesing pour mettre à bien ce vaste projet ? En allant tout
d’abord puiser dans un auteur qui anticipe d’une certaine manière l’approche
phénoménologique traditionnelle : René Descartes. En allant puiser ensuite dans le
père attesté de l’approche phénoménologique (et qui fait lui-même de Descartes un
précurseur à la phénoménologie) : Edmund Husserl.101 Mais avant cela, et tout au
101
Pour plus de détails sur le rapport qu’entretient la phénoménologie de Husserl à Descartes,
voir : Edmund Husserl, Méditations cartésiennes : introduction à la phénoménologie (1929),
Paris : Vrin, 2008. Ouvrage auquel Wiesing fait référence de manière déterminante afin
47
�départ de la réflexion qu’amorce Wiesing dans MW, il propose de distinguer trois
types de connaissances : la connaissance « mythico-modélisante », le connaissance
« méta-médiatique » et la certitude. C’est par cette distinction qu’il nous faut donc
commencer afin de voir alors comment seul ce qu’il appelle la certitude phénoménale
(phänomenale Gewissheit)102 peut servir à fonder sa philosophie de la perception, puis
sa philosophie de l’image, et enfin TC2.
d’opérer par la suite, on le verra, sa critique de Descartes. Voir : Lambert Wiesing, Das Mich
der Wahrnehmung, op. cit., p. 78-82.
102
Ibid., p. 73.
48
�2. Vers une phénoménologie de la perception.
2. 1. Mythes, modèles et médias
Les expressions précédemment énoncées de « connaissance mythico-modélisante » et
« connaissance méta-médiatique » sont de moi. Elles serviront ici d’étiquettes
commodes afin de parvenir à résumer assez brièvement la catégorisation qu’opère
Wiesing en ouverture de MW et d’arriver ainsi plus rapidement au type de
connaissance qui nous intéresse plus particulièrement ici et qui, selon Wiesing, est
absolument certain et doit fonder la connaissance philosophique : la certitude
phénoménale immédiate. Nous pourrions éventuellement décider de passer
directement ici à la nature de cette connaissance certaine, mais vu que celle-ci se
définit également par opposition à la nature de la connaissance mythico-modélisante
et de celle méta-médiatique, il me semble judicieux de commencer par présenter
brièvement celles-ci ici.
Par connaissance mythico-modélisante, je regroupe simplement ce que Wiesing
désigne par les deux expressions de connaissance mythique et de connaissance
modélisante dans le premier chapitre de son livre, intitulé : « Mythes philosophiques
et modèles » (Philosophische Mythen und Modelle).103 En effet, selon Wiesing, ces
deux genres de connaissances (qu’il commence par distinguer l’un de l’autre)104 sont
semblables en ce que tous deux posent un intermédiaire entre moi et le monde : un
mythe ou un modèle. Intermédiaire qui rend alors possible l’acquisition de
connaissances plus ou moins utiles sur le monde. Ainsi, une certaine pensée mythique
peut par exemple (cet exemple est de moi), par la croyance en un certain Dieu,
proposer une explication de ce qu’est la foudre. Ceci tout comme une certaine pensée
scientifique (cet exemple est également de moi) fonctionnant grâce à des modèles, en
optant par exemple pour un modèle de type atomiste, peut proposer une autre
explication de ce même phénomène de la foudre.
Or l’important n’est pas ici pour Wiesing de distinguer le vrai du faux ou le correct
du non-correct, mais de comprendre en quoi il est nécessaire, dans les deux cas,
d’opter pour un mythe ou un modèle afin d’arriver à une connaissance nécessairement
médiate de la réalité. Connaissance qui peut alors s’avérer très utile afin de
comprendre, d’expliquer et de prédire les phénomènes qui nous entourent105 – et
connaissance qui se distingue d’un deuxième genre de connaissance : la connaissance
« méta-médiatique ».
103
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 11-69.
Je me permets de sauter ici la distinction précise que fait Wiesing entre connaissance
s’acquérant par l’intermédiaire d’un mythe et connaissance s’acquérant par l’intermédiaire
d’un modèle car celle-ci n’a, me semble-t-il, pas de conséquences directes en ce qui concerne
sa théorie de l’image. Celle-ci me semble toutefois, sur un plan épistémologique,
passionnante, tout comme l’analyse qu’il fait dans ce chapitre du rôle du « reproche de
mythifier » (Mythenvorwurf) aujourd’hui en philosophie, voir : Ibid., p. 17-20.
105
Verstehen, erklären, vorhersagen : voici en effet les trois fonctions principales, selon
Wiesing, du travail de modélisation propre à la science, voir : Ibid., p. 23.
104
49
�Par connaissance méta-médiatique, j’entends simplement la connaissance qui porte
non sur la réalité au travers du prisme d’un modèle ou d’un mythe, mais qui porte sur
les modèles eux-mêmes. D’où cette épithète « méta » que je me permets d’accoler ici
au mot « médiatique ». Le type de recherches ou d’investigations dont ce genre de
connaissance est le fruit serait selon Wiesing particulièrement à la mode dans tout un
pan de la philosophie au moins depuis Kant : c’est tous ces courants de pensée qui ne
s’intéressent ni directement à la réalité, ni aux choses mêmes, mais plutôt à nos
interprétations des choses et du monde (Wiesing parle d’Interpretationismus)106, ou à
nos représentations de ces mêmes choses (il parle également de
Repräsentationalismus)107, ou encore à ces médias108 prétendus nécessaires entre moi
et le monde, et seuls accessibles. C’est aussi toute l’approche herméneutique et
linguistique en philosophie que vise Wiesing ici, tout comme la pensée prétendument
« postmoderne », celles-ci voyant justement dans le langage, dans le « texte » ou
encore dans des « structures » un intermédiaire nécessaire entre moi et le monde – le
monde demeurant, lui, inconnaissable.109 Ce sont là des approches qui, selon Wiesing,
se rangent ainsi toutes sous un même paradigme de la médiateté nécessaire de la
connaissance, sous un même « paradigme de l’accès » (Paradigma des Zugangs).110
Alors après cette brève esquisse de la catégorisation épistémologique qui ouvre
MW, on devrait être ici en mesure de se demander : en quoi la certitude (Gewissheit)
s’oppose-t-elle, selon Wiesing, à ces deux genres de connaissances, celle qui est le
fruit d’un modèle ou d’un mythe (c’est-à-dire d’un intermédiaire médiatique), et celle
qui est le fruit d’une enquête à propos de ces intermédiaires médiatiques eux-mêmes ?
En ce que la certitude, dans l’acception que lui donne Wiesing, est une connaissance
phénoménale immédiate et certaine ou plutôt : immédiate donc certaine.111
2. 2. Un fondement dans la tradition : Descartes
En s’intéressant à ce qui est immédiat et ce qui est, pour ainsi dire, « directement
certain », unmittelbar,112 il s’agit ainsi, on l’aura compris, de proposer une espèce de
troisième voie, de troisième genre de connaissance qui ne soit ni scientifique, ni
mythique, ni méta-médiatique, ni linguistique, ni structurelle. Il s’agit par là d’opérer
un retour à son expérience phénoménale, c’est-à-dire à sa propre expérience vécue
106
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 43-48.
Ibid., p. 58-61.
108
Wiesing emploie par exemple l’expression de medial turn, voir : Ibid., p. 40.
109
Il comprend également dans cette approche toujours médiate de la connaissance les :
Kantianer und Nietzscheaner, Sprachanalytiker und Hermeneutiker, Dekonstruktivisten und
Strukturalisten. « Kantiens et nietzschéens, analystes de la langues et l’approche
herméneutique, les déconstructivistes et les structuralistes. » (Ibid., p. 41.)
110
Ibid., p. 61-69.
111
Pour résumer encore plus, on pourrait même dire que Wiesing ouvre MW en repérant au
fond une distinction épistémologique fondamentale : celle qui existe selon lui entre la
connaissance médiate et la connaissance phénoménale immédiate.
112
Ibid., p. 74.
107
50
�consciente (bewusste Erlebnisse), 113 ou encore aux données immédiates de sa
conscience114 : il s’agit de revenir à Descartes. Ce faisant, il s’agit de se distinguer
d’une approche scientifique et modélisante, mais aussi de prendre un peu à rebours
tout ce pan de la philosophie qui a aujourd’hui tendance à mettre au centre de ses
préoccupations les médias entre moi et le monde, et de voir (ou de revoir) ainsi avec
Descartes comment et pourquoi certaines connaissances sont immédiates donc
indubitables. Il s’agit de prolonger, aujourd’hui, le geste initié par les Méditations. Or
ce que nous dit Descartes dans sa 2ème méditation, et qui constitue le véritable point de
départ de la démonstration de Wiesing dans MW, c’est qu’il est certain qu’il pense (il
ne peut en douter) et que donc il est certain d’être une chose pensante. Il s’agit alors,
avec Wiesing, et pour fonder sa philosophie, d’affirmer un peu la même chose mais
ceci à trois différences cruciales près que j’évoquerai rapidement.
La première différence (considérable), c’est que là où Descartes voit de la pensée,
Wiesing voit de la perception. En effet, et bien que Wiesing souscrive au parcours
intellectuel proposé par Descartes dans ses Méditations jusqu’au moment de la
formulation du cogito (Wiesing invite même son lecteur à vivre concrètement et de
manière protreptique ces méditations pour lui-même), 115 il y a un pas dans
l’argumentation de Descartes que Wiesing refuse de faire : c’est celui qui fait passer
Descartes d’une définition de la res cogitans grâce une énumération de facultés
différentes, à une autre définition plus stricte et réductrice de la res cogitans comme
pur entendement, comme pure mens.116 Le moment où Wiesing refuse de suivre
Descartes, c’est celui où ce dernier réduit les différentes activités auxquelles semble
indubitablement s’adonner mon esprit à une seule activité ou faculté principale : la
pensée rationnelle. Lambert Wiesing, tout comme Husserl avant lui,117 estime que ce
qui apparaît durant la 2ème méditation, c’est au contraire un faisceau de facultés qui ne
113
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 73.
Je me permets ici cette référence au titre d’un ouvrage célèbre de Henri Bergson pour deux
raisons. À cause d’une remarque de Wiesing, selon laquelle : […] auch der alte Begriff der
Intuition mag treffend sein. « […] le vieux concept d’intuition pourrait aussi être pertinent. »
(Ibid., p. 73.) Et parce que j’estime que le fondement que proposent Wiesing et Bergson à la
connaissance certaine car immédiate est proche. Voir : Henri Bergson, Essais sur les données
immédiates de la conscience (1889), Paris : Presses univ. de France, 1982.
115
La partie que consacre Wiesing à la pratique rhétorique de la protreptique, tout-à-fait
passionnante, est quelque chose que je saute ici avec regret. Elle porte sur la possibilité même
d’exprimer, par le langage, des certitudes immédiates qui a priori ne sont pas verbales. Mais
ayant trop peu de lien avec la théorie de l’image de Wiesing, je me contente ici de renvoyer le
lecteur au texte lui-même, soit : Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p.
82-95.
116
Descartes écrit en effet dans ses Méditations : « Mais qu’est-ce donc que je suis ? Une
chose qui pense. Qu’est-ce qu’une chose qui pense ? C’est-à-dire une chose qui doute, qui
conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. » Soit
dans l’original : Sed quid igitur sum ? Res cogitans. Quid est hoc ? Nempe dubitans,
intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque, & sentiens. (René
Descartes, Méditations métaphysiques (1641), 2ème Méditation, §9, Paris : Presses univ. de
France, 2010, p. 43.)
117
Voir : Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 78.
114
51
�sont nullement réductibles à la seule faculté rationnelle de penser.118 Or si il y a bien
une de ces facultés qui, selon Wiesing, détient un intérêt particulier et semble même
fonder la connaissance, c’est plutôt la faculté de percevoir. Ainsi, s’il fallait formuler
une espèce de « cogito wiesingien », on serait tenté de baptiser celui-ci plutôt par
l’expression de « percipio wiesingien »119 à la base duquel on trouverait l’affirmation
certaine suivante : je perçois.
Toutefois, une deuxième différence importante, et qui devrait nous amener
maintenant à réviser cette formulation un peu hâtive du « je perçois » de Wiesing,
c’est qu’il ne s’agit en fait là, selon lui, justement pas d’une certitude dépendante d’un
sujet, d’un ego, d’un « je », mais plutôt d’une certitude qui m’apparaît, qui implique
donc un « moi » (au genitivus obiectivus)120 ou encore un « me »121 et non un « je ».
D’où le titre de l’ouvrage, qui ne mentionne pas le « je » de la perception mais bien le
mich (que l’on peut traduire en français par « moi » ou par « me ») de la
perception. Or que cela change-t-il ici exactement, de préférer ici le moi au je ? Cela
qu’en formulant le percipio, il s’agit d’éviter d’en conclure trop vite l’existence du
« sujet moderne » avec tout ce que celui-ci implique : l’idée de personne, de raison,
d’esprit, d’âme qui perdure dans le temps, etc.122 Ce qui apparaît comme certain et
immédiat à Wiesing, c’est le fait de l’existence de ma perception – pas que j’existe en
tant que sujet, ou en tant que personne, ou en tant qu’ego rationnel et indépendant.
Ceci inverse donc d’une certaine manière l’équation cartésienne traditionnelle
puisque ce qui est certain, c’est que l’existence de ma perception me fonde comme
sujet de la perception, c’est-à-dire comme sujet dépendant d’une perception, comme
mich der Wahrnehmung – et c’est tout. Autrement dit, le « je » est une conséquence
de la perception, une suite à la perception, et non quelque chose de transcendantal ou
118
Le terme de « faisceau de facultés » me semble bon parce qu’il convient au vocabulaire de
David Hume, dont Wiesing est également un spécialiste, voir son commentaire ici : David
Hume, Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand (1748), Lambert Wiesing (éd.),
Frankfurt am Main : Surkamp, 2007. Le terme générique qui regroupe cependant sous la
plume de Wiesing les différents états mentaux que sont les : Erlebnisse, Gedanken, Wünsche,
Erfahrungen, Imaginationen, Wahrnehmungen, Schmerzen, Hoffnungen, est bien celui de
Phänomene, voir : Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 73.
119
L’expression est de moi.
120
Ibid., p. 120.
121
Pour bien comprendre ce qu’est le genitivus objectivus, on peut ici prendre le même
exemple que Christian Touratier dans sa Grammaire latine, où il compare les deux
expressions metus hostium (la crainte des ennemis) et metus mortis (la crainte de la mort). Car
alors que la première expression peut se comprendre comme référant à la peur que ressentent
les ennemis eux-mêmes en tant que sujet (= génitif subjectif), mais aussi comme référant à la
crainte que l’on peut avoir vis-à-vis de ces ennemis donc cette fois en tant qu’objets d’une
peur (= génitif objectif), la deuxième expression ne peut s’entendre qu’au génitif objectif : la
mort ne peut avoir peur, elle ne peut qu’être l’objet d’une peur. (Christian Touratier,
Grammaire latine, Paris : Armand Collin, 2008, p. 104.) Or c’est dans ce sens particulier que
le « moi » est un objet dépendant d’une perception qui le précède.
122
Par l’expression « sujet moderne », je réfère à la notion de sujet telle qu’élaborée par
exemple chez Locke, mais dont on peut selon Alain de Libera tracer la genèse au moyen-âge,
voir : Alain de Libera, L’invention du sujet moderne, Paris : Vrin, 2005.
52
�d’antérieur à celle-ci.123 Or en disant cela, j’anticipe un peu sur la troisième différence
de Wiesing d’avec Descartes et qui me semble en fait découler de cette deuxième
différence : il ne faut, selon Wiesing, pas déduire trop hâtivement de l’existence de
ma perception l’existence d’une substance mais plutôt l’existence d’une relation.
Cette troisième différence d’avec Descartes prend à nouveau sa source dans cet
entre-deux se situant entre le moment ou Descartes énumère les différentes facultés de
l’âme, qu’il réunit sous le terme encore générique à ce moment là de cogitare, et celui
où il réduit le nombre de ces facultés à une seule. En effet, en faisant cela, Descartes
ne fait pas que réduire l’acte de penser en général à quelque chose de rationnel, il en
fait également une res, une chose, une substance pensante – cela là où Wiesing
compte, lui, éviter de poser l’existence de quelque chose comme une « substance
percevante ». Qu’il y ait ma perception, cela n’implique à aucun moment que « je »
sois alors nécessairement quelque chose comme une substance.124 Cela implique par
contre quelque chose d’autre, qui est que le sujet de la perception existe toujours en
relation à un objet perçu. Autrement dit, il n’y a selon Wiesing pas de fundamentum
inconcussum substantialis (fondement inébranlable à la substance), mais un
fundamentum inconcussum relationalis (fondement inébranlable à la relation) 125 :
fondement dont il s’agit maintenant d’explorer, cette fois grâce à Husserl, la structure
logique.
2. 3. La structure logique de la perception : Husserl
C’est pour cette partie, exposée au chapitre deux de MW, et intitulée «
Phénoménologie : la philosophie sans modèles » (Phänomenologie : die Philosophie
ohne Modell),126 que Wiesing a principalement recours au travail d’Edmund Husserl.
Car partant de cette critique de la connaissance médiate, puis se fondant sur la
certitude de l’existence de ma perception (puisée dans le travail de Descartes), il
s’agit d’acquérir un fondement solide à la connaissance mais aussi, ensuite, d’élaborer
« sur » ce fondement ou plutôt : d’acquérir d’autres connaissances logiquement
conséquentes à ce fondement. Or qu’entendre ici par « logiquement
123
Pour plus de détails à ce sujet, voir : Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op.
cit., p. 115-124.
124
On peut noter ici que, dès la diffusion des Méditations dans les cercles savants, Hobbes
faisait déjà la même critique à Descartes, reprochant non sans ironie à propos du cogito : « Ce
raisonnement ne me semble pas bien déduit de dire je suis pensant, donc, je suis une pensée,
ou bien, je suis intelligent, donc, je suis un entendement. Car de la même façon je pourrais
dire, je suis promenant, donc je suis une promenade. » Voir les : « Réponses aux troisièmes
objections », in : René Descartes, Méditations métaphysiques, op. cit., sur II, 7., p. 186-187.
125
Sur la notion de fundamentum inconcussum, voir : Lambert Wiesing, Das Mich der
Wahrnehmung, op. cit., p. 82-91. On peut encore noter ici que le cas latin de l’expression
fundamentum inconcussum relationalis peut paraître étonnant. En effet, si Wiesing voulait
dire par là « fondement relationnel inébranlable », il devrait plutôt dire (me semble-t-il)
relationale et non relationalis. D’où ce fait que l’expression est mieux traduite par
« fondement inébranlable à la relation ».
126
Ibid., 71-107.
53
�conséquentes » ? 127 Et comment se passe cet enchaînement entre une première
certitude et d’autres certitudes qui lui seraient conséquentes ? Wiesing propose ici
d’avancer en utilisant un outil conceptuel élaboré par Edmund Husserl dans ses
Recherches Logiques : les variations eidétiques.
Faire des variations eidétiques, nous dit Wiesing, qui s’appuie donc lui-même sur le
travail de Husserl, cela consiste à chercher l’invariant dans une chose. Ainsi, effectuer
des variations eidétiques quant à la nature d’une pomme (cet exemple et de moi), c’est
chercher dans notre fantaisie (Phantasie) les différentes manières dont je peux
concevoir une pomme ainsi que les manières dont je ne peux pas la concevoir : je
peux la concevoir rouge, verte, mesurant dix kilomètre de diamètre, douée d’une
conscience – mais je ne peux pas concevoir une pomme non étendue dans l’espace, ou
encore un cercle carré ou encore, pour reprendre un exemple de Spinoza : une mouche
infinie.128 Ainsi, en pratiquant dans mon esprit des variations eidétiques, c’est-à-dire
des variations quant à l’eidos ou à l’idée d’une pomme, il m’est possible d’arriver à
quelque chose d’invariant dans mon idée de pomme, sans quoi celle-ci ne peut être
conçue comme étant encore une pomme. Il m’est ainsi possible, par des variations
eidétiques, de dégager les invariants qui constituent l’essence (au sens husserlien)
d’une chose.129
Or à quels résultats aboutissent maintenant des variations eidétiques quant à la
chose qui nous intéresse ici : quant à ma perception ? Lorsque je considère les
perceptions que j’ai, qu’est-ce qui m’apparaît comme constant, comme nécessaire,
comme proprement invariant ? Quel est l’invariant dans cette certitude déjà établie de
l’existence de ma perception ?
Avant de répondre de manière claire à cette question, il me semble important de
remarquer ici en quoi Wiesing ne propose pas là, par des variations eidétiques, à
proprement parler de « construire » quelque chose « sur » cette certitude qu’est la
perception (comme on a pu le dire plus tôt), mais plutôt de continuer à décrire la
perception. Comme le dit lui-même Wiesing en filant la métaphore d’un fondement
ou d’un sol à la connaissance :
Es geht nicht um eine Nutzung des Bodens, sondern um eine Beschreibung des
Bodens.130
127
Sur la notion de « logique » telle que l’emploit Wiesing dans MW, voir : Lambert Wiesing,
Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 101-107. On peut cependant déjà noter ici, pour
éviter certains malentendus, que la logique telle que l’entendent Husserl et Wiesing n’a pas
grand chose à voir ni avec la logique inductive ni avec la logique déductive.
128
Baruch Spinoza, Tractatus de Intellectus Emendatione (1677), §38, trad. Par Charles
Appuhn, Paris : GF Flammarion, 1964, p. 200.
129
On voit donc ici en quoi il reste pertinent, dans MW, de parler de l’essence d’une chose,
mais dans un sens toutefois différent de ce que signifie ce terme dans son acception
aristotélicienne traditionnelle.
130
« Il ne s’agit pas d’utiliser le sol, mais de le décrire » (Lambert Wiesing, Das Mich der
Wahrnehmung, op. cit., p. 82.)
54
�Or ce détail est important pour au moins deux raisons. Tout d’abord, parce que la
tâche de la (bonne) philosophie, selon Wiesing, c’est justement de décrire la réalité
immédiate : pas de l’interpréter, ni de la comprendre, ni de l’expliquer, ni d’en prédire
le futur, ni d’arriver à la maîtriser, ni même (comme on a peut-être pu le croire dans la
première partie de ce travail) de la définir – juste de la décrire.131 Ensuite, parce qu’en
refusant, pour continuer à filer cette métaphore, de « construire sur » un fondement,
mais en cherchant simplement à explorer les invariants de ce fondement, Wiesing
évite de s’exposer au problème suivant, que rencontrait déjà Descartes et que celui-ci
résolvait en faisant appel à l’existence de Dieu : au nom de quoi ? Je veux dire par là
que même dans le cas où l’on accepterait le fondement que Wiesing propose à la
connaissance, celui-ci étant apparemment circonscrit et limité à une seule affirmation
(son percipio), on pourrait être tenté de faire remarquer à Wiesing que sa certitude,
bien qu’indubitable, est en fait parfaitement inutile et triviale, et qu’elle ne permet pas
d’obtenir d’autres connaissances – ou alors seulement au risque de quitter le sol
certain de cette première connaissance immédiate. Le problème pourrait aussi se
formuler de la sorte : comment passer d’une connaissance apparemment purement
subjective et phénoménale (ma perception), à une connaissance utile et portant sur le
monde sans, en faisant cela, se fonder sur d’autres prémisses que sur cette première
connaissance certaine ?
La réponse de Wiesing est la suivante : en continuant simplement à décrire plus
précisément, par des variations eidétiques, ce fondement déjà établi et sa structure
logique. C’est comme si cette première certitude constituait en fait déjà toute ma
certitude,132 mais qu’il fallait encore essayer, petit-à-petit, de décrire cette certitude
dans ses détails. Pour continuer à filer cette métaphore spatiale, voir géométrique,133 il
ne s’agit donc pas maintenant de construire de manière arbitraire un édifice fragile sur
un fondement solide, mais d’observer simplement plus attentivement ce fondement
afin d’en découvrir la composition, la matière, l’organisation, bref : ce que nous
appelions plus haut la structure logique.134 Ainsi :
Aus der Beschreibung von Phänomenen soll durch die Variation eine Logik
der Phänomene werden.135
131
Il s’agit en effet de : Beschreibungen an die Stelle von Erklärungen treten zu
lassen. « remplacer les explications par des descriptions. » (Lambert Wiesing, Das Mich der
Wahrnehmung, op. cit., p. 161.)
132
On retrouve bien cette idée de se limiter à ce qui est déjà certain dans la remarque suivante
de Wiesing : Der Phänomenologue zieht sich auf ein sicheres Terrain und bleibt dort. « Le
phénoménologue se retire sur un terrain certain et y reste ». (Ibid., p. 80.)
133
Ibid., p. 78.
134
La structure logique d’une chose étant justement ce que permettent de découvrir des
variations eidétiques, celles-ci rendant possible, selon Wiesing : […] ein dritter Weg neben
Induktion und Deduktion. « […] un troisième chemin à côté de l’induction et de la
déduction. » (Ibid., p. 102.)
135
« À partir d’une description des phénomènes doit apparaître, au travers de la variation, une
logique des phénomènes. » (Ibid., p. 104.)
55
�Revenons donc maintenant à la question principale qui nous occupe ici : qu’est-ce
que la pratique de variations eidétiques nous permet-elle de préciser et d’apprendre
sur ce à quoi nous avons jusqu’ici simplement référé par le terme de « perception » ?
Le fait qu’elle est toujours et nécessairement une relation. En effet, on ne peut, selon
Wiesing, concevoir de perception qui n’implique une relation entre ce qui perçoit et
ce qui est perçu, entre un sujet et un objet. Pourquoi cela ? Parce qu’il est possible de
faire varier l’eidos de la perception et de la concevoir comme perception d’une
couleur, d’un goût, d’un certain poids – ce qui demeure néanmoins nécessaire, c’est à
chaque fois le « de » et donc l’existence d’une relation entre le sujet percevant et
l’objet perçu. La perception a une structure toujours intentionnelle,136 c’est-à-dire que
la perception implique, par sa nature même (c’est-à-dire par sa structure logique),
l’existence d’un sujet de cette perception et l’existence d’un objet de cette même
perception. Décrire la perception, c’est alors décrire la nature de la relation entre le
sujet percevant et l’objet perçu – et c’est en fait cette unique tâche de description de la
perception et de ses différents modes que s’assigne Wiesing dans le reste de MW. On
peut ainsi dire que la nécessaire relation qu’implique toute perception permet de
dégager, par des variations eidétiques, ce que Wiesing appelle les deux pôles de la
perception : le sujet percevant (der Wahrnehmende) et l’objet perçu (das
Wahrgenomene).
Das Wahrnehmungserlebnis erlaubt die Differenzierung einerseits eines
Subjekts, welches sich in diesem Zustand des Wahrnehmens befindet, und
andererseits eines Objekts, das in diesem Zustand dem Subjekt gewahr
wird.137
Mais quel est maintenant plus précisément la nature de cette relation qu’est l’« état
du percevoir » (Zustand des Wahrnehmens) ? Et qu’est-ce que cet état implique-t-il
plus précisément quant à la nature du sujet percevant et quant à la nature de l’objet
perçu ? Enfin, existe-t-il plusieurs états de perception suffisamment différents pour
qu’on puisse distinguer clairement plusieurs manières d’être percevant, c’est-àdire plusieurs manières dont je dois être un je dans le monde (Weisen, wie ich in der
Welt ein Ich sein muss) ?138
136
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 82-91.
« L’expérience de la perception permet de différencier d’un côté un sujet qui se trouve
dans cet état de la perception, et de l’autre un objet qui est perçu par le sujet dans cet état. »
(Ibid., p. 125.)
138
Ibid., p. 84.
137
56
�3. De la perception à la participation
3. 1. Perception et présence
En conclusion du troisième chapitre de MW, portant explicitement sur le moi de la
perception,139 Wiesing récapitule six résultats auxquels il est arrivé au fil de son
travail de description du moi, soit autant de conséquences qu’aurait l’état du percevoir
sur la nature du sujet se trouvant dans cet état. Les voici :
So ist mit dem Urphänomen Wahrnehmung für den Wahrnehmenden die
Konsequenz verbunden, ein innerweltlich partizipierendes, ein leibliches, ein
kausal affizierbares, ein sichtbares, ein öffentliches und ein identisches
Subjekt sein zu müssen.140
Nous n’aurons pas le temps ici de s’intéresser dans le détail à ce que Wiesing
considère dans MW comme six conséquences logiques sur le sujet de l’état de
perception ou à ce que l’on pourrait également se permettre d’appeler, me semble-til : les six attributs essentiels du sujet percevant. Il est néanmoins possible de
regrouper ces six attributs du sujet percevant sous un même attribut générique : celui
d’être présent. Percevoir, cela implique en effet toujours, selon Wiesing, quant au
sujet percevant, le fait d’être présent. Or c’est cette implication là, ce lien entre
percevoir et être présent, qu’il faut maintenant essayer de comprendre. Pourquoi la
perception implique-t-elle, selon Wiesing, pour le sujet, sa présence ? Répondre à
cette question devrait permettre d’obtenir quelques pistes afin de mieux comprendre
ce que l’on vient d’appeler les six attributs du sujet percevant, mais devrait surtout
nous permettre d’exposer les prémisses qu’emploie ensuite Wiesing pour édifier sa
théorie de l’image.
Or pour comprendre cette implication, qui va donc de la perception à la présence, il
me semble utile de revenir ici à la racine de nos certitudes afin d’insister à nouveau,
avec Wiesing, sur le fait que celles-ci se manifestent en fait sous plusieurs formes. En
effet, comme on l’a déjà remarqué avec Descartes, il n’est pas seulement certain que
je perçoive, mais aussi que je veuille, que je ressente, que j’imagine, etc. Ainsi, ces
différentes activités de mon esprit semblent bel et bien m’apparaitre immédiatement
et constituer elles aussi le fondement de mon expérience phénoménale consciente et
indubitable. Or c’est justement cela que répète ici Wiesing en insistant sur la diversité
des types de certitudes immédiates : je ne suis pas seulement certain de percevoir
mais aussi de faire bien d’autres choses. Afin d’éviter un malentendu probable, il ne
s’agit donc pas, pour Wiesing, en se focalisant sur la perception, de nier ce que la
139
Chapitre le plus long de l’ouvrage, peut-être le plus compliqué, et intitulé comme
l’ouvrage lui-même : Das Mich der Wahrnehmung. Voir : Lambert Wiesing, Das Mich der
Wahrnehmung, op. cit., p. 109-194.
140
« C’est ainsi qu’avec le phénomène primitif de la perception est lié causalement le fait de
devoir être un sujet dans le monde participant, corporel, affectable causalement, visible,
public et identique. » (Ibid., p. 191.)
57
�nature de ces autres facultés ou expériences vécues peuvent également nous apprendre
sur nous-même ou sur le monde, mais simplement de s’intéresser à l’une d’entre elles
spécifiquement : à la perception et à ses conséquences.
Or quelles conséquences logiques a la perception que, par exemple, l’imagination
n’a pas ? Toutes deux impliquent une relation, une intentionnalité. Mais qu’est-ce
qu’implique (entre autre) la perception, que n’implique pas l’imagination ? Le fait que
l’objet de la perception soit toujours et nécessairement présent tandis que l’objet du
sujet imaginant n’a justement pas à être présent. En effet, on ne peut concevoir, par
des variations eidétiques, percevoir quelque chose qui ne soit pas là. On ne peut
concevoir percevoir quelque chose qui soit tout-à-fait absent. La présence de l’objet
perçu pour le sujet percevant constitue donc, selon Wiesing, un autre invariant, une
autre conséquence logique de toute perception. En effet :
Eine Wahrnehmung ist ein Zustand oder Erlebnis, in dem sich Subjekte
befinden können; nämlich der Zustand, ein bestimmtes, beschreibbares Objekt
für gegenwärtig und existent zu halten.141
On peut ainsi, avec Wiesing, poser ici la chose suivante : la perception d’un objet
par un sujet implique une présence. Phénomène de présence dont l’analyse logique
détaillée amènera ensuite Wiesing à poser les six attributs du sujet percevant
précédemment mentionnés. Mais au lieu d’aller dans le détail de ces six conséquences
de la présence sur le moi de la perception, tentons plutôt ici de préciser le sens de ce
terme de présence. En effet, qu’est-ce comme relation que d’être présent à quelque
chose ? D’être en présence de quelque chose ? Qu’est-ce qu’implique la relation de
présence quant à la relation entre le sujet et l’objet de la perception ? En d’autres
termes : que signifie plus précisément gegenwärtig ? Et quelle différence d’avec son
synonyme, que Wiesing emploi deux pages plus tard de Präsenz ?142 Enfin d’avec cet
autre synonyme, que Wiesing utilisera également, d’anwesend ?143
3. 2. Présence et participation
Ce que me semble impliquer le mot de gegenwärtig, c’est tout d’abord cette idée
d’être contre (gegen) la chose présente, ou d’être face à ou encore en face de la chose
présente, ensuite d’être là en même temps que la chose. En effet, la perception
implique toujours d’être, d’une certaine manière, face à ou contre la chose perçue, en
contact avec elle, et donc d’être là au même moment qu’elle, simultanément à elle. Je
ne peux pas percevoir quelque chose qui ne soit pas, d’une manière ou d’une autre, en
contact avec moi, contre moi, face à moi et ce en même temps que moi, dans une
141
« Une perception est un état ou une expérience, dans laquelle des sujets peuvent se
trouver ; à savoir l’état de prendre un objet défini et descriptible pour présent et existant. »
(Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 121.)
142
Ibid., p. 124.
143
Ibid., p. 125.
58
�même « portion d’espace-temps ». C’est, soit dit en passant, également une idée que
l’on entend dans le mot allemand synonyme du terme Objekt qu’est Gegenstand : un
Gegenstand, c’est toujours quelque chose qui se trouve ou se tient contre ou en face
d’un sujet.
Mais qu’ajoute à cette idée ce deuxième terme de Präsenz, que Wiesing a par la
suite tendance à préférer à celui de gegenwärtig ? Cette idée, me semble-t-il, d’une
relation qui ne soit plus de simple simultanéité de deux choses dans un espace, mais
bien d’un rapport réciproque d’implication. On dit de deux choses qu’elles sont
présentes l’une à l’autre. La présence, nous dit Wiesing, est une relation
symétrique.144 Aussi pourrait-on ajouter que, dans le langage ordinaire, « être présent
pour quelqu’un » cela ne veut pas simplement dire « être en même temps que lui dans
le même lieu » mais être là pour lui, être là avec lui. Ce qu’exprime aussi, me semblet-il, ce troisième terme de anwesend. Lorsque l’on est appelé à l’armée ou lors d’une
rendez-vous à être présent, à être anwesend, cela n’implique pas seulement d’être
gegenwärtig à un moment donné et à un endroit donné, mais cela implique d’être
présent à quelque chose, d’être disponible pour faire quelque chose, d’être prêt à
participer à quelque chose.
Ainsi, par ces petits glissements sémantiques, on peut à mon avis arriver à
pressentir ce qui conduit Wiesing à compléter cette idée fondamentale de présence par
celle, non moins fondamentale, de participation, lorsqu’il il précise que :
Jede Wahrnehmung ist für ihr Subjekt mit einer gnadenlosen persönlichen
innerweltlichen Präsenz- und Partizipationspflicht verbunden.145
Percevoir, cela implique d’être présent, d’être là, et donc d’être d’une certaine
manière déjà impliqué dans les choses. Percevoir par exemple quelqu’un qui souffre
en face de soi, ce n’est (normalement) pas seulement être un spectateur (Zuschauer),
mais c’est déjà être impliqué dans cette souffrance puisque je suis dès lors
physiquement dans le même espace que celui qui souffre, qu’il peut me voir,
m’appeler à l’aide, provoquer mon empathie, et que même ne pas apporter d’aide,
dans une telle situation, c’est toujours déjà faire quelque chose : c’est donc déjà
participer. Ainsi, être présent c’est ce qui me fait selon Wiesing être dans le monde et
pas à l’extérieur ni au-dessus de celui-ci. C’est ce qui me fait participer à ce qui s’y
passe ou même : me force à y participer. Car comme le dit Wiesing :
Die Wirklichkeit meiner Wahrnehmung lässt mir keine Wahl: Ich bin dabei!
Ich bin immer beteiligt! 146
144
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 152.
« Chaque perception est liée pour son sujet à un impitoyable devoir de présence et de
participation au monde. » (Ibid., p. 124.)
146
« La réalité de ma perception ne me laisse aucun choix : je suis là ! Je participe toujours ! »
(Ibidem.)
145
59
�Or cette idée que la perception implique plus que la présence au sens de
simultanéité de l’être-là du sujet percevant et de l’objet perçu, cette idée que percevoir
c’est déjà s’impliquer, enfin que percevoir, c’est déjà (dans la grande majorité des
cas) participer à ce qui est perçu : voilà autant d’idées que Wiesing explore dans la
deuxième moitié du troisième chapitre de MW. Chapitre au bout duquel il en arrive
donc à poser les six thèses précédemment mentionnées quant à l’essence du sujet de
la perception qui serait donc, à cause de sa nécessaire présence participative au
monde, nécessairement corporel, affecté causalement, visible, publique et identique
dans le temps.
Mais il faut continuer à laisser de côté ici la formulation plus précise de chacune de
ces six thèses ainsi que leur démonstration spécifique afin d’en arriver maintenant à la
problématique qui nous intéresse plus spécifiquement ici : les images. Or pour ce
faire, il nous suffit de revenir à une ambiguïté que j’entretiens délibérément plus haut,
à savoir que percevoir c’est « dans la grande majorité des cas » ou « normalement »
déjà participer. En effet, si percevoir, selon Wiesing, c’est dans tous les cas être
présent à quelque chose, ce n’est toutefois pas nécessairement participer. L’idée de
présence n’implique pas celle de participation au même titre que l’idée de perception,
elle, implique bel et bien celle de présence. Il est au contraire possible, selon Wiesing,
de vivre sa présence aux choses en tant que pur spectateur, c’est-à-dire en ne
participant pas mais en voyant seulement. Or par quoi cette faculté de vivre un
moment sans participer, c’est-à-dire comme pur spectateur, est-elle rendue possible ?
On s’en doutera : par les images. Et c’est maintenant cette pause de participation que
rendent possible les présences artificielles que sont les images, qu’il faut explorer.
60
�4. La pause de participation
4. 1. Les trois paradigmes de la Bildtheorie
Qu’est-ce qu’une pause de participation, une Partizipationspause ? Ce n’est pas le
fait, nous dit Wiesing dans le dernier chapitre de MW,147 comme lorsque l’on dort ou
même, lors de notre mort, de cesser complétement de percevoir, donc de cesser de
participer. Mais c’est plutôt le fait de simplement « prendre une pause » : de ne plus
participer pendant un laps de temps donné à ce que l’on perçoit. Laps de temps au
bout duquel le cours normal de la perception devra reprendre. Vivre une pause de
participation équivaut ainsi à vivre un instant comme suspendu entre deux perceptions
« normales ».148
Or ce phénomène de pause de participation rendu possible, selon Wiesing, par la
perception d’image, est à présenter et à analyser de trois points de vue différents.
Trois points de vues qu’il considère comme autant de directions de recherches
fondamentales (grundsätzliche Richtungen), comme autant de paradigmes dans le
champ de la théorie de l’image (Bildtheorie) ou plus spécifiquement : dans le champ
de la théorie de la Bildwahrnehmung.149 Il s’agit dans les trois cas d’observer ce qui
change entre le cas de la perception normale et donc participative, et le cas de la
perception d’images. Il s’agit dans les trois cas de voir en quoi la Bildwahrnehmung
est différente de la normale Wahrnehmung. Il s’agit ainsi, pour reprendre la
terminologie employée jusqu’ici, d’analyser, de trois points de vue différents, les
invariants de toute Bildwahrnehmung.
Or ces trois points de vue ou plutôt « paradigmes » se laissent ainsi distinguer,
selon Wiesing, suivant que l’on focalise son intérêt : (1) sur l’objet du sujet percevant
une image : c’est le Bildwahrnehmungsobjekt (ou ce que nous appelions plus tôt le
Bildobjekt) ; ou (2) sur le sujet percevant l’image : c’est-à-dire le Bildrezipient (ou
encore le Bildsubjekt) 150 ; enfin (3) sur la perception de l’image elle-même : la
Bildwahrnehmung elle-même. Comment se repère alors ce changement de la
perception normale et participative à la perception purement spectatorielle de l’image,
ce phénomène de « prendre une pause » dans chacun de ces paradigmes ? Mais aussi :
quel lien y-a-t-il entre ces trois paradigmes ? Y-a-t-il entre eux, selon Wiesing, une
hiérarchie, l’un d’eux fondant peut-être la pertinence des deux autres ? Nous
présenterons maintenant ces paradigmes tel que les conçoit Wiesing, puis tenterons de
répondre à ces questions, avant de conclure cette deuxième partie.
147
Chapitre ayant justement pour titre : « La pause de participation » (Die
Partizipationspause). Voir : Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 195228.)
148
Wiesing défend en effet, à l’opposé de la perception d’image, l’existence d’une perception
normale (normale Wahrnehmung). (Ibid., p. 228.)
149
Ibid., p. 200.
150
À ne pas confondre avec le Bildsujet dont nous parlions plus tôt.
61
�4. 2. Vers une ontologie et une physique de l’image : das Bildobjekt
La question principale inhérente au premier paradigme est la suivante : qu’est-ce qui
change lors de la perception d’images au niveau spécifique de l’objet de la perception,
de l’image-objet, de ce que Wiesing appelle dès AP le Bildobjekt ? Autrement dit :
quel est le statut ontologique à part entière des images, de ces objets qui permettent de
vivre une pause de participation ?
Or une chose semble assez évidente quant au statut de ces choses que sont les
images, c’est que celles-ci sont ontologiquement très particulières, voir
extraordinaires : einzigartig.151 Il n’a d’ailleurs (comme on le suggérait déjà dans la
première partie de ce travail) pas fallu attendre plus longtemps que Platon et sa
République pour s’en rendre compte et y porter attention. Celui-ci y propose en effet
de bannir toutes les images de la cité idéale en raison de la distinction qu’il opère
alors entre l’être de l’image et l’être du réel, c’est-à-dire entre l’apparence et la réalité,
entre le Scheinendes et le Seiendes : le premier terme désignant à chaque fois, selon
Platon, une imitation du second.152 Or que faisait Platon en condamnant ainsi les
images au statut de pure imitation, donc de pure apparence, de pure
illusion ?153 Selon Wiesing, en mettant au centre de son attention ce qu’est l’image,
en se proposant ainsi de définir le statut de cet objet einzigartig qu’est l’image comme
un Scheinendes, Platon se proposait justement de poser les bases d’une possible
ontologie de l’image et posait aussi, ce faisant, également les bases d’une possible
physique de l’image. De nombreuses théories à propos de l’image, de Platon à
aujourd’hui, seraient ainsi, selon Wiesing, à ranger sous ce paradigme, vieux d’au
moins 2'500 ans, dont la question principale est donc : quel est l’être de l’image-objet
perçu, l’être de das besondere Objekt der Bildwahrnehmung ?154
Or la réponse de Wiesing lui-même à cette question, s’inscrivant par là dans cette
tradition, est la suivante : l’image est une présence artificielle. Pourquoi cela ? Parce
que tout d’abord, comme tout objet d’une perception, elle implique nécessairement,
comme on l’a vu, la présence de quelque chose à un sujet (et réciproquement). Mais
aussi parce que, et contrairement cette fois à la majorité des objets dans le monde, elle
n’implique justement pas de participation. Elle propose ainsi à son spectateur quelque
chose qui n’est pas réellement une présence ou plutôt : qui n’est qu’une présence
artificielle. Or quel lien y-a-t-il plus précisément entre cette idée que l’on ne participe
pas aux images et cette idée selon laquelle celle-ci serait donc artificielle ? Comment
expliquer au juste ce lien entre non-participation et artificialité en dépassant cette
banale contradiction entre « réel » et « artificiel » ?
151
En effet : Das Bildobjekt ist ein einzigartiges Objekt, welches sich von den normalen
Wahrnehmungsobjekten unterscheide. « L’objet-image est un objet extraordinaire [ou :
singulier] qui se distingue des objets normaux de ma perception [ou : des objets de ma
perception normale]. » (Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 201.)
152
Ibidem.
153
Je traite déjà de cette question dans la première partie de ce travail aux pages 27 et 28,
ainsi que lorsque j’évoque ce que Wiesing nomme la théorie de l’illusion aux pages 90 à 97.
154
Le « witz » étant que Platon nie justement que cet objet soit véritablement en le
condamnant ainsi au statut de pure apparence. (Ibidem.)
62
�Pour le comprendre, il faut en arriver ici à un argument crucial de Wiesing, déjà
exposé dans Artifizielle Präsenz et que l’on a brièvement présenté dans notre première
partie, selon lequel l’image, c’est quelque chose qui est, d’une certaine manière, aphysique.155 Car quelle différence y-a-t-il entre, par exemple, la perception d’une
maison réelle et la perception d’une image de maison ? Selon Wiesing une différence
radicale, qui n’est cependant pas à faire, comme chez Platon, entre être et paraître,
mais plutôt entre « physique » et « non-physique » ou a-physique. Car alors que je
peux casser les vitres d’une maison réelle, c’est-à-dire en présence de laquelle je suis,
que ses murs peuvent s’écrouler sur moi et que, si une tempête se déclenche, celle-ci
va m’affecter moi tout comme elle va affecter la maison en face de moi, tout cela est
faux dans le cas de l’image. En effet, je ne peux pas casser les vitres de la maison
dans l’image, de l’image de maison, du Bildobjekt où je vois une maison, ses murs ne
peuvent m’affecter ni une tempête dans le monde auquel je participe physiquement
avoir de l’influence sur l’image. Tout ce qu’une tempête pourrait faire, ce serait
d’affecter le support de l’image, par exemple le cadre ou la toile qui supporte l’image
(ce que Wiesing, on l’a vu, appelle le Bildträger) – jamais l’image elle-même, jamais
son Bildobjekt. Ainsi, proposer une ontologie de l’image, selon Wiesing, c’est
justement ne pas s’intéresser au Bildträger, qui lui est bel et bien dans le même
monde physique que moi, mais c’est s’intéresser au Bildobjekt qui lui, ne l’est pas et
échappe du même coup aux lois de la physique.
Der Bildträger unterliegt dem Zahn der Zeit und allen anderen Gesetzen der
Physik. Doch das Bildobjekt ist dem enthoben.156
Car c’est précisément cela qui fait de l’image, selon le Wiesing (de ce paradigmeci)157 quelque chose de strictement artificiel : le fait qu’elle n’est pas soumise aux lois
de la physique est qu’elle n’est donc :
[…] in einem physikalischen Sinne kein materieller Gegenstand in Raum und
Zeit.158
Se proposer de faire l’ontologie de l’image, dans l’optique de Wiesing ici, c’est
ainsi partir du fait que nous ne participons pas à la réalité de l’image, qu’elle n’est pas
dans le monde et cela pour une raison simple : parce qu’elle n’a pas de réalité
physique. Sa présence, bien qu’effectivement perçue, n’est pas physique ni matérielle
155
L’expression est de moi.
« Le support de l’image est soumis à la dent du temps et à toutes les autres loi de la
physique. Mais l’objet-image lui échappe. » (Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung,
op. cit., p. 204.)
157
Nous verrons en effet par la suite qu’à la fin de MW, il semble qu’il y ait « plusieurs
Wiesing », c’est-à-dire que celui-ci semble hésiter entre plusieurs thèses quant au caractère aphysique de l’image. Hésitation que nous tenterons alors de résoudre.
158
Ibid., p. 202.
156
63
�et n’est donc que « fantomatique »,159 elle n’est qu’artificielle. Or nous voici ainsi
renseigné sur le lien qui unit non-participation et artificialité. Ce qui change, entre le
cas de la perception normale et la perception d’images, c’est que dans le deuxième cas
je suis physiquement séparé de l’objet de ma perception puisque celui-ci est une
physikfreie Präsenz,160 c’est-à-dire qu’il n’est présent que de manière artificielle.
Nous reviendrons encore une fois sur cet argument de l’« a-physicalité » de l’image
afin de mieux en évaluer la pertinence et afin de chercher à mieux voir en quoi cette
thèse de l’a-physicalité de l’image et le paradigme dans lequel elle s’inscrit découlent
ou non de la méthode cartésiano-husserlienne développée jusqu’ici. Mais avant cela,
quel est maintenant, selon Wiesing, la question principale qui anime le deuxième
paradigme de la Bildtheorie, celui concernant le Bildrezipient ?
4. 3. Vers une psychologie du spectateur : das Bildrezipient
La question est ici la suivante :
Was leiste ich, damit das möglich ist, was wirklich ist: nämlich, dass ich ein
physikfreies Bildobjekt sehe?161
Le paradigme du Bildrezipient met ainsi au centre de ses préoccupations non pas
l’être de l’objet-image, son ontologie ou ses propriétés physiques (ou plutôt : son
absence de propriétés physiques), mais les facultés ou capacités psychiques du sujet
spectateur d’une image. On s’y demande ainsi pourquoi :
[...] das wahrnehmende Subjekt im Fall der Bildwahrnehmung grundlegend
andere
Konstitutionsleistungen
als
im
Fall
der
normalen
162
Gegenstandswahrnehmung erbringt.
Or à cette question, que Wiesing qualifie de génétique ou transcendantale,163 il ne
propose étonnamment pas de réponse personnelle. Au lieu de cela, il se satisfait d’une
présentation de trois réponses données dans l’histoire de la Bildtheorie à cette
question par Hippolyte Taine, Jean-Paul Sartre Richard Wollheim.
Ainsi, dans le premier cas, c’est-à-dire dans l’optique Tainienne, ce qui fait la
particularité de l’opération psychique qu’accompli le Bildrezipient face à une image,
c’est que celui-ci éprouve alors une perception contradictoire, au travers de laquelle il
159
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 204.
Ibidem.
161
« De quelles facultés dois-je être doté afin qu’il soit possible ce qui est effectivement ; à
savoir que je vois un objet-image a-physique ? » (Ibid., p.207.)
162
« […] dans le cas de la perception d’image le sujet percevant fournit des prestations
constitutives fondamentalement différents du cas de la perception normale d’objets. » (Ibid.,
p. 206.)
163
Ibid., p. 204.
160
64
�perçoit deux choses de nature différente : à la fois le support matériel de l’image et
l’image. Il éprouve alors à la fois une perception d’image et une perception normale
au sujet d’un même objet, perçu une fois comme Bildträger et une fois comme
Bildobjekt, d’où une espèce de combat chez le sujet percevant entre deux perceptions
de natures différentes mais simultanées. 164 Or l’analyse de ce lien dialectique
contradictoire entre perception de l’image et perception du support matériel de
l’image est selon Wiesing le sujet des analyses non seulement de Taine mais aussi de
James J. Gibson et plus récemment de Gottfried Boehm.165
Alors que dans le deuxième cas, celui de Sartres, le spectateur d’une image
n’éprouve pas de perception contradictoire mais conçoit différemment deux objets, ou
plutôt : il voit l’un et imagine l’autre. Ce serait alors, dans l’optique sartrienne, cette
capacité qu’à l’homme d’en même temps voir ce qui est réellement là (un objet
matériel) et d’y imaginer en même temps autre chose (une image) qui constituerait la
faculté spécifique dont la Bildtheorie devrait proposer l’analyse.166
Mais ces deux manières de concevoir les capacités psychiques particulières que met
en œuvre le spectateur de l’image sont cependant, selon Wiesing, des positions
extrêmes.167 Positions extrêmes entre lesquelles on trouve par exemple la proposition
de Richard Wollheim de considérer cette faculté spécifique de percevoir les images
plutôt comme un voir dans (seeing-in).168 Voir dans un support matériel une image :
voici ce dont serait capable l’homme qui voit une image selon Wollheim – le tout
étant ensuite de définir ce que l’on entend exactement par « voir dans ».
Voilà pour ce qui est de ce paradigme du spectateur, auquel Wiesing me semble
globalement moins s’intéresser qu’aux autres. Or ce relatif manque d’intérêt me
semble être symptomatique d’un problème plus profond quant au statut de ce
paradigme et quant à sa légitimité théorique à l’intérieur de MW. Nous aurons à y
revenir afin de conclure mais avant cela, présentons le troisième et dernier paradigme,
soit celui qui donne le primat à la perception de l’image elle-même, à la
Bildwahrnehmung.
164
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 207.
Ibid., p. 208.
166
Voir : Jean-Paul Sartre : L’imaginaire (1940), Gallimard : Paris, 2005.
167
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 209.
168
Ibid., p. 204. Sur la question du seeing-in chez Wollheim, ainsi que sur le débat qui y est
lié à propos de la notion de two-foldness, voir : Richard Wollheim, Art and its Objects, New
York : Cambridge University Press, 1980. ; ainsi que par exemple: Gregorie Currie, Arts and
Minds, Oxford University Press, 2004.
165
65
�4. 4. Vers une phénoménologie de l’image : die Bildwahrnehmung
Lorsque c’est au tour de la Bildwahrnehmung elle-même de détenir le primat, alors
naît (entsteht),169 nous dit Wiesing, un troisième paradigme. Dans celui-ci, ce n’est ni
l’objet-image, ni le spectateur, mais bien ce qui se passe lors de la perception d’une
image qui est au centre de l’attention. C’est donc, serait-on tenter de dire, bel et bien
ce qui change à un niveau phénoménal entre une perception normale et une perception
d’image qui est ici plus précisément analysé, et non l’objet de la perception ni son
sujet pris isolément. La question centrale de ce paradigme, Wiesing la formule en
effet de la façon suivante :
Was geschieht mit mir, wenn ich ein Bild sehe?170
Or c’est à ce troisième niveau que se fait le mieux sentir, me semble-t-il, la qualité
de ce qu’est une pause de participation passée au contact d’images. Car « ce qui se
passe avec moi » lorsque je contemple une image, ce n’est pas seulement, comme
suggéré au travers du premier paradigme de la Bildtheorie, que l’étrangeté
ontologico-physique de l’image-objet « provoque » chez moi une pause de
participation ; ce n’est pas non plus le fait que je monopolise à cet effet une faculté
psychologique particulière – mais c’est bien ce qu’il se passe dans ma relation à
l’objet de ma perception. Or ce qui se passe dans ma relation à ce que je perçois, c’est
que je ne vis alors plus dans le même monde que lui mais lui suis extérieur : je suis là
dans un rapport spectatoriel de non-immersion à lui. Or voici les deux dernières
notions clés qu’il s’agit maintenant d’approfondir : celle de spectateur, liée
intimement à celle de non-immersion.
Pour comprendre celles-ci, il faut opérer, selon Wiesing, une nouvelle distinction,
cette fois entre deux manières de percevoir des images. Il faut faire la distinction entre
percevoir une image comme on peut en fait percevoir n’importe quel autre objet, et
être véritablement spectateur de cette image en y demeurant donc extérieur. C’est-àdire qu’il faut faire la distinction entre voir une image afin, d’une certaine manière,
d’entrer en elle, de vivre en immersion dans le monde que je perçois au travers
d’elle ; et voir une image pour ce qu’elle est : juste une image. Il s’agit ainsi de
rectifier un malentendu que l’on a peut-être pu induire plus tôt, dans notre
présentation du paradigme ontologique, à l’intérieur duquel on a probablement pu
laisser croire que l’image, simplement parce qu’elle serait ontologiquement
singulière, provoquerait nécessairement chez moi un état spectatoriel : un état où je ne
participe pas mais ne fais que voir. Au contraire, il s’agit de comprendre ici en quoi
c’est un rapport spécifique aux images qui rend possible ce type de d’état – et non la
nature même de l’image.
En effet, tout ce à quoi l’on réfère habituellement par le nom d’ « image » ne
provoque pas nécessairement, chez celui qui la regarde, un rapport de spectateur à ce
169
170
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 209.
« Que se passe-t-il avec moi lorsque je vois une image ? » (Ibid., p. 210.)
66
�qu’il regarde. Lors par exemple de la projection d’un film en trois dimensions dans un
Imax, je peux me sentir complétement immergé dans l’image : je crois alors
réellement participer à ce qu’il s’y passe, je peux même en arriver à tenter d’esquiver
un projectile qui me semblerait venir dans ma direction. Mais je ne suis dans ce cas
justement pas à proprement parler en train de voir l’image pour ce qu’elle a de si
particulier, c’est-à-dire en train de vivre cette expérience unique que peut constituer la
perception non-immersive d’images, puisque je suis au contraire en train de participer
à ce que je vois sous le mode qui est en fait déjà le mien lors de la vie de tous les
jours. Or ce n’est au contraire que lorsque ce qu’il se passe avec moi, c’est que je vis
la présence de l’objet de ma perception comme artificiel, que je vis à proprement
parler une Bildwahrnehmung, c’est-à-dire que la perception qui est la mienne se
distingue clairement de la perception normale et participative. Contrairement à cet
exemple de la perception immersive d’images dans un Imax au travers de laquelle, en
fait comme dans la vie normale, je suis absorbé, immergé et participe à ce que je vois,
c’est seulement dans un état de contemplation non-immergé, dans un état que seul me
permet une certaine attitude vis-à-vis des images,171 que je ne participe plus mais vois
seulement. Alors en distinguant le rapport immersif du rapport non-immersif aux
images, il s’agit de distinguer le rapport perceptif « normal » que j’ai aux choses et
que je peux continuer à avoir aux images (par exemple au cinéma)172 de ce rapport
peut-être plus étrange aux images, et qui fonde selon Wiesing tout leur intérêt : ce
rapport dans lequel je ne me sens plus forcé à participer à ce que je perçois, ce rapport
dans lequel je peux librement contempler l’objet d’une image tout étant conscient
qu’il n’est pas réellement là et qu’il ne m’oblige donc à rien.
Ainsi l’image, contrairement à ce que semble en dire Platon, et comme le remarque
ici Wiesing, n’entraîne pas forcément un rapport mensonger ou d’illusion au monde.
Au contraire l’image, perçue précisément comme image (et non comme quelque chose
de réellement présent), perçue donc sous le mode de la Bildwahrnehmung et non de la
normale Wahrnehmung, a presque une fonction inverse à celle de l’image trompel’œil : je ne m’immerge pas en elle ni ne croît à la présence réelle de son objet, et
c’est cela qui se passe avec moi (mit mir) lors de la pause de participation que permet
la Bildwahrnehmung : je vois seulement quelque chose, que je sais ne pas être
vraiment là, être artificiellement présente, et je suis alors conscient, peut-être avec un
certain sentiment de soulagement (Entlastung), que pour une fois je ne dois pas
nécessairement participer à ce que je vois. Ce qui fait ainsi la valeur si particulière de
l’image selon Wiesing, et l’on en arrive ainsi selon moi à une idée de Wiesing qui à
elle seule justifie, me semble-t-il, le chemin argumentatif accompli jusqu’ici, c’est le
fait que l’image rend possible une relation au monde profondément libératrice.
L’image me permet de me libérer du monde qui m’entoure, auquel je suis
normalement obligé de participer.
171
C’est précisément cette attitude qu’il s’agira dans la troisième partie de ce travail, aux
pages 100 à 106, de mieux décrire.
172
Le cinéma ayant tendance à provoquer chez le spectateur, tout comme les trompe-l’œil, un
sentiment d’immersion et donc une attitude participante artificielle (künstliche TeilnehmerHaltung). (Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 225.)
67
�Nous revoyons ainsi, sous un autre angle, ce qui a été dit au sujet de l’ontologie de
l’image et ce que nous exprimions déjà en conclusion de la première partie de ce
travail, à savoir que l’image détient une espèce de qualité a-physique. Or nous
pouvons maintenant, me semble-t-il, préciser un peu le sens de cette idée puisque
comme on vient de le voir ici, ce n’est en fait pas l’image elle même qui est aphysique, qui aurait véritablement pour propriété d’être a-physique ou encore
immatérielle, mais c’est plutôt la relation que je peux entretenir à elle qui peut me
permettre de vivre un moment un peu en dehors du monde physique. L’a-physicalité
n’est ainsi pas à considérer comme un attribut de l’image elle-même et prise
isolément (ce n’est pas un trait de son « essence »), mais elle est plutôt révélatrice
d’un certain type de relation spectatorielle et non-immersive que je peux entretenir
aux images. L’image rend possible un état, pour le spectateur, d’a-physicalité. Un état
que Wiesing qualifie d’ailleurs également d’a-politique (unpolitische Verhältnisse).173
Un état d’exception (Ausnahmezustand)174 qui, loin d’être caractérisé comme chez
Platon comme quelque chose de négatif et qui éloignerait de la vérité, est défini par
Wiesing comme rendant possible un moment de libération qui me permet de vivre, ne
serait-ce qu’un instant, dans un metaphysisches Paradies.175 Or voici, me semble-t-il,
la dernière idée forte et profondément originale de Wiesing dans MW, selon laquelle :
Die Partizipationspause lässt sich als artifizielle Welflucht verdammen, aber
auch als einen ersten Schritt in Richtung auf ein metaphysisches Paradies
begrüssen.176
4. 5. Un paradis métaphysique
On l’aura compris, il est dans cette dernière partie fait référence à deux « arguments
physiques » qui correspondent respectivement aux résultats du premier et du troisième
paradigme que dégage Wiesing. Le premier de ces arguments177 réside dans cette idée
que c’est l’être de l’image lui-même qui est a-physique ; le deuxième défendant que
c’est plutôt « l’état perceptif non-immersif que rend possible la contemplation
strictement spectatorielle d’images » qui est a-physique. Or lequel est véritablement
une conséquence logique du développement présenté jusqu’ici ? Autrement dit, lequel
de ces paradigmes est-il proprement le fruit de la démarche phénoménologique
qu’élabore pas à pas Wiesing dans MW ? Pour tenter d’être encore plus clair,
reformulons cette question de la manière suivante : être une « présence artificielle »,
est-ce (comme on a pu le laisser entendre) une propriété de l’objet-image (Bildobjekt)
a-physique, ou cela qualifie-t-il plutôt la spécificité d’un rapport que l’on vit, la
173
Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 214.
Ibid., p. 211.
175
Ibid., p. 228.
176
Ibidem.
177
Argument déjà présenté en conclusion de notre deuxième partie, aux pages 44 et 45.
174
68
�spécificité de ce quelque chose qui se passe dans la manière libérée dont je vis ma
présence aux images ?
La bonne réponse à cette question, on s’en doutera, me semble être la deuxième
option. C’est-à-dire qu’être présent artificiellement, c’est un état dans lequel un sujet
perçoit une image sans s’immerger en elle et c’est seulement, écrit Wiesing, lorsque je
perçois une image en tant qu’image, c’est-à-dire en tant que chose hors du monde,
que je peux alors vivre en présence d’un objet qui ne me force à rien, allant ainsi
jusqu’à me permettre de vivre loin des contraintes du monde réel dont je peux ainsi,
l’espace d’un instant et par un simple regard sur une image, faire abstraction. Car
pour ce faire, comme le dit Wiesing :
Es genügt der Blick auf ein Bild! 178
Mais alors quel lien y-a-t-il entre cette thèse-ci et les deux thèses, respectivement
ontologiques et psychologiques, précédemment évoquées ? Ce rapport, et bien que
Wiesing semble un peu affirmer le contraire du fait même qu’il emploie le terme de
« paradigme » (un paradigme ne pouvant normalement fonder un autre paradigme),
est à nouveau de fondation. Le troisième paradigme, celui de la Bildwahrnehmung,
fonde, me semble-t-il, les deux autres (qui ne sont du même coup pas vraiment des
paradigmes). C’est-à-dire que ce n’est ni pour des raisons strictement ontologiques, ni
pour des raisons simplement psychologiques que la perception d’images permet ce
« mode d’être moi » si particulier qu’est la pause de participation, mais pour des
raisons proprement phénoménologiques. C’est « ce qui se passe avec moi » à un
niveau phénoménal, quand je perçois des images comme présentes artificiellement,
qui justifie ensuite, à un niveau ontologique, que je décrive leur être comme artificiel.
Tout comme c’est ce même phénomène fondamental « qui se passe » lorsque je
contemple des images que, en analysant du point de vue du sujet, on peut décrire
comme lié à l’emploi d’une faculté psychique particulière que l’on décrira alors
comme un voir dans. Et cela pour une raison simple : ni l’image seule, ni le sujet seul
ne peuvent provoquer de pause de participation sans que ce même sujet n’entre dans
cette relation si particulière à son objet qu’est justement une pause de participation.
Comme on l’a vu : l’image peut aussi provoquer chez le spectateur (par exemple au
cinéma) un état immersif. De la même manière un individu, et cela me semble assez
trivial, peut aussi voir un visage dans un nuage : il n’a pas forcément besoin d’images
pour « voir dans ». Mais seule « la perception d’une image tout en ne s’immergeant
pas en elle » peut rendre possible une véritable pause de participation dans laquelle ce
que je vois ne m’oblige véritablement à rien. Autrement dit, seule l’analyse de la
relation qu’est la Bildwahrnehmung (ainsi que les conséquences sur un plan
phénoménal de cette analyse) me semble être ici véritablement fondée par la méthode
phénoménologique de Wiesing et du même coup apte à fonder des considérations plus
précises en ce qui concerne le sujet de l’image et son objet pris plus isolément. Or, et
178
« Il suffit d’un regard sur une image ! » (Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung,
op. cit., p. 199.)
69
�je conclurai la deuxième partie de ce travail là-dessus, le fait que l’un de ces
paradigmes fonde et justifie en fait les deux autres, s’il peut apparaître un peu comme
une critique faite à l’argumentation de Wiesing dans MW, ne l’est en fait que
superficiellement. Au contraire c’est là, me semble-t-il, la solution à un problème plus
sérieux.
En effet, si l’on ne se base que sur le paradigme ontologique de l’image que
présente MW (qui reprend en fait dans une large mesure des idées déjà énoncées dans
AP), on arrive selon moi assez vite au problème de savoir ce qu’entend plus
exactement Wiesing par « la physique ». Car quelles sont les lois précises que
Wiesing désigne par cette expression ? En quoi est-il selon lui justifié de considérer
que « la physique » est une discipline unifiée, dont les résultats (qui seraient soit dit
en passant biens connus de tous) seraient « contraires à la nature de l’image » ? Une
telle idée fait-elle même sens ? Enfin, n’est-il pas étrange de défendre que ce qui se
passe dans une image en mouvement de cinéma, par exemple lorsque l’on y voit le
Titanic couler, n’a absolument rien à voir avec quelque chose comme la physique ?
Que faire de plus, et dans ce cas, de ce que l’on appelle dans l’univers des jeux vidéos
très précisément le « moteur physique », c’est-à-dire ce grâce à quoi ces jeux
permettent aux joueurs d’évoluer dans un environnement plus ou moins réaliste et bel
et bien soumis à des règles physiques ?
En employant dans AP et dans le paradigme ontologique de manière me semble-t-il
un peu vague le concept de « physique », qui semble alors en même temps référer à
des lois stables et établies, mais aussi à « la » physique contemporaine telle qu’elle se
pratique, enfin à la physique au sens de « nature » ou de « matière » tout en ne
revenant à aucun moment au fait que la physique, dans son sens le plus banal, c’est
simplement la science qui a pour objet le mouvement, Wiesing me semble se
condamner à fonder sa notion de présence artificielle sur quelque chose que l’on serait
tenté de qualifier d’à la fois un peu bancal et de paradoxal. Bancal car rien, dans toute
l’argumentation de nature phénoménologique que développe Wiesing dans ses
ouvrages, ne justifie le fait de donner tout-à-coup une pareille place à ce concept
presque étranger de « physique ». Et paradoxal, parce que Wiesing passe toute une
partie du premier chapitre de MW (on s’en rappelle) à nous expliquer que la science
fonctionne grâce à des modèles et qu’il veut lui, au contraire, proposer une
philosophie dénuée de modèles – mais alors pourquoi faire intervenir « la physique »
(c’est-à-dire une science strictement modélisante) à un moment si crucial ?
La réponse à cette question est me semble-t-il que Wiesing ne comprend au fond ici
la physique ni comme étant ce qui fait l’objet des physiciens (il ne s’intéresse
d’ailleurs jamais particulièrement à ce que font ces derniers), ni à proprement parler
comme étant ce qui fonde le mouvement, ni encore comme l’équivalent du domaine
de « la nature », mais comme étant le monde. Le monde en tant que ce cadre dans
lequel nous sommes toujours empêtrés, qui nous sollicite sans cesse, qui nous force à
faire tant de choses et requière partout notre présence et notre action – là où par
opposition, l’artificialité radicale de l’image nous permet de souffler un peu : de
prendre une pause. Le terme « physique » prenant ainsi le sens plus simple de
70
�mondain. 179 L’image nous permet, un instant, d’échapper un peu au monde et
provoque ainsi en nous quelque chose comme un soulagement, nous autorisant à un
vivre un petit moment ailleurs et au travers duquel :
Ich sehe, ich tauche ein und bin weg.180
179
Wiesing parle déjà du monde dans AP, du fait d’être dans le monde mais d’un peu s’en
extraire grâce aux images. Voir : Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 31-32.
Tout comme il évoque le caractère nécessairement « dans le monde » (innerweltlich) des
choses réelles dans MW, voir : Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p.
191.
180
« Je vois, je me trempe et je suis parti. » (Ibid., p. 228.)
71
�III. Qu’est-ce qu’une pure visibilité ?
Sehen lassen
1. La notion de pure visibilité dans l’œuvre de Lambert Wiesing
Dans Artifizielle Präsenz (2005), Lambert Wiesing emploie l’expression de reine
Sichtbarkeit afin de caractériser l’image, cela pour la première fois dans le passage
suivant (qui porte sur la production d’une image de maison) :
Wer ein Bild herstellt, schafft nicht ein Zeichen, sondern eine besondere Art
von Gegenstand: ein Bildobjekt, ein imaginäres Haus – oder wie Fiedler
sagen würde: ein „Sichtbarkeitsgebilde“. Er schafft ein nursichtbares Haus,
einen Gegenstand aus reiner Sichtbarkeit.181
Mais alors (et comme nous nous le demandions déjà en conclusion de la première
partie de ce travail) qu’est-ce qu’une chose seulement visible (nursichtbar) ? En quoi
est-ce là quelque chose qui n’est pas un signe (nicht ein Zeichen) ? Et que signifie
plus précisément la notion même de pure visibilité (reine Sichtbarkeit) ?182
Apporter une question claire à cette série de questions me semble d’autant plus
important que Wiesing continuera d’employer régulièrement l’expression de pure
visibilité dans ses ouvrages postérieurs. 183 Avec cette autre idée, selon laquelle
l’image est une présence artificielle, l’idée selon laquelle l’image serait seulement
visible me semble même constituer l’une des deux thèses centrales de la théorie de
l’image de Wiesing (c’est TC2). Or afin de répondre à ces questions et de bien
comprendre les enjeux philosophiques et théoriques qui se cachent sous cette notion
de pure visibilité, le meilleur moyen, me semble-t-il, c’est d’explorer le sens de cette
idée de pure visibilité dans un ouvrage postérieur à AP : dans Sehen lassen (2013).
En effet, Wiesing procède dans Sehen Lassen à une enquête nouvelle à l’intérieur
de son travail philosophique sur l’image : il y expose une phénoménologie de l’acte
du montrer. Dit autrement, il cherche à y décrire la pratique de la « monstration »184
181
« Celui qui produit une image ne crée pas un signe mais une sorte particulière d’objet : un
objet-image, une maison imaginaire – ou comme dirait Fiedler : une "structure de visibilité".
Il crée une maison seulement visible, un objet fait de pure visibilité. » (Lambert Wiesing,
Artifizielle Präsenz, op. cit., p. 31.)
182
Il faut noter ici que Wiesing emploie cependant déjà l’expression de pure visibilité en
1997, dans Die Sichtbarkeit des Bildes, là aussi en faisant référence au travail pionnier de
Konrad Fiedler. Voir : Lambert Wiesing, Die Sichbarkeit des Bildes, op. cit., p. 145-208.
183
J’entends par là : Das Mich der Wahrnehmung (2009) et Sehen Lassen (2013).
184
Le terme de « monstration » n’a pas vraiment d’équivalent en allemand. Wiesing emploie
simplement le substantif : « le montrer », comme par exemple dans le sous-titre du livre : Die
Praxis des Zeigens. Mais en français, dire « le montrer » ou « la pratique du montrer » ne me
semble pas très heureux. D’autant qu’il existe justement cette expression de monstration que
j’emprunte tout d’abord au domaine spécifique de la théorie du cinéma, mais dont l’usage me
semble de plus en plus étendu. Voir par exemple : Gottfried Boehm, « Ce qui se montre : De
72
�en général ainsi que, plus spécifiquement, lorsque l’on montre quelque chose avec des
images. Or pourquoi cet ouvrage et sa problématique permettraient-ils de mieux
trouver des réponses à nos questions qu’AP ?
Premièrement, parce qu’au lieu de porter principalement, comme c’est le cas d’AP,
sur le caractère artificiellement présent de l’image, Sehen lassen porte aussi (comme
l’indique le titre), sur le fait de voir ou plus précisément : sur le fait de laisser voir. Il
semble donc a priori assez légitime d’espérer y trouver une description plus complète
de ce que c’est au juste que voir ainsi que, a fortiori, ce que c’est que voir seulement.
Deuxièmement, parce qu’AP, on l’a déjà remarqué, est un ouvrage court, presque
trop court. Les deux seuls chapitres où il est fait mention de cette notion fondamentale
de pure visibilité sont de plus relativement brefs et il y est, me semble-t-il, plutôt
exprimé une intuition voir un programme de recherche relatif à cette intuition qu’une
conception réellement élaborée de ce qu’est une pure visibilité. Il me semble ainsi
manquer, dans AP, une meilleure justification à cette idée que l’image est purement
visible – justification que l’on trouve à mon sens dans SL.
Car en effet, et troisièmement, Wiesing ne cherche dans SL pas seulement à dire ce
que c’est que montrer, puis à décrire à un niveau pragmatique la monstration au
travers d’images. Il désire aussi – et c’est peut-être là un troisième objectif moins
apparent de SL – y établir plus solidement la thèse selon laquelle l’image est une
chose purement visible. En effet, si Wiesing arrive à établir, dans un premier temps,
que l’image ne peut rien montrer elle-même mais que c’est l’utilisation que l’on en
fait qui permet de faire des choses (entre autres : de montrer), alors on ne peut ni ne
doit définir l’image par son action, par ce qu’elle montre. De même que l’on ne doit
alors pas non plus la définir par ce qu’il est, par son intermédiaire (et de manière
contingente) possible de montrer : on ne doit pas la réduire à l’une de ses fonctions
possibles. Bien plutôt, on doit chercher à la définir par ce qu’elle est, c’est-à-dire,
comme on l’a déjà dit évoqué, par ses propriétés (Eigenschaften). Alors, par cet
apparent détour à propos de la façon dont l’image permet, à un niveau pragmatique,
de montrer, il s’agit bel et bien aussi de fonder, de manière pour ainsi dire indirecte, la
thèse « ontologico-phénoménologique » (et on le verra : d’inspiration heideggérienne)
de Wiesing quant à l’être phénoménal purement visible de l’image. Mais reprenons
maintenant ce raisonnement dans le détail.
la différence iconique », in : Penser l’image, Emmanuel Alloa (éd), Paris : Les presses du
réel, 2010, p. 27-47. Pour en savoir plus au sujet de ce concept dans le champs des études
cinématographiques, voir : Alain Gaudreault, Du littéraire au filmique : système du récit,
Paris : Méridiens Klincksieck, 1988. Ou encore : Alain Boillat, La fiction au cinéma, Paris /
Montréal : L'Harmattan, 2001.
73
�2. Montrer en général
2. 1. L’approche évolutionnaire de la monstration
La question qui ouvre SL est la suivante : qu’est-ce que montrer ? Selon Wiesing, il
existe deux manières traditionnelles de répondre à cette question.185 La première, que
celui-ci nomme l’évolutionnaire,186 consiste principalement à défendre que montrer,
c’est le premier acte de communication de l’homme :
Das Zeigen ist die erste Kommunikationsform des Menschen.187
Montrer, ce serait alors (par exemple selon Habermas)188 le premier pas sur la route
du langage et de la communication complexe que l’on pratique, en tant qu’adulte, tous
les jours. Il semble en effet assez convaincant de défendre que le premier acte (ou
« proto-acte ») de langage de l’enfant, c’est de désigner quelque chose du doigt (ou de
la main), d’ainsi se référer à ce quelque chose, et du même coup d’instituer un
premier rapport sémantique (ou « proto-sémantique ») à la réalité. En montrant
quelque chose du doigt, même si l’enfant ne sait pas encore parler, il isole ce quelque
chose du reste des choses qui l’entoure, il l’« institue » quasiment en tant qu’objet de
communication et pose ce faisant les bases d’un possible échange à propos de ce
détail dans le paysage : la racine de la référence et du discours étant ainsi à chercher
dans le montrer primitif que pratique l’enfant. Une pratique qui aboutirait alors, plus
tard, au langage plus complexe et complet que nous employons. Langage dans lequel,
pour montrer de manière précise et sans avoir à être directement en présence de
l’objet auquel on réfère, nous utilisons également des noms propres, des noms
généraux et des pronoms (voir des variables). 189 Ainsi, du point de vue
évolutionnaire :
Die simple Fähigkeit, mit einem Finger auf etwas zeigen zu können, ist die
entscheidende intellektuelle Vorraussetzung, aus der sich die komplexen
185
Traditionnelles à l’intérieur de ce que Wiesing appelle la Zeige-Forschung : la recherche à
propos du montrer. Domaine de recherche cependant relativement nouveau si l’on en croit
Wiesing lorsqu’il écrit que : Man wird sich schwertun, überhaupt ein ganzes Buch zu finden,
das sich speziell und ausschliesslich mit dem Zeigen befasst – und das schon älter als zwanzig
Jahre ist. « On aura bien de la peine à trouver un livre entier qui se consacre spécialement et
exclusivement au montrer – et qui ait plus de vingt ans. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen,
op. cit., p. 9.)
186
C’est le paradigme évolutionnaire (das evolutionäre Paradigma). (Ibid., p. 9.)
187
« Le montrer est la première forme de communication de l’homme. » (Ibid., p. 10.)
188
Wiesing donne ici pour référence : Jürgen Habermas, « Es beginnt mit dem Zeigefinger »,
in : Die Zeit, n° 51, 2009, p. 45.
189
Dans ma description de ce premier acte du montrer de l’enfant, j’essaie de faire écho à la
description que donne W. V. Quine de l’origine de l’acte de référer dans : W. V. Quine,
Pursuit of Truth, Revised Edition, MA / London : Cambridge, 1992, p. 23-25. D’où le fait
d’ajouter ici entre parenthèses cette idée propre à Quine selon laquelle ce premier acte de
référer peut aboutir, plus tard, à l’usage de variables.
74
�sprachlichen Formen der menschlichen Kommunikation haben schrittweise
entwickeln können.190
Or sans entrer dans trop de détails ici sur cette approche évolutionnaire, on se rend
assez vite compte que celle-ci, bien qu’intéressante, pose problème. En effet, mis à
part ce récit (d’ailleurs discutable) 191 du premier acte de montrer prétendument
accompli par l’enfant, trop peu d’éléments semblent, selon Wiesing, véritablement
soutenir cette idée selon laquelle montrer ne serait qu’une espèce de « phénomène
primitif » (Vorlaüferphänomen).192 Au contraire, dans la vie de tous les jours, même
les êtres les plus évolués (et les plus érudits) continuent de montrer des choses : que
ce soit avec leur doigt, avec un laser, ou avec des images. Dès que l’on s’intéresse
ainsi plus précisément à l’acte du montrer dans sa complexité, on se rend compte que
cette pratique subsiste pour ainsi dire parralèlement à l’usage du langage verbal. Le
langage verbal n’efface ni ne supprime le langage par monstration et vice-versa. On
serait donc plutôt tenté de défendre, dans une deuxième approche que Wiesing
nomme l’approche phénoménologique (c’est-à-dire ici, en gros : une approche antiévolutionnaire et descriptive)193 que montrer est une pratique évoluée qu’il faut tenter
de décrire dans toute sa complexité. En effet :
Das Sprechen und das Zeigen sind beide menschliche Pratiken; man hat es in
beiden Fällen gleichermassen mit Handlungen von Menschen zu tun.194
Or ce sont ces pratiques (ou actions)195 humaines à part entière qu’il s’agit alors
d’observer et de décrire. La question devenant ainsi la suivante : si montrer, ce n’est
pas un acte primitif dont on épuise le potentiel en prenant l’exemple de l’enfant qui
montre du doigt quelque chose avant d’être capable d’y référer par le langage verbal,
qu’est-ce que c’est exactement ? Qu’est-ce que l’acte de montrer, pris cette fois dans
son acception non-primitive et complexe ?
190
« La simple capacité à pointer quelque chose du doigt est la condition intellectuelle
décisive à partir de laquelle des formes langagières relevant de la communication humaine
ont pu pas à pas se développer » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 10.)
191
Sans entrer dans le vaste domaine de la psychologie de l’enfant, il semble que le nouveau
né fasse de nombreuses choses avant de montrer du doigt. Pleurer, rire, sourire : autant
d’actes de communication que l’enfant accompli avant de montrer.
192
Ibid., p. 11.
193
Sur ce qu’est à proprement parler la phénoménologie, voir le deuxième chapitre de ce
travail, pages 49 à 56.
194
« Le parler et le montrer sont des pratiques humaines ; on a dans les deux cas affaire à des
actions accomplies par des humains. » (Ibid., p. 13.)
195
Wiesing utilise dans SL les termes de Praxis et de Handlung de manière synonyme. Nous
ferons donc de même ici avec les termes « acte », « action », et « pratique » en désignant par
là toujours quelque chose qui est accomplit intentionnellement par quelqu’un – et jamais en
faisant référence à la distinction aristotélicienne entre « en acte » et « en puissance ».
75
�2. 2. L’approche phénoménologique de la monstration
Faire de la phénoménologie, on l’aura compris dans le deuxième chapitre de ce
travail, c’est en deux mots décrire ce qui nous apparaît afin d’y distinguer ensuite des
invariants. 196 Or comment nous apparaît, tout d’abord, l’action du montrer : sous
quelles différentes formes (Formen ou Grundarten) que l’on pourrait décrire? Selon
Wiesing, sous deux formes principales. En effet, il semble plausible de décrire et de
distinguer deux manières différentes de montrer, selon que l’on à affaire à de la
confrontation (Konfrontation) ou à de la désignation (Hinweisen).197 À un niveau
linguistique, ces deux manières de montrer trouvent d’ailleurs leur meilleure
expression en anglais, puisque la langue anglaise opère toujours la distinction entre
ces deux manières de montrer, selon que l’on a affaire à du showing ou à du pointing,
cela là où le français comme l’allemand rendent possible l’emploi de ce seul terme
moins défini, plus général et donc un peu plus confus de « montrer » ou de zeigen.
Mais alors quelle différence y-a-t-il entre to show something et to point at something ?
Le fait que, dans le premier cas, celui du « show » et de la confrontation, on met
celui à qui l’on veut montrer quelque chose directement en face ou en présence de la
chose même que l’on veut lui montrer : on le confronte directement à la chose. Ainsi,
si je veux par exemple montrer (dans le sens de to show) la Tour Eiffel à quelqu’un
(cet exemple est de moi), je peux l’emmener aux pieds de celle-ci et je la lui aurai
alors montrée, je l’aurai « confronté » à la Tour Eiffel. Cela alors que, dans le
deuxième cas (celui du point at), je ne procèderai pas de la même manière. Au lieu de
mettre la personne à qui je souhaite montrer la Tour Eiffel directement en face de
celle-ci, j’utiliserai une espèce de « troisième terme » entre lui et la Tour Eiffel : par
exemple mon doigt, avec lequel je désignerai la Tour Eiffel, par l’intermédiaire
duquel je « pointerai vers » la Tour Eiffel.198
La distinction entre ces deux manières de montrer, pourrait-on avoir envie de
suggérer ici, ne semble pas radicale. Cependant, en plus du fait que l’une soit directe
et l’autre indirecte, une autre différence assez précise semble subsister. Car alors que,
dans le premier cas, je confronte réellement quelqu’un avec la chose que je veux lui
montrer, celui-ci n’ayant ainsi pas vraiment le choix de la voir ou non car se trouvant
directement en sa présence, dans le deuxième cas, il est laissé à celui à qui l’on
montre une certaine liberté. L’exemple paradigmatique du premier type de
196
La philosophie de Wiesing est avant tout, on l’a vu, une phénoménologie. D’où le fait que
je me permette ici (et bien que Wiesing ne le fasse pas explicitement) de parler des invariants
de la monstration. Il pourrait cependant sembler plus approprié de parler ici de « conditions »,
ou alors de « principes » de la monstration, tel que le fait Wiesing par exemple quand il
évoque les : Prinzipien […], die für das Funktionieren dieser Praxis notwendig sind. « Les
principes […] qui sont nécessaire au fonctionnement de cette pratique. » (Lambert Wiesing,
Sehen lassen, op. cit., p. 14).
197
Ibid., p. 19-24.
198
L’exemple n’est peut-être pas le meilleur ici puisque, de par sa grandeur et son aspect
assez spectaculaire, la Tour Eiffel semble plutôt se prêter au « show ». Mais imaginons être
sur le toit d’un immeuble à plusieurs kilomètres de la tour. Pour attirer l’attention sur celle-ci,
j’aurai alors besoin de « point at » elle, de la désigner par exemple du doigt.
76
�monstration étant celui que procure l’exhibitionnisme : la victime d’un exhibitionniste
est directement confrontée à la nudité de celui qui se montre et n’a donc pas vraiment
le choix de voir. Alors que l’exemple paradigmatique du deuxième type de
monstration est plutôt, me semble-t-il, le geste par lequel on montre la lune : il est
possible ici de décider de ne pas lever la tête pour regarder la lune et ce à quoi celui à
qui on montre la lune est directement confronté, c’est plutôt le doigt que l’on pointe
alors sous son nez.
On pourrait entrer dans plus de détails ici et tenter de mieux discerner la différence
entre montrer ainsi par confrontation ou par désignation. Mais le plus important pour
Wiesing à ce stade, c’est plutôt de se demander, à partir de ces descriptions (et en
admettant qu’il s’agisse là des deux seules catégories de la monstration)199 : quels
point communs partagent donc ces deux pratiques du montrer ? Qu’est-ce qui fait que,
dans un cas comme dans l’autre, il s’agit bel et bien de monstration ? En effet, en
énumérant et en explicitant les différentes conditions (ou les différents invariants) qui
font que, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit bien de montrer quelque chose,
nous devrions en arriver à une première caractérisation de ce qu’est toujours montrer.
2. 3. Les quatre conditions de la monstration
Quelles conditions sont nécessaires afin d’avoir bel et bien affaire à de la monstration,
au sens direct ou indirect ? Le fait de montrer étant une action, la question peut, selon
Wiesing, se reformuler de la manière suivante : qu’est-ce qu’il faut comme ensemble
de conditions pour qu’un acte de monstration soit performativement réussi
(performativ gelungen) et que donc, à un niveau pragmatique, quelque chose ait
effectivement été montré à quelqu’un ?200
Une première condition au montrer qui apparaît comme triviale à Wiesing ici, c’est
que dans tous les cas où quelque chose est montré à quelqu’un (qu’il s’agisse de
confrontation de désignation), il faut au moins deux termes, deux individus : « celui
qui montre » et « celui à qui il est montré quelque chose ». On aurait en effet de la
peine à dire ce que pourrait bien vouloir dire : « se montrer quelque chose à soimême ». Ainsi on peut dire que :
[…] zum Zeigen gehören immer mindestens zwei : ein Zeigender und jemand,
dem es gezeigt wird.201
199
On l’a vu, la philosophie de Wiesing se présente parfois également comme
aristotélicienne. D’où le fait que je me permette de catégoriser ici de cette manière le rapport
entre montrer en général, c’est-à-dire comme phénomène sui generis (Lambert Wiesing,
Sehen lassen, op. cit., p. 13), et ses deux « espèces » que sont la monstration par confrontation
et la monstration par désignation.
200
Ibid., p. 25.
201
« Pour montrer il faut être deux : un montreur [ou : quelqu’un qui montre] et quelqu’un à
qui quelque chose est montré. » (Ibidem.)
77
�De même qu’il faut une espèce de troisième terme qui constitue pour ainsi dire le
« centre » de cette relation du montrer : c’est l’objet même qui est montré. Objet qui
peut lui, par contre, être identique à l’un des deux autres termes. Je peux « me »
montrer à quelqu’un (c’est ce que fait l’exhibitionniste), tout comme je peux amener
quelqu’un d’autre à se découvrir lui-même devant la glace, par exemple après que je
l’aie maquillé.
Ensuite, une deuxième chose qui semble aller de soi, c’est qu’il faut
qu’effectivement, lorsqu’un individu A montre x à un individu B, l’individu B
perçoive x. Comme le dit Wiesing :
Gezeigt wird etwas dann und nur dann, wenn der Akt des Zeigens dazu führt,
dass das Gezeigte auch wirklich von jemandem gesehen wird […]202
En effet, si A essaie de montrer x à B mais que, à aucun moment, B ne perçoit x (par
exemple parce qu’il lui tournerait le dos), alors la « tentative » de monstration a
échoué et x n’a pas été montré à B.
Ce qui signifie aussi, troisièmement, qu’il faut que B ait compris que, en montrant
x, A désirait bel et bien montrer x, et pas y. En effet, imaginons (cet exemple est de
moi) que A souhaite montrer La Joconde à B. Imaginons aussi que B, c’est-à-dire
celui à qui on veut montrer La Joconde, soit encadreur de profession et donc tout-àfait passionné par la forme du cadre des tableaux. Imaginons ensuite que A amène B
au Louvre, devant La Joconde, et y pointe le tableau du doigt en disant : « Voici le
tableau que je voulais te montrer : La Joconde ». Si B, totalement obnubilé par le
cadre de l’image (par son Bildträger), en oublie de regarder « à l’intérieur » du cadre
et n’y distingue même pas le sourire de La Joconde, puis que A et B s’en vont, alors
A aura-t-il bel et bien montré la Joconde à B ? Si B, au sortir du musée, ne sait
toujours pas si La Joconde est un portait ou une nature morte, un homme ou une
femme, peut-on dire qu’il a vu la Joconde et que A la lui a montrée ?
Vraisemblablement pas. Il faut donc que l’individu B, auquel A montre quelque
chose, en plus de percevoir x, comprenne que ce que A veut lui montrer, c’est bel et
bien l’objet x – et pas autre chose. C’est-à-dire qu’il faut que B prenne en compte
l’intention de A. Or dans notre exemple, l’intention n’était pas de montrer le cadre de
La Joconde (bien que cela eût pu l’être), mais bien de montrer l’image « à l’intérieur »
du cadre : ce que Wiesing appelle, pour le distinguer du support matériel d’un tableau,
son Bildobjekt. Ainsi, pour qu’un acte de montrer soit réussi, il faut aussi que
l’intention derrière l’acte soit comprise par celui à qui l’on montre quelque chose.203
202
« Il n’est montré quelque chose que lorsque l’acte du montrer conduit à ce que ce qui est
montré soit effectivement vu par quelqu’un […] » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p.
19.)
203
Dans un style plus « externaliste » à la Wittgenstein, on pourrait aussi dire ici : « il faut
que B respecte les règles du jeux de la monstration auquel l’invite A ». Cela pourrait nous
éviter d’avoir recours à ce concept en fait assez problématique en philosophie de l’esprit
78
�On peut ainsi dire :
Zeigen ist das Sehen-Lassen von etwas Intendiertem.204
Mais qu’est-ce que cette troisième condition quant à la réussite d’un acte de
monstration implique-t-elle à son tour ? On le voit bien : l’idée d’homme (ou
d’« animal intelligent ») vu que ce n’est qu’à l’homme (et peut-être à certains
animaux) qu’il peut sembler justifié d’attribuer des intentions.205 Ce ne sont que les
humains qui peuvent vouloir montrer quelque chose, tout comme ce n’est que d’un
homme que l’on peut dire qu’il a compris ce que l’on voulait lui montrer. Or c’est là
une thèse décisive aux yeux de Wiesing, à laquelle je propose par la suite de référer
par l’étiquette de CM4 (comme Condition au Montrer 4), selon laquelle : il faut être
un homme pour montrer. Un légume, une pierre ou une image, au contraire, ne
peuvent rien prétendre montrer, tout comme on ne peut rien prétendre leur montrer.
Or cette quatrième condition au montrer était en fait déjà présupposée, plus ou
moins implicitement, par tous les exemples présentés jusqu’ici et par certains propos
dans lesquels on tenait en fait déjà pour acquis que c’était à chaque fois des humains
entre eux qui se montraient des choses. Alors comment expliciter maintenant plus
clairement les raisons pour lesquelles seul l’homme est en mesure de montrer,
comment en démontrer la justesse et surtout : comment en voir les implications à
propos de la monstration par l’intermédiaire d’images ? Car cette thèse CM4 joue un
rôle crucial pour la théorie de la monstration par images que développe Wiesing dans
SL.
2. 4. Monstration, action et intention : trois problèmes
On peut tenter de mieux comprendre cette thèse CM4 en décomposant
l’argumentation qui y mène, cela afin d’en dégager plus clairement les prémisses. On
se rend alors compte que cette thèse CM4 semble en fait également déductible de
deux prémisses différentes. En effet, on peut partir, pour démontrer la thèse selon
laquelle seul l’homme montre, de la thèse PA1 (comme Prémisse Anthropologique 1)
selon laquelle : seul les hommes ont des intentions. C’est d’ailleurs ce que l’on vient
de faire. Ou alors, on peut partir de la thèse peut-être encore plus triviale PA2 (comme
Prémisse Anthropologique 2) selon laquelle : seul les hommes agissent.206 En effet, il
d’intention. Toutefois, ceci ne nous permettrait pas de poser certaines thèses dont, on le verra,
Wiesing a besoin pour contredire la « nouvelle mythologie de l’image ».
204
« Montrer c’est laisser voir quelque chose d’entendu [ou : l’objet de son intention]. »
(Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 21.)
205
Il peut sembler important d’émettre ce doute quant à la capacité ou non, pour tel ou tel
animal, de montrer. Ce débat ne nous intéresse toutefois pas particulièrement ici. Je le
laisserai donc de côté et n’ajouterai pas de manière systématique, après « les hommes » : « et
peut-être certains animaux ».
206
C’est ce que dit Wiesing quand il commence une phrase par : Da jede Handlung ein
Subjekt voraussetzt […] « Puisque chaque action suppose un sujet […] » (Lambert Wiesing,
79
�semble correct de dire que montrer requiert une intention de montrer, or seul les
hommes ont des intentions, donc seul les hommes peuvent montrer. Tout comme il
semble correct de défendre que montrer est une action, or seul les hommes peuvent
agir, donc seul les hommes peuvent être en mesure de montrer.207 Mais maintenant, et
au-delà de la cohérence de ces deux déductions, à quoi cela sert-il exactement à
Wiesing de dégager ces deux thèses PA1 et PA2, selon lesquelles seul l’homme est
capable d’agir et d’avoir des intentions ?
Ces démonstrations peuvent apparaître, à première vue, comme à la fois un peu
triviales et assez vaines : personne n’a en effet du attendre Wiesing ou ces déductions
pour en arriver à la conclusion selon laquelle les pierres et les légumes n’étaient, à
proprement parler, ni en mesure d’agir, ni de montrer, ni d’avoir des intentions.
Cependant, et c’est ici que cela devient (je l’espère) intéressant, ces deux thèses ou
prémisses PA1 et PA2 peuvent également sembler, pour au moins trois raisons,
problématiques et justifier le fait que Wiesing commence par soigneusement
distinguer ces quatre conditions au montrer en général ainsi que ces deux prémisses
possibles de CM4 avant de s’intéresser plus spécifiquement aux images.
Premier problème, ne dit-on pas, bien souvent : « l’horloge montre l’heure » ? Ou
encore : « cette image montre la Tour Eiffel » ? Enfin : « cette voiture fait du bruit » ?
Contrairement à ce que l’on vient de dire, il ne semble en fait pas si facile que cela de
savoir à quoi il est légitime d’attribuer la capacité d’agir et d’avoir des intentions ou
non. Dans le langage commun, nous attribuons la capacité d’agir, de vouloir et de
montrer à bien plus de choses qu’aux seuls hommes. Nous attribuons régulièrement la
capacité de montrer à des objets inanimés tels que des images par exemple. Wiesing
aurait-il donc tort en prétendant que seul les hommes agissent, ont des intentions et
montrent ? Ou faut-il, à partir de ce constat, opérer une distinction entre ce
qu’est réellement une action et ce que, par une sorte d’« abus de langage », on traite
comme une action, mais qui n’en est en fait pas vraiment une ?
Deuxième problème, il existe tout un courant théorique actuel qui a pour objet
l’image et dans lequel on affirme, au contraire, que l’image fait et montre
effectivement des choses et que ce n’est donc pas que l’homme qui montre.
Autrement dit, il existe des théoriciens qui contredisent explicitement CM4, ses
prémisses et ses conséquences. L’image, selon ces théoriciens, ne fait d’ailleurs pas
que montrer : elle réfléchit aussi, elle dénonce parfois, elle oppresse. Mais alors qui a
raison et en quel sens ? Lambert Wiesing ou ce qu’il appelle, pour mieux s’en
distinguer, la nouvelle mythologie de l’image (die neue Bildmythologie) ?
Enfin, troisième problème, il existe selon Wiesing encore une autre approche de la
monstration par l’intermédiaire d’images que sa phénoménologie descriptive et cette
« nouvelle mythologie » : c’est ce que Wiesing appelle la théorie de l’illusion
Sehen lassen, op. cit., 43.) On reviendra tout-de-suite sur l’équivalence, dans cette phrase,
entre « homme » et « sujet ».
207
La différence entre ces deux déductions est que, à nouveau dans un langage traditionnel
aristotélicien, montrer est une action spécifique appartenant à la catégorie, plus générale, des
actions. Être capable d’agir n’implique donc pas forcément d’être capable de montrer, mais
en constitue plutôt une des conditions nécessaires.
80
�(Illusionstheorie). À l’intérieur de celle-ci, on défend une chose principale, qui est que
l’image fonctionne comme un signe au travers duquel on montre, à celui qui la
regarde, une illusion. Or si cette idée ne semble pas directement contredire la théorie
de la monstration de Wiesing présentée jusqu’ici, une autre question se
pose toutefois : comment, à partir de ce que l’on a vu, en arrive-t-on à cette
conclusion sur le caractère illusoire de ce que l’image montre ? Et est-elle légitime ou
non ? Car selon Wiesing, il s’agit en fait là d’une erreur qu’il faut à tout prix éviter de
faire si l’on veut finalement réussir à bien distinguer ce à quoi sert l’image lorsque
l’homme l’utilise comme un signe de ce qu’elle est véritablement : une pure visibilité.
Il semble ainsi que Wiesing, en dégageant ses quatre conditions au montrer en
général, ne fait pas qu’affirmer des banalités. Bien plutôt, il se prépare à résoudre par
là au moins trois problèmes relatifs aux images : celui posé par l’usage commun que
l’on fait de verbes comme « faire » et « montrer » ; celui posé par ce que défend, face
à lui, ce qu’il nomme la nouvelle mythologie de l’image ; et celui posé par la théorie
de l’illusion. Trois problèmes que nous considérerons maintenant dans cet ordre, et
qui nous permettrons ainsi de dégager petit-à-petit la question de l’être phénoménal
purement visible de l’image.
81
�3. Montrer avec des images
3. 1. Le langage commun de l’action et de la monstration (1er problème)
La question est au fond, dans le cadre de ce premier problème, la suivante : qui
montre ?208 Autrement dit, à qui ou à quoi est-il légitime d’attribuer la capacité de
montrer ? Comme on l’a vu dans nos exemples, le meilleur candidat semble ici être
l’homme (et peut-être certains animaux). En effet, il a été établit plus haut que, pour
qu’un acte de monstration soit performativement réussi, il faut que les deux termes de
la relation du montrer se soient mis d’accord sur l’intention de celui qui agit en
montrant quelque chose. Or seul l’homme semble être capable d’agir en nourrissant
une intention (par exemple celle de montrer quelque chose). Donc seul l’homme peut
montrer. Toutefois, et contre cette conception des choses, il semble qu’il y ait ce que
nous avons appelé le « langage commun » dans lequel nous attribuons la capacité de
montrer ou plutôt : nous employons comme sujet grammatical du verbe montrer toute
une série d’être inanimés qui semblent, à y réfléchir un peu plus, ne pas être
réellement capable de montrer ou même d’agir. Alors comment résoudre cette
tension entre notre démonstration, résultat elle-même de nos intuitions les plus
banales à propos des capacités (et des limites) des choses, et le langage commun que
nous employons dans la vie de tous les jours ?
Selon Wiesing, en distinguant deux usages différents du langage : son usage
métaphorique et son usage littéral.209 En effet, et Wiesing prend ici l’exemple qui
suit : lorsque l’on dit, dans la vie de tous les jours, que « ma voiture m’avertit d’une
plaque de verglas », tout le monde est bien conscient que ce n’est pas réellement et
littéralement ma voiture qui m’avertit. 210 Ma voiture n’est pas véritablement un
individu capable d’avertir qui que ce soit. Alors par une telle phrase, on est en fait en
train d’user de la langue de manière métaphorique. C’est-à-dire que l’on associe là,
sans le dire explicitement, la voiture à un humain – ou alors, si l’on croit
véritablement qu’une voiture est capable d’avertir les gens, on est carrément dans
l’irrationnel. On pratique ainsi, par un tel usage métaphorique du langage, une espèce
d’anthropomorphisation de l’objet inanimé « voiture ». Cela alors que quand je dis
que : « Paul me montre La Joconde », je veux bien dire par là que c’est Paul qui me
montre, au sens littéral, La Joconde.
Mais alors qu’est-ce qui permet, selon Wiesing, de distinguer précisément l’usage
métaphorique de l’usage littéral de verbes impliquant une action tels que « montrer »,
« faire », « avertir » ? Le fait que l’on ait affaire ou non, à l’endroit du sujet de la
phrase, à un sujet seulement grammatical ou à un sujet grammatical agent réel. Or si
l’expression « sujet grammatical » semble claire, qu’entendre par ce que je propose de
traduire ici par « sujet grammatical agent réel » et que Wiesing nomme
parfois wirklich handelndes Subjekt mais aussi, souvent, et plus simplement, das
208
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 42-44.
Sur cette distinction, voir principalement : Ibidem.
210
Ibid., p. 42.
209
82
�Subjekt ?211 Le fait qu’en plus d’être le sujet de la phrase au niveau grammatical, le
sujet agent réel soit toujours, à un niveau ontologique, un sujet au sens moderne (ou
lockéen) du terme,212 c’est-à-dire tout simplement : une personne, un humain, un
individu, une conscience. En effet, comme il a déjà été suggéré plus haut (au travers
de PA1 et PA2), seul quelque chose de vivant, de mouvant et d’intelligent de la façon
dont l’est l’homme, c’est-à-dire seul ce que j’appellerai désormais un « sujet
agent réel », semble réellement pouvoir agir en nourrissant une intention d’agir. Alors
lorsque l’on emploie, dans une phrase, comme sujet d’une action, une chose morte et
inanimée (c’est-à-dire quelque chose qui ne peut en aucun cas être le sujet agent réel
et concret d’une action), on emploie simplement le langage de manière métaphorique.
On anthropomorphise, par cet emploi métaphorique du langage, le sujet de l’action –
sans toutefois croire vraiment que le sujet de la phrase soit bel et bien l’égal d’un sujet
agent réel. On est en effet conscient, dans la vie de tous les jours, par exemple dans le
cas de l’emploi métaphorique de verbes comme « montrer » pour décrire ce que
« fait » l’image, que celle-ci n’utilise en fait pas ses « petits doigts » pour montrer
quelque chose mais que c’est bien un homme, par exemple un peintre, qui a produit
cette image afin de montrer quelque chose ou encore un journaliste qui utilise telle
photo pour illustrer son article.
Alors pour caractériser cet emploi métaphorique du langage, Wiesing parle aussi
d’ellipse (elliptische Formulierung).213 Au lieu de se compliquer la vie et de dire, à
des fins de clarté qui ne servent pas toujours à grand chose : « Par cet image,
quelqu’un (tel ami, vendeur, journaliste, etc.) me montre la Tour Eiffel » on dit de
manière elliptique : « Cette image montre la Tour Eiffel » – tout en sachant en fait
bien que ce n’est pas littéralement l’image elle-même qui montre quoi que ce soit
mais bien une ou plusieurs personnes qui utilisent l’image à cette fin. Ou encore, au
lieu de dire : « Le système de sécurité électronique de la voiture a été conçu de
manière à ce que, lorsqu’il se trouve un plaque de verglas à proximité, les hautparleurs de la voiture émettent un son que j’ai appris à associer à un signal d’alarme »,
on préfère dire plus simplement : « La voiture m’avertit d’une plaque de verglas. »
Cela même si, encore une fois, il est assez clair que seul un sujet, c’est-à-dire seul un
homme, est réellement capable d’avertir, et non seulement d’être le sujet grammatical
d’une phrase employant métaphoriquement le verbe « avertir ». Pour résumer, lorsque
l’on emploie, dans la vie de tous les jours, un objet inanimé comme sujet d’une
action, on ne commet donc pas directement d’erreur grammaticale (grammatische
Verstellung), 214 mais on emploie elliptiquement et métaphoriquement, à des fins
purement pratiques215 et en connaissance de cause, un sujet simplement grammatical
comme un sujet agent réel.
211
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 44.
Par l’expression « sujet moderne », je réfère à la notion de sujet telle qu’élaborée
justement chez Locke, mais dont on peut selon Alain de Libera tracer la genèse au moyenâge, voir : Alain de Libera, L’invention du sujet moderne, op. cit.
213
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 44.
214
Ibidem.
215
Ibid., p. 87.
212
83
�On pourrait, à ce stade, entrer dans des considérations plus précises sur ce qu’est
une ellipse, tout comme on pourrait tenter d’approfondir la distinction qu’il y a à
faire, selon Wiesing, entre langage littéral et langage métaphorique. On se rendrait
alors compte, me semble-t-il, que la frontière entre ces deux manières de parler est
plus poreuse qu’il ne peut sembler à première vue.216 On pourrait aussi se demander
quel lien nourrit cette conception du sujet humain avec la conception que se fait
Wiesing de ce même sujet dans MW.217 Mais l’important ici est plutôt de bien voir
comment Wiesing pose là une distinction fondamentale entre deux sortes de sujet : le
sujet agent réel (au sens de personne ou d’individu) et le sujet simplement
grammatical. Distinction DF2 (comme Distinction Fondamentale 2) que l’on pourrait
formuler de la sorte : Il y a deux types de sujets : les sujets agents réels et les sujets
seulement grammaticaux. Distinction sur laquelle Wiesing fait donc reposer PA1 et
PA2, sur lesquelles il fait ensuite reposer CM4, puis toute sa théorie de la
monstration. Et distinction qui a ainsi l’avantage de porter en elle toutes les
distinctions que l’on fait traditionnellement entre ce qui est réellement un sujet, un
homme, un individu, une personne, et tout ce qui est dépossédé de ce que l’on attribue
traditionnellement au sujet agent réel, comme : la vie, la liberté, la conscience,
l’intelligence, etc. Une distinction traditionnelle qui, en permettant à Wiesing d’établir
plus solidement CM4, lui permet aussi de mieux contredire la nouvelle mythologie de
l’image.
3. 2. La mythologie de l’image : ce qu’elle est (2ème problème)
Qu’est-ce que cette « nouvelle mythologie de l’image » à laquelle Wiesing consacre
une grande partie de SL ?218 Pour donner une première piste quant à la manière dont
les auteurs lui appartenant219 ont d’appréhender le rapport entre image et monstration,
Wiesing utilise une analogie avec certains des errements auxquels peut parfois
conduire la recherche scientifique à propos non des images, mais du cerveau : la
216
Pour donner un aperçu plutôt ludique de ces questions et de la limite qu’il y a entre
langage théorique sérieux et langage métaphorique, on peut lire : Jacques Derrida, Limited
Inc, Paris : Galilée, 1990. Ou alors on pourra se plonger dans la vaste littérature au sujet du
rapport entre philosophie et métaphore, par exemple dans : Roger M. White, The structure of
metaphor : the way the language of metaphor works, Oxford ; Cambridge Mass. : Blackwell,
1996.
217
Les prémisses anthropologique PA1 et PA2, sur lesquelles s’appuie l’argumentation de SL,
ne me semblent pas particulièrement problématiques. Mais vu que Wiesing entend, dans MW,
remettre un peu en question la notion moderne et cartésienne de sujet (qu’il fait alors
dépendre de la perception), on pourrait se demander pourquoi il semble ici appréhender la
notion de sujet de manière moins originale.
218
C’est la longue partie intitulée : « La nouvelle mythologie de l’image : les images se
montrent elles-mêmes » (Die neue Bildmythologie : Bilder zeigen sich selbst) (Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 78-105.)
219
La nouvelle mythologie de l’image telle que la décrit Wiesing regroupe principalement les
auteurs suivants : Gottfried Boehm, Günter Figal, W. J. T. Micthell, Horst Bredekamp, et
Andreas Cremonini.
84
�Neurowissenschaft. 220 En effet, selon Wiesing, dans la recherche actuelle sur le
cerveau, il n’est pas rare que l’on considère celui-ci comme étant littéralement un
sujet agent réel. On y prétend alors, au travers de discours qui se prétendent
scientifiques, que « le cerveau désire » ou que « le cerveau réfléchit ». Or par des
affirmations comme celles-ci, on ne fait, selon Wiesing, pas une simple ellipse ni ne
procède par métaphore vu que les propos que l’on tient en pareille circonstance sont à
prendre pour des énoncés scientifiques donc littéraux. Bien plutôt : on y commet une
erreur de catégorie (Kategorienfehler).221 En effet, le cerveau lui-même ne pense pas,
ni ne désire quelque chose, mais c’est bien à chaque fois un sujet agent réel ou, plus
simplement, un homme qui désire ou qui réfléchit en monopolisant (entre autres) les
aptitudes que lui confère son cerveau. On confond donc là deux choses tout-à-fait
différentes et appartenant à des catégories différentes : l’homme et son cerveau. On
anthropomorphise le cerveau, que l’on prend à tort pour une homme.222 Alors les
scientifiques et chercheurs qui entretiennent cette confusion, Wiesing va jusqu’à les
accuser d’appartenir à une certaine « mythologie krypto-religieuse des neurones »
(kryptoreligiöse Neuromythologie).223
Mais maintenant, en quoi cela est-il analogue à ce que disent nos « mythologues de
l’image » ? En ce que le type d’erreur est le même : il s’agit également (entre autres
erreurs) d’une erreur ou d’une confusion catégoriale, impliquant une
anthropomorphisation. En effet, ces nouveaux mythologues défendent, contre CM4
(et donc contre PA1, PA2 et DF2), que (et c’est là leur thèse principale MI1 comme
Mythologie de l’Image 1) : il est littéralement vrai que l’image montre elle-même des
choses. Or en disant cela, ils ne sont plus simplement en train de pratiquer une ellipse
ou un usage métaphorique de la langue, mais ils anthropomorphisent délibérément,
consciemment et littéralement les images. Au lieu de voir le sujet agent humain
derrière toute action de montrer, ils lui substituent l’image elle-même dont, à défaut
de pouvoir faire de manière cohérente un sujet agent réel ils font, selon Wiesing, un
sujet mythique (mythisches Subjekt) – d’où cette appellation de « mythologie de
l’image ».224 Ils confondent ce que soi disant l’image serait capable de faire seule
avec ce qu’il est possible pour l’homme de faire avec des images.
Car Gottfried Boehm parle bel et bien de l’action propre des images (das
eigentliche Tun der Bilder),225 alors que W. J. T. Mitchell se pose de son côté, dans
220
Wieising évoque deux fois la science du cerveau dans SL, voir : Lambert Wiesing, Sehen
lassen, op. cit., p. 78-81.
221
Ibid., p. 44.
222
On pourrait aussi accuser, me semble-t-il, un tel procédé rhétorique de fonctionner par
métonymie abusive, c’est-à-dire en prenant la partie pour le tout ou, ce qui est encore pire : en
réduisant le tout à l’une de ses parties. L’avantage étant alors que, si l’homme ce n’est que
son cerveau, en expliquant scientifiquement comment fonctionne le cerveau, on pourra
prétendre expliquer ce qu’est l’homme tout court.
223
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 80.
224
Ibidem.
225
Wiesing donne ici sur Boehm la référence suivante : Gottfried Boehm, « Das Zeigen der
Bilder », in : Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren, Gottfried Boehm / Sebastian Egenhofer /
85
�Das Leben der Bilder sérieusement la question de savoir ce que veut l’image ? (Was
will das Bild ?),226 que Horst Bredekamp propose une théorie de l’acte de l’image
(Bildakt) et une éthique de l’image (Bildethik) dans lesquelles il désire rendre compte
de la force vivante de l’image,227 alors qu’Andreas Cremonini écrit lui de son côté
que :
Bilder tun etwas. Sie verfügen, so könnte man sagen, über eine eigentümliche
Handlungsform.228
Alors au lieu d’expliquer les effets d’un acte de monstration par la manière dont,
pragmatiquement, celui-ci se passe lorsque des sujets agents réels (des hommes)
utilisent des images afin de montrer des choses, avec des intentions et dans des
contextes spécifiques, ils inventent un sujet mythique, inhérent à l’image, qui agirait
de manière autonome et en son nom. Ce n’est ainsi plus l’homme qui montre au
travers des artefacts que sont les images, mais ce sont les images qui, disposant de
mystérieuses facultés, montreraient elles-mêmes des choses. Ces auteurs commettent
donc, on l’aura compris, une erreur de catégorie dans laquelle il s’agit de :
[…] [das] Bild zu vermenschlichen und zu beseelen.229
Et du même coup, à défaut de véritablement réussir à faire de l’image un sujet agent
réel, il s’agit là également de :
[…] [ein] Materielles Ding zu einem Mythischen Subjekt [zu] verklären.230
C’est un peu, nous dit Wiesing, comme si ces auteurs défendaient là une espèce de
mystic turn.231 Qualificatif qui me semble bien faire écho à la « krypto-religion » dont
Christian Spies (éds.), München : Wilhelm Fink, 2010, p. 19-54, ici p. 48. (Lambert Wiesing,
Sehen lassen, op. cit., p. 79.)
226
Wiesing donne ici sur Mitchell la référence suivante : W. J. T. Mitchell, Das Leben der
Bilder : Eine Theorie der visuellen Kultur, München : C. H. Beck, 2005, p. 46-77. (Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 79.) La position de Mitchell me semble toutefois moins
caricaturale que ne semble le prétendre Wiesing ici. Voir par exemple : W. J. T. Mitchell, «
Que veulent réellement les images ? », in : Penser l’image, Emmanuel Alloa (éd.), Paris : Les
presses du réel, 2010, p. 27-47.
227
Wiesing donne sur Bredekamp la référence suivante: Horst Bredekamp, Theorie des
Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Berlin : Suhrkamp, 2010, p. 55. (Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 85.)
228
« Les images font quelque chose. Elle disposent, pourrait-on dire, d’une forme propre
d’action. » (Ibid., p. 79.) Wiesing cite ici : Andreas Cremonini, « Was ins Auge sticht : Zur
Homologie von Glanz und Blick », in : Movens Bild : Zwischen Evidenz und Affekt, Gottfried
Boehm / Birgit Mersmann / Christian Spies (éds.), München : Wilhelm Fink, 2008, p. 93-118,
ici p. 93.
229
« […] humaniser et animer l’image. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 81.) Or
il s’agit là d’un problème que l’on pouvait déjà entendre dans la critique que formulait
Wiesing à l’encontre de l’approche anthropologique et des thèses AA1 et AA2 dans AP.
230
« […] faire d’une chose matérielle un sujet mythique. » (Ibid., p. 80.)
86
�nous parlions plus tôt pour décrire ce à quoi s’adonnent, selon Wiesing, certains
spécialistes du cerveau. C’est même, selon Wiesing, comme si ces nouveau
mythologues cultivaient une espèce assez étrange de rapport magique aux choses
(Dingmagie).232 Une magie qui, je le répète, pose d’autant plus problème qu’elle se
réclame strictement scientifique.
3. 3. La mythologie de l’image : trois critiques
Sous couvert de scientificité, c’est donc, me semble-t-il, pour synthétiser, de faire
preuve d’une certaine irrationalité que Wiesing accuse ces auteurs. En effet, le champ
lexical des erreurs et confusions dont sont, selon Wiesing, victimes ces auteurs (je les
rappelle : celles de pratiquer une anthropomorphisation, d’avoir une approche
mystique, de vouloir faire de la magie, d’animer des êtres inanimés et de proposer des
mythes) me semble bien être celui de l’irrationnel. Reproche général d’irrationalité
que l’on peut alors, pour reformuler brièvement la vaste critique que produit Wiesing
à ce sujet, réordonner comme se déployant au travers de trois critiques principales :
une première d’ordre ontologico-sémantique, une deuxième d’ordre méthodologique
et une troisième d’ordre plutôt déontologique.
En effet, l’erreur de ces nouveaux mythologues est d’abord ontologique et
sémantique puisque, comme on l’a dit, ils confondent ontologiquement et
sémantiquement deux types de sujets : le sujet grammatical d’une phrase telle que
« l’image montre la Tour Eiffel » et le sujet agent réel de l’action au travers de
laquelle quelqu’un utilise une image afin de montrer quelque chose à quelqu’un
d’autre. Ils ne semblent pas percevoir la différence ontologique pourtant cruciale entre
ces deux types de sujets, et commettent du même coup une erreur grammaticale.
Ensuite, leur erreur est d’ordre méthodologique puisque, comme y insiste Wiesing,
aucune donnée empirique ne confirme ou même ne semble indiquer que l’image vit et
désire.233 On aura beau observer et décrire l’image dans les circonstances que l’on
veut (et autant de temps que l’on le souhaite) : on ne l’observera jamais, subitement,
prendre vie (ou du moins, on ne l’a encore jamais observé). On a donc affaire, de la
part de ces auteurs, à des assertions :
[...] die sich überhaupt nicht aus der Erfahrung, und sei es einer metaphorisch
beschriebene Erfahrung, ableiten lassen, sondern die in das Bild
Eigenschaften hineinlegen und projizieren, die ein Lebewesen haben muss.234
231
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 81.
Ibid., p. 87.
233
Comme on l’a vu dans notre deuxième chapitre, Wiesing donne méthodologiquement la
primauté à la perception. Il peut donc sembler assez naturel qu’il défende contre la
mythologie de l’image une certaine forme d’empirisme.
234
« […] qui ne se laissent vraiment pas dériver de notre expérience, que celle-ci soit décrite
de manière métaphorique, mais qui projettent dans l’image et lui attribuent des propriétés qui
232
87
�Car au lieu de respecter un minimal de rigueur scientifique, leur manière même de
procéder ne semble qu’autoriser, selon Wiesing, à des espèces de divagations
invérifiables et infalsifiables,235 ou encore à des Sprachspielereien.236 Des « petits
jeux de langage » dans lesquels l’ambition rhétorique l’emporte sur la clarté que l’on
serait en droit d’attendre de propos théoriques sérieux.
Mais enfin, troisièmement, et c’est peut-être du point de vue de Wiesing l’erreur la
plus problématique que commettent ces chercheurs : ceux-ci « kitschisent »
(verkitschen) l’image et la placent, ce faisant, dans le domaine du numineux.237 Or
qu’est-ce que le fait de kitschiser un objet ? Et qu’est-ce que le numineux ?
« Kitschiser » un objet, c’est justement, selon Wiesing, empruntant ici à Bazon
Brock,238 le fait de lui attribuer une âme, de considérer cet objet comme ayant donc un
pouvoir égal à celui que l’on attribue habituellement à un être vivant – tout en
reconnaissant que celui-ci a l’apparence d’un simple objet.239 En effet, selon Brock, le
kitsch ce n’est pas seulement le « mauvais goût » ou encore un attribut formel de
certains objets. C’est un traitement (Umgang) que l’on peut réserver à un objet
apparemment inanimé, auquel on souscrit cependant une force vitale, et que l’on a dès
lors tendance à respecter pour cela, voir à vénérer.240 Attitude qui revient ainsi, et l’on
en arrive au deuxième terme de cette critique déontologique, à situer cet objet dans la
sphère très « select » des choses qui sont si hautes et mystérieuses que, face à elles, on
ne peut ni ne doit plus chercher à comprendre ou à expliquer mais seulement à
honorer ou à adorer, tel que l’on peut par exemple adorer certains objets et certaines
icones dans divers cultes religieux. En effet, le « noumène » (qui n’est pas la même
chose que le numineux mais en partage la racine étymologique) dans sa définition
kantienne, c’est ce à quoi nous n’aurons jamais véritablement accès. Alors que le
numineux, c’est un concept forgé à l’intérieur de l’anthropologie du fait religieux241
afin de caractériser les objets que l’homme de foi, dans son rapport au sacré,
considère comme l’inaccessible, le « tout autre » ou encore, pour le dire dans le
vocabulaire de l’anthropologue Mircea Eliade : le hiérophanique.242 Objets qui en
sont celles que seul un être vivant doit avoir . » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p.
97.)
235
Sur la notion de falsifiabilité (Falzifierbarkeit), voir : Ibid., p. 100.
236
Ibid., p. 75.
237
Ibid., p. 105.
238
Wiesing donne ici sur Brock la référence suivante : Bazon Brock, « Kitsch als
Objektmagie », in : Der Barbar als Kulturheld, Gesammelte Schriften 1991-2002, Köln :
DuMont, 2002, p. 578-581, ici p. 578. (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 105.)
239
Ibidem.
240
Brock ne parle pas explicitement de « vénération » mais, face à des objets que l’on
considère de manière kitsch, il parle d’une attitude dans laquelle nous nous « mettons à
genoux » (auf die Knie fallen). (Ibidem.)
241
Dans le domaine de l’anthropologie du fait religieux, c’est avant tout Rudolf Otto qui
théorise le numineux, dans : Rudolf Otto, Le Sacré (1917), trad. par André Jundt, Paris :
Payot, 2015.
242
Mircea Eliade, anthropologue du fait religieux (et connaisseur de l’œuvre Rudolf Otto),
parle de hiérophanie pour désigner ce que, à l’intérieur d’une religion, on considère sacré.
Voir : Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris : Payot, 1983, p. 15-45.
88
�deviennent profondément (voir absolument) inexplicables, incompréhensibles, et qui
possèdent une espèce d’aura qui, on le sent bien, ne devrait pas particulièrement plaire
à Wiesing. En effet, en plus de l’arrière-gout irrationnel d’une telle notion d’objet
numineux, celle-ci semble impliquer que, face à un tel objet appartenant au numineux,
on doive abandonner toute espérance de vouloir un jour le comprendre et l’expliquer.
On devrait donc irrémédiablement, face à l’image, consentir à mettre de côté
l’ambition même qui fonde le projet théorique de Wiesing dans SL de réussir à
expliquer les phénomènes de monstration par l’intermédiaire d’images. Alors si l’on
veut, au contraire, éviter ces conséquences assez catastrophiques pour Wiesing, le
constat suivant s’implique :
Möchte man das Bild […] nicht zu einem Ort des Numinosen und des Kitsches
verklären, dann gilt es, einen Grundgedanken ernst zu nehmen: Zeigen ist eine
Praxis.243
Or si l’on prenait maintenant la citation précédente au mot, il ne nous resterait plus
qu’une chose à faire ici : passer à une description plus précise de pratiques concrètes
de monstration par l’intermédiaire d’images, dans lesquelles on appliquerait à chaque
fois le programme de pragmatique phénoménologique que propose ici Wiesing qui
consiste, dans chaque cas que l’on voudrait décrire, à se demander : « qui montre à
qui quoi à l’aide de quoi ? » (wer zeigt wem was womit ?). C’est d’ailleurs ce qui
vient dès la page qui suit le passage précédemment cité, dans la troisième (et dernière)
partie de l’ouvrage, où l’on trouve six descriptions d’actes de monstrations distincts
soit par leur contexte, soit par leur manière de fonctionner et les règles qu’ils mettent
en jeux, soit par ce qu’ils montrent, soit encore par l’objet ou le médium au travers
duquel il est montré quelque chose.
Toutefois, il me semble que l’on ne devrait ici, ne serait-ce que par charité
intellectuelle, conclure de cette manière si tranchée cette partie consacrée au travail de
ces « mythologues ». En effet, par delà l’absurdité apparente de cette thèse MI1, selon
laquelle l’image montre elle-même des choses, quelles sont pour le moins leurs
intentions ? Et si vraiment leur position s’avère à ce point insoutenable, qu’est-ce qui
fait que Wiesing s’y attarde de cette manière, au point d’en faire l’un des thèmes
principaux de l’ouvrage ? Autrement dit, qu’est-ce que Wiesing, malgré son attitude
très critique à l’égard de leurs théories, « achète-t-il » tout-de-même chez ces
auteurs ?
On trouve un premier indice de l’intérêt et du crédit relatif que Wiesing accorde
tout-de-même à leur travail dans le fait qu’il définisse leur approche comme une
mythologie. Comme le dit lui-même Wiesing dans MW (et comme on devrait ici
l’avoir encore à l’esprit), accuser, comme il le fait, ces auteurs de proposer une
explication mythologique d’un phénomène, ce n’est pas seulement les accuser d’être
243
« Si l’on ne veut pas mettre l’image dans la catégorie [ou : le lieu] des objets numineux et
du kitsch, alors cela vaut la peine de prendre une pensée fondamentale au sérieux : montrer
est une pratique. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 105.)
89
�dans l’erreur. C’est aussi et en même temps attester du fait qu’ils proposent tout-demême une espèce de modèle explicatif qui, bien qu'inexact, n’en demeure pas moins
un récit qui doive servir à rendre compte d’un phénomène énigmatique.244 Il se
pourrait donc bien que, à un niveau logique, sémantique, méthodologique et
déontologique, ils soient dans l’erreur, mais que ce sur quoi ils mettent le doigt
(l’apparente autonomie et même vie de l’image) soit un phénomène digne d’un
certain intérêt. Alors de quel phénomène ces nouveaux mythologues essaient-ils plus
précisément de rendre compte en allant jusqu’à prêter vie à l’image ?
D’un phénomène qui est passé complétement inaperçu aux yeux d’autres
théoriciens, s’inscrivant eux dans une deuxième approche que présente Wiesing dans
SL : dans la théorie de l’illusion. Théorie que nous présenterons maintenant avant
d’en arriver plus précisément à la critique que produit à son égard (et selon Wiesing
avec une certaine pertinence) la « mythologie de l’image ». Ceci devrait ensuite nous
permettre d’en arriver à ce qui échappe à ces deux approches : l’être phénoménal de
l’image.
3. 4. La théorie de l’illusion : ses deux thèses (3ème problème)
Comme la position phénoménologique de Wiesing et la position dite
« mythologique », la théorie de l’illusion, ou encore : « la position classique de la
théorie de l’illusion » (klassische Position der Illusionstheorie )245 tente à sa manière
de rendre compte de l’acte de la monstration par l’intermédiaire d’image. Or comment
s’y prend-elle ?
Remarquons une première chose ici qui est que pour les auteurs appartenant à cette
théorie de l’illusion, la question du sujet de la monstration par l’image ne semble pas
véritablement se poser. La question principale qui anime le débat inhérent à la théorie
de l’illusion n’est en effet plus : « qui montre par l’intermédiaire d’images ? » ou :
« quel est le sujet de la monstration par images ? » mais plutôt : « qu’est-ce que
montrent les images ? ». Dans la question que pose Wiesing de savoir wer zeigt wem
was womit ? c’est donc surtout le « was » qui les intéresse. À première vue (on y
reviendra bientôt), on semble donc simplement y présupposer que l’image montre, et
cela indépendamment de savoir si c’est le cas à cause de son utilisation par des
hommes ou à cause de sa nature même : indépendamment de savoir ce qu’est plus
précisément la nature du « wer » de la monstration, du sujet de la monstration. La
question devient donc ici : comment l’image montre-t-elle la réalité, comment réfère244
En effet, comme Wiesing le dit dans MW et comme on l’a déjà vu dans notre deuxième
partie : Mythen funktionieren formal wie wissenschaftliche Modelle und umgekehrt. Denn
Modelle und Mythen sind gleichermassen erklärende Erdenklichkeiten angesichts
rätselhafter, empirischer Vorgaben. « Les mythes fonctionnent formellement comme des
modèles scientifique et inversément. Car les modèles et les mythes sont pareillement des
conceptions [ou : manières de penser] face à des données empiriques énigmatiques. »
(Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 21)
245
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., 55-65.
90
�t-elle à la réalité ? Quel rapport y-a-t-il entre une image et l’objet qu’elle dépeint (ou
« dépicte ») ? 246 Comment définir ce lien qui unit l’objet représenté à la
représentation ? Et quelle est la nature du « représenté » ? Or les réponses de la
théorie de l’illusion à ces questions s’articulent au travers de deux thèses principales
qui entretiennent entre elles un lien étroit.
Tout d’abord, celle-ci défend depuis Platon (on comprend pourquoi Wiesing emploi
le terme de « classique » pour faire référence à cette théorie) et au moins jusqu’à
Gombrich, 247 que (et c’est TI1 comme Théorie de l’Illusion 1) : ce que l’image
montre est une illusion. En effet, au-delà de savoir exactement par quels moyens
l’image montre, il est clair pour cette théorie que l’image montre quelque chose qui
n’existe pas : c’est, par exemple, la maison dans l’image, qui n’existe nulle part
réellement. L’image, selon eux, en montrant, ment toujours : elle produit une illusion.
L’image produit une apparence mensongère du réel, quelque chose que Wiesing
qualifie de wissenresistent, de résistant au savoir.248 Apparence qui rend alors celui
qui la regarde victime d’une illusion de réalité. L’être de l’image est ainsi, à
l’intérieur de la théorie de l’illusion, définitivement disqualifiée comme illusion.
Or cette première thèse TI1 contient déjà d’une certaine manière une deuxième
thèse TI2 (comme Théorie de l’Illusion 2), peut-être encore plus fondamentale
(quoiqu’un peu plus discrète) qui est que, puisque l’image imite la réalité, alors :
l’image est toujours un signe du réel. En effet, selon la théorie illusionniste classique,
l’image réfère toujours, d’une manière ou d’une autre, à la réalité. Or il s’agit par là
de dire plus que de simplement constater que, souvent, il existe un lien entre une
image et la réalité qu’elle dépeint : il s’agit de défendre que l’image est entièrement
déterminée par ce lien avec la réalité. Autrement dit, c’est parce que la réalité existe
que l’image peut « exister » sous le mode de l’illusion : c’est-à-dire en référant à cette
réalité, en la copiant, en produisant une illusion de cette réalité. L’image fonctionne
ainsi, en plus d’être une illusion, toujours comme un symbole du réel, par exemple
comme le symbole d’une maison réelle. Et c’est ainsi parce qu’elle imite ou signifie
toujours des choses réellement existantes qu’a contrario l’image est, selon cette
246
Comme dans la première partie de ce travail (à la page 30), j’empreinte ici le verbe
« dépicter » à Nelson Goodman qui emploi lui le verbe anglais : to depict afin de caractériser
le rapport entre les images et ce à quoi elles réfèrent dans : Nelson Goodman, Langages de
l’art, op. cit. En effet, comme on l’avait alors évoqué (et comme on le verra mieux) Nelson
Goodman peut lui aussi être considéré comme un héritier un peu contestataire de cette théorie
de l’illusion. Il ne défend pas explicitement que l’image est une illusion, mais il estime que
c’est bien le lien que l’image entretient à la réalité qui détermine ce qu’elle est.
247
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 55.
248
Wiesing écrit à ce sujet : Illusionen sind wissenresistentes Wirklichkeitsbewusstsein von
etwas, das nicht wirklich existiert. « Les illusions sont des états de conscience au travers
desquels on prend pour réel quelque chose qui n’existe pas, et cela tout en demeurant
imperméable [ou : en résistant] au savoir. » (Ibid., p. 56).
91
�théorie, une illusion. En effet :
Illusionen gibt es nur dann, wenn Phänomene als Erscheinungen von etwas
anderem behandelt werden.249
Or la nature de cet autre, de cet etwas anderem étant d’être réel, il est de la nature de
l’image d’être, au contraire, une illusion, une pure apparence (Erscheinung). Quitte à
me répéter, c’est donc parce que le réel existe lui bel et bien, que la monstration par
l’intermédiaire d’images, en référant à ce réel, produit une simple apparence de ce
réel – apparence dénuée de réalité.
Alors l’un des enjeux qui anime cette théorie de l’illusion, c’est de tenter de mieux
déterminer la nature de ce lien ou de cette référence qui unit l’image, illusoire, à la
réalité. Qu’est-ce que c’est exactement que ce rapport et comment fonctionne-t-il ?
Comment est-il possible qu’une telle manière de référer ou de symboliser les choses
donne-t-elle lieu à l’existence de ces illusions que sont les images ? Et c’est alors
deux réponses principales et concurrentes que formulent les partisans de cette
position. Soit (et c’est là la position proprement platonicienne, à laquelle je référais
dans la première partie de ce travail par l’abréviation AS2) l’image réfère au monde
par mimesis, c’est-à-dire parce qu’elle lui ressemble. Soit, et c’est là une réponse
peut-être plus récente et qui semble, dans une certaine mesure, en fait remettre un peu
en question le point de vue strictement platonicien (et à laquelle je référais plus tôt par
l’abréviation AS3), l’image réfère au monde pour des raisons conventionnelles.250 De
même que le son que l’on fait lorsque l’on dit « tigre » réfère pour des raisons
purement conventionnelles à ce mammifère carnivore à fourrure rousse rayée de
noir (ce son ne « ressemble » en effet pas à cet animal), l’image réfèrerait alors au
monde également en raison de conventions culturelles.
249
« Il n’y a d’illusions que lorsque des phénomènes sont traités comme des apparences [ou :
apparitions] d’une autre chose. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 59.)
250
Il faut en effet faire une distinction ici entre ceux qui partagent TI1 et TI2 et ceux qui
partagent pour ainsi dire « une partie seulement » de TI1, en ce qu’ils défendent TI2. En effet,
les sémioticiens à la Goodman ne proclament pas explicitement que l’image est une illusion
(TI1) et contestent même parfois explicitement l’approche platonicienne. Ils disent cependant
que l’image, est – et est seulement – un signe (c’est AS1). Elle n’est donc pas non plus à
proprement parler une chose existante au sens où est existant le réel. Ils partagent donc en ce
sens « une partie » de TI1. Or ce fait me semble suffire à ranger toute la theory of depiction
(que j’évoque déjà pages 28 à 31) dans l’approche illusionniste plutôt que dans la
phénoménologie ou la nouvelle mythologie. Sur la theory of depiction en général, vastement
influencée par le travail de Goodman et de Gombrich, voir : John V. Kulvicki, Images, op. cit.
Pour une approche « conventionnaliste » à la Goodman à l’intérieur de cette théorie, voir par
exemple : Kendall L. Walton, « Pictures and Make-Believe », in : The Philosophical Review,
Vol. 82, No. 3, 1973, p. 283-319. Pour une approche plutôt « mimétique » à la Gombrich,
voir : Malcolm Budd, Aesthetic Essays, Oxford / New York : Oxford University Press,
chapitre 12 : « The Look of a Picture », 2008, p. 216-238.
92
�Nous n’entrerons pas plus avant ici dans ce débat qui occupe encore aujourd’hui les
tenants de la théorie de l’illusion (aujourd’hui theory of depiction)251 vu que nous
l’avons déjà évoqué dans la première partie de ce travail et parce qu’il n’a pas
directement rapport aux questions qui nous occupent ici. La question est pour nous
maintenant plutôt la suivante : la position illusionniste classique a-t-elle raison de
défendre ces deux thèses selon lesquelles l’image réfère toujours au réel (TI2) et
produit par là toujours une illusion de ce réel (TI1) ? Autrement dit : l’image se
réfère-t-elle toujours le réel et ment-elle toujours en faisant cela ? Car c’est
précisément à ces deux thèses que la « mythologie de l’image » et cette fois avec elle
Lambert Wiesing ne souscrivent pas et essaient de proposer des alternatives.
3. 5. La théorie de l’illusion : deux critiques
Que rétorque à ces deux thèses la phénoménologie de la monstration de Wiesing mais
aussi la « mythologie de l’image », cette fois associées dans ce combat ?
Premièrement, qu’il est faux de dire que l’image produit nécessairement une illusion.
En effet, et cela peut en fait paraître assez trivial, lorsque je regarde une image, je ne
crois pas (à moins de vivre sa présence de manière purement immersive)252 que ce
que je regarde, c’est la réalité. Je suis (la plupart du temps) conscient que ce que je
regarde, c’est justement une image. C’est-à-dire que je suis, la plupart du temps,
conscient par l’image d’être artificiellement en présence de la chose que je vois et que
donc, lorsque je regarde une image de maison, je ne regarde justement pas une
maison. Alors si je suis bien conscient que la nature de ce que je regarde, c’est d’être
artificiellement présent, et qu’à aucun moment je ne prends ce que je vois comme
étant réellement dans le monde, où est l’illusion ? Entretenir une illusion, nous dit
Wiesing, c’est croire à quelque chose d’illusoire et de résistant au savoir
(wissensresistent). Mais où est l’illusion si je sais que, lorsque je regarde une image,
ce que je regarde, c’est précisément une image ? Et quel nouveau savoir à propos de
l’image pourrait-il être à même de supprimer cette erreur, c’est-à-dire de faire se
dissiper cette illusion ? Enfin, à quelles nouvelles connaissances à propos des images
pourrait donc bien me conduire un tel savoir ?253
Or, selon Wiesing, c’est d’une critique de ce point de vue réducteur concernant
l’être de l’image qui est là disqualifié comme pur paraître et comme pure illusion que
251
Pour un aperçu de ce débat, comparer par exemple : John Kulvicki, « Image structure »,
in : Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 61, 2003, p. 323-340. et : John Hyman, The
objective eye, Chicago : University of Chicago Press, 2006, p. 127-151.
252
Sur la notion d’immersion dans l’œuvre de Wiesing, voir les pages 66 à 68 de ce travail,
ou alors directement : Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnhemung, op. cit., p. 209-223.
253
Ce que démontre Wiesing ici, c’est que j’ai beau disposé de tout le savoir disponible sur
une image et sur son support matériel, je ne cesserai cependant pas de la voir. Et même si
j’arrivais à ne voir, face à une image, plus que ce qui « existe vraiment », par exemple une
feuille de papier et des tâches de couleurs, je n’aurai alors pas pour autant accès à la
« réalité » de l’image : je n’aurai simplement plus accès à l’image du tout. Voir : Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 59.
93
�se développe, à partir de Husserl, la position phénoménologique. En effet :
Man kann so weit gehen und sagen, dass sich die spezifisch
phänomenologische Position in der Bildtheorie aus einer expliziten Kritik an
der Illusionstheorie des Bildes entwickelt.254
Car selon la phénoménologie que défend Wiesing, face à une image, et en tant que
spectateur de cette image, je ne suis pas victime d’une illusion mais je vis plutôt un
rapport spécifique à la présence de l’objet « pas vraiment là » que je regarde. Pour le
dire en deux mots, je ne suis pas victime d’une illusion face à une image mais plutôt :
je vis une pause de participation, pause qu’il faut alors tenter de décrire dans toute sa
richesse phénoménale. Or cela étant déjà le thème du deuxième chapitre de ce
travail,255 comment maintenant, et pour quelles raisons, contredire aussi la deuxième
thèse de la position illusionniste, que nous présentions plus haut comme « peut-être
encore plus fondamentale » ?
C’est plutôt à l’intérieur de cette deuxième critique à la théorie de l’illusion que la «
mythologie de l’image » se fait entendre. En effet, selon les tenants de cette position,
contrairement à ce que nous dit TI2 (et contrairement à ce que défendait déjà AS1),
l’image n’est justement pas seulement un signe ou un symbole. L’image peut servir à
signifier quelque chose, à symboliser quelque chose, à référer à quelque chose (tel que
le fait par exemple le langage verbal), elle peut donc remplir une fonction référentielle
– mais ce n’est pas tout ce que l’image permet de faire. L’image, selon cette
« mythologie », permet de faire et de vivre infiniment plus de choses que de
simplement référer à « la réalité ». Le tort de la théorie de l’illusion (et d’une
approche strictement sémiotique de l’image), c’est qu’en se focalisant uniquement sur
ce lien (parfois décrit de manière simpliste) entre image et réalité, elle perd en fait
totalement de vue ce qu’il se passe concrètement et phénoménalement lorsque des
gens produisent et consomment des images. En effet, et pour reprendre un exemple
que l’on a déjà utilisé, voir La Joconde, cela ne semble pas seulement être une
expérience dans laquelle on « vit », de manière dépictive, une référence à La Joconde
réelle – peut-être n’est-ce même pas du tout cela. Alors si l’on veut bien comprendre
ce qu’il se passe lorsque des humains produisent, contemplent et consomment des
images, selon cette « mythologie » (que l’on serait tenté de qualifier ici, et de manière
254
« On peut aller jusqu’à dire que la position spécifiquement phénoménologique à l’intérieur
de la théorie de l’image s’est développée à partir d’une critique à l’encontre de la théorie de
l’illusion. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 60.) Or une raison de plus de voir un
lien fort entre sémiotique de l’image et théorie de l’illusion, c’est que Wiesing disait
exactement la même chose du rapport entre phénoménologie et sémiotique, comme nous le
remarquions également avec Husserl à la page 41 de ce travail.
255
Sur la notion de pause de participation, voir notre deuxième partie aux pages 61 à 71, ou se
référer directement au chapitre de MW intitulé Die Partizipationspause. (Lambert Wiesing,
Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 195-228.) Wiesing y explique très bien la différence
entre la « vraie » illusion qu’est une illusion d’optique, que peut par exemple provoquer un
trompe l’œil, et la perception d’une image.
94
�moins péjorative, plutôt comme une anthropologie)256 il faut cesser de se focaliser sur
l’existence de ce seul lien de simple référence ou de simple signification qui existerait
entre les images et la réalité et qui résumerait tout l’intérêt de l’image – il faut
s’intéresser à ce que concrètement les hommes font et vivent grâce aux images.
Or prenons trois exemples ici (ces exemples sont de moi) pour étayer notre propos :
celui de l’art abstrait, de l’icone religieuse, et de la publicité. Que se passe-t-il,
lorsque, pour employer un terme fort général, on « voit » des images dans ces
différents contextes ? Il me semble que, dans le premier cas que nous fournit l’art
abstrait (par exemple lors de la contemplation d’un Rothko), je ne sois pas juste en
train de « contempler une référence à quelque chose de réel » mais bien plutôt, pour le
dire par exemple dans les mots de l’historien de l’art Daniel Arasse, que je sois en
train vivre un choc coloriste.257 C’est-à-dire que je sois là en train de faire une
expérience particulièrement vibrante de la couleur. Or où est la référence symbolique
au réel dans cette expérience ? Et même en admettant qu’elle joue un rôle, explique-telle de manière satisfaisante le fonctionnement d’une telle image et la qualité d’un tel
moment de « choc coloriste » ? Dans le deuxième cas, celui de l’expérience religieuse
impliquant une icône, il est possible de constater un peu le même genre de décalage
entre ce qu’y voit, de manière réductrice, la théorie de l’illusion, et ce qu’il se passe
effectivement pour celui qui regarde une image. En effet, que se passe-t-il
concrètement pour celui qui va à l’église prier et « regarder » une icône ? Il peut
s’agir, par exemple, de vénérer un dieu par l’intermédiaire de cette image et de ce
contexte – et pas simplement de « faire référence » à quelque chose, encore moins de
faire référence à un « objet réel ». Alors que dans le troisième cas, celui de la
publicité, est-il pertinent de défendre que les agences de marketings et de publicités
produisent seulement, au travers des images qu’elles réalisent, des « références » à
des « objets réels » ? Il me semble qu’il s’agit plutôt là pour elles de produire des
images afin (et seulement afin) de vendre – et donc surtout pas de faire référence à un
objet réel qui, s’il existe, ne dispose en fait pas du quart des propriétés au sujet
desquelles je fantasme en consommant sa publicité.258
On pourrait multiplier ici les exemples au travers desquels ils semble transparaître
que l’image, dans l’utilisation que l’on en fait, ne se réduit pas à un simple « outil de
référence » au réel, à ce que Wiesing nomme (après Heidegger) un Zeigzeug.259
256
Sans entrer dans le détail, on peut en effet remarquer que plusieurs auteurs appartenant
selon Wiesing à la mythologie de l’image se retrouvent dans la catégorie de l’anthropologie
de l’image telle qu’élaborée dans AP. De même que cette critique de mythologiser l’image et
de procéder de manière confuse se trouve aussi dans ce que reproche Wiesing à
l’anthropologie de l’image dans AP, voir pages 32 à 34 de ce travail.
257
Sur la notion de « choc coloriste » (non propre à l’art abstrait), voir : Daniel Arasse,
Histoires de peintures, Paris : Denoël, 2004, p. 17-23.
258
C’est peut-être dans l’usage que la publicité fait de l’image que Platon reconquiert toute sa
pertinence. C’est d’ailleurs comme un travail étrangement platonicien que l’on peut lire la
critique que formule Jean Baudrillard à l’égard de nôtre société en général, par exemple dans :
Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris : Gallimard, 1970.
259
Sur la notion de Zeigzeug, que Wiesing emprunte à Heidegger, et sur laquelle nous
reviendrons, voir: Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 14, 47, 179.
95
�L’image permet de faire bien plus de choses que de seulement référer. Elle a, pour
ainsi dire, un « potentiel » beaucoup plus élevé. Or dès que l’on est attentif à cela, il
semble important de remarquer que tout le courant sémiotique, qui peut être considéré
comme une sous-branche de la théorie de l’illusion, réduit en fait, dans son approche
exclusivement symboliste (voire linguistique), les images à leur fonctionnement
référentiel. En effet, selon Wiesing :
Man hat es dann in der gegenwärtigen Bildtheorie mit einer Reaktion auf die
Diagnose zu tun, dass keineswegs jede Bildtheorie der letzten Jahrzehnte –
insbesondere nicht semiotische und sprachanalytische – der kulturellen und
anthropologischen Bedeutung und Wirkungsmächtigkeit von Bildern gerecht
wird oder sich überhaupt die Frage stellt, diese zu erfassen. Aus diesem
Grund werden in den Texter der Bildmythologie tendenziell semiotische
Beschreibungen als eine Perspektive auf das Bild kritisiert und abgelehnt;
diese Sichtweise werde die Eigenständigkeit und Besonderheit des Bildes nicht
gerecht, will in ihr das Bild als ein blosses sprachliches
Kommunikationsmedium beschrieben sei.260
L’image permet de vivre, selon Wiesing, des pauses de participation mais aussi, et
comme on vient de le voir dans ces trois exemples tirés d’expériences assez banales,
également bien d’autres choses.261 Or c’est précisément sur ce point qu’une bonne
anthropologie de l’image permet d’attirer l’attention : sur la richesse et la complexité
de notre rapport aux images. Car de même qu’un ordinateur, bien qu’il permette de
diffuser de la musique, n’est cependant pas que ça, l’image, si elle permet parfois de
référer au réel, n’est cependant, elle non plus, pas que cela. L’image, bien qu’elle
puisse entre autres servir à montrer des choses en référant au monde, n’est pas que
cela : elle n’est pas l’une de ses fonctions possibles.
Mais est-elle, pour autant, vivante ? Et doit-on maintenant faire le geste « inverse »
de celui du sémioticien, c’est-à-dire non pas réduire l’image à un signe mais pour
ainsi dire l’ « augmenter » ou l’animer, voir la kitschiser, jusqu’à y voir l’équivalent
d’un sujet, d’un humain ? C’est là l’autre erreur que Wiesing, on l’aura compris, veut
éviter et donc la raison pour laquelle, s’il ne se situe pas du côté de la théorie de
260
« On a affaire dans la théorie contemporaine de l’image à une réaction à ce diagnostique
selon lequel la plupart des théories de l’image des dix dernière années – en particulier celles
qui sont sémiotiques et analytiques – ne prennent pas en compte la signification culturelle et
anthropologique de l’image ainsi que sa puissance [ou : son efficacité]. Pour cette raison, dans
les textes de la nouvelle mythologie de l’image, les description sémiotiques de l’image se
verront tendanciellement reléguées au rang de simple perspective sur l’image et critiquées ;
cette manière de voir ne rendrait pas justice à l’autonomie et à la particularité de l’image, qui
n’est alors décrite que comme un simple moyen de communication. » (Lambert Wiesing,
Sehen lassen, op. cit., p. 89)
261
Wiesing défend à ce sujet que l’intérêt anthropologique de l’image est en fait le fruit d’une
seule et unique expérience : c’est la pause de participation. Selon Wiesing, c’est cet unique
phénomène de pause de participation qui explique le fonctionnement de ces différentes
expériences. Voir : Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 91.
96
�l’illusion, il ne souhaite pas non plus intégrer la « mythologie de l’image ». Alors un
dernier dilemme se pose ici : comment éviter les erreurs de la théorie de l’illusion et
donc prendre en compte la critique que produit à son encontre l’approche
anthropologique inhérente à la mythologie de l’image, sans toutefois tomber dans
« l’excès d’animation » qui est le leur ? Autrement dit : comment réussir à saisir ce
qu’est véritablement une image, sans par là la réduire à l’une de ses potentialités
(montrer) et sans pour autant vouloir, à l’inverse, lui donner une réelle puissance
s’agir ? En allant puiser, comme le propose Wiesing, dans une philosophie qui établit
de manière radicale cette différence fondamentale qu’il y a entre un être « en tant
qu’être » et un être « en tant qu’outil » sans pour autant aller jusqu’à prêter vie à l’être
en général : en allant puiser dans Heidegger.
97
�4. L’être de l’image
4. 1. Heidegger et l’« a-référentialité » des phénomènes
C’est à trois reprises dans SL que Wiesing fait mention du travail de Heidegger. Cela
en fait l’auteur auquel SL se réfère le plus longuement. 262 Une première fois
rapidement dans l’introduction,263 puis plus longuement dans le premier chapitre de
l’ouvrage, alors comme pour préparer le terrain à sa propre phénoménologie de la
monstration, et une troisième fois juste après avoir mené sa « croisade » contre la
nouvelle mythologie de l’image.264 C’est un peu, me semble-t-il, comme si Wiesing
voulait montrer par là que l’auteur emblématique dans lequel certains mythologues de
l’image pouvaient croire trouver leur légitimité, Wiesing l’avait en fait rangé de son
côté. Pour employer une expression familière, en commençant assez tôt, dans SL, par
considérer le rapport de Heidegger au montrer, Wiesing semble « couper l’herbe sous
le pied » des « mythologues » qui pourraient prétendre s’en réclamer. Or le but n’est
pas seulement, grâce à Heidegger, d’accomplir ce geste critique. Il s’agit aussi, pour
Wiesing de véritablement s’approprier le travail de cet auteur afin de trouver dans la
phénoménologie originale qu’il élabore ce que je propose d’appeler la première
distinction fondamentale (DF1) dont Wiesing a besoin pour énoncer sa propre théorie
de l’image dans SL, distinction selon laquelle : ce qu’est une chose est radicalement
différent de ce à quoi elle peut servir. Or comment Wiesing s’y prend-il pour opérer
cette distinction ?
C’est dans la partie intitulée : « La pratique de laisser se montrer une chose : le
programme de la phénoménologie » (Die Praxis, etwas sich zeigen zu lassen : Das
Programm der Phänomenologie)265 que Wiesing débute son exégèse à Heidegger,
plus précisément au concept que ce dernier invente dans Sein und Zeit (1927) du SichZeigen. Wiesing commence alors par remarquer que le sens de ce concept du SichZeigen pourrait sembler n’avoir à première vue rien de bien compliqué. En effet,
262
On pourrait donc dire, et c’est une des particularité de SL, qu’avant d’être influencé par la
phénoménologie de Husserl, le contenu de cet ouvrage est influencé par Heidegger.
263
C’est le moment où Wiesing dit simplement : Für diesen Zweck des Zeigens werden oft
spezielle Werkzeuge verwendet – eben Werkzeuge, die Martin Heidegger so passend wie
originell „Zeigzeug“ nennt. « On utilise souvent des outils spéciaux afin de montrer –
précisément des objets que Martin Heidegger appelle de manière si pertinente "objet-quimontre". » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 14)
264
Wiesing revient en effet à Heidegger une dernière fois, à la page 104 de SL, où il écrit :
Heidegger hat den Begriff des Sich-Zeigens eingeführt […] Doch die Rezeptionsgeschichte
könnte kaum paradoxer sein : Genau das Gegenteil von den Absichten Heideggers geschieht,
wenn derselbe Begriff des Sich-zeigens auf das Bild in der Welt angewendet wird.
« Heidegger a introduit le concept du se-montrer […] Mais l’histoire de la réception de ce
concept ne pourrait être plus paradoxale : c’est exactement le contraire des intentions de
Heidegger qui s’est passé quand ce même concept du se-montrer a été appliqué à l’image. »
(Ibid., p. 104.) Il s’agit donc, dans SL, également de « rendre justice » à Heidegger et au sens
originairement heideggérien du « se-montrer ».
265
Ibid., p. 25-39.
98
�comme dans le cas d’autres verbes réflexifs, sich zeigen, « se montrer », réfère
simplement à une action dans laquelle :
[...] [D]as Subjekt der Zeige-Handlung selbst das Objekt der Zeige-Handlung
ist: Jemand zeigt jemand anderem sich selbst.266
Comme on l’a déjà vu, et cela semble trivial, il est possible pour un sujet (dans le
sens d’homme) de se montrer lui-même (mais toujours à quelqu’un d’autre).
Toutefois, Heidegger s’éloigne en fait assez vite de cette manière habituelle
d’employer le verbe « se montrer » afin d’en proposer sa propre acception technique,
qu’il dérive du verbe grec ancien : phainesthai.267 Heidegger emploie alors le concept
du Sich-Zeigen afin de déterminer, dans le deuxième chapitre de son introduction à
Sein und Zeit ce qu’est un phénomène. Car le phénomène, selon Heidegger, c’est
justement ce qui se montre, ou plutôt, c’est « le » ce-qui-se-montre ou encore le cequi-est-en-train-de-se-montrer : das Sichzeigende (voir même : das Sich-an-ihmselbst-zeigende). 268 Ce n’est donc plus là, on l’aura compris, de l’emploi
réflexif littéral banal du verbe « se montrer » qu’il s’agit. Il s’agit plutôt, selon
Wiesing, et par cette invention, pour Heidegger, de faire principalement deux choses.
Il s’agit là de :
[...][D]as Wesen der Phänomene und die Aufgabe der Phänomenologie mit
Rückgriff auf den Begriff des Sich-Zeigens zu erläutern.269
Or en quoi Heidegger propose-t-il à ce moment-ci (c’est-à-dire en 1927), et en
ayant ainsi recours à ce concept du Sichzeigende, une nouvelle définition de ce que
sont les phénomènes et en quoi assigne-t-il là une nouvelle tâche à la
phénoménologie ? Autrement dit, contre quelle tradition phénoménologique
précédente se dresse-t-il ici ?
Sans entrer dans un débat trop technique et exclusivement relatif aux diverses
« nuances » de phénoménologies qui existent, on peut cependant remarquer ici, afin
de répondre à cette question, que l’une des raisons pour lesquelles Heidegger redéfinit
ainsi l’objet et la tâche de la phénoménologie, c’est selon Wiesing de s’opposer à
celui qui a été plus tôt son maître (et auquel il dédie d’ailleurs Sein und Zeit) :
Edmund Husserl. Il s’agit en effet de proposer là un nouvel objet à la phénoménologie
266
« […] le sujet de l’action du montrer est lui-même l’objet de l’action du montrer :
quelqu’un se montre lui-même à quelqu’un d’autre. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op.
cit., p. 25.)
267
Un point important que soulève Heidegger à propos de cette racine grecque, c’est que le
verbe phainesthai emploie le « moyen-passif », une forme qui n’existe ni en français, ni en
allemand, mais qui permet justement de jouer sur le rapport entre action et monstration, voir :
Ibid., p. 28-29.
268
Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2006, §7, p.
28.
269
« […] expliquer l’être des phénomènes et le travail de la phénoménologie en ayant recours
au concept du se-montrer. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 27.)
99
�(dont Heidegger se réclame alors encore)270 et un autre objectif à celle-ci que ceux
proposés par Husserl un peu plus tôt. Mais alors il faut commencer par se
(re)demander ici : qu’est-ce qu’un phénomène pour Husserl ?
C’est, comme on l’a déjà vu dans notre deuxième partie, l’expérience vécue
consciente. Comme le répète alors Wiesing dans SL :
Für Husserl ist ein Phänomen das, was für jemanden bewusst ist.271
Or à quoi s’oppose, chez Husserl, cette expérience vécue consciente que ce dernier
qualifie de phénomène mais aussi, de manière synonymique d’apparition
(Erscheinung) ? Le Phänomen ou l’Erscheinung s’opposent chez Husserl à ce qui ne
nous apparaît pas mais que l’on appréhende (ou modélise)272 au travers des outils que
nous fournit par exemple la science. Pour donner un exemple simple (qui est le mien),
le bleu de la mer est un phénomène : il m’ « apparaît » ; alors que la composition
chimique de l’eau qui compose la mer elle, ne m’apparaît pas : elle n’est donc pas,
pour Husserl, un phénomène. Ainsi, et toujours selon Husserl (mais dans les mots de
Wiesing) :
Das heisst wiederum, dass Phänomene keine naturwissenschaftlich
beschreibbaren Dinge oder sonst wie physische oder materielle Entitäten
wären.273
Nous avons déjà évoqué cette même opposition dans notre deuxième chapitre. Mais
alors qu’est-ce maintenant qu’un phénomène pour Heidegger, et en quoi s’écarte-t-il
dans Sein und Zeit de cette conception husserlienne classique du phénomène ?
En ce que Heidegger défend que le phénomène, parce qu’il est un Sichzeigendes,
n’est pas « ce qui m’apparaît » par opposition aux connaissances auxquelles aboutit la
science, mais c’est plutôt (et j’espère que l’on va maintenant un peu retomber sur nos
pieds) ce qui se montre lui-même et ne montre rien d’autre que lui-même. C’est ce
qui ne réfère à rien d’autre, ce qui n’est rien d’autre que lui même, ce qui n’est le
signe de rien ou encore : ce que l’on laisse « se montrer » comme ne référant à rien
d’autre. Le phénomène, au sens heideggérien, c’est selon Wiesing ce qui ne possède
pas de structure référentielle immanente (keine immanente Verweisstruktur).274 C’est
270
Jusqu’à quel moment est-il légitime de défendre que Heidegger reste
« phénoménologue » ? Question à laquelle on trouvera quelques pistes de réponses dans :
Jean-François Courtine, Heidegger et la phénoménologie, Paris : Vrin, 1990.
271
« Pour Husserl, un phénomène c’est cela qui est conscientisé par quelqu’un. » (Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 31.)
272
Sur le rôle des modèles dans la science mais pas dans la philosophie, voir les pages 49 et
50 de ce travail, ainsi que directement dans MW la partie intitulée Philosophische Mythen und
Modelle (Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 11-69.)
273
« Ce qui signifie à son tour d’un phénomène n’est pas une chose descriptible par les
sciences de la nature comme le serait un quelconque entité physique ou matérielle. »
(Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 31.)
274
Ibid., p. 32.
100
�ce que l’on laisse se montrer « en lui même » (an ihm selbst),275 c’est-à-dire sans
tenter d’y voir ni un sens, ni un symbole, ni une référence à autre chose, c’est-à-dire
en essayant d’éviter d’y voir ce qu’il n’est pas en lui-même (was es an ihm selbst
nicht ist).276 On pourrait donc dire ici qu’un phénomène, c’est tout sauf un signe
d’autre chose.
Or pour donner un exemple qui clarifierait un peu cette idée, Wiesing cite ici le
heideggérien Andreas Luckner qui considère, dans le passage suivant, également le
cas d’une couleur qu’il oppose alors à tout ce qui n’est pas à proprement parler cette
couleur-ci mais seulement ce à quoi cette couleur peut nous sembler référer. Ainsi,
selon Luckner :
So können wir etwa ein Farbphänomen, z. B. das Türkisgrün eines
Badezimmers, als Erscheinung einer bestimmten Schwingung des
elektromagnetischen Feldes betrachten, als Erscheinung eines bestimmten
chemischen
Pigmentstoffes,
als
Erscheinung
einer
bestimmten
Netzhautreizung,
als
Erscheinung
einer
bestimmten
kulturellen
Farbunterscheidungsleistung oder als Erscheinung der Kälte der bürgerlichen
Gesellschaft. Dies wären alle unterschiedliche Erscheinungen, von der das
wissenschaftliche Interesse auf das Indizierte übergeht. In allen diesen Fällen
handelt es sich aber um dasselbe Phänomen, nämlich um die Farbe
Türkisgrün. Wenn wir dies Phänomen beschreiben wollen, ohne dass eine
Reduktion des erscheinenden auf ein nichterscheinendes Wesen stattfinden
soll, müssen wir Türkisgrün als das nehmen, was es ist: Farbe.277
Or cette conception du phénomène comme étant « ce qui n’est rien d’autre que lui
même » et « ce qui se montre comme tel », est peut-être déjà présente chez Husserl
qui, en proposant de pratiquer l’époché, propose aussi de s’éloigner de l’attitude
naturelle que l’on entretient habituellement aux choses du monde, attitude naturelle
qui nous pousse justement à les voir autrement qu’en tant que phénomènes. 278
275
Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., §7, p. 28.
Ibidem.
277
« Nous pouvons de cette manière concevoir un phénomène de couleur comme le vert
turquoise d’une salle de bain en tant qu’apparence d’une certaine onde d’un champs
électromagnétique, en tant qu’apparence d’un pigment chimiquement déterminé, en tant
qu’apparence d’une certaine excitation de la rétine, en tant qu’apparence d’une capacité à
différencier les couleurs culturellement déterminée, ou en tant qu’apparence du froid de la
société bourgeoise. Ce seraient toutes des apparences différentes à propos desquelles l’intérêt
scientifique porte. Mais dans tous ces cas il s’agirait du même phénomène, à savoir de la
couleur vert turquoise. Quand on veut décrire ce phénomène sans qu’une réduction de ce qui
apparaît à ce qui n’apparaît pas n’ait lieu, on doit prendre la couleur pour ce qu’elle est :
couleur. (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 39.) Wiesing donne ici la référence
suivante : Andreas Luckner, Martin Heidegger : Sein und Zeit, Paderborn : Schöningh, 2007,
p. 25.
278
Sur la notion d’attitude naturelle, voir : Edmund Husserl, De la synthèse passive (19181926), trad. par Bruce Bégout & Jean Kessler, Grenoble : J. Million, « Perception et sens
perceptif », 1998, §10, p. 49-52.
276
101
�Cependant, faire de cette idée de l’« a-référentialité » (l’expression est de moi) le trait
saillant de ce qu’est l’objet même de la phénoménologie (et donc, pour Heidegger, de
la philosophie tout court), ceci semble bien être une thèse originale de Heidegger.
Idée qui implique alors que, et contrairement à ce que défend Husserl, il faille
toujours clairement distinguer les concepts d’Erscheinung et de Phänomen. En effet,
une Erscheinung, écrit Wiesing, c’est toujours une Erscheinung de quelque chose
d’autre. C’est toujours la manifestation, au niveau de mon expérience phénoménale,
de quelque chose que l’on supposerait existant en dehors de cette
expérience. L’Erscheinung semble toujours devoir renvoyer à une chose qui n’est pas
dans mon expérience vécue consciente (c’est, par exemple, la mer dont je ne fais que
percevoir le bleu). Alors qu’au contraire le Phänomen, pour Heidegger, c’est ce qui
ne réfère à rien d’autre, c’est simplement ce qui se montre, pris comme ce qu’il est en
lui-même, se montrant lui-même. C’est ce qui ne renvoie à rien de « en-arrière-plan »
(Hintergründigem) ou, pour le dire encore autrement : c’est ce que j’essaie
d’appréhender, dans mon rapport à cette chose, comme ne référant à rien d’autre,
comme n’étant rien d’autre que ce qu’elle est et comme n’étant à expliquer par rien
d’autre qu’elle-même. D’où l’importance, on l’aura compris, du sich dans ce concept
du Sich-Zeigen : ce n’est plus moi qui appréhende une chose extérieure par mon accès
subjectif à elle, mais c’est la chose elle-même qui se montre.
Or comment préciser encore un peu maintenant cette idée originale du « ce-qui-semontre », du Sichzeigende, sans pour autant multiplier les paraphrases ? Et ce concept
du Sichzeigende n’impliquerait-t-il pas une certaine anthropomorphisation des
phénomènes qui seraient ainsi capables de « se montrer eux-mêmes » ?
Anthropomorphisation qui risquerait alors de nous rendre coupable des mêmes erreurs
que la mythologie de l’image ? Enfin, comment distinguer plus clairement le lien que
l’on peut faire entre ce concept du Sich-Zeigen et l’être de l’image, auquel nous
arrivons ici à petits pas ? En focalisant maintenant notre attention sur l’attitude « anutilitaire »279 à entretenir, selon Heidegger, afin justement d’essayer de laisser les
phénomènes se montrer.
4. 2. Heidegger et l’« an-utilité » des phénomènes
On l’aura compris, le se-montrer heideggérien est un « acte » d’une nature
particulière. Alors que le verbe « montrer » implique, dans son acception habituelle et
littérale (comme on l’a vu) un sujet agent réel, l’acception du « se montrer »
heideggérien ne le semble aucunement. Le bleu de la mer, alors qu’il « se montre » à
moi dans toute sa richesse phénoménale, n’est à aucun moment pour Heidegger à
279
J’invente ici cette expression d’ « an-utilitaire » qui signifie simplement : privé d’utilité,
sans utilité ou encore « pris dans son inutilité ». Un phénomène, c’est ce à propos de quoi la
question de l’utilité ne se pose pas, c’est donc l’a-utile, l’an-utile. Je préfère en effet cette
expression à celle plus habituelle d’« inutile » car cette dernière implique généralement
quelque chose de péjoratif – or il s’agit là au contraire de valoriser l’image prise dans son anutilité.
102
�prendre littéralement comme un sujet agent réel : ce bleu ne « fait » rien « lui-même »
quand il se montre. Mais alors qu’implique cet acte bien particulier du se montrer des
phénomènes ?
Au lieu d’impliquer quelque chose de la part de la chose qui se montre (par
exemple qu’elle soit vivante), le phénomène, pour se montrer, nous dit Heidegger,
exige plutôt quelque chose de la part du sujet agent réel qui laisse la chose se
montrer. En effet, selon Heidegger, que Wiesing cite ici, les phénomènes ne se
montrent que :
[...] dann und nur dann, wenn die Welt aufgrund einer phänomenologischen
„Behandlungsart“ zu einem Phänomen gemacht wird.280
De la même manière, et toujours dans les mots de Heidegger :
Der Ausdruck „Phänomenologie“ […] charakterisiert nicht das sachhaltige
Was der Gegenstände der philosophischen Forschung, sondern das Wie
dieser.281
C’est-à-dire que le phénomène n’est pas véritablement « actif ». Il n’est cependant
perceptible qu’à condition que le sujet agent réel qui lui fait face cultive une certaine
attitude proprement phénoménologique. Mais alors à quelle « manière
d’appréhender » (Behandlungsart) le monde et à quelle attitude fait ici référence
Heidegger ? Quelle est cette attitude que l’on devrait entretenir afin de laisser les
choses se montrer ? Comment doit donc se comporter, selon Heidegger, le
phénoménologue rigoureux ou, plus simplement : le philosophe ?
C’est ici, nous dit Wiesing, que Heidegger et Husserl se retrouvent.282 En effet,
l’attitude proprement phénoménologique que défend Heidegger ressemble à celle de
Husserl en ce que tous deux nous invitent ici à faire un réel effort dans notre manière
d’être au monde et de considérer ce monde. Tous deux défendent un certain « ethos »
du philosophe dans lequel il est prescrit (Wiesing parle de Präskription)283 à ce
dernier de ne justement pas vouloir aller chercher derrière ce qu’il voit. Car ce n’est
pas la chose elle-même qui possède une capacité spéciale lui permettant de « se
montrer » mais c’est le sujet qui appréhende la chose qui, dans sa manière de le faire,
doit la laisser se montrer telle qu’elle est. Comme le disait déjà Goethe, que Wiesing
280
« […] quand et seulement quand le monde, en raison d’une manière particulière de le
traiter, est fait phénomène [ou : est traité comme un phénomène]. » (Lambert Wiesing, Sehen
lassen, op. cit., p. 35.). Voir : Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., §7, p. 27.
281
« L’expression "phénoménologie" […] ne caractérise pas le quoi chosal des objets de la
recherche philosophique, mais plutôt leur comment. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op.
cit., p. 35.) Voir : Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., §7, p. 27.
282
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 35.
283
Ibid., p. 38.
103
�cite ici pour illustrer l’attitude que préconisera plus tard Heidegger :
Man suche nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre.284
Ce qui veut dire qu’à l’intérieur de cette attitude, et pour le dire encore autrement :
Das, was ist, muss so behandelt werden, dass es nicht etwas anderes zeigt,
sondern eben nur noch ist.285
Or on le sent bien dans ces deux extraits, il ne s’agit pas directement de l’objet de la
phénoménologie qui aurait une capacité anthropomorphe à « se montrer » ; il s’agit
plutôt de celui qui veut découvrir et connaître les phénomènes, de qui l’on exige cette
attitude qui consiste à ne rien aller chercher derrière les choses.286 Ainsi, et c’est à
côté de ce que nous avons appelé l’ « a-référentialité des phénomènes », une
deuxième idée cruciale de Heidegger : il s’agit là de considérer les choses dans ce
qu’elles sont et non pour ce à quoi elles peuvent nous servir. Il s’agit d’arrêter de voir
les choses comme des signes mais aussi de cesser, dans notre rapport aux êtres, de les
voir comme des outils, comme des choses que je peux utiliser. Heidegger invente
même tout un nouveau lexique pour parler de ce rapport ordinaire et utilitaire aux
choses duquel il souhaite, en faisant de la phénoménologie, s’extraire. Lexique dans
lequel on trouve par exemple le concept de Zuhandenheit, généralement traduit en
français par « être à portée de la main » et qui sert justement à exprimer la manière
d’être de l’outil, soit de ce que je ne considère qu’afin de (um zu) faire des choses.287
Lexique original dans lequel on trouve aussi le concept inédit (et assez intraduisible)
de Zeughaftigkeit,288 soit la propriété que nous prêtons aux objets dans notre manière
de les utiliser quotidiennement, par laquelle nous les réduisons en fait au statut
d’outil. Or dans l’attitude phénoménologique proprement heideggérienne, il s’agit de
quitter la posture utilitaire qui caractérise ce rapport « normal » aux choses (et que
l’animal semble également privilégier dans son rapport à ces mêmes choses) afin
d’adopter une attitude que l’on pourrait alors être tenté de qualifier ici (et bien que
Heidegger ne le fasse pas explicitement dans Sein und Zeit) de désintéressée, voir de
contemplative. Grâce à une telle attitude, il s’agit alors, par exemple en face d’un
marteau, de ne plus y voir seulement un outil mais avant tout une certaine forme, une
284
« On ne cherchera rien derrière les phénomènes ; ils sont eux-mêmes l’enseignement [ou :
la connaissance]. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 36.) Wiesing donne ici sur
Goethe la référence suivante : Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre
oder die Entsagenden (1829), in : Goethes Werke, Bd. 8, Erich Trunz (éd.), München : dtv,
1973, p. 7-486, ici p. 304.
285
« Ce qui est doit être traité de manière à ce que cela ne montre pas autre chose, mais est
seulement. » (Ibid., p. 36.)
286
Le fait qu’il s’agit là d’une exigence est explicite dans le temps des verbes employés dans
ces citations : man suche chez Goethe (au Kojnuktiv I donc) c’est « on cherchera » ou « on
devra chercher », tandis que le verbe müssen exprime toujours un devoir.
287
Martin Heidegger : Sein und Zeit, op. cit., §15, p. 69.
288
Ibid., p. 68.
104
�certaine matérialité, un éclat, une couleur, un poids, une texture, etc.289 Attitude au
travers de laquelle, en ne voyant dans les choses ni des signes, ni des outils, nous les
contemplons alors en tant que phénomènes, c’est-à-dire enfin tels qu’ils sont, dans la
manière dont ils se montrent. Mais alors qu’apportent maintenant ces deux idées
heideggériennes de l’« a-référentialité » et de l’« an-utilité » des phénomènes en
général à ce que nous avons dit jusqu’ici à propos des images et de la monstration par
l’intermédiaire image ? Elles apportent principalement deux choses.
La première, c’est de permettre de bien comprendre en quoi il existe une sorte de
« troisième voie » dans la manière dont on appréhende la monstration par
l’intermédiaire d’images. En effet, et comme on l’a déjà évoqué, être un
phénoménologue heideggérien, ce n’est pas être un mythologue de l’image. Il ne
s’agit pas par là de prêter vie à des objets mais plutôt de cultiver une certaine attitude
an-utilitaire vis-à-vis des images. Le Sichzeigende, c’est ce qui se montre « luimême » non parce qu’il est vivant, mais parce que lorsque je le considère non pas en
tant que signe, ni en tant qu’outil, alors j’arrive à ce qu’il est avant d’être réduit à
autre chose que lui-même. Mais considérer les images en phénoménologue
heideggérien, ce n’est pas non plus être un « théoricien de l’illusion ». C’est même
tout le contraire vu qu’il s’agit, contrairement à ce à quoi nous invite TI2, à ne plus
s’intéresser aux images en tant que signe mais plutôt en tant qu’êtres a-référentiels ou
encore « a-sémiotiques ». L’attitude heideggérienne semble ainsi nous proposer une
alternative dans le dilemme que nous exposions plut tôt entre une approche
illusionniste et une approche mythologique de la monstration par l’image (toutes deux
insatisfaisantes).
Or Heidegger nous apporte par là une deuxième chose encore dans la manière dont
on peut appréhender les images, c’est de nous permettre de sortir définitivement d’un
rapport pragmatique à leur égard. Ne voir les choses ni comme des signes, ni comme
des outils, mais seulement pour le phénomène qu’elles sont et pour la manière dont
elles se montrent, c’est (comme on vient de le dire) refuser de voir les images pour ce
qu’elles permettent de faire, c’est refuser de les considérer « afin de ». Or il s’agit là
d’un point, quant à la phénoménologie de Heidegger, qu’il est crucial de bien intégrer
afin de nous permettre de quitter maintenant l’analyse pragmatique de l’image ou
encore ce que nous avons également appelé (page 89) une « pragmatique
phénoménologique ». Cela afin de se demander cette fois non pas comment on peut
montrer avec des images mais, et a contrario, ce que les images sont. La question de
l’être de l’image n’a en effet de sens qu’à condition de ne plus s’intéresser à elle ni en
tant que signe, ni en tant qu’outil, mais en tant que simple phénomène. Dans la suite
(et fin) de ce travail, il ne s’agit donc plus de se demander, face à l’image, ce à quoi
elle peut servir ou comment elle peut nous servir, mais au contraire : ce qu’elle est
elle-même comme phénomène. Il s’agit ainsi de sortir de la pratique du montrer
(Praxis des Zeigen) qui nous a occupé jusqu’ici dans cette troisième partie afin de
289
Cet exemple est de moi. Le problème est que Heidegger ne donne lui-même pas vraiment
d’exemples de phénomènes dans Sein und Zeit. Je me sens donc obligé d’en proposer un moimême.
105
�s’intéresser à ce qui, me semble-t-il, capte au fond le plus l’attention de Wiesing dans
l’ensemble de son travail sur l’image : l’être phénoménal de celle-ci et non les
« accidents » auxquels correspondent autant d’usages possibles de celle-ci.
Mais alors qu’est-ce qu’une image lorsque l’on cesse de vouloir l’utiliser et que,
pour le dire dans les termes de Heidegger, on la laisse se montrer ou encore : lorsque
l’on se laisse simplement voir une image qui se montre ? Elle est, on l’aura deviné,
une pure visibilité. Toutefois, et avant de donner les raisons définitives de cette idée,
un dernier préliminaire devrait nous permettre de comprendre toute la pertinence de
celle-ci. Ce préliminaire ne porte cette fois plus sur la question de savoir « qui »
montre dans l’image, ni sur « ce que » montre une image, mais sur la question
suivante : où les images se montrent-elles ? Autrement dit, dans quel cadre arrive-t-on
le plus aisément à cette attitude qui consiste à laisser les images se montrer ? Dans
quel contexte l’attitude phénoménologique heideggérienne est-elle, face aux images,
si non obligatoire, du moins encouragée? C’est, selon Wiesing, lorsque l’on visite un
musée.
4. 3. La désinstrumentalisation de l’image au musée
Parmi les six descriptions d’autant de différentes pratiques de monstration que
présente Wiesing dans la troisième et dernière partie de SL il y en a une qui, me
semble-t-il, devrait tout particulièrement attirer notre attention ici. C’est la partie que
Wiesing intitule « Le montrer des images : le dépassement de l’image au musée »
(Das Zeigen von Bildern : Die Aufhebung des Bildes im Museum).290 Dans celle-ci,
Wiesing tente en effet de décrire une « pratique » de monstration qui a cela de
paradoxal qu’au travers elle on peut en fait s’extraire un peu de notre rapport
pratique aux choses : c’est la visite au musée. Partie que Wiesing amorce alors en
posant la question suivante : que montre un musée, lorsqu’il montre des images ?291
Or pour répondre à cette question tout en respectant les contraintes langagières que
nous nous sommes fixés plus tôt, il vaut peut-être la peine de tout d’abord reformuler
celle-ci de manière non elliptique. Elle devient alors : que montre l’institution
« musée », c’est-à-dire un ensemble de commissaires d’expositions, de curateurs et
d’« accrocheurs » à ses visiteurs, lorsque ces mêmes responsables de l’exposition
mettent aux murs de leur musée des images et invitent des gens à venir voir ces
images ?
Ils montrent des choses qui montraient déjà avant de montrer dans le musée. C’està-dire que les visiteurs d’un musée y voient des images au travers desquelles les
artistes ou simples producteurs de ces images montraient déjà des choses. Une image
permet en effet déjà de montrer lorsqu’un artiste la produit et que, par exemple dans
290
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 180-191.
Par « musée », Wiesing entend en fait dès le départ le musée d’art ou en tout cas : le genre
de musées qui ne cherchent pas à montrer, par des images, un seul type d’objet déterminé (tel
que pourrait par contre le faire un musée dédié exclusivement à l’automobile ou à la
botanique).
291
106
�le cadre de son atelier, celui-ci montre quelque chose par son intermédiaire à un
visiteur ou à un ami. Alors dans un musée, vu que l’image montrait déjà avant d’y
être exposée, elle « re-montre », elle montre doublement. En plus de montrer quelque
chose, elle est à son tour montrée en tant qu’image. Comme le dit Wiesing :
Das Kunstmuseum stellt die Bilder aus; es konfrontiert den Besucher mittels
verschiedener Methoden und durch Inszenierungen mit den Bildern, weil sie
Bilder sind.292
On a ainsi affaire, dans un musée, à ce que Wiesing appelle un phénomène du
deuxième degré (Phänomen zweiter Ordnung). Phénomène au travers duquel on ne
voit pas simplement des images par l’intermédiaire desquels on montre d’autres
choses, mais on expose des images qui, à leur tour, montrent des choses.293 Pour le
dire de manière plus concise, il semble bien qu’au musée :
Es kommt zu einem regelrechten Zeigen von Zeigen.294
Or qu’est-ce qu’un phénomène si particulier et propre selon Wiesing à l’espace du
musée a-t-il comme effet sur la manière dont les images sont alors perçues par les
spectateurs ? Principalement, un tel phénomène a pour effet, nous dit Wiesing, de
désinstrumentaliser l’image. En effet, ce phénomène du deuxième degré a pour effet
principal de produire une manière de montrer (Art des Zeigens) :
[…] die sich von der normalen, instrumentellen Verwendung von Bildern zum
Zeigen grundlegend unterscheidet.295
Or pour bien comprendre l’impact d’un tel dispositif, on peut faire remarquer une
première chose ici, qui est que Wiesing n’invente pas cette idée. Il l’emprunte en fait
à toute une tradition critique qui, au moins depuis Marcel Duchamp et jusqu’à
Maurizio Cattelan, n’a en effet cessé d’interroger le rôle et la fonction du musée dans
notre société. Tradition critique qui, nous dit Wiesing, exprime alors cette idée de
désinstrumentalisation de l’image propre au musée de principalement deux manières :
d’une première manière négative, péjorative, et d’une deuxième manière plus positive
et enthousiaste vis-à-vis de l’espace du musée.
292
« Le musée expose des images ; au moyen de diverses méthodes et au travers de mises en
scène, il confronte le visiteur avec les images parce qu’elles sont des images. » (Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 181.)
293
La formulation est ici à nouveau elliptique. Sans ellipse, on devrait plutôt dire que : « Les
gens responsables du musée y montrent des images au travers desquels les producteurs de ces
images avaient déjà l’intention de montrer des choses et montraient peut-être déjà des choses
dans d’autres cadres que celui du musée. »
294
« Il s’agit d’un véritable montrer du montrer. » (Ibid., p. 180.)
295
« […] qui se distingue fondamentalement de l’usage normal, instrumental des images afin
de montrer. » (Ibidem.)
107
�La première manière (négative donc) de considérer cet effet, nous pouvons en
trouver les racines, nous dit Wiesing, dans les attaques violentes que produit à
l’encontre du musée le futuriste italien Filippo Tommaso Marinetti au début du XXème
siècle. En effet selon ce dernier, le musée, en montrant ainsi des choses qui
montraient déjà, en devient un véritable cimetière pour l’art. C’est-à-dire que ce
phénomène de désinstrumentalisation n’aurait pas pour effet de produire des effets de
sens intéressants mais de complétement dénaturer l’œuvre d’art en général qui aurait
alors, dans le cadre du musée, totalement perdu son sens. N’étant ainsi plus utile à
rien, elle n’aurait plus d’intérêt, elle aurait profondément ausgedient.296 Comme le dit
Marinetti de manière particulièrement polémique dans cet extrait de son Manifeste du
futurisme de 1909 (que cite Wiesing) :
Museen : Friedhöfe ! […] Museen : öffentliche Schlafsäle, in denen man
immer neben verhassten und unbekannten Wesen schläft. Museen : absurde
Schlachthöfe der Maler und Bildhauer.297
Ce serait ainsi comme une espèce de « désamorçage » de l’image qui se passerait
dans le cadre du musée puisque dans cette conception en fait essentiellement politique
de l’art, l’image peut servir à des causes importantes et avoir un impact réel sur notre
société, mais dès que l’on l’expose dans un musée, elle semble perdre toute sa force
ainsi que sa possible fonction révolutionnaire pour n’être plus que contemplée par des
spectateurs ensommeillés. Autrement dit, puisque l’image ne montre, dans le cadre du
musée, plus directement ce que l’artiste pouvait vouloir montrer au travers d’elle,
alors elle est seulement montrée en tant qu’objet esthétique inutile. Or on le sent bien,
cette même idée de l’inutilité de l’image dans le cadre du musée peut se laisser
formuler d’une manière quasiment inverse et qui en souligne cette fois l’intérêt.
En effet, on peut également selon Wiesing, et en fait pour les mêmes raisons,
considérer le cadre du musée de manière plus enthousiaste puisque l’on peut repartir
de cette observation selon laquelle l’image, au musée, a ausgedient, mais en refusant
cette autre prémisse, selon laquelle l’image doit avoir une fonction politique (et donc
ne pas se retrouver recluse dans le cadre du musée), on peut considérer au contraire
que l’image, dans ce cadre muséal, est comme libérée de cette obligation d’avoir
toujours un sens et une fonction précise. Dans cette deuxième optique, l’image, en
raison de ce même phénomène de désinstrumentalisation (provoqué lui-même par
cette monstration du deuxième degré précédemment évoquée) n’a alors plus de
fonction – mais c’est précisément là ce qui lui permet d’« être seulement », c’est-àdire de se montrer dans le sens heideggérien que nous présentions. Le musée semble
ainsi permettre à ses visiteurs d’accéder plus facilement à ce que les images sont
296
Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 184.
« Musées : cimetières ! Musée : dortoirs publics dans lesquels on dort toujours à côté
d’êtres haïs et inconnus. Musées : absurdes abattoirs des peintres et des sculpteurs. »
(Ibidem.) Wiesing donne ici à propos de Marinetti la référence suivante : Filippo Tommaso
Marinetti, « Gründung und Manifest des Futurismus » (1909), in : Geschichte des Futurismus,
Christa Baumgarth (éd.), Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1966, p. 23-29, ici p. 27.
297
108
�comme phénomènes. Le cadre du musée semble même être le cadre idéal pour
encourager un tel rapport « an-utilitaire » aux images, où celles-ci se montrent
seulement.
L’attitude phénoménologique de Heidegger, c’est celle qui laisse les choses se
montrer telles qu’elles sont et non telles qu’elles peuvent nous servir. Or ceci peut
être, selon le contexte, une attitude difficile à entretenir, voir une attitude presque
contrindiquée. Comme le remarque Wiesing dans cet exemple plutôt amusant :
Wer in einem plüschigen Schlafzimmer einen pornographischen Videoclip auf
einem Monitor interesselos auf die beeindruckende Komposition,
Kameraführung und schöne Farbgebung hin betrachtet, dürfte nicht
verstanden haben, was das Bild hier zeigen soll und welchem Zweck es hier
dient.298
Or peut-être que le seul contexte dans lequel l’usage que l’on doit faire des images
que l’on voit, le sens que l’on doit leur donner et ce que l’image nous montre, n’est
pas donné d’avance mais est plutôt à rechercher, à produire – voire à refuser de
produire – c’est le musée. Et cela précisément à cause de ce phénomène de
désinstrumentalisation de l’image qui y a lieu. Comme le dit si justement Wiesing :
alors que la fonction d’une tasse décorée d’une image de Van Gogh dans la boutique
du musée est claire, la fonction du Van Gogh lui-même et cette fois dans le musée,
elle ne l’est pas. Le musée semble ainsi encourager à ne plus s’intéresser
exclusivement au sens des choses que sont les images exposées, ni à ce à quoi elles
peuvent me servir, mais seulement à ces images en tant que ce qu’elles sont : des
Sichzeigende.
C’est ainsi la combinaison entre une certaine attitude (heideggérienne) et un certain
contexte (muséal) qui permet d’appréhender l’image se montrant, c’est-à-dire l’image
comme phénomène. En effet, selon Wiesing :
Man hat es so mit einer wechselseitigen Ergänzung von Betrachter-Haltung
einerseits und Kunst-Kontext andererseits zu tun.299
Le musée, conjugué à une certaine attitude proprement phénoménologique, nous
permet d’avoir accès à l’image en tant que telle. Alors comme le dit Wiesing en
conclusion de cette partie consacrée au musée, ce qui apparaît là de manière
298
« Celui qui regarde une vidéo à caractère pornographique sur un écran dans une chambre à
coucher en contemplant de manière désintéressée l’impressionnante composition de l’image,
les mouvements de caméra et le joli coloris de cette image n’a peut-être pas compris ce que
l’image est ici sensée montrer et à quel but elle est sensée servir. » (Lambert Wiesing, Sehen
lassen, op. cit., p. 185)
299
« On a ainsi affaire à une complémentarité réciproque entre l’attitude contemplative d’un
côté et le contexte du musée de l’autre. » (Ibidem.)
109
�particulièrement claire, c’est que :
Was Bilder zeigen, zeigt sich nicht.300
Ce qui veut dire, à un premier niveau, que le sens et la fonction des images, à
l’intérieur d’un musée, ne sont pas déterminés. Mais ce qui veut également dire, si
l’on considère cette phrase en ayant bien en tête ce que l’on a vu avec Heidegger au
sujet du Sich-Zeigen, que ce que l’image est lorsqu’elle « se montre », c’est-à-dire
lorsque l’on la considère, grâce à une certaine attitude qu’encourage le cadre du
musée, comme un phénomène, ce n’est en fait jamais l’équivalent de ce que l’image,
après que l’on lui ait prêté un sens, est sensée montrer. Mais alors qu’est-ce
maintenant qu’une image comme pure Sichzeigende ? Comment se montre à moi
l’image dans le cadre du musée, lorsque je la saisis comme phénomène ? Et comment
décrire ce phénomène ? En le décrivant comme pure visibilité. Or c’est là le dernier
point qu’il nous faut maintenant appréhender.
4. 4. Qu’est-ce qu’une pure visibilité ?
Au début de cette troisième partie, nous avons posé trois questions : que signifie cet
attribut de n’être que visible ? Qu’est-ce qu’une pure visibilité ? En quoi est-ce là
quelque chose qui n’est pas un signe ? Il nous faut maintenant, pour conclure, tenter
de voir en quoi ce que l’on a vu jusqu’ici devrait nous permettre de répondre de
manière appropriée à ces questions. Alors reprenons les dans ce même ordre.
Que signifie cet attribut de n’être que visible et pourquoi l’image ne serait-elle que
visible ? La réponse à cette première question pourra peut-être un peu décevoir ici, vu
qu’elle n’est en fait pas vraiment impliquée par le raisonnement mené jusqu’ici dans
la troisième partie de ce travail. En effet, on aurait tout aussi bien pu la donner en
ouverture de ce cette partie (et je mentionne d’ailleurs brièvement cette idée déjà dans
la conclusion de la première partie de ce travail) : une image est seulement visible,
selon Wiesing, parce que l’on ne peut ni la toucher (avec ses mains), ni la sentir (avec
son nez), ni l’entendre (avec ses oreilles), ni la goûter (avec sa bouche) – on ne peut
que la voir (avec ses yeux). Il semble en effet impossible d’utiliser un autre sens que
la vue pour percevoir une image (c’est-à-dire son Bildobjekt). Elle est donc, dans ce
premier sens, seulement visible. Or cela, Wiesing le disait déjà dans AP, puis le
répétait dans Das Mich der Wahrnehmung :
Der Käse auf einem Foto lässt sich nicht berühren oder riechen; er kann
ausschliesslich gesehen werden.301
300
« Ce que les images montrent ne se montre pas. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit.,
p. 191.)
301
« Le fromage sur une photo ne peut être touché ou senti ; il peut seulement être vu. »
(Lambert Wiesing, Das Mich der Wahrnehmung, op. cit., p. 202.)
110
�Toutefois cette idée, donc déjà exposée avant SL, si elle devait servir seule à définir
ce qu’est une image en tant que telle, c’est-à-dire comme phénomène, poserait des
problèmes assez évidents. En effet, parmi les choses que je ne semble, dans ce
premier sens, que voir, il n’y a pas seulement les images. Il y aussi par exemple la
lune et les étoiles : je ne peux ni les toucher, ni les sentir, ni les goûter, ni les entendre
– je ne peux que les voir. Or cela en fait-il des images ? Il semble bien que non. C’est
donc qu’il ne faut pas seulement comprendre cette idée que l’image est « seulement
visible » de cette manière. Mais alors de quelle autre manière ? Nous pourrions poser
ici le problème d’une autre façon. Quel genre de nécessité fait-il que je ne peux que
voir une image ? Et quel genre de nécessité fait-il que je ne peux que voir les étoiles ?
S’agit-il là du même genre de nécessité ?
Selon Wiesing, il ne s’agit justement pas du même genre de nécessité. L’un est à
expliquer par les limites matérielles (ou technologiques) qui sont les miennes, quand
l’autre est à chercher dans l’être même de l’image, qui détient comme propriété
ontologique spécifique de n’être que visible.302 En effet, l’image, si je ne peux que la
voir, ce n’est pas en raison de limitations qui sont les miennes, mais c’est en raison de
la nature de l’être de l’image, qui est d’être une pure visibilité. Car alors que dans le
cas de la lune ou des étoiles, c’est pour des raisons concrètes que je ne peux que voir
la chose que je regarde (par exemple parce que je ne dispose pas d’un vaisseau pour
aller sur la lune), dans le deuxième cas, on peut s’imaginer posséder tous les
instruments et toutes les technologies du monde, on ne fera jamais que voir une image
(à moins, comme dans certain contes, d’être capable d’entrer dans l’image). Mais
alors à quoi est dû ce deuxième genre particulier de nécessité ? Vu que cette nécessité
ne se situe pas dans une incapacité qui serait la mienne, c’est que celle-ci est à
chercher dans l’image même, qui n’est que visible. Or qu’est-ce qui permet
d’affirmer, et c’est là notre deuxième question, que l’image est une pure visibilité, une
reine Sichtbarkeit ?
C’est premièrement le fait que l’image, en tant que phénomène, en tant que
Sichezigende donc, est bel et bien un être. L’image n’est pas une illusion puisqu’elle
est bien une chose : elle est un phénomène (au sens heideggérien du terme) au même
titre d’ailleurs que n’importe quel autre phénomène qui se montre à moi. Il suffit pour
s’en rendre compte de faire l’expérience phénoménale d’une image : elle se montre
comme n’importe quelle autre chose, elle m’est tout aussi bien présente. Or c’est là
une équivalence cruciale que l’on aura essayé d’établir ici au travers de notre critique
de la théorie de l’illusion, puis de notre commentaire de Wiesing alors lui-même
lecteur attentif de Heidegger : l’image possède une manière de se montrer propre,
donc un être propre, qui se montre à moi lorsque je la regarde, au même titre que
n’importe quel autre être.
Être propre de l’image à propos duquel on peut alors se poser, ensuite, la question
suivante : quelles sont ses propriétés ? Et ce qui apparaît alors, de manière
302
Wiesing parle en effet ici de la ontologische Eigenschaft des Bildobjektes (Lambert
Wiesing, Sehen lassen, op. cit., 70.), ou encore de la bildspezifische sichtbare Eigenschaft
(Ibid., p. 75).
111
�particulièrement claire au travers de l’expérience phénoménale de l’image que
permettent conjointement l’attitude phénoménologique heideggérienne et l’expérience
muséale de l’image, c’est qu’elle a comme propriété ontologique spécifique d’être
seulement visible. Face à une image, à moins de l’utiliser et de lui prêter un sens, je
ne fais a priori que voir. Cela non parce que je suis incapable de percevoir l’image
différemment, mais parce que l’image est, c’est-à-dire se montre tout d’abord comme
une pure visibilité, comme un phénomène de pure visibilité. Or cela, c’est le cadre du
musée qui peut le mieux nous permettre de le sentir puisqu’au musée, je ne fais que
vivre la présence de choses purement visibles. Choses auxquelles je peux alors, a
posteriori, donner tel ou tel sens ou utiliser afin de montrer telle ou telle chose à
quelqu’un mais ce sens, dans le musée, ne m’est pas donné. Dans un premier temps,
au musée, je ne fais véritablement rien d’autre que voir des images, je ne les utilise
pas, je ne leur souscris pas un sens déterminé, je les vois. Ce qui apparaît alors comme
particulièrement clair c’est que:
Was auf einem Bild zu sehen ist, ist eben ausschliesslich zu sehen. Das ist eine
phänomenologisch einlösbare Beschreibung. Doch was sichtbar ist, muss
nicht gezeigt worden sein; die Gleichsetzung der Sichtbarkeit eines
Bildobjekts mit dem Ergebnis einer Zeige-Handlung ist eine gewaltige
Unterstellung, die sich – um mit Heidegger zu sprechen – gerade nicht
zeigt.303
L’image, avant tout, est, c’est-à-dire se montre, et la propriété ontologique
spécifique que je saisis alors dans mon expérience proprement phénoménale de
l’image, c’est qu’elle est purement visible. Or c’est précisément ce que dit Wiesing
quand il affirme que :
[…] Bilder niemals per se Zeichen sind.304
Il veut dire par là que c’est l’être per se visible de l’image qui fonde le reste : ses
usages comme ses sens que je peux a posteriori, et selon la pratique de monstration
dans laquelle je suis engagé, lui attribuer. On a ainsi par là, me semble-t-il, également
répondu à cette troisième question qui est, je le rappelle : en quoi l’image est-elle
quelque chose qui n’est pas un signe ? Elle n’est pas un signe car signifier ce n’est,
pour une image, rien d’autre qu’un usage possible de ce qu’elle est plus
fondamentalement : une chose purement visible.
303
« Ce qui est à voir sur une image est justement seulement à voir. Ceci est une description
phénoménologique de l’image que l’on ne peut dissoudre [ou : ignorer]. Mais ce qui est
visible ne doit pas être montré ; poser une équivalence entre la visibilité de l’image-objet et le
résultat d’une action de montrer est une erreur qui – dans les mots de Heiddeger – ne se
montre justement pas. » (Lambert Wiesing, Sehen lassen, op. cit., p. 93.)
304
« […] les images ne sont jamais per se des signes. » (Ibid., p. 136.)
112
�Bibliographie
WIESING Lambert, Die Sichtbarkeit des Bildes : Geschichte und Perspektiven der
formalen Ästhetik (1997), Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2008.
WIESING Lambert, Artifizielle Präsenz : Studien zur Philosophie des Bildes,
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2005.
WIESING Lambert, Das Mich der Wahrnehmung : Eine Autopsie, Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 2009.
WIESING Lambert, Sehen lassen : Die Praxis des Zeigens, Berlin : Suhrkamp, 2013.
ARASSE Daniel, Histoires de peintures, Paris : Denoël, 2004.
ARISTOTE, Secondes Analytiques, trad. par Jules Tricot, Paris : Vrin, 1979.
ARISTOTE, Catégories, trad. par Richard Bodéüs, Paris : Les belles lettres, 2002.
BAUDRILLARD Jean, La société de consommation, Paris : Gallimard, 1970.
BELTING Hans, Pour une anthropologie des images (2001), trad. par Jean Torrent,
Paris : Gallimard, 2004.
BERGSON Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Paris :
Presses univ. de France, 2007.
BOEHM Gottfried, « Ce qui se montre : De la différence iconique », in : Penser
l’image, Emmanuel Alloa (éd.), Paris : Les presses du réel, 2010, p. 27-47.
BOEHM Gottfried, « Das Zeigen der Bilder », in : Zeigen. Die Rhetorik des
Sichtbaren, Gottfried Boehm / Sebastian Egenhofer / Christian Spies (éds.),
München : Wilhelm Fink, 2010, p. 19-54.
BOILLAT Alain, La fiction au cinéma, Paris / Montréal : L'Harmattan, 2001.
BRANDT Reinhard, Die Wirklichkeit des Bildes, München / Berlin : Hanser, 1999.
BREDEKAMP Horst, Theorie des Bildakts : Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007,
Berlin : Suhrkamp, 2010.
BROCK Bazon, « Kitsch als Objektmagie », in : Der Barbar als Kulturheld,
Gesammelte Schriften 1991-2002, Köln : DuMont, 2002, p. 578-581.
BRUNSCHWIG Jacques, « Aristote, Platon et les formes d’objets artificiels », in :
Aristote et la notion de nature, Pierre-Mariel Morel (dir.), Presses univ. de
Bordeaux, 1997, p. 45-68.
BUDD Malcolm, « The Look of a Picture », in : Aesthetic Essays, Oxford / New
York : Oxford University Press, 2008, p. 216-238.
COURTINE Jean-François, Heidegger et la phénoménologie, Paris : Vrin, 1990.
CREMONINI Andreas, « Was ins Auge sticht : Zur Homologie von Glanz und
Blick », in : Movens Bild : Zwischen Evidenz und Affekt, Gottfried Boehm / Birgit
Mersmann / Christian Spies (éds.), München : Wilhelm Fink, p. 93-118.
CURRIE Gregory, « The Authentic and the Aesthetic », in : American Philosophical
Quarterly, vol 22, n°2, University of Illinois Press, 1985, p. 153-160.
CURRIE Gregorie, Arts and Minds, Oxford University Press, 2004.
DE LIBERA Alain, L’invention du sujet moderne, Paris : Vrin, 2005.
113
�DESCARTES René, Méditations métaphysiques (1641), Paris : Presses univ. de
France, 2010.
DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris : Gallimard, 2005.
ELIADE Mircea, Traité d’histoire des religions, Paris : Payot, 1983.
FIEDLER Konrad, Vom Ursprung der künstlerischen Tätigkeit (1887), in : Schriften
zur Kunst, Bd. I, G. Boehm (éd.), München : Wilhelm Fink, 1991.
GAUDREAULT Alain, Du littéraire au filmique : système du récit, Paris : Méridiens
Klincksieck, 1988.
GELL Alfred, L’art et ses agents : une théorie anthropologique (1998), trad. par
Sophie & Olivier Renaut, Dijon : Les presses du réel, 2009.
GODIN Christian, « Bild », in : Philosophische Grundbegriffe für Dummies,
Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2012, p. 27-28.
GOMBRICH Ernst H., Art and Illusion (1960), Princeton University Press, 2000.
GOODMAN Nelson, Langages de l’art (1968), trad. par Jacques Morizot, Nîmes : J.
Chambon, 2011.
HABERMAS Jürgen, « Es beginnt mit dem Zeigefinger », in : Die Zeit, n° 51, 2009.
HEIDEGGER Martin, Sein und Zeit (1927), Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2006.
HUME David, Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand (1748), Lambert
Wiesing (éd.), Frankfurt am Main : Surkamp, 2007.
HUSSERL Edmund, Logische Untersuchungen, Bd. 2/1 : Untersuchungen
zur Phänomenologie und Theorie des Erkenntnis (1901), in : Husserliana, Bd.
XIX/I, U. Panzer (éd.), Den Haag / Boston / Lancaster : Martinus Nijhoff
Publishers, 1984.
HUSSERL Edmund, « Perception et sens perceptif », in : De la synthèse passive
(1918-1926), trad. par Bruce Bégout & Jean Kessler, Grenoble : J. Million, ,
1998, §10, p. 49-52.
HUSSERL Edmund, Méditations cartésiennes : introduction à la phénoménologie
(1929), Paris : Vrin, 2008.
HYMAN John, The objective eye, Chicago : University of Chicago Press, 2006.
JONAS Hans, « Homo Pictor : Von der Freiheit des Bildens », in : Kritische
Gesamtausgabe der Werke von Hans Jonas, Band I/1, Dietrich Bühler / Michael
Bongardt / Holger Burckhart / Christian Wiese / Walter Ch. Zimmerli (éds.),
Freiburg / Berlin / Wien : Rombach Verlag KG, 2010, p. 277-303.
KULVICKI John V., « Image structure », in : Journal of Aesthetics and Art Criticism,
Vol. 61, 2003, p. 323-340.
KULVICKI John V., Images, Abingdon : Routledge, 2014.
LUCKNER Andreas, Martin Heidegger : Sein und Zeit, Paderborn : Schöningh, 2007.
MITCHELL W. J. T., Das Leben der Bilder : Eine Theorie der visuellen Kultur,
München : C. H. Beck, 2005.
MITCHELL W. J. T., « Que veulent réellement les images ? », in : Penser l’image,
Emmanuel Alloa (éd.), Paris : Les presses du réel, 2010, p. 27-47.
OTTO Rudolf, Le Sacré (1917), trad. par André Jundt, Paris : Payot, 2015.
114
�PEIRCE Charles S., « D’une nouvelle liste de catégories » [On a New List of
Categories] (1867), 1.545-1.560, in : Textes fondamentaux de sémiotique, trad.
par Berthe Fouchier-Axelsen & Clara Foz, Paris : Klicksieck, 1987, p. 21-42.
PLATON, La République, trad. par Pierre Pachet, Paris : Gallimard, 1993.
QUINE W. V., Pursuit of Truth, Revised Edition, MA / London : Cambridge, 1992.
SARTRE Jean-Paul : L’imaginaire (1940), Gallimard : Paris, 2005.
SPINOZA Baruch, Tractatus de Intellectus Emendatione (1677), trad. par Charles
Appuhn, Paris : GF Flammarion, 1964.
TOURATIER Christian, Grammaire latine, Paris : Armand Collin, 2008.
WALTON Kendall L., « Pictures and Make-Believe », in : The Philosophical Review,
Vol. 82, No. 3, 1973, p. 283-319.
WHITE Roger M., The structure of metaphor : the way the language of metaphor
works, Oxford ; Cambridge Mass. : Blackwell, 1996.
WOLLHEIM Richard, Art and its Objects, New York : Cambridge University Press,
1980.
115
�
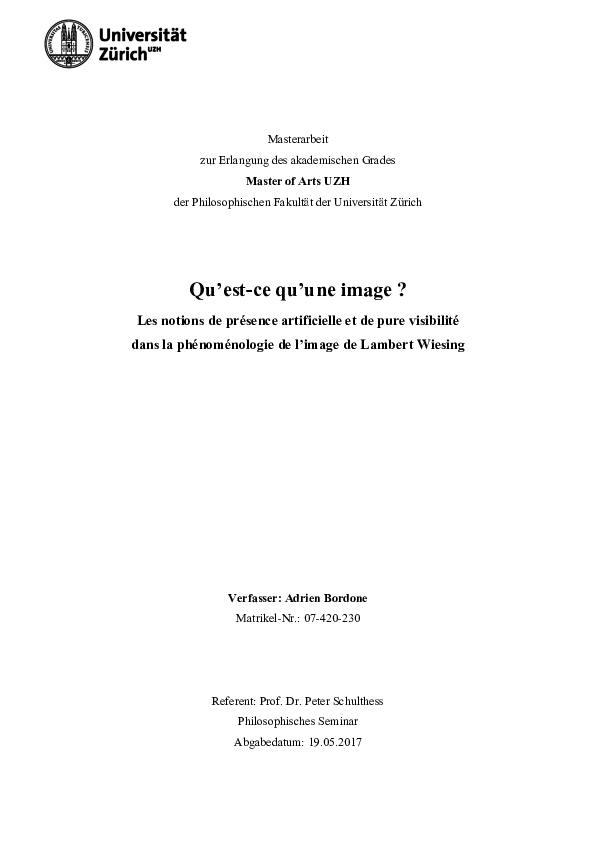
 Adrien Bordone
Adrien Bordone