NOTES DE LECTURE
De Boeck Supérieur | Politix
2013/4 - N° 104
pages 235 à 243
ISSN 0295-2319
Article disponible en ligne à l'adresse:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-politix-2013-4-page-235.htm
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Pour citer cet article :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Notes de lecture »,
Politix, 2013/4 N° 104, p. 235-243. DOI : 10.3917/pox.104.0235
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.
© De Boeck Supérieur. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�HUYARD (Caroline), Rare. Sur la cause politique de maladies peu
fréquentes, Paris, Éditions de l’EHESS, 2012, 251 p.
Par Anne-Marie ARBORIO
Aix-Marseille Université, LEST-CNRS
Les sciences sociales peuvent parfois donner le sentiment de s’intéresser en premier
lieu aux phénomènes les plus massifs, aux cases les plus pleines des tableaux statistiques. Dans un ouvrage tiré de sa thèse de sociologie soutenue en 2007, C. Huyard
relève le défi de prendre un objet défini a priori comme rare et fait de ce qualificatif
le titre de cet ouvrage. Les maladies dites rares sont certes nombreuses, de plus en
plus nombreuses à être caractérisées comme telles (plus de 7 000 aujourd’hui), mais
chacune présente une forte singularité par ses symptômes, par ses effets plus ou moins
invalidants, par sa gravité. Et surtout, chacune ne concerne qu’un nombre limité de
malades (moins d’une personne sur 2 000 selon la définition française). Cependant, de
telles caractéristiques n’ont pas empêché ces maladies, bien au contraire, de mobiliser
autour d’elles des malades, leurs proches ou des professionnels de santé, dans le cadre
d’associations qualifiées rapidement d’« associations de malades ». La « cause politique
des maladies peu fréquentes », comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage, est donc au
cœur de la recherche de C. Huyard.
Cette perspective permet d’interroger les effets sociaux de la rareté, sans présupposer que ceux-ci soient dominants par rapport à d’autres caractéristiques des faits
rapportés, et surtout sans considérer une nécessaire homogénéité induite par un label
DOI: 10.3917/pox.104.0235
104
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Notes de lecture
�236
Notes de lecture
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Ces différentes perspectives imposent la combinaison de trois niveaux d’analyse et
échelles d’observation. En premier lieu, l’organisation de la recherche médicale et les
politiques publiques, l’échelon intermédiaire que constituent les organisations associatives ensuite et, enfin, les parcours et les points de vue des individus qui croisent
la catégorie dans leurs trajectoires individuelles ou familiales et qui contribuent aux
mouvements associatifs. Pour chacun de ces niveaux, l’auteur mobilise un volume impressionnant de matériaux empiriques variés, objets de traitements divers. Six maladies ont donc été sélectionnées pour être étudiées en profondeur. Une partie de ces
matériaux est tirée d’une enquête de terrain réalisée en France. Des entretiens approfondis, longuement cités dans l’ouvrage et précisément analysés, ont été menés avec
des malades ou avec leurs proches, mais aussi avec des bénévoles ou salariés des associations de malades – huit associations à vocation nationale étant liées aux six maladies retenues. D’une manière plus ponctuelle sont exploités des entretiens avec des
professionnels de santé. L’auteure a également suivi et directement observé les activités
des associations concernées au travers de la participation à des réunions, à des conférences, ou autres manifestations telles que la marche des maladies rares. Une autre
partie des matériaux est de type documentaire, notamment un important corpus de
publications médicales, essentiellement en langue anglaise, permettant entre autres
choses de restituer l’évolution des pratiques médicales dans le cas de l’une des maladies retenues, la maladie de Wilson. La clarté d’exposition des résultats fait oublier
combien le coût d’entrée dans ce type de littérature est élevé pour le chercheur en
sciences sociales. À ces documents scientifiques s’ajoutent des articles de presse qui les
complètent s’agissant du cas très médiatique de l’« huile de Lorenzo » aux États-Unis,
du nom de l’enfant pour lequel elle a été mise au point. Ce type de matériaux permet
des incursions sur le terrain américain et des comparaisons fructueuses entre les continents européen et américain par exemple sur les modalités de dépendance réciproque
entre action publique et mobilisation protestataire.
Si certaines des maladies considérées aujourd’hui comme « maladies rares » sont
identifiées depuis longtemps, si leur fréquence limitée est prise en compte à des fins diagnostiques, le regroupement d’un ensemble de maladies sous un label unifiant ne date
que des années 1970. La restitution de la naissance de la catégorie, dans une première
partie de l’ouvrage, permet de réviser le rôle des évolutions des pratiques médicales et
de l’organisation du travail médical dans ce rapprochement d’affections si différentes,
dont le seul point commun est leur faible fréquence. La chaîne de causalité conduisant
à l’invention des maladies rares semble plutôt liée à la question du médicament. En
effet, le processus de mise au point de traitements médicamenteux pour la maladie de
Wilson, étudiée en détail dans le premier chapitre, montre que le passage d’une médecine artisanale à une médecine industrielle, l’expansion du paradigme de la médecine
des preuves, avec un recours croissant à des outils statistiques supposant la prise en
compte d’un grand nombre de cas, ne contreviennent pas à la réalisation d’avancées
importantes pour cette maladie peu fréquente. Le renouvellement de la division du travail médical va cependant conduire à la marginalisation des maladies rares, du fait du
poids croissant donné à l’industrie pharmaceutique, dont l’encadrement réglementaire
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
(« maladies rares ») qui s’imposerait d’évidence. La construction de la catégorie ellemême, apparue à partir des années 1970, est ainsi restituée pour en comprendre les
contours, les enjeux et la chaîne de déterminations. Mais la rareté de la maladie s’impose aussi dans l’expérience même qu’en font les malades, ainsi que dans l’organisation de leur mobilisation au sein d’associations dédiées, regroupées dans un ensemble
inter-associatif plus vaste, censé porter plus efficacement des revendications jugées
compatibles entre elles.
�Notes de lecture
237
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
La deuxième partie s’intéresse à la rareté vécue, aux effets sociaux de cette catégorisation sur les malades et, par suite, sur leur mobilisation dans le cadre d’associations
spécifiques. Autrement dit, que fait la rareté aux malades ? Difficile de démêler ce qui
relève, dans leur expérience, de la maladie elle-même ou de la faible fréquence de cette
maladie, notamment dans le chapitre 3 où il est question de « l’expérience de l’isolement ». Difficile aussi de démêler dans le discours des malades ce qui provient d’une
reconstruction a posteriori, éventuellement co-construite avec l’association. Ce pourrait être le cas de l’« errance diagnostique » sur laquelle insistent certains collectifs,
mais qui n’est rapportée dans ces termes que par trois personnes, les autres considérant qu’un délai plus long de diagnostic est acceptable du fait même de la rareté de leur
maladie. En revanche, les actes de « négligence » dont ils se sentent victimes de la part
du monde médical sont fustigés, qu’il s’agisse par exemple d’un manque d’effort d’investigation pour poser un diagnostic, d’une non-reconnaissance de ses limites par le
professionnel, ou d’un manque d’information sur la vie quotidienne avec la maladie.
L’autre versant de ce chapitre concerne les relations à autrui, l’insertion dans un collectif. La « rupture biographique », étudiée pour d’autres maladies, induit ici le rattachement à de nouveaux groupes, celui des malades de la même affection par exemple. En
même temps, l’aspiration à une vie la plus normale possible peut conduire à chercher à
invisibilier sa maladie ou à contrôler les différences qu’elle induit. Si l’on considère ces
deux caractéristiques de l’expérience de la maladie rare comme relevant de l’isolement,
l’association paraît une voie pour en sortir, et le corpus d’entretiens laisse d’ailleurs
voir une forte participation associative. Le chapitre suivant propose donc de mettre
à l’épreuve empirique l’idée classique que la rareté serait mobilisatrice. L’utilisation
d’une typologie des « biens », inspirée d’Olson, liée à leur accessibilité, conduit à une
typologie des « modalités d’articulation entre un bien, un motif d’association et une
fonction du collectif » (p. 126), illustrées à chaque fois par des entretiens. On aurait pu
attendre ici une description plus fine des processus d’engagement, fût-ce au détriment
de l’exposé théorique préliminaire. Il ressort cependant très nettement de l’analyse que
la rareté – ou la volonté de sortir de la rareté – constitue « une motivation très puissante au regroupement » (p. 140) dans des associations dont le nombre d’adhérents
sera forcément limité, ou qui devront se regrouper au-delà d’une pathologie spécifique
pour atteindre une taille critique.
104
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
se renforce compte tenu de la mise en avant des risques liés à l’activité thérapeutique
elle-même. Cela conduit à examiner de plus près, dans le chapitre 2, le rôle de la puissance publique dans l’apparition de la catégorie des maladies rares : au-delà du pouvoir réglementaire de l’État, c’est aussi son rôle dans la mobilisation de patients – et de
leurs proches – qui se reconnaissent dans cette catégorie qui est analysée. La comparaison entre Europe et États-Unis donne à voir « deux séquences d’interaction successives
et de co-construction des acteurs dans l’élaboration d’une politique publique », utilement synthétisées dans un tableau. L’encadrement de la mise sur le marché des médicaments aux États-Unis, en privant certains malades de leurs médicaments, a « créé un
public » (p. 64), protestant individuellement puis collectivement contre les difficultés
rencontrées pour bénéficier d’un traitement. La législation autour des médicaments
orphelins, supposée répondre à la situation, impose un seuil de prévalence des maladies. En France, c’est un acteur privé – les entreprises pharmaceutiques – qui lance le
processus en s’intéressant au dispositif visant les médicaments orphelins aux ÉtatsUnis ; l’administration se fait « entrepreneur de protestation » (p. 74) en organisant la
prise en compte d’un problème de santé publique et en appuyant la constitution d’une
coalition associative.
�Notes de lecture
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Les associations, échelon intermédiaire de l’analyse, font l’objet de la troisième partie. Elle s’ouvre classiquement (chap. 5) par une description des structures associatives
retenues dans le corpus, sous l’angle de l’organisation de leur pouvoir, de leurs moyens
et de leurs objectifs, répondant à la question « qui dirige ? ». Deux formes principales
d’organisation en ressortent. Les associations « pluralistes » où le partage de la décision
entre les malades, leurs proches et les professionnels de santé est la règle et les associations « monistes » dirigées par une seule catégorie d’acteurs. Parmi ces dernières, celles
qui disposent de moyens importants se distinguent par un certain « radicalisme » qui
en fait un troisième type possible, les trois types étant là encore efficacement présentés dans un tableau de synthèse (p. 166). Pour comprendre ce monde associatif,
la rareté de l’affection ou la traditionnelle opposition entre experts et profanes sont
moins importantes que les modalités de l’organisation du pouvoir. Cette recherche
autorise ainsi une perspective critique sur le terme choisi pour les désigner – association de malades – qui ne rend pas toujours compte de la représentation réelle des
différents acteurs dans l’organisation. Du point de vue de leur activité (chap. 6), leur
objectif commun peut se résumer à la création des différents éléments de la « panoplie
thérapeutique moderne » (p. 170) avec un objectif intermédiaire consistant à disposer
d’interlocuteurs et à les mettre en relation entre eux, la rareté faisant de cette recherche
un défi, qu’il s’agisse de recenser les malades, d’éveiller l’intérêt par des colloques, de
former des professionnels, de gagner des chercheurs à leur cause, voire d’« autoproduire une thérapie » – comme dans le cas détaillé ici de l’huile de Lorenzo que les parents contribuent à mettre au point – ou rendre leur cause publique. Toutes ces actions
se font dans une confusion des rôles entre profanes et professionnels et fournissent
une voie pour observer les modalités d’une perturbation de la relation thérapeutique.
L’ultime chapitre, prudemment présenté comme « exploratoire », s’intéresse au niveau
interassociatif. La frontière numérique qui définit une maladie comme rare ne suffit
pas forcément à assurer la cohésion de l’ensemble. Les malades ne se reconnaissent
pas forcément non plus dans la représentation parfois unifiée qui est donnée par les
médias ou imposée par les organisateurs de la marche des maladies rares sur laquelle
des notes de terrain (p. 207) – trop peu souvent détaillées dans l’ouvrage – montrent
l’utilité d’une approche au plus près des pratiques militantes. Deux modèles de rapport à l’interassociatif coexistent. Le premier, résumé par la formule « un pour tous »
considère que le soutien à l’une de ces maladies aura des effets en chaîne positifs pour
d’autres maladies, tandis que l’autre relève du « chacun pour soi ». Ce dernier, majoritairement présent dans le corpus utilisé ici, fait cependant l’objet d’hésitations, tandis
que d’autres approches de la solidarité entre les maladies rares s’observent sans qu’elles
puissent être rangées dans l’un ou l’autre des modèles.
Pour peu que le lecteur connaisse de très près telle ou telle de ces maladies qui n’ont
pas été retenues dans le corpus, il objectera que, pour cette maladie spécifique, des
processus un peu différents auraient pu être trouvés. Sans doute le chantier reste-t-il
ouvert, mais le livre a le mérite de se confronter aux réalités complexes et diverses de
six maladies, sans jamais voiler cette complexité et cette diversité, par une enquête empirique fouillée. Il en ressort de nombreuses analyses ou pistes de recherche qui seront
utiles tant pour travailler sur le champ des maladies rares que plus largement sur les
maladies plus communes, tant les maladies rares apparaissent comme un « analyseur »
(p. 232) de nombreuses tensions qui affectent les systèmes de santé contemporains
ou les pratiques médicales, mais aussi sur la mobilisation de groupes restreints, ayant
des caractéristiques communes tout autres que l’atteinte par une maladie. Il apporte
donc une contribution importante tant pour la sociologie de la santé, et plus particulièrement de la relation thérapeutique ou de l’expérience de la maladie, que pour la
sociologie des mobilisations collectives.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
238
�Notes de lecture
239
MATHIEU (Lilian), L’espace des mouvements sociaux,
Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2012, 285 p.
Par Julie LE MAZIER
(CESSP-CRPS - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Alessio MOTTA
(CESSP-CRPS - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Walter F. NIQUE FRANZ
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Comment saisir ensemble les dynamiques protestataires au sein de sociétés segmentées en des univers sociaux relativement indépendants ? Comment rendre compte
des relations qu’entretiennent les acteurs contestataires entre eux et avec les différents
champs (politique, médiatique, intellectuel…) avec lesquels ils interagissent ? C’est
à ces questions qu’invite à réfléchir L’espace des mouvements sociaux. L’ouvrage, issu
du mémoire d’habilitation de L. Mathieu, reprend et complète des travaux antérieurs
autour de la même notion (« L’espace des mouvements sociaux », Politix, 77, 2007).
L’enjeu est d’abord d’éprouver la fécondité de l’hypothèse selon laquelle les mouvements sociaux constituent un espace d’interdépendance relativement autonome.
Comme l’explique l’auteur, cette problématique n’est pas nouvelle dans la sociologie
des mouvements sociaux. Les notions de « champ multi-organisationnel » (Curtis (R.),
Zurcher (L.), « Stable Resources of Protest Movements: the Multi-Organizational Field »,
Social Forces, 52 (1), 1973), de « secteur des mouvements sociaux » (Mc Carthy (J.), Zald
(M.), « Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory », The American
Journal of Sociology, 82 (6), 1977), de « champ du mouvement social » (Mauger (G.),
« Pour une politique réflexive du mouvement social », in Cours-Salies (P.), Vakaloulis
(M.), dir., Les mobilisations collectives. Une controverse sociologique, Paris, Presses universitaires de France, 2003) ou encore de « champ militant » (Péchu (C.), Droit au
Logement : genèse et sociologie d’une mobilisation, Paris, Dalloz, 2006), pour ne citer
que quelques exemples, s’inscrivaient déjà dans cette perspective. L’originalité de l’approche ici développée tient à la multiplicité des fils que l’auteur tire à partir de cette
hypothèse. Celle-ci l’engage dans une relecture critique des principaux résultats de
la sociologie des mobilisations de ces dernières décennies à l’appui d’un important
volume de matériaux empiriques de première et de seconde main. Il propose de ce
point de vue un ouvrage de référence pour la sociologie des mouvements sociaux, qui
apporte une boîte à outils conceptuelle et méthodologique pour les enquêtes à venir.
Le livre repose sur un dialogue riche entre approches sociologiques distinctes. Pour
construire sa description de l’espace des mouvements sociaux, L. Mathieu s’inspire
notamment des travaux de Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann et Michel Dobry sur
la différenciation des sociétés complexes en univers relativement autonomes. Il discute également les théories de l’école de la mobilisation des ressources, les sociologies
interactionniste et pragmatique, ainsi que l’analyse des cadres de l’action collective.
Le livre est structuré en trois parties. La première étudie les liens qui unissent mobilisations, causes, organisations et acteurs au sein de cet univers particulier qu’est
l’espace des mouvements sociaux. La deuxième partie est consacrée aux relations que
ce dernier entretient avec différents champs (politique, médiatique, intellectuel…).
L. Mathieu s’y attache, à partir de l’étude du cas français du XIXe siècle à nos jours
et plus particulièrement de 1968 à 2007, à identifier les variations conjoncturelles de
104
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
(CESSP-CRPS – Capes Foundation Brazil)
�240
Notes de lecture
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Dans la première partie, L. Mathieu tente de montrer les principes d’unification de
l’espace des mouvements sociaux. Si la comparaison avec la notion bourdieusienne de
champ – appréhendée ici comme un idéal-type – traverse tout l’ouvrage, L. Mathieu
montre bien qu’il s’agit là d’un espace moins structuré et institutionnalisé que d’autres.
Raison pour laquelle il choisit le terme d’espace plutôt que de champ. Dans cet espace existent des rapports d’interdépendance objectifs qui relient les organisations et
sous-espaces de lutte : circulation de militants et de leadership, reprise de registres,
de cadres cognitifs et de répertoires d’action, stratégies de coalition ou affrontement
entre organisations… Les acteurs et organisations se trouvent également pris dans des
dynamiques concurrentielles pour rendre visibles leurs revendications, imposer leur
perception sur des enjeux, se faire reconnaître comme l’interlocuteur d’une négociation ou le porte-parole légitime d’une cause. Ces interactions produisent une « zone
d’évaluation mutuelle » (p. 43-51), impliquant un travail constant d’observation de
l’état des rapports de forces à l’intérieur de l’espace, de l’action des autres organisations et, en conséquence, des risques et opportunités ouvertes dans chaque contexte.
L. Mathieu l’illustre par exemple par l’impulsion des mobilisations pro-vie aux ÉtatsUnis, en réaction à l’essor du mouvement féministe dans les années 1970.
Pour autant, les logiques de concurrence internes à l’espace n’ont pas pour enjeu
une catégorie unique de trophées. Contrairement à ceux qu’identifie Bourdieu dans
des champs constitués, ceux-ci, même si l’on peut en repérer un certain nombre, « sont
trop divers et exercent des effets trop distincts pour se laisser résumer dans une forme
unique de capital ou d’illusio » (p. 43). L’intérêt de mettre au jour les dynamiques
concurrentielles internes aux mobilisations est ailleurs. Trop souvent, les mouvements
contestataires sont appréhendés comme des entités rassemblant des ressources et mettant en œuvre une stratégie en vue d’un objectif partagé. Il s’agit ici, au contraire, de
montrer que le caractère collectif des mobilisations doit moins être traité comme un
donné que comme une construction, produit d’un travail militant toujours fragile, et
dont les conditions de félicité sont à élucider (chap. 2).
Moins institutionnalisé qu’un champ, l’espace des mouvements sociaux est également plus hétéronome. C’est aux variations conjoncturelles de sa consistance, et de ses
relations avec d’autres champs, qu’est consacrée la deuxième partie de l’ouvrage. L’auteur invite à considérer toutes les pratiques de balisage ou de bornage par lesquelles
les acteurs contestataires tentent d’assurer l’autonomie de leurs luttes, notamment par
rapport au champ politique. Dans le chapitre 4, il montre que celle-ci a fluctué au
cours de l’histoire française. L’après-mai 1968 est un moment important d’autonomisation d’un espace des mouvements sociaux. La reconversion de militants de gauche
dans la cause de groupes marginalisés et des minorités entraîne une progressive différenciation par rapport au pôle révolutionnaire de l’extrême gauche, orienté vers la
conquête du pouvoir politique. En revanche, après l’arrivée de la gauche au pouvoir
en 1981, on observe un processus d’absorption de l’espace de mouvements sociaux par
la politique partisane. Une nouvelle recomposition s’opère dans les années 1990. Des
organisations comme Droit au logement, Agir ensemble contre le chômage ou Attac,
des mobilisations, comme celle contre le plan Juppé en 1995, ou encore l’appel « Nous
sommes la gauche » (1997), témoignent d’entreprises visant à obtenir des victoires
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
l’autonomie de l’espace des mouvements sociaux. Enfin, une troisième partie s’intéresse à ce qui se joue au niveau des acteurs – leurs dispositions, leurs compétences et les
discours de justification de leurs pratiques qu’ils produisent. L’ouvrage articule ainsi
une compréhension des propriétés objectives et structurelles de cet espace particulier
à celle des dimensions subjectives et pratiques de l’activité contestataire, les intégrant
dans une même grille d’analyse de l’action collective.
�Notes de lecture
241
sans le relais d’organisations partisanes. À la fin de la décennie 2000, les rapports entre
mouvements sociaux et champ politique se complexifient, comme le montre entre
autres exemples la candidature de José Bové à l’élection présidentielle de 2007.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
La troisième partie de l’ouvrage est centrée quant à elle sur les acteurs des mouvements sociaux, leurs dispositions, perceptions et représentations, et surtout sur les
compétences pratiques et cognitives qu’ils mobilisent dans la pratique contestataire. La
comparaison de l’espace des mouvements sociaux avec la notion de champ pourrait
laisser penser que L. Mathieu s’inscrit dans une approche dispositionnelle. De celle-ci,
il retient le rôle des trajectoires passées dans la propension à s’engager et à occuper
telle ou telle place dans l’action collective. Néanmoins, Lilian Mathieu construit ici un
dialogue avec d’autres courants qui mettent davantage l’accent sur le rôle des logiques
de situation, des interactions, et sur le sens que les militants donnent à leur action. Il
se livre ainsi à une discussion serrée de la sociologie interactionniste, de la sociologie
pragmatique et de l’analyse des cadres de l’action collective, qui démontre la nécessité de croiser ces approches pour comprendre l’engagement contestataire. Il invite à
mettre l’accent non seulement sur les dispositions des acteurs, c’est-à-dire sur les matrices incorporées susceptibles d’engendrer des comportements, mais surtout sur les
compétences qu’ils mobilisent dans leurs pratiques, savoirs et savoir-faire spécifiques
impliqués par l’action elle-même : maîtriser un répertoire d’action collective, publiciser une cause, manier le conflit, mais aussi la négociation et le compromis, se repérer
dans les différents courants politiques investis dans une mobilisation et posséder les
schèmes de perception propres à cet espace, etc.
L. Mathieu ouvre ici un programme de recherche important, dans la mesure où ces
compétences et pratiques sont plus souvent présupposées que décrites pour elles-mêmes
dans la sociologie de l’action collective. Or il souligne qu’elles supposent nécessairement
un travail d’adaptation et d’apprentissage de la part des acteurs, même lorsqu’ils possèdent les dispositions requises pour l’action collective. Parmi ces dernières, il en analyse
en particulier deux, qu’il qualifie de « disposition critique » (p. 188-193) et de « disposition à l’action collective » (p. 193-200). Celles-ci sont souvent acquises dans d’autres
sphères sociales (familiale notamment), et par conséquent leur ajustement immédiat
à la situation d’engagement, loin d’être la norme, est plutôt l’exception. La sociologie
dispositionnelle doit donc être complétée par les apports de la sociologie interactionniste, et ce dans deux directions. D’abord, Lilian Mathieu invite à placer la focale sur
la façon dont la situation contestataire permet l’activation de ces dispositions et, ce
faisant, les travaille et les transforme. Ensuite, s’appuyant principalement sur l’enquête
qu’il a menée avec Annie Collovald sur des salariés du commerce, il montre que l’approche dispositionnelle ne permet pas de rendre compte de tous les cas d’engagement.
Certains acteurs sont peu dotés en ressources et capitaux habituellement répertoriés
par la sociologie des mouvements sociaux comme nécessaires à l’action collective, et
se mobilisent pourtant : c’est la question des mobilisations improbables. Une analyse
104
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
L. Mathieu distingue ainsi deux conjonctures de structuration de l’espace des mouvements sociaux : les années 1970 et une nouvelle vague à partir de la mi-1990. Dans
ces périodes, « l’autoréférence de l’espace des mouvements sociaux, i.e. le sentiment
partagé par nombre de ses membres de constituer un univers distinct et qui, quoique
situé à distance du champ partisan, n’en est pas moins capable de peser sur le cours
de la vie politique » (p. 144), serait plus évidente. Si les relations avec le champ politique exercent des effets structurants sur l’espace des mouvements sociaux, ses rapports comme ses différences avec d’autres champs (syndical, artistique et intellectuel,
médiatique) sont également centraux pour comprendre les dynamiques qui s’y jouent
(chap. 5).
�242
Notes de lecture
de type interactionniste est alors nécessaire pour comprendre comment telle ou telle
situation les a contraints à s’engager, entraînant éventuellement une transformation
de leur rapport à l’action contestataire (p. 228-239).
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
L’auteur met finalement en évidence l’univers de sens que construisent les mouvements sociaux, ensemble de schèmes de perception requis pour y participer (p. 269-277).
C’est sans doute l’un des arguments les plus centraux pour montrer l’autonomie et l’unification d’un espace des mouvements sociaux en tant que tel : l’action contestataire suppose bien des compétences pratiques et cognitives particulières, que l’on retrouve dans
différents types de mobilisations, et qui circulent entre elles. Cela se traduit dans le sentiment d’étrangeté des novices lorsqu’ils découvrent la pratique contestataire, la sensation
d’entrer dans un univers nouveau, et la transformation de leurs schèmes de perception
par l’action collective, qui se retrouvent de façon similaire dans différents mouvements
sociaux. Cela indique qu’il existe bien un univers particulier de la contestation en tant
que pratique singulière et obéissant à ses propres logiques.
Néanmoins, si la prise en compte des logiques sectorielles ou des effets de champ est
heuristique pour saisir les dynamiques contestataires, on peut se demander – et c’est la
principale limite de l’ouvrage – si celles-ci dessinent bien un espace des mouvements
sociaux ou plutôt une pluralité d’espaces contestataires, correspondant à chaque cause
ou ensemble de mouvements. Cette dernière hypothèse est évacuée par l’auteur au motif que « la diversité de leurs enjeux n’empêche pas les mouvements de s’unir dans des
coalitions (comme lorsque les malades du sida soutiennent les chômeurs) ou simplement de s’inspirer de leurs registres de discours ou formes d’action (comme quand les
prostituées “empruntent” l’occupation d’église aux sans-papiers) » (p. 22). Pourtant,
la zone d’évaluation mutuelle pertinente pour des acteurs contestataires semble plus
souvent se réduire à des mouvements agissant autour de causes proches (ou antagonistes) que s’étendre à l’ensemble des mouvements sociaux. Il existe des points d’appui
empiriques suggérant que certains acteurs se perçoivent comme parties prenantes d’un
espace qui serait « le mouvement social », comme en témoigne par exemple l’« Appel
pour une autonomie du mouvement social », lancé par les militants de plusieurs syndicats et organisations et publié dans Libération le 3 août 1998. Mais il n’est pas certain
qu’il en aille ainsi pour tous les participants à des mouvements sociaux. Et à plus forte
raison si l’on y inclut, davantage que ne le fait le livre, les mobilisations conservatrices
ou « de droite ».
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Enfin, un intérêt est porté à la production de discours, de justifications et de schèmes
de perception spécifiques produits par et dans l’activité contestataire. Cela passe d’abord
par une discussion des apports de la sociologie pragmatique, qui cherche en particulier
à identifier des « grammaires » de l’action collective (p. 245-249), normes non écrites
sur ce qui « se fait » ou pas dans telle ou telle situation. Pour Lilian Mathieu, le principal intérêt de cette approche est d’attirer l’attention sur les inégalités dans la maîtrise
de l’étiquette, les « fautes de grammaire », pour mieux comprendre des inégalités de
participation ou les obstacles rencontrés par certaines mobilisations. Il invite en outre
à explorer les conditions différenciées d’acquisition de ces compétences pragmatiques.
Les inégalités de compétences permettent en effet de distinguer des « virtuoses » et
des « novices » de l’action collective (p. 249-252). Cela passe ensuite par une critique
frontale de l’analyse des cadres de l’action collective qui tend – notamment dans les
travaux de David Snow – à les réifier, les traitant comme des instruments stratégiques
utilisés par les acteurs et ayant une existence autonome, alors que les justifications de
l’action sont en grande partie produites dans et par l’activité protestataire.
�Notes de lecture
243
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
En tout état de cause, l’ouvrage offre un riche travail de cartographie synchronique
et diachronique des luttes en France depuis 1968. Il apporte également des outils précieux pour en comprendre les enjeux et ressorts pratiques, en puisant dans des approches théoriques variées. Si l’idée qu’il existerait un espace des mouvements sociaux
unifié peut être contestée, l’entreprise d’unification des cadres et méthodes permettant
de les analyser est clairement réussie.
104
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.99.200.24 - 16/06/2014 22h34. © De Boeck Supérieur
Il est certes peu intéressant de fixer d’emblée les limites d’un espace ou d’un champ,
parce que ces dernières sont elles-mêmes un enjeu de luttes. Mais en l’absence de limites claires, de trophées centraux autour desquels les luttes concurrentielles se structureraient, peut-on vraiment parler d’un espace ? La difficulté du projet théorique de
L. Mathieu tient dans la volonté de faire tenir ensemble une comparaison de l’espace
des mouvements sociaux avec des champs constitués, et le constat que leurs propriétés communes sont labiles. En définitive, l’intérêt de l’analyse repose peut-être moins
sur l’accent mis sur l’unification des mouvements sociaux dans un méta-champ que
sur l’analyse que propose l’auteur chemin faisant des dynamiques de relations entre
des acteurs et unités liés à des causes, mobilisations et enjeux distincts. Les exemples
mobilisés le rapprochent ainsi de la perspective adoptée par d’autres auteurs attentifs
à l’inscription des acteurs contestataires dans des arènes ou des espaces différenciés.
On pense par exemple à M. Dobry (Sociologie des crises politiques. La dynamique des
mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences
politiques, 1992) ou, plus récemment, à Neil Fligstein et Doug McAdam (A Theory of
Fields, New York, Oxford University Press, 2012).
�
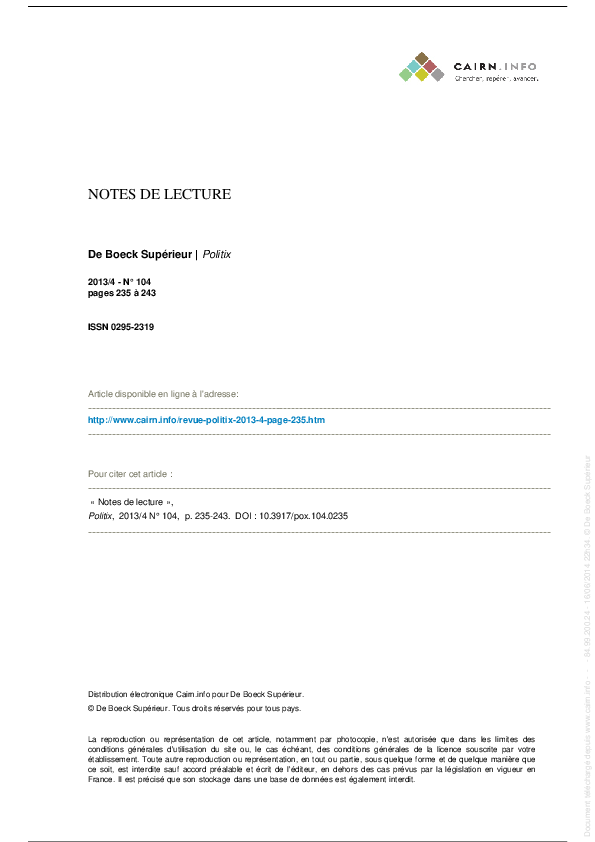
 Walter Nique Franz
Walter Nique Franz