Article paru dans J.F. de Pietro et Marielle Rispail (dir.) L’enseignement du français à l’heure du plurilinguisme, Presses Universitaires de Namur, 2014, p. 65-79.
De la typologie linguistique à sa déclinaison didactique :
pour la maîtrise du langage et de la langue française par l’aide au bilinguisme, en particulier dans les Outre-mer français
Michel Launey
Université Paris-7 et IRD-Guyane
1. Acquis et apories.
La dissociation théorique entre FLE (Français Langue Etrangère) et FLS (Français Langue Seconde ou Langue de Scolarisation : Cuq 1991, Verdelhan 2003) témoigne d’une maturation de la réflexion sur la place de la langue française dans la vie personnelle et sociale des apprenants. L’apprentissage peut en effet se placer soit dans le cadre d’un choix réfléchi et éventuellement révocable – enrichissement culturel ou accès à un métier qui implique le bilinguisme – soit dans celui d’une certaine contrainte : si l’on vit dans une partie du monde où le français est langue officielle et véhiculaire, il est socialement intenable de l’ignorer. Impliquant des méthodologies différentes, cette opposition a désormais une traduction dans les programmes et les cursus, où les deux sigles définissent des approches également légitimes.
D’un autre côté, il n’y a pas de table rase. Apprendre une langue seconde est aussi se construire comme bilingue, et chez les chercheurs en sciences du langage ou en sciences de l’éducation, un certain consensus est aujourd’hui réuni pour préconiser une prise en compte de la langue première. Mais ce principe ouvre sur toute une série de questionnements et de pratiques pédagogiques, et comme on peut s’y attendre sur certaines controverses, où les convictions et les arguments se mêlent parfois à la défense de positions institutionnelles acquises
Voir Maurer (2007) pour un tel cas d’école dans un pays africain.. Et cette fois, le système éducatif français se montre beaucoup plus réticent à traduire dans ses méthodes et ses programmes – et dans la formation de ses maîtres – un principe auquel adhèrent pourtant en privé un nombre croissant d’enseignants et d’inspecteurs. On peut y voir plusieurs causes : la difficulté de renoncer à l’idée, incarnée dans les années 1880 par la méthode directe ou méthode Carré (Puren 2004), que c’est l’exclusion de leur langue dans l’espace scolaire qui garantit aux élèves allophones l’accès au français ; le fait que dans la société française contemporaine ces élèves allophones ne soient plus des autochtones d’une région de l’hexagone, mais des étrangers, issus d’une immigration linguistiquement plurielle, avec en conséquence la difficulté de prendre en compte ce grand nombre de langues ; le fait que beaucoup (la plupart ?) des langues concernées ne bénéficient pas de la tradition d’un enseignement scolaire et manquent souvent de matériel pédagogique, de normes graphiques et de maîtres formés ; et bien sûr, l’existence de débats qui empêchent la livraison clés en main d’une didactique intégrée fournit un argument de bonne ou de mauvaise foi aux tenants de l’enseignement monolingue.
On peut ainsi dresser un constat navrant : l’école qui se proclame ouverte sur le monde a du mal à prendre en compte la partie du monde extérieur qu’elle accueille, et ce tout particulièrement en ce qui concerne les langues. Les instructions officielles font preuve d’une désarmante naïveté :
On attend aussi de l’apprentissage d’une langue étrangère ou régionale qu’il renforce la maîtrise du français en attirant l’attention sur les ressemblances et les différences entre les langues, et qu’il élargisse l’horizon culturel des élèves (programmes 2002).
L’apprentissage des langues étrangères peut conduire à des comparaisons qui donnent des éclairages nouveaux à l’analyse menée sur la langue française (programmes 2007).
Les élèves découvrent très tôt l’existence de langues différentes dans leur environnement, comme à l’étranger. L’apprentissage des langues vivantes s’acquiert dès le début par une pratique régulière et par un entraînement de la mémoire (programmes 2011).
On le voit, la seule relation pensée aux langues est l’apprentissage d’une langue seconde inconnue au départ. Si l’altérité linguistique est présentée comme une « découverte », qui se fait par le hasard (rencontres, voyages) ou par la curiosité intellectuelle relayée par l’école, c’est que le programme est conçu pour des monolingues francophones. Mais ceux pour lesquels la pluralité des langues fait partie du vécu quotidien ne sont pas invités à appliquer à leur langue première la curiosité dont sont dignes les langues de grande diffusion – et dans les faits, la plupart du temps, le seul anglais. Ni eux-mêmes, ni l’école ne tirent aucun profit de cette compétence
Sur ce sujet, voir (entre autres) Hélot (2007)., qui n’est pas acquise par l’effort assidu ou par « entraînement de la mémoire », mais simplement par les conditions ordinaires du développement du langage.
2 Enseignement ou présence réfléchie ?
D’autant que le cas de figure rencontré par l’école de Jules Ferry à la fin du XIXe siècle – une langue régionale qui est aussi la langue maternelle et seule connue des enfants arrivant à l’école – a certes disparu en France hexagonale, mais est encore largement présent dans plusieurs endroits en Outre-mer : à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans une partie de la Guyane (les écoles où la majorité des élèves sont Amérindiens, Bushinenge ou Hmong
Les Bushinenge ou Noirs marrons sont les descendants des esclaves ayant fui les plantations et développé dans la forêt des sociétés libres. Leurs langues sont des créoles à base lexicale anglaise. Les Hmong, originaires du Laos, ont après 1977 essaimé en diaspora dans plusieurs endroits du monde, dont deux villages de Guyane, Cacao et Javouhey.), une partie de la Nouvelle-Calédonie (les villages kanak) et de la Polynésie
Le bilinguisme français – langue locale est beaucoup plus répandu dans les DOM créolophones, encore qu’en Guadeloupe et à La Réunion le bilinguisme soit souvent déséquilibré au profit du créole, voir plus bas.. L’acquisition du français en tant que langue de scolarisation y représente un enjeu capital, d’autant qu’on n’y trouve pas réunis les facteurs qui ont assuré le succès de la francisation des allophones métropolitains dans la période 1880-1950 : une altérité culturelle modérée, un corps enseignant très majoritairement local
L’extranéité du corps enseignant est particulièrement forte en Guyane, mais nettement moindre ailleurs., et de réelles perspectives d’ascension sociale à travers la maîtrise de la langue nationale. Si en arrivant à l’école les enfants entendent parler de choses qu’ils ne connaissent pas dans une langue qu’ils ne comprennent pas, la transmission des connaissances et l’intégration sociale sont compromises. Les évaluations nationales de CM2 reflètent bien cet échec : dans les tests de français, par rapport aux moyennes nationales, les trois îles créolophones (Guadeloupe, Martinique, Réunion) décrochent de quelques points, mais la Guyane et surtout Mayotte « plongent »
Les résultats de 2011 sont : au niveau national, la meilleure des quatre « tranches » regroupe 43% des élèves, les trois îles créolophones entre 33% et 38%, la Guyane 15%, Mayotte 8% ; pour la tranche inférieure, la moyenne nationale est de 7%, les trois îles entre 10 et 16%, la Guyane 46%, Mayotte 57% : http://www.education.gouv.fr/pid20947/archives-des-resultats-des-evaluations-des-acquis-resultats.html?acad=30&dpt=0&annee=2011&niv_scol=CM2&form_action=resultat&envoie.x=42&envoie.y=11 Ces évaluations ne sont pas réalisées dans les territoires du Pacifique..
C’est la raison pour laquelle sont apparus, à partir de l’expérience du terrain plus que d’une politique nationalement concertée, des dispositifs introduisant la langue maternelle dans les petites classes (cycles I et II, de la maternelle au CP ou au CE1), sous la forme de ce qu’on appelle activités de langage : incitation à la verbalisation, sensibilisation ludique à la phonétique ou à certaines structures grammaticales, enrichissement du vocabulaire, écoute de contes, etc. La forme la plus élaborée, et qui rejoint des formules expérimentées ailleurs (en particulier dans certains pays latino-américains pour la scolarisation des Amérindiens), se rencontre à Wallis : l’accueil en première année se fait en langue maternelle, et la langue de scolarisation est introduite en proportion croissante dans les années suivantes. En Guyane existent depuis 1998 des ILM (Intervenants en Langue Maternelle, originellement appelés Médiateurs bilingues), dans certaines écoles accueillant des enfants amérindiens, bushinenge et hmong. Leur utilité est désormais reconnue, mais leurs plages d’intervention sont courtes (1 à 2 heures par semaine) et son développement a été chaotique à cause des incertitudes sur leur statut
Voir Goury et al. (2000), Crouzier (2007), Launey et Puren (2010). Pour un aperçu plus général de la situation guyanaise, voir Léglise et Migge (2007).. A Mayotte, une timide expérience de ce type a été menée dans trois écoles à partir de 2006, mais dans l’hostilité sourde ou déclarée de deux des trois vice-recteurs successifs, et sans formation des enseignants : ce blocage est d’autant plus navrant que c’est l’endroit où une telle expérimentation serait le plus nécessaire et le plus facile à mettre en place, puisqu’il n’y a que deux langues et un corps enseignant largement local et locuteur de ces langues
Sur Mayotte, voir Laroussi et Liénard (2011)..
Bien que les langues concernées aient les caractéristiques des langues régionales selon la Charte européenne des langues régionales et minoritaires de 1992, et apparaissent comme telles dans le rapport Cerquiglini de 1999
Les langues de la France : http://www.dglflf.culture.gouv.fr/lang-reg/rapport_cerquiglini/langues-france.html , ces dispositifs ne se placent pas dans la perspective LCR (Langues et Cultures Régionales), telle qu’elle a été tracée par la loi Deixonne
Loi 51-46 du 11 janvier 1951 : « Enseignement des langues et dialectes locaux »., les circulaires Savary
Circulaires 82-261 du 21 juin 1982 « L’enseignement des cultures et langues régionales dans le service public de l’Education nationale » et 83-547 du 30 décembre 1983 « Texte d’orientation sur l’enseignement des cultures et langues régionales »., et le Code de l’Education de 2000. Il ne s’agit pas d’enseignement au sens strict, mais plutôt d’activités de langage en langue maternelle, dans la perspective d’un « équilibrage » linguistique permettant le bien-être dans le langage par un bilinguisme assumé. Et contrairement à une tradition qui depuis l’abbé Grégoire veut cantonner les langues régionales dans les études savantes, c’est évidemment dans les petites classes, à l’âge où n’est pas terminé le développement du langage à travers celui de la langue première, que ces activités ont du sens et de la fécondité.
Une autre ambiguïté est levée. La loi Deixonne était issue de propositions de députés bretons et méridionaux qui avaient acquis le français selon la méthode Carré : conscients par expérience personnelle des souffrances causées, ils étaient désireux d’éviter la même expérience aux générations suivantes, en leur donnant les moyens de développer un bilinguisme harmonieux. Mais la francisation linguistique était déjà bien avancée en 1951, où les enfants d’âge scolaire étaient soit monolingues francophones soit bilingues en langue régionale et en français. Le statut du français comme seule langue de scolarisation ne posait donc plus de problème. En revanche, il était difficile d’enseigner une langue régionale à la fois à des locuteurs et des non-locuteurs, et de choisir entre des méthodes d’enseignement de langue maternelle ou de langue seconde. On sait que ce dilemme a donné lieu à une dérive consistant à minorer le volet « langue » au profit du volet « culture », et à glisser de là vers le folklore (Gardin 1975). En 1983 (circulaires Savary), le nombre des bilingues lui-même avait tellement diminué que la forme la plus adéquate des enseignements de LCR consistait à adopter des programmes de langue seconde, avec une progression à partir de zéro comme pour une langue vivante étrangère.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie présentent un cas un peu différent. L’existence d’exécutifs autonomes donne plus de liberté décisionnelles, et les langues kanak ou polynésiennes sont présentes dans les plus grandes classes, avec des volumes horaires plus importants (entre 5 et 7 heures hebdomadaires en Nouvelle-Calédonie, 2h 40 à 5 heures en Polynésie). Bien que ces enseignements se soient ouverts dans le cadre de la loi Deixonne (en 1981 pour le tahitien, en 1992 pour quatre langues kanak
Drehu, ajië, nengone, paicî., ils se déroulent au moins dans les petites classes selon des objectifs et des méthodes qui sont plus proches des ILM guyanais que des LCR métropolitaines, et laissent la porte ouverte à certaines initiatives locales dans d’autres langues
Voir par exemple pour le xaracùù le projet Bb-lecture de Marie-Adèle Jorédié : http://www.sorosoro.org/videos-en-langue-xaracuu-nouvelle-caledonie.. D’autre part, si les langues kanak sont plutôt bien transmises « en brousse »
Formulation localement consacrée et non péjorative. et dans les îles Loyauté, il n’en va pas de même en ville, où les leçons en telle ou telle langue kanak sont suivies par des enfants qui sont originaires d’un autre groupe linguistique. A Tahiti, le tahitien est très présent dans la vie quotidienne, mais n’est langue première que d’une partie de la population. Au-delà du rôle essentiel de la langue première, celui d’une langue de socialisation et de patrimoine peut être un élément légitime d’une pédagogie du bilinguisme
Voir les travaux de l’équipe ECOLPOM : http://www.ecolpom.univ-nantes.fr . Voir aussi Vernaudon et Fillol (2009)..
Un problème voisin se retrouve dans les pays créolophones, où le bilinguisme français-créole est le cas de figure le plus répandu, et où le créole a souvent un rôle véhiculaire et intégrateur. Le soutien à un bilinguisme existant dans la société peut contribuer à un nivellement de la maîtrise des deux langues chez les individus pour lesquels elle est inégale. En tout cas, quand les jeunes enfants s’avèrent meilleurs créolophones que francophones, on voit se développer des activités pédagogiques de type ILM : ainsi en Guadeloupe (Bolus 2009) et à La Réunion (Georger 2006)
Sur La Réunion, voir aussi Prudent, Tupin et Wharton (2005). .
Si ces activités sont particulièrement adaptées aux petites classes linguistiquement allophones et homogènes, elles peuvent donc se poursuivre sous d’autres formes dans la suite de la scolarité, et s’adresser à des (encore) non-locuteurs ou locuteurs passifs, là où la langue est très présente dans l’environnement et peut être un élément de socialisation. Mais elles impliquent que les enseignants ou intervenants qui les assurent aient une maîtrise parfaite de la langue. Si les classes sont plurilingues, et si les enseignants sont extérieurs, on entend régulièrement une objection teintée d’angoisse : « Mais je ne peux tout de même pas parler toutes les langues de mes élèves ! ».
Bien sûr, mais là encore c’est penser la relation aux autres langues sous le seul angle de l’apprentissage à des fins communicatives, non de l’intérêt intellectuel qu’il y a à se former une conception plus riche du langage, ou de l’exploitation judicieuse des connaissances partielles. Ce changement de paradigme est proposé par les méthodes dites d’éveil aux langues (Candelier 2003, Balsiger et al. 2012), qui prennent la diversité linguistique elle-même comme objet d’étude, et proposent des exercices ludiques (Perregaux et al. 2003, Kervran 2006) portant chaque fois sur plusieurs langues et visant à développer l’observation, les capacités métalinguistiques, la confiance dans le contact avec les réalités non familières, et l’intérêt pour l’altérité linguistique et culturelle (en particulier, mais pas exclusivement, sur celle qui est présente à travers les pairs). Dans ces activités, la compétence attendue des enseignants n’est pas la maîtrise d’une ou plusieurs langues, mais – ce qui peut être acquis par une formation plus légère – la capacité au décentrage et l’aptitude à « rebondir », pour les exploiter pédagogiquement, sur des éléments de connaissance qu’ils n’ont pas au départ, mais qui peuvent apparaître à travers certains de leurs élèves devenus informateurs et experts de leur langue.
Toutes ces formules montrent que l’enseignement comme langue seconde, ou même comme langue maternelle, n’est pas la seule forme féconde de présence d’une langue à l’école : celle-ci peut se décliner de plusieurs manières (selon la langue, l’âge, le degré d’homogénéité de la classe, le degré de bilinguisme des élèves et de la société…), de sorte qu’il serait préférable de réserver les syntagmes enseigner (ou : enseignement de) la langue L, apprendre (ou : apprentissage de) la langue L au cas de l’enseignement/apprentissage d’une langue seconde. Mais même dans les formes les plus prototypiques des enseignements de français langue seconde, même si le groupe est linguistiquement hétérogène et même si l’enseignant ne connaît pas la ou les langues des élèves, certaines précautions peuvent être prises qui là encore impliquent une formation relativement légère des enseignants, non pas à telle ou telle langue particulière, mais à la place du français dans la typologie linguistique.
La langue première en position subliminale.
Qu’on me permette de partir d’une expérience personnelle. En 2004, le principal d’un collège de Cayenne, que je connaissais indirectement, me sollicita pour étudier un cas qu’il jugeait préoccupant. Il s’agissait de deux sœurs chinoises – appelons-les A et Q – scolarisées en cinquième. Comme tous les élèves dits primo-arrivants, elles bénéficiaient d’un certain nombre d’heures d’apprentissage du français dans le cadre de la CLA (Classe d’Accueil), avec d’autres jeunes immigrés, pour la plupart Brésiliens. Au bout de quelques mois, leur niveau de français avait si peu progressé que leur intégration dans le cursus scolaire et dans le groupe d’élèves devenait problématique. A part les mathématiques et un peu la géographie, toutes les disciplines leur semblaient fermées. L’idée de demander l’avis et si possible l’aide d’un linguiste s’était ainsi fait jour dans l’équipe pédagogique. Avant toute intervention, je précisai que la réputation qui m’avait été faite de parler chinois était tout à fait exagérée, et que, sans être totalement nulles, mes connaissances ne dépassaient pas le niveau Assimil.
Je fais ainsi la connaissance de deux jeunes personnes travailleuses, mais en proie à une insécurité linguistique majeure. Elles ont parfaitement conscience de leurs difficultés, et cherchent à les surmonter par un recours permanent au dictionnaire bilingue, feuilleté et annoté dans les marges, avec en complément des cahiers de vocabulaire qu’elles remplissent frénétiquement. J’observe une excellente écriture des caractères latins, et je me rends compte que certaines particularités de l’orthographe française, en particulier la non-prononciation des finales de pluriel en –s ou –nt sont admises sans problèmes. Sachant que l’une des principales différences entre le chinois et le français est l’existence d’une morphologie verbale dans la seconde langue, je propose une première activité de grammaire comparée.
Il s’agit d’une mise en regard des paradigmes de conjugaison au présent d’un verbe français (en l’occurrence : marcher) et de sa traduction chinoise (zǒu). Dans les deux cas, les pronoms sujets sont présents : la communauté d’un système de trois personnes a quelque chose de sécurisant (on ne parle pas n’importe comment) et je vois que mes interlocutrices ont déjà bien intégré certaines particularités du français : l’opposition de genre à la 3ème personne, et le fait que les pronoms pluriels nous et vous ne sont pas les pluriels réguliers de je et tu, contrairement à ce qui se passe en chinois (wǒ-men, nǐ-men). Mais quand je fais constater l’alternance des suffixes verbaux du français, face à l’invariabilité du verbe chinois, A se lève, va fouiller dans son sac, et en extrait son manuel de français de sixième, qu’elle ouvre à la dernière page, en me demandant : c’est de ça que vous parlez ?
Effectivement, on trouve sur ces dernières pages quelques tableaux de conjugaison : être, avoir, chanter, finir, et trois verbes du troisième groupe. En questionnant A et Q, je me rends compte que pendant tous ces mois aucun de leurs enseignants, même celle de CLA, ne les a renvoyées explicitement à ces paradigmes, et qu’elles les avaient bien repérés en feuilletant leur manuel, mais sans comprendre de quoi il s’agissait. Suite à cette découverte, je leur propose une lecture à haute voix du paradigme, suivie d’une application à d’autres verbes du premier groupe, récités oralement. Visiblement, elles renouent ainsi avec des pratiques pédagogiques auxquelles elles étaient habituées dans le système éducatif chinois.
La deuxième séance est l’occasion d’une nouvelle découverte. Depuis qu’elles utilisaient – et avec quelle conscience ! – leur dictionnaire bilingue, A et Q n’avaient jamais fait attention au fait que dans la partie français-chinois apparaissaient après chaque item nominal les notations n.m. ou n.f. La catégorie du genre était pour elles un domaine de perdition, et j’étais le premier à leur apporter une bouée, à savoir : le nom peut être masculin (yángxìngde) ou féminin (yīnxìngde)
Le premier jour, j’avais par erreur utilisé les termes appliqués au sexe des animés (nánde et nǚde). Par courtoisie (ou par méconnaissance de la terminologie grammaticale) A et Q ne m’avaient pas corrigé, mais de toute façon elles avaient immédiatement compris la règle, et c’est bien l’essentiel. ; en principe il y a une relation au sexe dans le cas des animés, pour les inanimés on ne peut rien prévoir, mais ce qui est sûr, c’est que selon que le nom est marqué n.m. ou n.f. on aura des conséquences prévisibles dans les adjectifs et les déterminants. On fait aussitôt quelques exercices d’application avec les articles et les possessifs
Avec des noms commençant par une consonne, pour éviter au moins dans un premier temps l’apparition perturbante de mon devant un nom féminin (mon école). Le nombre insuffisant de séances ne nous a pas permis d’arriver à ce complément d’information., au grand plaisir d’A et Q qui avancent désormais en terrain sûr.
Au cours des séances suivantes sont abordés d’autres points. La morphologie des verbes irréguliers est bien admise (malgré l’absence de morphologie dans leur langue première). On peut encore produire des barbarismes, mais l’essentiel est qu’on ait compris l’existence même de la conjugaison, et les paradigmes – un peu comme la table de multiplication – garantissent un recours possible à la forme grammaticale. On peut ainsi embrayer sur la formation du passé composé (je cherche à leur intention dans mon dictionnaire chinois les termes grammaticaux pour passé composé, participe passé et auxiliaire). Quelques exercices sur les accords de genre et de nombre permettent de clarifier les choses : Q propose Les garçons écrit une lettrent, mais se corrige après discussion avec sa sœur qui avait mémorisé et la position de l’accord, et le paradigme d’écrire. Je propose par ailleurs un tableau comparatif de la conjugaison d’un verbe transitif avec les pronoms sujets et objets, ce qui provoque à la fois la stupéfaction – car personne ne leur avait explicité la double différence avec le chinois : le pronom objet arrive avant le verbe et est différent du pronom sujet – et la satisfaction de s’amuser à produire sans erreur toutes les combinaisons possibles.
Pour diverses raisons, je n’ai pu assurer que quatre séances et je regrette en particulier de ne pas avoir travaillé la phonétique. J’ai su par la suite que Q, malade et dépressive, était retournée en Chine mais que A était restée et avait atteint un niveau honorable. S’il y a un enseignement à tirer de cette expérience, c’est bien que pour une partie au moins des apprenants l’explicitation des paradigmes morphologiques et des règles de syntaxe doit être un élément important de l’apprentissage. Le problème de ces deux jeunes filles était que leur première et jusque-là seule expérience du langage s’était faite à travers une langue isolante, sans morphologie. Elles étaient suffisamment sérieuses pour affronter la difficulté des paradigmes, et pour les apprendre par cœur, mais encore fallait-il que les méthodes d’apprentissage leur ouvrent la voie en leur explicitant certaines particularités imprévues de la langue seconde, et en les aidant à faire la part de ce qui n’a pas de justification rationnelle (« ce nom est féminin ; le suffixe de pluriel verbal est –nt ; ce verbe est irrégulier… ») et de ce qui même à l’intérieur de l’arbitraire garde de la cohérence et de la prévisibilité (les accords de genre et de nombre).
Le diagnostic était assez clair. Dans le cadre de la CLA, elles avaient reçu une initiation au français dans une version quelque peu extrémiste de l’approche communicative, reposant sur une simulation de situations concrètes, avec jeux de rôles, visant à développer diverses compétences définies comme objectifs langagiers : se présenter, demander un renseignement, interrogation et réponse sur une quantité, une localisation spatiale, un déroulement temporel, expression de l’appartenance, de la possibilité, etc.
On comprend les raisons de préférer une telle approche à des pédagogies traditionnelles dans lesquelles la grammaire jouait un rôle essentiel. Il s’agit de permettre à l’apprenant de « se débrouiller » dans la vie réelle, au contact de locuteurs utilisant la langue au quotidien. Mais en l’occurrence, l’approche communicative qui avait donné des résultats à peu près satisfaisants avec leurs camarades brésiliens avait échoué avec ces Chinoises, aboutissant à l’opposé des objectifs poursuivis : elles n’avaient aucune confiance et aucune autonomie dans leur pratique du français, et elles étaient isolées dans leur classe. Deux facteurs essentiels avaient été négligés : la relation strictement linguistique entre le chinois et le français est extrêmement différente de celle qui existe entre le portugais et le français ; et le mode de structuration des connaissances auquel elles étaient habituées, avec classement, formulation et mémorisation d’items et de règles, les amenait à être désorientées par une pédagogie où ces principes étaient largement absents. Faute de compétences pour le second volet du problème, je me contenterai de quelques réflexions sur le premier.
Dans un contexte FLE, où l’apprenant est explicitement étranger et peut reprendre le cours de sa vie dans son pays d’origine, les exigences sur la connaissance de la langue seconde sont modulables selon les besoins. Sauf pour des professionnels (professeurs de français, traducteurs, cadres commerciaux…), le niveau supérieur (C2 du Cadre Européen Commun de Référence) n’est pas requis, et un niveau moyen (B1 ou B2) est satisfaisant pour des besoins touristiques voire pour une certaine convivialité. La clarté de la communication vaut satisfaction, la tolérance est la règle, et un étranger qui s’exprime avec peu de fautes s’attire un petit succès d’estime, surtout s’il est anglo-saxon. Dans un contexte FLS, défini par le caractère inéluctable de la présence du français dans la vie sociale, il y a très peu de tolérance pour les productions fautives, surtout à l’écrit, et l’on tend vers une exigence du niveau C2 (performances scolaires, aisance dans les démarches administratives, prise de parole, entretiens d’embauche etc.)
En juin 2011, le vice-recteur de Mayotte s’est ainsi permis d’exprimer publiquement l’opinion que les élèves mahorais devaient « s'exprimer couramment, sans accent, devant les gens qui vont leur donner un travail et devant l'ensemble de la société ».. Or dans ce contexte la proportion de classes sociales « défavorisées » (souvent mal à l’aise dans l’écrit) est beaucoup plus forte que chez les apprenants en F.L.E. Ajoutons que les allophones aggravent leur cas aux yeux des détenteurs de la norme s’ils sont citoyens français, ce qui comme nous l’avons vu se produit dans certaines zones ultramarines.
Pour introduire une certaine bienveillance et une certaine efficacité dans leur accès au français, il faut dépasser la conception des langues comme instruments de communication, mais aussi comme marqueurs identitaires et même comme véhicules de cultures. Elles sont tout cela, mais ces dimensions ne fondent pas une pédagogie qui réponde aux exigences sociales du contexte FLS, où l’on devrait conformer aux principes, strictement linguistiques :
que toute langue, et donc le français comme la langue première de l’apprenant, est une construction intellectuelle qui permet de faire du sens
que le bilinguisme est une harmonisation de deux manières de construire le sens
que dans ces conditions le français n’est pas un « absolu » linguistique auquel tout être parlant et raisonnable aurait automatiquement accès, mais une langue particulière avec des spécificités
que ces spécificités sont autant de « stratégies significatives » face auxquelles une autre langue peut présenter des alternatives
que l’enseignant doit donc avoir, sous des formes qui restent à définir, des éléments de connaissance des solutions alternatives existant dans d’autres langues, qui lui permettent d’évaluer – sans les surestimer ni les sous-estimer – les difficultés rencontrées
que le lieu nodal de la signification est bien la grammaire plus que le lexique
Ce dernier point est capital. La modulation de l’enseignement du français comme langue seconde doit prendre comme curseur le critère proximité-éloignement, et y donner une place majeure à la typologie (Launey 2008, Sörés 2008
Anna Sörés montre comment prendre en compte la dimension typologique, mais presque exclusivement à partir de langues européennes (le hongrois ne présentant finalement qu’une altérité relativement modérée), et en visant clairement un public universitaire. Il s’agit ici de prendre en compte aussi des langues de très grande altérité, et de penser à des apprenants très jeunes et à leurs enseignants.). Il existe en effet par rapport au français :
(1) des langues de proximité, comme les langues romanes, avec une altérité plutôt faible de la grammaire, et des similarités lexicales qui se prêtent à construire des correspondances phonétiques
(2) des langues d’altérité moyenne, comme la plupart des langues indo-européennes, où les parentés lexicales sont moins évidentes mais où l’on retrouve certaines constantes grammaticales
(3) des langues de grande altérité, comme le chinois et la majorité des langues d’Outre-mer (amérindiennes, mahoraises
Le shimaore, variante de comorien, est une langue bantoue ; le kibushi est une variante de malgache., polynésiennes, mélanésiennes) ; cette grande altérité est elle-même très plurielle : type isolant ou morphologie foisonnante, manque ou organisation très différente des catégories grammaticales (genre, nombre, aspect-temps, détermination…), répartition différente des classes de mots, ordre des mots, etc.
(4) des langues que l’on peut appeler de fausse proximité, en l’occurrence les créoles à base lexicale française, caractérisés par un vocabulaire très majoritairement d’origine française (avec des évolutions phonétiques parfois minimes), mais une grammaire entièrement différente : perte de l’essentiel de la morphologie (donc langues isolantes), avec absence de genre et invariabilité des pronoms, reconstitution d’un système verbal à partir de particules (le plus souvent issues d’auxiliaires ou de prépositions) marquant le temps et l’aspect, tendance à recatégoriser les adjectifs comme sous-classe des verbes plutôt que sous-classe des noms, etc.
Selon le type de langue première, ce ne sont pas nécessairement les mêmes chemins qui assurent le passage le plus facile et le plus efficace vers le français. Les programmes de langues vivantes étrangères pour francophones organisent l’acquisition de la langue nouvelle sur la connaissance préalable du français. Mais enseigner le français (ou une autre langue) à des groupes linguistiquement hétérogènes est toujours un défi pédagogique. Il ne peut être relevé que si l’enseignant, outre sa capacité à animer des activités communicatives, est surtout pleinement conscient de ce qui, dans certains traits grammaticaux ou phonologiques du français, ne va pas de soi pour tout être humain ayant développé le langage dans n’importe quelle autre langue. Il est bon de savoir, par exemple, que les voyelles arrondies d’avant ([y], [ø], [œ]), sans être d’une grande rareté, sont tout de même absentes de la majorité des langues du monde, et les éléments de base de la phonologie (tableau des consonnes et des voyelles) ne sont pas toujours présentes dans la formation des professeurs des écoles, ce qui leur occulte la raison de certaines productions réputées fautives et ne leur permet pas de trouver les « remédiations » adéquates. De même, un programme de FLS à l’intention des jeunes enfants, s’il ne peut pas expliciter les règles de grammaire (au moins dans le livre de l’élève), se doit au moins une certaine prudence dans la progression, sans quoi les données arrivent dans la tête des enfants en se bousculant de façon désordonnée, le mettant dans l’impossibilité de se construire des régularités. Je prendrai comme exemple le manuel Langage en fête, qui a été la Bible des professeurs des écoles de Guyane pendant quelques années après 2003
Il avait au moins pour qualité de sécuriser l’enseignant qui doit exercer dans un milieu totalement allophone. Sa disparition progressive a fait plus de mal que sa présence, et j’en suis venu à le défendre malgré ses défauts..
Il est organisé sur la distinction entre objectifs langagiers (acquisition des actes de langage) et objectifs linguistiques (acquisition des formes grammaticales et lexicales du français qui permettent de réaliser les actes de langage), les seconds étant clairement subordonnés aux premiers. Or on peut se demander si un enfant de six à huit ans, qui parle déjà une langue quelle qu’elle soit, a vraiment des problèmes pour « se présenter, demander un renseignement, exprimer une localisation spatiale, identifier un objet, etc. », et si la véritable difficulté, conditionnant sa réussite scolaire et sociale, n’est pas la formulation en français de ces actes de langage. On sait par ailleurs que par un effet pervers l’inadéquation de l’expression en français (objectif linguistique) risque d’être évaluée comme un échec de l’activité langagière en général (objectif linguistique), et de reporter sur la dimension psychologique ce qui n’est qu’une mauvaise maîtrise de la langue seconde. Les enseignants et les auteurs de manuels de FLS devraient ainsi être attentifs à des points tels que :
La catégorie du genre, telle qu’elle existe en français (deux classes de noms + phénomènes d’accord) ne va pas de soi, et l’on entretient la confusion si par exemple on ne donne que vieille et vieil (masculin devant voyelle) mais jamais vieux : comment peut-on comprendre qu’on accepte un vieil oiseau, mais pas un vieil vélo ?
La répartition des déterminants en français, et leur existence même, ne va pas de soi, et l’on entretient la confusion en présentant des alternances avec certains usages improbables (Qu’est-ce que c’est ? – C’est une tortue, un bec, une queue, un rocher, la plage, l’océan, un trou, de la pluie…)
La complexité morphologique peut être acquise, mais il est bon de frayer les chemins qui mèneront au choix judicieux de je, me, moi, mon, ma, ou mes là où un créole ou une langue d’Extrême-Orient aura toujours la même marque de 1ère personne ; ou encore de construire les dialogues et les exemples de telle sorte que certaines formes ambiguës ne soient pas source de confusion durable (elle, pronom clitique dont le masculin est il, ou tonique, masculin lui ; lui, pronom tonique, féminin elle, ou pronom objet indirect des deux genres…)
Le passé composé peut être acquis, et les irrégularités morphologiques aussi, mais on entretient la confusion s’il est introduit d’abord avec des verbes qui ont pour auxiliaire être (il est monté), et si la première introduction d’avoir comme auxiliaire est précisément avoir lui-même (il a > il a eu, incitant à former sur ce modèle il chante > il chante eu…)
Pour se faire une conscience plus claire des points de la grammaire française qui ne vont pas de soi, et pour aménager une progression plus réfléchie, il n’est pas besoin de savoir parler beaucoup de langues, mais de connaître quelques éléments de typologie générale. Pour permettre à l’apprenant de se construire comme bilingue, il s’agit de reconnaître, non seulement que l’apprenant a sa propre langue, mais aussi que cette langue est une langue, qui a des propriétés spécifiques. La connaissance proprement linguistique et typologique prônée ici devrait entrer dans la formation des enseignants qui s’adressent à de jeunes enfants allophones, et l’expérience prouve qu’elle n’y prend pas forcément une part excessive
Mon expérience personnelle dans la formation initiale (IUFM) et continue (DAFOR) montre que 20 à 25 heures suffisent à aborder l’ensemble des problèmes..
Bibliographie
Balsiger C., Bétrix Köhler D., de Pietro J.F., Perregaux C. (dir.), 2012 Eveil aux langues et approches plurielles, Paris, l’Harmattan.
Bolus M., 2009 L’enseignement du créole en Guadeloupe, Thèse, Université Antilles-Guyane.
Candelier, M., 2003 L’éveil aux langues à l’école primaire, Bruxelles, De Boeck.
CASNAV Guyane 2003 Langage en fête (GS-CP-CLIN), SCEREN-CRDP de Guyane.
Crouzier M.F., 2007 « Inclusion scolaire et médiateurs culturels bilingues : l’expérience guyanaise », in Mam-Lam-Fouck S. (dir.) Comprendre la Guyane d’aujourd’hui, Cayenne, Ibis Rouge éditions, p. 453-464.
Cuq, J.P., 1991 Le Français langue seconde – Origines d’une notion et implications didactiques, Paris, Hachette.
Gardin, B., 1975 « Loi Deixonne et langues régionales: représentation de la nature et de la fonction de leur enseignement » Langue française n° 25 p. 29-36.
Georger F., 2006, Créole et français : deux langues pour un enseignement, Saint Paul de la Réunion, Ed. Tikouti.
Goury L., Launey M., Queixalos F., Renault-Lescure O. (2000) « Des médiateurs bilingues en Guyane française », Revue française de linguistique appliquée n° V-1, p. 43-60.
Hélot C., 2007 Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école, Paris, L’Harmattan.
Kervran M. (dir.) 2006 Les langues du monde au quotidien, 2 vol. (Cycles 2 et 3), SCEREN-CRDP de Bretagne, Rennes.
Laroussi, F. et Liénard, F. (dir.), 2011 Plurilinguisme, politique linguistique et éducation : Quels éclairages pour Mayotte ? P.U. Rouen-Le Havre
Launey M. 2008 « La typologie maîtrisant Babel : français langue seconde et langues premières des élèves de Guyane », 17th biennal conference of the SCL with the SPCL, 28-31 July 2008, support DVD, Society for Caribbean Linguistics.
Launey M. et Puren L., 2010 « Josiane Hamers à la rencontre du plurilinguisme guyanais », Synergies – Monde n°7, p. 79-96.
Léglise I. et Migge B. (dir.), 2007 Pratiques et représentations linguistiques en Guyane, Paris, IRD-Editions.
Maurer, B., 2007, De la pédagogie convergente à la didactique intégrée, Paris, L’Harmattan.
Perregaux, C, de Goumoëns C., Jeannot D., de Pietro J.F. (dir.) 2003 EOLE :Education et ouverture aux langues à l’école, 2 vol. CIIP, Neuchâtel.
Prudent, L.F., Tupin, F. et Wharton, S. (dir.), 2005 Du plurilinguisme à l’école, Berne, Peter Lang.
Puren, L., 2004 L’école française face à l’enfant alloglotte, Thèse, Université Paris III.
Sörés, A., 2008 Typologie et linguistique contrastive : théories et applications, Berne, Peter Lang
Verdelhan-Bourgade, M., 2002 Le Français de scolarisation, pour une didactique réaliste, PUF.
Vernaudon, J. et Fillol, V. (dir.), 2009, Vers une école plurilingue dans les collectivités françaises d’Océanie et de Guyane, Paris, L’Harmattan.
PAGE \* MERGEFORMAT1

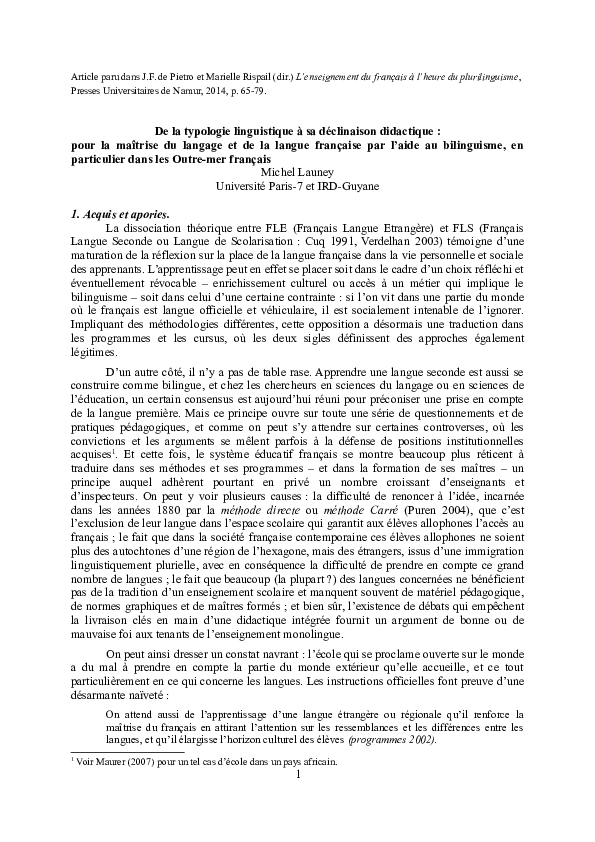
 nicole launey
nicole launey